
1830-1831-1839 : indépendance de la Belgique et du Grand-Duché : faits méconnus

|
|
Le 27 septembre 1830
Un drapeau commémorant la participation des citoyens de multiples communes à la révolution. Le choix des cités et des villages illustre et confirme le caractère national de la fête du 27 septembre. Voici la liste trop peu connue de ces communes.
Tout d’abord les francophones (sic – en fait, à cette époque en majorité wallophone): Andenne, Ans et Glain, Arlon, Ath, Bastogne, Binche, Bouillon, Brainel’Alleud, Braine-le-Comte, Charleroi, Châtelet, Couvin, Dinant, Dour, Enghien, Ensival, Fayt-lez-Manage, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Gembloux, Genappe, Gosselies, Gràce-Montegnée, Grez-Doiceau, Hermée, Herstal, Herve, Hodimont, Huy, Ixelles, Jemappes, Jemeppe-sur-Meuse, Jodoigne, La Hestre, La Hulpe, Leuze, Liège, Luxembourg, Maffle, Meslin-l’Evêque, Mons, Morlanwelz, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Péruwelz , Perwez, Philippeville, Quaregnon, Quiévrain, Rebecq-Rognon, Saint-Ghislain, Saintes, Sclayn, Seneffe, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Waterloo, Wavre. On y ajouta Paris en gratitude envers la France.
Et voilà les communes alors à majorité néerlandophone: Aalst, Aarschot, Anderlecht, Antwerpen, Boom, Brugge, Bruxelles, Dendermonde, Diest, Geel, Gent, Geraardsbergen, Halle, Hasselt, Herenthout, Herzele, Heverlée, Kortrijk, Leuven, Lier, Maaseik, Meerhout, Menen, Mol, Molenbeek, Oostende, Overijse, Roermond, Roeselare. Ronse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Tielt, Venloo, Watermael-Boisfort, Westerloo.
Dès le matin du 27 septembre 1830, Bruxelles s’éveille au son des cloches et des salves d’artillerie. La place Royale est envahie par la foule, on se presse aux fenêtres pour assister à l’arrivée de l’émouvant cortège des blessés de septembre 1830. On en compte quatre cents qui, partis de l’hôtel de ville, atteignent la place Royale précédés par une fanfare et und étachement e cavalerie.
|
|
1830 |
Alfred Dubru, Houffalize et l’indépendance belge, GSHA, 51, 2000, p.26-35
(p.27) De jeunes Ardennais n’hésitèrent pas à rejoindre Bruxelles. On ne connaît que les noms de quelques-uns de ceux qui se battirent dans la capitale.
|
|
1830
|
Christian Laporte, Constitution – 175 ans / « Un modèle au siècle des nationalités », LB 07/02/2006
En quoi, la Constitution belge fut-elle si originale? Pour son pôle des libertés et son pôle parlementaire. On n’imaginerait plus une Constitution qui n’évoquât les droits et les devoirs mais notre originalité fut de l’insérer directement dans la loi fondamentale. A l’époque, la mode était plutôt à la rédaction de préambules ou de déclarations de droits avec des discussions récurrentes et agaçantes sur la force de leurs dispositions respectives. C’étaient des morceaux de littérature mi-politique, mi-juridique. On y eut encore recours pour la Constitution française de 1958 avec un renvoi à celle de 1946 qui renvoyait elle-même à 1789. Plus près de nous, il y a la charte européenne. Nos pères fondateurs ont été originaux dans la mesure où ils ont associé droits et devoirs et aussi gouvernants et gouvernés -je préfère le terme de citoyens… Les uns et les autres se rendirent compte que la Constitution leur appartenait au premier chef. Au-delà des principes généraux, elle donnait des lignes de force en matière de libertés d’enseignement, des cultes, de la presse, d’association. Plus personne ne pourrait contester le caractère juridique de ces droits. T Puis, il y a le pôle parlementaire. Gare à l’équivoque : beaucoup croient que quand on a un Parlement, il y a automatiquement un régime parlementaire. C’est oublier, que dans les pires dictatures, il y a aussi des Parlements. Mais ils ne connaissent pas la révocabilité mutuelle.
Chez nous, la Chambre peut renverser le gouvernement et ce dernier a la capacité de la dissoudre. De vrais régimes parlementaires ne sont pas légion. Les Etats-Unis, par exemple, n’en sont pas un puisque le président ne peut dissoudre le Congrès et celui-ci ne peut pas le renverser directement.
|
|
1830 |
Jo Gérard, La première campagne électorale en Belgique, LB, 12/05/1995
Les Belges votèrent le 3 novembre 1830. Il y eut 380429 électeurs ‘censitaires’ et 7.670 ‘capacitaires’. La constitution la plus démocratique d’ Europe. Les députés du Congrès national décidèrent que notre futur roi ne disposerait d’ aucun pouvoir sans la signature d’ un au moins de ses ministres, mais que ceux-ci ne pourraient rien sans la signature royale.
|
|
1830 |
Jo Gérard, Les mythes belges, LB 08/08/1995
Anne Morelli (ULB) n’aura jamais fini de nous amuser, surtout quand elle écrit qu’il ne se passa rien, le 27 septembre 1830. Ce matin-là, des milliers de nos jeunes volontaires partirent à l’assaut du Parc où étaient retranchés 10.000 soldats hollandais. Nos volontaires étaient prêts à risquer leur vie car ils ignoraient encore que leurs adversaires avaient fui durant la nuit. Il ne se passa rien, le 27 septembre 1830 ? .. Anne Morelli tient-elle pour rien les souffrances de nos centaines de blessés dans les hôpitaux bruxellois, ce jour-là ? M. Franck a raison de mettre en valeur le texte de Stengers, qui s’est basé sur la thèse de doctorat du professeur Demoulin, parue il y a quarante ans : « Les journées de septembre 1830 ». Mais n’oublions pas le rôle décisif en 1830 de la garde bourgeoise composée de 4.000 bourgeois bruxellois commandés par le baron Van der Linden d’Hoogvorst. Oui au caractère populaire de notre révolution, oui aussi à son caractère bourgeois. Quant à Godefroid de Bouillon, Isabelle Wanson semble ignorer les archives prouvant que, tant au nord et au sud de notre pays, comtes, barons et chevaliers vendirent leurs domaines pour équiper leurs hommes, que ces nobles qui ne s’étaient jamais vus, firent connaissance dans l’armée de Godefroid de Bouillon où les rassemblaient les mêmes convictions. D’où cette unité de foi dontj’ai parlé. Par ailleurs, natif de Boulogne, Godefroid était duc de Bouillon et marquis d’Anvers, donc bien enraciné dansle « chez nous » de son temps.
|
|
1830 |
Jo Gérard, Souvenirs de 1830, II Le son du canon
Et le prince d’Orange? Il se replie sur Anvers non sans voir ses troupes attaquées sans cesse par des partisans d’une rare audace.
IV La révolution en province
Les paysans flamands de Berthem, d’Heverlee, de la région de Diet et d’Aarschot (JG: Aerschot) accourernt aucombat, tandis que sonne le tocsin de leurs églises. un historien nous la décrit (= réaction des masses flamandes): « La promptitude avec laquelle le peuple flamand se soulève, chasse l’armée, et balaie les ministériels est l’indice le plus sûr que les sentiments belges de la population préexistaient mais refoulés par l’appareil militaire et judiciaire. » Il ne faut pas frustrer les Belges de leur révolution de 1830 et prétndre que sans les Français elle aurait échoué. Fait toujours passé sous silence à paris, les nombreux clubx républicains, bien que tenus au courant des événements de Belgique par nos concitoyens De Potter et bartels, se gardent d’envoyer des renforts à nos compatriotes qui se battent si rudement et risquent le tout pour le tout.
|
|
1830 |
Léon Vander Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, s.d.
(p.203) XXIV LES JOURNEES DE SEPTEMBRE 1830
S’EST-ON déjà demandé comment, pendant les journées de septembre 1830, le prince hollandais Frédéric d’Orange et ses troupes, chargés par le roi Guillaume de mettre fin à l’émeute qui avait suivi la représentation de la Muette de Portici, furent battus par les « volontaires »; comment des soldats et des généraux qui avaient servi dans les armées napoléoniennes durent honteusement se retirer devant des combattants improvisés et rendre ainsi possible le triomphe de la révolution ? C’est ce que nous nous proposons d’expliquer ici. L’émeute qui suivit la représentation de la Muette de Portici au Théâtre de la Monnaie, et dans l’origine de laquelle des émissaires français, envoyés par des clubs parisiens qui désiraient provoquer l’annexion de la Belgique à la France, avaient incontestablement eu (p.204) la main, ne fut au début, comme l’écrit Gendebien lui-même, qu’ « une mauvaise farce d’écoliers ». Dans la nuit, grossie de contingents d’ouvriers chômeurs et de chenapans sortis des bas-fonds de Bruxelles, la foule des manifestants se livra à des actes de pillage, d’incendie et à des excès que les promoteurs du mouvement n’avaient pas prévus. Une commission de notables se réunit le lendemain et organise, sous la direction du baron van der Linden d’Hoogvorst, une garde bourgeoise et rétablit l’ordre. Personne ne songe en ce moment à se séparer de la Hollande. Les bourgeois qui ont mis fin à l’émeute envoient une délégation à La Haye, chez le Roi, pour lui montrer qu’il est de son devoir d’aider les « bons citoyens » et de réaliser enfin le redressement des griefs que les Belges réclamaient de lui avec tant d’insistance depuis 1828. Le roi Guillaume écouta ces délégués et promit de pourvoir à la disparition des griefs par « voie constitutionnelle » : il fit cependant entendre qu’il ne pouvait capituler devant une émeute et que d’abord l’ordre devait être rétabli. A la nouvelle des événements du 25 et du 26 août, le Roi avait décidé instantanément d’envoyer en Belgique ses deux fils, les princes Guillaume et Frédéric d’Orange, pour « y dompter la révolte » avec l’aide d’une petite armée. Il fournit ainsi des armes au parti des extrémistes (p.205) qui, à la différence des modérés du genre d’Hoog-vorst, ne voulaient pas d’ « opposition légale », mais qui tendaient à la séparation des deux pays, avec l’espoir d’être soutenus par la France. Ce sont les proclamations enflammées et les excitations de ces extrémistes qui firent accourir dans Bruxelles des volontaires armés, parmi lesquels se distinguent, dès le premier jour, les bouillants Liégeois conduits par Charles Rogier. Alors que les modérés attendent patiemment les suites de leur visite à La Haye et s’efforcent, par tous les moyens, de retenir le peuple dans la «légalité», les extrémistes et les volontaires prennent peu à peu le dessus. Ces derniers créent le « Club de la Réunion centrale », analogue aux clubs d’agitation politique existant à Paris; les discours violents qu’y prononcent Rogier, Ducpétiaux, le Français Chazal amènent le peuple à envahir subitement l’Hôtel de Ville de Bruxelles et à en chasser les modérés. Les extrémistes, les partisans de la séparation l’ont emporté. Cette nouvelle ne surprit pas le roi Guillaume : il donna l’ordre à ses troupes de marcher sur Bruxelles et d’ occuper la capitale. * * * La lutte va donc s’engager entre les « volontaires » et l’armée royale. C’est le 20 septembre. Les chefs du mouvement, effrayés à la nouvelle de l’approche des troupes du roi Guillaume et convaincus que le bas peuple, les paysans, les mineurs wallons et les étrangers (p.206) dont se composent les bandes de « volontaires » sont incapables de défendre la ville, estiment la cause perdue et s’en vont : Van de Weyer et Rouppe se rendent à Valenciennes, bientôt rejoints par Van der Burght, Moyard, Fleury, Van der Smissen, Van der Meeren, Levae et Niellon. Félix de Mérode se retire dans son château de Trelon; Vleminckx et P. Roden-. bach se réfugient à Lille. Le dernier à partir fut Charles Rogier : après avoir erré comme un fou, se demandant ce qu’il devait faire, il finit par s’enfoncer dans les taillis de la forêt de Soignes au moment où le canon hollandais tonna à la porte de Schaerbeek. Le baron van der Linden d’Hoogvorst ne voulut pas quitter Bruxelles : aidé de Charles Pletinckx, un ancien officier de cavalerie, et d’André Jolly, qui avait déjà essayé, avant lui, d’organiser une autorité responsable, il va diriger la défense de la capitale. Abandonnés par les chefs politiques, les « volontaires » décidèrent de vendre chèrement leur vie. Une femme du peuple remarqua pittoresquement : « Maintenant on ne voit plus ces messieurs en redingote qui siégeaient à l’Hôtel de Ville. Quand il s’agit de se battre, on ne voit plus ces damnés gaillards. Ce sont les « blouses bleues » qui doivent défendre Bruxelles! » Les paysans venus des environs de Bruxelles et du Brabant wallon, les mineurs du Borinage, les volontaires liégeois et louvanistes, les ouvriers et le petit peuple (p.207) de Bruxelles furent disposés en ordre de combat, aux portes de la ville et aux barricades qu’on avait élevées, par l’Espagnol Don Juan van Haelen, Ernest Grégoire, l’ancien général français Mellinet, P. Parent, le vicomte de Culhat et Larivière. Le baron d’Hoog-vorst alla siéger à l’Hôtel de Ville. Le prince Frédéric et ses soldats, au nombre de 10.000, accompagnés de vingt-six pièces d’artillerie, sachant que les chefs du gouvernement avaient quitté Bruxelles, ne songeaient guère à se battre. Ils s’imaginaient qu’ils n’avaient qu’à montrer « leurs billets de logement » aux habitants pour être partout reçus. Le 23 septembre, à 7 heures du matin, les troupes royales se dirigèrent sur Bruxelles, réparties en quatre colonnes. La première de celles-ci, sous les ordres du général Schuurman, s’empara de la porte de Schaer-beek, poussa jusqu’au parc et occupa le palais. La deuxième colonne prit la porte de Louvain. La troisième réussit à se rendre maître de la porte d’Anvers, mais fut clouée sur place par le feu violent des volontaires. La quatrième colonne tomba dans une embuscade à la porte de Flandre et fut rejetée en désordre. L’avance des troupes royales se buta aux barricades de la Place Royale, défendues par environ 1.200 paysans et ouvriers, sous les ordres de Mellinet, Parent et de Culhat. S’y faisait remarquer surtout le Liégeois Charlier, surnommé « Jambe de bois », qui (p.208) servait sa pièce d’artillerie avec une véritable rage et qui semait la mort dans les rangs hollandais. Des hôtels qui entouraient la place des tireurs d’élite entretenaient une fusillade nourrie : les troupes royales furent obligées de se replier sur le Parc, laissant le haut de la ville aux mains des insurgés. Une grande faute fut commise par le prince Frédéric. Au lieu d’encercler Bruxelles avec ses troupes, renforcées au préalable par la cavalerie du général Cort-Heyligers qui courait sans but entre Louvain et Tirle-mont, il s’engagea imprudemment dans une bataille de rues, où l’assaillant est toujours en position défavorable. Les généraux du prince, convaincus qu’il faudrait prendre Bruxelles maison par maison, lui proposèrent le dilemme suivant : ou bombarder la ville ou se retirer. Le prince Frédéric s’indigna : il ne voulait pas verser le sang ou détruire Bruxelles. Indécis, il donna, vers le soir, l’ordre de cesser le feu et commit la faiblesse d’envoyer un parlementaire aux insurgés. C’était avouer son impuissance… . L’effet se fit immédiatement sentir. Les Hollandais s’étant retirés dans le Parc et sur les boulevards, autour de leur bivouac, les volontaires belges abandonnèrent tranquillement leurs barricades et leurs chefs et allèrent se désaltérer dans les « estaminets » voisins ! Comment le prince Frédéric n’en profita-t-il pas (p.209) pour s’emparer des barricades ? C’est ce que l’on ne comprend pas. Pendant la nuit, le baron d’Hoogvorst quitta en secret l’Hôtel de Ville et s’en alla au quartier général du prince hollandais pour l’engager à évacuer Bruxelles. Frédéric d’Orange répondit que c’était le Roi son père qui lui avait ordonné d’occuper la capitale, qu’il ne pouvait lui désobéir, mais que, ne désirant pas la ruine de Bruxelles, et dans l’intérêt de la bourgeoisie — qui s’était tenue tranquille — il se contenterait d’une attitude défensive. Si énorme que le fait puisse paraître, le prince tint parole : pendant les « trois jours qui suivirent, ses soldats ne quittèrent pas leurs positions ! La même nuit, Rogier, ayant appris le succès des volontaires, rentra à Bruxelles. En même temps que lui, des volontaires accoururent encore, venant de Haï, Genappe, Wavre, Nivelles, Binche; de la poudre à canon fut expédiée, le tocsin sonnait partout dans les campagnes brabançonnes. Le 24 septembre, à 9 heures du matin, le combat reprit, et sous^ forme nouvelle. Les chefs politiques, qui s’étaient réfugiés en France, revinrent l’un après l’autre à Bruxelles et Rogier installa avec eux à l’Hôtel de Ville une « Commission administrative » sous le baron d’Hoogvorst, pour donner plus de cohésion à la résistance. Il nomma le colonel espagnol Don Juan van (p.210) Haelen comme général des patriotes et dressa un plan d’attaque. On allait enfermer les Hollandais dans le Parc. Bientôt, des tirailleurs, s’étant glissés dans les hôtels de la rue de la Loi et de la rue Royale, firent pleuvoir de là une grêle de balles sur les troupes qui se trouvaient, presque à découvert, dans le Parc. Le prince Frédéric ordonna alors de tirer au canon sur la ville. Ces coups de canon secouèrent la bourgeoisie, qui jusque-là s’était tenue en dehors du mouvement, tremblant derrière ses portes et fenêtres hermétiquement closes. Ce réveil fut encore accentué par une proclamation des volontaires annonçant aux habitants que les Hollandais allaient se livrer au pillage des maisons. Cette fois, les bourgeois bougèrent et beaucoup vinrent rejoindre le peuple aux barricades. Le courage des volontaires en fut considérablement augmenté. Même, sur l’ordre de Rogier, Don Juan van Haelen déclencha une violente attaque, mais il fut repoussé. La « Commission administrative » siégeant à l’Hôtel de Ville fit alors connaître aux volontaires qu’on élèverait aux tués un monument national sur la place Saint-Michel (maintenant la place des Martyrs). Les Hollandais s’étaient tenus immuablement sur la défensive : ils avaient même perdu du terrain. Le dimanche 26 septembre, le prince Frédéric avait complètement perdu courage : les Belges qui faisaient partie de ses troupes, impressionnés par la victoire des (p.211) volontaires, s’étaient mis à déserter. Enfin, la bataille ayant provoqué de nombreux incendies, le palais des Etats Généraux et le palais royal menacèrent de prendre feu. Le fils du roi Guillaume estima alors que les instructions de son père étaient devenues inexécutables. Vers minuit, il donna l’ordre de retraite et fit évacuer en silence le Parc. Le lendemain, les volontaires constatèrent avec stupéfaction que l’ennemi avait décampé: 125 cadavres furent trouvés dans les allées du Parc de Bruxelles, et il semble que le nombre des blessés que les troupes royales emportèrent se montait à 2,000 environ. Quant aux volontaires, ils comptaient 450 morts et 1,300 blessés. Ce sont ces humbles combattants des « Journées de Septembre » qui sont les vrais créateurs de la Belgique indépendante.
|
|
1830 |
Léon Vander Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, s.d.
(p.221) LA REVOLUTION BELGE DE 1830 ET LES ORIGINES DIPLOMATIQUES DE NOTRE INDEPENDANCE LA Révolution belge de 1830 est l’aboutissement de la désunion progressive de la Belgique et de la Hollande, provoquée par la politique autocratique et inhabile de Guillaume Ier. Cette politique suscita finalement un mouvement de mécontentement dans toutes les classes de la population belge et fit naître l’Union catholico-libérale de 1828. Ce mouvement, où catholiques et libéraux belges s’étaient unis pour combattre le gouvernement despotique du Roi et pour obtenir des libertés et des garanties constitutionnelles comme Louis-Philippe allait en donner aux Français après la révolution de juillet 1830 à Paris, resta cependant dans les limites de la légalité, malgré les excitations du groupe francophile de Gendebien et les manœuvres des agents français, venus de Paris comme mandataires de coteries qui prônaient l’annexion de la Belgique à la France. A la veille de la Révolution belge, l’opposition au régime de (p.222) Guillaume I » était restée entièrement aux mains du groupe des modérés et des partisans de l’agitation légale qui se retrouvaient dans l’Union catholico-libé-rale. En germe depuis plusieurs années, la révolte éclata brusquement par suite de circonstances d’ordre secondaire et presque fortuites. C’est ce qu’il importe de remarquer et c’est ce que nous montrons dans les pages qui suivent. Les débuts de la Révolution se placent entre le 25 août et le 3 septembre 1830. Depuis la révolution de juillet à Paris, qui avait amené sur le trône le roi « bourgeois » Louis-Philippe, la population bruxelloise était restée surexcitée et cet état d’esprit n’avait pas manquer d’alarmer les représentants de l’autorité. Dans les cafés, des jeunes gens de la bourgeoisie avaient arboré des cocardes françaises : les nombreux ouvriers chômeurs étaient l’objet de sollicitations continuelles de la part d’émissaires des clubs politiques parisiens, de ces clubs qui visaient à l’extension de la France jusqu’au Rhin et dont Louis-Philippe avait grand-peine à comprimer l’audace, dangereuse pour sa tranquillité et sa situation vis-à-vis des Puissances de la Sainte-Alliance. Le petit groupe de Gendebien, en rapport avec ces clubs, se démenait sans trêve et des ambassades partaient continuellement pour Paris pour se tenir en contact (p.223) avec les agitateurs français. On n’avait pas l’idée de l’annexion à la France, mais on espérait obtenir l’appui de celle-ci pour arriver à redresser complètement les griefs dont se plaignaient les Belges. Le 17 août 1830, dans les milieux libéraux et francophiles . du « Courrier des Pays-Bas », on chochute que la France n’est pas prête à intervenir, qu’il est encore trop tôt, que l’autorité de Louis-Philippe n’est pas encore bien assise. Le même jour, on apprend que la révolution, que d’aucuns parmi le groupe Gendebien préparaient fébrilement, serait remise jusqu’au 15 septembre. De fait, on voit Gendebien calmer l’ardeur de ses partisans. Pendant ce temps, les modérés de l’Union catholico-libérale songeaient encore toujours à une forme d’opposition « légale, paisible et grave » : ils regardaient avec dédain et non sans amusement, dirait-on, l’agitation bruyante des francophiles. Il n’en reste pas moins vrai que l’atmosphère était chargée d’électricité : on sentait partout que « quelque chose se préparait » et qu’à la moindre occasion les extrémistes, les partisans de la manière forte, seraient prêts à frapper un coup. Le 24 août était le jour anniversaire de S.M. le roi des Pays-Bas : de grands préparatifs avaient été faits pour célébrer cette fête, un feu d’artifice devait être tiré porte de Namur et le parc de Bruxelles tout entier devait être illuminé. La population bruxelloise, loin de se réjouir, critiquait vertement la dépense de 7.000 florins (p.224) que ces festivités allaient coûter à une municipalité au budget déséquilibré et qui essayait de boucler ci budget en maintenant un impôt odieux sur le pain. Sur le mur du Palais des Etats Généraux, on pu> lire, tracée au charbon, cette menace, provenant sans •doute d’un partisan de la manière forte : Lundi, feu d’artifice; Mardi, illumination; Mercredi, révolution. Chose étonnante, ni les autorités civiles ni les autorités militaires ne prirent aucune mesure préventive : elles se contentèrent de décommander les fêtes sous prétexte de mauvais temps. Mais la municipalité n’osa pas, par crainte de désordres, interdire la représentation de La Muette de Portici, le nouvel opéra d’Aubcr, qui était annoncée pour le 25 août au Théâtre Royal de la Monnaie. Cet opéra avait eu beaucoup de succès : lorsqu’il fut joué pour la première fois le 12 février 1829, Guillaume I »r et la famille royale y avaient assisté et avaient donné le signal des applaudissements. Longtemps avant le commencement du spectacle, le soir du 25 août 1830, la salle était occupée par un public frémissant : on savait qu’un certain nombre de jeunes gens de la bourgeoisie avaient décidé de profiter de la représentation pour organiser une manifestation contre le pouvoir, c’est-à-dire contre les autorités hollandaises. Mais — il faut insister sur ce (p.225) point — on ne songeait pas à une révolution destinée à chasser les Hollandais. Sur la place, devant le théâtre, une foule compacte de badauds, où la populace était majorité, attendait les événements. Pendant la représentation, tous les appels à la liberté, chantés par Lafeuillade, qui incarnait Mazaniello, toutes les allusions patriotiques déchaînèrent des applaudissements. Après le quatrième acte la foule, électrisée, sortit du théâtre et se répandit sur la place. Des badauds se joignent à elle, une manifestation s’organise sur-le-champ. On voit dans ce cortège houleux et enthousiaste des émissaires français — qui s’imaginent que l’heure a sonné pour les plans d’annexion — des fils de famille, et même des garçons de 12 à 15 ans. C’est ce qui fit écrire à Gendebien, dans une lettre datée de cette soirée, que •« ce fut une mauvaise farce d’écoliers ». On saccagea les bureaux et l’imprimerie du National, l’organe officieux de Guillaume Ier, on pilla la maison du directeur du journal, Libry — un pamphlétaire français, que le roi avait pris à gages —, on finit par incendier les demeures du directeur de la police M. de Knijff, et du ministre de la Justice, Van Maanen, que les Belges considéraient comme « l’âme damnée », l’inspirateur des mesures réactionnaires du souverain. Bientôt, des bas-fonds de la ville arrive, pour se joindre aux manifestants, cette tourbe anonyme des gens sans aveu et sans moyens d’existence, qui sont toujours prêts à profiter des mouvements (p.226) populaires pour piller ce qui leur tombe sous la main. Levae, rédacteur du journal Le Belge, écrivant à De Potter, rend très bien la physionomie de cette première nuit de révolution : « A minuit, dit-il, le mouvement était encore con-» duit par des gens bien mis et honorables, mais à » 3 heures du matin, lorsqu’on a mis le feu chez Van » Maanen, tous ces gens comme il faut avaient dis-» paru. Je n’ai plus aperçu que l’écume de la société… » Ce peuple a bientôt senti sa force et en a profité, » non pour faire une révolution, comme l’avaient sans » doute espéré ceux qui l’avaient déchaîné, mais pour » faire ses propres affaires : il s’est mis à brûler les » fabriques, à briser les mécaniques, à piller, à dé-» vaster. » Affolées, les autorités constituées livrèrent la ville à l’émeute : le général comte de Bylandt, commandant de la province du Brabant, laissa ses troupes l’arme au pied; les autorités civiles ne bougèrent pas et la police ne tenta même pas d’empêcher les désordres. Le 26 août, les bourgeois eurent alors un sursaut d’énergie. Un étranger — un émissaire français — ayant arboré les couleurs françaises à l’Hôtel de ville, les bourgeois les arrachèrent instantanément et les remplacèrent, non par les couleurs néerlandaises, mais par les vieilles couleurs brabançonnes : noir, jaune, rouge, qui avaient fait pour la première fois leur apparition lors de la Révolution contre Joseph II, en 1789. Remarquons cet incident : il montre clairement que, (p.227) si des étrangers tentèrent un instant d’exploiter au profit de leur cause le mouvement populaire, la population les désavoua sur l’heure. Le baron Van der Linden d’Hoogvorst, un homme énergique, au tempérament calme et décidé, organisa une « garde bourgeoise », à laquelle fut provisoirement confié le maintien de l’ordre et la protection des propriétés tant publiques que privées. C’était rester dans les traditions : au XVIe et au XVIIIe siècle, lorsque la force publique ne fait pas son devoir ou outrepasse ses droits, c’est toujours la garde bourgeoise, institution plongeant ses racines jusqu’à l’époque des communes, qui maintient la sécurité dans la ville et protège la vie et les biens des citoyens. Le 27 août, grâce à l’énergie de la garde bourgeoise et aussi parce que la populace était fatiguée de ses excès, le calme se rétablit. C’est alors qu’une cinquantaine des principaux citoyens de Bruxelles se réunirent spontanément à l’Hôtel de ville, sous la présidence du baron de Sécus, le mentor des députés de l’opposition, pour délibérer sur la situation. C’est à partir de ce moment que commence réellement la Révolution : sous l’apparence de la légalité, et sans qu’on puisse méconnaître leurs excellentes intentions, ces citoyens s’arrogent en réalité un pouvoir extra-légal, posent, de fait, un acte révolutionnaire. Les autorités hollandaises, en effet, sont regardées dès lors comme inexistantes. (p.228) Ces citoyens paisibles ne sont cependant pas des extrémistes : ce sont des membres du parti des modérés, de l’Union catholico-libérale. Aussi, ils vont essayer de tirer parti des événements qui viennent de se dérouler, non pour provoquer la séparation de la Belgique et de la Hollande — ils n’y songent pas — mais pour poursuivre la réalisation du programme de redressement des griefs établi en 1828. Une adresse au Roi est rédigée et votée par acclamation : elle fut immédiatement envoyée à La Haye. On n’y trouve guère le langage de révolutionnaires: c’est Je langage d’hommes modérés et honnêtes qui, ayant dompté la révolte, supplient le Roi de les aider en faisant montre de bonne volonté à l’égard des Belges. C’est la politique de « l’opposition légale, paisf-blé et grave » dont on parlait en 1829 et au début de 1830. Il est à remarquer que ces modérés ont su garder prisonniers et forcer d’adhérer à leur mouvement des hommes comme Gendebien, qui étaient, au fond, des extrémistes, mais que la soudaineté des événements avait désemparés et forcés de se mettre provisoirement du côté des partisans de l’agitation légale et parlementaire. Ce que ces hommes demandaient à Guillaume Ier, ce n’était pas de consentir à la séparation des deux pays, mais de tenir compte des vœux de la population, qu’un imprimé anonyme fit connaître ce même jour, le 28 août. (p.229) L’avenir était dans les mains du Roi. Autoritaire comme il l’était, il lui semblait qu’il ne pouvait céder devant l’émeute : il se sentait d’ailleurs soutenu dans la voie de l’inflexibilité par. les gens de son pays qui, très contents du régime, ne parvenaient pas à comprendre toute cette agitation en Belgique. A la nouvelle des événements du 25 et du 26 août, le roi Guillaume avait instantanément décidé d’envoyer à Bruxelles ses deux fils, les princes Guil-Jaume et Frédéric, à la tête de 6.000 soldats. Mais, comme le roi était aussi hésitant en politique qu’il était obstiné dans ses idées personnelles, il ne donna pas aux deux princes des instructions précises : ils marcheraient sur Bruxelles, on verrait après ce qu’il y aurait à faire. Pendant ce temps, la députation de notables bruxellois envoyée à La Haye attendait impatiemment une réponse du Roi : celui-ci ne lui donna aucune indication définitive. Faute capitale, qui allait immédiatement fournir des armes aux extrémistes ! Cependant, les troupes hollandaises s’étaient approchées de la capitale : elles s’arrêtèrent à Vilvorde, où les princes Frédéric et Guillaume établirent leur quartier général. N’obtenant aucune réponse de La Haye, sentant que la direction du mouvement allait leur échapper — les journaux commençaient à exciter le public — les chefs des modérés, le baron d’Hoogvorst en tête, décidèrent de se mettre en rapport avec les princes hollandais. (p.230) Une entrevue eut lieu à Vilvorde, où Frédéric et Guillaume firent connaître les ordres qu’ils avaient reçus de leur père : ils allaient entrer dans la capitale à la tête de leurs soldats. Dès que cette nouvelle se répand à Bruxelles, une émotion intense s’empare de la population. On court aux armes et l’on voit des gens du peuple, aidés de bourgeois, se préparer à ériger dans les rues des’ barricades. Ce fut, dès lors, dans la masse du peuple, une attitude ouvertement révolutionnaire; les cocardes aux couleurs brabançonnes se multiplient, on se prépare à combattre. De plus en plus, l’idée de la résistance violente gagne du chemin. Aussi, les leaders des modérés sollicitent une seconde entrevue à Laeken, où les chefs des troupes hollandaises s’étaient installés. L’un des deux princes, le prince d’Orange, était populaire parmi les Belges : il n’avait point le caractère hautain de son père, il était jovial et enjoué, et, par là même, plus indiqué pour s’entendre avec la population. C’est auprès de lui que les délégués belges, le duc d’Arenberg et le prince de Ligne, firent un suprême effort. Le prince accepta de se rendre à Bruxelles, seul, pour y agir en médiateur. Il tint parole. On assista alors à une scène émouvante. Le prince s’avança à travers les rues de la capitale, sans escorte, entre les haies de gardes bourgeois en armes, au milieu (p.231) du silence impressionnant de la foule, que cette crânerie disposait à l’admiration. Arrivé à l’Hôtel de ville, il installa immédiatement une commission consultative, qui avait à suggérer une solution. Gendebien proposa alors une formule : la séparation administrative, législative et financière de la Belgique et de la Hollande, idée qui avait été mise pour la première fois en avant en 1829 par De Potter — alors en prison pour « crime de presse — dans sa fameuse Lettre de Démophile au Roi, Gendebien avait fait par- . tie, nous l’avons vu, de la députation de notables envoyés à La Haye après les désordres des 25-26 août. Au cours de cette mission, il avait eu un entretien avec le ministre Lacoste. Comme Gendebien lui avait parlé des griefs des Belges, le ministre lui répondit : « Si le Roi accorde satisfaction sur ces points, la Hollande se soulèvera ! » « Cette observa-» tion, écrivit Gendebien à De Potter, fut pour moi •» un trait de lumière et je conçus dès lors le projet » de la séparation du Nord et du Midi ». En présentant cette formule, Gendebien avait espéré que le prince d’Orange l’accepterait et qu’il se laisserait peut-être proclamer roi des Belges. Lorsqu’il découvrit cette pensée au fils de Guillaume Ier celui-ci refusa, indigné, mais il consentit à partir pour La Haye afin de plaider auprès de son père en faveur de l’idée de la séparation administrative. (p.232) Nous sommes maintenant au début de septembre, On attendait anxieusement la réponse que ferait le Roi à son fils, porteur des propositions belges. Hélas ! fidèle à son caractère et à sa politique hésitante, Guillaume se contenta de répondre que, le 13 septembre, il inviterait les Etats-Généraux à examiner « si les relations établies par les traités devaient changer de forme et de nature ». Ce procédé dilatoire, dit l’historien hollandais Colenbrander, « lui fit perdre la Belgique pour sa dynastie, alors qu’elle était déjà, en ce moment, perdue pour sa personne ». Ce qui aggrava la situation, c’est la guerre à coups d’épingles que se livraient les journaux hollandais et les journaux belges. Les diatribes de la presse du Nord devenaient de plus en plus dolentes et la presse bruxelloise les réimprimait avec complaisance, certaine qu’elle était de monter ainsi les têtes. A ces excitations venaient s’ajouter les alarmes qu’occasionnait la présence des troupes royales à deux lieues de Bruxelles. Le 5 septembre, à Tervueren, des patrouilles de la garde bourgeoise faillirent ouvrir les hostilités contre !es avant-postes du prince Frédéric. En quelques jours, tout le bon effet produit par les promesses du prince d’Orange et par l’espoir d’une séparation administrative s’en alla sans retour. Le mouvement contre le régime hollandais fit des progrès surprenants. Beaucoup de volontaires étrangers, de ces gens qui aiment les coups de mains et la violence, des Français, des Polonais, des Espagnols, des Italiens, (p.233) même des Anglais accourent pour renforcer la garde bourgeoise. Les autres villes suivent l’exemple de Bruxelles : Liège et Louvain, Mons, Charleroi, Namur, Bruges commencent à s’agiter. Spontanément, les villes de province offrent leur aide à Bruxelles : des paysans des Flandres, des ouvriers du Hainaut et du Borinage, des bourgeois de Namur, de Tournai et de Courtrai s’enrôlent comme volontaires. Toutefois, dans la première quinzaine de septembre, le calme règne encore dans l’ensemble des Flandres. A Gand et à Anvers on ne bouge pas : ce sont des centres « orangistes », où les grands fabricants sont fidèles aux Nassau. C’est ce qui fit dire à la presse : « Mes-» sieurs du commerce et de l’industrie ont peur que, le » divorce accompli, les Hollandais ne mettent l’Escaut » en bouteilles. » A Attdenarde, à Alost, à Lierre, en Campine, la population se tient tranquille : on y soupçonne les chefs du mouvement de vouloir chercher l’annexion à la France, et, en tous cas, l’enthousiasme n’y existe pas. Louvain et Bruges, au contraire, s’agitent, il s’y enrôle des volontaires; Liège envoie à Bruxelles Charles Rogier avec un contingent de gens décidés à tout et follement enthousiastes. Le danger croît de jour en jour. Mons, Charleroi, Bruges, Namur font parvenir au Roi des adresses semblables à celle que Bruxelles avait expédiée à La Haye; elles ont toutes le même thème : séparation administrative des deux pays. Tandis que les modérés, d’Hoogvorst en tête, essaient (p.234) de maintenir le peuple dans un calme relatif, en attendant la réunion des Etats-Généraux promise par le roi, une minorité de radicaux, s’appuyant sur les volontaires — principalement sur les volontaires liégeois de Rogier — veut aller de l’avant, escomptant l’appui de la France, et établir un gouvernement provisoire. Ils admettent le principe de la séparation, sous la dynastie des Nassau. Emportés par les avancés, les modérés, avec d’Hoogvorst et de Gerlache, sentant que la direction des affaires va irrémédiablement leur échapper, acceptent à contre-cœur la création d’une « Commission provisoire de sûreté publique », qui leur est imposée par les huit sections de la garde bourgeoise, dont les délégués s’étaient réunis à l’Hôtel de ville. Cette « commission de sûreté publique » avait pour mission, comme l’apprend la proclamation adressée au peuple, « d’assurer le maintien de la dynastie, de » maintenir le principe de la séparation du Nord et du » Midi; de prendre, enfin, les mesures nécessaires » dans l’intérêt du commerce, de l’industrie et de l’or-» dre public. 2» C’était, pour les modérés, un pas de plus dans la voie de l’opposition extra-légale : dès ce moment, il existe en fait une autorité dirigeante révolutionnaire. (p.235) Ce premier gouvernement provisoire n’allait pas durer longtemps : douze jours. Le calme relatif qui succéda à la création de la « Commission de sûreté publique » n’était qu’apparent. Le 13 septembre s’ouvrit la session tant attendue des Etats-Généraux à La Haye. Dans son discours du trône, Guillaume I » fit connaître que la demande de séparation introduite par les Belges serait soumise au vote de la Chambre; c’est la majorité qui déciderait en cette matière. L’impression causée par les paroles royales fut désastreuse : comme c’était le Roi lui-même qui dirigeait la majorité des Etats-Généraux, le résultat était prévu. Les Belges n’obtiendraient point gain de cause, et, en cas d’émeute, c’étaient les armes qui rétabliraient l’autorité du souverain. On n’osa pas afficher le texte des paroles royales : il fut distribué en feuilles volantes dans la soirée du H septembre. Dans une réunion des Liégeois, Charles Rogier lut le texte du document : cette lettre fut reçue aux cris de Aux armes ! Vive la liberté! A bas le Roi! Dans la soirée, la populace brûla les exemplaires du discours royal et l’effervescence fut telle que la garde bourgeoise dut intervenir énergiquement. Le lendemain, à la séance de la « Commission de sûreté-publique », de Mérode proposa d’envoyer une députation auprès des membres belges des Etats-Généraux à La Haye pour leur faire comprendre qu’ils devaient obtenir la séparation et leur faire connaître (p.236) l’effet malheureux des paroles royales. C’était un dernier essai des modérés. Mais les Liégeois protestèrent violemment : ils assistaient, en maîtres, aux séances de la « Commission de sûreté publique » et essayaient de la terroriser. Selon eux, il fallait rompre avec le Roi et établir tout de suite un gouvernement provisoire. Ils se plaignent de la politique d’agitation légale des Bruxellois et finissent par menacer ceux-ci de lâcher contre eux les mineurs du Borinage. Les volontaires de Verviers, de Luxembourg et d’autres villes encore parlèrent dans le même sens. Comme les Bruxellois de la « Commission » tinrent tête, une scission se produisit : Rogier et les volontaires liégeois abandonnèrent la salle des séances, Ducpétiaux les suivit. Ensemble avec Je Français Cha-zal, ils fondèrent alors un club aux allures révolutionnaires qu’ils appelèrent le « club de la réunion centrale ». L’agent diplomatique anglais Cartwright, venu de La Haye pour observer les événements, note en ce moment dans sa correspondance : « Les libéraux » (c.-à-d. les extrémistes ou radicaux) deviennent de » plus en plus exaspérés et se trouvent maintenant » complètement sous la dépendance de M. Ducpétiaux » et de la députation de Liège, composée principale-» ment de jeunes gens aux idées les plus exagérées ». Les discours enflammés du « Club de la réunion centrale » excitèrent considérablement le peuple : les volontaires liégeois demandèrent de marcher contre les (p.237) troupes hollandaises. Aussi, le 29 septembre, on les vit partir pour Tervueren et Vilvorde, dans l’espoir d’en venir aux mains avec les avant-postes du prince Frédéric, Cette dangereuse équipée fut blâmée par une proclamation de la « Commission de sûreté publique ». C’est ce qui mit le feu aux poudres. Le peuple crut voir dans cette proclamation la preuve de ménagements inopportuns et de manque d’enthousiasme patriotique. Le cri de Trahison ! retentit : ont se crut vendu. Dans la soirée du 19 septembre, la foule attaqua l’Hôtel de ville, mais dut reculer devant l’attitude de la garde bourgeoise, qui fit usage de ses armes. Le lundi 20 septembre, une troupe furieuse, composée surtout de volontaires liégeois, mais où se trouvaient aussi des ouvriers, des paysans, de la populace, des bandes étrangères, foule lasse de toute autorité, se rua à l’assaut de la maison communale et l’emporta, en dispersant les modérés qui y siégeaient. Ainsi fut dissous le pouvoir temporaire créé par la bourgeoisie, ainsi prit fin l’essai de révolution « légale ». C’est le règne de l’élément révolutionnaire qui commence. C’est le moment attendu par le roi Guillaume; il donna au prince Frédéric l’ordre de marcher sur Bruxelles. Le 22 septembre, les forces royales, composées de 12.000 fantassins, 1.500 cavaliers et 52 bouches à feu, (p.238) s’avancèrent pour entrer en ville. Les « orangistes » ou partisans des Nassau, un nombre considérable de modérés, beaucoup de négociants se réjouirent en secret, dans la pensée de voir enfin « Tordre rétabli ». Le peuple, lui, n’eut point peur de la lutte : aussitôt Ja marche en avant des troupes connue, une nuée de tirailleurs sortit de la ville pour aller harceler l’avant-garde ennemie. Mais les chefs bourgeois, qu’on venait de déposséder de leur autorité, ne partagent point cette confiance. Ils s’imaginent que toute résistance est impossible. La plupart dés extrémistes partagent cette opinion. Aussi voit-on tour à tour Gendebien, Van de Weyer, Rouppe, Félix de Mérode, d’autres encore, s’apprêter à quitter la ville. La plupart se rendent en France. Seul le fougueux Rogier, hésitant, désespéré, erre pendant des heures dans la forêt de Soignes, se demandant s’il doit aider le peuple dans la lutte inégale qui va s’engager, ou partir. Finalement, lui aussi s’en va, au moment où le canon hollandais tonne à la Porte de Schaerbeek. Seul le baron Van der Linden d’Hoogvorst reste à Bruxelles. Avec Charles Plé-tinckx, un ancien officier de cavalerie de l’Empire, il va diriger la défense et représenter la seule autorité existant dans la ville. Malgré sa fureur de voir les chefs disparaître au moment critique, le peuple affronte courageusement Je danger. Les combattants des « Journées de Septembre ». ce sont, certes, des bourgeois, mais ce sont (p.239) surtout des habitants des quartiers pauvres, des gens appartenant aux classes inférieures de la population, des ruraux des environs de Bruxelles, de Haï, de Lou-vain, du Brabant wallon, des volontaires liégeois et hennuyers, même des étrangers, des braconniers aussi. Il suffit de rappeler ici pour mémoire les combats de rue dont Bruxelles fut le théâtre pendant les 23. 24, 25 et 26 septembre 1830. Aux portes de Louvain, de Laeken et de Flandre, les troupes du prince Frédéric furent tenues en échec. Elles eurent un succès passager à la porte de Schaerbeek, et parvinrent à gagner le Parc, où elles s’établirent. Elles ne réussirent point à un déboucher, à cause de la résistance acharnée des volontaires, embusqués derrière les barricades de la Place Royale, Au fur et à mesure que la victoire du peuple s’affirme et que la stupéfiante nouvelle se répand — 6.000 volontaires, sans chefs, avaient arrêté 13.000 soldats instruits et disciplinés, commandés par des généraux formés à l’école de Napoléon — la population de Bruxelles se sent prise d’enthousiasme. De nouvelles recrues affluent et viennent grossir le noyau des défenseurs. L’Anglais Cartwright note à ce propos dans sa correspondance : « L’exaspération est intense et gagne » maintenant toutes les classes, même les habitants les » plus respectables, et tous sont également pris de » fureur à l’idée des dommages infligés à leur ville » (lettre du 26 septembre). Et quelques jours après, il écrit : « Tous les partis se sont maintenant unis et (p.240) cette rébellion est maintenant en voie de devenir » une question nationale. Les habitants modérés et bien pensants (better disposée) qui, il y a dix jours, » priaient positivement pour que les troupes entras-» sent en ville, du moment qu’ils ont vu que les efforts » de la populace armée allaient être couronnés de suc-» ces et que l’armée serait repoussée, se rallièrent à la » cause et tous sont maintenant unis aux libéraux et » ne forment plus qu’un seul parti ». Après la première journée de lutte, dès qu’il apprit que le peuple avait remporté des succès, Rogier s’était hâté de rentrer à Bruxelles et de se joindre à d’Hoog-vorst. Successivement, au fur et à mesure que les bonnes nouvelles se précisaient, les chefs politiques suivirent cet exemple et revinrent dans la capitale. Ils firent bien, car si le peuple s’était bien battu, il était totalement incapable de tirer politiquement parti de la victoire. Par la sûreté de leur coup d’œil et leur énergie surprenante, ils allaient racheter les faiblesses et les fautes des jours précédents. Le 26 septembre, pendant qu’on se battait encore, ils décidèrent la création d’un gouvernement provisoire. En firent partie d’Hoogvorst, — qui méritait bien d’être à l’honneur après avoir été à la peine, — Charles Rogier, André Jolly, Félix de Mérode, Gendebien, Sylvain Van de Weyer, J. Van der Linden, le baron de Coppin et Nicolay. Dans la nuit du 26 au 27 septembre, les soldats du prince Frédéric abandonnèrent la lutte et battirent en (p.241) retraite. Aussitôt, une exaltation intense s’empara •de tout le pays. Alost se débarrassa de sa garnison hollandaise, en même temps que Ath et Tournai. Le 6 octobre, la citadelle de Namur est prise par les patriotes. Bientôt, l’une après l’autre, toutes les places fortes sont évacuées. En dehors de la province d’Anvers, tout le territoire belge fut bientôt nettoyé de troupes. De Flandre et de Wallonie arrivèrent continuellement des contingents armés, qui vinrent grossir l’embryon d’armée nationale qui se constituait. Bientôt, toutes les villes reconnaissent l’autorité du gouvernement provisoire. Seules Anvers, Gand, Saint-Nicolas, Termonde restent fidèles aux Nassau. Finalement, pendant que les volontaires repoussent les derniers contingents hollandais vers le Nord, le 4 octobre, le Gouvernement provisoire proclama l’indépendance de la Belgique. Le lendemain de cette proclamation, le 5 octobre, le prince d’Orange arriva inopinément à Anvers. Il semblait s’être tenu à l’écart des affaires du gouvernement depuis que, le 3 septembre, il était parti pour La Haye porter à son père les propositions de séparation. Le prince Frédéric avait échoué par la force, le prince Guillaume essaya la politique de conciliation. Mais, malgré le fait que le Roi avait fini par lui céder « le gouvernement des provinces méridionales », malgré ses tentatives auprès du gouvernement provisoire, malgré sa proclamation du 16 octobre où il alla jusqu’à (p.242) reconnaître l’œuvre de la révolution, tous ses efforts restèrent stériles. Comprenant qu’il n’y avait plus rien à espérer, le roi Guillaume révoqua tous les pouvoirs donnés à son fils et le rappela à La Haye. Au moment de se séparer des Belges, le prince d’Orange leur adressa une proclamation où il leur fit ses adieux. Si ceux-ci touchèrent le cœur de nombreux Belges, ils ne purent empêcher l’irréparable. Quelques jours après, les volontaires entrèrent à Anvers, après un sanglant combat à Berchem, où fut tué Frédéric de Mérode. Ne pouvant s’emparer de la citadelle, défendue par le « grognard » de l’Empire qu’était le général hollandais baron Chassé, ils conclurent une convention par laquelle ils s’engageaient à ne rien entreprendre contre la forteresse. A la suite d’incidents qui éclatèrent entre des volontaires ivres et des soldats hollandais réfugiés à la citadelle, des coups de feu furent échangés. Alors que la trêve durait toujours, Kessels, commandant de l’artillerie mobile, fit sauter à coups de canon la porte de l’enceinte de l’arsenal encore aux mains des Hollandais. Chassé, furieux, fit bombarder, à boulets rouges, grenades et obus, la ville d’Anvers, dont plusieurs quartiers furent incendiés. Ce bombardement, explicable en la circonstance, n’en marqua pas moins la fin de toute possibilité d’entente entre les Belges et le roi Guillaume. Comme on le dit dans le style grandiloquent de (p.243) l’époque : « un fleuve de feu et de sang divisait les deux peuples ». Belgique et Hollande étaient désormais séparées, et pour toujours. Le Gouvernement provisoire, qui avait déployé, au milieu du désarroi suivant la retraite des troupes hollandaises, une activité fébrile et étonnante, fut prié par le Congrès national de rester à la tête des affaires. Le 16 novembre, il créa un Comité diplomatique pour diriger la politique extérieure : Sylvain Van de Weyer fut nommé président de cet organisme. Il était temps. La « question belge » allait se poser maintenant devant l’Europe. Qu’allaient faire les Puissances, dont l’œuvre venait d’être si soudainement ruinée par les Belges ? Dès le début d’octobre, le roi des Pays-Bas avait réclamé l’appui militaire des quatre co-signataires du traité des XIII articles : Angleterre, Autriche, Prusse et Russie. L’Angleterre répondit évasivement à cet appel et fit annoncer « qu’une conférence se réunirait à Londres » pour aviser aux moyens de mettre de l’ordre dans le royaume. Très déçu, Guillaume Ier demanda alors la médiation des Puissances pour préparer la séparation administrative de la Belgique et de la Hollande. Mais les Puissances, y compris la France, décidèrent de régler elles-mêmes la question hollando-belge : leurs délégués se réunirent bientôt à Londres en conférence. (p.244) Talleyrand y représentait le gouvernement de Louis-Philippe, Palmerston l’Angleterre, le baron de Bulow la Prusse, Estherhazy et Wessemberg l’Autriche, le prince de Lieven et le comte Matuscewic la Russie. Le 4 novembre, la Conférence reconnut la situation de fait, considéra les Belges comme belligérants — non comme rebelles — et proposa aux deux gouvernements de Belgique et de Hollande un armistice, suivant lequel les troupes en présence se retireraient respectivement sur une ligne, qui correspondait aux frontières de la République des Provinces-Unies antérieurement à l’invasion française. Le Gouvernement provisoire adhéra à ce projet : Guillaume Ier fit des réserves, mais respecta la trêve pendant neuf mois. Des négociations furent alors entamées entre les Puissances, la Hollande et le comité diplomatique belge, en vue de résoudre le problème soulevé par la Révolution. Les Puissances étaient partagées en deux camps : celui des Etats « réactionnaires » de la Sainte-Alliance, comprenant la Prusse, l’Autriche et la Russie, et que dominait le ministre autrichien Metternich, et celui des Etats à tendances « libérales », la France et l’Angleterre. Dans le groupe « réactionnaire », des liens de famille unissaient les souverains à la famille des Nassau et on y envisageait la nécessité de réprimer militairement le soulèvement des Belges. En Angleterre, où un gouvernement libéral venait d’arriver au pouvoir (p.245) avec Lord Grey et Palmerston, on désirait la séparation des deux parties du royaume des Pays-Bas, séparation favorable aux intérêts économiques anglais. La France de Louis-Philippe voulait l’écroulement de la barrière que les traités de 1814 avaient dressée contre elle, et elle nourrissait le secret espoir de dominer entièrement la Belgique affranchie. Un événement fortuit fit pencher la balance du côté des Puissances libérales. Fermement décidé à intervenir en Belgique, l’empereur de Russie venait de concentrer à Varsovie des régiments polonais, qui devaient marcher sur Bruxelles. A la nouvelle de la révolution belge qui leur parvint au moment du départ, les Polonais décidèrent d’imiter les Belges et d’essayer de secouer le joug russe. Les régiments destinés à la répression en Belgique se révoltèrent et refusèrent d’obéir. Cet événement sauva le Gouvernement provisoire : il permit à l’Angleterre et à la France de prendre la direction de la Conférence de Londres et les deux Puissances libérales firent immédiatement adopter le principe de non-intervention. Le 20 décembre, impressionnées par l’énergie montrée par le Gouvernement provisoire, les Puissances invitèrent celui-ci à envoyer des délégués à Londres, pour y travailler de concert avec elles « à combiner » l’indépendance future de la Belgique avec les stipu-» lations des traités, avec les intérêts et la sécurité des » Puissances et avec la conservation de l’équilibre » européen ». (p.246) A Van de Weyer et au vicomte Charles Vilain XIïII échut le périlleux honneur de représenter la Belgique. C’est alors que commence cette lutte opiniâtre entre les Belges et les Puissances, dont l’ensemble se résume en réalité dans l’histoire des revendications territoriales du Gouvernement provisoire. Nous esquissons cette histoire dans les paragraphes qui suivent. Lorsque, sur la proposition des Puissances, un armistice avait été conclu, il fut stipulé que « les troupes respectives » se retireraient « réciproquement derrière » la ligne qui séparait, avant l’époque du traité du » 30 mai 1814, les possessions du prince souverain » des Pays-Bas de celles qui ont été jointes à son » territoire, pour former le royaume des Pays-Bas, par » le dit traité de paix et par ceux de Vienne et de » Paris de l’année 1815 ». Du coup les Puissances révèlent quels seront les principes d’après lesquels toutes les questions territoriales, affectant la séparation de la Belgique et de la Hollande, vont être envisagées. En fixant les bases de la séparation, elles mettent en avant que, lors de la séparation de deux partenaires dans une affaire commune, chaque parti rentrera en possession de la portion qui lui appartenait en toute propriété au moment de la réunion ou de la mise en commun de leur avoir. Restait ensuite à établir quelle était la propriété de (p.247) chaque partenaire avant la réunion, en d’autres termes quelles étaient les limites respectives de la Belgique et de la Hollande avant la création du royaume des Pays-Bas. Cette question n’était pas aussi facile à résoudre pour la Belgique que pour la Hollande. Les Puissances jugeaient que seule la République des Provinces-Unies formait un Etat indépendant au moment de la réunion de 1814, tandis que les Pays-Bas dits autrichiens (ou Belgique) n’avaient pas formé un tel Etat. C’est pour ce motif qu’on les avait regardés comme un ensemble anonyme, un « accroissement de territoire » donné à la Hollande. Il restait dès lors à régler, lors de la séparation de 1830, le sort de ce tout anonyme, destiné à devenir, pour la première fois, un Etat indépendant, une personne politique. C’est parce que la Hollande était un Etat, une personne politique en droit public, que l’armistice proposé par les Puissances indiquait, dès l’abord, quelles seraient les limites qu’on lui assignerait :• les troupes se retireraient sur les frontières antérieures au traité du 30 mai 1814. C’était désigner, en d’autres termes, les limites de 1790, sur la base desquelles la Hollande s’était reconstituée en décembre 1813. C’était donner, dès l’abord, l’avantage d’une fixation de frontières, un droit de postliminium, comme l’on dit, à celui des deux antagonistes qui, seul, pouvait se vanter d’avoir possédé l’indépendance politique en 1814. C’éFait ne pas se prononcer sur les limites à attribuer à la Belgique, qui, ne jouissant pas encore en ce moment de l’indépendance reconnue formellement par l’Europe, était laissée dans une situation indéfinie et indéfinissable quant à l’extension de ses frontières. Les Belges saisirent immédiatement toute l’importance de la question. Le caractère vague de cette délimitation de frontières allait permettre au Gouvernement provisoire de pousser ab ovo des revendications d’ordre territorial ou du moins d’essayer d’interpréter en leur faveur un texte dont la portée exacte n’était pas encore précisée. En annonçant qu’il accepte les termes de l’armistice proposé, le Gouvernement provisoire ne manque pas l’occasion de faire observer que, pour lui, ces limites sont celles « qui, conformément à l’article 2 de la Loi fondamentale des Pays-Bas, séparaient les provinces septentrionales des provinces méridionales, y compris toute la rive gauche de l’Escaut ». Dès le premier moment où ils viennent en contact avec les Puissances, les Belges avancent hardiment cette revendication de la rive gauche « sans laquelle, comme le diront un peu plus tard leurs commissaires à Londres, la Belgique serait à découvert de ce côté, et la libre navigation de ce fleuve pourrait n’être qu’une stipulation illusoire ». Plusieurs notes furent adressées à la Conférence des Puissances réunies à Londres pour appuyer ces prétentions. Le 1er décembre 1830, MM. Cartwright et Bresson, commissaires de la Conférence à Bruxelles, remettaient de la part des Puissances une contre-note (p.248) repoussant les prétentions des Belges. On fait entendre durement à ces derniers que si l’on fixe la limite de 1790 pour la Hollande, celle-ci avait en 18H son existence politique, tandis, que « la Belgique n’existait pas comme état distinct » à ce moment-là, qu’elle n’était qu’un « démembrement de l’Empire français, en dépôt entre les mains des Puissances alliées ». Et l’en sommait le Gouvernement provisoire de montrer les actes de cession ou d’incorporation montrant que « la Flandre hollandaise, ou Maestricht, ont jamais appartenu à la Belgique ». Les Belges ne s’émurent pas de cette fin de non-recevoir; ils soupçonnaient bien que, pour le moment, le roi de Hollande parlait par les bouches des commissaires de la Conférence. Ils attendaient anxieusement le moment où ils pourraient envoyer eux-mêmes des délégués à Londres pour entrer en contact direct avec Palmerston et ses collègues. Le 20 décembre, ce moment arriva. En transmettant aux Belges l’invitation d’envoyer des représentants à Londres, la Conférence leur fit savoir que les arrangements à envisager ne pourraient « affecter en rien les droits que le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique exercent sur le Grand-Duché de Luxembourg ». C’était une restriction par avance des revendications que les Belges ne manqueraient point de présenter. La réponse du Gouvernement provisoire ne se fit pas attendre. Loin de se laisser intimider, il fit savoir (p.250) qu’en envoyant des commissaires munis de pleins pouvoirs, il lui paraissait cependant impossible « que la » Belgique constituât un Etat indépendant sans la garantie immédiate de la liberté de l’Escaut, de la possession de la province de Limbourg en entier et du grand duché de Luxembourg, sauf les relations » (de ce dernier) avec la confédération germanique. C’était, on le voit, un programme maximum, dont le sens fut vigoureusement souligné au Congrès par Lebeau. Lebeau alla jusqu’à dire : « Eh bien, Mes-» sieurs ! il faut que la Conférence de Londres sache » que la question des limites ne la regarde pas; qu’au » Congrès national seul appartient le droit de régler » les limites et de décider les questions relatives au » Limbourg et au grand duché de Luxembourg ». Des applaudissements couvrirent cette déclaration pour le moins audacieuse. C’est ici que l’on saisit sur le vif l’abîme qui séparait l’attitude de la Conférence et celle de la Belgique pendant toutes ces négociations. En 18H, les Puissances, «par droit de conquête», avaient disposé de la Belgique dans l’intérêt de l’équilibre européen et de la paix générale. En 1830, après l’écroulement de l’œuvre qu’elles avaient édifiée avec tant d’optimisme, elles estiment encore avoir le droit d’intervenir dans les affaires belges, au même titre ou sous le même prétexte qu’en 1814. Les Belges partent d’un tout autre point de vue. Aux « droits de l’Europe », ils opposent « le droit des (p.251) peuples de disposer d’eux-mêmes ». Ils refusent de reconnaître toute délimitation de territoire qui leur serait imposée. Ils réclament comme limite, non la frontière « juridique » ou soi-disant telle de 18H ou de 1790, mais la limite de facto des provinces soulevées, qui voulaient être indépendantes et « en avaient le droit, par cela seul qu’elles le voulaient ». L’on ne peut oublier cet aspect du problème : il domine toute la question des négociations de 1830-1839. C’est ce que l’historien français R. Guyot a très bien saisi et exposé dans son article sur La dernière négociation de Tal-leyrand. Le programme des revendications belges avait éié précisé, tel que nous l’avons fait connaître, dans une note du 3 janvier 1831. La Conférence la fit restituer au gouvernement belge, en faisant remarquer qu’elle tendait « à établir le droit d’agrandissement et ce conquête en faveur de la Belgique » et que c’était contraire au système de paix générale et d’équilibre européen préconisé à Londres. Inlassablement, les Belges revinrent à la charge. Dès leur arrivée à Londres, les commissaires belges remirent un mémorandum sur le système de limites que leur gouvernement désirait faire prévaloir. Il importe de s’y arrêter un instant. Cette note n’insiste pas beaucoup.sur l’argument historique ni sur les limites « juridiques »; elle met surtout en avant l’argument de (p.252) nécessité, des questions de fait et le droit de libre disposition des populations. Les Belges ne réclament pas seulement « l’ancienne Flandre Zélandaise », Maes-tricht et la province de Luxembourg pendant la durée de l’armistice, mais aussi en vue de la démarcation des limites définitives. Ils font observer que la ci-devant Flandre des Etats (ou Flandre Zélandaise), réunie en 1795, par le traité de La Haye, aux départements français de l’Escaut-et de la Lys, ne peut cesser de faire partie de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, qui remplacent, sous une autre dénomination, ces deux anciens départements « belges ». Puis, passant tout de suite au côté pratique de la question, ils insistent sur le fait que, sans la possession de la rive gauche de FEscaut, la Belgique serait à découvert, et la libre navigation sur le fleuve illusoire. « Les Hollandais, continue la note, maîtres du pays » situé sur cette rive, et maîtres par conséquent de » toutes les écluses construites pour l’écoulement des » eaux de la Flandre ci-devant autrichienne, inonde-» raient à volonté, comme ils l’ont fait à des époques » antérieures, le sol dont se composerait le territoire » belge. La ville de Gand, qui communique avec l’em-•» bouchure de l’Escaut par le nouveau canal de Ter-» neuzen, perdrait tous les avantages commerciaux » résultant pour elle de ce moyen de grande naviga-» tion ». Les commissaires belges font ensuite valoir que Maestricht « est encore une de ces possessions qu’on (p.253) » ne saurait disputer à la Belgique avec quelque appa-» rence de justice et de raison. Elle n’a jamais fait » partie de la République des Provinces-Unies, mais » les Etats-Généraux y exerçaient certains droits en » concurrence avec le prince-évêque de Liège ». Quant au Luxembourg, les commissaires rappellent brièvement qu’il faisait partie intégrante de l’ancienne Belgique; ils insistent surtout sur la volonté du peuple luxembourgeois, qui a participé à la révolution de 1830, qui a déclaré que ses représentants ne pouvaient siéger aux Etats-Généraux à La Haye; qui a, au contraire, envoyé ses députés au Congrès belge, qui a voté l’exclusion des Nassau, qui « ne peut et ne veut plus rentrer sous la domination de cette famille ». Et aux droits de l’Europe et aux principes de l’équilibre invoqués à Londres, les Belges opposent, une fois de plus, leur conception : « Telles sont les dispositions des Belges rendus à la liberté, telles sont les conditions nécessaires de leur indépendance ». Peu de temps après la remise de cette note, la Conférence, pressée d’en finir à cause de l’agitation qui se manifestait dans le pays à propos du choix d’un souverain, trancha le différend par le protocole du 20 janvier, qui était destiné à établir « les bases de séparation » de la Belgique et de la Hollande. Dans les deux premiers articles de ce ‘protocole, les Puissances reprennent le principe déjà déposé dans le protocole du 4 novembre 1830 relatif à l’armistice. Les limites de la Hollande seront celles de 1790. La Belgique sera (p.254) formée de tout le reste du territoire qui avait reçu la dénomination de « royaume des PayS’Bas » dans le traité de 1815. Mais on lui refuse la possession du Luxembourg. Sur cette revendication, la Conférence se prononce catégoriquement : ce territoire, « possédé » à un titre différent par les princes de la maison de » Nassau, fait et continuera affaire partie de la confé-» dération germanique ». En accordant à la Hollande le retour au postHmi-nium de 1790, les membres de la conférence avaient agi sans entrevoir exactement la portée de cette décision. Tout comme en 1919 à Versailles, les diplomates de 1830, surpris par une catastrophe politique, n’étaient dominés que par des idées générales et ne s’intéressaient pas beaucoup aux questions de détail, qu’ils ignoraient pour la plupart. Une de ces idées générales, équitable du reste, était de rendre après la séparation à la Hollande tout ce qui lui avait appartenu avant l’union. En décembre 1813, la Hollande s’était reconstituée sur la base de 1790 : c’est ce que tout le monde savait à Londres, mais on ne savait que cela ! De là l’ignorance qui se manifeste dans la discussion détaillée des revendications territoriales, et le peu de compte que l’on tint des mémoires et des notes remises sur ce point. Plus tard, lors du traité des XVIII articles, J. B. Nothomb, en se basant sur les principes du postliminium (p.255) de 1790, parvint à arracher à Lord Grey, le chef du cabinet britannique, la réponse que, si en 1790 Amsterdam n’avait pas appartenu aux Provinces-Unies, cette ville, d’après les articles 1 et 2 du protocole du 20 janvier, appartiendrait à la Belgique ! Les membres de la conférence eurent alors la franchise d’avouer qu’ils ne s’étaient pas rendu compte des conséquences de leur système abstrait, mais que le bénéfice du principe restait acquis à la Belgique. Lord Pal-merston s’écria : « Nous n’avions pas bien su ce que » nous faisions. Mais c’est fait; tenez-vous y ! » Quoi qu’il en soit, les « bases de séparation » du protocole du 20 janvier 1831 ne plurent point aux Belges. Le Congrès national fit entendre une violente protestation. Conformément à l’attitude que nous avons exposée plus haut, il protesta, au nom de la souveraineté nationale, contre toute intervention dans les délimitations de territoires, et refusa de se soumettre « à une décision qui détruirait l’intégrité du terri-» toire et mutilerait la représentation nationale ». Et, de nouveau, la Conférence répond à cette thèse de libre disposition des peuples par les droits de l’Europe : « Chaque nation a ses droits particuliers, mais » l’Europe a aussi son droit : c’est l’ordre social qui » le lui a donné ». Les traités qui régissent l’Europe doivent être respectés. Quant à la protestation de la Belgique, on y oppose le principe déjà mentionné plus haut : c’est en vain qu’elle invoque à son tour un droit de postlîminium « qui n’appartient qu’aux Etats indépendants (p.256) et qui ne saurait par conséquent lui appar-» tenir, puisqu’elle n’a jamais compté au nombre de » ces Etats ». Le conflit, né de points de départ absolument différents, menaçait de devenir insoluble. La Belgique s’en tint, pour le moment, à son refus obstiné de reconnaître les « bases de séparation », Le choix de Léopold de Saxe-Cobourg comme roi des Belges allait heureusement offrir l’occasion de sortir de l’impasse où l’on se trouvait engagé. Le Congrès national avait proclamé la déchéance des Nassau : l’hypothèse de l’élection du prince d’Orange, comme roi des Belges était, de ce fait, écartée. Les partisans d’un rapprochement avec la France, relativement peu nombreux mais très actifs, étaient majorité dans le Gouvernement provisoire et dans le « Comité diplomatique ». Ce parti francophile — comprenant tous ceux qui voulaient une intervention plus ou moins accentuée du gouvernement de Louis-Philippe dans les affaires belges — n’avait aucun programme bien arrêté; Rares étaient ceux qui désiraient l’annexion pure et simple. La majorité d’entre eux menaient cette politique francophile plus comme «moyen» que comme but. Gendebien lui-même avait dit au Congrès national : « La Belgique ne veut pas être réunie à la France ». Si, disait-il, nous avons songé, au début, à cette réunion « nous le considérions (p.257) comme moyen mais jamais comme but ». Le Gouvernement provisoire cherchait d’ailleurs à se ménager l’appui éventuel de la Confédération germanique, et lui envoya un agent à Francfort. La note remise par cet agent disait : « La politique francophile a été pour » la Belgique une nécessité résultant de la situation du » moment ». C’est parce qu’ils croyaient que l’indépendance du pays serait sauvegardée le mieux avec l’appui de la France que tous les membres du parti francophile s’étaient ralliés à la candidature du fils de Louis-Philippe, le duc de Nemours, au trône de Belgique. En face d’eux se dressait le groupe « doctrinaire » ou parti de l’indépendance, composé surtout de catholiques et de-Flamands. Ceux-ci patronnaient la candidature du duc Auguste de Leuchtenberg, fils d’Eugène de Beau-harnais et mari d’Amélie, fille du roi de Bavière. Malgré l’existence d’autres candidatures, fin janvier 1831 la lutte était circonscrite entre Nemours et Leuchtenberg. Pendant cette période, la politique de Louis-Philippe, dirigée par Sébastian!, est faite d’atermoiements, d’hésitations et d’intrigues, qui ne s’expliquent que par la peur de la Sainte-Alliance et la crainte de mécontenter Palmerston. Les débats au sujet de l’élection d’un roi furent violents. Le baron de Gerlache, président du Congrès national, prodigua ses avertissements aux partisans de Nemours et leur prédit des complications internationales si le candidat français était élu. Rien n’y fit. Les (p.258) francophiles l’emportèrent au vote et le fils de Louis-Philippe fut élu roi des Belges. Immédiatement, Palmerston entra en scène et fit connaître aux Belges et à Louis-Philippe que l’Angleterre était prête à déclarer la guerre si un prince français montait sur le trône du nouvel Etat. Aussi, Louis-Philippe se vit-il contraint de déclarer à la délégation belge qui était venue à Paris pour offrir la couronne à Nemours, qu’il était obligé de « sacrifier ses intérêts de famille à la sécurité de la France >. Cette attitude provoqua, comme bien l’on pense, le plus complet désarroi à Bruxelles : le Gouvernement provisoire fut obligé de s’en aller. Le Congrès national nomma alors un « Régent de Belgique » en la personne du baron Erasme Surîet de Chokier, homme intègre, mais personnage débonnaire et insignifiant. II eut à se débattre contre des tentatives de révolte des « Orangistes », les partisans des Nassau, qui étaient secrètement encouragés par Lord Ponsonby, ambassadeur de l’Angleterre à Bruxelles. Ce diplomate anglais travaillait, malgré le veto du Congrès national, à l’élection du prince d’Orange et s’accrochait obstinément à cette idée. Les troubles orangistes et le mouvement violent de réaction qu’ils provoquèrent finirent par ouvrir les yeux à Ponsonby. D’accord avec le général Belliard, envoyé extraordinaire français à Bruxelles, il approcha Joseph Lebeau, la figure la plus intéressante et l’homme d’Etat le plus distingué (p.259) de cette première période de notre indépendance, et essaya de travailler dans un sens d’apaisement. Ponsonby mit alors en avant la candidature du prince Lcopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était devenu depuis peu le favori de l’Angleterre, surtout depuis les troubles anti-orangistes du mois de mars 1831. Léopold avait pris part aux campagnes de 1813 et 1814 contre Napoléon. Nationalisé anglais, il avait ensuite épousé Charlotte, héritière du trône de Grande-Bretagne. Profondément amoureux de sa jeune femme, il eut la douleur de la voir mourir en couches après un an de mariage. Il avait été nommé field-maréchal et venait de refuser le trône de Grèce. Consulté par une délégation belge au sujet de son acceptation éventuelle du trône de Belgique, Léopold de Saxe-Cobourg se déclara prêt à écouter la proposition, à condition que les Belges acceptassent les protocoles de janvier et se réconciliassent avec les Puissances. Il n’entendait point assumer les responsabilités royales dans un pays en proie à l’agitation et en froid avec l’Europe. Il fut élu roi des Belges par le Congrès national, le 4 juin 1831. Après avoir quitté l’Angleterre, Léopold arriva en France et fut solennellement reçu à la frontière belge, près de La Panne; le 19 juillet il s’installa à Laeken. Il prêta serment et fut inauguré comme roi le 21 juillet suivant. (p.260) Cet événement mémorable marqua le triomphe de la politique de Palmerston. Le choix de Léopold Ier comme roi des Belges allait offrir l’occasion de sortir de l’impasse où se trouvaient les négociations de Londres. Les Belges s’étant ralliés au candidat anglais, le gouvernement britannique pesa sur les décisions de la Conférence et obtint de meilleures conditions pour notre pays. D’ailleurs, Lebeau et Nothomb avaient habilement travaillé les milieux des plénipotentiaires, avec lesquels ils avaient été mis en contact intime grâce à l’intermédiaire du prince Léopold. Ils appelèrent l’attention de la Conférence sur la difficulté que créait la décision antérieure de ne pas toucher au Luxembourg; ils firent valoir que la question belgo-luxembourgeoise n’était qu’une querelle entre la Belgique et la maison de Nassau, non entre la Belgique’ et les sujets des Nassau. Ils suggérèrent dès lors de maintenir le statu que* dans le Luxembourg, et d’autoriser des négociations entre la Belgique, les Nassau et la Confédération germanique. La Conférence se rangea à leurs vues et modifia en faveur des Belges l’article 2 des « bases de séparation ». La revendication de la rive gauche de l’Escaut dut être abandonnée, cette prétention étant considérée indéfendable à la suite du droit de postliminium accordé à la Hollande et constituant le principe de toutes les négociations. Les Belges eurent la prudence de ne (p.261) pas insister, mais ils obtinrent une stipulation qui leur garantissait le libre usage du canal de Terneuzen et l’adoption de mesures pour préserver la Flandre de l’inondation par un système de décharge des eaux intérieures. Les commissaires belges profitèrent du fait que la Conférence ne s’était pas rendu compte des conséquences du principe proclamant en faveur de la Hollande le droit au posttiminium de 1790. Nous avons vu que J.-B. Nothomb avait arraché à Lord Grey une interprétation qui était en faveur des prétentions belges. Les Belges dirent à la Conférence : « En vertu de votre principe, la Hollande n’a droit qu’au territoire qui lui appartenait en 1790 et rien qu’à celui-là; par conséquent, tout ce qui ne lui appartenait pas à cette date exacte, nous le réclamons ». Armé de vieilles cartes et de documents de tout genre, J.-B. Nothomb parvint à faire reconnaître à la Conférence que les Belges pouvaient réclamer, en se fondant sur l’histoire, la moitié de la souveraineté sur Maestricht. Forts de l’acquiescement de Lord Grey à leur interprétation du postlimininm de 1790, les commissaires réussirent aussi à prouver qu’il existait en Hollande des enclaves allemandes, acquises après 1790, et que par conséquent ces enclaves revenaient à la Belgique. Ces enclaves allemandes en Hollande devenaient donc entre les mains des Belges une monnaie d’échange pour obtenir en retour les enclaves hollandaises (p.262) du Limbourg. L’on sait que ces enclaves hollandaises dans le Limbourg se groupaient surtout autour de Venloo, Stcvensweert et Maestricht et que notamment les 53 villages dits « de généralité », s’étendant sur les deux rives de la Meuse, en faisaient partie. La Conférence accepta la thèse de MM. Lebeau et Nothomb : on put espérer que grâce à l’échange des enclaves, l’intégrité territoriale du Limbourg serait sauvée. Les efforts énergiques des commissaires belges et l’action secrète mais efficace du prince Léopold, conduisirent finalement à la rédaction du protocole connu comme le Traité des XVIII articles. L’article 2 introduit des modifications très favorables pour la question du Luxembourg, en disant que « les cinq Puissances emploieront leurs bons offices « pour que Je statu qtto dans le duché de Luxembourg » soit maintenu pendant le cours de la négociation » séparée, que le souverain de la Belgique ouvrira > avec le roi des Pays-Bas et avec la Confédération » germanique…, négociation distincte de la question » des limites entre la Hollande et la Belgique ». L’article 4 reconnaissait la thèse belge concernant Maestricht en disant : « S’il est constaté que la République » des Provinces-Unies des Pays-Bas n’exerçait pas » exclusivement la souveraineté dans la ville de Maes-» tricht en 1790, il sera avisé par les deux partis aux » moyens de s’entendre à cet égard sur un arrangement (p.263) convenable ». Enfin, l’article 5 admettait l’échange des enclaves « respectives ». Il est à remarquer aussi que la conférence n’intervenait plus que comme c simple médiatrice » et qu’elle respectait donc la souveraineté que les Belges avaient si énergiquement réclamée. C’était un beau succès diplomatique. Aussi, le roi Guillaume ne put-il cacher sa fureur. Le 12 juillet 1831, une dépêche fut adressée par le ministre hollandais baron Verstolk à la Conférence, déclarant ces préliminaires de paix inadmissibles et discutant point par point les satisfactions qu’ils accordaient aux Belges. Le roi de Hollande ne se bornerait pas là. Dès la retraite de son armée en 1830, il avait nourri des plans de revanche, et avait préparé en secret une campagne d’invasion, destinée à peser sur les décisions des grandes Puissances ou à reconquérir purement et simplement la Belgique. L’homme très tenace et très intelligent qu’était le roi de Hollande savait qu’une question de fait l’emporte souvent sur une question de droit. Au début d’août 1831, le roi Léopold était occupé fi faire sa joyeuse entrée dans nos principales villes, lorsque subitement une armée hollandaise de près de 38.000 hommes envahit la Belgique. Léopold Ier ne put lui opposer que des troupes indisciplinées, mal équipées, dépourvues de matériel. Des deux armées belges, celle de la Meuse fut coupée, rejetée sur Hasselt et écrasée : celle de l’Escaut, après s’être vaillamment (p.264) battue, fut cernée à Louvain et allait être anéantie, lorsque l’arrivée des troupes françaises du maréchal Gérard, accourues à l’appel de Léopold Ior, et l’intervention diplomatique de la France et de l’Angleterre imposèrent un armistice immédiat et forcèrent le prince d’Orange à évacuer notre territoire. Aussitôt les sentiments de la Conférence changèrent à l’égard des Belges : on se mit à douter de la solidité du jeune Etat. Après avoir examiné une fois de plus les prétentions en présence et constaté que Belges et Hollandais ne s’entendaient point — les Belges avaient cependant accepté le traité des XVIII articles — la Conférence brusqua le dénouement. Elle appliqua la dure loi du vae victis, et trancha elle-même la question, non plus en médiatrice, mais en mandataire de l’Europe, par l’énoncé du Traité des XVIII articles (M octobre 1831). La Belgique perdait tout le fruit de ses efforts antérieurs, les concessions obtenues au Traité des XVIII articles lui étaient enlevées. Par les articles 1 et 2 de ce traité, les Puissances consentaient à détacher du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’il avait été constitué par le Congrès de Vienne, la partie qui correspond à la province belge actuelle de Luxembourg. En échange de ce « sacrifice » le roi de Hollande reçoit, comme le stipule l’article 3, une « indemnité territoriale » dans la province de Lim-bourg. Sur la rive droite de la Meuse, on laisse au roi Guillaume les anciennes enclaves hollandaises (Venloo, Stevenswert, parties de Fauquemont, villages (p.265) « de généralité » etc.). Mais, de plus, pour relier ces enclaves, on y joint les districts limbourgeois qui, en 1790, n’appartenaient pas aux Etats Généraux. La partie du Limbourg située sur la rive droite appartenait « désormais tout entière à S. M. le Roi des Pays-Bas ». Sur la rive gauche de la Meuse, les quelques enclaves hollandaises, comme Zepperen, Houpertin-gen, Peen, Rutten, etc. sont données à la Belgique, mais on en excepte Maestricht, laquelle, « avec un rayon de territoire de 1200 toises, continuera d’être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas ». De plus, sur la rive gauche encore, au nord d’une ligne aboutissant au fleuve au-dessous de Wessem, les anciens territoires de Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord, Thorn, etc., sont donnés (« feront partie ») à la Hollande. Une émotion très vive se manifesta dans le pays : de violentes protestations se firent entendre; les députés du Limbourg et du Luxembourg ne furent pas les moins empressés à répudier un arrangement, qui faisait fi de leurs désirs légitimes. Toutefois, pour ne pas provoquer une conflagration générale en Europe, les Chambres belges, adhérèrent finalement au traité, qui fut signé le 15 novembre 1831. Malgré les avantages d’ordre territorial qu’il retirait du traité, le roi de Hollande refusa de le reconnaître. Il avait escompté des conditions plus avantageuses encore; il espérait, par la politique d’inertie, pouvoir (p.266) provoquer un fait nouveau qui changerait une fois de plus les dispositions des Puissances; il entrevoyait toujours la possibilité de reprendre la Belgique à la faveur d’une guerre. Comme Guillaume persistait à garder les forts de Lillo et de Liefkenshoek, qu’il était tenu d’évacuer en vertu de l’armistice — pour le déloger d’Anvers, il avait fallu le siège de la citadelle par l’armée française — les Belges, avec le consentement tacite de la Conférence, dont les travaux ne continuaient d’ailleurs plus, restèrent en possession effective du Limbourg e’t du Luxembourg tout entiers, exceptés Maestricht et la forteresse de Luxembourg. Ce régime provisoire dura jusqu’en 3838. Les Belges avaient fini par s’imaginer que ce provisoire deviendrait définitif et que les stipulations du traité des XXIV articles ne seraient pas appliquées. Aussi, leur stupéfaction, leur effarement furent grands lorsque, le M mars 1838, Guillaume de Hollande, las d’attendre en vain « le fait nouveau » qu’il escomptait, fit brusquement savoir à Londres qu’il acceptait les XXIV articles. C’est alors que les représentants des populations limbourgeoises élevèrent la voix pour protester contre la séparation définitive dont ils étaient menacés. On entendit des accents vraiment tragiques, lorsque ces députés supplièrent les Chambres belges de ne pas les abandonner, les insultèrent, les traitèrent de lâches, rappelant qu’ils avaient voté, eux aussi, l’exclusion des (p.267) Nassau et qu’ils ne désiraient pas rentrer sous l’obéissance de cette dynastie. L’agitation fut intense. Léopold Ier offrit de racheter à prix d’argent le Limbourg et le Luxembourg : on songea même un instant — idée folle et impraticable — à faire la guerre, mais l’hostilité nettement marquée des Puissances fit comprendre aux Belges que cette attitude pouvait causer leur ruine définitive. Aussi, les Chambres se résignèrent finalement à signer les traités rédigés par la Conférence de Londres : cette signature eut lieu le 9 avril 1839. Dès ce . moment, on incorpora définitivement à la Hollande les territoires contestés, on frappa la navigation sur l’Escaut d’un droit de péage au profit des Pays-Bas, on établit qu’Anvers ne pourrait être port de guerre, on réduisit, d’autre part, de 8.400.000 à 5.000.000 de florins la part de la rente commune entre eux et la Hollande. Enfin, la neutralité perpétuelle et l’intégrité et l’inviolabilité du territoire belge furent proclamées. Ces traités de 1839 mirent fin aux longues tentatives européennes pour doter la Belgique d’un statut international. Ce sont ces traités que, en août 1914, le chancelier von Bethmann-Holweg traita de « chiffon de papier » dans sa célèbre entrevue avec l’ambassadeur d’Angleterre.
|
|
1830 |
M. Désir* et l’ histoire, LB 18/09/1980
“Dans un flamboyant “Billet du Bourgmestre” diffusé dans sa commune, Georges Désir* proclame qu’ en 1830: “Naissait la solidarité Wallonie-Bruxelles.” Et de citer avec éloge le rôle de Charles Rogier à l’appui de sa thèse dont on trouve pas la moindre trace dans les journaux et les discours de 1830, car la révolution fut essentiellement nationale, ce qui gêne Georges Désir. L’excellent homme ignore que son héros Rogier deviendra gouverneur d’Anvers et que lorsqu’il quitta sa charge, les Anversois lui payèrent par souscription, une maison à Saint-Josse: “Pour les services qu’il avait, en tant que gouverneur, rendus aux arts et aux lettres flamands.”
* Georges Désir, du parti raciste FDF
|
|
1830
|
Paul Vaute (vertaling M. Duyck), België was er vóór de Belgische staat!, p.2-6, in : Delta, 1, 2005
(p.2) « Voorafgaand moet men in de denkcategorieën van de betrokken tijd geraken. « Sébastien Dubois
Dit jaar wordt de 175ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid gevierd. Een eerbiedwaardige leeftijd, die door het merendeel van de huidige Staten niet bereikt wordt. . . Maar de Belgischeidee is veel ouder dan de barricaden van 1830.
« En zeggen dat er mensen zijn die schrijven dat het woord « België » na 1830 uitgevonden werd! Terwijl diezelfden voor veffe tijden de woorden « Vlamingen » of « Walen » zonder enig aanhalingsteken gebruiken… » Zoals velen allicht, heeft Sébastien Dubois ten aanzien van onze identiteitsperikelen de gave van de verwondering nog niet verloren.
« Waar sommige van onze tijdgenoten zich niet meer met België verbonden voelen dit is hun volste recht -, staat de intellectuele eerl/ijkheid niet toe de geschiedkundige werke/ijkheid te vervalsen zegt onze man.
Als jonge archivaris (geboren in 1977) bij het Luikse Rijksarchief, heeft hij enkele maanden terug aan de UCL een totnogtoe onuitgegeven doctoraatsthesis verdedigd die hem de prijs Burggraaf Terlinden opbracht. De titel luidt « De uitvinding van België. Vorming en voorstellingen van het grondgebied van een Natie-Staat, van de Vrede van Westfalen tot aan de onafhankelijkheid (1648-1839) ». 1648, het vertrekpunt, is de erkenning van de breuk tussen onze provinciën (Spaanse Nederlanden) en Nederland (Verenigde Provinciën). 1839 is het punt van aankomst, de definitieve regeling van het Belgisch-Hollands conflict door het Verdrag van Londen. Besloten als hij was om het onbekende, namelijk het aanhorigheidgevoel van de mannen en vrouwen die dit « land » op het einde van het Ancien Régime en ten tijde van de revoluties bezielden, te doorgronden, moest hij heel wat klippen omzeilen.
« De zaak aanpakken vanuit onze begrippen natie en nationalisme die beide in de helft van de XIXde eeuw ontstonden, is een anachronisme plegen », zegt hij. « Men moet voorafgaand in de denkcategorieën van die tijd intreden ». ln zijn licentiaatthesis over moderne geschiedenis, had de doctorandus de nationale problematiek reeds aangepakt via de uitermate concrete component van de territoriale grenzen. Hier kwamen heel wat onontgonnen archiefstukken aan te pas, achtergelaten door de kleine comités die zich in de XVIIIde eeuw bogen over de geschillen in de katholieke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. In deze archivalische zee gooide de geschiedkundige zijn netten uit en haalde een visie op over de wegen langswaar de bepaling van de – tijdens het Ancien Regime zeer vrije – grenzen geleidelijkaan verwezenlijkt werd.
Zo te zien dagtekent het lapwerk van de ontelbare enclaves die aan oudere landkaarten het uitzicht geven van opgeapte kledingstuken, niet van 1789 en de gevolgen ervan.
Wie zetelde in deze grenscomités? Dormeel de vorst, de gouverneur-generaal, de gevolmachtigde ministers zoals Neny… ‘Wanneer zij zich ter plaatse begeven, bijvoorbeeld bij een schending van het grondgebied, stellen zij processen-verbaal op die soms tot tweehonderd pagina’s dik zijn. Het gebeurt dat al de bewoners van een bepaalde plaats opgeroepen worden om te getuigen. Zo kan men lezen dat iemand riep « Leve de keizer van Oostenrijk! » Of hoe de mensen hun aanhorigheid bij een land be/even, hoe.zij het noemen. »
Een andere goudmijn, die in het nationale Archief van Parijs ligt, vloeit voort uit de onderhandelingen die leidden tot de versplintering van België in departementen na de aanhechting bij Frankrijk in 1795. Er zijn klachten, schrijft de wetenschapper. Zo die van een Naams dorp dat tot het Land van Luik behoorde en naar het kanton Dinant overgeheveld werd. Men leest daarin: »Wij hebben met Dinant niet meer te doen dan met Peking! ». Er zijn ook Luikse bronnen die betreuren dat Luik aan België gekoppeld werd terwijl het een onafhankelijk prinsdom geweest was. Op dat punt zullen de meningen mettertijd wei veranderen. ln 1814-1815 vragen Luikse petities om hetzelfde lot ais België te kennen. De kortstondige poging van de gewezen prins-bisschop de Méan om het prinsdom opnieuw op te richten zal op niets uitdraaien. » Gaandeweg lijkt Sébastien Dubois helemaal dezelfde weg op te gaan ais wijlen Jean Stengers, die hem trouwens geen lof spaarde. De professoremeritus van de ULB was trouwens zelf opnieuw aan het werk getogen en pleegde twee boekdelen over de « Geschiedenis van het nationaal gevoel in België » (Uitg. Racine, 2000 en 2002). Twee boeken die niets van doen hadden met het unitaristische militantisme – de huidige tijd werd er niet in behandeld – maar die een grote nul gaven aan heel wat, al dan niet, beroemde auteurs van pareltjes: zo de socioloog Claude Javeau die verklaarde dat « België slechts voor een handjevol mensen een natie geweest is » of generaal de Gaulle die ons land aanzag ais « een tegennatuurlijke vereniging opgedrongen door de Engelsen », of die Minister-president van de Vlaamse Gemeenschap die aan de vroegere correspondent van « Le Monde » verkondigde dat Vlaanderen sedert eeuwen bestaat, België slechts sedert anderhalve eeuw », waarbij hij zonder enig speurwerk of controle het samenleven van de Belgen reduceerde tot « 150 jaar ». Ja, de lijst is vrij lang!
Nochtans moet je geen grote geleerde zijn om onder andere te vatten dat wanneer de revolutionairen van 1790 de « Vereenigde Nederlandse Staten » uitroepen, deze uitdrukking niet uit de lucht is komen vallen. Als erfgoed van een oude geschiedenis waarvan de omtrekken vrij vaag waren, wordt de benaming « België » van in de Renaissance weer levendig waaronder het geheel van graafschappen, hertogdom men en heerlijkheden bedoeld wordt (p.4) die door de hertogen van Bourgondië verzameld werden. De Latijnse namen « Belgium »en « Belgica » worden gebruikt, in het Frans « Belgique » of « Pays-Bas » en in het Nederlands « Nederland( en) ».
Maar ja, de taal kan grillig zijn. « Soms, zegt onze specialist, wordt het woord « Vlaanderen » gebruikt om het geheel aan te duiden, een beetje zoals « Holland » de ganse noordelijke Nederlanden zal aanduiden. Met de Brabantse Omwenteling is het Brabant dat voor gans België gebruikt wordt. « Deze stijlfiguren verklaren waarom vooral in het buitenland, de uitdrukking « de Vlaamse schilderkunst » ook gebruikt wordt om artiesten uit de Romaanse gouwen aan te duiden…zonder dat daarom enige politiekculturele Nederlandstalige hierom zou gelobbyd hebben. Nu is wei duidelijk dat de geografische betekenis die vandaag gegeven wordt aan « Vlaanderen » en « Wallonië » amper terug gaat tot in de helft van de XIXde eeuw.
De bronnen die voor de naam van het land pleiten laten ook de kennis zien die de autochtonen over zijn vorm hadden. « Een van de geliefde straffen in de les aardrijkskunde was de landkaart te laten tekenen met de hoofdsteden van de provinciën. Voordien was er de voorstelling in de vorm van de Belgische Leeuw, die vanaf de XVlde eeuw in zwang kwam. Deze uitbeelding heeft de scheiding in de Oostenrijkse Nederlanden overleefd maar niet in de Verenigde Provinciën ».
De wijze waarop het nationale verleden onderwezen wordt, brengt ook alweer een boel bewijsstukken aan. « De studiehervorming van 1777 legt verplicht » een cursus « nationale Belgische geschiedenis » op in aile colleges. Onder de examenvragen, leest men wanneer de « Etat belgique » of Nederlandse Staat ontstaan is en het te geven antwoord luidt: in de XVde eeuw. ln diezelfde tijd werd ook reeds gezegd dat de Grote Markt van Brussel de mooiste in de wereld is! » En sedert onheuglijke tijden dreunen de leerlingen de beroemde woorden van Cesar af « fortissimi sunt Belgae », ook al bewoonde de betrokken bevolking niet helemaal het latere Belgische grondgebied.
Formeel echter waren de zuidelijke Nederlanden toen Oostenrijks bezit. Maar technisch vormen zij wei een aparte Staat, met zijn eigen gouverneur-generaal en met zijn hofhouding die ais soeverein werd beschouwd. Vandaar de inhoud van de handboeken. « Wenen verlangt niet België tegen te werken. Het zal er onder de Franse overheersing helemaal anders aan toe gaan.”
Dit gezegd zijnde, mag niet vergeten worden dat die boeken uiteraard slechts de geletterde minderheid bereikten. Wat weten wij over de mening van de « lagere » bevolking? »
De gewone sterveling hoort allereerst bij zijn dorp, antwoordt onze deskundige. Maar het feit dat in een bepaalde plaats ordonnantiën door de pastoor worden voorgelezen betekent dat men onderdaan is van deze of gene vorst. Wanneer in Fontaine-L’Evêque een ordonnantiënoorlog uitbarst tussen Luik en de Nederlanden, rukken de partizanen van het éne kamp de ordonnantiën af die diegenen van het andere kamp hebben aangeplakt. . . « De zeer Belgische gewoonte van vernieling en overschildering heeft dus niet gewacht op de taalperikelen om zich te ontplooien! ».
Buiten de dorpen zijn er de provinciën met de rivaliteiten waardoor zij soms tegen elkaar – opgezet raken, zoals tussen- het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen. « Maar het nationale gevoel komt duidelijker naar boven in de stadskringen waar men meer contacten met de centrale overheid heeft ». In tegenstelling tot wat veellandgenoten menen, refereert de leuze « Eendracht maakt macht » niet naar Vlamingen en Walen, maar wei naar katholieken en liberalen alsmede naar de provinciën die – bij ons evengoed ais bij de buren – hun particularismen moesten overstijgen om tot één Staat uit te groeien.
In tegenstelling tot Pirenne, gelooft Sébastien Dubois niet dat de eenheid van beschaving de Belgische staat opgedrongen heeft: « Integendeel, het is de on derwerping aan dezelfde overheden die het land een eigen gelaat en gemeenschap pelijke karakteristieken heeft verleend », Deze primaire identiteit wordt uiteraard eerst in de hogere sferen waargenomen. Terwijl het proto-patriottisme van het volk veeleer uit een dynastische trouw bestaat, minder aan de grond verbonden dan aan de vorst van wie de afbeelding op de munten staat, van wie huwelijk of overlijden door de klokken aangekondigd wordt, voor wie men een « Te Deum » bidt « .., allemaal tekenen die tot de nederigsten in den lande reiken ».
Voor zover de vrijheden en de privilegies van het land worden geëerbiedigd – en dat men… niet te veel belastingen eist! blijkt deze aanhankelijkheid goed verankerd en oprecht. Het verzet tegen de trawanten van Lodewijk XIV die naar de talloze Vlaamse, Naamse en Luxemburgse dorpen gezonden werden om de bewoners er toe te dwingen hun onderdanigheid aan de Zonnekoning te betuigen, is er een sprekend getuigenis van. En in de stormachtige jaren 1780-1830, tel kens als de vorst afgezet wordt, wordt men opnieuw ais vanzelf Belgisch patriot.
Deze gevoelens veranderen niet fundamenteel on der het Franse, noch onder het Hollandse bewind. « Onder het Directoire is er echt sprake van een ware vogelvrijverklaring. Men spreekt van « het voormalige België » of de « voormalige Luikenaars ». Wanneer iemand in Gent een « Gazet van België » wil uitgeven, wordt dit hem verboden omdat het woord te veel aan het Ancien Regime herinnert. Maar na 1800 wordt het regime soepeler. De woorden « Belg » en « België » worden aanvaard en zelfs door de gezagvoerders, de prefecten, gebruikt. »
Eenzelfde verdraagzaamheid ten tijde van Den Haag: « Belg » of « België » en « Nederlander » of « Nederlanden » zijn samen officieel algemeen goed terwijl het in de praktijk, om zich toch van het Noorden te onderscheiden, eerder de eerste twee termen gebruikt worden.
Zo is het niet te verwonderen dat de patriottische verzuchtingen van 1830 in het verlengde van die van 1789 zullen liggen. « Bij de aanvang van de Septemberdagen in Brussel, wordt soms de indruk gewekt dat sommigen hun kentekenen en vlaggen bij de Brabantse Omwenteling zijn gaan zoeken. Louis Dewez die 1789 meemaakte, spreekt er over in zijn « Histoire de la Belgique », verschenen in 1805-1807, ais over een eerste omwenteling naar onafhankelijkheid ». En in de wandelgangen van het Nationaal Congres, zwaait de patriot Jean-Joseph Raepsaet, geboren onder het bewind van Maria-Theresia, met de Blijde Intrede van Brabant. . .
En de taal? Bij de aanvang van de negentiende eeuw blijkt zij niet een bepalende factor te zijn. « ln de Verenigde Staten spreekt men Engels al hebben zij de Britten er uit gegooid. De Oostenrijkers spreken Duits zonder daarom bij Duitsland te willen horen. Ook mag men niet vergeten dat de volkstaal van plaats tot plaats verschilt. Zo vond ik het verhaal van een Franse reiziger uit de XVIlide eeuw die zich naar Bergen begaf. Hij schrijft: « Ik ben in België, iedereen spreekt hier Vlaams! » Versta hieruit dat hij een dialect hoorde spreken dat hij niet kende. Wanneer geletterde reizigers in een dorp aankomen, zoeken zij dadelijk de pastoor op want met hem zullen zij ten minste dan toch in het Latijn (p.6) kunnen spreken. »
Bij de lectuur van het werk van Sébastien Dubois zullen wei de laatste twijfels verzwinden, mochten die er nog zijn. De theorie van België – kunstmatige schepping van de grootmogendheden – heeft nooit grond gehad.
Paul Vaute (vertaling M. Duyck)
|
|
1830 |
Pierre Thomas, /Brugge/, Belgische vlag, in: DS 12/11/1999
In 1830 bestond de Belgische vlag uit horizontale banen. Rood bovenaan, midden geel en onderaan zwart. deze horizontale vlag bleef in gebruik tot 1848. de Brugse schilder désiré Donny (1798) maakte in 1831 een groot schilderij van de Brugse Burgerwacht op de Grote markt van Brugge voor het provinciehuis met wapperende horizontale Belgische vlaggen. Door de vlag te keren ging de Belgische vlag qua vorm althans wat meer op de Franse lijken en wat minder op de Nederlandse.
|
|
1830 |
Robert Baude, REVISIONNISTE de l’HISTOIRE de BELGIQUE ?, s.r.
Lors des émissions produites par la RTB les 26 et 27 septembre 1988, à l’occasion des fêtes de la « Communauté française »(!), nous avons vu un garçonnet recevoir de Monsieur FEAUX, président de l’Exécutif Wallon, une leçon d’histoire de Belgique quelque peu ahurissante. Selon cette Excellence un tantinet régionalisée,la Révolution Belge de 1830 aurait été l’oeuvre des Wallons et des Bruxellois. Jusqu’à présent, on nous avait enseigné que cet épisode de notre histoire nationale, qui avait vu les Hollandais repoussés dans leur pays d’origine, avait été une oeuvre commune des Belges et que de tous les coins du pays, des Flandriens, des Limbourgeois, des Anversois s’étaient mêlés aux Wallons de partout pour participer avecr les Bruxellois et les Brabançons à ces combats dans les rues de Bruxelles et dans d’autres régions du pays. Faut-il croire que les méthodes de critique historique moderne bouleversent à ce point nos croyances que vous devrions conclure que notre premier roi des Belge, Léopold ler,ne fut qu’un faussaire ? Mais contentons-nous de rappeler à Monsieur FEAUX de l’Exécutif Wallon,d es témoignages qui ne peuvent être récusés. Le premier: Tous nous connaissons la Place des Martyrs à Bruxelles et le monument PRO PATRIA qui rappelle à tous,le souvenir des combats de 1830. Ce monument est élevé sur un soole imposant construit en-dessous du niveau du sol sur une aire que nous appelons “crypte”. Les murs de celle-ci sont recouverts de plaques de bronze sur lesquelles sont gravée les noms et les commumes d’origine des 467 combattants enterrés nous cette Place. Que Monsieur FEAUX daigne un jour descendre dans cette crypte; il y verra que les Flamands ne sont nullement absents de cette nécrologie. Un deuxième témoignage est celui produit par le Ministère de l’Iintérieur qui, le 7 juin 1982, fit parvenir au Secrétaire de Pro Belgica, à l’époque, Mr MONIQUET, une lettre dans laquelle sont repris les noms des communes ayant reçu, le 27 septembre 1832, des mains de-S.M., le roi Léopold ler, le drapeau de la reconnaissance.
Parmi ces noms de communes nous y trouvons Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Diest, Geel, Gent, Geraardsbergen, Hal, Hasselt, Herenthout, Herzele,Heverlee, Kortrijk, Leuven, Lier, Maaseik, Meerhout, Menen, Mol, Oostende, Roeselaar, Ronse, Tervuren, Tielt, Tienen, Westerlo. A moins que nos connaissances géographiques soient troublées par nos réformes constitutionnelles, nous certifions que ces comunes ne sont ni en Wallonie ni dans la « Région Bruxelloise » ni en partie germanophone du pays. Alors ?’ Alors pourquoi Monsieur FEAUX veut-il tromper non seulement un garçonnet qui fait foi à ce que lui disent les grandes personnes, mais également le public naïf et ignorant l’histoire de Belgique ? Pourquoi la RTB s’est-elle faite complice d’une mauvaise action? Nous connaissons certains pays où les révisionnistes de l’histoire font florès. Allons-nous employer en Belgique les méthodes de ces spécialistes ? Est-cela le style des nouveaux Belges ?
|
|
1830
|
Roger Angot, ORIGINE DE LA BRABANÇONNE, in : Le Messager, 05/01/1996
S’il est profondément regrettable que certains Belges – et surtout parmi les plus jeunes – ignorent le texte actuel de la Brabançonne , beaucoup plus encore n’ont jamais entendu parler de l’auteur des paroles, ou, plus exactement, des auteurs car ils furent au moins deux. Un coup d’œil rétrospectif dans les premières décennies du XIXe s. va, d’emblée, éclairer notre lanterne. Après la défaite de Waterloo (18 juin 1815), les provinces de Belgique furent réunies à la « Néerlnnde » sous la houlette de Guillaume I d’Orange. Les bévues et les maladresses de ce monarque protestant – qui ne cessait de provoquer nos populations par des mesures vexatoires et par des atteintes à nos libertés fondamentales – engendrèrent les prémices de la Révolution de 1830. Chant martial pour la liberté, symbole par excellence de l’union des Belges, la ‘Brabançonne » fut composée, en effet, à l’occasion des luttes pour notre indépendance, en 1830. Le public manifesta avec enthousiasme le 25 août 1830, à la sortie du Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, où l’on avait joué « La muette de Portici » qui exaltait le patriotisme des Napolitains luttant contre leurs oppresseurs espagnols. La foule se déchaîna quand le ténor La Feuillade entonna le célèbre duo : » Amour sacré de la patrie, Rends-nous l’audace et la fierté ! A mon pays je dois la vie, II me devra la liberté ! » Au sein d’une atmosphère, à la fois violente et fébrile, un certain Chevalier Louis-Alexandre Déchet (1801-1830), écrivit un poème exaltant la lutte du peuple belge contre le despotisme néerlandais.
Mais, qui était ce Louis-Alexandre Déchet? C’était un comédien français, né à Lyon en 1801. Après des études à Paris, il se produisit en Corse, en France, et enfin, en1828, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Déchet fit sensation partout et, bientôt, les Bruxellois, amateurs de théâtre, l’adoptèrent puis le portèrent aux nues. Devenu « Bruxellois » sous le nom de ]en-neval (ou Geneval), il se fit incorporer dans la garde civique chargée de maintenir l’ordre à Bruxelles pendant l’insurrection. Combattant, il fut tué par un boulet hollandais, le 18 octobre 1830, près de Lierre. De nouvelles chansons patriotiques incitèrent bientôt les Belges à ne pas céder face aux Bataves. Ce fut aussi du délire quand le ténor La Feuillade, chanta, à la Monnaie, la « Brabançonne » écrite par Jenneval. On sait que les troubles se prolongèrent, notamment, par les combats des Quatre glorieuses du 23 au 26 septembre pour chasser les troupes hollandaises. Il y avait bien eu, auparavant, ce que l’on appella la « Révolution légale » dont le sens avait été précisé par la célèbre énigme des douze w que le peuple traçait sur les murs à cette époque : « w(ij) w(illen) w(illem) w(eg). w(û) w(illem) w(iizem) w(ezem), w(ij) w(illen) w(illem) iu(een) \ » (Nous voulons que Guillaume parte, si Guillaume veut être plus sage, nous voulons ravoir Guillaume).
Cependant, au début, la « Brabançonne » se présentait sous un accent assez loyaliste. Qu’on en juge plutôt ! Il y était question, notamment, de… « greffer l’Orange sur l’arbre de la liberté » et encore cet extait du 2e couplet : Restons armés, que rien ne change, Gardons la même volonté ! Et nous verrons fleurir l’Orange Sur l’arbre de la liberté ! » L’offensive hollandaise vers Bruxelles modifia totalement les mentalités et le chant, en sa nouvelle version, devint nettement révolutionnaire. Voici un extrait du 1er couplet : C’en est fait ! oui, Belges, tout change, Avec Nassau plus d’indigne traite. La mitraille a brisé l’Orange Sur l’arbre de la Liberté…»
Le poème de Jenneval avait reçu un accueil favorable au sein de la bourgeoisie bruxelloise et un certain éditeur Jorez suggéra de l’adapter à un air déjà existant : « Les Lanciers polonais.» Toutefois, un professeur de musique, compositeur et ténor bruxellois, François van Campenhout (1774 -1848) se proposa d’écrire une mélodie pour le poème patriotique. Ce fils d’aubergiste se lança dans la musique, entra à la Monnaie en tant que violoniste, suivit des cours de chant et se produisit en qualité de ténor à Gand, Anvers, Bruxelles ainsi qu’à l’étranger et, notamment, à Bordeaux, Lyon et Amsterdam. Quand éclata la Révolution, à Bruxelles, il refusa la chaire de professeur que la Hollande lui offrait au Conservatoire de la Haye, opta pour la patrie belge, composa une musique pour le poème de Jenneval et chanta celui-ci dans divers cafés célèbres où se réunissaient de gais lurons. Cependant, ce poème ne fut finalement, que fidée originale de notre hymne national. Il fut souvent remanié et adapté aux circonstances du moment. Après l’acceptation du Traité des XXIV articles par le roi de Hollande, le 14/ 03/ 1838, les relations s’améliorèrent avec nos voisins du Nord, à telle enseigne qu’une nouvelle version de la « Brabançonne » vit le jour en 1856 sous l’impulsion du juriste Charles Rogier qui avait été membre du gouvernement provisoire au Congrès National.
Il ne s’y trouvait plus de paroles offensantes pour la Maison d’Orange mais bien un couplet « pacificateur ». Si je ne m’abuse le voici à titre documentaire : « Rallions-nous à d’anciens frères, De nous trop longtemps désunis. Belges et Battaves plus de guerre ! Les peuples libres sont amis. A jamais resserons ensemble Les liens de fraternité Et qu’un même cri nous rassemble : Le Roi, la Loi, la Liberté ! » Sans commentaire ! (à suivre)
|
|
1831 |
Jean-Léon Huens, Auguste Vanderkelen, Histoire illustrée de la Belgique, T3, éd. Racine 2003 (texte : Schoonjans Jean)
Le 21 juillet 1831, le roi Léopold Ier prêta le serment de fidélité à la Constitution.sur la Place Royale à Bruxelles.
(p.66) Les Belges ont fait du Congo une des plus belles colonies du monde. Ils ne négligèrent pas leurs efforts pour la moderniser, l’embellir et l’enrichir.
|
|
1831 |
Vive la Belgique!, VA 30/07/1998
Le 21 juillet 1831, Léopold Ier quittait l’Angleterre afin de guider la Belgique vers l’équilibre et la prospérité . Ce jour-là, il faisait son entrée à Bruxelles, prêtait serment en tant que premier Roi des Belges et prenait place sur le trône.
|

La Brabançonne: origine et les 4 versions
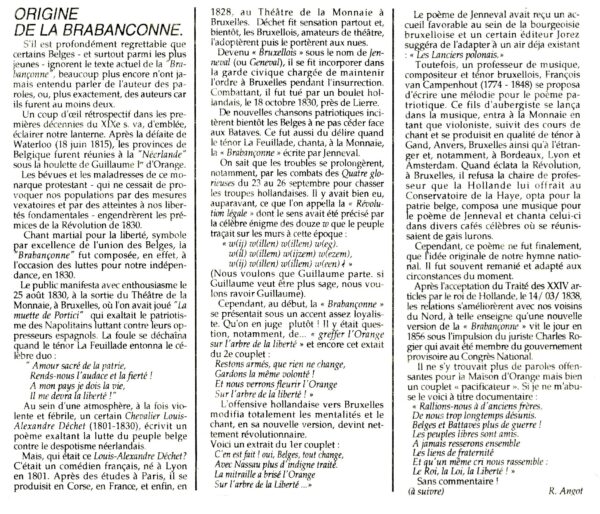
(Le Messager, 05/01/1996)

(LS, 27/07/1999)
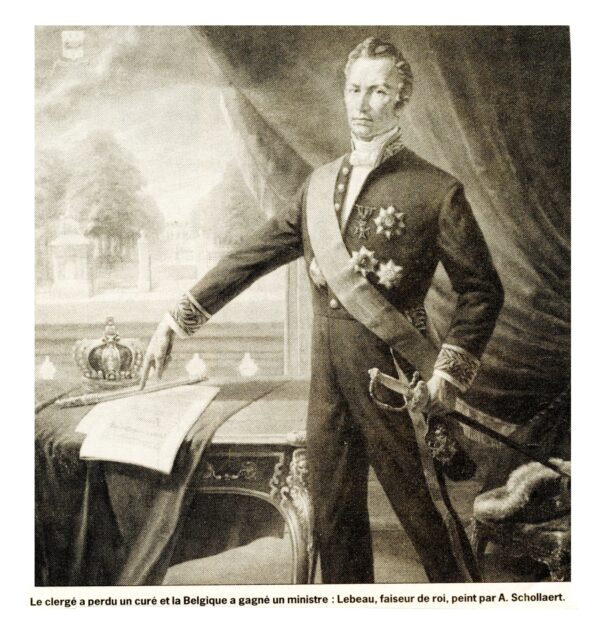
1830 - Joseph Lebeau
(in: LS, 23/07/1991)

1830 - La première campagne électorale en Belgique / Le constitution belge, la plus démocratique d'Europe


Louis Surlet de Chokier, uit Gingelom, eerste regent van België
(DS, 14/03/2005)


Lucien Jottrand (Genappe) a créé le drapeau belge
(VA, 19/11/2018)

1830
(Knack, 03/04/2020)

1830 - Comment la Pologne aida la Belgique à assurer son indépendance
(Yolanta Krafft-Grenet, in: LB, 1980s)


Les Flamands de 1830 - 1 les bobards et la vérité; 2 mourir pour Anvers ?; 3 Gand et ses orangistes
(Jo Gérard, in: LB, 1980s)




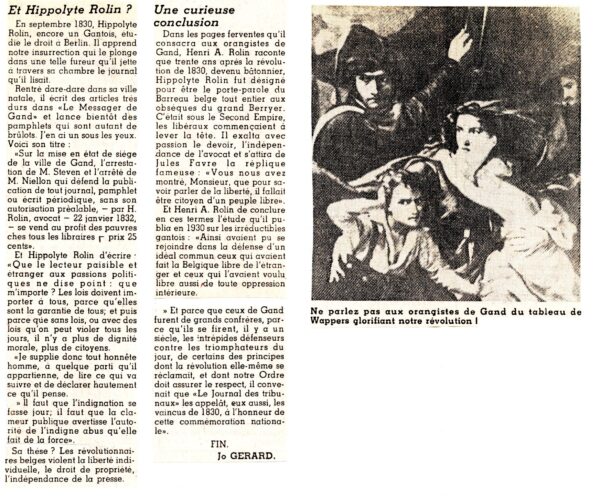
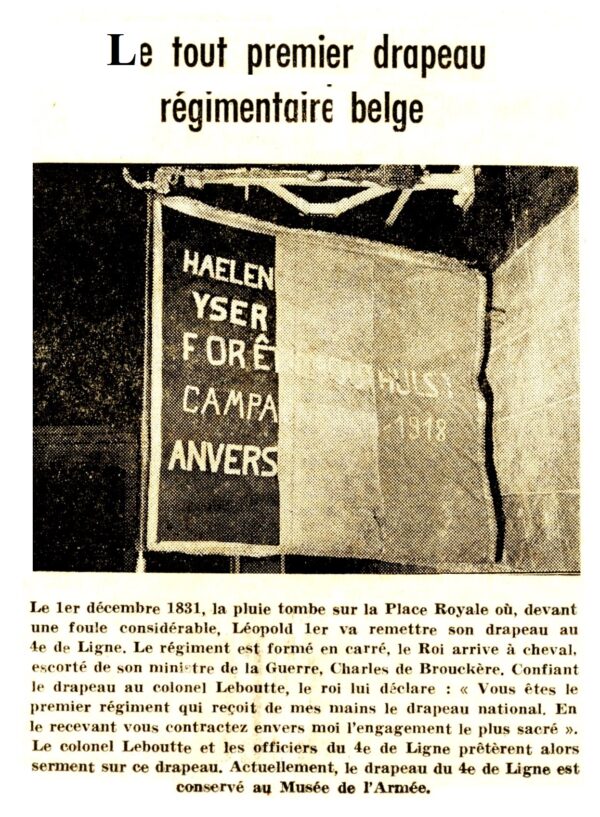
1831 - le tout premier drapeau régimentaire belge
(LB, 01/1974)

1831 - La Constitution belge de 1831 - Un modèle au siècle des nationalités
(LB, 07/06/2006)


Le 7 février 1831, la Belgique se dotait d'une constitution
(LS, 06/02/2006)

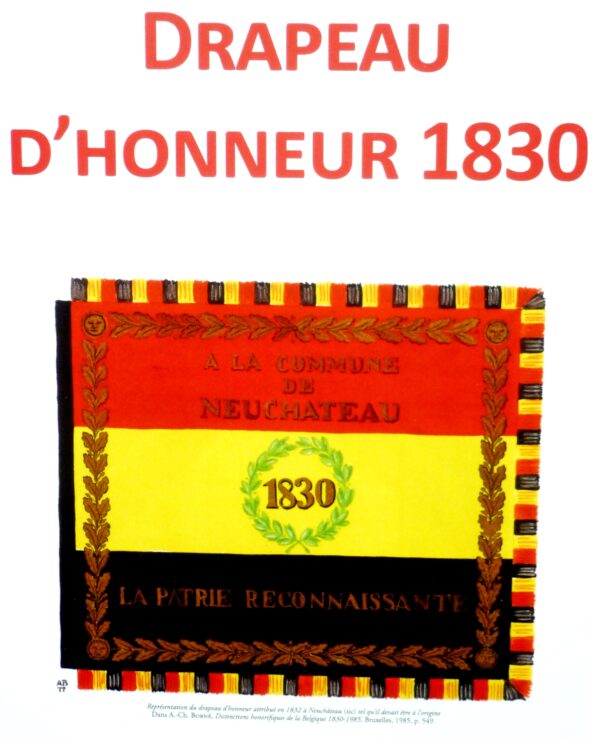
drapeau d'honneur 1830

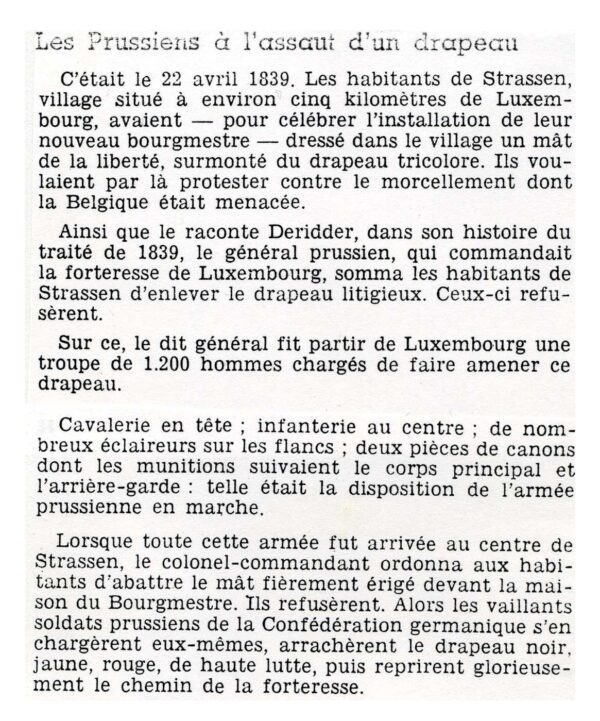
1839 - Grand-Duché - Les Prussiens à l'assaut d'un drapeau
(in: X. Michaelis, Arlon et la Révolution, 1964, éd. Dryade, Virton, p.34-35)

1930 - centenaire de l'indépendance de la Belgique
(Daniel Conraads, Visé, Terre de gildes, 2010, p.158)

2015 - Hermalle-sous-Argenteau - "L'union fait la force"

2017
Commémoration
Ce samedi 30 septembre, LE ROUX et le Groupe des Volontaire de 1830 du village commémoreront les Journées de Septembre 1830.
Vous êtes cordialement invités à rehausser de votre présence cette commémoration en Mémoire des Vaillants combattants de notre Indépendance.
Les porte-drapeaux sont attendus nombreux aux côtés du comité organisateur.
10h45 : Rendez-vous à la cafétéria du Hall Sportif « Michel Dargent », rue Grande, n° 33 à 5070 LE ROUX
11h00 : Départ du cortège vers la plaque commémorative de l’Indépendance fixée aux écoles communales – Discours et dépôts de gerbes.
11h30 : Cortège dans le centre du village et retour vers le Hall Sportif – Vin d’honneur offert par la ville de Fosses-la-Ville.
Possibilité de petite restauration.
Avec le plaisir chaleureux de vous rencontrer dans ce Relais de la Mémoire.
MERCI de diffuser cette invitation autour de vous pour réunir un maximum de porte-drapeaux.
Daniel Tilmant
