
L'impérialisme français en Belgique, une peste pour notre pays: la vérité en histoire
La France, ennemie de la Belgique depuis plus de 700 ans…
PLAN
1 Analyses
2 Documents
1 Analyses
Hans Van de Cauter, LA BELGIQUE, UNE COLONIE FRANCAISE? – BELGIË, EEN FRANSE KOLONIE?, 18/06/2012
LA BELGIQUE, UNE COLONIE FRANCAISE?
On ne pouvait ignorer à l’approche des élections françaises que les médias du régime antibelge et surtout ceux de la « communauté française » – en l’occurrence, la désignation est plus appropriée que celle de « Fédération Wallonië-Bruxelles » – ont suivi l’événement avec un intérêt plus qu’ordinaire. Il semblait comme si la Belgique était devenue le 120ème département – ou la 28ème région – de France. Toutefois, ne serait-ce déjà bien plus une réalité à l’heure actuelle que nous ne le pensons ? Ou est-ce une coïncidence que nos banques, notre secteur de gaz et d’électricité ainsi qu’une grande partie de notre secteur d’alimentation sont aux mains de Français?
Dans ce texte, nous examinerons la colonisation politique (et non économique) de la Belgique par la France, qui se manifeste surtout dans le sud du pays.
La Belgique est située à la croisée de deux (anciennes) grandes puissances, l’Allemagne et la France. Tout au long de notre histoire nationale, avant la Révolution belge de 1830, la France a essayé d’agrandir son influence dans nos régions. Après la fondation du Deuxième Empire Allemand en 1871, l’Allemagne l’a fait aussi, mais ces tentatives ont (probablement) pris fin avec l’effondrement de l’impérialisme allemand en 1945.

Le Traité de Verdun (843) – Het verdrag van Verdun (843)
1 LES ORIGINES : L’EMPIRE DU CENTRE
À la mort de Charlemagne (843) son empire – qui incluait la plupart de l’Europe de l’Ouest – fut partagé entre ses trois fils. L’Empire du Centre, qui revenait à Lothaire, englobait dans le Nord un territoire plus grand que l’actuel Benelux (à l’exception du comté de Flandre, qui devenait un fief français) dont le Rhin constituaient les frontières nord et est. Le centre de l’Empire comprenait un territoire, plus grand que l’actuelle Alsace-Lorraine. Au sud, cette région comprenait la Bourgogne, la Provence et la plus grande partie de l’Italie du Nord, y compris la Corse. Certaines parties de la Suisse actuelle appartenaient également à l’Empire du Centre. A l’ouest de ce Royaume se développait le noyau de ce qui est aujourd’hui la France, à l’est le noyau de l’Allemagne actuelle. L’Empire du Centre a rapidement été absorbé par ces deux territoires : en l’an 870 (traité de Meerssen), la division fut presque totale.
2 LES ROYAUMES BOURGUIGNONS
Cependant, la Bourgogne a échappé à cette division. L’histoire de la Belgique est étroitement liée au développement de cette région. Déjà en 407, le premier Royaume de Bourgogne a été fondé par les Bourguignons près de Worms, un Royaume qui a finalement été détruit par les Romains. Le deuxième Royaume (443-534) a été fondé dans la région de l’actuelle Bourgogne et fut finalement annexé à l’Empire des Francs, dont il fit partie jusqu’en 843.

les Francs: une tribu germanique - de Franken : een Germaanse stam
Entre parenthèses, les Francs constituent un peuple germanique apparaissant sous la forme d’une confédération de tribus au moment des grandes invasions. Une partie d’entre eux a joué un rôle central dans l’histoire française, des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne à compter de leur sédentarisation en Gaule Romaine . Ils ont donné leur nom à la France et aux Français (Wikipedia). Les Belges francophones sont donc en grande partie d’origine germanique…
Par le traité de Verdun, la Bourgogne a été divisée entre la France et l’Empire du Centre. Pendant les divisions de l’Empire du Centre le (troisième) royaume bourguignon a connu une renaissance (855-863). À la fin du 9ième siècle, il y avait trois Etats qui portaient le nom de Bourgogne : deux royaumes et un duché (° 888). Finalement, les deux royaumes furent absorbés par le Saint-Empire romain, sauf le comté de Bourgogne qui s’est formé en 867 (et qui fut un fief allemand jusqu’au 13ième siècle). Le duché tomba sous le pouvoir des rois français. En 1363, les ducs de Bourgogne ont réussi à acquérir le comté. Encore une fois, les Bourguignons ont essayé de transformer leurs possessions un (cinquième) Royaume.

Charles le Téméraire - Karel de Stoute (1433-1477)
Dans la période entre 1363 et 1477, les ducs de Bourgogne ont acquis, par mariages, par successions et par rentes, un empire composé de deux blocs : d’une part la Bourgogne historique au Sud, d’autre part, une zone plus grande que l’actuel Benelux au Nord. La tentative d’unification des deux territoires par Charles le Téméraire – pour restaurer partiellement l’Empire du Centre – échoua en 1477, quand celui-ci perdit la bataille de Nancy contre le Roi de France.
Lorsque le pouvoir bourguignon a atteint son apogée, l’empire bourguignon englobait (environ) le Bénélux actuel élargi par de grandes parties de la France actuelle (tant au Nord, qu’à l’Est et au Centre) voire d’une partie de l’Allemagne de l’Ouest. La principauté de Liège (qui englobait entre autres les provinces actuelles de Liège et du Limbourg) n’en faisait partie que durant une courte période et deviendrait ensuite un Etat indépendant jusqu’en 1795.

Bourgogne - Bourgondië (1477)
- LES ANNEXATIONS FRANCAISES JUSQU’AU 19ième SIECLE
Rappelons au lecteur que la nation belge est plus vieille que le Royaume de Belgique. Après la fondation de la Belgique par les ducs de Bourgogne au Moyen Âge, le territoire passa ensuite – au cours du 15ème siècle – en mains bourguignonnes. Le 4 novembre 1549, la Sanction Pragmatique fut éditée, par laquelle les Pays-Bas bourguignons devenaient juridiquement un pays un et indivisible.
Il y a un siècle, l’éminent historien néerlandais Huizinga remarqua: “Les Pays-Bas méridionaux [lire: la Belgique] devenaient à presque tous les égards la vraie extension, quoique coupée des deux côtés, de l’empire bourguignon. » (J. HUIZINGA, “Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef”, De Gids, éd. 76, 1ère partie, 1912, p. 487). Ainsi, il précisait d’abord que le Royaume de Belgique fut, comme on l’a indiqué, né de l’héritage bourguignon, mais aussi qu’au cours des siècles la Belgique avait perdu des territoires. Evidemment, le territoire perdu ne passait pas seulement à la Hollande, qui était reconnue comme un Etat indépendant en 1648, mais aussi, et surtout, à la France.
Les territoires historiquement belges suivants ont été annexés par la France au 15ème et au 16ème siècle: la Bourgogne (1477), Metz et Verdun (1552), Franche-Comté (1648), Lothaire (1648/1733), le comté d’Artois (1659), des parties de la Picardie et du Hainaut (1659), Dunkerque (1662), Lille (1668), Strasbourg et des parties du Luxembourg (1684). La Belgique a aussi perdu des territories à l’avantage de la Prusse, mais dans une moindre mesure (par exemple des parties du Luxembourg en 1815).

La Bataille de Fleurus (1794): une victoire française contre les Autrichiens en Belgique – de Slag bij Fleurus (1794): een Franse overwinning tegen de Oostenrijkers in België (1794)
A la fin du 18ème siècle, la France révolutionnaire déclencha une guerre contre les Pays-Bas habsbourgeois (autrichiens). De ce fait, la Belgique a été incorporée dans la France pour une période de plus de 20 années. Au 19ème siècle, la France a essayé d’annexer la Belgique – ou à tout le moins a planifié une telle démarche – en 1830, 1860 et 1880. Après l’échec de l’annexation territoriale, la France a soutenu le mouvement “wallon” (lire: francophone) et, ensuite, dans la deuxième moitié du vingtième siècle, le mouvement “flamand”.
- LES DEUX GUERRES MONDIALES
Avant la Première Guerre Mondiale (1905-1914), la campagne de propagande française a atteint un nouveau point culminant, notamment par l’octroi de subsides à certains journaux francophones belges, par des investissements dans des Expositions Universelles belges etc. Le wallingant Jules Destrée – qui ne participa cependant pas à ce mouvement pro-français – et le mouvement “wallon” trouvèrent un nouveau symbole en France: le coq. Jamais dans l’Histoire de la Belgique ce symbole n’avait été utilisé à des fins nationalistes. Le drapeau “wallon” était né.
L’invasion allemande de la Belgique du 4 août 1914 effaça de façon abrupte le statut de neutralité qui était imposé à notre pays par les grandes puissances depuis 1839. La Belgique se battit alors aux côtés du Royaume-Uni et de la France contre l’Empire allemand. Néanmoins, la Belgique n’était pas dans le camp des alliés. La France et la Grande Bretagne n’ont fait qu’aider notre pays, dont ils garantissaient la neutralité. Lorsque la guerre se termina en 1918, les Belges pouvaient choisir entre la neutralité et une alliance. Il va de soi que le prestige des alliés avait fort augmenté et que l’Allemagne – le pays qui avait détruit la Belgique et désorganisé sa politique – avait perdu tout son crédit de l’avant guerre.
Dans ce contexte, le 7 septembre 1920, un accord militaire franco-belge fut conclu. Selon les flamingants, cet accord était – et ils n’avaient pas tort – une expression de l’expansionisme français. Entretemps, l’on sait que la Cour royale belge y fut opposée. En 1933 – suite à la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne –la peur d’une intervention préventive de la France prit de l’ampleur dans des cercles diplomatiques belges (Bruno DE WEVER, Greep naar de macht, Tielt, 1994, pp. 192-194). Le 24 avril 1937, l’accord fut résilié et la Belgique revenait à sa politique de neutralité.
La Deuxième Guerre Mondiale mit de nouveau un terme à cette neutralité. Lorsque les troupes allemandes franchirent la frontière belge le 10 mai 1940, la Belgique fit appel à la France et au Royaume Uni. L’avancée allemande progressa rapidement et à la fin du mois de mai, l’armée belge fut totalement encerclée par les troupes allemandes. Le 25 mai 1940, cette situation causa une rupture entre le Roi Leopold III et ses ministres. Selon le gouvernement belge, la Belgique devait continuer la lutte en tant qu’allié de la France et du Royaume Uni. A l’encontre cet argument, le Roi défendait le point de vue que ces deux pays n’étaient que les “garants” de la neutralité belge. Il ne voulait pas que l’armée belge – dont la situation était devenue désespérée – fût sacrifiée pour les intérêts franco-anglais. Le 28 mai 1940, le Roi capitula. L’Etat-major et le gouvernement français le haïssait pour cette raison. Lors d’une allocution diffusée à la radio, le Premier Ministre français Paul Reynaud appellait cette soi-disant “trahison” un acte “sans précédent dans l’Histoire”. En passant, il reprocha subtilement au Roi belge d’avoir attribué la même valeur à un mot français qu’à un mot allemand jusqu’au 10 mai 1940 [il faisait référence au statut de neutralité que la Belgique avait adopté en 1937].
Sous pression française, le Premier Ministre belge, Pierlot, fut obligé de lire une déclaration par laquelle il avoua que le Roi avait commis une erreur, qu’il avait rompu son serment constitutionnel et s’était placé sous l’autorité de l’occupant. Ce fut la base de la “Question Royale”, qui influencerait l’Histoire de notre pays dans l’après-guerre.
- LA DEUXIEME MOITIE DU 20ième SIECLE
En 1945, le nationalisme flamand, qui s’était compromis par sa collaboration avec l’occupant allemand avait apparement tout à fait disparu. En apparence seulement, vu que les sanctions pour la collaboration (la soi-disant “répression” – mais il s’agit d’un terme qui a été inventé par les flamingants pour accuser à tort les autorités belges d’avoir infligé des peines excessives) étaient très clémentes (à la différence des sanctions en France et en Allemagne). Plusieurs collaborateurs condamnés à mort obtinrent une atténuation de leur peine, voire un pardon. Grâce à cela, les nationalistes flamands pouvaient se réorganiser à partir de 1950 et le mouvement antibelge “flamand” fut ranimé de façon remarquable au cours des années 1950. Cette reprise allait de pair avec une renaissance tout aussi remarquable des ressentiments wallingants gauchistes.
5.1. LA QUESTION ROYALE
Le 7 mai 1945, l’armée américaine libéra la Famille Royale, qui fut arrêtée par les Allemands le 7 juin 1944. Après la libération de la Belgique en septembre 1944, le Parlement avait décidé de confier au Prince Charles la régence du Royaume. Bien que le Roi eût souhaité rentrer en Belgique, les ministres furent divisés sur la question: les catholiques étaient pour, les autres contre. Cette situation provoqua l’éclatement de la coalition gouvernementale. Le 19 juillet, une loi fut adoptée visant à ne pas autoriser le retour du Roi sans que le parlement belge ne se prononce sur la fin de “l’impossibilité de régner” qui avait été décrétée par le gouvernement Pierlot en juin 1940, suite à la capitulation. Après les élections de 1949, une coalition entre catholiques et libéraux se mit en place. Ce gouvernement organisa, le 12 mars 1950, une consultation populaire sur le retour du Roi sur le trône.

Le résultat était que 57,68 % des Belges se déclaraient en faveur du retour du Roi (contre 42,32 % qui y étaient opposés). Les régionalistes “wallons” et “flamands” soulignent le fait que 72,2 % des soi-disant “Flamands” s’étaient montrés favorables au souverain tandis que 58 % des soi-disant “Wallons” y étaient opposés. Pourtant, dans toutes les provinces belges – hormis en Liège et au Hainaut – une majorité était en faveur du retour du Roi. Mais même dans la province de Liège, l’arrondissement de Verviers votait « oui » à 60 %. Les élections de juin 1950 amenèrent les sociaux-chrétiens seuls au pouvoir et mirent fin à l’impossibilité de régner du Roi. Léopold III revint le 22 juillet 1950. Entretemps, des manifestations et des grèves furent organisées, surtout par la FGTB, les socialistes, les communistes et le mouvement “wallon”. La tension atteignit son comble lorsque, le 30 juillet 1950, trois hommes furent abattus par la gendarmerie lors d’un meeting à Grâce-Berleur en banlieue liégeoise. Face aux violences, Léopold III prit la décision de transmettre ses pouvoirs à son fils Baudouin qui devint Prince Royal le 31 juillet 1950 (le prince devint “lieutenant général du Royaume” le 11 août 1950). À la suite de l’abdication de son père le 16 juillet 1951, Baudouin devenait le lendemain 17 juillet 1951 le cinquième Roi des Belges.
Quel était le rôle de la France durant cette période mouvementée?
Fin juillet 1950, quelques réunions eurent lieu à Liège, réunissant des syndicalistes socialistes, rejoints ensuite par des représentants d’autres partis politiques et du mouvement wallon. Parmi eux se trouvait un certain André Renard, dont on reparlera ci-après. Les révolutionnaires envisageaient la création d’un gouvernement “wallon”. La tâche de ce gouvernement aurait été d’entamer le processus menant à la scission du pays. Le gouvernement “wallon” aurait bénéficié d’une certaine sympathie de la part de la Grande-Bretagne où l’attitude du Roi pendant le deuxième conflit mondial avait été sévèrement critiquée. Un document, datant de 1964, précisa à cet égard : « en 1950, au moment de la question royale, il fut envisagé de constituer un gouvernement provisoire wallon, chargé de convoquer les Etats Généraux de Wallonië […] Le consul général de France, Jules-Daniel Lamazière avait, par ordre de son ambassadeur, promis le concours de deux régiments français pour soutenir le nouveau gouvernement wallon…» (F. SCHREURS, Quelques figures d’ancêtres, la famille Schreurs, Tome II, Liège, 1964, p. 118).
5.2. LES ANNEES SOIXANTE
C’était de nouveau André Renard qui était la figure de proue pendant la grève contre la Loi Unique de Gaston Eyskens en 1961, ce qui fit de lui un héros du mouvement “wallon”. Renard était même l’un des inventeurs du système (inconstitutionnel) de la fédéralisation. Trois ans plus tôt, il déclara:
« Notre cœur reste attaché à la France. Nous avons foi dans cette France qui, pour nous, est éternelle. […] C’est pourquoi nous terminons comme nous l’avons commencé, en criant : Vive la France ! » (André Renard dans « La Wallonië » le 13 juillet 1958). Par qui Renard fut-il inspiré? Par des agents français? Peut-être. Quoi qu’il en soit, le thème mérite une recherche beaucoup plus approfondie que celle qui a effectuée jusqu’à ce jour.
La résurgence subite du mouvement flamand dans les années 60 a été influencée par l’arrivée au pouvoir de Charles De Gaulle en France en janvier 1959. L’historien belge Vincent Dujardin le commenta ainsi (« Saga Belgica », Le Soir, juin 2008) : « D’après des rapports émanant de la Sûreté, [le Président De Gaulle] aurait de façon indirecte financé les partisans du “Walen buiten”, ce qui a conduit le gouvernement belge à s’opposer à une visite de sa part en Belgique en 1968 ».
La France, qui s’opposait au début du 20ème siècle à la néerlandisation de l’université de Gand aurait donc été partisane de la scission d’une université bilingue? Ce paradoxe n’est compréhensible que si l’on sait que vers 1910 la France espérait placer sous sa tutelle l’ensemble de la Belgique comme Etat satellite tandis que 60 années plus tard – la frontière linguistique fut délimitée entretemps – elle s’était concentrée sur le Sud de notre pays (et Bruxelles).

De Gaulle au Québec/in Québec (1967)
Cela explique pourquoi en 2009 la presse “belge” rapporta que le défunt Ministre d’Etat Hugo Schiltz de la Volksunie (le précurseur de la N-VA) estimait que les services secrets français étaient co-responsables de la radicalisation du nationalisme flamand en Belgique. Il n’y a d’ailleurs aucune raison de penser que la France agirait différemment à sa frontière Nord qu’au Québec (Canada), où elle soutenait – ou soutient toujours – le mouvement séparatiste. Lors d’une allocution à Montréal en juillet 1967, le président français De Gaulle prononça ces paroles historiques mais très peu diplomatiques: “Vive le Québec libre !”. Une semaine avant, il avait révélé à son fils le caractère explosif de cette phrase. Mais, selon De Gaulle, c’était nécessaire de le dire parce qu’il s’agissait de la dernière chance pour la France de se repentir de la “trahison” de la France. Il voulait dire que, selon lui, la France avait abandonné aux Britanniques quelques dizaines de milliers de colons français durant la Guerre de Sept Ans (1756-1763). La conscience historique française est donc très grande. La France aurait-elle déjà pardonné à la Belgique d’avoir acquis le Comté de Flandre au Moyen Âge, pourtant une dépendance française depuis des siècles?
Deux années avant ses déclarations au Québec – c’est-à-dire en 1965 – De Gaulle confia au ministre français de l’information, Alain Peyrefitte, ce qui suit:
« Si un jour une autorité politique représentative de la Wallonië s’adressait officiellement à la France, ce jour-là de grand cœur nous répondrions favorablement à une demande qui aurait toutes les apparences de la légitimité […] La politique traditionnelle de la France a toujours tendu à rassembler en son sein les Français de l’extérieur : la Wallonië a été exclue de ce rassemblement par un accident de l’Histoire. Elle a pourtant toujours vécu en symbiose avec nous, et ce depuis Alésia [où Vercingétorix fut battu par les troupes romaines en 52 avant J.C.] jusqu’au 18 juin 1940 [le jour de la capitulation de la France dans la Deuxième Guerre Mondiale] en se rangeant rapidement dans notre camp. C’est un drame pour le peuple wallon dont le passé est si remarquable de dépendre aujourd’hui d’un autre peuple qui ne fera rien d’autre que de l’étouffer en attendant de l’absorber un jour…»
En outre, l’ingérence française en Belgique ne se limitait et ne se limite pas aux affaires communautaires. Le 25 mars 1960, Georges Laperche, un professeur liégeois, partisan de l’indépendance de l’Algérie fut assassiné de façon brutale par les services secrets français. Deux autres Belges échappaient au même sort: chez l’un l’explosif avait pu être désamorcé et l’autre fut alerté par l’attentat commis contre Laperche (‘Libération’ du 24 mai 2001).
- DEVELOPPEMENTS RECENTS
Depuis la crise politique belge qui monta au début de ce siècle, Paris montre un intérêt plus que normal pour la politique intérieure belge. Dans ce processus, les Français peuvent également s’appuyer sur des politiciens “belges”. Ainsi, Daniel Ducarme, l’ancien « ministre-président » de la région bruxelloise et ancien président du MR déclara le 15 décembre 2007 dans les journaux Le Soir, La Libre Belgique et Libération: « Dans l’hypothèse où la Flandre […] continuerait à faire se dégrader les rapports nord-sud [alors] je militerai en faveur de la création d’un système d’association avec la France ».
Le 13 septembre 2010, des membres du PS français offrirent assistance au PS “belge” pour le cas où un Etat croupion “Wallonië-Bruxelles” serait créé. Beaucoup moins connu est le fait que le PS publia dès 2007 une brochure consacrée au rattachisme. On pouvait y lire qu’il n’y avait désormais plus qu’une seule alternative à la scission de la Belgique (“une Belgique résiduelle”), mais que “le rattachement/la réunion à la France était […] également aussi crédible, rassurant et attractif que la première hypothèse…” (P. HUBERT, Etat de la question; le rattachisme: une conviction en progrès en Wallonië?, Bruxelles, Inst. Em. Vandervelde, 2008, p. 8). Nous voulons souligner que le PS, tout comme les autres partis antibelges, est subsidié par le contribuable belge, ce qui est remarquable puisqu’il s’agit de clubs privés dont la constitution belge ne fait même pas état. Il en va de même pour des institutions séparatistes ou régionalistes comme l“l’Institut Emile Vandervelde” ou “l’Institut Jules Destrée”.

Le 2 septembre 2010, Philippe Moureaux (PS), auteur de nombreuses réformes de l’Etat, déclara que dans le contexte du processus de la scission de l’Etat belge, la cohésion entre la soi-disant “Wallonië” et Bruxelles devait être renforcée. Et il y ajouta: “on pourrait […] s’appuyer sur la France. Je ne trouve pas idiot d’y réfléchir”. Une semaine plus tard, Guy Spitaels, également membre du PS, s’interrogea: “Se rattacher à la France ? C’est une solution défendable, […] J’ai essayé de servir la Belgique comme vice-Premier. Mais y suis-je affectivement attaché ? Je ne cherche pas de subterfuge, ma réponse est non.” (Guy Spitaels, ancien “ministre-président” de la région wallonne et Ministre d’Etat, Le Soir, 9 septembre 2011).
En 2011, des agents français entreprirent une mission en Belgique lors de laquelle ils ont interrogé maints politiciens, journalistes et professeurs belges et dont a résulté un rapport volumineux sur la “question belge” (voir notre article là-dessus).
L’on sait également que des “rattachistes” notoires – ceux qui veulent “réunir” la “Wallonië” à la France – sont soutenus ouvertement par des politiciens français. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l’extrême gauche aux présidentielles déclara à la RTBF d’être “fou de joie” si les “Wallons” se “rattachaient” à la France (LLB, 15.04.12). La candidate du Front National, Marine Le Pen, a fait une déclaration semblable pendant la campagne présidentielle de 2012. D’ailleurs, elle avait déclaré un an plus tôt, à l’occasion de la fête nationale belge (20 juillet 2011) que si la “Flandre” devenait indépendante, une hypothèse de plus en plus réaliste selon Le Pen, “la République française s’honorerait d’accueillir en son sein la Wallonië”.

Le coq "wallon": un symbole français - de "Waalse" haan: een Frans symbool
Certes, on peut juger ces déclarations insignifiantes, mais Mélenchon et Le Pen ont obtenu des millions de voix aux élections présidentielles françaises. De plus, le RWF, un parti “rattachiste” écrivit il y a peu de temps: “Il faut savoir que notre président fondateur Paul-Henry Gendebien envoie ses ouvrages […] aux plus hautes personnalités françaises, dont des Ministres qu’ils soient de droite ou de gauche […] On serait étonné du nombre de remerciements accompagnés de quelques mots d’adhésion à notre projet, d’encouragement ou plus simplement de sympathie qu’il a reçus en retour…” (communiqué de presse du 14 avril 2012).
On veut bien le croire. Des « rattachistes » belges sont les bienvenus au Sénat français où ils ont été accueillis il y a quelques années sans que quelqu‘un en Belgique ne s’en soit ému. Le quotidien Le Soir écrivait à l’époque: “Il a fallu changer de salle car plus de cent personnalités avaient répondu à l’invitation. A l’entrée, ils recevaient une brochure intitulée «La scission de la Belgique», rédigée par François Perin et éditée par l’antenne française des rattachistes. Dans la salle, il y avait évidemment des sénateurs dont deux anciens ministres, des généraux, deux ambassadeurs et un haut fonctionnaire des Affaires étrangères, mêlé en 1967 au fameux voyage du général de Gaulle au Québec («Vive le Québec libre !»).” (Le Soir, 18 janvier 1997).
En passant, le B.U.B. souligne que mener une propagande contre l’Etat belge avec de l’aide étrangère constitue un délit punissable (l’article 135bis du Code pénal).
CONCLUSION: La colonisation politique (et économique) de la Belgique par la France fait partie d’une très ancienne géopolitique impérialiste française. Cette pensée politique est inspirée par la “théorie des frontières naturelles”, qui implique la volonté de s’offrir des frontières naturelles (à savoir: le Rhin). A travers les siècles, les moyens et la tactique ont changé, mais le but est resté le même. On peut confirmer avec une quasi-certitude que, si la Belgique implosait, la soi-disant “region wallonne” chercherait d’une manière ou d’une autre à se rapprocher de la France. Il existe déjà des indices en ce sens. Evidemment, l’expansion française ne se limiterait pas au sud de la Belgique, mais engloberait également (et au moins) Bruxelles, Fourons et les communes à facilités. Il va de soi que dans ce scénario un Etat croupion “flamand” n’aurait parfaitement rien à dire.
Par ailleurs, on ne peut perdre de vue que la Belgique a déjà perdu le Limbourg néerlandais et le Grand-Duché de Luxembourg, abandonnés à la Hollande en 1839. La Belgique perdit déjà la Flandre zélandaise et le Brabant septentrional avant. La Prusse, quant à elle, s’était accaparée de la Rhénanie. De la Grande Belgique médiévale s’étendant de Breskens à Bâle et de Düsseldorf à Amiens, il n’en reste déjà pas grand’ chose à l’heure actuelle.
En d’autres termes, les nationalistes « flamands » qui militent pour la destruction de la Belgique sont en réalité au service du Quai d’Orsay à Paris et sont par conséquent les meilleurs alliés de l’impérialisme français.
BELGIË, EEN FRANSE KOLONIE?
Je kon er in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen moeilijk naast kijken: de anti-Belgische regimemedia, en vooral die in de “Franse gemeenschap” – de benaming is in casu toepasselijker dan de “Communauté Wallonië-Bruxelles” – schonken aan dit evenement een meer dan gewone belangstelling. Het leek wel alsof België het 102de departement – of de 28ste regio – van Frankrijk was geworden. Maar is dat vandaag al niet meer het geval dan we denken? Of is het soms toeval dat onze banken, onze gas- en elektriciteitsector alsook een groot deel van onze voedingssector in Franse handen zijn?
In deze tekst bespreken we niet de economische, maar de politieke kolonisatie van België door Frankrijk, die vooral in het zuiden van het land waarneembaar is.
België ligt op het kruispunt van twee (gewezen) grootmachten, Frankrijk en Duitsland. Doorheen heel onze nationale geschiedenis, dus van vóór de Belgische revolutie van 1830, heeft Frankrijk zijn invloed in onze streken proberen te vergroten. Duitsland deed dat ook na 1871, maar aan die pogingen kwam (vermoedelijk) een einde met de ineenstorting van het Duitse imperialisme in 1945.

Le Partage de l'Empire carolingien au Traité de Verdun/De opdeling van het Karolingische Rijk bij het verdrag van Verdun (843)
- VOORGESCHIEDENIS : HET MIDDENRIJK
Bij de dood van Karel de Grote (843) werd zijn Rijk – dat het grootste deel van West-Europa omvatte – opgedeeld tussen zijn drie zonen. Het zogenaamde Middenrijk, dat Lotharius toekwam, omvatte in het noorden een territorium, groter dan de huidige Benelux (met uitzondering van het graafschap Vlaanderen, dat een Franse leen werd), waarvan de noord- en oostgrens de Rijn was. Het centrum van het Rijk omvatte een territorium, groter dan het huidige Elzas-Lotharingen, het Zuiden een gebied dat liep over Bourgondië, de Provence, het grootste deel van Noord-Italië m.i.v. Corsica. Ook delen van het huidige Zwitserland waren behoorden tot het Middenrijk. Ten westen van dit Rijk ontwikkelde zich de kern van wat vandaag Frankrijk is, ten oosten ervan de kern van het huidige Duitsland. Het Middenrijk ging al snel op in deze twee staten: in het jaar 870 (verdrag van Meerssen) was de verdeling bijna totaal.
- DE BOURGONDISCHE RIJKEN
Bourgondië ontsnapte echter aan deze opdeling. De geschiedenis van België is nauw verweven met de ontwikkeling van dit gebied. Al in 407 werd door de Bourgondiërs het eerste Koninkrijk Bourgondië in de streek van Worms gesticht, dat uiteindelijk door de Romeinen ten gronde gericht werd. Het tweede Koninkrijk (443-534) werd gesticht in de streek van het huidige Bourgondië en uiteindelijk geassimileerd in het Frankische Rijk, waar het tot 843 deel van zou uitmaken.
Tussen haakjes, de Franken zijn een Germaans volk dat tijdens de periodes van de grote volksverhuizingen bestond in de vorm van een stammenconfederatie. Een deel van hen speelde vanaf hun nederzetting in Romeins Gallië een grote rol in de geschiedenis van Frankrijk, Nederland, België en Duitsland. Zij hebben hun naam aan Frankrijk en de Fransen gegeven (Wikipedia). De Franstalige Belgen zijn dan ook grotendeels van Germaanse oorsprong…
Bij het verdrag van Verdun werd Bourgondië opgedeeld tussen Frankrijk en het Middenrijk. Bij de verdelingen van het Middenrijk leefde het (derde) Koninkrijk opnieuw kortstondig op (855-863). Aan het einde van de 9de eeuw ontstonden er drie staten die de naam Bourgondië droegen: twee koninkrijken en een Hertogdom (°888). Beide koninkrijken werden uiteindelijk geabsorbeerd door het Heilig Roomse Rijk, op het Graafschap Bourgondië na dat in 867 ontstaan was (en tot de 13de eeuw een Duitse leen was). Het Hertogdom kwam onder de macht van de Franse koningen. In 1363 slaagden de hertogen van Bourgondië erin om het Graafschap te verwerven. Nog eenmaal poogden de Bourgondiërs hun rijk in een (vijfde) Koninkrijk om te smeden.
In de periode tussen 1363 en 1477 verwierven de hertogen van Bourgondië door huwelijken, erfopvolging en door lijfrentes een gebied dat uit twee blokken bestond: enerzijds het historische Bourgondië en anderzijds een gebied in het Noorden, uitgestrekter dan de huidige Benelux. De poging tot vereniging van beide territoria door Karel de Stoute – om zo het Middenrijk deels te herstellen – mislukte in 1477 toen hij de slag bij Nancy tegen de Franse koning verloor.
Op het hoogtepunt van de Bourgondische macht omvatte het Bourgondisch Rijk (ongeveer) de huidige Benelux, aangevuld met grote delen van het huidige Noord-, Oost- en Midden-Frankrijk en zelfs met een deel van het westen van Duitsland. Het Prinsbisdom Luik (dat o.a. de huidige provincies Luik en Limburg omvatte) kwam slechts gedurende een korte tijd onder het Bourgondisch gezag en zou tot 1795 een onafhankelijke staat vormen.

Leo Belgicus: La Belgique pendant le 16è siècle - België in de 16de eeuw
- DE FRANSE ANNEXATIES TOT DE 19de EEUW
We herinneren de lezer eraan dat de Belgische natie, ouder is dan het Koninkrijk België. Na de oprichting van België door de Bourgondische hertogen in de middeleeuwen ging het gebied vervolgens – tijdens de 15de eeuw – in Habsburgse handen over. Op 4 november 1549 werd de Pragmatieke Sanctie uitgevaardigd waardoor de Habsburgse Nederlanden de iure een één en ondeelbare staat werden.
Een eeuw geleden merkte de eminente Nederlandse historicus Huizinga op: “De Zuidelijke Nederlanden [lees: België] werden in bijna alle opzichten de echte, maar aan weerszijden gesnoeide uitgroei van de Bourgondische staat” (J. HUIZINGA, “Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef”, De Gids, 1ste deel, jg. 76, 1912, p. 487). Hij bedoelde daarmee allereerst dat het Koninkrijk België, zoals aangegeven, uit de Bourgondische erflanden ontstaan was, maar ook dat het doorheen de eeuwen territorium verloren had. Natuurlijk ging het verloren grondgebied niet alleen naar Noord-Nederland dat in 1648 als een onafhankelijke staat erkend werd, maar ook en vooral naar Frankrijk.

Arras/Atrecht: jadis une ville belge - eertijds een Belgische stad
Volgende historisch Belgische gebieden werden door Frankrijk in de 15de en in de 16de eeuw geannexeerd: Bourgondië (1477), Metz en Verdun (1552), Franche-Comté (1648), Lotharingen (1648/1733), Artesië (1659), delen van Picardië en Henegouwen (1659), Duinkerke (1662), Rijsel (1668), Straatsburg en delen van Luxemburg (1684). Ook aan Pruisen gingen (in mindere mate) territoria verloren: zo bijvoorbeeld delen van Luxemburg in 1815.
Aan het einde van de 18de eeuw ontketende het revolutionaire Frankrijk een oorlog tegen de Habsburgse (Oostenrijkse) Nederlanden. Daardoor werd België zonder meer ingelijfd bij Frankrijk en dit voor een periode van 20 jaar. Tijdens de 19de eeuw heeft Frankrijk België proberen te annexeren – of tenminste plannen in die richting gesmeed – en dit zowel in de jaren 1830 als in de jaren 1860 en 1880. Toen de territoriale annexatie mislukte, heeft Frankrijk de “Waalse” (lees: francofone) en vervolgens, in de tweede helft van de twintigste eeuw, de “Vlaamse” beweging gesteund.
- DE TWEE WERELDOORLOGEN
In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog (1905-1914) bereikte de Franse propagandaslag een hoogtepunt, o.a. door subsidies aan bepaalde Franstalige dagbladen, door grote investeringen in Belgische Wereldtentoonstellingen enz.. De wallingant Jules Destrée – die zich weliswaar buiten de pro-Franse collaboratie zou houden – en de “Waalse” beweging vonden een nieuw symbool in Frankrijk: de haan. Nooit eerder in de Belgische geschiedenis werd dit symbool voor nationalistische doeleinden gebruikt. De “Waalse” vlag was geboren.
De Duitse inval in België maakte op 4 augustus 1914 abrupt een einde aan het neutraliteitstatuut dat ons land sedert 1839 door de grootmachten was opgelegd. België streed nu aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegen het Duitse Rijk. Wel behoorde België niet tot het kamp van de geallieerden. Frankrijk en Groot-Brittannië snelden enkel het land ter hulp waarvan ze de neutraliteit garandeerden. Toen de oorlog in 1918 eindigde, stond het de Belgen vrij om opnieuw te kiezen voor neutraliteit of om een alliantie aan te gaan. Het spreekt voor zich dat de geallieerden enorm aan sympathie en prestige gewonnen hadden en Duitsland – dat ons land verwoest en politiek ontwricht had – was al zijn vooroorlogse krediet kwijtgespeeld.
In deze context werd op 7 september 1920 een Franco-Belgisch militair akkoord gesloten. De Vlaamsgezinden zagen hier – niet onterecht – een uiting van Frans expansionisme in. Ondertussen weten we dat het Belgische Hof een tegenstander was van het akkoord. In 1933 – vlak na de machtsovername van de nazi’s in Duitsland – rees in Belgische diplomatieke kringen de angst voor een preventieve interventie van Frankrijk (Bruno DE WEVER, Greep naar de macht, Tielt, 1994, pp. 192-194). Op 24 april 1937 werd het akkoord opgezegd en keerde België terug naar zijn neutraliteitspolitiek.

Propagande anti-dynastique et anti-belge de la France - anti-dynastieke en anti-Belgische Franse propaganda
De Tweede Wereldoorlog maakte wederom een einde aan deze neutraliteit. Toen de Duitse troepen op 10 mei 1940 de Belgische grens overschreden, riep België de hulp in van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse opmars vorderde snel en eind mei 1940 was het Belgisch leger volledig ingesloten door Duitse troepen. Op 25 mei 1940 leidde die situatie tot een breuk tussen Koning Leopold III en zijn ministers. Volgens de Belgische regering diende België verder te strijden als geallieerde van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Koning bracht tegen deze zienswijze in dat die twee landen slechts “garanten” waren van de Belgische neutraliteit. Hij wenste niet langer dat het Belgisch leger – waarvan de situatie hopeloos werd – opgeofferd werd voor de Anglo-Franse belangen. Op 28 mei 1940 capituleerde de Koning. In Franse leidende kringen werd hij hiervoor gehaat. In een radiotoespraak noemde de Franse Eerste Minister Paul Reynaud dit zogezegd “verraad” een daad “zonder voorgaande in de geschiedenis”. Terloops verweet hij nog fijntjes de Belgische Koning tot op 10 mei 1940 dezelfde waarde aan een Frans als aan een Duits woord gegeven te hebben [dit was een vingerwijzing naar het in 1937 aangenomen neutraliteitsstatuut van ons land]. Onder Franse druk werd de Belgische premier, Pierlot, verplicht om een verklaring voor te lezen waarin hij stelde dat de Koning een fout had gemaakt, zijn grondwettelijke eed verbroken had en zich onder het gezag van de bezetter geplaatst had. Hier ligt de oorsprong van de “Koningskwestie”, die de geschiedenis van ons land in de jaren na de oorlog zou tekenen.
- DE TWEEDE HELFT VAN DE 20ste EEUW
In 1945 was het Vlaams-nationalisme, dat zich voor een tweede maal gecompromitteerd had door collaboratie met de Duitse bezetter schijnbaar volledig van de kaart geveegd. Schijnbaar aangezien de sancties voor collaboratie (de zogenaamde “repressie” – maar dat is een term die door de Vlaams-nationalisten werd uitgevonden om de Belgische overheid onterecht van excessen te beschuldigen) zeer mild waren (in tegenstelling tot de sancties in Nederland en Frankrijk). Heel wat ter dood veroordeelde collaborateurs kregen strafvermindering of zelfs strafkwijtschelding. Daardoor konden de Vlaams-nationalisten zich vanaf de jaren 1950 hergroeperen en beleefde de anti-Belgische “Vlaamse” beweging in de jaren 1960 een opmerkelijke heropleving. Die opleving ging gepaard met een al even opmerkelijke opwelling van wallingantische ressentimenten aan de linkerzijde.

5.1. DE KONINGSKWESTIE
Het Amerikaanse leger bevrijdde de Koninklijke Familie – die door de Duitsers gevangen genomen was op 7 juni 1944 – op 7 mei 1945. Bij de bevrijding van België in september 1944 had het Parlement besloten om Prins Karel het regentschap van het Koninkrijk toe te vertrouwen. Hoewel de Koning naar België wou terugkeren, waren de ministers verdeeld over de kwestie: de katholieken waren voorstanderen, de anderen niet. Deze situatie leidde tot de val van de coalitie van Eerste Minister Achille Van Acker. Op 19 juli, werd een wet aangenomen, ertoe strekkende om een koninklijke terugkeer slechts dan toe te laten, wanneer het Belgische Parlement zich uitsprak over het einde van de “onmogelijkheid om te regeren”. Die toestand was uitgevaardigd in juni 1940 door de regering Pierlot, volgend op de capitulatie. Na de verkiezingen van 1949, kwam een coalitieregering tussen katholieken en liberalen tot stand. Deze regering hield op 12 maart 1950 een volksraadpleging over de terugkeer van de Koning op de troon.
Het resultaat was dat 57,68 % van de Belgen zich een voorstander verklaarde van de terugkeer van de Koning (tegen 42,32 % die tegen waren). De “Waalse” en “Vlaamse” regionalisten benadrukken het feit dat 72,2 % van de zogenaamde Vlamingen” voorstander van de terugkeer van de Koning waren, terwijl 58 % van de zogenaamde “Walen” tegen waren. Nochtans was er in alle Belgische provincies – Luik en Henegouwen daargelaten – een meerderheid voorstander van de terugkeer van de Koning. Zelfs in de provincie Luik, stemde het arrondissement Verviers vota « ja » (60 % « ja »-stemmen ). De verkiezingen van 1950 brachten de christen-democraten alleen aan de machten en zorgden voor het einde van ’s Konings onmogelijkheid om te regeren. Op 22 juli 1945 keerde Leopold III terug. Ondertussen warden betogingen en stakingen georganiseerd, vooral door de FGTB, de socialisten, de communisten en de “Waalse” beweging. Op 30 juli 1950, toen drie mannen door de rijkswacht tijdens een samenkomst in Grace-Berleur, een Luikse voorstad, neergekogeld werden. Tegenover het geweld, besloot Leopold III om zijn machten aan zijn zoon Boudewijn over te dragen op 31 juli 1950 toen hij Kroonprins werd (op 11 augustus werd de Prins ‘luitenant-generaal’ van het Koninkrijk). Volgend op de troonsafstand van zijn vader (16 juli 1951), werd Boudewijn de vijfde Koning der Belgen op 17 juli 1951.
Wat was de rol van Frankrijk tijdens deze bewogen periode?
Eind juli 1950 vonden enkele samenkomsten plaats in Luik, met socialistische syndicalisten, gesteund door vertegenwoordigers van andere politieke partijen en van de Waalse beweging. Onder hen bevond zich André Renard, over wie we het later nog zullen hebben. De revolutionnairen stelden de creatie van een “Waalse” regering in het vooruitzicht. De taak van die regering zou geweest zijn om het splitsingsproces van het land op gang te trekken. De “Waalse” regering zou kunnen gerekend hebben op een zekere sympathie van Groot-Brittanië waar de houding van de Koning tijdens de Tweede Wereldoorlog streng veroordeeld werd. Een document uit 1964 verduidelijkt: « in 1950, tijdens de Koningskwestie, werd in overweging genomen om een voorlopige Waalse regering in te stellen, gevolmachtigd om een Staten-Generaal van Wallonië samen te roepen. […] De consul-generaal van Frankrijk, Jules-Daniel Lamazière had, op bevel van zijn ambassadeur, beloofd om twee Franse regimenten in te zetten om de nieuwe Waalse regering te steunen…“(F. SCHREURS, Quelques figures d’ancêtres, la famille Schreurs, Tome II, Luik, 1964, p. 118).
5.2. DE JAREN 60

André Renard
Renard, die door de staking tegen de Eenheidswet van Gaston Eyskens (1961) een legende werd in de “Waalse” beweging en mee aan de oorsprong lag van het (ongrondwettelijke) federaliseringsproces. Drie jaar eerder had dat zelfde heerschap al geschreven:
“Ons hart blijft gehecht aan Frankrijk. Wij hebben vertrouwen in Frankrijk, dat voor ons eeuwig is […] Daarom eindigen we zoals we begonnen met de uitroep: “leve Frankrijk!” (André Renard in La Wallonië, 13 juli 1958). Door wie werd Renard geïnspireerd? Door Franse agenten? Het thema verdient alleszins een veel breedvoeriger onderzoek dan tot op heden het geval was.

Paul VAN DEN BOEYNANTS (CVP-PSC): un grand Homme d'Etat belge - een groot Belgisch Staatsman
De heropleving van de “Vlaamse” beweging is alleszins deels te wijten aan het aan de macht komen van Charles De Gaulle in januari 1959 in Frankrijk. De Belgische historicus Vincent Dujardin zei hierover (« Saga Belgica », Le Soir, juni 2008) : « Volgens verslagen van de staatsveiligheid zou [de Franse President De Gaulle] onrechtstreeks de aanhangers van “Walen buiten” [dus zij die de tweetalige Leuvense universiteit wouden splitsen] gefinancierd hebben, wat er de Belgische regering toe gebracht heeft zich te verzetten tegen zijn bezoek aan België in 1968. ». Frankrijk, dat zich aan het begin van de 20ste eeuw verzette tegen de vernederlandsing van de universiteit van Gent zou dus plots voorstander zijn van een splitsing van een tweetalige universiteit? Deze schijntegenstelling wordt pas begrijpelijk wanneer men begrijpt dat ca. 1910 Frankrijk erop hoopte héél België als Franstalige satellietstaat binnen zijn invloedssfeer te krijgen, terwijl het 60 jaar later – de taalgrens was inmiddels afgebakend – eerst zijn zinnen op het zuidelijke deel van ons land (en op Brussel) zou zetten.
Dat verklaart waarom men in 2009 in de “Belgische” pers kon lezen dat wijlen Minister van Staat Hugo Schiltz van de Volksunie (de voorloper van de N-VA) de Franse geheime dienst mede aansprakelijk achtte voor de radicalisering van het Vlaams-nationalisme in België. Er is trouwens geen zinnige reden om aan te nemen dat Frankrijk aan zijn noordgrens anders zou handelen dan het in Québec (Canada) doet, waar het de separatistische beweging openlijk steunde of nog steeds steunt. In een toespraak van de Franse president De Gaulle in juli 1967 in het Canadese Montréal sprak hij immers de historische, maar zeer ondiplomatische woorden uit: “Vive le Québec libre !”. Een week tevoren had hij zijn schoonzoon toevertrouwd dat die zin als een bom zou inslaan. Maar het moest volgens De Gaulle gebeuren want het was de laatste kans voor Frankrijk om berouw te tonen voor het “verraad” van Frankrijk. Daarmee bedoelde hij dat, naar zijn aanvoelen, Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) door zijn verlies in Noord-Amerika enkele tienduizenden kolonisten in de steek had gelaten ten voordele van de Britten. Het Franse historisch besef is dus erg groot. Zou Frankrijk het België al vergeven hebben dat het in de middeleeuwen het graafschap Vlaanderen verkreeg, dat nochtans eeuwenlang een Franse leen was?
Twee jaar vóór zijn verklaringen in Québec – in 1965 – vertrouwde De Gaulle de toenmalige Franse minister van informatie Alain Peyrefitte toe: “Als er op een dag een vertegenwoordigende “Waalse” overheid zich officieel tot Frankrijk zou richten, dan zullen wij op die dag met een groot hart gunstig antwoorden op een vraag die alle schijn van wettelijkheid heeft […] Het is de traditionele politiek van Frankrijk om in zijn schoot Fransen uit het buitenland te verzamelen: “Wallonië” is van die eenheid uitgesloten door een ongeluk van de geschiedenis. Nochtans leefde ze altijd met ons in een symbiose en dat vanaf Alesia [de plaats waar Vercingetorix door de Romeinse troepen in 52 v.C. werd verslagen] tot aan 18 juni 1940 [de dag van de capitulatie van Frankrijk in Wereldoorlog II]. Het is een drama voor het “Waalse” volk om vandaag af te hangen van een ander volk dat niets anders zal doen dan het te versmachten in afwachting van de opslorping…”.
Overigens beperkte en beperkt de Franse inmenging in België zich niet alleen tot communautaire aangelegenheden. Zo werd op 25 maart 1960 Georges Laperche, een Luikse professor die voorstander was van de Algerijnse onafhankelijkheid, op een brutale wijze vermoord door de Franse geheime dienst. Twee andere Belgen ontsnapten aan dit lot: bij de ene werkte het bompakket niet meteen en kon het buiten werking gesteld worden. De andere werd verwittigd door de gelukte bomaanslag op Laperche (Libération, 24 mei 2001).
- RECENTE ONTWIKKELINGEN
Sedert de Belgische politieke crisis die begin deze eeuw opflakkerde, wordt er vanuit Parijs een meer dan gewone belangstelling voor de Belgische binnenlandse politiek aan de dag gelegd. Daarbij kunnen de Fransen ook steunen op “Belgische” politici. Zo verklaarde wijlen Daniël Ducarme, oud-« minister president » van het Brussels gewest en oud-voorzitter van de MR op 15 december 2007 in de bladen Le Soir, La Libre Belgique en Libération: “Indien ‘Vlaanderen’ […] zou blijven doorgaan met de verslechtering van de relaties tussen het Noorden en het Zuiden, dan zal ik voorstander zijn van de creatie van een Franstalig België, dat met Frankrijk geassocieerd is”.

Guy Spitaels
Op 13 september 2010 boden Franse PS’ers Franse bijstand inzake defensie aan de “Belgische” PS aan voor het geval er een “Waals”-Brusselse rompstaat zou ontstaan. Veel minder geweten is dat de PS al in 2008 een brochure wijdde aan het rattachisme. Daarin stond dat er niet langer één alternatief was voor een splitsing van België (“een rest-België”), maar dat “de vereniging/hereniging met Frankrijk (…) ook even geloofwaardig, verzekerend en aantrekkelijk is als de eerste hypothese…” (P. HUBERT, Etat de la question; le rattachisme: une conviction en progrès en Wallonië?, Brussel, Inst. Em. Vandervelde, 2008, p. 8). Hierbij willen we ook aanstippen dat de PS, net zoals de andere anti-Belgische partijen, betaald worden met geld van de Belgische belastingbetaler, wat opmerkelijk is aangezien het hier louter om privé-clubs gaat, die niet in de Belgische grondwet vermeld worden. Datzelfde geldt voor de separatische of extreem-regionalistische instellingen zoals het “Institut Emile Vandervelde” en het “Institut Jules Destrée”.
Op 2 september 2010 verklaarde Philippe Moureaux (PS), één van de oudgedienden van de vele “staatshervormingen”, dat in de context van een scheidingsproces van de Belgische staat de cohesie tussen het zogenaamde “Wallonië” en Brussel versterkt diende te worden. En hij voegde er aan toe: “men zou [daarbij] op Frankrijk kunnen steunen. Ik vind het niet idioot om daarover na te denken”. Een week later sprak zijn partijgenoot Guy Spitaels op dezelfde wijze: “Zich aanhechten bij Frankrijk? Het is een verdedigbare mogelijkheid […] Ik heb geprobeerd België als vice-premier te dienen. Maar ben ik er emotioneel mee verbonden? Ik zoek geen uitvlucht: het antwoord is ‘neen’” (Guy Spitaels, oud “minister-president” van het Waals gewest en “Minister van Staat”, Le Soir, 9 september 2011).
In de loop van 2011 ondernamen Franse agenten een onderzoeksmissie in België, waarbij ze talloze Belgische politici, journalisten en professoren ondervroegen en die resulteerde in een lijvig rapport over de “Belgische kwestie” .

Propagande "rattachiste" - "rattachistische" propaganda
Het is trouwens bekend dat notoire “rattachisten” – personen die Zuid-België met Frankrijk willen “herenigen” – openlijk steun krijgen van Franse politici. Jean-Luc Mélenchon, de uiterst-linkse presidentskandidaat, verklaarde op de RTBF “dol van vreugde te zijn” als de “Walen” zich bij Frankrijk zouden aansluiten (LLB, 15.04.12). De Franse presidentskandidate van het Front National, Marine Le Pen, deed tijdens de Franse presidentscampagne van 2012 een gelijkaardige uitspraak. Overigens stelde ze een klein jaar tevoren, aan de vooravond van de Belgische nationale feestdag (20 juli 2011), in een communiqué dat als “Vlaanderen” onafhankelijk wordt, een hypothese die volgens Le Pen steeds reëler wordt, “de Republiek Frankrijk vereerd [zal] zijn Wallonië in zijn schoot op te nemen” en dat wegens de grote “historische broederbanden”.
Nu kan men die uitspraken onbetekenend vinden, maar de Mélenchon en Le Pen behaalden wel miljoenen stemmen tijdens de Franse presidentsverkiezingen. Bovendien schreef de “rattachistische” RWF onlangs: “Men moet weten dat onze stichter-voorzitter Paul-Henri Gendebien zijn boeken […] aan de hoogste Franse dignitarissen opstuurt, waaronder ministers van de linker- en de rechterzijde. Men zou verwonderd zijn over het aantal dankwoorden, gepaard gaande met enkele woorden van steun aan ons project, van aanmoediging of eenvoudigweg van sympathie die hij als dank terugkreeg” (persbericht d.d. 14 april 2012).
Dat geloven we best. Belgische « rattachisten » zijn welkom in de Franse Senaat, waar ze enkele jaren geleden ontvangen werden zonder dat iemand in België zich er druk over maakte. Het dagblad Le Soir schreef toen: “Men moest van zaal veranderen, want meer dan honderd personen waren op de uitnodiging ingegaan. Aan de ingang kregen ze een brochure, getiteld «De splitsing van België », opgesteld door François Perin en uitgegeven door de Franse vleugel van de rattachisten. In de zaal waren er vanzelfsprekend Senatoren, waaronder twee oud-ministers, generaals, twee ambassadeurs en een hoge gezagsdrager van Buitenlandse Zaken, die betrokken was bij de beruchte reis van generaal De Gaulle in Québec («Vive le Québec libre !»).” (Le Soir, 18 januari 1997).
Terloops gezegd is buitenlandse steun voor het voeren van een anti-Belgische propaganda in België strafbaar gesteld (artikel 135bis van het Belgisch strafwetboek).
BESLUIT: De politieke (en economische) kolonisatie van België door Frankrijk maakt deel uit van een eeuwenoude Franse imperialistische geopolitiek. Dit politiek denken is geïnspireerd door de “théorie des frontières naturelles”, namelijk het streven naar natuurlijke grenzen (i.c. de Rijn). Doorheen de eeuwen zijn er verschuivingen geweest in middelen en tactiek, maar nooit in doel. We weten nu met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat, mocht België imploderen, het zgn. “Waals gewest” in één of andere vorm toenadering tot Frankrijk zal zoeken. De tekenen hiervan zijn vandaag al duidelijk zichtbaar. Uiteraard zal de Franse territoriale expansie dan niet beperkt blijven tot het zuiden van België, maar minstens ook Brussel, Voeren en de faciliteitengemeenten omvatten. Het spreekt vanzelf dat een “Vlaams” rompstaatje dan volstrekt niets in de pap zal te brokken hebben.
Men mag evenmin vergeten dat België in 1839 Nederlands-Limburg en het Groothertogdom Luxemburg aan Nederland verloor. Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant werden eerder al ontfutseld. Pruisen nam ons het Rijnland af.
Van het middeleeuwse Groot-België van Breskens tot Bazel en van Düsseldorf tot Amiens blijft er vandaag al niet veel meer over.
Anders gezegd, de Vlaams-nationalisten, die ijveren voor de vernietiging van België, werken in realiteit voor de Quai d’Orsay in Parijs en zijn zo de beste bondgenoten van het Franse imperialisme.
|
|
/Obsession tenace/ (suite), in: Kenmerk-L’Accent, 129, 1998, p.11
Grâce au sens de l’Etat du ministre Thorbecke le Nord connut en ce un revirement: « La nature est riche non pas parce qu’elle serait une seule force, mais parce qu’elle permet à une multitude infinie d’êtres, chacun vivant selon ses propres lois, de vivre sous une loi commune. » Par manque d’une telle vision, les fondateurs du nouvel Etat belge persistent dans l’erreur jacobine. Le combat flamand soutenu empêche l’homogénéisation linguistique. Même considéré d’un point de vue belge le Mouvement Flamand apporta un solde bénéficiaire. Il a garanti la liberté de langue et ainsi contribué à une grande ouverture du pays en toutes directions. Mais le régime unitaire soutenu pendant un siècle et demi a suscité des courants nationalistes qui tentent de forger deux « peuples » au sein desquels « le mal français » persiste. Au sein d’une Europe du Nord-Ouest déjà si parcelée ils tentent d’installer deux petits-états-nations crispés, évidemment conçus selon le modèle classique français. Sans racines dans le passé, ces constructions nouvelles n’ont aucun avenir. Elles n’éveillent d’ailleurs pas l’enthousiasme de la population. Sauf chez ceux qui en vivent. D’ingénus politiciens veulent réaliser des rêves surannés qui ne tiennent pas compte de la fonction de noyau européen qui est celle des régions du Delta doré. Les parties débridées prévues par la nouvelle construction étatique poussent celles-ci dans l’isolement. Les erreurs accumulées depuis 1795 doivent être imputées à un manque total de culture politique. Il n’a pas été tenu compte de la position géographique unique de nos régions. Et pas plus de leurs riches traditions politiques. Il est urgent d’y travailler.
|
|
|
André Belmans, De bouw van Europa moet voltooid worden, in : Delta, 8, 2007, p.2-5
Van dit laatste blijven vandaag als onafhankelijke Staten alleen de Beneluxlanden en Zwitserland over. Deze strijd ging gepaard met een onophoudelijke rivaliteit om de overmacht in Europa. (…) De Bourgondische vorsten kregen forse tegenwind vanuit Frankrijk maar ook van de Helvetische Confederatie, die hiertoe door de Franse Koning Lodewijk XI opgestookt was. Vandaag betreuren vele Zwitserse historici dit « verzet van hun land tegen een poging om Europa tot vrede te brengen.” Te meer daar de Bourgondiërs open stonden voor de Helvetische opvatting van de federale organisatie van de politieke maatschappij. De veelvuldige intriges van Lodewijk XI in de Nederlanden en even goed in Spanje hadden tot gevolg dat zij de Habsburgers een kans boden, want uiteindelijk slaagden dezen er in zich in beide landen te doen gelden en als het ware aldus Frankrijk te omsingelen.
|
|
|
Han Renard, Historiek van de onafhankelijkheidsgedachte Interview met Waals geschiedenisprofessor Hervé Hasquin ‘Een onafhankelijk Wallonië is een zinloos project’, in : Knack Extra, 02/02/2011, p.13 en volg.
De mentale omslag in Wallonië is er gekomen met de grote staking tegen de eenheidswet van Gaston Eyskens in 1960, zegt MR-politicus en historicus Hervé Hasquin. ‘Op dat moment ben ik ook, als zeventienjarige, een aanhanger van het federalisme geworden.’
(…) Als minister-president van de Franse Gemeenschap publiceerde hij een ophefmakende studie (op basis van een koffertje met documenten dat op geheim-zinnige wijze in zijn bezit kwam) over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog van een groepje Waalse separatisten met het Vichyregime van maarschalk Philippe Pétain. Hasquins gena-deloze blootlegging van een tôt dan toe doodgezwegen, ‘weinig glorieuze’ épisode uit de geschiedenis van de Waalse beweging, werd hem in Waalse militante kringen niet in dank afgenomen. De beruchte koffer zit inmiddels, tot groot jolijt van de hartelijk lachende Hasquin, veilig achter slot en grendel ergens in de gebou-wen van de prestigieuze Académie royale de Belgique, waarvan Hasquin secretaris voor het leven is. Daarnaast is hij ook de vader van verschillende standaardwerken over de geschiedenis van Wallonië en de Waalse beweging.
(p.14) (…) In 1898 werd het Nederlands naast het Frans als officiële taal erkend. Maar in het gecentraliseerde, unitaire België, waar het Frans lange tijd als de enige officiële taal had gegolden, bekleed-den de Walen natuurlijk functies in het hele land. Het vooruit-zicht van verplichte tweetaligheid veroorzaakte bij die mensen grote beroering. Ze waren bang om hun baan te verliezen en hadden moeite met het verdwijnen van het Franstalige België dat ze hadden gekend. De Waalse beweging ijverde dan ook voor intrekking van de taalwetten, en haar leden zagen zich zichzelf aïs de hoeders van de eenheid van het land. (…) De Assemblée wallonne was overigens heel francofiel. Maar hoe moest ze haar sympathie voor Frankrijk uitdrukken zonder van rattachisme te worden beschuldigd? Als Waals symbool werd eveneens gekozen voor de Gallische haan, maar de Waalse haan mocht niet helemaal identiek zijn aan de Franse. En dus is de Waalse haan een stappende haan geworden, de rechterpoot in de lucht, in tegenstelling tot de kraaiende Franse haan, die met beide poten stevig op de grond staat. (lacht)
(p.15) Waren de verzetslui in Wallonië dan allemaal wallinganten? hasquin: Zeker niet, er zaten ook veel belgicisten bij, maar er waren toch nogal wat Waalse groeperingen in het verzet. Andere wallinganten zijn bij het uitbreken van de oorlog naar Frankrijk gevlucht. Denk aan de Luikse drukker en vooraanstaande wallingant Georges Thone. Die had in 1940 met een aantal gelijkgestemden in Frankrijk onderdak gezocht. Uit haat tegen Leopold III, tegen Duitsland en tegen de Britten, die bij de eerste gelegenheid Leopold III weer op zijn troon zouden zetten, zijn Thone en zijn Waalse separatistische vrienden met de opeen-volgende Vichyregeringen en maarschalk Pétain, een mario-net van nazi-Duitsland, over de mogelijke aansluiting van Wallonië bij Frankrijk gaan onderhandelen. Ze waren zo verblind door hun rattachistische ideeën dat ze zich steeds verder op het pad van de collaboratie begaven. Die Waalse separatisten vorm-den weliswaar een kleine minderheid, maar ze hebben dus wel bestaan. Wallonië zelf telde ook heel wat collaborateurs, al waren dat geen Waalse nationalisten, wel echte fascisten, terwijl in Vlaanderen de collaboratie toch vooral een zaak van de Vlaamse beweging is geweest.
(p.16) Ook het politieke landschap zal in de jaren 1960 sterk veranderen, met het ontstaan van het FDF, het Rassemblement wallon en de snelle opgang van de Volksunie in Vlaanderen. In 1968 is er de kwestie-Leuven Vlaams. Dat alles zal uitmonden in de fameuze redevoering van vader Eyskens in 1970 in het parlement, waarin hij zei dat België niet langer een unitaire staat was. In de jaren 1970 zijnvervolgens alle traditionele partijen, ook in Wallonië, federa-listisch geworden.
Het Belgische federalisme lijkt intussen op zijn grenzen te zijn gestoten. Sommige Franstalige politieke kopstukken zijn met de jaren dan ook hun geloof in België verloren. Hoe zit dat met u? hasquin: François Perin heeft ooit geprobeerd mij van de weldaden van de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk te overtuigen, maar zonder veel succes.
(…) hasquin: (schudt het hoofd) Een onafhankelijk Wallonië is een volstrekt zinloos project. Bij het verdwijnen van België moet je ofwel denken aan de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk, ofwel aan een confederatie Wallonië-Brussel. Die confederatie zou volgens het internationaal recht de naam België kunnen bewaren. Maar een onafhankelijk Wallonië is een heilloos pad. Er bestaat geen natiegevoel in Wallonië, économiser! is een zelfstandig Wallonië niet leefbaar, en uit alle peilingen blijkt dat de voorstanders van Waalse onafhankelijkheid bijzonder dun gezaaid zijn.
|
|
|
Ludo Baeten, EEN AANHOUDENDE OBSESSIE. TWEE EEUWEN VOLHARD1NG IN DE FRANSE JACOB1JNSE DENKTRANT, in: Kenmerk / L’Accent, 129, 1998, p.8-10
In 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk ingelijfd op grond van het jacobijnse principe « la langue est la nation toute entière ». In de Zuidelijke provincies van België werden er romaanse dialecten gesproken terwijl in de Noordelijke de adel en de hoge burgerij reeds sterk verfranst waren. Was het graafschap Vlaanderen ooit niet onderhorig geweest aan de Franse kroon? Onze gewesten, die tot dan toe ieder hun bestuurlijke identiteit hadden bewaard, werden in een unitair dwangbuis opgenomen. Er werd een politiek van uniformisatie doorgevoerd terwijl de elite aan een ware hersenspoeling werd onderworpen. Geen enkele Natie heeft zozeer als de Franse la « conquête des esprits » in haar vaandel geschreven.
De Franse opvatting van de politieke maatschappij werd doorgedrukt en verdrong het eigen staatkundig denken zoals dit zich in de loop der eeuwen had ontwikkeld en tot dan toe had standgehouden.
« Vanaf de tijd der Bourgondische hertogen hadden de vreemde « heersers over de Zuidelijke Nederlanden het eigen leven van « deze oude gewesten ontzien. Hun politiek tastte de lokale « rechten en autoriteiten zo min mogelijk aan en trachtte « slechts over hen heen het gezag van een centrale regering te « handhaven. In de provincies kwamen de Statenvergaderingen « regelmatig bijeen en zij waren veel meer dan in de « Noordelijke Nederlanden, waar zj beheerst werden door de « regentenoligarchie en eerder regeringsraden dan « representatieve lichamen waren, nog vertegenwoordigingen van « de oude standen. Hun macht, gebaseerd op allerlei als « provinciale constituties beschouwde privilégies – de « beroemdste is natuurlijik de Brabantse Blijde Inkomst – was « niet gering; vooral in belastingszaken woog hun beslissing « zwaar.(l) Door hun aanhechting bij Frankrijk werden de Zuidelijke Nederlanden van hun historische wortels afgesneden. De geestelijke overwoekering door Franse denkbeelden en mythen bleek nog rampzaliger dan de militaire bezetting en de politieke overweldiging. De gevolgen ervan zullen zich tot op heden doen gelden.
In 1815 wordt de eenheid van de Lage Landen hersteld. Koning Willem, wiens verdiensten steeds meer worden gewaardeerd (2), was ten zeerste begaan met de ontwikkeling van de op vele gebieden achteropgeraakte Zuidelijke Nederlanden. Jammer genoeg was ook hij ingenomen met het Franse politieke denken dat trouwens in de kaart speelde van een bepaald verlicht despotisme. Ook koos hij zijn medewerkers onder de oudgedienden van het Franse bewind. Hij gaf geen gehoor aan degenen die hem voorhielden wat meer rekening te houden met de eigen politieke tradities.
Was hij op deze wijze raadgevingen ingegaan en had hij een meer gedecentraliseerd bestuur in acht genomen, de Brusselse rellen van 1830 zouden wellicht nooit aanleiding hebben gegeven tot een afscheidingsbeweging. De diepere oorzaak van de scheiding moet worden gezocht in de weigering een nochtans opvallende verscheidenheid te erkennen en in het verwerpen van een gezond particularisme eigen aan ‘s lands tradities. Dank zij het staatsmanschap van Thorbecke (3) komt in Nederland daarin verandering in de jaren 1848-1851. Amper twintig jaar na de Belgische afscheiding wordt aan de gemeenten en aan de provincies een ruimere autonomie toegekend, zodat Nederland een gedecentraliseerde unitaire Staat werd. Deze decentralisatie heeft de politieke samenhang van Nederland eerder versterkt dan verzwakt.
De bezielende gedachte van Thorbecke was: « de natuur is niet daarom zoo rijk dewijl zij ééne kracht, maar omdat zij, ééne oneindige verscheidenheid van wezens, ieder met eigen kracht, onder een algemene wet laat werken ».(4) Bij gebrek aan een dergelijke visie volharden de grondleggers van de nieuwe Belgische Staat in de jacobijnse vergissing. Andermaal wordt de staatsconstructie naar Frans model op een strak unitaire leest geschoeid. Men zag niet in dat tussen eenheid en verscheidenheid een vruchtbare wisselwerking kon ontstaan.
Door een verbeten Vlaamse Strijd mislukt de poging tot taalkundige homogenisatie. Zelfs vanuit een Belgisch standpunt moet de Vlaamse Beweging als een winstpunt worden beschouwd. Zij heeft in de Zuidelijke Nederlanden de verscheidenheid van taal gevrijwaard en daardoor een grotere openheid van het land in vele richtingen mogelijk gemaakt.
Het anderhalve eeuw volgehouden unitaire regime heeft echter frustratiegevoelens gewekt die uitmonden op nationalistische stromingen. Deze sturen aan op de vestiging van twee tegengestelde « gemeenschappen », waarin « le mal français » welig blijft voortwoekeren. Ieder nationalisme is behept met Franse concepten, dogmes en mythen. Het Vlaams nationalisme ontsnapt daar niet aan.
In het reeds oververkavelde Noord-West Europa wordt aldus aangestuurd op de oprichting van twee nieuwe verkrampte natie-staatjes al dan niet samengehouden door een impotente Statenbond. Wel te verstaan worden deze natie-staatjes geconcipieerd naar het klassieke Franse mode). Zonder wortels in het verleden bieden deze nieuwe scheppingen geen uitzicht op de toekomst. Ook wekken zij bij de bevolking niet het verhoopte enthousiasme. Behalve dan bij degenen aan wie zij een loopbaan verschaffen. Zij zijn het kunstmatig product van een politiek onvermogen. Argeloze politici hebben getracht onrijpe jeugddromen, achterhaalde idealen van vijftig jaar geleden te verwezenlijken. Met de nieuwe internationale context werd geen rekening gehouden. Aan de functie van Europees kerngebied van de landen en gewesten van de Gouden Delta werd niet gedacht.
De ingevoerde nieuwe staatsregeling drijft de losgeslagen gebiedsdelen in een positie van isolement. Zij worden aldus een gemakkelijke prooi voor de drijverijen van de grote gieren van de Europese politiek. Zo lang de Europese Unie geen evenwichtige klassieke federale structuur heeft verworven blijft de grootste waakzaamheid geboden. De sedert 1795 opeengestapelde vergissingen moeten worden toegeschreven aan een schrijnend gebrek aan politieke cultuur. Er werd geen rekening gehouden met de uitzonderlijke geografische positie van onze landen en gewesten. Evenmin met hun zo rijke politieke tradities. De meest dringende taak is aan dit gebrek te verhelpen.
(1) Prof. Dr. ER.H. Kosmann – De Lage Landen I 780-1940 (2) Yves Schmitz – Guillaume I et la Belgique. (3) Prof. Mr R. Kranenburg – Studiën over Recht en Staat. (4) Johan Rudolf Thorbecke ( I 798-1872) was van 1825 tot 1830 hoogleraar aan de Universiteit van Cent. Hij doceerde daar de historia politica.
|
|
|
Ludo Baeten, Meer aandacht voor de internationale dimensie, in: Accent-Kenmerk, 128, 1998, p. 2-5
(p.4) Te allen prijze wil Frankrijk verhinderen dat er een stevig bondgenootschap ontstaat onder de landen van de historische Nederlanden, terwijl in België de centrifugale krachten op alle mogelijke manieren worden aangemoedigd. (p.5) Sedert lang speelt het Vlaamse nationalisme argeloos in de kaart van de Franse politiek. Maar ook de recente omvorming van de Belgische Staat draagt zeer duidelijk de stempel van de eeuwenoude Franse bemoeienissen in de Zuidelijke Nederlanden. Wanneer men bepaalde eigenaardigheden van het Belgische “federalisme” vergelijkt met de richtlijnen van Richelieu kan men er niet naast kijken. De Franse propaganda en de Franse diplomatie weten precies hoe ze het moeten aan boord leggen om de politieke onervaren Vlamingen te paaien. Uit hun historie hebben de Franse leiders onthouden hoe er moet worden omgegaan met volkeren die niet geleerd hebben in politieke termen te denken. |
|
|
Pierre Pirard, Ah ! ces Belges qui ont « fait » la France !, LB 04/11/1982
« Ces Belges qui ont fait la France: à voir ce titre avantageux de Noël Anselot (1), on se demande d’abord s’il prête à rire. Et quelle sera la réaction du lecteur d’outre-Quiévrain.: quoi des Belges qui ont fait la France ? Et nos rois alors, qu’ont-ils fait ? » Le volume compte dans les trois cents pages distribuées en nombreux chapitres. (…) Pharamond, premier roi des Francs, est Campinois. Mérovée est enterré à Tournai. Son fils, Childéric y est né. Y est né, Clovis «qui conçut à Soissons sa plus belle page de publicité en cassant la vaisselle ». Le, premier Pépin vient de Landen en Hesbaye. Le deuxième vient de Herstal. Charles Martel naît à Theux. Pépin le Bref vient de Jupille. Sa femme Berthe-auxlongs-pieds lui donne deux fils -tous deux pareillement nés à Jupille, Carloman et Charlemagne qui fait entrer dans les églises les orgues à tuyaux, le chant grégorien, le latin, et importe en France le premier éléphant. Noël Anselot sait vraiment tout. Pierre l’Ermite, est de Neufmoustier près de Huy et non d’Amiens. Saint Bernard prêche à Liège, on a traduit une de ses homélies en vieux wallon. Saint Hubert meurt à Tervueren. Saint Gérard, originaire de Stave près de Namur, bàtit des monastères en Lorraine et dans le Nord. Saint Norbert, fondateur des Prémontrés en France, est né à Gennep dans le Limbourg. Sainte lu,Iienne qui inventa les proces-sions àe-la Fête-Dieu, est Liégeoise. Saint Poppon mort à Marchiennes est évêque d’Arras. Jean Bolland, né au village du même nom près de Liège, invente l’Encyclopédie des vies de saints. (…) La tapisserie en-France «est l’oeuvre des Belges»; le Brugeois Berquen invente la taille du diamant; cinquante ouvriers d’Audenaerde enseignent à ceux des Gobelins l’art du tissage ; Hannequin de Bruges répand en France l’art de la peinture à l’huile; le célèbre .Philippe de Champaigne est né à Bruxelles, Ferdinand Hellé, à Mahnes; Pierre-Joseph Redouté, le peintre des roses, à SaintHubert; Félicien Rops, à Namur; René Magritte, à Lessines; Paul Delvaux, à Antheit; Van Praet fit le pont que l’on sait mais aussi la Bibliothèque nationale’ de Paris; Empain fit le Métro de Paris et les tramways électriques de diverses villes de France et de 1’uniVers;- Jan Lintlaer inventa la machine qui perrnit d’emplir les bassins du Louvre et des Tuileries avec les eaux de la Seine; pareillement Renkin Sualem dé lemeppessur-Meuse inventa à- Versailles «la célèbre machine de Marly» (200 pompes qui firent monter à l’eau de là Seine plus de 160 mètres en trois paliers successifs).
Les écrivains Faisons de la nomenclature. Parmi les auteurs de renom, la Belgique réclame Froissart et Commynes, ainsi que Châtellain, tous trois du Moyen Age et historiens. Elle réclame jean Lemaire en qui Ronsard et du Bellay ont salué un très grand poète; le prince de Ligne qui a de l’esprit à revendre et à qui tout le monde emprunter Camille Lemonnier, de Louvain; Verhaeren de SaintAmand, près d’Anvers; Roden-, bach de Bruges, Maeterlinck de Gand. Pour l’avoir dans leur Académie, les Français. firent l’impossible-‘ët ce fut en vain,’ Maeterlinck déclarait’: «Belge, je suis et Belge, je mourrai». Voici toute une pléiade d’astres divers nés en Belgique . et desdendus à Paris, pour en revenir dans l’un ou l’autre cas. Christian Beck (Verviers) qui fut l’ami de Gide; les deux Rosny (Bruxelles) qui s’appelaient réellement Boex; Vautel (Tournai) né Vaulet; O.P. Gilbert, l’écrivain belge le plus lu après Simenon; Plisnier (Hainaut) prix Goncourt; France Adine (du pays de Dixmude) «formidables tirages»; Dominique Rofin (Bruxelles); Françoise Mallet-Joris (Anvers) de l’Académie Goncourt; Michaux (Namur) qui crache sur la Belgique; Crommelynck de Bruxelles, Francis de Croisset de Bruxelles; Ghelderode de Bruxelles, tous trois célèbres; Marceau né Carette et à Car-tenberg, membre de l’Académie française, Claude Spaak.homme de théâtre Steeman de .Liège; Simenon de Liège lui aussi.
Les musiciens
L’un des premiers musiciens belges qui s’illustrèrent en France est Guillaume Dufays ou Dufay de Chimay, inventeur du contrepoint qui a pour objet la superposition de hgnes mélodiqües’ Jan Van Ockeghem qui fait ses débuts à la chorale de Notre-Dame d’Anvers, sera, selon Fétis, ‘un des musiciens les plus illustres du Xve siècle; Josquin des Prés, né- Hennuyer, selon le témoignage de Ronsard; se répa ‘ ndit dans tout l’Occident et en France; le
grand Roland de Lassus (Mons) de qui le renom fut tel qu’on ne peut s’en faire iine idée, on disait de lui que « si Orphée put déplacer les rochers, Lassus attira à lui Orphée lui-même »; Henry du Mont,qui s’appelle en réalité Henry de Thier, est né à Villers-l’Evêque dans la princi- pauté de Liège. Compositeur d’une incroyable, fécondité ! Noël Anselot sait-il qu’il compgsa même des messes’en gzégorien et qu’au vieux pays dei son enfance avant la réforme de Vatican II, on en chantait une écrite sur là premier ton, c’est-à-dire, grosso modo, en ré mineur ? Nommons le Liégeois Grétry assez célèbre pour que suffise ce rappel; Gossec qui s’appelle Gosse et voit le jour à Vergnies dans le Hainaut, sera le musi. cien de la Révolution française,; il chantera l’hurhanité, la liberté, l’égalité, la divinité ; toutes les abstractions. De César Franck, «pater seraphicus », le père est flamand, la mère est flamande, lui-même voit le jour à Liège, il fait ses études ciu conservatoire de cette ville, il a une carrière d’enfant prodige (sic) quand il part pour Paris dès ses quinze ans, il porte dans sa besace, deux trios, deux concertos et une fantaisie pour piano; il collectionne les premiers prix : piano, flûte et fugue. Son génie le metant trop à part de ses rivaux, sa carière s’en ressent. Finissons ce papie avec quatre noms : le violoniste Ysaye de Liège, la pianiste Marie Pleyel de Gand, le claveciniste Tasquin de Theux et Adolphe Sax de Dinant qui inventa le saxophone.
On pourrait continuer en citant les grands chanteurs et les grandes cantatrices originaires de Belgique qui «ont fait la France » mais il convient de s’arrêter en regrettant deux choses . premièrement, sauf erreur, Noël Angelot n’a rien dit de Jean Ray que Ghelderode tenait en très haute estime et secondement, il manque à cet ouvrage un index des noms cités qui permettrait de le consulter aisément. (1) Noël Anselot, Ces Belges qui ont fait la France, chroniques, 316 pp, France-EmPire, Paris.
|
|
|
UNE OBSESSION TENACE, in: Kenmerk-L’Accent, 129, 1998, p.10-11
En 1795 les Pays-Bas du Sud furent intégrés à la France sur base du principe « la langue est la nation tout entière ». Nos régions qui jusqu’alors avaient connu leur identité propre, furent soumises à une contrainte unitaire. Une politique d’uniformisation fut introduite et les élites soumises à un véritable lavage de cerveau. Aucune autre nation n’a écrit « la conquête des esprits » dans son drapeau comme le fit la France. L’absorption des Pays-Bas du Sud par la France coupa ceux-ci de leurs racines. L’imprégnation de vues et mythes français dans tes esprits fut plus néfaste encore que l’occupation militaire et la main-mise politique. Les conséquences en sont sensibles jusqu’à nos jours. L’union des Pays-Bas est rétablie en 1815. Bien que le roi Guillaume fut fort préoccupé par le développement des provinces du Sud dégénérées, il souffrait lui aussi de la philosophie française qui flattait d’ailleurs un certain despotisme éclairé. Trop souvent il choisit ses collaborateurs parmi les anciens de service du régime français. Une meilleure acceptation d’un pouvoir décentralisé aurait pu éviter la sécession de 1830.
|
|
1071-1978 |
Raf Seys, Twee Peeneboeken in een band, Roeselare, 1996
(p.7) WOORD VOORAF
DE NEDERLANDEN IN FRANKRIJK In de verre geschiedenis strekten de Nederlanden zich uit tôt aan de Somme (Zomme), waaraan de stad Abbeville (Abbegem) gelegen is. Boulogne (Bonen), Calais (Kales), Douai (Dowaai), Arras (Atrecht), Lille (Rijsel) e.a. zijn belangrijke steden uit dit gebied dat stuk voor stuk door Frankrijk werd ingepalmd en verfranst. Het nu nog in enige mate VLaamssprekend gedeelte dat de Westhoek wordt genoemd, grenst aan de Aa, die te Grevelingen (Gravelines) in de Noordzee uitstroomt. Aan de overkant van de rivier (de linkeroever), ligt Sint-Omaars (Saint-Omer), waar (in de stad zelf of in haar onmid-dellijke omgeving), eind Ile eeuw, de vooralsnog oudst bekende Neder-landse glossen geschreven werden. De belangrijkste steden in dit gewest zijn : Duinkerke, Hazebroek, Belle (Bailleul), Steenvoorde, Sint-Winoksbergen (Bergues), Hondschote en Wormhout.
DE HEILIGE BERG VAN VLAANDEREN In het oude stadje Kassel, gelegen op de 176 m hoge Kasselberg, een knooppunt van Romeinse heerwegen, bevindt zich een historisch monument (1873), dat herinnert aan de drie memorabele veldslagen die in de onmiddellijke omgeving geleverd werden. 1. Op 20 februari 1071 overwon Robrecht de Pries te Bavinkhove de Franse koning Filips I, en werd graaf van Vlaanderen. 2. Op 23 augustus 1328 verloren Niklaas Zannekin (van Lampernisse) en de Kerels van Vlaanderen te Harde-foort (Hardifort) de strijd tegen koning Filips VI van Valois. 3. Op 11 april 1677 werd Willem van Oranje tussen Noordpeene en Zuidpeene verslagen door Filips van Orléans, broer van de Zonnekoning Lodewijk XTV: de Hollanders waren ni. de stad Sint-Omaars te hulp gekomen die onder Franse belegering stond.
DE NOODLOTTIGE 17e EEUW Deels door het geweld van de wapens, deels door de macht van het geld, bereikte de annexionistische politiek van Lodewijk XIV haar doel. In 1658 verloor de Spaanse bezetter de Slag der Duinen en nam Turenne (p.8) Broekburg (Bourbourg), Grevelingen (Gravelines) en Duinkerke in, -Duinkerke, de stad die aan de Engelsen werd overgegeven, maar in 1662 weer werd afgekocht. In 1667 werden Dowaai (Douai) en Rijsel (Lille) door Lodewijk XIV veroverd, terwijl door de Vrede van Aken (1668) Frankrijk o.a. Sint-Winoksbergen (Bergues) kreeg toegewezen. Door de Vrede van Nijmegen (1678), gevolg van de Slag aan de Peene, werden o.m. de kasselrijen Belle en Kassel, alsook Sint-Omaars en Arien (Aire-sur-la-Lys), d.w.z. de rest van wat thans de naam Frans-Vlaanderen draagt, aan Lodewijk afgestaan.
L’HISTOIRE DE FRANCE De grote Fransvlaming Jean-Marie Gantois (1904-1968) schrijft in zijn boekje Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond (1942) hoe hij zich, aïs jonge student, gevoelde na de lectuur van Notre vieille Flandre (1904) van deken Vandepitte : « Op school en collège had ik alleen de ‘histoire de France’ geleerd, en welke Franse geschiedenis! Woordelijk lijk mijn zwarte staatsgenoten van Timboektoe, had ik mijn les opgezegd : « Onze voorouders, de Galliërs, waren groot, enz.. » (Nos ancêtres, les Gaulois, étaient grands, etc…). Nu vernam ik plotseling dat ik andere voorouders had, en ook een ander vaderland, dat ik tôt een ander volk behoorde dan tôt die zwarte of blanke ‘citoyens de l’Empire’, dat mijn volk, dat ik een eigen geschiedenis had, dat deze niet precies dezelfde was aïs die welke mijn schoolhandboeken ophemelden, dat Filips de Eerste, en Filips August -zoals ze hem noemden – en Filips de Schone, en Filips VI van Valois, wel een plaats in onze geschiedenis innemen, maar dat wij noch te Kassel, noch te Bouvines, noch te Pevelenberg, noch weerom in Kassel, aan dezelfde kant van de barricade stonden. Zo een kleine ontdekking heeft wel haar waarde voor een jonge geest ! »
DE GESCHIEDENIS VAN VLAANDEREN De confrontatie met ons boekje De Slag aan de Peene 1677 + even eromheen (le druk 1977, 2e druk 1978) en in belangrijke mate, sinds 1977, de jaarlijkse Zwijgende Voettocht door het Slagveld van de Peene, hebben hun waarde, in Vlaanderen en Nederland. Niet alleen voor een jonge geest, maar tevens voor zoveel andere! Wijlen André Demedts heeft het méer dan eens geschreven: « Niet allé intellectuelen in Vlaanderen en Nederland zijn ervan op de hoogte dat onze zuidwestelijke (p.9) volksgrens niet met de staatsgrens tussen België en Frankrijk en even-min met de huidige taalgrens samenvalt. » – We hopen dat het allen goed zal doen een bladzijde, hoe droef ze ook is, uit de geschiedenis van ons Vlaanderen te lezen. In 1977 werd, t.g.v. de le Université Populaire Flamande d’Eté – Vlaemsche Zomervolks-hoogeschoole te Hazebroek, onder de titel // était une fois… la Flandre, een geschiede-nissyllabus (55 blz. met tal van illustraties), door Eric Vanneufville en Xavier Taraud, uitgegeven. Syllabus die inmiddels door Eric Vanneufville met nieuwe uitgaven werd aangevuld.
(p.46) WIJ ZIJN VLAMINGEN IN FRANKRIJK Français je suis, Flamand je reste
« Waarlijk, we zijn Vlamingen in Frankrijk. Sinds 300 jaar is Frankrijk ons land. We houden van Frankrijk: voor Frankrijk heb ik m’n bloed gestort in ’14; voor Frankrijk zijn zoveel Vlamingen gevallen op de slagvelden. Die tijd, die drie eeuwen, dat bloed, dat lijden en sterven, dat verenigt ons met Frankrijk. Er is dus een administratieve grens, en die moet blijven. Maar – zo wil ik eindigen – het is geen grens van hart en ziel, het is geen grens voor het gevoel, de taal, de gedachten, de gewoonten, de gebruiken, geen grens voor het gemeenschappelijk geloof. Het is ook geen grens voor de trouw aan Vlaanderen, aan onze Moe-dertaal, geen grens voor onze broederlijke liefde. »
Mgr. Michel Devos in 1965 in een interview voor Radio Kortrijk MICHEL DEVOS (Wilder 11.6.1893 – Rijsel 21.7.1973) was vanaf 1947 vicaris-generaal van het bisdom Rijsel en aartsdiaken van Vlaanderen. Gunstig beïnvloed door pastoor Emiel Descamps, van Zerkel, een vriend van Guido Gezelle, was hij een minnaar van de moedertaal. Aïs jongen leed hij erg onder het verbod van het Vlaams in de Fransvlaamse scholen. (Luc Verbeke) De volledige tekst van het interview (afgenomen door Valère Arickx) verscheen in ‘Ons Erfdeel’, jg. 8, nr. 3 blz. 3-6. Het belangrijkste Fransvlaamse tijdschrift na Wereldoorlog II was Notre Flandre / Zuid-Vlaams Heem (1952-1968) dat in 1969 werd opgevolgd door La nouvelle Flandre, beide onder de leiding van Dr. Jan Klaas (Kales 19.3.1925), vroeger geneesheer te St.-Omaars. -In 1976 werd gestart met het tweemaandelijkse Tijl (Revue des Flamands de France -Tijdschrift van de Frans-Vlamingen, hoofdredacteur : Nick Neirynck, Duinkerke), dat furore maakte. In 1970 werd in Frans-Vlaanderen, op ruime schaal, het keurig manifest Nous, les Flamands de France (16 blz.), een pleidooi voor het behoud van het Nederlands, verspreid. Deze publikatie, opgesteld door Jacques Fermaut (Winnezele 9.4.1939), die te Bieren (Bierne) huize ‘Vlaanderen’ betrekt, en Jozef Tillie (Steenvoorde 29.8.1894 – 7.12.1971), die in zijn geboortedorp ‘Ons Huisje’ bewoonde, was door een 30-tal Fransvlamingen mede-ondertekend.
(p.47) WIJ ZIJN NEDERLANDERS IN FRANKRIJK
« Merkwaardig is ook het treurspel van Michiel de Swaen (1654-1707) over de épisode van Keizer Karels troonsafstand, ‘De zedige dood van Karel de Vijfde’, vooral dan om de talrijke blijken van blijvende ge-hechtheid aan het oude vaderland, van trouwe liefde voor de Nederlan-den. Het is wel opvallend dat hij uiterst zelden de woorden ‘Vlaanderen’ en ‘Vlaams’ en nooit het woord ‘Vlaming’ heeft neergeschreven. Zijn nationaal gevoel strekte zich klaarblijkelijk veel breder uit: over geheel Nederland, dat voor hem een eenheid was, berustend op taal en land-aard. In dit stuk ontdekken we een der eerste Groot-Nederlanders. » (Raf Seys)
Ik ben geen Frans-Vlaming, Ik ben geen Zuid-Vlaming, geen Vlaming. Ik ben geen Groot-Nederlander, geen Heel-Nederlander. Ik ben Nederlander.
Jean-Marie Gantois (1904-1968)
Over de taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen: Vlaanderen in Frankrijk, door Luc Verbeke (met inleiding en slotbeschouwing door André Demedts), Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Utrecht, 1970, 245 blz.; Frans-Vlaanderen, door Jozef Deleu en Frits Niessen, Uitg. Van In, Lier 1968, 112 blz.; Frans-Vlaanderen, door Jozef Deleu (m.m.v. André Demedts, Erik Vandewalle en Frits Pittery en foto’s van Paul van den Abeele), Lannoo, Tielt/Utrecht, 1972, 198 blz. In 1976 startte de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel vzw, die ook de tijdschriften Ons Erfdeel (1957) en Septentrion, revue de culture néerlandaise (1972) publiceert, met het tweetalig jaarboek De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Français, allé onder de hoofdredactie van Jozef Deleu. In 1969 gaf Jozef van Overstraeten, onder de titel De Nederlanden in Frankrijk, opgedragen Ter nagedachtenis van Jean-Marie Gantois, de Franse Nederlander, een beknopte encyclopédie uit. In 1972 werd in Frans-Vlaanderen het tijdschrift Les cahiers des Pays-Bas Français in het leven geroepen.
(p.48) WIJ, FRANSVLAMINGEN
WAT ONGELUK VOOR ONS GERUSTIG NEDERLAND Wat ongeluk voor ons gerustig Nederland, Dat onze vorst Filips zijn prinselijke hand Verbond aan d’erfgenaam van ‘t Aragons vermogen ! Ach ! sedert deze band is onze macht gebogen, Onz’ heerlijkheid verneêrd, onz’ vrijheid onderdrukt: Uit deez’ verzaming, die hem scheen zo wel gelukt, En staat ons niets dan ramp en onheil te verwachten. O Prins ! dat Nederland, zo roem- en zegerijk, Het schoonste en beste deel van g’heel het Spaanse rijk, De bloeme van Euroop, de pronk van allé landen, Zal eindelijk ontvaên het juk van vreemde handen. Michiel de Swaen Omgespeld door Raf Seys
MICHIEL DE SWAEN (Duinkerke 20.1.1654 – 3.5.1707) : heelmeester van beroep. « Over-dreven zijn streekgenoten wanneer ze hem aïs dichter naast en zelfs boven Vondel stel-den, dan staat het toch onomstootbaar vast dat hij in de Nederlandse literatuur der 17e eeuw de merkwaardigste Vlaamse vertegenwoordiger is geweest. » – « Sinds Michiel de Swaen werd 6ns, door wat nu algemeen aïs Frans-Vlaanderen bekend staat, geen waardig literair werk meer gegeven, zodat wij zijn oeuvre in ère te houden hebben aïs het pre-cieuze afscheidsgeschenk van Duinkerke en van het gehele gebied van Leie, Aa en Kolme aan de rest van de Nederlandse gemeenschap. » (Raf Seys) – Zijn best bekende werk, de klucht De gekroonde leerze, wordt nog af en toe opgevoerd. In 1964 stuurden we aan het stadsbestuur van Duinkerke, toen nog onder het burgemees-terschap van Paul Asseman, een paar exemplaren van ons werkje Michiel de Swaen I Gelijk de zonnebloem, samen met een schrijven waarin werd voorgesteld in Duinkerke de herinnering aan De Swaen in ère te houden: bv. vanals er mogelijkheid toe bestond zijn naam te verbinden aan een straat. Per 1.1.1970 werd Malo-aan-Zee gefusioneerd met Duinkerke. Daar in beide steden een rue de l’Hôtel de Ville bestond, is, in oktober 1970, de Duinkerkse in rue Michel de Swaen veranderd. Raf Seys, Michiel de Swaen. Gelijk de zonnebloem, bloemlezing met inleiding, Heideland, reeks Poëtisch erfdeel der Nederlanden, nr. P 26, Hasselt, 1964. In 1971 werd te Kassel, door een groepje jongeren, een Cercle Michel de Swaen /Michiel de Swaenkring gesticht, met zetel te Duinkerke, die zich de verdediging en bevordering van de eigenheid en de cultuur van Frans-Vlaanderen, in ‘t bijzonder van zijn taal, tôt doel stelt. In 1974 startte de kring met een reeks Cahiers du Cercle Michiel de Swaen, la-ter met Tijl en sinds 1993 met Vlaanderen den Leeuw /La Flandre au Lion (Jacques Fer-maut, St.-Winoksbergen; Michel Lieven, Kales).
(p.49) AAN DE HEER VAN HEEL, MU ONBEKEND, OVER ZIJN KLACHT OP MIJN VERTREK UIT HOLLAND Wat klaagt gij, Heer Van Heel, wat doet gij Holland treuren, Omdat een wilde Swaen zijn kust verlaten heeft ? De Swaen, met meerder recht, tôt rouwe zich begeeft, Nu een zo zoet verblijf niet meer hem mag gebeuren. O Holland ! vreedzaam land, waarin de vrijheid leeft, Wat zocht ik die vergeefs bij uwe nagebeuren, Waar Frans en Castiliaan de rust en vrede scheuren, Waar ‘t hoofd der burgerij voor vreemde heren beeft ! O ! had ik, Lieve Land, in uw begrijp gebleven, Hoe vrolijk werd mijn stem tôt zingen voortgedreven, Of aan de Rotte-stroom, of midden op de Maas ! Nu leef ik in een oord waar vreugde is uitgeweken : Mijn spijs is bittre gai, mijn zang: Eilaas ! Eilaas ! Och ! och ! waar heb ik mij, misleide Swaen, versteken ?
Michiel de Swaen Omgespeld door Raf Seys
(p.50) O MOEDERTAAL, WIE KAN U DOIT VERGETEN ? Hoe kan een oog vergeten Het licht der zonnestraal ? Hoe kan een oor vergeten De klank der moedertaal ? O Nederland, uw taal Was mijnes geestes licht, En ‘t eerste woord van liefde Werd mij in ‘t Vlaams gericht. Hoe durf ik u vergeten, Gij, duurste liefdespand ! Al voel ik mij verloren, Hier, in mijn vaderland. Word ik om u verstoten, Word ik om u misacht, Aan u mijn laatste pogen, Aan u mijn laatste kracht.
Jules Andouche
JULES ANDOUCHE (Berten 3.6.1887 – Rijsel 24.10.1948) : oefende aïs priester-leraar een weldoende invloed uit op enkele voormannen der Vlaamse Beweging in de Westhoek. – In het bisschoppelijk collège te Hazebroek…: « Daar vooral had ik het geluk met een leraar kennis te maken, de E.H. Jules Andouche, die de eerste Vlaamse invloed op mijn geest en op mijn leven uitoefende. Deze priester, vurig bewonderaar en verdediger van het Vlaamse vaderland, bezat een prachtige bibliotheek, rijk aan werken over Vlaanderen, wier schatten mij open stonden. Met de boeken ontving ik geestdriftige commentaren en on-vergetelijke lessen. Toen beschouwde ik gaarne de toekomst aïs een rustig en werkzaam leven heel en gans aan de geschiedenis van onze Vlaamse streek gewijd. » (Jean-Marie Gantois) – Op zijn grafsteen te Berten staat het woord van Guido Gezelle: « Wees Vlaming dien God Vlaming schiep. »
(p.51) VANWAAR KWAM IN MU DIE DRANG NAAR DE TAAL Vanwaar kwam, in mij, die drang naar de taal, die zo machtig was, machtig genoeg om mij de kracht te geven om zovele hinderpalen te overwinnen? Mijn geval, het weze bescheiden gezegd, mag aïs typisch gelden. Het dorp waar ik geboren en getogen werd, ligt aan gène zijde van de taal-grens. Weliswaar wonen er veel Vlaamssprekende mensen, van het overige Vlaanderen gekomen. Weliswaar is de Vlaamssprekende streek zo dichtbij gelegen dat men er op marktdagen niet veel minder Vlaams dan Frans hoort. Maar de omgangstaal der inheemse bevolking is, sedert meerdere geslachten, het Frans. Noch op straat, noch op school, bood zich aan een kind de gelegenheid om met makkers Vlaams te praten. In de school, ook door Vlaamstalige kinderen der naburige dor-pen bezocht, werd het schandsignum uitgereikt aan de jonge schuldigen die in hun taal ook maar een uitroep loslieten. In de huiskring was het niet beter gesteld. Mijn familie behoorde tôt de meest verfranste maatschappelijke standen: de vrije beroepen. Mijn vader was geneesheer, de huisvrienden waren allen van de burger-stand. Aïs thuis een woord Vlaams weerklonk, was het van de lippen van de meiden die van Millam, Lynck of Kapellebroek waren. Hoe was ik er toe gekomen aan de invloed van zo een midden te ont-snappen, mijn onkunde in het Vlaams aïs een leemte aan te voelen? Hoe meer ik me in de geschiedenis van mijn land verdiepte, hoe meer de vaderlandsliefde in mij wakker werd, hoe meer ik tôt het besef kwam dat die taal mijn natuurlijke taal, mijn taal was.
Door de Stichting Ons Erfdeel werd (in 1978) een gestencild overzicht verspreid over Het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen sinds 1945. – In 1978 verscheen het eerste leerboek (!) voor de Vlaamse volkstaal in de Westhoek: Vlaemsch leeren, door Jean-Paul Sepieter. In het Aanbod door Westhoek-Editions (Duinkerke) om er op in te tekenen, lezen we o.m.: « Op een paar stappen van zijn graf af beleeft het Vlaams, dat in de netten van de Parijse centralisatie geraakt was, die het verwijderd had uit de school, uit de média en de plaatselijke administratie, een wonderbare opleving in het kader van een wereldwijde beweging van allé volkeren die het recht opeisen op hun anders-zijn, het levensrecht voor hun taal en kultuur aïs een van de talrijke oorspronkelijke verschijnings-vormen van de mensheid, het recht om te leven en zich te kunnen ontplooien. »
(p.52) Volstaat die uitleg? Of moet men, om de grondreden te vinden, nog ver-der doordringen tôt die diepe, geheimzinnige maar zekere wetten die de innerlijke verhoudingen tussen bloed, geest en taal beheersen en waar de geheimen van ons innigste wezen schuilen ? Wat er van zij, aïs men mij vraagt, en het gebeurt dikwijls, hoe ik aangespoord werd om op zoek naar mijn verloren taal te gaan, heb ik maar éen antwoord, éen enkel: « Ik hoorde de stem van het bloed, en ik luisterde naar deze roep. » Het ging noch zonder strijd, noch zonder tegenkanting. Maar over mijn ouders heen vond ik mijn voorouders terug.
Jean-Marie Gantois
JEAN-MARIE GANTOIS (Waten 21.7.1904 – 28.5.1968), priester; was de voornaamste promotor van de Vlaamse Beweging in Frankrijk. De los van elkaar bestaande Vlaamse kringen werden in 1924 onder zijn impuis gebundeld tôt het Vlaams Verbond van Frankrijk, waarvan hij secretaris werd. (Frits Pittery) – Het WF, waarvan hij de bezieler was, heeft in de période tussen de twee wereldoorlogen éen ongeziene opbloei gerealiseerd; hij was ook de drijvende kracht in de beide tijdschriften die het Verbond (van 1929 tôt 1944) uitgaf: ‘Le Lion de Flandre’ en ‘De Torrewachter’. (Jozef Deleu) – Naast éen 6-tal Franse boeken gaf hij volgende Nederlandse uit: Nederland in Frankrijk (o. ps. H. van Byleveld), (1941), Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond (1942), Ons Nederland boven de Zornme (1956), De zuidelijkste Nederlanden (1967). Van Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond verscheen in 1977 éen 3e uitgave. LIT.: André Demedts, Jean-Marie Gantois. Over mijn ouders heen, VWS-Cahiers, nr. 24, 1970.
(p.53) BERGUES Mon Nord est froid d’un froid de fer. Nos cieux offerts sont durs En leur pâleur de tendre porcelaine. Je vois ces vieux quais morts et leurs canaux herbus, Des pavés, l’orgueil tors de ma cité nouée En ses murailles souveraines. Mon pays s’ennoblit de ce qu’il a souffert, Nul ne sera vainqueur de sa force d’attendre : Ma Flandre est chaude comme un coeur.
Emmanuel Looten
SINT-WINOKSBERGEN Mijn Noorden is van ijzer koud. Onze lage hemelen zijn hard In hun van bleekheid teder porselein. Ik zie de oude kaaien dood, in de kanalen gras, Plaveien, de geknakte trots van mijn verschanste stad Binnen haar soevereine wallen. Mijn land wordt edeler door wat het leed, Geen zal vermeesteren zijn wachtende kracht. Mijn Vlaanderen, warm hart.
Emmanuel Looten Vertaling Willy Spillebeen
|
|
1200s |
R. De Buysscher, Jean Ier, Duc de Brabant, in: L’ACCENT-KENMERK, Sept.-Oct. 1995, p.21-24
Sur le plan linguistique, Jean Ier fut aussi un novateur: « Là où son père, à côté du latin, n’utilisait que le français (celui-ci dans les relations avec des seigneurs francophones comme les comtes de Flandre, de Namur ou du Hainaut ou encore avec des nobles des territoires de langue française) le duc fut le premier à accorder des privilèges aussi en langue thioise. Bruxelles fut la première ville à bénéficier de cet avantage. Les autres villes brabançonnes comme Louvain, Anvers , ‘s Hertogenbosch , Lierre, Tirlemont et Zoutleeuw ne reçurent de privilèges semblables dans la langue populaire que sous le règne de Jean II (1294-1312). » (p.22)
Depuis un peu plus d’un siècle, des historiens « révisionnistes » (eh oui! il y en avait déjà) se sont penchés sur cette période difficile et ont fini par s’inscrire en faux sur l’acception que l’on se fit de cette époque. (p.23)
|
|
1302 |
Liebaart <liebaart@tiscalinet.be> a écrit dans le message : 3c395adc$0$75149$ba620e4c@news.skynet.be… > > Des cavaliers namurois aux Eperons d’ Or, LB 01/05/1983
> > > > les hommes du comté de Looz enfin que mène au combat Henri de Petershem. » |
|
1302 |
Olivier Rogeau, 1302-2002 Les batailles de la Flandre, in : Le Vif/ L’Express 05/07/2002, p.12-16
18 mai 1302 : de Brugse Metten : révolte des artisans de Bruges massacre de centaines de soldats français et de quelques ‘leliaerts’. « Les uns sont assommés ou égorgés dans leur lit, les autres traqués dans les ruelles étroites. »
11 juillet 1302 de Guldensporenslag
|
|
1400s-1794 |
M. Gauchez, L’ Entre-Sambre-et-Meuse, Office de publicité, Bruxelles, 1949
(p.5) « Les troupes de Henri II et de Louis XIV y pillèrent cyniquement . » (= la Fagne) (Mariembourg, Philippeville).) (p.8) « Le 20 septembre, ayant franchi la Sambre à Châtelet, Henri II logea à Jumet, puis il dévasta le Hainaut comme il avait ruiné l’ Entre-Sambre-et-Meuse. » (p.70) La collégiale de Walcourt – « Les Français l’avaient incendiée en 1477 » (…) (p.80) « En 1794, Charbonnier, Saint-Just et Jourdan, désireux de dégager Maubeuge, et de passer la Sambre, marchèrent à l’attaque jusqu’ au moment des victoires de Fleurus et de Charleroi: celles-ci livrèrent la Belgique aux Sans-Culottes et valurent à nos provinces d’irréparables ruines. »
|
|
1408-1790s |
P. Blondeau, Au pays des Rièzes et des Sarts, 97, 1984, p.37-38
(p.37) « Les « pilleries » françaises
(p.38) « Notre châtellerie de Couvin fut victime pendant 4 siècles des déprédations de ses voisins du Sud. » « La liste est longue: les Bourguignons en 1408, 1466, 1468; les « Ecorcheurs » de 1433 à 1436! Au XVIe siècle, spécialement en 1505, 1521, 1544, 1545, 1552, 1553, 1554 et 1555, puis en 1582, les armées de Van Trossem, de Henri II et ses connétables, en passant par les garnisons de Mariembourg, Philippeville et Charlemont qui se considéraient en pays conquis. Au siècle suivant, les ravages sans arrêt des troupes de Louis XIII, puis de Louis XIV, pillant, réquisitionnant, brûlant villes et villages en 1622, 1628, 1629, 1635, 1640, 1643, 1653, 1667, 1872, (…) 1676, 1678, 1682, 1688, 1694, 1696, 1699 … Et les archives continuent à nous signaler les méfaits et ‘pilleries’ de leurs sucesseurs en 1703,1709,1710, 1711, 1736, 1741, 1746 .. avec, comme bouquet la fin du 18e siècle. »
|
|
1500s |
F.-A. Sondervorst, Histoire de la médecine belge, éd. Séquoia, 1981
/Erasme/
(p.65) Ayant repris le chemin de l’Angleterre, il s’arrêta souvent en cours de route pour rédiger l’Eloge de la folie qui connut un succès prodigieux. En Angleterre, il publia plusieurs œuvres d’auteurs grecs et latins. Les Colloques, véritable galerie de portraits sarcastiques, lui suscitèrent de nombreuses inimitiés.
Si Erasme (Fig. 26) égratignait ses adversaires, il était cependant un pacifiste convaincu, ainsi qu’en témoignent ses Adages publiés à Venise. Adversaire de tous les pouvoirs, il y écrivit: «Pourquoi l’aigle représente-t-il symboliquement les rois? C’est parce que cet oiseau, qui (p.66) n’est ni beau, ni musical, ni comestible, est carnivore, glouton et détesté de tous. » Partout où Erasme apparaissait, il prêchait l’entente et la conciliation: «dulce bellum inexpertis», elle est bien suave la guerre pour ceux qui ne fréquentent pas les champs de bataille! Partout, il reçut un accueil enthousiaste, mais il finit par partager le sort de presque tous les gens modérés, celui de déplaire aux deux parties. Les moines ne furent pas moins animés contre lui que les Luthériens; les premiers l’accusant d’hérésie, les seconds le traitant de dangereux papiste. Pour échapper à ses ennemis, il erra à travers l’Europe, balloté entre l’enthousiasme suscité par sa parole et ses écrits et un reflux de popularité. De guerre lasse et quelque peu désabusé, il se retira à Baie où, torturé par la goutte et la gravelle, bientôt frappé de paralysie, il quitta en 1536 ce monde de barbares, implorant la pitié divine et laissant tous ses biens aux pauvres. Ni les grands de ce monde, ni les célèbres académies de son temps, ne purent s’attacher ce grand humaniste épris d’indépendance et de liberté. Après Cambridge, Paris et Louvain lui offrirent en vain un magistère. Holbein, dans son tableau du Louvre, a le mieux immortalisé ce roi de l’intelligence: des yeux pétillant d’intelligence, un nez un peu trop long, flairant les faiblesses de ses adversaires, des lèvres mi-caustiques mi-amères, semblant se plisser pour distiller quelque malice, des mains spirituelles mettant tout leur temps à écrire. Grâce à ce portrait, on saisit davantage la pensée et l’œuvre d’un homme qui s’est efforcé de faire sortir l’esprit humain de l’obscurantisme statique du moyen âge et de l’orienter dans la voie de la recherche et du progrès.
|
|
1554- |
M. Chapelle, R. Angot, Les processions et la marche militaire de la Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville, s.d.
1) (p.43) « En 1928, le doyen de Fosse – l’abbé J. Crépin – attribua l’ origine des Marches « à la nécessité d’ être à même de défendre le Saint-Sacrement ou les Reliques des Saints contre une explosion du fanatisme protestant et, notamment, conte les coups de main des bandes de Huguenots français qui parcouraient notre région et ne reculaient pas devant d’ odieux sacrilèges. » « Effectivement, en 1568, sous la conduite du Sire de Genlis, les Huguenots se livrèrent, à Fosse, à un pillage monstrueux les 18 et 19 octobre. » 2) « En 1554, l’ armée d’ Henri II, roi de France, vint brûler Fosse les 5 et 19 juillet. En 1568, ce fut le vandalisme des Huguenots signalé ci-dessus. » 3) (p.44) « En 1653, le Grand Condé, lui aussi, investit la ville, la pilla et brûla l’ hôpital des Soeurs Grises. » 4) « Enfin, les guerres, suscitées par l’ ambition de Louis XIV, roi de France, accablèrent aussi la cité d’ une foule d’ exactions. »
|
|
1600s |
Georges Krug, s.j., Impasses politiciennes, LB 23/01/1992 « Le vrai fédéralisme est un mouvement ascendant et convergent. » « Ce n’est pas tant d’imagination qu’ont manqué nos réformateurs … Obnubilés qu’ils étaient (et que plusieurs semblent toujours être) par les dogmes jacobinistes des XVIIe et XIXe siècles, ils ont ignoré le vrai tissu, depuis toujours multiforme et très diversifié, de ce riche pays de l’entre-deux que nous constituons. »
|
|
1655-1797 |
Aline Octave, porte ouverte sur … Bourcy, 1973
(p.32) « /Citons pour erminer ce chapitre,/ les lignes suivantes inscrites sur la page de garde des oeuvres de loi de la Haute Cour de Bourcy: « L’ an 1655, la 21e année de la guerre triste et déplorable qui fut comméncée par Louis XIII, Roy de France, et continuée par Louis XIV, prions Dieu, qu’ Il nous donne la paix. » « En janvier 1651, deux régiments de cavalerie commandés par le Compte de Granpré, lieutenant du Maréchal de Turenne, occupent les seigneuries de Longvillé et de Borsy. Les soldats y enlevèrent tous les chevaux de service, tout le bétail, les grains et les meubles. La moitié des habitants furent réduits à la besace. Ils s’ adresèrent au Conseil du Luxembourg. » /Arch. du Gouvernement – Luxembourg/
(p.70) Sous le régime français (1792-1815) « Ce fut pour le Luxembourg, une période de troubles et de persécutions religieuses. … L’ abbaye d’ Orval fut pillée et incendiée, de même que celles de Saint-Hubert et de Clairefontaine. » A partir du Directoire du 4 septembre 1797, une scission éclata parmi les prêtres: d’ une part, les prêtres jureurs (jurant fidélité à la République, comme le décrétait un arrêté de cette époque) et les prêtres qui avaient refusé le serment. (pp.71-72) « Il ne restait aux prêtres fidèles, que la clandestinité et ses retraites. ls trouvèrent dans nos villages, grâce au dévouement de la population chrétienne,des maisons sûres et des cachettes nombreuses pour exercer leur ministère dans la clandestinité. C’ était bien souvent un ministère de nuit, célébré dans un endroit quelconque, toujours différent, parfois même dans les bois. Un courant de résistance s’ installa sous le nom de « Stevenisme ». Il avait à sa tête, pour la région de bastogne, l’ abbé J. Reding, curé de Bercheux, et Luc Grandjean, curé de Nives. Ces deux prêtres réfractaires très en vue furent très recherchés. Nous relevons quelques noms de prêtres de la région, cachés ou absents: J. HENNECART, curé de Noville, BALON, ex-vicaire de Bourcy, …, les deux frères BARTHELEMY de Bourcy. (La famille Barthélemy, est ascendante de la famille Duplicy). »
|
|
1695 |
Pierre Israël (Heusy), Histoire(s) de pommes de terre, AL 25/04/2001
Il faut cesser de faire référence à l’histoire de France et à ce bon monsieur Parmentier pour expliquer l’introduction de la pomme de terre en Belgique. Ce tubercule est en réalité arrivé chez nous via l’Allemagne où elle est apparue dès le début du XVIIe siècle par les ports hanséatiques. Dans la principauté de Stavelot-Malmedy, elle a été ramenée en 1695 par un habitant de Hockay travaillant à Hambourg. Elevée dans un premier temps dans les potagers, le temps de l’apprécier et de produire des plants en quantité suffisante, la « crompire » (de l’allemand Grundbirne, poire de terre) est cultivée dans les champs de la plupart des villages de la principauté dès 1705, soit 81ans avant l’expérience de Parmentier.
|
|
z1789 |
M. Duyck, LA BATAILLE DE TURNHOUT, in: L’ACCENT-KENMERK, Sept.-Oct. 1995, p.14-21
Que retenir de cette bataille du 27 octobre 1789 qui se déroula en pleine ville contre les Autrichiens, et qui marqua le début de la résistance des patriotes au régime de Joseph II – qui n’en faisait qu’à sa tête – et aboutit enfin à la naissance des « Etats Belgiques Unis »?
En 1989 la ville de Turnhout commémorait cette glorieuse bataille par tout un ensemble de manifestations. Leur succès était tel qu’on décida de les reprendre, du moins en partie, les 15, 16, 17 et 22, 23, 24 septembre 1995. Neuf épisodes de cette bataille furent de nouveau mis en scène en neuf endroits différents de la ville, chaque épisode étant répété neuf fois au même endroit; le public se déplaçant d’un endroit à l’autre, d’une scène à une autre, conduit par des patriotes, tambours , porte-drapeaux, porte-flambeaux, etc. Plus de 16.000 spectateurs assistèrent dans l’enthousiasme à ces neuf évocations historiques. La critique de représentations théâtrales ou de plein air n’est évidemment pas la vocation de notre périodique mais il nous est quand même difficile de ne pas parler de ce succès qui dépassait toute attente et de l’enthousiasme d’un public subjugué par l’ensemble du spectacle. Le sujet lui-même mérite l’attention de tous dans un pays où les valeurs historiques se font facilement fictives et où la politique d’un jour l’emporte souvent sur des valeurs solides. Cela vaut peut-être la peine de creuser un peu plus si l’on sait qu’un ancien ministre, bourgmestre de Liège, jadis capitale de la principauté, s’est permis de refuser de prêter un tableau sous prétexte que celui-ci devait aller à cette remarquable exposition d’ oeuvres uniques du temps des « Fiamminghi », prêtées par un grand nombre de pays étrangers. Le bourgmestre ignorait-il que ce mot englobait tout ce qui de ce temps-là fut produit comme oeuvre d’art à travers l’ensemble des Pays-Bas, y compris la principauté?
Cela vaut sûrement la peine de relire le « TRAITÉ D’UNION ET ÉTABLISSEMENT DU CONGRÈS SOUVERAIN DES ÉTATS BELGIQUES-UNIS ». Ce Traité fut « Ainsi conclu, fait et arrêté, à Bruxelles, dans l’ Assemblée-Générale des Etats Belgiques-Unis, par les soussignés Députés des Etats respectifs, sous la Ratification de leurs commettans, le onze de Janvier, l’ an mil-sept-cent-quatrevingt-dix, à deux heures du matin- » Suivent alors les signatures des délégués de « Brabant, Gueldres, Flandres, West-Flandre, Hainaut, Namur, Tournay, Tournesis, Malines ». Voila comment le précurseur de la Belgique actuelle fut tenu sur les fonts baptismaux.
Dès le début il est clairement rappelé qu’à la mort de Marie-Thérèse, Joseph II a été reconnu comme souverain incontesté, « mais sous des réserves & avec des stipulations expresses, telles que la constitution de ces provinces les avoit édictées, d’ancienneté. » « Ces stipulations & ces réserves, contenues dans le pacte inaugural, étoient plus anciennes que la Maison qui gouvernoit le Pays, & nées pour ainsi dire avec la Nation même. Aussi furent-elles agréées & jurées solennellement: & rien ne manqua au Traité, que le Peuple, avant de se donner, fit suivant l’usage, avec son Prince. »
L’article VII stipule que « Chaque Province retient & se réserve tous les autres droits de souveraineté; sa législation, sa liberté, son indépendance; tous les pouvoirs, enfin, juridiction & droits quelconques, qui ne sont pas expressement mis en commun & délégués au Congrès Souverain ».
Si en ce moment on parle tant de démocratie et de droits démocratiques c’est sans doute parce que ceux-ci font singulièrement défaut- Une vraie démocratie repose sur la reconnaissance de l’autorité suite à un contrat d’accords entre cette autorité et le peuple. Joseph II ignorait tout simplement ces accords. Les retombées de la Révolution française allaient encore aggraver les choses. La poursuite des principes de liberté, égalité et fraternité allaient aboutir à l’effet inverse. L’influence de ces prises de position idéologiques sur le déroulement des événements allait, surtout sous la conduite de Vonck, ébranler bien vite l’état fraîchement constitué et l’affaiblir terriblement. L’intervention de la Prusse, des Provinces Unies et de l’Angleterre, conduisit finalement au Traité de Reichenbach qui rétablit la Maison d’Autriche dans ses « droits » et cela après que Léopold II, qui avait succédé à son frère Joseph II, décédé subitement, eut promis que les institutions des provinces Belges seraient respectées, et que les insurgés bénéficieraient d’une amnestie. Les troupes autrichiennes se rendirent à nouveau maître au pays et à partir de décembre 1790 l’administration autrichienne siégea à nouveau à Bruxelles.
Pour la gouverne des fédéralistes actuels qui se sont emparés du pouvoir, l’article VII, cité plus haut, définit clairement les relations à respecter pour aboutir à une vraie fédéralisation. Un état fédéral digne de ce nom, contrairement à celui qu’ont imaginé des hommes politiques qui depuis longtemps refusent de tenir compte de la voix du peuple, doit reposer sur des valeurs naturelles authentiques et non pas sur des slogans du type « La langue est tout le peuple ». Nous proposons aussi à la méditation de ces mêmes hommes politiques qui se sont appropriés une grande part de la politique étrangère de notre pays à partir d’arguments linguistiques, l’article X de ce Traité. – « Il ne sera libre à aucune Province de faire une alliance, ou traité quelconque, avec une autre puissance, sans le consentement du Congrès; & les provinces particulières ne pourront s’unir entr’elles, s’allier ou contracter, de quelque maniere que ce puisse être, sans le consentement du Congrès. »
|
|
1789-1989 |
Le bouleau …, LB 02/03/1989
José Happart vient d’écrire à tous les bourgmestres wallons pour attirer leur attention sur une activite qui sera organisée le 21 mars dans chaque municipalite de France, à savoir la plantation d’un arbre de la liberte (en l’occurrence un bouleau) pour commemorer la Déclaration des droits de l’homme… et pour leur demander de faire de même. C’est que, explique le premier élu de Fourons, « la Wallonie est très proche par sa langue, sa culture et ses principes démocratiques de l’Etat français”, Dès lors, il souhaite que toutes les communes de Wallonië imitent leurs consoeurs françaises ‘(pour prouver leur attachement indéfectible à la Communauté de langue française d’Europe”. Enfin, le deputé socialiste européen demande que les bourgmestres l’informent de leur décision afin qu’il puisse en informer la population wallonne… mais aussi serait-il un agent du Quai d’Orsay ? – “les autorités françaises”.
… OU le chêne ? L’initiative témoigne d’une francophilie aussi exacerbée que déplacée. Elle est, au reste, peu suivie et suscite des réactions négatives. A lire, par exemple, celle de la commune de Dour sous la plume de son premier échevin, M. Jacques Lefèvre, qui est aussi le secrétaire politique du P.S.C. Tout en marquant évidemment son attachement aux droits de l’homme, M. Lefèvre s’étonne de la date choisie, qui est celle fixée par les municipalités de France . “Comme Wallons – et fiers de l’être – nous pensons que nous devons nous-mêmes prendre nos responsabilites. C’est pourquoi Dour donnera un relief particulier à la commémoration de la Declaration des droits de l’homme… mais lors des fêtes de Wallonie et de la Communauté française, le 27 septembre.” M. Lefèvre précise aussi – In cauda venenum – que l’arbre de la liberté qui sera planté sera un chêne et non un bouleau “car le bouleau est un arbre qui plie et s’incline trop souvent”.
La querelle de l’ arbre, LB 06/03/1989
José Happart a proposé aux bourgmestres wallons de planter un bouleau, comme leurs collègues français, le 21 mars. Il s’agit, pêle-mêle, de commémorer les droits de 1’ homme, de l’enfant, de la femme, du citoyen, la Déclaration universelle, la Révolution française, la première libération du joug hollandais, la liberté, la francité, et quelques autres grandes idées par un geste symbolique. Le secrétaire politique du P.S.C , Jacques Lefèvre, a repondu à l’ex-candidat bourgmestre qu’il préférerait la date du 27 septembre, fête de la Communauté française et de la Wallonie. Il ajoutait qu’un chêne lui semblait préferable au bouleau, “qui plie et s’incline trop souvent“. (L.L.B. du 2 mars). La réponse de José Happart allait de soi : le bouleau plie, mais ne rompt point. Il ajoute qu’il s’agit d’une essence indigène et signale qu’il ne se braque pas sur une date précise mais que le mois de septembre est très mauvais pour transplanter un arbre. Sur le terrain horticole, l’ex-candidat bourgmestre est très fort.
|
|
1792 |
Georges Krug s.j., Rassemblement Wallonie-France, LB 08/12/1999
Il faut prendre les auditeurs pour des ignares de l’ABC de notre histoire pour oser parler d’un ‘retour’ à une mère-patrie qui serait la France. Sur un passé de plus deux mille ans, les Pays-Bas du Sud ont été annexés par la force à la France de 1792 à 1915. Ces 23 pauvres années furent marquées par le pillage de nos trésors d’art, la mise à sac de plusieurs sanctuaires, l’embrigadement forcé de toute une jeunesse dans les armées de la république, puis de l’empire …Waterloo fut un soulagement, mais la liberté ne nous échut que 15 ans après. L’idolâtrie de la Nation-Etat est l’idéologie directement issue du jacobinisme post-révolutionnaire. Nos séparatistes du Nord, comme ceux du Sud, s’en repaissent. Aucune estime du composite, allergie au polymorphe, méconnaissance de l’esprit fédéral … Alors que l’avenir est aux ensembles diversifiés, ils ne tolèrent que des monolithes. Ils se prétendent l’avenir, ils s’y orientent à reculons … Si, par malheur, ils réussissaient à dresser des barières là où jamais il n’en a existé la moindre, alors: de pomme de leur discorde, Bruxelles deviendrait un foyer de discorde. Le coeur même de l’Europe serait écartelé. Cruelle victoire de l’intolérance sur l’ouverture du coeur et de l’esprit! Un remake de l’Anschluss … Moins barbare que celle 1936, cette annexion résulterait du même virus nationalitaire.
|
|
1792 |
Villance / Culture – Le culte clandestin et la Révolution française, VA 04/02/2003
Conférence à Libin donnée par Thierry Scholtes, conservateur des Archives de l’Etat de Saint-Hubert : « Le culte clandestin en Luxembourg au temps de la Révolution française (1795-1802) ».
|
|
1792-1815 |
Hervé Hasquin, éd., La Belgique française, 1792-1815, Crédit Communal, 1993
(p.421) La bigarrure linguistique des « provinces belgiques »
Pour les révolutionnaires français, cartésiens par tradition et porteurs d’un projet si neuf qu’il paraissait ne pouvoir s’accomplir qu’au moyen d’une politique de la « table rase », les provinces belges n’allaient pas manquer, par la diversité de leurs comportements linguistiques, de susciter de nombreuses difficultés à la mise en application d’une politique cohérente et systématique en matière de langue. A Bruxelles, la-situation était pour le moins complexe. Ainsi pouvait-on lire, par exemple, dans une Description de la ville de Bruxelles éditée chez Boubers en 1782, ces quelques lignes: «La langue naturelle des habitants de Bruxelles est le flamand, mais presque tous entendent et parlent le français ; c’est même aujourd’hui la langue que l’on parle le plus communément». La présence de la Cour, qui avait contribué à promouvoir le français comme langue principale dans la vie sociale, de même que la pratique du français par les classes aisées de la population, qui y avaient trouvé une sorte de passeport culturel dans l’orbite de la vie parisienne, ne pouvaient cependant faire oublier que Bruxelles était et restait une ville flamande. Des études récentes ont permis de fixer aux environs de 10 à 15% le pourcentage de francophones dans la capitale du Brabant d’avant la Révolution. A cet égard, la relation entre l’appartenance à un certain milieu social et l’emploi de l’une ou l’autre langue est apparue de façon particulièrement explicite : on parle surtout français dans les quartiers huppés du haut de la ville, du parc de Bruxelles, ou de la rue Neuve. Le bilinguisme de fait d’une bonne partie des Bruxellois avait par ailleurs entraîné, dans le courant du siècle, un relatif abâtardissement du flamand parlé dans la capitale, qui, fortement contaminé par le français, avait créé quantité de vocables hybrides plus ou moins savoureux. Cette proximité relative avec les tournures françaises, ainsi que la facilité avec laquelle il était loisible de se faire comprendre et de converser en français aux quatre coins de la ville, n’allaient pas manquer, dans un premier temps, d’induire les occupants en erreur quant à l’appartenance linguistique des Bruxellois.
En Flandre même, malgré la diversité des patois d’une ville ou d’une région à l’autre, la conscience d’appartenir à une même entité linguistique et culturelle était vive. La tradition, quelque peu surannée, des « chambres de rhétorique » dans les villes, et l’influence du clergé dans la vie sociale des campagnes constituaient notamment un ciment culturel particulièrement solide. Bien que pratiquant dans une large mesure le français, les élites sociales flamandes elles-mêmes n’en étaient pas pour autant coupées de leurs racines linguistiques et culturelles. Elles continuaient à employer le flamand dans leurs rapports avec la population locale, et, pour ce qui est de la vie sociale et administrative, on peut parler, dans les provinces flamandes sous l’Ancien Régime, d’un véritable unilinguisme. Au niveau local, comme à l’échelon provincial, tout se traitait en flamand. De même, dans leurs rapports avec l’administration centrale à Bruxelles, les différentes instances flamandes, tout comme les particuliers, pouvaient user sans difficulté de l’idiome (p.424) du pays. La plupart des fonctionnaires du gouvernement central étaient d’ailleurs astreints au bilinguisme pour pouvoir exercer leur fonction. Ce n’est donc guère que dans quelques salons, parmi l’élite cultivée, que le français était parlé, en Flandre, à la veille de l’invasion française. La principauté de Liège, dont un bon tiers chevauchait l’actuelle province de Limbourg, n’échappait pas à la double appartenance linguistique, compliquée encore par l’usage, largement majoritaire dans les campagnes et fort répandu en milieu urbain, du wallon. La même situation prévalait dans le comté de Namur et le duché de Luxembourg, ce dernier comportant en outre, dans sa partie orientale, un « quartier allemand », dont la fidélité au pouvoir autrichien, fortement conditionnée par des facteurs de nature culturelle, allait constituer une source supplémentaire de résistance à l’occupant. Seul, peut-être, le Hainaut pouvait paraître présenter une situation linguistique propice à une politique de francisation. Bien qu’on y parlât également le wallon et le picard, la proximité de la frontière et les vicissitudes de l’histoire avaient fait depuis longtemps du français une langue usuelle pour une bonne partie de la population.
Premières mesures prudentes sous le Directoire
V otée quelques jours avant la chute de Robespierre, la loi du 2 thermidor an ii ne devait lui survivre que quelques semaines. Suspendue dès le 16 fructidor (2 septembre 1794), elle ne fut d’ailleurs jamais remise en vigueur par le Directoire. Au contraire, celui-ci allait – tout comme Dumouriez l’avait fait pendant les quelques mois (novembre 1792-mars 1793) de la première occupation française – pratiquer, en matière linguistique, une politique de type pragmatique qui, sans abandonner l’idéal de francisation, tiendrait compte du multilinguisme de fait des provinces belges. Dans un rapport présenté à la Convention au début de l’année 1794, les commissaires Camus et Treilhard, délégués en Belgique pour y organiser la première occupation, avaient en effet rendu compte des difficultés supplémentaires «considérables» que représentait, pour la pénétration des idées révolutionnaires, l’obstacle de la langue. En Flandre, par exemple, ils avaient relevé que le français n’était pratiquement pas compris de la masse de la population dans des villes comme Courtrai, Bruges, ou Ostende, où il avait fallu faire appel à la bonne volonté de quelques républicains locaux pour se faire entendre d’elle. A Meerhout, en Campine limbourgeoise, c’est en latin que le commissaire de la République Publicola Chaussard avait dû s’entretenir avec le bourgmestre, qui ignorait le français. L’Ancien Régime se vit dès lors accusé, entre autres maux, par le même Chaussard, d’avoir entretenu à dessein la diversité des langues pour mieux asservir les peuples. La «réunion» des provinces belges à la France, proclamée officiellement le 1er octobre 1795, allait être l’occasion, pour les nouvelles autorités, de tenter de remédier à cette situation préoccupante. Le 21 vendémiaire an iv (13 octobre 1795), un décret prescrivait que les lois et arrêtés ne seraient (p.425) désormais plus envoyés aux administrations d’arrondissement et aux municipalités qu’en français. L’article 3 précisait cependant que «partout où besoin serait», une traduction flamande pourrait y être jointe. Face à une situation locale peu favorable à une francisation rapide, les autorités se résignaient provisoirement à une sorte de compromis.
L’année suivante, la loi du 2 frimaire an v (22 novembre 1796) amorçait clairement une procédure de francisation dans le domaine judiciaire : désormais, seul le français devait être employé au cours de la procédure, quelle que soit la langue des parties. Les actes en flamand devraient faire l’objet d’une traduction certifiée, qui seule aurait force de preuve. Il n’y eut, de prime abord, que peu de réactions au sein de la magistrature flamande, composée il est vrai, pour l’essentiel, de partisans du nouveau régime et au sein de laquelle le bilinguisme était déjà un fait acquis. Quelques voix s’élevèrent bien lorsque la conjoncture politique française parut permettre, dans le courant de 1797, au parti royaliste de relever la tête, mais le coup d’Etat républicain du 18 fructidor an v (4 septembre 1797) mit fin à toutes velléités en ce sens. L’arrivée au ministère de la Justice du campinois Charles-Joseph (p.426) Lambrechts, originaire de Samt-Trond, fut cependant suivie de la publication en flamand du Bulletin des lois, ce qui mettait au moins la population a même de prendre connaissance dans sa propre langue des mesures législatives décidées à Paris.
De ce point de vue, il faut reconnaître qu’en pays flamand comme à Bruxelles, la plupart des affiches officielles étaient bilingues. De même, en ce qui concerne la presse, et même si le gouvernement tentait d’imposer ses propres publications, la plupart des journaux flamands avaient pu continuer à paraître. En matière d’enseignement, la déliquescence de l’ensemble des réseaux après cinq années de troubles, n’avait pu être endiguée. De ce point de vue, flamand et wallon faisaient, en principe, l’objet d’un traitement différent. Considéré comme un « idiome », et donc une entité linguistique à part entière, susceptible de véhiculer une idéologie contre-révolutionnaire, le flamand devait a priori être éradiqué du territoire national, au même titre par exemple que l’allemand ou l’italien. L’envoi « d’instituteurs de langue », prévu dans les régions concernées par un décret du 8 pluviôse ann (27 janvier (p.428) 1794), était pratiquement resté lettre morte en Flandre. La méfiance de la population envers un enseignement considéré comme impie avait fait le reste : les écoles flamandes, trop peu nombreuses et désertées par les élèves, n’avaient pu jouer dans le processus de francisation le rôle qui leur était en principe assigné. Quant au wallon, classé dans la catégorie des « patois » par le décret du 8 pluviôse, il ne faisait pas, en raison de l’absence de danger pour l’identité nationale qu’était supposée présenter sa parenté avec le français, l’objet de mesures spécifiques. Bien que fréquemment employé, notamment à Liège, dans les pamphlets contre-révolutionnaires, il fut plus méprisé, ou simplement ignoré, que véritablement combattu par les autorités directoriales.
Si le français avait certes fait des progrès dans la vie sociale et administrative – ainsi qu’en témoignent les registres notariaux bruxellois, au sein desquels la proportion d’actes en français passe, entre 1794 et 1799, de 24 à 60% -, il ne faudrait cependant pas se méprendre sur l’impact réel, très mince, de la francisation de la population au cours de ces premières années du régime français. Sans doute, le contact quotidien avec les nouvelles autorités et les nombreux Français présents dans nos régions fit-il plus, pendant cette période, pour familiariser la population avec la langue de l’occupant, que des mesures administratives à la fois trop peu nombreuses, incohérentes et mal appliquées, dont l’effet vexatoire ne pouvait, dans un milieu souvent hostile au régime lui-même, en particulier en matière de politique religieuse et de conscription, que susciter des réactions de rejet. Dans ce contexte, ce n’est sans doute pas un hasard si la « guerre des Paysans», qui éclate en Cam-pine et en Flandre fin 1798, et le « Klëppelkrich » luxembourgeois, qui lui est contemporain, constituent pratiquement les deux principaux faits de résistance collective armée au pouvoir français, synonyme non seulement de conscription forcée, mais aussi d’oppression linguistique dans ces régions de langue germanique.
Le Consulat et l’Empire : une francisation « à marche forcée »
Le coup d’Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) et l’installation du Consulat (15 décembre 1799), bientôt confié «à vie» au seul Bonaparte (2 août 1801), assurent dans la vie politique intérieure de la France, et par conséquent dans nos provinces, la stabilité nécessaire à la poursuite d’une politique de francisation active. Après un statu quo de quelques années, la loi du 24 prairial an xi (14 juin 1803) remet à l’ordre du jour les dispositions du 2 thermidor an n. De nouveau, il est stipulé que tout acte public devra être rédigé en français, et que les actes sous seing privé ne vaudront que munis d’une traduction certifiée par un traducteur juré, laquelle seule sera receva-ble. Les officiers publics sont cependant autorisés, si les justiciables en font la demande, à inscrire en marge de l’acte officiel en français, une traduction en idiome du pays. Bien qu’appliquées dans une large mesure – la proportion d’actes notariés en français à Bruxelles dépasse désormais les 80% – ces directives ne le sont pas avec la même exactitude dans toutes les régions du (p.429) pays, et ne manquent d’ailleurs pas de susciter certaines protestations. Ainsi, les notaires, pourtant devenus fonctionnaires publics depuis la réforme du 3 prairial an iv (22 mai 1796), contestent-ils notamment cette mesure à l’égard des testaments, et ce au nom de l’article 972 du nouveau Code Civil, publié le 21 mars 1804, qui stipule qu’ils doivent être couchés dans la langue du testateur. Régnier, ministre de la Justice, refusera tout accommodement à ce sujet : bien que dicté dans la langue du testateur, le testament devra être transcrit en français par le notaire et seule cette transcription pourra être considérée comme authentique. Bien qu’un délai d’un an fût accordé pour la mise en pratique de ces mesures, il paraît évident que leur application fut (p.433) loin d’être un fait acquis au cours des années suivantes dans l’ensemble des départements réunis.
Si la francisation des classes dominantes se poursuivait – notamment à travers un enseignement pratiquement francisé aux niveaux secondaire et supérieur, par le brassage culturel de l’institution militaire, et au sein de la fonction publique qui connaissait un développement sans précédent – il s’en faut de beaucoup que tous les cœurs aient été gagnés au français et à la France dans ces milieux. Ainsi, en Flandre, les chambres de rhétorique, qui périclitaient sous le Directoire, relèvent-elles la tête et permettent-elles de maintenir, au sein de l’environnement culturel flamand, une certaine tradition dialectale. Parfois débaptisées en «genootschap» voire en «société», elles entretiennent parmi les élites intellectuelles flamandes la conscience tangible d’une identité séparée. De même, les journaux flamands subsistent-ils dans un premier temps. Un seul exemple permettra de vérifier ce maintien tenace, à travers les vicissitudes politiques du temps, d’un véritable « sentiment flamand». En 1796, des médecins progressistes avaient fondé à Anvers une association dont les réunions se tenaient en néerlandais. Réprimandés par les autorités, il n’hésitèrent pas à publier, en tête du premier volume de leurs annales, un texte intitulé Lof der rijke en bevallige Moedertael (« Eloge de la riche et élégante langue maternell e»). Mieux encore, contraints de fusionner en 1801 avec la très francophone et francophile Société d’Emulation de la ville, ils s’en séparèrent dès 1806, pour fonder la Société médico-latine, dont les débats se faisaient dans la langue de Cicéron ! Chez ces bourgeois cultivés, progressistes, et qui maniaient très probablement le français quand besoin était, c’est là le signe évident de la volonté de conserver une identité flamande. De même peut-on signaler la fondation par J.A. Stips et J.A. Terbruggen d’une société intitulée Tot Nut der jeugd (« Pour le bien de la jeunesse »), dont l’objectif essentiel était le maintien de la langue maternelle dans l’enseignement.
De ce côté, la volonté de francisation s’était également affirmée. Dans les collèges et lycées, seul le français devait être enseigné, tandis qu’un effort particulier était fait dans l’enseignement primaire afin d’y implanter la (p.434) langue de l’occupant, à l’aide d’instituteurs formés dans les nouvelles écoles normales. Certains parents cédèrent sans doute à l’envie d’assurer à leurs enfants un meilleur avenir grâce à l’apprentissage du français, mais la mesure semble cependant avoir été un échec, puisqu’il fallut, en 1804, ouvrir au lycée de Bruxelles une classe préparatoire de français. La résistance du clergé à la politique du nouveau régime, bien qu’atténuée après la signature du Concordat de 1801, n’avait pas réellement cessé, et est sans doute responsable, pour l’essentiel, de cet échec scolaire de la francisation des populations flamandes, pour lesquelles la langue française restait souvent synonyme d’impiété et d’incroyance. La nomination, par Napoléon, d’évêques français dans les départements réunis ne parvint pas à renverser la situation, l’opinion restant fermement attachée au bas-clergé qui maintenait, dans l’ensemble, son opposition au régime. Face à cette résistance, certains préfets, véritables petits despotes locaux, choisirent la manière forte pour tenter d’imposer le français comme seule et unique langue dans leur département. Ainsi vit-on à Anvers, le préfet Voyer d’Argenson interdire les périodiques en langue flamande. A Gand, d’Houdetot se signalait par son zèle également, en obligeant par exemple la Gazette van Cent à publier dorénavant ses articles en français, en interdisant, en 1810, l’impression de tout ouvrage ou périodique en flamand dans le département de l’Escaut, et en tentant deux ans plus tard d’imposer une traduction obligatoire des noms de rues et des enseignes, alors même qu’on avait dû, à Bruxelles, six ans auparavant, en revenir aux dénominations usitées sous l’Ancien Régime, en raison des protestations répétées de la population.
Malgré ces mesures coercitives, et nonobstant l’usage généralisé du français dans la vie mondaine, sociale et administrative, le régime était loin d’être parvenu, après vingt ans d’efforts, à la francisation souhaitée. La méthode (p.435) employée, souvent brutale, l’attitude, fréquemment arrogante, des fonctionnaires français ne pouvaient certes pas favoriser la réalisation d’un tel objectif. Sans doute des progrès avaient-ils été accomplis dans la direction souhaitée, mais il y manquait l’adhésion de la population sans laquelle une véritable francisation ne pouvait s’accomplir. La facilité avec laquelle le régime hollandais put s’installer en 1815 est une preuve supplémentaire de cet échec, que l’on aurait facilement pu prédire au vu des réactions suscitées dans une région aussi potentiellement francophile que celle de Mons par la défaite des Français à Neerwinden. Amers, après six mois à peine de présence française, les mêmes qui avaient chanté en wallon l’arrivée des libérateurs, composaient une pièce intitulée Les Montwas in sont dégoûtés, proclamaient que les Etats «valiont bié mieûs que l’club» et se réjouissaient de pouvoir à nouveau porter en procession la châsse de Sainte Waudru. «L’abject et insignifiant jargon» décrié par le républicain liégeois Dieu-donné Malherbe dans un ouvrage daté de 1802, le langage «impur» que stigmatisait le Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans la langue française publié en 1806 « par un ancien professeur» tout acquis à la cause de la francisation, avait encore devant lui, tout comme les différents patois (sic) flamands, un bel avenir. Dans un pays où le provincialisme était depuis des siècles cultivé comme une vertu, l’œuvre centralisatrice et rationalisante des révolutionnaires français était, par avance, condamnée à s’embourber dans le maquis inextricable des particularismes. Pourquoi en aurait-il été autrement dans le domaine linguistique ?
|
|
1794 |
Roger Viroux, Révisionnisme pas mort, in: L’Accent, nov.-déc. 1997, p.13-15
Dans LA LIBRE BELGIQUE du 18 novembre 1997, j’ai lu une phrase où manquent trois mots: voici le texte: « Avant Waterloo, nous étions OCCUPÉS PAR LES Français. C’est tout de même autre chose ! » Oh, oui, que c’était autre chose ! Les 20 ans d’occupation ont été, avec les occupations récentes, 1914-1918 et 1940-1944, parmi les plus noirs de notre histoire.
Le but de l’invasion de la Belgique n’était pas de nous apporter la liberté, l’égalité et la fraternité: c’était de nous piller! « Un des premiers actes du gouvernement de Paris, après leur victoire de Fleurus, fut de lever en Belgique une contribution de soixante millions ». « Dignes héritiers des dévastateurs du Palatinat », dit M. Verhaegen, les Conventionnels taxèrent, le 14 juillet 1794, la ville de Tournai à 10 millions, Bruxelles à 50 millions et ordonnèrent d’enlever six cents otages dans cette dernière ville. Ils prescrivirent de prendre les cuirs, charbons, fers, bois, bestiaux, chevaux, céréales, fourrages, et de les expédier en France. Carnot recommande particulièrement de « dépouiller le Brabant ». (1)
« Tandis qu’elle permettait aux Français de payer l’impôt forcé … au moyen d’assignats, la Convention obligeait les Belges de fournir leur part en espèces… La France … commettait, à l’égard de la Belgique, un acte de rapine en même temps qu’un acte de malhonnêteté et d’hypocrisie, en faisant semblant de payer en assignats ce qu’elle payait… Le système ne peut se qualifier que par un mot: « pillage ». « Pillons, disaient-ils, ce pays qui est à notre merci! »
Les Comités d’Extraction s’appliquèrent à détruire les monuments artistiques de notre pays et à piller nos oeuvres d’art. (2) Nos oeuvres d’art qu’ils ne pouvaient emporter ils les détruisirent, mais ils volèrent d’énormes quantités d’oeuvres d’art. En 1818, après la victoire de Waterloo, l80 diligences vinrent en cortège de Paris à Bruxelles pour nous restituer nos tableaux, orfèvreries, etc. La fameuse Bibliothèque des Ducs de Bourgogne n’a jamais été restituée et se trouve toujours à Paris! Les biens de l’Eglise et des communautés religieuses furent confisqués au profit de la France et vendus à des particuliers, faisant de ceux-ci, ipso facto, des kollabos. Les nobles virent aussi leurs propriétés volées.
La déportation des prêtres refusant de prêter serment de haine à la royauté et des fonctionnaires refusant de collaborer avec l’occupant pour les enfermer dans les camps de concentation de l’Ile de Ré ou en Guyane suivit. Or « Au mois d’août l795, dans le Brabant seul, plusieurs centaines de détenus languissaient depuis, six, huit, dix mois dans la misère, la pourriture et le désespoir sans parvenir à être mis en jugement » (3)
Des comités de Surveillance surveillaient et dénonçaient les Belges. Ils avaient le pouvoir de faire des perquisitions et d’arrêter ceux qui leur paraissaient suspects. Le commissaire de Jemappes écrivait au ministre de la police: « J’ai confronté deux espions qui servent merveilleusement la République: l’un est déserteur d’un régiment français et l’autre un … émigré et voleur? Je les emploie. » (4)
Een trouwe abonnee, de heer R. Viroux las ook in de krant het « interview van een knecht van Chirac, luidende « Avant Waterloo, nous étions Français, c’était tout de même autre chose! », dat door onze medewerker A. Delrivière in bovenstaand artikel aangehaald wordt. Hij schreefeen lezersbriefmaar is bevreesd dat zijn brief niet gepubliceerd zou worden. Hij bezorgde ons een afschrift dat wij graag ietwat verkort publiceren.
HET REVISIONNISME IS NIET DOOD
In LA LIBRE BELGIQUE van 18 november 1997, las ik een zin waarin drie woorden ontbreken: « Voor Waterlo,waren wij DOOR DE Fransen BEZET. Dat was nogal wat anders! ».
Inderdaad Het doel van de verovering van België was niet ons vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid te brengen maar om ons te plunderen. Onmiddellijk werd een heffing van zestig millioen opgelegd. In 1794 werd Doornik beboet met tien miljoen, Brussel met 50 miljoen en zeshonderd gegijzelden. Leder kolen, ijzer hout, vee, paarden, graan, hooi, werden naar Frankrijk vervoerd. Carnot drong er speciaal op aan « Brabant te plunderen » (1)
De Fransen mochten de gedwongen belasting in assignaten betalen, de Belgen alleen in baar geld. « Laten wij dit land dat wij veroverden plunderen! »
Roofcomités verwoestten de kunstwerken en stalen ze. Wat zij niet konden meenemen vernielden zij. Na Waterlo reed een konvooi van l80 diligences van Parijs naar Brussel om onze kunstschatten terug te brengen Maar niet alle. De vermaarde bibliotheek van de Hertogen van Bourgondië berust nog steeds in Parijs.
Goederen van Kerk en kloostergemeenschappen werden aangeslagen en aan particulieren verkocht, eigenlijk collaborateurs De adel zag zijn bezit ook geplunderd.
Deportatie van priesters die weigerden de eed van haat tegen het koningdom af te leggen of die weigerden met de bezetter mee te werken, werden op het eiland Ré of naar Guyana verbannen. ln augustus 1995 lagen alleen al in Brabant honderden gevangenen maandenlang in de miserie en de vuilnis en met grote wanhoop in de gevangenissen zonder berecht te worden.
Bewakingscomités bespiedden en verklikten de Belgen. Er werd gemoord Priester Martin, in België geboren, had pastoraal werk in Kamerijk en was naar België teruggekeerd. Hij werd beschuldigd van emigratie en op 25 juli 1 794 te Brussel gefusilleerd.
De Boerenkrijg was aanleiding tot slachtingen. Na de inname van Diest legden de Fransen de inwoners een boete van veertig miljoen frank op en generaal Collaud gunde de soldaten twee uren om te plunderen. Wat zij duchtig deden Het beleg van Herentals duurde 24 uren: de Boeren lieten er 600 doden achter. De Fransen leden ook zware verliezen en legden een groot deel van de stad in de as.
In Hamme-Mille had een botsing plaats tussen jonge Walen op weg naar hun Vlaamse makkers, en Franse soldaten. De strijd bleef onbeslecht.
Onder leiding van Constant de Roux-Miroir bereikten zij hun Vlaamse strijdgenoten en veroverden Geldenaken, en later Hasselt De Belgen die tot vier uur in de namiddag weerstand boden, werden daarna tot 10 uur ‘s avonds uitgemoord door de Fransen die over kanonnen en paarden beschikten Constant de Roux-Miroir en eenentwintig jonge verzetslui werden gevangen genomen en naar Brussel gebracht. Allen ter dood veroordeeld en te Brussel gefusilleerd. In 1793 worden tien Belgen op het Koningsplein te Brussel gefusilleerd, twee geestelijken te Namen, kanunnik Rutten te Otrange, de onderwijzer van Florenville … Op 30 juni 1794 worden zestien priesters en geestelijken naar Atrecht vervoerd om daar onthoofd te worden …
2 Mille ans de l’histoire des Belges, par Franz Neve, 1926, p. 302. En Napoleon veranderde er niet veel aan: vierhonderd dikke eiken uit het bos van Wauhu bij Binche moesten er aan geloven. Hij veroordeelt Werbrouck die openlijk kritiek op hem had uitgebracht Wanneer de rechtbank hem toch vrijlspreekt, gaat een stoet door de hoofdstad om de bezetter te tergen. Opnieuw wordt hij opgepakt en naar Dowaai gevoerd waar hij van ontbering en slechte behandeling in de gevangenis stierf. Wie dit alles leest, meent de SS-tijd opnieuw te beleven!
Inderdaad: Dat was nogal wat anders!
|
|
1795 |
Ludo Baeten, Twee eeuwen volharding in de Franse Jacobijnse denktrant, in: Delta, 6, 2005, p.12-14
(p.12) In 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk ingelijfd op grond van het jacobijnse principe « la langue est la nation toute entière » (De taal is gans het volk, waar hebben we dit nog gehoord?). In de Zuidelijke provincies van België werden er romaanse dialecten gesproken, terwijl in de Noordelijke de adel en de hogere burgerij reeds sterk verfranst waren. Was het graafschap Vlaanderen ooit niet onderhorig geweest aan de Franse kroon?
(p.13) Onze gewesten, die tot dan toe ieder hun bestuurlijke identiteit hadden bewaard, werden in een unitaire dwangbuis gedwongen. Er werd een politiek van uniformisatie doorgevoerd terwijl de elite aan een ware hersenspoeling werd onderworpen. Geen enkele natie heeft zozeer ais de Franse la « conquête des esprits » in haar vaandel geschreven. (1)
De Franse opvatting van de politieke maatschappij werd doorgedrukt en verdrong het eigen staatkundig denken zoals dit zich in de loop der eeuwen had ontwikkeld en dat tot dan toe had standgehouden (2).
« Vanaf de tijd der Bourgondische hertogen hadden de vreemde heersers over de Zuidelijke Nederlnden het eigen leven van deze oude gewesten ontzien. Hun politiek tastte de lokjale rechten en autoriteiten zo min mogelijk aan en trachtte slechts over hen heen het gezag van een centrale regering te handhaven. ln de provincies kwamen de Statenvergaderingen regelmatig bijeen en zij waren veel meer dan in de Noordelijke Nederlanden, waar zij beheerst werden door de regentenoligarchie en eerder regeringsraden dan representatieve lichamen waren, nog vertegenwoordigingen van de oude standen. Hun macht, gebaseerd op allerlei ais provinciale constituties beschouwde privileges – de beroemdste is natuurlijk de Brabantse Blijde Incomste – was niet gering. Vooral in de belastingskwesties woog hun beslissing zwaar » (3)
Door hun aanhechting bij Frankrijk werden de Zuidelijke Nederlanden van hun historische wortels afgesneden. De geestelijke overwoekering door Franse denkbeelden en mythen bleek ncg rampzaliger dan de militaire bezetting en de politieke overweldiging. De gevolgen ervan zullen zich tot op heden doen gelden.
In 1815 wordt de eenheid van de Lage Landen hersteld. Koning Willem, waarvan de verdiensten steeds meer worden gewaardeerd (4), was ten zeerste begaan met de ontwikkeling van de op vele gebieden achteropgeraakte Zuidelijke Nederlanden.
Jammer genoeg was hij ook ingenomen met het Franse politieke denken dat trouwens in de kaart speelde van een bepaald verlicht despotisme. Ook koos hij zijn medewerkers onder de oud-gedienden van het Franse bewind en aan overtuigde « centralisten » zoals bv. Minister Comelis van Maanen. Hij gat geen gehoor aan degenen die hem voorhielden wat meer rekening te houden met de eigen politieke tradities.
Was hij op deze wijze raadgevingen ingegaan en had hij een meer gedecentraliseerd bestuur in acht genomen, de Brusselse rellen van 1830 zouden wellicht nooit aanleiding hebben gegeven tot een atscheidingsbeweging. De diepere oorzaak van de scheiding moet worden gezocht in de weigering een nochtans opvallende verscheidenheid te erkennen en in het verwerpen van een gezond particularisme eigen aan ‘s lands tradities.
Dank zij het staatsmanschap van Jan Thorbecke (5) komt in Nederland daarin verandering in de jaren 1848-1851. Amper twintig jaar na de Belgische atscheiding wordt daar aan de gemeenten en de provincies een ruimere autonomie toegekend, zodat Nederland een gedecentraliseerde unitaire staat werd. Deze decentralisatie heeft de politieke samenhang van Nederland eerder versterkt dan verzwakt.
De bezielende gedachte van Thorbecke was: « de natuur is niet daarom zoo rijk dewij/ zij ééne kracht, maar omdat zij, ééne oneindige verscheidenheid van wezens, ieder met eigen kracht, onder een a/gemene wet /aat werken » (6).
Bij gebrek aan een dergelijke visie volharden de grondleggers van de nieuwe Belgische staat in de jacobijnse vergissing. Andermaal wordt de staatsconstructie naar Frans model op een strak unitaire leest geschoeid. Men zag niet in dat tussen eenheid en verscheidenheid een vruchtbare wisselwerking kon ontstaan.
Door een verbeten Vlaamse strijd mislukt de poging tot taalkundige homogeneïsatie. Zelfs vanuit een Belgisch standpunt moet de Vlaamse Beweging ais een winstpunt worden beschouwd. Zij heeft in de Zuidelijke Nederlanden de verscheidenheid van taal gevrijwaard en daardoor een grotere openheid van het land in vele richtingen mogelijk gemaakt.
Het anderhalve eeuw volgehouden unitaire regime heeft echter trustratiegevoelens gewekt (p.14) die uitmonden in nationalistische stromingen. Deze sturen aan op de vestiging van twee tegengestelde « volksgemeenschappen », waarin « le mal français » welig blijft voortwoekeren. leder nationalisme is behept met Franse concepten, dogmas en mythen. Het Vlaamse nationalisme ontsnapt daar evenmin aan.
ln het al oververkavelde Noordwest Europa wordt aldus aangestuurd op de oprichting van twee nieuwe verkrampte natie-staatjes, al dan niet samengehouden »door een impotente Statenbond. Wei te verstaan worden deze natiestaatjes geconcipieerd naar het klassieke Franse mode!.
Zonder wortels in het verleden bieden deze nieuwe scheppingen geen uitzicht op de toekomst. Ook wekken zij bij de bevolking niet het verhoopte enthousiasme. Behalve dan bij degenen aan wie zij… een loopbaan verschaffen! Zij zijn het kunstmatig product van een pOlitiek onvermogen.
Argeloze politici hebben getracht onrijpe jeugddromen, achterhaalde idealen van zestig jaar geleden te verwezenlijken. Met de nieuwe internationale context werd geen rekening gehouden. Aan de functie van Europees kerngebied van de landen en gewesten van de Gouden Delta werd niet gedacht.
De ingevoerde nieuwe staatsregeling drijft de losgeslagen gebiedsdelen in een positie van isolement. Zij maken er een gemakkelijke prooi van voor de drijfveren van de grote gieren van de Europese politiek. Zolang de Europese Unie geen evenwichtige klassieke federale structuur heeft verworven blijft de grootste waakzaamheid geboden.
De sedert 1795 opeengestapelde vergissingen moeten worden toegeschreven aan een schrijnend gebrek aan politieke cultuur. Er werd en wordt geen rekening gehouden met de uitzonderlijke geografische positie van onze landen en gewesten. Evenmin met hun zà rijke politieke traditie. De meest dringende taak is aan dit gebrek te verhelpen.
(1) in tegenstelling bijvoorbeeld met het tijdperk van de Spaanse Habsburgers, waarvan men terecht kon schrijven: “le roi d’Espagne règne en Belgique mais ne la gouverne pas-. (2) Over het verschil tussen Frankrijk en bv. Spanje (of Oostenrijk), schrijft Henri Pirenne in zijn « Histoire de Belgique-: « L’Espagne qui a régné si longtemps sur la Belgique, n’y a rien laissé d’elle, si ce n’est quelques noms de forteresses (Charlemont et Charleroi), quelques appellations de familles dues à l’alliance d’un noble castillan avec une héritière ou d’un soldat avec une paysanne. A part cela, de même que son sang ne s’est pas mêlé à celui de peuple, elle n’a exercé aucune action sur l’art, ni sur la littérature; elle n’a même passé aucun mot de son vocabulaire aux dialectes flamands ou wallons. Les deux nations ont vécu l’une à côté de l’autre sans se pénétrer, ni se comprendre» En Godefroid Kurth voegt er aan toe: « II n’y a pas eu à proprement parler de domination espagnole en Belgique, non plus de domination autrichienne; il y a eu seulement des Espagnols et des Autrichiens investis chez nous, par la confiance de nos souverains, des positions importantes qui provoquaient la susceptibilité nationale» (3) Prof. dr. E.H. Kosmann « De Lage Landen 1780-1940“. (4) Yves Schmitz « Guillaume 1er et la Belgique » Men leze daarover eveneens «De Taalpolitiek van Willem 1» door dr. A. De Jonghe met voorwoord van Gouverneur L. Roppe. (5) Prof. Dr. R. Kranenburg “Studiên over Recht en Staat”. (6) Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) was van 1825 tot 1930 hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Hij doceerde daar de historia politica.
|
|
1800s |
Eric Meeuwissen, Un livre, un prof, pour jouer au stratégo à Waterloo, LS 31/5/90
A propos du livre de Luc Devos, Les 4 jours de Waterloo 15-16-17-18 juin 1815, éd. Hatier Le livre mentionne une erreur parue dans le “Dictionnaire d’histoire de Belgique “, publié en 1988 sous la direction d’Hervé Hasquin et dans lequel on peut lire: “Les Belges qui participèrent à la bataille de Waterloo le firent surtout dans les rangs de l’armée française.”
|
|
1800s |
Philippe Engels, Olivier Rogeau, 1302-2002 Les batailles de la Flandre, in : Le Vif/ L’Express 05/07/2002, p.12-16
Henri Conscience écrivait “De Leeuw van Vlaanderen”. Le roman de Conscience (…) est d’abord utilisé comme une arme pro-belge face à la menace française.
|
|
1940 |
Jean Vanwelkenhuyzen, Jacques Dumont, 1940 : Le grand exode, 1983
p. 94 massacre d’Abbeville p.112 assassinat de DENUIT, père d’un journaliste du « Soir ». 60 ans ( C’était un parachutiste.)
p. 213 Dans les magasins, dans les restaurants, on vit des affichettes « Rien pour les Belges » Des incidents eurent lieu dans les rues. Beaucoup de salariés belges furent congédiés. C’est l’époque, où des Belges, voulant se désaltérer encaissent de cinglants : « Allez donc boire l’eau du Canal Albert ! » L’épithète « Boche Boches du Nord » est alors à la mode.
p.225. A Toulouse, la marquise de Panaât, ayant voulu témoigner de son estime pour l’armée belge, m’avait fait offrir les salons de son hôtel pour y établir le mess de garnison. A la nouvelle de la reddition, elle nous en interdit l’accès. Le même jour, l’évêque de Lourdes défendait aux prêtres belges de dire la messe et de confesser, sous peine de péché mortel. Il fallut, après plusieurs jours, l’intervention d’un jésuite belge pour faire cesser cette incroyable mesure.
p. 229. Jeunes CRAB envoyés pour des travaux à l’arrière du front en réalité, près du front : 60 morts + des blessés.
|
|
1940-2006 |
Le courage de l’ambassadrice… , LB 18/11/2006
AVANT-PREMIÈRE, JEUDI SOIR A L’ÉCOLE ROYALE MILITAIRE du documentaire « La couleur du sacrifice » signé par Mourad Boucif qui retrace l’engagement des soldats des colonies françaises au cours de la Seconde Guerre et des conflits qui l’ont immédiatement suivie. Un film très engagé qui n’épargne pas la France officielle et dont une bonne partie évoque la bataille de Gembloux et le sacrifice des soldats maghrébins qui reposent aujourd’hui au cimetière français de Chastre. L’ambassadrice de France avait été invitée et tout en sachant à quoi elle devait s’attendre, Joëlle Bourgois ne s’est pas débinée, intervenant même dans le débat devant un parterre d’étudiants de l’ERM, de nombreuses écoles de tous bords et d »‘anciens » de la Seconde Guerre. •
… et la détermination de Flahaut L’occasion pour le ministre (PS) de la Défense de rappeler son engagement pour une citoyenneté plus responsable, devant un public qui se sent concerné… André Flahaut a annoncé que l’hommage annuel serait encore plus multiculturel en 2007. Avec certainement une mise en valeur des pays concernés. Il y a quelques années, un attaché militaire français avait refusé que l’on hisse les couleurs marocaines au cimetière de Chastre, mais André Flahaut a tenu bon. Et le ministre s’est réjoui, en des termes moins diplomatiques, qu’il l’avait fait muter !
|
|
1963 |
Marcel Grégoire, Un adversaire de la “belgitude”, LB 24/04/1984
M. Claude de Groulart, professionnellement, collabore avec talent au service de politique étrangère du journal Le Soir. Dans cette fonction, aucune passion excessive ne paraît l’inspirer, même pas la francolâtrie. Mais peut-être le lit-on mal ? En tout cas, le livre qu’il vient de publier sous le titre De Gaulle : “ Vous avez dit Belgique ? » révèle un Belge qui, manifestement, n’ aime ni la Belgique ni, moins encore, la « belgitude”. Ce qui étonne d’abord, dans ce livre, ce sont ses inexactitudes. D’abord dans son titre. L’auteur reproduit un entretien qu’aurait eu, après 1963 (le livre ne permet pas de le situer avec plus de précision) avec le général De Gaulle un professeur de l’Université de Louvain, M. Robert Liénard, esprit distingué et francolâtre déclaré. La phrase que lui attribue le titre n’ a pas été prononcée ni au cours de cet entretien ni, à ma connaissance, dans aucune autre occasion. (…)
Je ne me souviens pas, par ailleurs (si je me trompe, il va de soi que je rectifierai), que le F.D.F , auquel est affilié M. de Groulart, ait particulièrement soutenu le programme Sauvy. Enfin, il paraît certain que si les ministres wallons, dans leur majorité, l’avaient voulu, une politique favorisant la famille et la natalité eût éte appuyée par les ministres flamands, aussi bien en raison de leurs convictions, qu’eu égard a la dénatalité qui menaçait également leur région.
Répondant à M. Liénard qui lui (d’après le contexte – p.39 – c’était le rattachement de la Wallonie à la France) De Gaulle fit valoir que la France, pour des raisons de politique internationale, ne pouvait prendre le risque d’intervenir, sauf » si, un jour, une autorité politique représentative de la Wallonie s’adressait officiellement a (elle) ; ce jour-là, de grand coeur, nous répondrions favorablement à une demande qui aurait toutes les apparences (sic) de la légitimité. Avant, c’est impossible ». » Toutes les apparences ” : ce qui s’est passé par la suite donne toute sa valeur à la nuance.
On relèvera encore, dans les propos du Général, deux phrases dont chacun, à son gré, appréciera le degré de comparabilité. La première: “Je regrette de pouvoir dire: “Chaque peuple: » Chaque peuple ne peut se redresser que par lui-même ”. La seconde: “J’ai pourtant la conviction que seule leur prise en charge par un pays comme la France peut assurer l’ avenir à vos trois ou quatre millions de Wallons.” Laquelle des deux est vraiment prémonitoire, pour parler comme M. Outers? (…) Le premier préfacier, un gaulliste de gauche, étonna lui aussi. Il attribue aux hommes politiques flamands la création du Benelux qui, affirme-t-il, fut le glas (sic) de la Wallonië; or, essentiellement, elle est due à P.-H. Spaak. De même, c’est celui-ci qui, de tous ses prédecesseurs et de tous ses successeurs, y compris les Flamands, dégagea le plus la politique étrangère belge de l’influence française; (…)
|
|
843-1973 |
Maurits Jossen, De eeuwenoude vijand van Vlaanderen en Wallonië (843-1973) (Breda – na WOI)
|
|
979-1979 |
Alain Germoz, M. Persoons /secrétaire d’Etat à la Communauté française/ n’est pas content /concernant la réaction négative de PP? à ‘son’ exposition baptisée Bruxelles … 1000 de rayonnement de la culture française./, PP? 13/12/1979, p.185-186
(p.186) N’en déplaise a M. Persoons, (…) il me semble que le rayonnement de la culture française va de guingois lorsqu’on présente le portrait, par Henry De Groux, d’un Charles Baudelaire qui prend les traits d’André Gide (p. 129). Sans compter que ledit Baudelaire apparaît plus loin (p. 148) comme dessin de Gide par Theo Van Rysselberghe.
Simple inversion de clichés, dira-t-on. Et ce “ Fernand de Portugal ” ? Faute d’attention ? Bien sûr. Mais comme l’exposition et le catalogue s’adressent principalement a des Bruxellois ignares… (selon les termes mêmes de M. Persoons, “ la plupart des Bruxellois ignorent ”, “ peu de Bruxellois savent ”, » ils ne savaient pas ”…) on voit d’ici le désordre qui peut s’installer dans les esprits non prévenus.
M Persoons reclame le droit de limiter le sujet d’une exposition. Certes Mais comment ? En cherchant son sujet en dehors de Bruxelles ? Que vient donc faire la la Cantilène de sainte Eulalie, originaire de la région de Valenciennes ? Orientée sur le thème » Comment tirer les draps de son côté ”, l’ exposition est exemplaire, mais sous ce seul aspect.
Et bizarrement, c’est ce qui gêne à présent M. Persoons alors qu’il est le promoteur de l’entreprise. On ne peut pourtant pas dire que Bruocsella manque de sources d’interêt, mais le veritable interêt eût consisté à susciter une exposition traitant de l’ensemble du problème et révélant au citoyen ignare (bruxellois, belge ou étranger) que la ville, au seul point de vue linguistique, a pu s’enorgueillir de voir fleurir côte a côte le français, le flamand et le latin. Cela aurait permis, par exemple, de donner enfin a Siger de Brabant l’importance qu’il mérite – reconnue par Dante, comme le précise justement le catalogue.
(…) M. Persoons a la franchise de le reconnaître: il y a intention politique. (…) Faut-il sacrifier à l’obscurantisme au nom d’une politique, F.D.F. ou autre? (…)
Nul ne songe a contester l’authenticité des documents recueillis pour l’exposition. C’est leur extirpation d’un contexte général et leur orientation particulière qui sont contestables et expliquent la réaction de M. Boel, président du Conseil culturel néerlandais, qui croit devoir mettre les étrangers en garde.
En attendant, pour clore cette polémique sans puiser dans l’arsenal (mais oui, M. Persoons) que l’Histoire tient a notre disposition, je me bornerai à citer le professeur Hasquin, de l’U.L.B., qui écrit : “ Il serait absurde de nier le caractère profondément flamand de Bruxelles au Moyen Age et pendant une bonne partie de l’epoque moderne ”. Horresco referens ! Le professeur Hasquin ose ajouter . » L’usage du français fut a peu près inexistant à Bruxelles jusqu’au XVe siècle ”. Pourquoi le nier ? Pourquoi s’en alarmer si tels sont les faits ?
|
|
979-1979 |
G. Pepers, Les mille ans de Bruxelles, LB 14/12/1979
J’aime la lettre de M. G.G., de Koekelberg, qui replace dans une perspective exacte les mille ans de Bruxelles. Il a d’ autant plus raison que tout le verbiage relatif à la francité et/ou la francophonie est strictement et exclusivement de notre temps, sans intéresser le moins du monde l’Europe contemporaine des débuts de Bruxelles.
D’abord, la montée du français comme langue universelle n’ est évidemment pas antérieure aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ensuite, le fanatisme ou chauvinisme linguistique français – ou disons francophone – est né de la Révolution, n’ existait pas avant elle. Car l’essai de Rivarol ne respire aucun fanatisme, Pour finir, on parle de la » francité » des gens, presque comme d’un caractère anthropologique, quelque chose d’ analogue à la couleur de la peau ou la forme du crâne, à ne pas confondre avec le » vulgum pecus » des variétés inférieures.
Il est, dès lors, fermement établi que le bavardage francolâtre de certains de nos contemporains belges, appliqué à nos origines, n’est pas autre chose que la projection dans un lointain passé d’un ordre de préoccupations rigoureusement hypermoderne.
|
|
979-1979 |
G.G. /Koekelberg/ Mille ans de Bruxelles?, LB 06/12/1979
Ancien du Séminaire d’Histoire de l’U.C.L., j’ai été voir avec un oeil critique l’exposition « … 1.000 ans de rayonnement de la culture française à Bruxelles (qui vient de fermer ses portes). Disons-le tout net, elle m’a déçu non à cause de sa présentation, qui est remarquable ni de ses pièces, toutes authentiques, mais à cause de leur interprétation et du rôle qu’on veut leur faire jouer. On a tendance à hypertrophier la destinée d’une ville, “liée à l’histoire de France plus particulièrement », alors qu’elle fit partie durant des siècles, comme toute la Wallonië, du Saint Empire romain germanique.
L’exposition se caractérise par ses accaparements et ses omissions. Que viennent faire dans cette affaire « les Serments de Strasbourg » et « la Cantilène de Ste-Eulalie » ? Est-ce parce que les sièges des diocèses sont situés en partie romane que la population de Bruxelles a des attaches francophones ? En quoi l’Evangile de Lothaire concerne-t-il la francité ? Et la Carte de Maastricht » ? Et celle se rapportant aux Templiers ? Et le , »Roman de la Rose » ? Les quelques fiefs et rentes inféodés par le roi de France à Wenceslas peuvent-ils faire oublier que les trois grands duchés, dont il est détenteur, relèvent de la mouvance germanique qui n’est pas citée. Si Charles-Quint constate le progrès du français, c’est bien la preuve que la ville etait auparavant entièrement flamande.
Significatif est l’absence de tout document se rapportant à l’architecture romane, originaire de la région rhénane, alors que le gothique français est amplement représenté. Est-ce qu’on peut conclure de la visite d’un souverain, d’un chroniqueur, d’un Voltaire, d’un Rameau à Bruxelles, que la ville est francophone ? Significatif aussi est l’escamotage du bombardement de la ville par les troupes de Louis XIV et l’incendie de la Grand’Place. Pas la moindre pièce, pas la moindre estampe sur la période révolutionnaire, la tyrannie sanglante des Français, la ruine de nos abbayes, les exactions iniques, le projet de vente, de démolition de Ste-Gudule et sa transformation en stade. Et j’en passe. Tout est à l’avenant.
Il s’agit d’une exposition qui tait sciemment certaines parties de la réalité historique d’une ville, dont la population à l’ évidence est fondalement flamande jusqu’au XIXe siècle, et qui, à partir d’alors fut progressivement francisée par des classes économiquement, socialement et politiquement dominantes. Elle n’aura convaincu que les sympathisants du F.D.F., les naïfs et les ignorants.
|
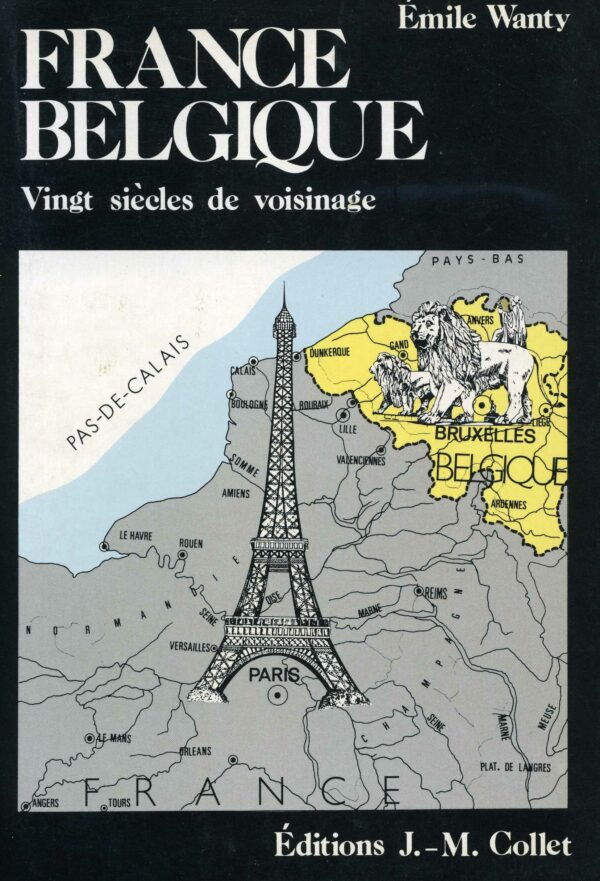
France-Belgique, 20 siècles de voisinage (Emile Wanty)
(à acheter aux éditions Collet)
Extraits:
Extraits du livre d’E. Wanty, France-Belgique, 20 siècles de voisinage, éd. Collet, 1989
(p.9) Le général de Gaulle était, de longue date, passé maître dans l’exercice de haute virtuosité qui consiste à ne réunir de l’histoire que quelques grands faits saillants, les plus favorables à une thèse donnée, la thèse nationaliste, en négligeant le contexte.
L’histoire est faussée dès lors que l’on ne tient pas compte de toutes les incidences qui, constituant la petite histoire, contribuent à établir la grande sur des bases plus solides, avec une approximation plus serrée de la vérité.
Le survol de l’histoire peut servir à la justification d’une politique « d’indépendance » nationaliste ou d’une attitude hostile à tel ou tel pays.
(p.46) Les historiens français sont habituellement discrets au sujet de (p.47) cette série d’événements et de la bataille qui connut pourtant un immense écho en Europe, celle de Courtrai (11 juillet 1302), dite aussi Guldensporenslag ou Bataille des Eperons d’or. L’armée flamande, rangée sur une surface de cinq cent mètres sur trois cent, ne comptait guère plus de sept à huit mille hommes, immense majorité de fantassins armés de la pique ; l’armée française, guère plus nombreuse, groupait mille cinq cents chevaliers de Normandie, Picardie, Artois et Flandre, de l’infanterie communale requise par le service féodal, et des mercenaires génois.
Cette bataille a laissé une trace ineffaçable dans l’histoire de la Flandre, qui la célèbre chaque année avec ferveur ; elle passe inaperçue dans l’histoire de la France. Pourtant, par ses résultats mêmes, elle fut la confirmation éclatante (cinquante barons et neuf cents chevaliers tués) de l’impuissance de la chevalerie, quelle que fût sa vaillance, devant une infanterie résolue luttant pour sa survie. Les précédents s’appelaient : Steppes (1213), Falkirk (1298). Elle signifiait aussi l’arrêt brutal de la politique d’expansion dynastique de la maison de France, et la naissance d’une conscience de classe dans le peuple. Après cette victoire, les grandes communes se soulevèrent et se libérèrent, y compris Lille et Douai. La Flandre retrouvait ses princes, seuls légitimes à ses yeux par leur résistance à la France, les Dampierre.
Bien entendu, comme il arrive toujours en pareil cas, le roi ou ses conseillers firent répandre le bruit selon lequel cette défaite écrasante était due à la trahison et au stratagème, pour sensibiliser et mobiliser son opinion publique.
Un fait important qui va peser sur les relations ultérieures de la France avec les Pays-Bas est l’influence prise par les légistes issus de ses écoles de droit, pénétrés de droit romain, désormais hostiles à la notion féodale de la royauté, y substituant la légitimité, le droit divin, la raison d’État. Le réalisme politique se conjugue maintenant avec la nouvelle notion juridique de la monarchie.
Tandis que l’armée flamande, en 1303, envahit le comté du Hainaut, s’empare de la ville épiscopale française de Thérouanne, et qu’une flotte commandée par Guy de Namur menace la Zélande, Philippe le Bel ne renonce pas à une revanche. Certes, par une trêve conclue en septembre 1303, libère-t-il Guy de Dampierre et ses fils, mais il prépare en même temps une nouvelle intervention armée. Elle réussit : la flotte de Guy de Namur fut défaite devant l’île de Zierikzee (p.48) par les lourdes galères de l’amiral génois Grimaldi (11 août 1304), tandis qu’une armée royale se heurtait aux troupes flamandes de Guillaume de Juliers et de Jean de Namur, à Mons-en-Pévèle (18 août 1304).
Cette bataille resta indécise, et de longues négociations aboutirent au traité d’Athis-sur-Orge (juin 1305). Très onéreux pour le comté de Flandre, celui-ci lui imposait de lourdes « amendes» , la fourniture d’un contingent annuel de six cents hommes d’armes, la destruction des murailles des villes. Trois mille bourgeois de Bruges furent condamnés à effectuer un pèlerinage. Le comte, la noblesse, les villes devaient jurer fidélité au roi, sous peine de confiscation du comté. Le même serment devait être prêté par les Flamands âgés de plus de quatorze ans, et renouvelé tous les cinq ans. Le roi prenait en gage les châtellenies de Douai, Lille, Béthune, les châteaux de Courtrai et de Cassel.
Ces clauses humiliantes sont un sujet d’étonnement si l’ on perd de vue que tous les négociateurs représentant la Flandre appartenaient à la noblesse que Guy de Dampierre, puis son fils Robert de Béthune, étaient las d’une lutte qui menaçait de confirmer un jour une mainmise totale sur le comté, qu’au surplus le patriciat prenait peur de l’ampleur de la révolte sociale. Le traité fut une convention passée entre le roi et un grand vassal, qui recevait la garantie de ne plus être justiciable que de ses pairs en France. Les villes ne prêtèrent qu’en 1309 le serment requis, et le peuple ne l’accepta pas dans le fond de son coeur. Cette dureté devait nourrir une haine qui ne s’éteindrait pas de sitôt.
Le divorce entre le peuple et les classes dirigeantes s’accentua par l’influence de la langue française à la cour du comte, dans l’administration centrale, dans la noblesse, et même dans le patriciat urbain, dans la société fermée des banquiers lombards et florentins, alors que le peuple restait foncièrement thiois. La courte période de domination française avait envenimé la situation linguistique. Philippe IV, alors qu’il semblait accaparé par sa querelle avec le pape Boniface VIII, par les problèmes fiscaux, par sa lutte contre l’ordre des Templiers, ne renonçait pas à son rêve d’annexion de la Flandre. Le comte Robert de Béthune, sans appui, dut consentir le 11 juillet 1312 (dix années exactement après Courtrai) à céder définitivement Lille, Douai et Béthune, c’est-à-dire en gros la Flandre d’expression romane.
(p.49) Troubles sociaux en Flandre et en France
La guerre reprit en 1314, après la mort de Philippe le Bel, mais l’armée du roi Louis X dut s’arrêter, immobilisée par la boue, en septembre 1315.
Louis X le Hutin (1289-1316) eut pour successeur Philippe V le Long, son frère (1293-1322). Le début de son court règne fut assombri par des troubles sérieux dans diverses provinces françaises, et aussi en Flandre, dont le comte suspendit les clauses du traité d’Athis, malgré la foi jurée.
Le conflit entre les deux camps prit un caractère aigu, caractérisé par des heurts armés tout le long de la frontière commune. Par ailleurs, le pouvoir du comte était affaibli par l’hostilité à sa politique de la puissante commune de Gand, de nouveau dominée par les Liliaerts (1319), et de ses fils Louis de Nevers et Robert de Cassel. En mai 1320, un nouveau traité de paix confirma l’abandon à la France de la partie romane de la Flandre.
Quatre années plus tard, une terrible révolte souleva la population, exclusivement rurale, de la Flandre maritime, pour des raisons sociales : surpopulation, sous-développement, famine, incompréhension de la part du patriciat, contributions fort lourdes pour payer les « amendes » imposées par la « paix » de 1320. Le chef en fut un bourgeois forain, Nicolas Zannekin, propriétaire de terres dans le Westhoek, secondé par d’autres petits propriétaires, qui organisèrent et coordonnèrent le soulèvement visant à renverser l’ ordre établi. Il diffère notablement, en ce sens, des révoltes rurales qui éclatèrent plus tard en France et en Angleterre, et témoigne d’une « prise de conscience » sociale, d’une opposition délibérée à tous les grands possesseurs du sol. Ce fut une véritable guerre civile, marquée du côté des insurgés (les Kerels de Flandre) par des atrocités. Elle ravagea surtout les régions de Furnes et de Bergues, avec la complicité de la démocratie urbaine de Bruges, celle des métiers d’Ypres, mais la farouche opposition de Gand. Cette révolte ne serait qu’un épisode, long et sanglant, de l’histoire interne de la Flandre, si les insurgés n’ avaient manifesté, une nette hostilité envers le roi de France, si les amendes qui lui étaient promises avaient été payées, si ses dirigeants n’avaient négocié avec l’ Angleterre. Philippe V jeta l’interdit sur les insurgés (novembre 1325), rompit les relations commerciales avec le comté, et rassembla ses troupes. Le 19 avril 1326, un traité fut signé à Arques, et les éléments modérés (p.50) acceptèrent des conditions assez dures. Seuls les chefs démagogues décidèrent de reprendre le combat, plus cruel encore, en lui conférant un caractère à la fois révolutionnaire par ses tendances radicales, et même anti-clérical. Le comte s’était réfugié à Paris, et Gand restait seule à soutenir la lutte contre l’insurrection.
Philippe V, sans héritier mâle, laissa la couronne à son frère Charles IV le Bel (1294- 1328), après avoir fait confirmer en 1316 et en 1322 l’ancienne « loi salique » excluant les femmes du trône. Charles IV, pendant son règne de courte durée, afficha des prétentions sur la couronne impériale et prétendit étendre l’influence française au-delà du Rhin. Politique assez nouvelle, qui prit appui sur la principauté de Liège, dont Adolphe de la Marck était devenu prince-évêque en 1312, grâce à l’intervention de Philippe IV auprès du pape d’Avignon, Clément V. Elle l’amena aussi à accorder son appui moral à l’adversaire du duc du Brabant.
Celui-ci s’était bien gardé d’intervenir dans les démêlés de la Flandre avec les derniers rois capétiens. Jean Ier et Jean II avaient poursuivi leur politique d’ouverture sur la Basse-Meuse et le Rhin. Jean III (1312-1355) la continua, mais en y apportant la fougue, la violence, la duplicité, au besoin qui caractérisaient la forte personnalité de ce prince haut en couleur. Il acquit plusieurs points d’appui Sur la Meuse, mais, à partir de 1324, dut faire face aux visées sur le Brabant de Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême. Trop faible pour affronter seul le puissant duc de Brabant il réunit contre lui une coalition disparate.
Philippe VI de Valois.
C’ est cette situation sociale et politique que trouva le nouveau roi de France. Les trois fils de Philippe le Bel étant morts sans descendance mâle, les barons réunis choisirent pour souverain un petit-fils de Philippe III, de la branche des Valois. Philippe VI (1293-1350) représentait un type de roi que l’on eût pu croire périmé, tranchant aussi nettement que possible sur le réalisme, le sens de l’opportunité, l’astuce de son oncle Philippe IV. Imbu de chevalerie, il allait se révéler inférieur à sa tâche, dépourvu de souplesse, féru de projets utopiques.
Mais tout d’abord, dès sa régence (1er février 1328), il voulut apporter une solution au problème angoissant qui suscitait les craintes du comte de Flandre, du prince-évêque de Liège et même du pape: (p51) la révolte de la West-Flandre. Il y fut d’autant facilement amené que Bruges proposait au roi d’ Angleterre Edouard III de le reconnaître comme roi de France.
Les insurgés furent menacés à la fois par les Français au sud et les Gantois à l’est. Les contingents des régions de Furnes, Bergues, Cassel, Bailleul et Bourbourg, massés sous les ordres de Zannekin, occupaient le mont Cassel, observant l’armée royale qui, habilement, ne manifestait aucune intention d’attaque. Ces milices, mal organisées, commirent alors l’immense faute de sortir de leur forte position pour assaillir le camp français. Bien vite leurs trois colonnes furent divisées, cernées, massacrées en détail, laissant sur le terrain plusieurs milliers de morts.
La répression par le comte et le patriciat fut impitoyable ; celle de la couronne, rigoureuse : abolition des chartes et privilèges des communes rebelles, démolition des murailles de Bruges et d’Ypres, condamnations à l’exil Ou à des rentes perpétuelles, confiscations.
Le souvenir, tout récent encore, de l’intervention française en 1302, celui, plus cuisant, de la journée de Cassel, allaient entretenir dans le plat pays flamand, dans le parti populaire, la haine de la France.
À cette époque le comté était gouverné, depuis la mort de Robert de Béthune, en 1320, par son petit-fils Louis de Nevers, d’éducation française, totalement étranger à ses sujets, et bien décidé à rester un vassal féal, alors qu’allait s’ouvrir le grand conflit monarchique entre la France et l’Angleterre.
Mais quittons provisoirement la Flandre pour le Brabant. En 1329, à l’occasion d’une violente querelle féodale entre le duc Jean III et le sire de Fauquemont (Valkenburg), membre de la coalition suscitée par Jean l’Aveugle, Philippe VI, sollicité par Fauquemont d’arbitrer le conflit, intervint, sans que la couronne de France eût le moindre titre à le faire. Jean III ne se fit du reste pas faute de le récuser, déclarant n’être en aucune façon son vassal. La guerre éclata entre le Brabant d’une part, le comte de Luxembourg, les comtes de Gueldre, de Juliers, de Looz, de Namur, les seigneurs de Fauquemont et de Beaumont, et même le comte d’Eu. Fort habilement Jean III fiança son fils à Marie, fille de Philippe VI, qui abandonna immédiatement les coalisés. Il s’agissait là d’une alliance du type féodal avec toutes ses faiblesses, et elle ne put rien contre la solide réalité politique et sociale que constituait le duché de Brabant.
(p.52) La lutte cessa en 1334. Un résultat assez inattendu en fut le sort de la seigneurie de Malines. Depuis 980, elle appartenait au prince-évêque de Liège; en 1333, elle fut cédée à Louis de Nevers, comte de Flandre, mais sans y consentir. Le roi de France en reçut la garde en 1334.
La guerre de Cent Ans: première phase.
La loi salique, première version rédigée à la fin du Ve siècle, avait dans l’un de ses articles exclu les Filles du partage du domaine royal. Le principe en était discutable, mais pendant des siècles on n’eut plus à l’appliquer. A la mort de Charles IV, le problème surgit: si une fille avait un droit successoral à la couronne de France, Isabelle, fille de Philippe IV, épouse d’Édouard II, roi d’Angleterre, le céderait légitimement à son fils Édouard III, qui réunirait aIors les deux couronnes. Édouard III se sentit renforcé dans ses prétentions par le fait qu’il était arrière-petit-fils, par les femmes encore, de Philippe III le Hardi. Cette éventualité redoutable ayant été prévue, la loi salique exhumée avait été rendue à la vie. Elle fut, on s’en doute, âprement discutée sur le plan juridique, et ce conflit sans issue ne pouvait déboucher que sur la guerre. Edouard III la prépara suivant la déjà ancienne méthode anglaise : se chercher et se trouver des alliés : le comte de Hainaut et de Zélande, le duc de Brabant, le comte de Gueldre, d’autres encore ainsi que l’empereur Louis de Bavière. Le concours de la Flandre était tentant, mais Louis de Nevers, s’appuyant sur le patriciat, restait fidèle à l’hommage féodal. En 1336, au milieu de la querelle juridique, il fit suspendre tout trafic commercial avec l’Angleterre. Edouard III y répliqua par la prohibition d’exporter la laine anglaise et l’arrestation des marchands flamands résidant dans l’île.
A ce jeu, la Flandre était perdante et le coup était terrible. C’est ce que comprit sur-le-champ un riche bourgeois de Gand, Jacques van Artevelde. Les métiers gantois se soulevèrent contre l’administration comtale, et Artevelde eut dès lors les coudées assez libres pour conclure en 1339 un important accord liant Angleterre, Flandre et Brabant sur la base de la liberté de commerce et de la franchise douanière pour les draperies vendues en Angleterre. En contrepartie politique, Edouard III fit reconnaître ses droits, aussi légitimes du reste que ceux de Philippe VI, au trône de France. Les obligations féodales et les nouvelles nécessités économiques (p53) se voyaient ainsi harmonisées. La Flandre allait rester théoriquement neutre dans le conflit.
Là ne s’arrêta pas le rôle du grand tribun gantois. Ses vues, singulièrement larges pour l’époque, dépassaient de loin les murs de sa cité et même les frontières du comté. Il réussit tout d’abord à réaliser l’union des trois « Membres » de Flandre : Gand, Bruges et Ypres, et à assurer leur autorité sur le plat pays. La paix était constamment troublée par un conflit endémique entre Flandre et Brabant. Le pacte de 1339, étendu au Hainaut, à la Hollande et à la Zélande, traduisit une conceprion neuve en reconnaissant la solidarité économique des divers Etats des Pays-Bas et esquissa un réel rapprochement entre eux. Mais l’existence en fut fugitive.
En effet, la Flandre était, soit inconsciente du péril extérieur, soit trop confiante dans ses possibilités, minée par l’individualisme agressif de ses orgueilleuses cités, imperméable à route notion de solidarité. Elle en revint bien vite à ses passions politiciennes et connut de nouveau de dangereuses convulsions sociales. La journée du Quade Maendagh (le mauvais Lundi) de mai 1345 vit le massacre des tisserands et des foulons gantois, et Jacques van Attevelde périt un mois plus tard, assassiné par son propre peuple. Ainsi, tout compte fait, la « paix » assurée par lui à la Flandre ne servit qu’à permettre les guerres civiles urbaines. Aux portes mêmes de la Flandre s’était livrée le 24 juin 1340 la première bataille navale de la guerre franco-anglaise, celle de l’Écluse qui se termina en désastre pour la florre française. Cette victoire anglaise n’eut pas de lendemain et il faudra attendre six années encore avant de pouvoir débarquer une petite armée en Normandie. On comprend mal l’allure hésitante et spasmodique de cette guerre larvée si l’on ne sait que le parlement anglais, conscient de son pouvoir, témoignait fort peu d’enthousiasme pour les prétentions dynastiques de son roi et se montrait très ménager de son appui financier.
En 1346, la fougue irraisonnée de la chevalerie française fut à l’origine du nouveau désastre de Crécy, suivi de la capitulation de Calais. Les Anglais devinrent alors partisans convaincus de cette guerre si bien entamée, et des “bandes franches » passèrent le Channel pour aller exploiter les campagnes françaises. Le comte de Flandre, Louis de Nevers, avait été tué à Crécy. Son fils, Louis de Maele, lui succéda.
(p.70) Jean sans Peur
Jean de Nevers était un authentique prince français. Une de ses premières manifestations fut pourtant une réaction contre la francisation systématique inaugurée par son père. Il rencontra à Menin, dernière ville de langue thioise, les députés flamands, exécuta leurs doléances relatives à l’emploi du flamand devant les tribunaux et au conseil de Flandre. Il accorda aussi le rétablissement des relations commerciales avec l’Angleterre et admit le principe d’une résidence fréquente du duc ou de sa femme en Flandre.
Tout ceci ne visait qu’à s’assurer dans le comté une base solide de sa politique française. Lorsqu’en fonction de cette dernière, il leva un impôt exceptionnel pour financer sa nouvelle menace contre l’Angleterre, Bruges s’y opposa (décembre 1406), mais le comte fut prompt à lui imposer une charte restrictive, le Calfvel, qui privait la ville de la plupart des droits des métiers. Par contre il eut l’habileté de transférer d’Audenarde à Gand la cour de justice.
(p.71) Nous retrouvons les impératifs d’une politique sociale française dans l’intervention de Jean sans Peur contre Liège, comme l’avait déjà fait son père.
La principauté de Liège était depuis longtemps, tout comme Gand, un des lieux élus de la fermentation populaire. Alors que les autres États avaient tout au moins l’avantage de posséder une dynastie dont les intérêts étaient généralement solidaires des leurs, la principauté ecclésiastique de Liège se voyait parfois imposer des princes-évêques qui n’avaient rien de commun, ni avec l’âme ardente de la cité, ni avec ses intérêts, ni même avec la religion. Il en fut encore ainsi lorsque Jean de Bavière, fils du comte de Hainaut, beau-frère du duc de Bourgogne, fut investi en 1389 à l’âge de dix-sept ans, sans même avoir reçu le diaconat. Les réactions violentes ne se produisirent pourtant qu’à la longue, en 1406. Jean de Bavière fut chassé par l’émeute, un autre évêque ayant été élu, reconnu et investi par l’empereur. Une terreur s’instaura et la principauté porta la guerre au-dehors. Or ces événements pouvaient réveiller les ardeurs assoupies des communes flamandes et, par là, avoir des répercussions sociales jusqu’en France.
Jean sans Peur entama en septembre 1408 une campagne de répression avec des contingents flamands, hennuyers et namurois. Les Liégeois et les Hutois furent battus et massacrés sans quartier (huit mille morts), à Othée. Les représailles furent sauvages, tout comme les sentences ultérieures qui privèrent Liège de toutes ses libertés.
L’empereur resta impuissant et passif devant cette agression, totalement illicite, puisque la principauté ne relevait à aucun titre du duc de Bourgogne ou de la France, mais uniquement de l’empire.
En France, Charles d’Orléans, fils de Louis, avait constitué avec son beau-père le comte d’Armagnac une puissante coalition anti-bourguignonne. En 1411, Jean sans Peur rassembla une armée brabançonne et flamande, ceci à l’encontre des règles féodales, qui réservaient (p.72) l’utilisation des milices urbaines à la défense intérieure.
Comme le service de l’« ost » n’était dû que pendant quarante jours, les communiers rejoignirent leurs foyers après une campagne languissante. Jean sans Peur négocia une alliance anglaise et entra dans Paris le 23 octobre, à la tête de mille deux cents archers anglais. La guerre civile fut implacable et atroce. Jean, maître de Paris, apaisa l’opinion par la convocation des état généraux ; les Armagnacs furent refoulés au sud de la Loire. Paris vit alors le déchaînement de la révolte du tripier Caboche, dont les partisans portèrent comme symbole le chaperon blanc des députés flamands. Jean sans Peur, débordé, se réfugia dans la région de Lille, tandis que les communes lui refusaient troupes et subsides, et que les bourgeois de Gand négociaient directement avec Charles VI.
À ce moment débute la deuxième phase de la guerre de Cent Ans, avec le débarquement des troupes de Henri V d’Angleterre (1415). En dépit de la neutralité affichée du duc de Bourgogne, son frère, le comte de Nevers, et le duc Antoine de Brabant furent tués dans les rangs français à Azincourt.
Volant au secours de la victoire, Jean sans Peur se rapprocha de l’ Angleterre (automne 14 16), rentra à Paris, en chassa les Armagnacs et y régna avec la complicité de la reine Isabeau de Bavière, tandis que le dauphin se réfugiait à Poitiers puis à Bourges, et que la faction d’Orléans et les Anglais dominaient les autres fractions du territoire.
Malgré toutes ces difficultés, le duc intervint encore pour assurer la succession du duché de Brabant après la mort d’Antoine. La destinée heurtée de ce prince, réaliste mais inquiétant, prit fin tragiquement, le 10 septembre 1419, sur le pont de Montereau, sous les coups de Tanneguy du Châtel, vengeur de Louis d’Orléans.
Avec le représentant de la troisième génération, Philippe, l’évolution s’achève. La dynastie de Bourgogne s’identifie à ce point aux intérêts de ses États qu’elle va se dresser en adversaire redoutable de la France, berceau de ses princes.
(p.73) CH VII Philippe le Bon, grand-duc d’Occident
La personnalité du duc
Le portrait de Philippe le Bon par Roger van der Weyden nous le montre en son âge mûr. Le regard est perçant sous des paupières lourdes ; le nez long, la bouche large et sensuelle, le menton quelque peu ravagé : une curieuse coupe de cheveux, en forme de calotte de capucin, dégage un front lisse et de grandes oreilles peu élégantes. Ce portrait ne rend pas pleinement l’impression de vivacité et d’amour de la vie qu’irradiait cette puissante personnalité.
Né à Dijon, le 30 janvier 1396, Fils unique de Jean sans Peur, Philippe ressemblait fort peu a son père. Optimiste et passionné, curieux de tout, amateur de ce qui est beau et bon, il ne craint pas l’aventure et le risque, est entiché de fêtes, se complaît aux déploiements fastueux. Son père a surveillé attentivement son éducation ; il connaît le français, le flamand, l’allemand (par sa mère), mais ignore le latin.
(p.80) Ces deux hommes ont pourtant un point commun ; la rupture avec leur père. Le futur Louis XI n’était plus d’accord avec Charles VII depuis qu’il s’était imprudemment associé, à l’âge de dix-sept ans, à une sorte de fronde féodale, la Praguerie. Après réconciliation, il avait reçu le gouvernement du Dauphiné. En 1456, se croyant menacé par son père, il avait demandé asile et protection au duc de Bourgogne et résidé pendant cinq années au château de Genappe et à l’université de Louvain. Il devint même parrain de Marie de Bourgogne, fille du comte de Charolais. Il eut donc tout loisir d’étudier la croissance et la puissance de l’État bourguignon et de percer à jour l’ambition du duc de reconstituer l’ancienne Lotharingie. Il entretint habilement les froissements de caractère entre Philippe et son fils et se chercha des appuis dans l’entourage princier, la famille de Croÿ, et dans la principauté de Liège.
À la mort de Charles VII, Philippe le Bon accompagna le nouveau roi à Paris, et commit l’erreur de déployer un grand faste. Louis XI n’avait aucune gratitude. Il profita sans vergogne de l’affaiblissement intellectuel du duc pour obtenir de lui la cession, contre quatre cent mille écus d’or, d’Amiens, Saint-Quentin, Doullens et Montreuil, à la grande indignation du comte de Charolais, qui convoqua à Anvers les délégués des communes, de la noblesse et du clergé. On y entendit de violents réquisitoires contre les Croÿ et la France. Charolais, opposé à son père, ne se réconcilia avec lui, non sans peine, que le 25 avril 1465. Il fut alors nommé lieutenant général de tous les États, et pratiquement régent jusqu’à la mort de Philippe le Bon, le 15 juin 1467.
En toute impartialité, il faut reconnaître que les politiques de ces deux souverains si différents sont justifiables au même titre. Charles est le successeur de trois ducs ayant créé un puissant État qui, par la force des ambitions et des circonstances, s’est opposé à la France. Et voici que cet ensemble cohérent vient d’être ébréché par la cession de villes de la Somme, frontière sud de cet État. Louis XI, de son côté, a la volonté bien affirmée, non seulement de relever la monarchie, mais d’en élargir le domaine.
Les moyens de ces politiques consisteront à susciter à l’adversaire toutes les oppositions possibles, internes ou externes.
Charles n’y manqua pas. Louis XI vit se dresser contre lui (p.81) les grands féodaux, inquiets à juste titre pour leurs privilèges, et se couvrant hypocritement du nom de « Ligue du Bien public.
Charles conclut alliance avec le duc de Berry, frère du roi, avec les ducs de Bretagne, de Lorraine, de Bourbon, les comtes d’Armagnac et de Saint-Pol. La bataille indécise de Montlhéry ( 1er juillet 1465) fut suivie de combats sous les murs de Paris, de la conférence de Vincennes et de la paix de Conflans, qui restitua au comte de Flandre les villes de la Somme. Louis XI renonçait à leur rachat du vivant de Charles le Téméraire.
Mouvements sociaux dans les pays d’En-Bas
La principauté de Liége revint au premier plan par une nouvelle révolte en 1465. Les Liégeois ravagèrent le Limbourg, et les Dinantais le Namurois, avec le discret encouragement de Louis XI. Les intérêts du comte de Charolais étant en jeu, il autorisa de sinistres représailles à Dinant (août 1466), tandis que la paix d’Oleye imposait à Liège une énorme contribution. Puis ce fut le tour de mouvements sociaux a Gand, Malines, Anvers, Lierre. Chaque fois, le duc intervint avec une énergie farouche. Mais Liège restait irréductible, et Louis XI se laissa proclamer « protecteur » de la cité. Protecteur bien pâle, car il n’intervint pas lorsque Charles marcha contre les forces liégeoises et les battit à Brusthem (2 octobre 1467). Il se fit confirmer « souverain avoué et gardien de Liège »; la principauté fut divisée en trois districts administrés respectivement par Maestricht, Louvain et Namur ; la charte fut abolie, les corporations et métiers supprimés, le Perron, symbole de la liberté liégeoise, transféré à Bruges.
Nouveaux échecs de Louis XI
Louis XI subit un nouvel échec, cette fois sur le plan de la stratégie matrimoniale. Il eût voulu marier son frère à la soeur du roi Édouard IV, Marguerite d’York. Mais ce fut Charles qui obtint sa main, effectuant ainsi un nouveau rapprochement avec l’Angleterre (juillet 1468).
Tout ceci devait inciter le roi de France à réagir. Il réunit cette même année les états généraux, se fit libérer par eux des engagements contractés envers ses adversaires par une paix, toute récente encore, et attaqua la Bretagne. Charles entra immédiatement en campagne et, une fois de plus, Louis XI dut temporiser.
(p.86) CHAPITRE IX Le retour en force du roi de France
Marie de Bourgogne.
La nouvelle duchesse, filleule de Louis XI, âgée de vingt ans, inexpérimentée, ne pouvait trouver un appui bien sérieux dans son entourage de « seigneurs du sang » et de hauts fonctionnaires, que les populations avaient appris à détester pour leur dédain, les impôtS de plus en plus lourds, les répressions et la francisation systématique. Le moment était venu, semble-t-il, pour Louis XI d’annexer la Flandre et de dissocier les autres États en soutenant les prétentions d’héritiers jadis frustrés, et en exploitant les différends linguistiques. Il adressa dans ce sens un appel aux populations d’idiome roman, et envoya un de ses conseillers, Oliver le Daim, en mission secrète à Gand.
Gand, depuis longtemps point névralgique des États bourguignons, ne tarda pas à se soulever une fois de plus, et Marie dut rétablir les privilèges, abolis depuis la défaite de Gavere. Les états généraux réunis reconnurent Marie de Bourgogne pour leur « héritière naturelle » se déclarèrent « bourguignons » et allèrent jusqu’à décider une levée de cent mille hommes (qui ne fut jamais effective). Par contre, faisant acte de souverain, ces mêmes états généraux dépêchèrent une ambassade auprès de Louis XI, s’érigèrent en Constituante et rédigèrent en une dizaine de jours un « Grand privilège » (11 février 1477). Il abolissait les institutions centrales, notamment, le parlement de Malines ; rétablissait dans leur intégralité les souverainetés particulières des États ; posait le principe de la réunion de plein droit des états généraux, sans convocation des princes ; interdisait toute guerre sans l’assentiment des sujets. Cette réforme, véritablement révolutionnaire en même temps que réactiOnnaire, représentait la victoire des anciens privilèges sur l’égalité, (p.87) du bien particulier sur l’intérêt général, de la politique médiévale urbaine dans son sens étriqué.
Elle rétablissait le particularisme provincial, avec l’exclusivisme urbain, qui restera une psychose des Belges jusqu’à la Révolution française.
La Flandre redevenait en fait une principauté indépendante. Bruges supprima le « Franc de Bruges » comme quatrième membre de la Flandre, interdit l’industrie drapière dans les villages, limita les droits des marchands étrangers. Un peu partout les métiers revendiquèrent leurs monopoles.
Tout ceci sous les yeux de Louis XI. Il excita les délégués gantois contre les conseillers bourguignons de la duchesse. Hugonet et d’Humbercourt, qui représentaient la politique, désormais condamnée du duc Charles, furent exécutés à Gand.
Malgré ses manifestations d’intentions pacifiques, le roi de France poursuivait ses succès militaires au nord de la Somme. La menace devint telle qu’elle provoqua un sursaut de défense. Arras se souleva ; Saint-Omer résista tenacement, tout comme Condé et Valenciennes, dont les bourgeois allèrent jusqu’à incendier les faubourgs. Les troupes françaises instaurèrent un régime de terreur et affamèrent les populations. Autour de Valenciennes, quatre mille faucheurs amenés de l’arrière abattirent les récoltes.
La ville de Tournai fut surprise par les Français. Les milices gantoises, réveillées, marchèrent à la rencontre des troupes royales mais furent battues au pont de l’Espierre (juin 1477).
Le résultat le plus tangible de cette campagne fut l’existence de deux lignes de défense couvrant la France ; la première jalonnée par Boulogne, Thérouanne, Aire, Béthune, Lens, Arras, Bapaume, prolongée par Saint-Quentin et Guise; la seconde par Montreuil, Hesdin, Doyllens, Péronne, Ham et Chauny.
Pour se découvrir enfin l’appui nécessaire, Marie de Bourgogne, sollicitée par de nombreux princes, y compris Louis XI pour son fils âgé de … huit ans, se résolut à épouser par procuration Maximilien d’Autriche. Lorsque ce dernier arriva dans les provinces, en août, il n’amenait qu’un millier de soldats, faute d’argent. Le mariage fut célébré le 18 août. Les deux époux, jeunes et beaux, ne pouvaient se comprendre que par signes.
Dans l’histoire des relations entre la France et les États du Nord, cette union fut plus importante qu’une bataille.
La dynastie bourguignonne, française à l’origine, s’était nationalisée (p.88) en quatre générations. La cinquième s’alliait, par la force des choses, à une maison étrangère dont les intérêts essentiels se Situaient à l’extérieur des frontières bourguignonnes. Car, selon toute probabilité, Maximilien deviendrait empereur et hériterait des domaines autrichiens des Habsbourgs.
Plus que par le passé, les Pays-Bas seraient ainsi mêlés à l’histoire européenne, non plus activement en leur qualité de membre important de l’État bourguignon, mais passivement, à la remorque.
Par contre cette alliance, malgré ses limitations contractuelles, pouvait rétablir un équilibre menacé par la politique de Louis XI.
Celui-ci le sentit aussitôt et prit des contre-mesures. Il fit agiter la Gueldre et la principauté de Liège, deux ennemis traditionnels de la maison de Bourgogne, et parvint à neutraliser les princes de l’empire par ses assurances pacifiques.
Il contesta les droits de Marie de Bourgogne à l’héritage, la fit déclarer « criminelle » et se proclama chef de l’ordre de la Toison d’or, création indiscutable de la maison de Bourgogne. Il démasquait imprudemment ses intentions réelles. Les Pays d’En-bas ne s’y trompèrent pas et connurent une recrudescence de loyalisme dynastique, favorisée par la naissance d’un héritier mâle, le futur Philippe le Beau (juin 1478).
Avec ses piquiers flamands, Maximilien d’Autriche livra contre les Français en 1479 la bataille, restée indécise, de Guinegatte. Tout naturellement, il reprit la politique traditionnelle de rapprochement avec l’Angleterre : traité de commerce d’abord (1478), alliance ferme en 1481, en association avec le duché de Bretagne.
Au moment où la situation tendait à s’améliorer, la jeune duchesse mourut d’une chute de cheval (27 mars 1482), laissant deux enfants, Philippe (quatre ans) et Marguerite (deux ans).
La régence de Maximilien d’Autriche
On aurait pu craindre une discontinuité provoquée par la régence d’un prince totalement étranger à ces provinces. Or Maximilien fut reconnu par les états généraux (avril 1482), sauf – et faut-il s’en étonner ? – par la Flandre. Investi des attributs de la souveraineté, il reprit la politique de son beau-père, justifiée somme toute par l’agressivité persistante de Louis XI. Il conserva des conseillers bourguignons, voulut entretenir ses bonnes relations avec l’ Angleterre, (p.89) dont l’appui, une fois de plus, allait se dérober. Mais les Gantois compliquèrent sa tâche. Négociant directement avec le roi de France, ils firent conclure la paix d’Arras (23 décembre 1482) aux conséquences désastreuses. Marguerite, fille de Maximilien et de Marie de Bourgogne, fiancée au dauphin, le futur Charles VIII, élevée à Paris, reçut en dot l’Artois, la Bourgogne, le Mâconnais et l’Auxerrois. Maigre compensation, le roi de France renonçait à Lille, Douai, Orchies et à ses prétendus droits sur le Luxembourg. En somme la Flandre – et plus exactement Gand – fut l’artisan du premier démembrement de l’État bourguignon, du rétablissement d’un droit féodal depuis longtemps périmé, et d’une alliance, qui semblait alors contre nature, avec la France. La Flandre fit également affirmer le principe de l’autonomie provinciale, suivant lequel le jeune prince et son gouvernement devraient résider à tour de rôle dans chacun des États. Mais, lorsqu’elle dut « passer » par rotation le jeune Philippe au duché de Brabant, elle viola cet accord.
Cest aussi sur Gand que s’appuyèrent les « seigneurs du sang » qui, opposés à la régence de Maximilien, firent admettre par les états généraux une régence constituée par la noblesse. Cette mesure s’expliquait en partie par le refus d’entrer dans l’orbite d’une politique étrangère, mais au prix d’une alliance avec l’ennemi héréditaire de la Flandre. Et l’on vit les provinces abuser de ce nouvel état de fait. Ypres abolit la draperie dans le plat pays ; Gand fit barrer l’Escaut à Calloo, pour gêner à la fois Anvers et le Brabant. Bref ces provinces se divisèrent à la fois entre elles et contre elles-mêmes.
Survint alors un événement : la mort de Louis XI, le 30 août 1483. Maximilien ne tarda pas à l’exploiter pour tenter de redresser une situation presque désespérée. Dès octobre 1483, il supprima la régence des seigneurs et obtint l’assentiments des états généraux, qui le reconnurent comme régent en 1484, sauf la Flandre. Elle comptait sur l’ appui de Charles VIII et de sa soeur la régente Anne de Beaujeu, femme remarquable ayant hérité l’esprit politique de son père.
Le 27 décembre 1484, Charles VIII déclara la guerre à Maximilien. En février 1485, il conclut une alliance avec la Flandre et lui envoya quatre cent lances, renfort bien faible alors que les milices communales avaient perdu de leur ancienne valeur. En juin, Bruges capitula devant les troupes de Maximilien, et Gand quelques jours
(p.92) CHAPITRE X Le premier Bourguignon-Habsbourg : Philippe le Beau
La première guerre d’Italie inaugure une longue période d’accalmie entre la France et les Pays-Bas. Véritable promenade militaire de cinq mois, couronnée par l’entrée à Naples (22 février 1495), elle fut immédiatement compromise par l’entourage du roi Charles VIII, rué à la curée. La ligue anti-française de Venise (25 mars 1495) engloba le duc de Milan, la République sérénissime, le pape Alexandre VI, Ferdinand II d’Aragon et l’empereur Maximilien.
Le fils de ce dernier, Philippe le Beau, âgé de dix-huit ans, venait d’être accueilli par ses États avec soulagement et même avec enthousiasme. Il s’entoura de conseillers belges, réaffirma le « Franc de Bruges », comme quatrième membre de la Flandre, reconstitua le Conseil ducal, réagit contre les empiétements des États provinciaux sur le domaine de la couronne. Les états généraux, rétablis en 1495, eurent à se prononcer sur les impôts, à décider de la paix ou de la guerre, conjointement avec le prince. Ce dernier devint réellement le « prince naturel », accepté comme tel. On peut en somme voir dans ce système une monarchie tempérée par un conseil de seigneurs autochtones et par l’intervention intermittente des états généraux. Seul devait compter l’intérêt des Pays-Bas, et cet intérêt était la paix à haut prix. Aussi ne secondèrent-ils en rien la politique de Maximilien, hostile à la France. Il est même curieux de constater que Philippe le Beau fit hommage à Charles VIII pour la Flandre et l’Artois, tout en s’en dispensant à l’égard de l’empereur pour les autres provinces.
Maximilien obtint pourtant un succès notable dans sa politique dynastique antifrançaise en négociant le mariage de son fils Philippe avec Jeanne de Castille, et celui de sa fille Marguerite avec don Juan. Cette double union de la maison habsbourgeoise et bourguignonne avec la dynastie espagnole préparait un encerclement de la France.
(p.93) Philippe se refusa néanmoins à appuyer la politique active de son père, car ces conseillers belges étaient animés de sentiments anti-autrichiens. Il est incontestable que les états généraux désiraient ardemment la paix, et entendaient y subordonner les intérêts dynastiques. Or, sans eux, pas de guerre pas d’argent.
L’orientation de la politique de le Beau est assez caractéristique. Il négocie avec Henri VII, roi d’Angleterre, réconcilié avec la France, et signe avec lui un acte célèbre l’Intercursus magnus, rétablissant le commerce entre et les Pays-Bas, interdit depuis nombre d’années.
Plus significative encore de Gueldre. Ce dernier avait été pendant longtemps le domaine de la famille d’Egmont, et Charles le Téméraire en avait pris possession par la force, à la mort du duc Adolphe (1473), après avoir acheté les droits de Gérard de Juliers à la succession. Les Gueldriens n’avaient accepté la domination bourguignonne. Charles d’Egmont, fils du duc Adolphe, avec l’aide active en hommes et en argent de Charles VIII, y provoqua un soulèvement général en 1491. Ainsi la France, par personne interposée, se donnait un allié sur des Pays-Bas, non loin du Rhin. L’empereur Maximilien comprit la menace et s’efforça de faire annuler les titres de Charles d’Egmont au bénéfice de ceux de son fils Philippe le Beau. Or, ce dernier, bien loin de soutenir ses droits dynastiques, s’abstint d’appuyer l’action militaire de son père, qui confisqua la Gueldre ; il alla jusqu’à autoriser le passage sur ses territoires de troupes françaises envoyées par Louis XII au secours de la Gueldre. Finalement l’arbitrage du roi de France rétablit la paix par le traité d’Orléans (29 décembre 1494). Petit épisode sans doute, mais significatif de ce désir de paix qui deviendra une obsession puis une tradition des provinces du Nord et de la Belgique.
Isabelle de Castille, épouse de Philippe le Beau, n’était pas l’héritière directe des royaumes d’Espagne, et Aragon. Il fallut trois décès successifs : celui de son frère Don Juan (1497), de sa soeur Isabelle (1498), du fils de cette dernière, don Miguel (1500) pour faire d’elle – et de son mari – les futurs souverains, l’année même de la naissance de leur fils Charles (1500). Ces faits décisifs orientèrent le destin des Pays-Bas dans une direction toute nouvelle, en même temps qu’ils établissaient en Europe occidentale et centrale un nouvel équilibre qui risquait de devenir un redoutable déséquilibre pour la France.
(p.96) Les interférences linguistiques
Si le phénomène économique peut s’expliquer par plusieurs facteurs : ouverture des Pays-Bas sur la Nord, guerres endémiques avec la France, il existe des interférences d’un autre ordre qui ne connaissent ni les frontières ni les guerres. Pour tenter de comprendre le problème linguistique, effectuons un retour en arrière. Les limites fixées par le fameux traité de Verdun de 843 avaient été tracées dans le sens sud-nord axe logiquement déterminé par le cours des fleuves traversant ces territoires. Il en fut de même lors de la création des diverses provinces, sauf celle d’Utrecht. Toutes étaient bilingues, partagées entre les dialectes thiois et romans. La Flandre le fut dès l’origine, à peu près à égalité, et le terme « flamand » n’impliquait alors aucun sens racial. Cela n’exclut nullement que l’on ne se rendît pas compte des besoins des peuples, alors que le latin, même “barbarisé”, restait la langue des autorités dirigeantes. À l’époque carolingienne, le clergé comptait nombre de bilingues. Au XIe siècle, dans le cloître de Saint-Amand (Gand), la même main recopiait le plus ancien poème français (la Cantilène de sainte Eulalie) et le Ludwigslied. Néanmoins, par les contacts fréquents entre les représentants de la société cosmopolite de la chevalerie, par les foires de Champagne, (p.97) surtout par l’action des moines clunisiens, la langue française gagna du terrain au début du XIIe siècle, devenant, après le latin, la langue des classes supérieures. Mais, à cause du profond fossé entre les classes sociales, il resta ignoré du peuple. Aux XIIe et XIIIe siècles, cette influence s’accentua dans les provinces du Nord. L’Allemagne l’ignorait, mais l’Angleterre était française, les comtes de Flandre et de la maison d’Alsace étaient des français d’éducation, Baudouin VIII et Baudouin IX étaient des Wallons, Jeanne et Marguerite avaient été élevées à Paris. Sous Guy de Dampierre, résolument flamand pourtant, la langue française était employée exclusivement dans la correspondance, les mandements, les actes de chancellerie. Elle était devenue celle de la littérature courtoise. Les nombreux mariages mixtes dans la grande internationale de la noblesse l’accréditèrent de plus en plus dans les régions thioises. À son tour, une nouvelle classe, la haute bourgeoisie du commerce, un peu par esprit d’imitation, mais aussi par nécessité économique, y vint. Les documents de crédit étaient libellés en français.
La frontière linguistique, entre le « thiois » et le « roman », qui au début « empiétait » sur le Boulonnais, recula vers le nord. Saint-Omer, longtemps germanique, devint Français au XIIIe siècle ; Ypres employa cette langue jusqu’au XIVe. Au début du XIIIIe siècle se produisit une réaction thioise ; le flamand reparut dans les actes établis par les corps qui étaient en relation directe avec le public. Lorsque les métiers s’emparèrent du pouvoir, le flamand s’imposa. Les Flamands de langue thioise réclamèrent au XIIIe siècle un diocèse qui fût de cette langue.
Dans le Brabant, la langue française s ‘était introduite à la cour du duc Jean Ier, par la littérature courtoise, mais son extension fut moindre qu’en Flandre. L’administration s’y était faite en latin. La langue flamande s’y substitua au XVe siècle, et l’usage du français ne dépassa pas la haute noblesse : affaire de mode et de bon ton.
Philippe le Hardi avait procédé à une francisation systématique de l’administration. Charles le Téméraire commit la même erreur en implantant dans les Pays-Bas des hauts fonctionnaires bourguignons. Le Grand Privilège de 1477 stipula néanmoins que chacun fût administré dans sa langue. Pour des raisons pratiques plus que culturelles, de nombreux jeunes gens allaient poursuivre leurs études en France, des familles se fixaient en région wallonne, des écoles françaises étaient créées en pays flamand.
(p. 104) Le prince-évêque de Liége, Érard de la Marck, avait partie liée avec Louis XII; les Gantois commençaient à s’ agiter;reprenant la politique de Louis XI, le roi de France « travaillait » psychologiquement les villes de l’ Artois. Le problème du duché de Gueldre n’était pas résolu ; cette guerre sévissait toujours et atteignait même le Brabant ; des renforts de cavalerie, envoyés par la France à l’aide de la Gueldre, étaient arrêtés par les villageois des provinces du Luxembourg et de Namur. Les états généraux refusaient d’épouser ces querelles dynastiques et n’ accordaient les subsides qu’à contre-coeur. Un sentiment anti-autrichien se développait dans la noblesse.
Les féodaux et les pouvoirs communaux qui avaient fait la loi ou s’étaient âprement opposés au cours du Moyen Âge finissant avaient dû céder au mouvement irrésistible en faveur de la concentration monarchique.
La situation de la France à cette époque était la suivante : Amiens, Dijon, Lyon faisaient pratiquement figure de villes frontières ; par le Dauphiné, elle poussait une pointe vers les Alpes ; au sud-est elle s’arrêtait au Var ; au sud, le Roussillon et la Navarre lui étaient étrangers ; la Bretagne était rattachée à la France par un lien personnel assorti de garanties formelles, mais celles-ci furent dénoncées, et l’annexion pure et simple eut lieu en 1532. Le domaine royal restait morcelé entre les grands féodaux ; les Bourbons possédaient en fait la France centrale. Mais il existait, surtout depuis l’apparition de Jeanne d’Arc, un sentiment national nourri de la haine de l’ Anglais.
L’État bourguignon venait de récupérer la Franche-Comté et le comté de Charolais, mais le duché de Bourgogne restait arraché au domaine de la couronne de France.
En Autriche, l’empereur Maximilien avait réussi à unifier la Styrie, la Carniole, le Tyrol, le Salzkammergut ; il possédait l’Alsace ; son deuxième fils avait été proclamé roi de Bohême et de Hongrie. Par un deuxième mariage, il était devenu héritier des Sforza de Milan, en compétition donc avec les Valois, autres héritiers des duchés italiens. Il régnait théoriquement sur le Saint-Empire, qui s’étendait de la Baltique à Trieste, de la Poméranie à Gravelines. Cet empire était en réalité une immense anarchie ; les guerres civiles et les brigandages y sévissaient. Toutes les ententes, les Landfriede ou (p.105) les essais d’unification étaient vouées à l’échec en raison de la divergence des intérêts particuliers d’essence féodale.
L’Espagne, à la fin du XVe siècle, comprenait quatre États : la Castille et le Léon ; l’Aragon ; la Catalogne; Valence, groupés en deux royaumes : celui de Castille ; celui d’Aragon avec les Baléares, la Sicile et la Sardaigne.
En 1504, Philippe le Beau avait hérité de la Castille ; la mort de Ferdinand d’Aragon laissa les deux royaumes au seul héritier Charles, le futur Charles Quint, petit-fi1s de l’empereur.
Cette formidable expansion territoriale ne pouvait qu’inquiéter le roi de France, car, désormais, les deux branches d’une puissante tenaille, les Habsbourgs d’Autriche et les Habsbourgs d’Espagne, permettraient l’encerclement du royaume.
Marguerite d’Autriche comprit qu’il fallait jeter du lest. En décembre 1505, elle signa le traité de Cambrai, qui scellait une entente entre Louis XII et l’empereur Maximilien, à la grande joie des états généraux. Interrompue en 1513 par l’entrée de l’empereur dans une ligue avec le pape, l’Angleterre et l’Aragon contre les ambitions italiennes de Louis XII, cette entente fut rétablie sur des bases plus fertiles en 15 14. Maximilien autorisa son petit-fils à s’allier avec Louis XII et avec Henri VIII d’Angleterre. Il renonça à sa tutelle, et Charles fut inauguré dans chaque État comme souverain : duc en Brabant, en Limbourg, en Luxembourg ; comte en Bourgogne, en Franche-Comté, en Flandre, dans le Hainaut, en Artois, en Hollande, à Namur ; marquis à Anvers.
Marguerite d’Autriche était devenue hostile à une politique de rapprochement, mais les seigneurs belges, avec Croÿ, seigneur de Chièvres à leur tête, voulaient un accord durable avec la France. À un point tel qu’une ambassade alla rendre hommage au roi de France pour les fiefs français.
Grâce à cette trêve, François Ier (1494- 1547) put reprendre la politique italienne et remporter (septembre 1515) la victoire de Marignan. Elle rétablit le prestige de la France, lui rendit le Milanais et lui permit de conclure une série de traités avec le pape, avec les Suisses, avec Charles Quint (13 août 1516), avec Maximilien, pour garantir réciproquement les possessions territoriales des contractants. Le traité de Noyon lança Charles Quint à Renée de France, fille de François Ier, qui recevrait en dot le Berry ; il passait sous silence les droits sur le duché de Bourgogne, mais stipulait (p.106) qu’en cas de non-mariage, Charles récupérerait les villes du Nord acquises par Louis Xl.
En janvier 1516, les Pays-Bas renouvelèrent l’alliance anglaise : c’était la paix assurée sur toutes les frontières, selon le voeu du pays.
Charles Quint, accumule les pouvoirs
À la mort de Ferdinand d’ Aragon (janvier 1516), et bien que sa mère, Jeanne la Folle, fût encore en vie, Charles se fit proclamer roi d’Espagne, à Bruxelles, le 13 mars. En septembre 1517, il se rendit dans ses nouveaux États, Aragon, Navarre, Castille, avec un entourage bourguignon et belge, qui ne tarda pas à se rendre odieux par son ignorance totale des populations et par son avidité à s’emparer des fonctions majeures. En contrepartie de cette hostilité grandissante, Charles s’assura l’appui sans réserve des seigneurs des Pays-Bas à une politique qui, tout d’abord nationale, allait devenir européenne et desservir les intérêts directs des Pays-Bas.
Le 12 janvier 1519, l’empereur Maximilien s’éteignit, et les grands électeurs féodaux, au nombre de sept, eurent à compter avec trois candidats principaux à l’empire : Frédéric le Sage, Charles Quint et François Ier. Tout fut mis en oeuvre pour appuyer les candidatures, et surtout l’argent. L’enjeu était d’importance. Pour éviter un encerclement, François lu, conscient des menaces potentielles, dépensa des sommes considérables, payées comptant, tandis que les « orchestreurs » de la candidature de Chartes, Marguerite d’Autriche, Chièvres, les seigneurs belges, les puissants banquiers Fugger, utilisèrent des lettres de change payables après coup. Les Fugger versèrent huit cent cinquante mille florins. Charles fut élu. Devenu souverain espagnol, déjà sollicité par des difficultés qui allaient le contraindre à s’ « espagnoliser » davantage, il accédait aux fonctions impériales, rendues critiques par la montée de la Réforme et par l’anarchie régnant entre les trois cent cinquante États que comptait la Germanie de 1495. Habsbourg, il retrouvait les causes de conflit avec la France en Italie. Prince bourguignon, il aspirait à récupérer le duché de Bourgogne. Ces diverses préoccupations devaient le jeter dans une politique européenne et anti-française, où les Pays-Bas, que n’intéressait aucune de ces querelles, allaient devoir faire pour le moins figure de payeurs.
(p.114) Charles Quint, malgré toutes ses difficultés en Allemagne contre ces princes protestants, obéissait à une politique de « prince très chrétien » et organisait une expédition contre les pirates barbaresques, couronnée par la prise de Tunis en 1535 et par la libération de vingt mille captifs. L’autre « prince très chrétien », François 1er, s’inspirant des seuls impératifs de sa politique anti-habsbourgeoise, subsidiait la ligue (protestante) de Smalkalde, et négociait avec le sultan Soliman 1er pour signer avec lui en, 1536 un véritable traité d’alliance.
François Ier tissa les fils d’une coalition complexe, et laissa son adversaire se lancer tout d’abord dans une nouvelle expédition contre les Barbaresques, qui cette fois se solda par l’échec d’Alger, en 1541.
Le roi de France, alors, se crut fort de l’appui de Soliman, des Barberousses, des princes protestants allemands (le comte palatin, les électeurs de Mayence et de Saxe), du Danemark, de la Suède, de l’Écosse, du duc de Clèves. Il envisageait déjà le morcellement des Pays-Bas.
La régente Marie de Hongrie manifesta une grande énergie dans la préparation de la défense. Dès que les hostilités furent entamées par les Français, en juillet 1542, la volonté de résistance fut unanime, malgré les dangers périphériques : une attaque de la flotte danoise contre les côtes de la Hollande ; une agression de la Gueldre contre la partie septentrionale du Brabant, puis à Brasschaat et Anvers ; des attaques françaises contre l’Artois et le Luxembourg. Mais, comme par le passé, ces opérations se révélèrent lentes et peu décisives. Une année se passa avant que François Ier pénétrât dans le Hainaut (août 1543). Charles Quint arriva alors à la rescousse avec une armée de vingt-six mille Italiens, Espagnols et Allemands, en descendant la vallée du Rhin. Il s’en prit à l’adversaire le plus menaçant, la Gueldre, qu’il conquit en trois semaines. Le traité de Venloo lui céda définitivement le duché de Gueldre et le comté de Zutphen. Les Dix-Sept Provinces étaient constituées. La suite de la campagne contre François ler se déroula comme les phases d’un jeu d’échecs : progression par Mons et Le Quesnoy, jusqu’à Landrecies ; arrivée d’une armée française de secours ; préparatifs de bataille ;
dérobade de François ler, repli de Charles Quint, qui n’en acquit pas moins le protectorat sur l’évêché de Cambrai. En 1544 la paix de Crespy interrompit les hostilités.
(p.116) Il se proclama « défenseur de la liberté germanique » et entra en campagne, tandis que Maurice de Saxe, chef des conjurés allemands, s’emparait d’Innsbruck. Dans son « voyage d’Allemagne », Henri II arriva en vue du Rhin, mais ne put compter sur ses alliés germaniques, qui venaient de conclure avec Charles Quint la « transaction de Passau » . La contre-offensive des impériaux se déclencha le 3 1 juillet 1552 et buta sur la place de Met%, défendue victorieusement par François de Guise, au cours d’un siège mémorable du 19 octobre au 26 décembre 1552. Par contre, les troupes de Charles Quint prirent les villes multiséculaires de Hesdin et de Thérouanne et les rasèrent impitoyablement.
Aussi ne peut-on s’étonner des représailles exercées par les Français au cours de leur invasion de 1554 dans les Pays-Bas méridionaux. Cette campagne, qui débuta dans la vallée de 1a Meuse et prit l’allure d’un vaste raid dévastateur, a laissé des traces nombreuses dans l’histoire des villes wallonnes. Les Français s’emparèrent de Mariembourg, perçant ainsi le système défensif de Bouvignes, de Dinant. Charles Quint avait posté son armée sous Namur. Henri 11 l’évita, franchit la Sambre à Châtelet ; son avant-garde s’aventura jusqu’à Nivelles, puis, contenu par les forces impériales, Henri II se rejeta vers le sud, ravageant l’Entre-Sambre-et-Meuse, livrant aux flammes les résidences de Marie de Hongrie à Binche et à Mariemont, puis Maubeuge et Bavai. Les hostilités dévastatrices se poursuivirent dans le nord de la France et devinrent plus actives en Italie.
L’absence de toute décision de part et d’autre, jointe à la fatigue de près de quarante années de guerres, explique la conclusion de deux paix, de deux trêves plutôt : la paix d’ Augsbourg (octobre 1555) avec les protestants ; la trêve de Vaucelles (février 1556) avec la France, conclue pour cinq années, sur la base du statu quo territorial, laissant donc à Henri II les Trois Évêchés (Verdun, Toul et Metz) ainsi que le Piémont.
Henri II contre Philippe II
L’abdication volontaire de Charles Quint (octobre 1555) provoqua la dislocation de l’empire. Philippe II conserverait l’Espagne, les Pays-Bas, le comté de Bourgogne, les possessions italiennes ; Ferdinand, frère de Charles, deviendrait empereur avec les territoires habsbourgeois d’ Autriche.
(p.117) Les Pays-Bas n’acceptèrent pas de gaieté de coeur leur futur « prince naturel « , et ils n’obtinrent pas qu’il vînt se faire inaugurer dans chaque province. La Gueldre, Zutphen, Overyssel, la Drenthe restèrent absolument réticentes, et cela présageait un avenir assez troublé. Tous ces États exigèrent d’être gouvernés au nom du roi par des compatriotes et Charles Quint appuya ces vues. La gouvernante Marie de Hongrie résigna immédiatement ses fonctions. Une phase nouvelle de la politique européenne s’ouvrait.
La trêve de Vaucelles, conclue pour cinq années, dura cinq mois. Henri II la rompit délibérément, sur le conseil des Guises. Les hostilités se déroulèrent en Italie, aux Pays-Bas, en Picardie. En janvier 1557, l’amiral de Coligny prit l’offensive, mais, après quelques mois de petits succès, se heurta à une armée anglo-espagnole commandée par Philippe-Emmanuel de Savoie, dépossédé du Piémont par le roi de France. Cette campagne fut marquée surtout par le siège de Saint-Quentin, place défendue par Coligny, et par la défaite d’une armée française de secours sous ses murs (10 août). Paris ne fut sauvée que par l’atermoiement des Espagnols dans l’exploitation de cette victoire. Le duc de Guise, rappelé d’Italie, réussit un coup de maître en allant s’emparer de Calais, possession anglaise depuis deux cent onze ans (9 janvier 1558). La reine Marie Tudor ne survécut que quelques mois à ce coup du sort. Guise conquit ensuite Guines et Ham, puis Thionville dans l’Est, et même Arlon, dans le Luxembourg.
Le traité du Cateau-Cambrésis (3 avril 1559) laissait à Henri II les Trois Évêchés, Calais et Saint-Quentin, mais il renonçait à ses prétentions sur Naples et le Milanais ; le duc de Savoie récupérait ses États. Élisabeth de France, soeur de Henri II, épousa le roi d’Espagne, Philippe II, veuf de Marie Tudor ; une autre de ses soeurs s’allia à Philippe-Emmanuel de Savoie.
(p.144) Mais, en 1623, un agent français commença à Liège une action de propagande intense, en dépeignant Louis XIII comme un protecteur naturel et en prenant contact avec les chefs populaires, sans grand résultat tout d’abord. En 1629, 1’intrusion de troupes de la Ligue, suivie de celles d’Espagne, fournit une chance nouvelle aux partisans de la France, qui demandèrent l’ aide de celle-ci. Louis XIII envoya un représentant officiel, mais s’abstint d’intervenir, malgré ses promesses. Les intrigues de ses agents n’en continuèrent pas moins pendant la rivalité des Chiroux et des Grignoux, qui déchira la principauté.
La minorité de Louis XIV
Les grandes batailles se livrèrent en marge des Pays-Bas, mais les Français ne cessèrent, avec des fortunes diverses, de grignoter la frontière fortifiée à l’ouest. En 1648, ils s’emparèrent d’Ypres et du fort de Knocke au confluent de I’Yser et de l’Yperlée ; ils les reperdirent en 1649. Les Espagnols prirent Bergues et Furnes en 1651, Dunkerque en 1652. En 1654, les troupes du duc de Lorraine ravagèrent la Hesbaye. En 1655, Turenne conquit Landrecies, Condé, Saint-Ghislain ; Condé fut reperdu en 1656. En 1658, la victoire de Turenne (bataille des Dunes) entraîna la chute rapide de Dunkerque, Bergues, Furnes, Dixmude, Gavere, Audenarde, Ypres, Comines, Grammont, Ninove, et de toute la Flandre maritime. Les Pays-Bas espagnols étaient ainsi largement entamés. La paix des Pyrénées (1659), si dure fût-elle pour eux, n’entérina pas toutes ces acquisitions. L’Espagne abandonnait néanmoins à la France : l’Artois (sauf Aire et Saint-Omer), Gravelines, Bourbourg, Landrecies, Avesnes, Philippeville et Mariembourg, Thionville et Montmédy. Est-il possible de comprendre les faiblesses de la défense espagnole ? Les Pays-Bas furent pratiquement exclus de toute participation active à la défense de leur territoire. Les contingents nationaux ne dépassaient pas mille huit cents hommes, alors que de nombreux volontaires « wallons » combattaient dans les tercios.
(p.147) Louis XIV revendiqua, au nom de sa femme, Marie-Thérèse, une partie des Pays-Bas : le Brabant, Anvers, le Limbourg, Malines, une fraction de la Gueldre, Namur, le Hainaut, l’ Artois, Cambrai, la Franche-Comté et une fraction du duché de Luxembourg.
Louvois avait constitué un puissant outil de guerre. Sans plus attendre, Louis XIV lança son armée à l’attaque en 1667. Ce fut une « promenade militaire ». Les places, indéfendables, tombèrent rapidement : Bergues le 5 juin, Furnes le 12, Tournai le 24, Douai le 6 juillet, Cambrai le 18, Audenarde le 31. Seule Lille ne succomba qu’après un long siège, du 2 au 28 août. Campagne de prestige, sans gloire réelle, menée par la terreur contre une régente impuissante, une résistance inorganisée, des troupes espagnoles mal payées et se débandant pour piller à l’instar des agresseurs. Tout le pays fut ravagé, les forêts aux couvents coupées sur ordre de Louvois, homme d’Etat efficace, dur et impitoyable. « Il ne faut plus songer », écrivait-il, peu après, « à gagner la Flandre sans troupes ni canons, en négociant avec des moines et en accordant des privilèges ».
Les Provinces-Unies s’inquiétèrent de la présence d’un tel voisin. Elles s’allièrent à l’Angleterre et à la Suède. Ensemble elles donnèrent un coup d’arrêt aux ambitions de Louis XIV; il ne le leur pardonnera pas. Le traité d’Aix-la-Chapelle (1668) lui accordait une ligne de villes : Furnes, Bergues, Lille, Audenarde, Tournai, Douai, Ath, Courtrai, Armentières, Binche, Charleroi. Il devait par contre restituer la Franche-Comté, qu’il avait conquise sans difficulté. Ce traité donnait à la France, non pas surtout des régions ou des provinces mais, le plus souvent, des places fortifiées. La nouvelle frontière du nord, dessinée en dents de scie, était à la fois défensive et offensive ; elle assurait aux Français le libre passage de la Sambre (à Charleroi), de l’Escaut (à Tournai et à Audenarde), de la Lys (à Courtrai).
Les coups de force se succédèrent, notamment en Lorraine, tandis que l’argent français désagrégeait la « triple alliance » et laissait finalement les Provinces-Unies isolées. Elles avaient refusé l’offre de Louis XIV, tendant au partage des Pays-Bas, et préféraient de loin l’existence d’un État-tampon au dangereux voisinage de la France. Il allait leur en coûter cher.
(p.148) La première offensive française, en 1672, fut rapidement menée. Les Pays-Bas espagnols ne servirent que de couloir de passage entre Charleroi et Maestricht, le long de la Meuse à travers la principauté de Liège, neutre, et par des territoires relevant de Munster et de Cologne. Les deux armées réunies franchirent le Rhin, événement célébré à l’envi, bien qu’il ne fût pas techniquement très difficile. Ce mouvement « tournait » les positions hollandaises de l’Yssel. Mais les Français tardèrent à exploiter leurs succès et les Hollandais percèrent leurs digues, inondant sans hésiter le plat pays.
Ils offrirent en même temps à Louis XIV de larges compensations : Maestricht, les villes du Rhin, Bois-le-Duc, Breda, Berg-op-Zoom. Mais le roi exigea tout le sud des Pays-Bas et posa d’autres conditions inacceptables. Un coup d’État porta au pouvoir Guillaume d’Orange ; le nouveau stadhouder avait vingt-deux ans, des qualités d’homme d’État, et il haïssait la France. Cet événement, le coup d’arrêt à l’invasion, la crainte inspirée à l’Europe par une ambition démesurée, provoquèrent la création d’une ligue associant l’Autriche, le Danemark, le Brandebourg et des princes allemands. La guerre se déplaça vers le Rhin, la Westphalie, la Moselle, l’Alsace. Des négociations, amorcées en juin 1673, avortèrent à cause des prétentions de Louis XIV sur Bréda, Bois-le-Duc, et visant la liberté du culte catholique dans les Provinces-Unies.
Les Français se trouvaient encore en Hollande ; les Pays-Bas espagnols leur servaient en somme d’arrières ; l’Espagne, dans la logique des choses, fut tentée de s’allier aux Provinces-Unies, au sein d’une coalition où figuraient aussi l’empire et le duc de Lorraine. Devant cette menace, Louis XIV se résigna à évacuer la partie occupée de la Hollande, après l’ avoir fait dévaster. L’Angleterre abandonna la France ; d’ autres princes allemands se joignirent à la coalition, à l’exception de la Bavière. Les Pays-Bas redevinrent le champ de manoeuvres stratégiques et de batailles. L’armée de Condé y livra la bataille de Seneffe (août 1675), tandis que Turenne conduisait une éblouissante campagne en Alsace. Louis XIV reprenait l’avantage, mais la guerre devenait vraiment européenne, pendant que les négociations piétinaient ; on se battit en Catalogne, en Sicile, dans la Méditerranée, dans la Manche et aux Antilles. Aux Pays-Bas se poursuivit la guerre de sièges qui satisfaisait les goûts de Louis XIV par leur caractère spectaculaire. En 1676, prise de Condé, Bouchain, Aire ; en 1677, Valenciennes, Cambrai, Saint-Omer, pendant (p.149) que Guillaume d’Orange se faisait battre à Cassel. L’année 1678 fut jalonnée par la prise de Gand, d’Ypres et par le siège de Mons.
Des pourparlers avaient été engagés dès 1675, mais il fallut l’alliance déclarée de Charles II d’Angleterre avec les Provinces-Unies, et le débarquement de troupes anglaises à Ostende pour les faire aboutir.
La paix de Nimègue se composait en fait de quatre traités. Les deux premiers, entre la France et les Provinces-Unies, restituaient à ces dernières leurs anciennes frontières plus Maestricht. Le troisième (17 septembre 1678), conclu avec l’Espagne, lui rendait Charleroi, Binche, Ath, Audenarde, Courtrai, c’est-à-dire les anciennes têtes de pont, mais la France absorbait la Franche-Comté, Aire et Saint-Omer, c’est-à-dire l’Artois, Valenciennes, Cambrai, Bouchain, Condé, Ypres, Bailleul, Cassel, Maubeuge. Le quatrième traité intéressait l’empire.
Le « pré carré » prenait forme. Vauban intervint dès 1677 comme commissaire général aux fortifications. Ses projets visaient essentiellement à adapter les données mathématiques des tracés aux sites des places à défendre, en tenant compte de leurs points faibles et de leurs points forts. Ces principes avaient été appliqués simultanément aux villes acquises par la France : Philippeville, Charleroi, Ath, Audenarde, Courtrai, Douai, Le Quesnoy; Brisach et Philipsburg dans l’Est, Pignerol dans le Sud-Est. Nul doute qu’il y ait eu un plan d’ensemble. Entre la Manche et le Rhin, la frontière était coupée plus ou moins perpendiculairement par la Lys, l’Escaut, la Sambre, la Meuse, la Moselle, les Vosges : autant de secteurs, où seront installées des places qui assureront non seulement une continuité frontale, mais aussi une protection des flancs. Dans le secteur Lys-Escaut, par exemple : Aire et Saint-Venant ; en profondeur, le long de la Lys : Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, échelonnées sur l’Escaut ; dans l’intervalle, Lille, Béthune, Douai, Arras et les lignes de canaux. Louis XIV accorda sa confiance à Vauban dans ce domaine et lui permit ainsi de « remodeler » des villes qui en garderont longtemps l’empreinte et le caractère de cités fermées. On y retrouve la majestueuse ordonnance, l’harmonie des proportions, la régularité du classicisme, une architecture militaire fonctionnelle, dans le cadre artistique’ de l’époque.
L’histoire des guerres de Louis XIV est plutôt monotone, si l’on fait abstraction de leurs à-côtés pittoresques et des misères qu’elles apportaient aux populations.
(p.154) En ce qui concerne les Pays-Bas, la chronologie des événements militaires s’établit comme suit :
1688 : les Français occupent le pays de Liège, théoriquement neutre ;
1689 : ils prennent Walcourt, Menin, Hondschoote.
1690 . victoire du maréchal de Luxembourg, à Fleurus. Occupation de Furnes, Dixmude, Courtrai. Exploitation du pays de Waes ;
1691 : siège et prise de Mons. Destruction de Hal. Bombardement de Liège ;
1692 : siège et prise de Namur. Victoire de Steinkerque;
1693 : reconquête de Furnes et Dixmude; prise de Huy; victoire de Neerwinden ; prise de Charleroi ;
1694 : les Français reperdent Huy ;
1695 : le maréchal de Villeroy fait effectuer l’effroyable et injustifiable bombardement de Bruxelles, qui en ruine toute la partie centrale: trois mille huit cent trente maisons détruites, quatre cent soixante fortement endommagées, trois mille bombes et mille deux cents boulets rouges. Les Français reperdent Namur ;
1696 : bombardement de Givet ;
1697 : les Français s’emparent d’Ath.
Ces dates et ces quelques faits indiquent le caractère compassé et sans décision réelle d’une telle guerre, dont la conclusion générale ne pouvait être que l’épuisement et le besoin d’une paix, fût-elle une simple trêve. Pour comprendre quelque peu ces méthodes de guerre, il faut tenir compte de la théorie juridique suivant laquelle « toute terre est propriété du souverain ». La ruiner signifiait donc affaiblir l’adversaire tout en suppléant à l’absence de toute logistique (c’est-à-dire de tous ravitaillements organisés et réguliers), idée inconnue à cette époque. Ce que l’on appelait d’un terme général les « fourrages » était donc chose normale ; seule l’absence de discipline des troupes les transformait parfois en entreprises de dévastation. Les réactions des populations étaient rarissimes et sporadiques, mais nous ne pouvons oublier ici l’action des « partisans » mot pris dans l’acception du temps, c’est-à-dire des groupements légers, agissant de façon autonome, sous des chefs régulièrement reconnus, destinés à la « guerre de course », le plus souvent en mission de renseignements ou de contre-information, et pratiquant aussi des raids au départ d’une base. La plus connue de ces troupes fut celle (p155) de Jacques Pastur, constituée le 1er octobre 1691, pour la défense de la forêt de Soignes contre toutes déprédations et pour donner la chasse aux partis français.
Les sentiments des populations belges nous sont suggérés dans un mémoire de Vauban, établi en 1689 et relatif aux fortifications de la ville d’Ypres. Parmi les « défauts » de cette place il citait « l’inclination que ses peuples conservent pour les Espagnols, par le souvenir de la liberté dont ils jouissaient sous leur domination, par la douceur avec laquelle se levaient les droits du roi (par les gens du pays, ce qui détournait la haine sur ces gens-là et non sur les Espagnols)… Les Espagnols se mariaient avec eux alors que nous (Français) ne souffrons pas que nos officiers majors prennent alliance avec eux ni que leurs filles se marient avec leurs voisins non sujets du roi. » Ce regret du régime espagnol, difficilement compréhensible pour des Belges qui ne se souviennent que de l’oppression sanglante de la seconde moitié du XVIe siècle, indique assez la tiédeur des populations à l’égard des occupants français.
Les traités de Ryswyck, conclus le 20 septembre 1697, restituèrent au roi d’Espagne Charles II, Luxembourg, Chiny, Charleroi, Mons, Ath, Courtrai, mais accordèrent aux Hollandais le droit d’installer des garnisons de sûreté dans les places de Charleroi, Binche, Audenarde et Gand. Louis XIV restituait la Lorraine, mais gardait Strasbourg. Le coup d’arrêt était néanmoins fort net.
La guerre de la Succession d’Espagne
Renonçant à la guerre comme instrument de son impérialisme, Louis XIV recourrait-il à des négociations diplomatiques pour régler la succession du roi d’Espagne, Charles II, mort sans héritier direct. Un projet de partage fut envisagé, qui eût laissé au dauphin de France les provinces italiennes relevant de l’Espagne, quitte à les échanger plus tard contre la Lorraine, Nice et la Savoie. Il n’y était pas question des Pays-Bas espagnols. Louis XIV en abandonnait-il l’idée ? Le problème ne se posa pas sous ce jour, car Charles II, mort le ler novembre 1700, cédait ses États à un petit-fils de Louis XIV, Philippe d’Anjou. Par son acceptation, le roi de France courait inévitablement à la guerre. Il ne pouvait pourtant agir autrement, car une renonciation eût fait le jeu des Habsbourgs d’Autriche. Quelques maladresses aggravèrent la situation. Sitôt devenu roi d’Espagne, Philippe V se préoccupa d’expulser les garnisons hollandaises (p.155) de Luxembourg (deux mille cinq cents hommes), de Namur (mille huit cents) de Mons (quatre mille. cinq cent soixante), d’Audenarde (mille cinq cents) et d’ Ath (mille cinq cents). Il y fallait surprise et vitesse d’exécution, mais rien ne pourrait se faire sans l’accord du gouverneur des Pays-Bas, Maximilien de Bavière. Il fut réalisé et Maximilien entra dans le camp franco-espagnol. L’opération réussit pleinement, le 6 février 1701, sans incident. Il est curieux de constater qu’à Namur cohabitèrent pendant quelques jours des troupes hollandaises, espagnoles, françaises, allemandes, anglaises et écossaises. Les Provinces-Unies obtinrent de rappeler leurs unités, et bientôt les troupes françaises se répandirent dans les Pays-Bas espagnols, occupant des villes voisines de la Hollande et jusqu’ en Gueldre.
Les Provinces-Unies se sentirent de nouveau menacées. L’armée espagnole dans les Pays-Bas, jusqu’alors lamentablement pauvre, fut rapidement réorganisée par le marquis de Bedmar, en cinquante-deux bataillons de sept cent cinquante hommes et quarante-neuf escadrons plus, en 1702, la valeur de neuf bataillons de milice dans le Hainaut, en Flandre et dans le Brabant. Maximilien-Emmanuel de Bavière, un instant écarté par méfiance, devint « vicaire général des Pays-Bas », le 10 septembre 1702.
Il fallait assurer la protection des régions les plus riches contre les attaques et les « fourrages ». Le général d’Artagnan proposa la création d’une ligne défensive d’Anvers à la Meuse. Cette ligne s’appuya au fort d’ Austruweel sur le Bas-Escaut, suivit la digue de Merxem, passa par Kessel jusqu’à la Petite-Nèthe et longea la Grande-Nèthe jusqu’ à l’ est de Lierre ; des tranchées la relièrent au Démer, obstacle prolongé par la Gette et la Petite-Gette jusqu’à Orp-le-Petit, puis par un nouveau système de tranchées jusqu’à la Mehaigne.
Telle était la situation lorsque, le 15 mai 1702, Anglais et Hollandais déclarèrent la guerre à Louis XIV. Ce dernier avait obtenu de son petit-fils, Philippe V, le transfert à la France du monopole du commerce espagnol par Cadix, ainsi que celui de la traite, au grand dam de l’Angleterre, qui s’en vit dépossédée. La nouvelle coalition groupait l’empire, le Brandebourg, le Hanovre, la Saxe, le Danemark, l’Angleterre, les Provinces-Unies ; elle disposait de deux grands capitaines : le prince Eugène de Savoie et le duc de Marlborough. Les troupes franco-espagnoles comptaient pour l’ensemble du territoire cent quarante-huit bataillons et deux cent deux escadrons (p.157), plus trente-deux bataillons dans les places. Notons incidemment que nous y retrouvons Jacques Pastur, autorisé à lever un régiment mixte de dragons à pied et à cheval, cette fois à la disposition des Français, qu’il avait si ardemment combattus. Les Pays-Bas espagnols, passés sous l’autorité directe de Philippe V d’Anjou, prince français, et sous l’autorité indirecte mais plus certaine de Louis XIV, avaient accepté ce Changement avec lassitude et résignation, mais aussi avec cet indéracinable sentiment de loyalisme à l’égard du souverain légitime. Lorsque Louis XIV se fit remettre par son petit-fils tous les pouvoirs dans les Pays-Bas (novembre 1700), l’opinion publique, pour autant qu’il soit possible d’en parler, se partagea entre partisans de la maison d’Autriche, dits les «cuirassiers », et fidèles de Philippe V. Les premiers comprenaient une partie de la noblesse autochtone, des membres des Conseils et cours de justice, de riches bourgeois, les métiers, irrités par l’influence française et les lourdes contributions, et par le souvenir, tout récent encore, du bombardement de Bruxelles, en 1695. Ce souvenir fâcheux fut ravivé du reste par des mesures vexatoires :une splendide réception organisée en faveur d’un grand chef français, le duc de Berwick, le 13 août 1701 , jour anniversaire de ce bombardement. Citons une curieuse phrase d’un officier français, M. de la Colonie, dans ses Mémoires, édités à Bruxelles en 1737 .« Ils (les Namurois} ajoutaient que nous nous applaudissions seuls et que nous méprisions le reste du genre humain, que nous mettions au-dessous de nous de nous conformer aux façons du pays Où nous avions à vivre. »
Les Pays-Bas constituaient somme toute un vaste camp retranché protégé par les lignes du Brabant. Bien que la guerre eût ces provinces pour enjeu principal, elle en resta longtemps écartée, se déroulant en Italie, mais aussi dans la Gueldre, où les alliés prirent Venlo (23 septembre 1702), Stevensweert (2 octobre 1702), Roermonde (7 octobre 1702), puis Liège, ce même mois. En été, 1703, Marlborough s’empara de Huy (23 août), de Limbourg (27 septembre) Les duchés de Gueldre et de Limbourg étaient perdus. L’année 1704 fut relativement calme dans les Pays-Bas, pendant que les Franco-Bavarois subissaient une lourde défaite à Blenheim (ou Hoechstadt), le 1 3 août. Maximilien-Emmanuel, revenu aux Pays-Bas, dirigea la campagne de 1705 ; aidé, et souvent contrecarré, par le maréchal de Villeroi.
(p.161) Charles VI continua la guerre contre la France, subissant échec sur échec, et dut consentir finalement aux traités de Rastadt (6 mars 1714) et de Baden (7 septembre 1714). L’accord d’Anvers (15 novembre 17 15) régla enfin le mode de transmission des Pays-Bas à l’empire. Pendant ces deux années, ils étaient restés livrés à l’arbitraire des Provinces-Unies qui, avec l’aide de l’Angleterre et même de la France (convention de juillet 17 13), consomma leur ruine sans que les nouveaux maîtres autrichiens firent preuve d’énergie.
Le traité d’Anvers faisait des provinces belges la grande victime des ambitions (…) de Louis XIV, mais aussi de leurs propres faiblesses et divisions. Largement entamées au sud, elles perdaient des territoires en Flandre zélandaise et en Gueldre, subissaient la fermeture de l’Escaut, se voyaient imposer des traités de commerce et des impôts désastreux et devaient accepter la présence militaire hollandaise. En ces années pénibles, les Belges souffrirent de leur particularisme étroit, défaut majeur qui se retrouvera encore au cours de leur histoire. Il les mit chaque fois en état d’infériorité devant une France, centralisée déjà et cohérente autour du trône, et devant les Provinces-Unies, exaltées par la grandeur de leur destin depuis plus d’un siècle, et du reste à la veille d’en perdre les fruits en face d’une Angleterre grandissante et vorace. Louis XIV mourut le 1er septembre 1715, laissant le trône à son arrière-petit-fils, tandis que Philippe V, roi d’Espagne, restait nominalement en guerre avec l’empire jusqu’en 1735.
(p. 165) La seconde moitié du XVIIe siècle, avec la fermeture de l’Escaut et les constantes agressions françaises vit la décadence totale dans tous les domaines. La langue française devint la seule langue véhiculaire d’une élite cultivée, les dialectes thiois se limitant aux couches populaires. Toute cette période connut une « atonie » prolongée de la culture dans les Pays-Bas, qui ne trouvait plus rien à quoi se rattacher.
Par les invasions des armées de Louis XIV, l’influence française, devint « écrasante », étouffante. Tout fut français d’inspiration : théâtre, presse, formation intellectuelle des rares élites, rejetant le reste dans une ombre épaisse et bannissant l’ancienne originalité de ces provinces. La situation y était tellement lamentable qu’elle permit à Voltaire d’écrire en 1740, sans trop d’exagération : « Ce n’est pas ici le pays des belles-lettres ; Bruxelles est l’éteignoir de l’imagination ; le séjour de l’ignorance, de la pesanteur, des ennuis et de la stupide indifférence. » « Un vrai pays d’obédience, privé d’esprit, rempli de foi.»
Après 1772, la Belgique s’entrouvrit à la littérature « philosophique », notamment aux oeuvres de Montesquieu et de Necker. Dans la principauté de Liège, la francisation fut plus rapide et plus intense, en même temps que les « contrefaçons » de livres édités à Paris s’y multipliaient.
(1790)
(p.170) L’ exposé des événements de cette époque, à coup sûr curieuse et déconcertante, n’entre pas dans le cadre du sujet. Il nous suffit d’indiquer que cette « révolution brabançonne » avait la faveur de Paris, car elle affaiblissait l’influence de l’Autriche, installée aux frontières nord d’une France révolutionnaire. Les états généraux avaient fait sonder les milieux gouvernementaux français. Deux agents, Sémonville et Ruelle, tentèrent vainement de faire arborer les couleurs de la France à Bruxelles (25 février 1790). Le général Dumouriez, appelé en consultation, resta dix-sept jours à Bruxelles, rédigeant un « mémoire militaire » adressé au Congrès souverain. Il estimait que la France ne pourrait tirer aucun avantage d’un tel chaos politique et militaire, car, à son avis, la défaite serait rapide.
La lutte se fixa dans les Ardennes et sur la Meuse, entre Dinant et Hastière, jusqu’en novembre 1790. La proximité de la frontière française amena le général d’Happoncourt, commandant la gauche autrichienne, à prendre contact avec le commandant de la place de Givet, le chevalier de Jannet, en vue d’éviter le passage par la France d’une colonne de patriotes pouvant ensuite l’attaquer à revers. Il lui fut répondu que, sur instruction éventuelle du gouvernement de Paris, on laisserait passer un corps de patriotes, mais après l’avoir désarmé, comme on l’avait déjà fait pour un bataillon autrichien. Par contre, la population de Givet réagit avec vigueur et contraignit Jannet à écarter de la ville tous les émigrés brabançons du parti impérial.
Lorsque s’affirma la victoire autrichienne, les éléments les plus compromis se réfugièrent : les conservateurs (vandernootistes) en Angleterre et en Hollande, les plus farouchement révolutionnaires (les vonckistes) en France, à Paris et dans la région de Lille. Ils s’y rencontrèrent avec les radicaux de la Révolution liégeoise, car le peuple de Liège s’était révolté, lui aussi, le 18 août 1789, contre son prince-évêque.
(p.171) Un rapide retour en arrière esr ici nécessaire. Une succession presque continue de princes-évêques bavarois, entre 1581 et 1723 n’avait pas réussi à rétablir dans la principauté l’influence germanique, tout d’abord sapée par l’influence espagnole, puis par l’infiltration des idées françaises. Après 1713, Liège rentra dans le « cercle de Westphalie », membre du Saint-Empire romain et relevant à ce titre de la chambre de Wetzlar, tout en restant toujours autonome. Liège fit souvent appel à cette chambre pour régler les conflits incessants entre l’évêque, le chapitre et les états. La principauté réussit à rester à l’écart des Pays-Bas autrichiens et connut une longue période de tranquillité relative et de restauration économique, d’industrialisation sur la Meuse en amont de Liège (sidérurgie) et sur la Vesdre (lainages).
On ne découvre aucune volonté ferme de réformes politiques ou sociales, jusqu’à l’avènement, en 1772, du prince-évêque François Charles de Velbrück, qui se réclamait de la philosophie nouvelle et de la politique éclairée », c’est-à-dire de la défense des droits du peuple contre les privilégiés. Il était donc logique que la principauté s’ouvrît davantage encore aux idées françaises des Encyclopédistes tout comme aux goûts artistiques venus de Paris. La France monarchique avait favorisé, en 1784, l’élection du prince-évêque de Hoensbroeck, dont l’avènement avait donné un coup de frein aux idées libérales. Aussi la nouvelle de la prise de la Bastille fut-elle à Liège le détonateur d’une révolution menée au nom des droits de l’homme er des revendications du prolétariat industriel. L’évêque dut fuir Liège dans la nuit du 26 au 27 août 1789, sous la pression populaire, mais, tout comme en France, la bourgeoisie, conduite par Bassenge, en cueillit les fruits. La chambre de Wetzlar lança un ultimatum, le 4 septembre, et chargea les trois directeurs » du cercle de Westphalie : le roi de Prusse (en sa qualité de duc de Clèves), l’électeur de Cologne et l’électeur Palatin, de 1’« exécution militaire » . Après hésitation, la Prusse se décida à éviter une fusion possible des deux nouvelles républiques, Liège et Pays-Bas, qui pourraient par la suite faire cause commune avec la France révolutionnaire. Quatre mille Prussiens et mille Palatins occupèrent la ville de Liège, mais l’évacuèrent le 16 avril 1790. Les troubles reprirent ; Liège organisa sa défense, remporta même deux succès sur l’armée du cercle, à Maeseyck et à Genck, dans le Limbourg. L’Autriche se résolut enfin à intervenir. Le rétablissement du pouvoir autrichien dans les Pays-Bas et l’insuccès (p.172) de la Révolution liégeoise eurent des conséquences à échéance différée, par l’émigration forcée, en France, des libéraux et des radicaux. Pendant qu’ils se regroupaient dans le nord de la France, une émigration en sens inverse peuplait les Pays-Bas, redevenus autrichiens, de Français fuyant la Terreur. Ils irritèrent la population par leur jactance, leur insolence, pendant que des émissaires du régime révolutionnaire travaillaient le peuple et que la gouvernante Marie-Christine signalait avec lucidité l’aveuglement du clergé, qui ne sentait pas le danger de se détacher du souverain et n’ apercevait pas la menace représentée par le système français.
Or cette menace se précisait, et l’Angleterre s’ en inquiétait, bien qu’en 1792 encore son opinion publique ne fût pas défavorable aux premières réformes en France. Le gouvernement de Paris s’efforça de convaincre Londres qu’il ne songeait nullement à conserver les possessions autrichiennes ni, à plus forte raison, à annexer les Pays-Bas. « Si nous sommes forcés de saisir la Belgique pour notre sécurité, nous renonçons à toute réunion. » Cette déclaration du 20 avril 1792 coïncida avec la déclaration de guerre à l’Autriche, et le Premier ministre anglais Pitt y répondit par une promesse de neutralité.
Après les premiers échecs et la débandade des armées françaises dans les régions de Tournai et de Mons (avril-juin 1792), après la canonnade de Valmy (20 septembre 1792), après le terrible bombardement de Lille par le duc Albert (29 septembre au 6 octobre), qui provoqua des représailles ultérieures des Français, la victoire de Dumouriez à Jemappes, le 5 novembre, scella le destin de la Belgique. La Convention jacobine décida de pousser la guerre de conquête jusqu’à la barrière du Rhin. Fin décembre, les Français se trouvaient à Aix-la-Chapelle, devant Maestricht et Venlo.
Alors se manifestèrent des divergences de vues entre Dumouriez et son gouvernement. Le premier envisageait la création d’une république belge, indépendante mais alliée à la France, le second exigeait l’annexion pure et simple, pour résoudre une situation financière déjà détériorée en s’assurant le gage des richesses de la Belgique et de la principauté de Liège. La Convention vota le 15 décembre 1792 un décret qui supprimait toutes les autorités établies dans les territoires occupés, prévoyait l’élection de représentants provisoires par les communes, excluait ceux qui refuseraient de prêter serment à la Liberté et à l’Égalité, décidait la saisie de tous les biens (p.173) du prince et des corps laïcs et ecclésiastiques, à l’intervention de commissaires français. Une phrase de ce document est éloquente : « Nous ne prenons rien ; nous réservons tout pour les frais de la guerre. Nous augmentons notre propre puissance, puisque nous aurons un moyen d’écoulement de nos assignats et que l’hypothèque que fourniront les biens mis sous la sauvegarde de la République augmentera le crédit de ces mêmes assignats. » Ce décret, qui annonçait implicitement une annexion, fut mal accueilli par l’immense majorité des citoyens belges. Le général Dumouriez, conscient de cette situation et de ses conséquences possibles, revint à Paris pour tenter de le faire rapporter et d’éviter ainsi une rupture avec l’Angleterre et avec la Hollande. L’Assemblée, qui ressemblait sans doute à toutes les assemblées, subissait la loi de la fraction la plus violemment énergique. La pression jacobine réussit à faire décider par la Convention, le 13 janvier 1973, l’exécution de ce décret. Le 1er février, la Convention déclara la guerre à l’Angleterre et à la Hollande.
Pendant ce temps, avec habilité, les commissaires jacobins mettaient en oeuvre les moyens de propagande, de coercition, au besoin de discrimination, pour aboutir à un plébiscite qui approuverait la « réunion. » Le 1er mars 1973, la Convention décréta l’annexion des Pays-Bas autrichiens que Carnot, l’« organisateur de la Victoire », qualifia de « retour aux frontières naturelles » et de « simple restitution ».
La Révolution restait en cela fidèle à la politique d’impérialisme dynastique et à son argumentation faisant fi des réalités historiques. Sous le couvert d’une propagation de la Liberté, il s’agissait tout simplement d’une expansion par la force, de l’exportation d’une monnaie détériorée, de la régularisation d’une exploitation systématique des ressources de ces provinces. Ce décret d’annexion du 1er mars 1793 coïncida exactement avec le premier échec des armées françaises sur la Roer. Elles durent lever le siège de Maestricht, évacuer Liège, se replier sur Tirlemont (15 mars), sous la poussée autrichienne. Dumouriez, accouru en hâte, libéralisa le régime jacobin pour tenter de regagner des sympathies, mais sa défaite à Neerwinden (18 mars), puis à Louvain (21 mars), l’amena à traiter avec Cobourg et à ramener son armée à la frontière. Le régime (p.174) autrichien fut rétabli sur-le-champ, avec l’archiduc Charles comme gouverneur général.
Aux exactions et aux pillages des soldats français succédèrent sans transition les pillages et les exactions des soldats allemands et autrichiens. Mais il faut reconnaître, à la lumière de nombreux témoignages d’époque, que cette « libération » épargna tout au moins aux provinces belges les excès de la TerreUr, dont elles n’avaient eu qu’un avant-goût.
En juin 1793, la Terreur jacobine se déchaîna dans son impitoyable rigueur. La Convention ne considérait la perte des Pays-Bas autrichiens que comme temporaire, ne portant nullement atteinte à « ses droits ». Elle décidait que « les pays réunis font partie de la République française. Avec une énergie qu’i1 faut admirer, le Comité de salut public préparait une guerre de reconquête à outrance, envoyant de nombreux agents propagandistes en Belgique, en Rhénanie, dans les cantons suisses, en Italie. Carnot comme stratège, Barthélemy comme diplomate, furent les grands inspirateurs de cette politique, qui s’attacha tout d’abord à retirer le roi de Prusse de la coalition.
Le programme des conquêtes fut clairement énoncé par l’arrêté du 18 septembre 1793 : prendre des otages, désarmer les habitants, imposer des contributions aux riches et aux corporations religieuses, faire vivre les armées aux dépens du pays ennemi ; enlever tout ce qui n’était pas strictement indispensable à la vie des habitants, saisir l’argenterie des édifices religieux et tous les biens publics transportables.
Les rapports de « représentants du peuple », de généraux tels Van Damme et Pichegru, se font l’écho de la réalisation de ce programme : Menin et ses environs ont « produit environ dix millions ; Ostende et Courtrai sont pillés ; des propriétés et des châteaux sont incendiés ».
Après une relative accalmie pendant l’hiver 1793-1794, tout se précipita. Il semblait pourtant, au printemps 1794, que la situation de la France fût presque désespérée, dominée sur les mers, menacée sur toutes ses frontières et même à l’intérieur (Vendée, Lyon, Toulon). Or, le 28 mai, le Comité de salut public confirma que « toutes les richesses des pays conquis » devront converger immédiatement vers la France ». Les opérations de reconquête avaient débuté le (p.175) 17 février pour l’armée du nord, les 9 et 18 mars pour les armées de la Moselle er des Ardennes. Elles connurent tout d’abord quelques échecs et des tâtonnements. En Flandre, Furnes et Courtrai furent pris, et Menin assiégé. Dans le Luxembourg, après avoir réoccupé Arlon le 21 mai, Jourdan, à la tête de vingt-cinq mille hommes, marcha par Saint-Hubert, Rochefort et Dinant pour rejoindre devant la Sambre l’armée des Ardennes. La campagne de 1794 ne fut pas un raz-de-marée. Pichegru dut attendre le début de juillet pour voir faiblir la résistance des coalisés et se dire maître de la Flandre maritime, avant de conquérir la Flandre zélandaise, Gand le 4 juillet, Audenarde le 5, Alost les 6 et 7, Termonde le 10, et entrer à Bruxelles le 9 juillet.
À cette même époque, après des combats acharnés pour les passages de la Sambre et pour Charleroi, qui avaient rempli presque tout le mois de juin, les chefs coalisés décidèrent le 25 juin un suprême effort. Et ce fut la fameuse journée de Fleurus (26 juin), couronnée par une éclatante victoire française. Après quelques jours, Jourdan reprit sa progression, facilitée par les malentendus entre les coalisés qui, au lieu de défendre une ligne Gand, Mons, Namur, se retirèrent sur une position Anvers, Malines, Louvain, Namur. Pas pour longtemps, car les Hollandais ne songeaient plus qu’à défendre leurs frontières, les Anglais à ne pas s’écarter de la mer et des bouches de l’Escaut, les Autrichiens à ne pas se laisser couper du Rhin, et les Prussiens à essayer de tirer parti de cette situation dans leur intérêt propre. La ligne de défense prévue fut rompue par la fougue française dans la journée du 15 juillet ; Anvers est occupé sans combat le 23 juillet et Liège le 27 (date précise du 9 thermidor). Cette dernière ville fut bombardée par l’artillerie autrichienne, des hauteurs de la Chartreuse, pendant trois jours.
La dernière position défensive, établie sur le bas Rhin, dans la Gueldre, à Roermonde, Venlo, Maestricht, la Chartreuse, les hauteurs de Sprimont et d’Aywaille, et placée sous les ordres des généraux belges Clerfayt, Beaulieu et Baillet-Latour, fur enfoncée, précisément dans le secteur jugé le plus inaccessible, celui de l’Amblève et de l’Ourthe, le 18 septembre. Cette nouvelle défaite scella l’abandon définitif des territoires belges et liégeois, le 20 septembre, à l’exception de Maestricht, qui soutint un siège du 22 septembre au 4 novembre, et de Luxembourg, qui résista jusqu’au milieu de 1795.Il nous tarde d’en finir avec ces opérations au cours desquelles (p.176) les populations eurent un rôle absolument passif. De cette période désolante subsistent d’émouvants témoignages des destructions perpétrées par des généraux révolutionnaires : les ruines imposantes des abbayes d’Aulne, de Villers-la-Ville et d’Orval. Il est inutile de multiplier les exemples de villes et de villages mis à sac et parfois à feu, suivant l’ordre de Carnot. « Il faut dépouiller le pays et le mettre dans l’impuissance de fournir aux ennemis les moyens de revenir. »
(p.177) CHAPITRE XXII L’annexion de la Belgique
Il est assez étonnant que la Convention ait attendu plus d’une année avant de décréter, le 1er octobre 1795, la réunion des provinces belges à la France. L’une des raisons est probablement que la France révolutionnaire se trouvait engagée contre de nombreux adversaires et que le sort des territoires conquis dépendait des résultats de ces actions militaires. Mais il semble aussi que ce long délai ait permis de réaliser la première partie du programme, c’est-à-dire l’exploitation systématique des ressources de la Belgique. Et encore, la relative modération de la politique de la Convention après le 9 thermidor provoqua-t-elle une opposition entre ses représentants en Belgique et les jacobins belges restés fidèles à la plus farouche idéologie.
Pour apprécier la légitimité de cette «réunion», référons-nous aux déclarations de Merlin, rapporteur devant la Convention, puis ministre dans le Directoire. Selon lui, le vote de la « réunion » avait été fortement minoritaire en Belgique, dans six départements, nul dans celui des Forêts, quasi nul dans les Deux-Nèthes et la Meuse Inférieure. Mais, ajoutait-il, « la République peut et doit, soit retenir à titre de conquête, soit acquérir par des traités, des pays qui seraient à sa convenance, sans en consulter les habitants ». La Convention ne se fit donc pas scrupule d’annexer, non seulement les provinces belges et la principauté de Liège, mais aussi les territoires entre Meuse et Rhin.
Le Comité de salut public n’avait pas attendu ce vote pour procéder à une division administrative provisoire des territoires « réunis ». Après quelques tâtonnements, la nouvelle répartition s’inspira, dans l’ensemble, des limites séculaires des provinces historiques, sauf en ce qui concerne l’ancienne Flandre, partagée en deux : le (p.178) département de la Lys (Bruges) et celui de l’Escaut (y compris la Flandre zélandaise), chef-lieu Gand. Le Brabant devint le département de la Dyle (Bruxelles) ; le Hainaut, celui de Jemappes (Mons) ; Anvers, celui des Deux-Nèthes (Anvers) ; Liège, avec Malmédy, Saint-Vith, celui de l’Ourthe (Liège) ; le Limbourg, avec l’actuel Limbourg hollandais, celui de la Meuse-Inférieure (Maestricht) ; Namur, celui de Sambre-et-Meuse (Namur), et le Luxembourg, y compris l’ actuel Grand-Duché, celui des Forêts (Luxembourg).
Le 26 octobre 1795, l’annexion au duché de Bouillon ajouta un canton à chacun des départements des Forêts et de l’Ourthe, et les autres au département français des Ardennes. Le plus hétéroclite de ces nouveaux départements fut la Meuse-Inférieure, qui englobait des territoires ayant appartenu à la Hollande, à la principauté de Liège, à l’empire, au Palatinat, à la Prusse et aux Pays-Bas autrichiens. Cette restructuration n’alla pas sans protestations, surtout dans les pays de Liège et de Stavelot, qui comptaient pourtant parmi les plus chauds partisans de la Révolution.
Cette première réforme annonçait le régime unitariste de la nouvelle Belgique sous les lois françaises. Le 25 octobre 1795, il fut précisé que ces lois ne seraient exécutoires dans les pays réunis qu’après une publication spéciale, et qu’en attendant subsisterait le régime d’exception. Fendant une année, l’introduction de la législation révolutionnaire fut désordonnée et provoqua des perturbations, jusqu’au 6 décembre 1796. Les nouvelles lois devinrent alors exécutoires en Belgique dès leur promulgation en France. A la tête de chaque département siégea une « administration centrale », de cinq membres élus, flanquée d’un commissaire du Directoire, dit commissaire centraI, délégué du gouvernement. À la tête des communes de plus de cinq mille habitants, une administration municipale élue, de cinq, sept ou neuf membres, assistée d’un commissaire du Directoire, dit commissaire municipal. Dans les communes moins importantes, un « agent » élu chargé de la police et de l’état civil, et un « adjoint ». Tous les « agents » constituaient au chef-lieu de canton l’administration municipale du canton, avec un président élu et un commissaire du Directoire.
Les communes belges perdaient ce qu’elles avaient voulu conserver au cours des siècles : leur autonomie administrative.
Les commissaires du Directoire, représentants du pouvoir exécutif, possédaient en fait des pouvoirs fort réduits ; il devait fatalement en résulter de l’anarchie. Anarchie administrative, dont les causes (p179) furent nombreuses : non-acceptation des postes par les autochrones, même dans les départements favorables aux idées nouvelles ; impossibilité, pour des raisons linguistiques évidentes, de découvrir dans les territoires flamands et hollandais, réfractaires du reste à ces idées, des agents ou des adjoints qui ne fussent pas illettrés ou qui fussent capables de tenir des registres en langue française. Car les autorités françaises se montrèrent fatalement allergique à ces nécessités linguistiques et toutes disposées à une francisation systématique.
Les cas de refus de coopération furent si nombreux dans le département de l’Escaut qu’on en vint, le 24 décembre 1796, à imposer aux réfractaires des « garnisaires » et une amende journalière. Une malencontreuse décision de la Convention vint aviver le mauvais vouloir : celle de faire du 21 janvier, date anniversaire de l’exécution du roi Louis XVI, une fête nationale, assortie de la prestation par tous les fonctionnaires du serment de fidélité à la République et de haine à la royauté. À l’exception des grandes villes, les cantons ruraux firent affluer refus et démissions.
Les Belges se défendaient aussi contre les exigences financières de la Révolution. Ils n’acceptaient les assignats qu’à des cours effondrés, la dépréciation atteignant, au début de 1796, 99,75 pour cent. Les marchands exigeaient des prix exorbitants pour les denrées. Mais ils ne purent échapper aux contributions extraordinaires imposées aux « pays réunis » et « formant leur contingent des frais de la guerre de la liberté ». Elles se traduisirent notamment par l’emprunt forcé, payable en Belgique en numéraire seulement. L’argent ainsi récolté fut directement envoyé à la Trésorerie de Paris. On sait que la politique financière du Directoire fut catastrophique, ne favorisant que la spéculation et la concussion.
À ces trop nombreux motifs d’irritation s’ajoutèrent les abus de pouvoir. Certes les Belges avaient échappé aux excès de la Terreur et aux génocides commis en France même (Vendée, Lyon), mais les autorités civiles, et plus encore les autorités militaires, usaient de procédés brutàux dans leurs réquisitions, encourageaient l’espionnage et la délation, « pour connaître les démarches de nos ennemis au milieu d’une foule de prêtres, de moines, de fanatiques dont nous n’entendons pas le langage ». (Note du commissaire central des Deux-Nèthes au ministre de l’Intérieur, 20 décembre 1795.) Les questions religieuses furent une cause majeure de ferment. Le serment constitutionnel ne fut pas exigé des prêtres belges, mais (p.180) l’interdiction du port du costume ecclésiastique, des cérémonies à l’extérieur des lieux du culte, faisaient partie de l’héritage de la Convention. Il faut reconnaître que le Directoire en usa modérément au début, à la grande indignation des jacobins de Belgique. Ce n’était que partie remise; une loi du 1er septembre 1797 supprima en Belgique les ordres, congrégations, monastères, abbayes ; les religieux belges reçurent en guise de compensation des bons qu’ils ne pouvaient utiliser que pour l’achat de biens ecclésiastiques nationalisés. Déjà détruites en partie, les abbayes d’Orval, de Villers et d’Aulne furent livrées à la démolition par les acquéreurs. La situation resta néanmoins préférable à celle des religieux français, et il faut sans doute l’attribuer à l’habileté traditionnelle des Belges à tourner les lois de l’occupant.’.
Il n’y avait encore aucune menace de trouble grave, et le meilleur diagnostic nous paraît être cette opinion d’un fonctionnaire français du département de la Dyle sur l’ « égoïste habitant qui ne veut être ni autrichien ni français » , et ne signalant que « quelques réactions de mauvais vouloir très localisées ». La Belgique souffrait pourtant de la dégradation des voies de communication, du blocus des ports : « Il n’y a presque plus d’autre commerce dans ce département ccelui de la Meuse-Inférieure que la contrebande. » Fabriques fermées, bétail décimé par l’épizootie ; les récoltes de céréales restaient abondantes, mais intransportables. L’insécurité se généralisait : bandes de « chauffeurs », véritables petites armées de brigands.
Le calme relatif qui faisait croire à une certaine résignation du pays allait prendre fin avec la reprise de la persécution religieuse, après le 18 fructidor. On vit successivement abolir le costume ecclésiastique en public ; abolir les congrégations ayant pour objet l’éducation publique et les soins aux malades ; supprimer « les chapitres séculiers, les séminaires et toutes les corporations laïques des deux sexes ; suspendre l’université de Louvain ; proscrire tous les signes extérieurs du culte ». La loi du 19 fructidor imposa un serment de « haine à la royauté et à l’anarchie, d’attachement et de fidélité à la République et à la Constitution de l’an III». Elle légalisa la déportation. Le cardinal de Franckenberg, rentré en 1795 à Malines, son diocèse, fut arrêté et frappé de déportation le 9 octobre 1797, exilé à Emmerich. L’immense majorité des prêtres refusa le serment, (p.181) sauf à Liège (cinq cents serments, dont beaucoup furent ensuite rétractés). En un an, cinq cent quatre-vingt-cinq prêtres belges furent déportés, certains internés dans des villes de France, d’autres expulsés, et trente envoyés en Guyane ; dix-neuf y moururent dont le « recteur magnifique » de l’université de Louvain. On en vint à la pratique des « messes aveugles, sans la présence du prêtre à l’autel.
Tout était prêt pour une explosion populaire. Quelle en serait l’étincelle ?
La loi du 18 fructidor an VI institua la conscription de tous les Français célibataires de vingt à vingt-cinq ans, répartis en cinq classes ; service de cinq ans en temps de paix, illimité en temps de guerre. La première levée fut décrétée le 3 vendémiaire an VII, suspendue toutefois en Vendée. En Belgique ce fut la révolte. Nous ne pouvons qu’en résumer à grands traits les faits saillants. Le 12 octobre 1798, émeute à Overmeire (département de l’Escaut) où l’on brûle les registres d’état civil. Une bande s’empare d’Axel, de Hulst, du Sas-de-Gand; une autre de Saint-Nicolas; une troisième, de la Tête-de-Flandre ( 19 octobre) bientôt délogée par une centaine de soldats de la garnison d’ Anvers. La Campine se soulève à son tour, de Hoogstraeten à Turnhout, à Lierre et Diest ; les insurgés se font une place forte du terrain dit « Petit-Brabant », entre Escaut et Rupel. Des tentatives sur Audenarde, sur Louvain, échouent. Ces bandes sont en effet mal armées, mal organisées, sans aucun soutien extérieur. Leur seule chance est leur mobilité. Mais la répression s’est organisée, et elle sera sauvage. C’est la « traque générale » avec incendie des maisons suspectes, recensement obligatoire dans chaque famille, prise d’otages, colonnes mobiles sous le commandement unique du général Colaud. À Malines on fusille sur place quarante et un prisonniers ; on compte six cents morts à Herentals. Les Français ne subissent que des pertes insignifiantes.
Dans le Luxembourg sévit aussi une guerre de partisans, au nom significatif Klöppelkrieg, ou guerre des bâtons. Ici aussi on note des massacres à Clervaux, à Saint-Hubert, à Amblève, à Stavelot. Cela se prolongera pourtant pendant des mois.
En Campine se révèle enfin une organisation. Cette petite armée réussit à surprendre Diest, le 13 novembre ; encerclée, elle se replie habilement. Puis survient la prise de Hasselt par trois mille cinq cents hommes, dont un tiers sans armes, le 4 décembre. Le général Jardon, un Verviétois, donne l’assaut le 5 (…).
(p.184) Le Directoire avait suspendu la levée en masse en Belgique. Après le coup d’État du 18 Brumaire, les consuls évitèrent d’appeler tous les conscrits et accordèrent la faculté de remplacement par un suppléant, moyennent le paiement d’une prime de trois cents francs. Seuls les conscrits de l’ an VIII furent convoqués, au nombre de trois à quatre mille, mais on n’ atteignit pas ce chiffre, loin de là. Beaucoup furent réfractaires, d’autres s’échappèrent des colonnes ou désertèrent. Ce qui fit dire par Viry : « Ce peuple n’est pas un peuple de soldats. » Jugement assez exact, mais incomplet, car d’autres facteurs jouaient : la nostalgie de l’Ancien Régime, la question religieuse, l’obstacle de la langue flamande.
Après la paix de Lunéville les officiers autrichiens démissionnaires purent résider en Belgique ; les Belges encore au service de l’Autriche reçurent le droit d’option, mais, s’ils désiraient rester autrichiens, ils durent vendre dans les deux ans leurs biens situés « en France ». Cette règle s’étendit aux familles princières d’Arenberg de Croÿ, de Looz, de Salm-Salm.
La politique consulaire exclut les Belges des postes importants et rétribués, et chercha à intégrer au nouveau régime la jeune génération. (p.185) « Les élèves, dans les lycées, s’y formeront à nos habitudes et à nos moeurs, s’y nourriront de nos maximes et reporteront dans leurs familles l’amour de nos institutions et de nos lois. Ainsi s’exprimait un « Exposé sur la situation de la République an X. “
La guerre continuait pour ou contre les « frontières naturelles » qu’exigeait le Consulat, tout comme l’avait fait la Convention. Et si la bataille décisive se livra en Italie, c’est, dit Cambacérès “pour la Belgique » qu’on s’y battit. Il s’en fallut de peu que Marengo fût une défaite cuisante. Elle ne mit pas fin à la guerre et c’est le rival redouté de Bonaparte, le général Moreau, qui emporta la décision à Hohenlinden. Le traité de Lunéville (9 février 1801) confirma les clauses de celui de Campo-Formio, cédant à la France, en toute légitimité, la Belgique et la rive gauche du Rhin, qui devint les départements de la Roer, de Rhin-et-Moselle, de la Sarre et du Mont-Tonnerre. Mais ces « limites naturelles » ne suffisaient déjà plus, et l’Autriche accepta que la France exerçât un protectorat sur la République batave, la’ République cisalpine, la République ligurienne, la République helvétique, occupât puis annexât le Piémont. L’Autriche cédait ainsi sur presque tous les points devant un impérialisme français enivré, alors que l’Angleterre refusait de s’associer à une telle abdication. Mais lorsque la menace potentielle française s’estompa dans la Méditerranée, par la capitulation du corps français resté en Égypte, le gouvernement anglais négocia à son tour une paix, celle d’ Amiens (25 mars 1802), qui consolidait les conquêtes territoriales de la France et allait sceller le sort de la Belgique pour treize années. La Belgique resta au premier plan des préoccupations. Le Premier Consul avait déclaré : « Depuis Campo-Formio, les Belges sont français, comme le sont les Normands, les Alsaciens, les Languedociens, les Bourguignons… Le peuple français n’aurait jamais, ni cédé ses droits ni renoncé à la réunion de la Belgique.»
(p.186) La Belgique au sein de l’Empire français
Il n’est plus question de relations entre Pays-Bas et France mais, tout simplement, de la situation des départements belges à l’intérieur d’un empire. Cela devient l’histoire de la France, de ses conquêtes, de ses ambitions séculaires de loin dépassées, de son prestige, de sa gloire. Cette histoire fut remodelée par le puissant génie de Napoléon, et la Belgique ne put pas plus s’y soustraire que la France elle-même ou les autres pays rattachés. La première manifestation en fut la hiérarchie des pouvoirs, coiffée par le pouvoir exécutif incarné en un seul homme. Dès 1800, chaque département possède son préfet, fonctionnaire nommé par Napoléon et assisté par le conseil général : chaque arrondissement a son sous-préfet et son conseil ; chaque commune son maire et son conseil. Aucune de ces fonctions n’est élective. Cette centralisation outrancière entre les mains du pouvoir central, associée à une structuration fort poussée, contribua efficacement à effacer les dernières traces de l’ancien particularisme des provinces belges.
Le même souci de hiérarchisation se traduisit dans la réforme judiciaire, également réalisée dès 1800. Tous les magistrats furent nommés par le Premier Consul et repartis entre les juges de paix (dans les cantons), les tribunaux de première instance (arrondissements) les tribunaux d’appel et les tribunaux criminels (bientôt cours d’assises) dans certains départements, et enfin le Tribunal de cassation. Ce fut l’une des réformes les plus durables.
Le Code civil en est une autre. Voulu par Bonaparte, dès son accession au Consulat, mis à l’étude en 1800, adopté finalement le 23 mai 1804, ce Code traduisait lui aussi une tendance à une société fortement hiérarchisée, reposant à la fois sur la communauté, familiale et sur certains sentiments de misogynie. Il ne répondit que (p.187) partiellement aux désirs de Napoléon en ce qui concernait les facilités d’obtention du divorce.
On citera volontiers à l’actif du régime impérial une nouvelle phase d’essor économique, pansant partiellement les plaies ouvertes par la Convention et le Directoire : création de bassins et de chantiers de constructions navales à Anvers, dans un but stratégique autant que commercial ; introduction à Gand de la technique de la filature mécanique, qui était jusqu’alors un secret et un monopole de l’Angleterre ; animation de l’industrie drapière verviétoise par, une amélioration sensible du cardage de la laine, due à un Anglais, John Cockerill. La métallurgie connut aussi un développement nouveau par le perfectionnement et l’accroissement des hauts fourneaux et par la participation intense de l’industrie des armes de Liège à l’équipement des armées françaises.
La Belgique fut à ce point intégrée à la France que ses citoyens servirent dans la plupart des régiments impériaux, en nombre variable, à l’exception de quelques corps composés à l’origine, vers 1804, d’une majorité de Belges. Les plus connus et les plus anciens parmi eux étaient le 112e régiment de ligne et le 27e régiment de chasseurs à cheval. La conscription fut appliquée en Belgique de la fin 1798 jusqu’en 1814. La situation se modifia profondément en 1814 par l’invasion étrangère, « libératrice », si l’on veut.
(p.188) CHAPITRE XXV La Belgique libérée
Le climat de 1814.
La Belgique semblait s’être accoutumée au régime impérial. Il en fut du moins ainsi aussi longtemps que l’Empire resta au sommet de sa gloire. Mais avec les événements d’Espagne, à partir de 1808 et la guerre de 1809, si victorieuse fût-elle, on sentit que quelque chose était fêlé. Puis survint en 1810 la reprise de la politique anticléricale marquée par la rupture entre Napoléon et le pape Pie VIII. Les besoins de la fiscalité se firent écrasants, et la conscription acheva de rendre l’Empire impopulaire. Aussi, lorsqu’en janvier 1814 les Prussiens pénétrèrent en Belgique, le premier sentiment fut-il de « libération » .
Alors qu’ Anvers, sous le commandement de Carnot, opposait une ferme résistance ; alors que le général Maison guerroyait encore en Flandre, les alliés se partagèrent l’occupation du pays par leurs troupes, et la Belgique, en quelques semaines, connut trois gouverneurs généraux, le duc de Beaufort, assisté de nobles belges, le baron prussien von Horst, le lieutenant général autrichien baron de Vincent au début du mois de mai 1814. Dans six départements, les préfets de l’empire furent remplacés par des intendants, tous Belges ; les départements des Forêts, de l’Ourthe et de la Meuse-Inférieure furent administrés directement par la Prusse, qui ne dissimulait pas ses intentions d’ annexer tous les territoires situés à l’ est de la Meuse. Enfin les cantons du sud : Walcourt, Dour, Merbes-le-Château, Beaumont, Chimay, dans le Hainaut actuel, Florennes, Gedinne et Beauraing dans le Namurois appartenaient juridiquement au territoire français.
La Belgique était devenue une « peau de chagrin », considérée comme pays plutôt occupé que libéré. Et de fait les exactions, réquisitions, (p.189) pillages, vols, violences, y furent nombreux, non pas du fait des Anglais, mais des Russes dans le Hainaut, l’Entre-Sambre-et-Meuse, à Marche et Saint-Hubert, et des Prussiens partout où ils étaient stationnés ou de passage. Les plaintes des autorités locales affluaient et leurs témoignages se complètent. Les Flandres connurent le même sort après le repli du général Maison sur Lille. Les autorités militaires étaient toutes-puissantes. On comprend que l’opinion publique, déçue dès l’abord, se soit exaspérée au fil des semaines et des mois. Cette opinion se partageait du reste entre les partisans du retour à l’ empire autrichien, ceux du rétablissement du régime français, ceux d’une indépendance pure et simple, alors que presque personne ne voulait d’une réunion avec la Hollande. Or c’est ce qui se produisit le 1er août. Le prince d’Orange reIilp1aça le gouverneur-général.
Malgré ces difficultés, les autorités alliées s’étaient attachées à rendre concrète la libération de la Belgique par la création d’une force armée nationale, la Légion belge, constituée en quatre régiments d’infanterie, un régiment d’infanterie légère, deux régiments de cavalerie et de l’artillerie. On n’y trouva que des chefs improvisés ayant servi l’Autriche, la Prusse ou l’Espagne. Parmi les milliers de soldats d’origine belge licenciés à la suite de l’abdication de Napoléon, le 5 avril, une minorité seulement prirent du service dans cette Légion belge. La plupart se montraient hostiles aux occupants, aux ennemis de l’empereur déchu.
Parmi les officiers placés en demi-solde, un certain nombre consentirent à prendre place dans la nouvelle armée belgo-batave en formation depuis le 1er août, sous la cocarde orange. Les Belges y constituèrent quatre bataillons d’infanterie de ligne, deux bataillons de chasseurs, un régiment de dragons légers et un de hussards. Il ne s’agissait plus de Belges, mais, dans l’appellation officielle, de Zuid-Nederlanders . On comprend assez mal, puisque cet « interrègne » a duré du début 1814 à juin 1815, qu’il se soit encore trouvé des Belges dans l’armée française, devenue l’armée de la Restauration. Et pourtant, après des recherches ardues, des historiens ont fixé le nombre d’officiers belges ayant combattu dans les rangs français à Waterloo entre deux cent cinquante et trois cents ; celui des sous-officiers et soldats ne peut être déterminé, mais certains estiment qu’il y en avait quelques milliers, répartis entre tous les régiments. Sans aller plus avant dans ces supputations, il est permis d’affirmer que la période (p.190) de l’agonie de l’empire a vu le « clivage » d’une petite partie des Belges entre les deux forces antagonistes » ce que le général Couvreur a appelé « le drame belge de Waterloo ». Mais le sort de la Belgique se jouait surtout ailleurs. Le premier traité de Paris (30 mai 1814) avait ramené la France à ses frontières de 1792, tout en lui laissant en Belgique les territoires de Beaumont et de Chimay. Cette relative générosité fut remise en question par le retour de Napoléon et sa défaite. Entre-temps l’Acte final de Vienne, signé le 9 juin 1815, avait notamment pris la décision capitale de constituer un seul royaume des Pays-Bas, associant la Hollande et la Belgique sous la dynastie d’Orange. La Belgique n’avait pas eu voix au chapitre, victime, une fois de plus de ses atermoiements et de son absence de personnalité politique réelle. Le second traité de Paris (20 novembre 1815) rendit au nouveau royaume Beaumont et Chimay, établissant ainsi la Belgique dans les frontières qu’elle conserva du côté de la France.
France et royaume des Pays-Bas
Les relations entre le nouveau royaume et la France de la Restauration ne pouvaient être, au début tout au moins, que de suspicion, puisque le premier servait en somme de tête de pont de l’ Angleterre. Tout changea une fois encore lorsque le congrès d’ Aix-la-Chapelle (septembre 1818) organisa l’évacuation anticipée du territoire français et admit la France comme cinquième membre du directoire de cet organisme international et conservateur que fut la Sainte-Alliance. Elle y fut associée à la Russie, à l’ Autriche, à la Prusse et à l’ Angleterre.
Les années 1820 et 1821 furent très agitées en Espagne, en Italie, dans les Balkans, en Amérique espagnole ou portugaise. La Sainte-Alliance intervint militairement en Italie (par les Autrichiens), en Espagne (par les Français); puis c’en fut fait de ce directoire ultra-conservateur et réactionnaire, après le retrait de l’ Angleterre.
Le royaume des Pays-Bas resta sagement à l’écart de ces troubles et de ces révolutions. Ce pays offrait même un curieux spectacle. Il eût été logique que le roi Guillaume Ier, bénéficiaire de la victoire des alliés sur Napoléon, dût en tout adopter une attitude réactionnaire, à l’instar de ce qui se passait dans les autres pays, France comprise. Or le roi des Pays-Bas s’entoura d’anciens fonctionnaires (p.191) de l’empire, reconnaissant leur efficacité dans l’administration, qui continua à s’inspirer des principes napoléoniens, c’est-à-dire obédience au souverain et responsabilité à l’égard de la nation. Il y eut certes des changements d’appellations, mais l’esprit resta. Beaucoup de ces agents étaient des libéraux anticléricaux. Or le principal opposant au régime hollandais était le clergé belge. Ceci explique peut-être un autre aspect de la politique de Guillaume. Tout comme les Pays-Bas ci-devant autrichiens avaient accueilli les émigrés pourchassés par la Convention, la Belgique hébergea les émigrés redoutant les foudres de la Restauration ; régicides et notables. Il se créa ainsi, à Bruxelles surtout, un centre vivant et animé où, à côté des Cambacérès, Sieyès, Martin et autres gros nantis de l’Empire, continuaient à mener grand train et s’agitaient les Vadier, Cambon, Rouyer de l’Hérault, etc., qui disposaient d’une presse à leur dévotion couvrant de sarcasmes « la réaction, l’obscurantisme, la Sainte-Alliance ».
Cette tolérance s’efforçait de tirer parti de leur anticléricalisme virulent pour neutraliser le clergé belge. Mais, contrepartie prévisible, Bruxelles allait devenir un foyer de propagande libérale où s’affirmera à la longue l’influence des opposants de Paris à la Restauration. Elle se confirma en 1824, avec l’avènement du roi Charles X, puis l’arrivée au pouvoir, en 1829, de Jules de Polignac, leader des “ultras », introduisant dans la politique étrangère française un rappel de l’ancien impérialisme dynastique. Polignac envisageait en effet un remaniement considérable de l’Europe, programme ambitieux dans lequel la France s’adjoindrait la Belgique et le Luxembourg ; la Prusse les provinces septentrionales (la Hollande), dont les riches colonies reviendraient à l’Angleterre. Celle-ci eut vent de ce projet et s’en inquiéta, bien qu’il fût chimérique, parce que la France se rapprochait de la Russie et amorçait la conquête de l’Algérie.
La révolution de Juillet à Paris, en chassant les Bourbons, lui enleva ce souci, tout en lui préparant d’autres.
(p.192) TITRE V La Belgique indépendante
CHAP. XXVI La révolution belge de 1830 et les interventions de la France
Les chefs de l’opposition constitutionnelle au gouvernement du royaume des Pays-Bas espérèrent que les contrecoups de cette révolution de Juillet amèneraient le roi Guillaume Ier à tenir compte de leurs griefs légitimes. Ce problème se référait uniquement aux relations entre Hollandais et Belges et à l’amélioration de la minorisation politique systématique de ces derniers. Mais l’occasion était belle pour les agents révolutionnaires français, libres d’agir dans Bruxelles, traditionnelle terre d’asile, centre cosmopolite, refuge des exilés contraints ou volontaires. Ils ne furent pas étrangers à l’émeute qui cristallisa les mécontentements à l’issue de la représentation houleuse de La Muette de Portici, au théâtre de la Monnaie, le 25 août 1830. Dans certains groupes on cria : « Imitons les Parisiens ». Nous ne développerons pas ici ces manifestations tournant à l’insurrection, dont Henri Pirenne a pu dire: « L’incapacité et la lâcheté des chefs de troupe a permis le succès d’une échauffourée qu’il eût suffi d’un peu d’énergie pour écraser”.
Le mouvement n’eut aucun chef au début, mais certains agents cherchèrent, comme il était naturel, à le canaliser au profit de la France. Le drapeau français fut déployé à l’hôtel de ville, mais des patriotes clairvoyants le remplacèrent aussitôt par les couleurs des États belgiques, nées de la révolution brabançonne. Il était temps, car, à l’étranger, l’exemple tout chaud encore des journées de Juillet à Paris, une suspicion tenace à l’ égard de la France accentuaient la (p.192) méfiance et l’hostilité inspirée par les événements de Bruxelles et de Liège.
Jusqu’au 11 septembre, des représentants de la bourgeoisie prirent la direction des événements et traduisirent leur hostilité aux étrangers en exigeant leur inscription sur les registres avant le 20 du mois. Conservateurs par nature, ils freinaient la démocratisation du mouvement. Mais des éléments plus dynamiques constituèrent un parti : Gendebien, Van de Weyer, le Liégeois Charles Rogier, à côté de Français: Lamarche, Mel1inet, ancien officier, Niellon, Chaza1, fils d’un ancien conventionnel, le chanteur Jenneva1, sans compter le Prussien Stildorf. Ces Français allaient devenir les agents actifs de la Révolution, mais d’une révolution belge, avec le concours des ardents Liégeois, oublieux de leur particularisme ancestral. On s’achemina ainsi vers les événements des 23, 24 et 25 septembre à Bruxelles, qui virent l’échec des troupes hollandaises et leur repli sur Anvers. Après cette première victoire, le gouvernement provisoire constitua des colonnes mobiles placées sous les ordres de deux Français, Mellinet comme général-major et Niellon comme colonel. Agissant l’un et l’autre avec habileté et souplesse, ils réussirent en quelques jours à refouler les Hollandais et à pénétrer dans la ville d’Anvers le 26 octobre, à la tête d’unités de partisans de plus en en plus individualistes et de plus en plus convaincus de leur supériorité foncière sur leur adversaire. Ces événements militaires n’intéressent pas directement notre sujet, mais l’état d’esprit des combattants de septembre aura une influence certaine sur les relations ultérieures avec la France.
La Révolution belge devait évidemment avoir des répercussions européennes ; elle détruisait l’oeuvre du traité de Vienne, qui avait voulu construire une barrière puissante, le royaume des Pays-Bas, contre les ambitions françaises. Le plus hostile parmi les partisans de ce traité fut le tsar Nicolas, convaincu déjà d’avoir fait aux idées révolutionnaires une concession excessive en reconnaissant le roi Louis-Philippe, héritier, selon lui, des traditions de la révolution de 1789, et résolu à étouffer le mouvement belge. Il y poussait le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume, qui n’éprouvait aucun désir belliqueux. L’Autriche connaissait de date les velléités d’indépendance des Belges et ses regrets étaient plutôt platoniques. L’Angleterre aurait dû être la plus directement intéressée au maintien du royaume des Pays-Bas, dont Wellington avait été le maître (p.193) d’oeuvre ; elle se trouvait donc confrontée à la France de Louis-Philippe. Ce dernier ne désirait nullement se mettre l’Europe à dos par une attitude tranchante, mais il tendait pourtant à retirer des avantages politiques de la situation nouvelle en Belgique, ou, tout au moins, de ne pas les abandonner aux autres. Il obtint de la Prusse un accord tacite sur le principe de la non-intervention, qui reçut aussi l’appui du parti whig en Angleterre, de tendance libérale. La situation du roi des Français était délicate, car les républicains de Paris réclamaient l’annexion pure et simple de la Belgique à la France. L’inusable Talleyrand, devenu le 25 septembre 1830 ambassadeur de France à Londres, chercha un compromis acceptable entre les tendances à l’ancienne théorie de la monarchie de droit divin (Autriche, Prusse, Russie) et des idées plus pragmatiques en ce domaine (Angleterre, France).
Voyons la marche des événements. Le gouvernement provisoire belge, créé le 25 septembre, convoque pour le 10 novembre un Congrès national, processus démocratique. Dans les premiers jours d’octobre, le roi Guillaume réclame l’intervention armée de l’Angleterre, de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie. Le Premier ministre Wellington, son ministre des affaires étrangères lord Aberdeen et l’ambassadeur Talleyrand se mettent d’accord sur le principe de la réunion d’une conférence européenne, ce qui constitue déjà en fait une reconnaissance implicite du fait belge. Le gouvernement anglais annonce cette conférence, le 17 octobre, pour le 4 novembre. Il propose, pour cette même date, au roi des Pays-Bas et aux « insurgés » belges une suspension des hostilités.
Exigeant un engagement des deux parties, cette intervention préparait à la fois un droit à l’arbitrage et la possibilité d’une mesure de coercition militaire. L’offre de suspension des armes, décidée le 15 novembre, renouvelée le 21, fut acceptée finalement par La Haye, le 26. Mais à cette date le Congrès national belge s’était réuni, avait proclamé, le 18, l’indépendance de la Belgique, adopté la monarchie comme forme de gouvernement, le 22 ; proclamé l’exclusion perpétuelle de la maison d’Orange, le 25. La suspension d’armes intervint donc dans une atmosphère plutôt orageuse ; si le royaume des Pays-Bas l’accepta, ce fut pour gagner du temps. Pris de court par les événements, il se mit à renforcer méthodiquement son armée. La situation s’aggrava aussi sur le plan extérieur ; la Russie était sur le point d’intervenir lorsque l’explosion violente de la révolution en Pologne, le 29 novembre, gêna fortement les trois (p.195) puissances copartageantes, Russie, Autriche et Prusse, et les tint un peu à l’écart de la conférence de Londres, dont les débats furent dès lors dominés par l’ Angleterre et la France.
La Belgique se préparait aussi à la lutte, mais sans esprit de suite, en lésinant sur les crédits, en accordant une confiance aveugle à la valeur des volontaires et de la garde civique, dans un climat belliciste qu’on a peine à s’imaginer dans la Belgique actuelle. Les négociations de Londres allèrent bon train. Le protocole du 20 décembre 1830, signé après une opposition acharnée de la Russie, admit le principe de l’indépendance de la Belgique, en l’assortissant d’une neutralité perpétuelle. Talleyrand devait en dire : « Les treize forteresses de la Belgique à l’ aide desquelles on menaçait sans cesse notre frontière nord tombent, pour ainsi dire, à la suite de cette résolution ». Les « bases de séparation » des 20 et 27 janvier 1831 stipulaient la neutralité imposée et sans dérogation, avec garantie (donc aussi droit d’intervention) des puissances ; adoption de la ligne séparant les provinces du nord et du sud en 1790, laissant aux Pays-Bas la Flandre zélandaise et l’embouchure de l’Escaut qui, du reste, avaient appartenu de tout temps aux Pays-Bas septentrionaux, plus d’anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg et le Luxembourg ; elles limitaient la liberté de navigation des Belges sur l’Escaut.
Le royaume des Pays-Bas accepta ces « bases » ; la Belgique les rejeta, bien qu’elle ne possédât pas les moyens de cette politique d’obstination. La France avait renoncé à toute idée d’intervention dans ses affaires, car il était clair que les autres puissances lui refuseraient de reprendre pied, sous une forme quelconque, en Belgique.
Celle-ci devait se trouver un roi. On avait songé à Charles d’Autriche, au prince Léopold de Saxe-Cobourg (déjà), mais les deux candidats les plus notoires étaient le duc de Nemours (âgé de seize ans), fils de Louis-Philippe, donc suspect à l’Angleterre, et le duc de Leuchtenberg (vingt ans), fils d’Eugène de Beauharnais, donc suspect à la France. Pour éviter l’élection de ce dernier, le gouvernement français laissa croire qu’il accepterait celle du duc de Nemours, mais, lorsque le Congrès, ainsi induit en erreur, choisit ce dernier le 3 février 1831 , Louis-Philippe refusa cette couronne pour son fils.
(p.200) …, en 1833, sur un total de deux mille quatre cent sept officiers il n’y avait que cent quarante-huit étrangers, dont cent quatre Français, trente-quatre Polonais et dix Allemands. Ils quittèrent peu à peu une armée inhospitalière ; il n’en restera que vingt-trois en 1837. Mais leur présence suffisait à alimenter la mauvaise humeur des militaires belges, et l’homme d’État Lebeau écrivait en septembre 1840 à un ami anglais : « Je vous dis que l’esprit anti-français est tel dans notre armée que vous allez voir allumer des feux de joie quand les officiers français se retireront du service ». L’année 1835 avait été spécialement virulente à cet égard, par le fait d’une feuille satirique venimeuse, Méphistophélès. Elle le fut à un point tel que les officiers de la garnison de Metz et ceux de villes de la frontière nord, émus par les échos, peut-être exagérés, de cette tension, voulurent aller en corps en Belgique pour les contrôler sur place et protéger leurs compatriotes et collègues. On eut beaucoup de peine à les calmer. On reprochera à bon droit à la Belgique et à son armée une ingratitude foncière envers la France, une véritable xénophobie, bizarrement exprimée dans la feuille le Lynx : « La France nous aime trop pour que nous puissions l’aimer » . Cette phrase remet du reste les choses dans une perspective plus exacte : l’excès d’intérêt que portait la France à la Belgique suscitait la méfiance d’une large partie de l’opinion publique. On n’était pas tellement loin de l’époque révolutionnaire et impériale. Et pourtant la France de Louis-Philippe ne pouvait provoquer aucune inquiétude. L’acceptation résignée du protocole final scellant l’abandon du Limbourg oriental et du Luxembourg oriental avait ramené la paix avec les Pays-Bas (19 avril 1839).
(p.204) /1848/
… ; les méfiances s’éveillèrent aussitôt dans les milieux politiques belges, qui connaissaient les tendances annexionnistes de ceux qui venaient de conquérir le pouvoir. Lamartine, ministre des affaires étrangères, fournit des assurances apaisantes, mais des forces obscures s’agitaient, en dehors du gouvernement français. Dans l’histoire de la Belgique, les événements de 1848 se ramènent à une échauffourée militaire qui se termina lamentablement pour les militants français. Ces derniers étaient armés de fusils qui ne pouvaient sortir que des arsenaux, grâce notamment à la complicité du commissaire de la république à Lille. Une première bande put s’embarquer dans un train qui, arrivé à Quiévrain, première gare en territoire belge, fut arrêté et encerclé par un bataillon de l’armée régulière (le 2 mars). La tentative fut reprise le 27 mars ; un groupement de mille deux cents hommes, commandé par des polytechniciens, se heurta à une fraction de brigade belge en un lieu-dit qui, dans ces circonstances, a tout l’air d’un « canular » : Risquons-Tout. On n’y risqua pas grand-chose, car une salve de l’infanterie et deux obus à mitraille dispersèrent les assaillants et ruinèrent – provisoirement – les tentatives d’annexion. La conséquence la plus curieuse de ces événements est que l’inquiétude du gouvernement belge fut partagée par le gouvernement hollandais ; que les deux souverains échangèrent des messages amicaux scellant un rapprochement entre les deux pays, naguère encore adversaires. Tous deux avaient fourni un remarquable exemple de stabilité politique dans la tourmente révolutionnaire européenne.
Mais de nouvelles inquiétudes seraient bientôt provoquées par l’accession à la présidence de la IIe République du prince Louis-Napoléon, dont l’ambition personnelle coïncida pendant quelque temps avec les vues des révolutionnaires. Cela changea par le vote de la loi Falloux (16 mars 1850), qui ramenait l’État sous la coupe de l’Église, par le truchement de la réforme de l’enseignement. Or, en 1848, le parlement belge comptait quatre-vingt-cinq libéraux et seulement vingt-trois catholiques. Le gouvernement Frère-Orban, nettement anticlérical, fermait les portes des écoles à l’influence religieuse. Il devait logiquement en résulter un courant de sympathie du clergé belge vers la France, et plus spécialement vers le prince Louis-Napoléon. Le cabinet libéral belge fut dès ce moment l’objet de vives attaques dans la presse officieuse française.
(p.206) … /coup d’État du 2 décembre 1851: accueil de Hugo, de Quinet, …/
Aussitôt les feuilles officieuses de Paris se déchaînèrent contre la presse belge» qui publiait les écrits, souvent violents, de ces émigrés ; contre le gouvernement libéral et les institutions du pays dont, affirmait le Constitutionnel, le maintien entraînerait une guerre des tarifs. Le 22 août 1852, une convention belge consacra le principe de la propriété artistique et littéraire et rendit désormais impossible sans sanction la « contrefaçon » qui sévissait en Belgique. Malgré cette importante concession, la France supprima le 14 septembre le régime de faveur accordé sous Louis-Philippe aux houilles et fontes belges.
Ce moyen de pression obtint un résultat : le parlement belge vota une loi sur la presse réprimant « l’injure » les attaques méchantes ». La voie fut ainsi rouverte à des négociations qui débouchèrent sur la convention du 27 février 1854 ; elle adoucissait légèrement le protectionnisme de la France à l’égard de la Belgique.
Les relations entre les deux pays se détendirent, mais pas pour longtemps. Lorsque le congrès de Paris de 1856, réglant la question d’Orient, après la coûteuse guerre de Crimée, consacra le prestige de Napoléon III, les attaques reprirent contre la Belgique, « où l’on prêchait ouvertement la révolte et l’ assassinat » et dont le gouvernement était impuissant à contrôler l’activité des émigrés en 1851.Les représentants de la Prusse et de l’ Autriche se joignirent à cette condamnation de la presse subversive, déclarant que la répression de celle-ci était un « besoin européen »» alors que le délégué britannique ne pouvait s’associer à des menaces de coercition contre la presse d’un autre État.
Le ton des feuilles françaises est donné par ces lignes du fougueux Émile de Girardin : « Cest de Bruxelles que partent toutes les provocations, tous les pamphlets, toutes les injures, toutes les calomnies écrites ou imprimées dont la France est parfois inondée…
C’est à Bruxelles qu’est le refuge de tous les mécontents, de tous les proscrits de l’opinion publique. C’est de la fausse liberté que celle qui permet à un pays d’être le réceptacle de tous les ennemis de l’ordre, de l’autorité et de la société. »
Interpellé le 7 mai 1856, le ministre belge des affaires étrangères, le comte Vilain XIIII, refusa en termes catégoriques de proposer des amendements à la Constitution qui eussent limité la liberté (p.207) d’expression ; il fut accueilli par « une longue acclamation, un élan indescriptible ».
Les réactions en France nous paraissent être bien résumées dans cet extrait d’un article du Pays : « Il s’agit simplement de savoir si la Belgique doit être plus longtemps un repaire de bêtes fauves qui ont soif du sang des rois et des dépouilles des peuples. » L’orientation politique de la France envers la Belgique se fit plus dangereuse à partir de 1857. En1858, Napoléon III dit à la baronne Bayens, épouse du ministre de Belgique à Paris, en manière de boutade : « La Belgique est une poire mûre qui nous tombera quelque jour dans la bouche. Elle alors de lui répliquer : « Puisse-t -elle alors vous étrangler, Sire. »
C’est à l’occasion des nouvelles mesures de défense de la Belgique que l’intrusion du gouvernement impérial se précisa dans les affaires intérieures belges. Il était question de transformer Anvers en un camp retranché, qui serait le réduit de la Belgique. Déjà, en 1853, l’empereur s’était de la démolition des vieilles places fortifiées d’Ath et de Philippeville servir « qui pouvaient servir de points d’appui à nos armées dans le cas où… je me verrais obligé de pénétrer sur votre territoire.” La presse parisienne entreprit donc en 1858 d’expliquer aux Belges que ces projets d’Anvers étaient « inutiles et dangereux», qu’ils pourraient un jour « faire éclater la foudre sur le pays” (le Constitutionnel) , qu’en décrétant de grands travaux militaires, “un pays appelait sur lui les dangers mêmes qu’il avait en vue de conjurer » (la Patrie). »
En 1859, cette presse se déchaîna, et Girardin écrivit : “La neutralité de la Belgique, nous disait-on, est un boulevard qui assure la sécurité de la france. On vient de voir ce que valent ce boulevard et cette garantie ». L’Indépendance belge, journal pourtant favorable à la France, y réagit avec vigueur : « Est-ce que nous avons jamais fait partie de la France autrement que par la conquête et imperceptible période de notre histoire. » On ne peut douter que la méfiance régnât dès cette époque dans les milieux politiques belges.
L’année 1860 vit débuter une intense campagne annexionniste, faisant appel à tous les arguments de l’histoire, de la géographie, de la politique, de l’identité de langue (en ignorant, bien entendu, le fait flamand), et surtout du thème des frontières naturelles. (p.208) La presse française prôna une « rectification de frontière » qui serait ratifiée par « le consentement populaire ». Le gouvernement impérial opposa un démenti à ces revendications, le 31 mai 1860. Le roi Léopold 1er avait prévu ces sautes d’humeur. Il écrivait le 4 février 1859 à sa nièce, la reine Victoria : « Les cieux seuls savent à quelle danse notre empereur Napoléon, troisième du nom, nous conduira… Pour nous, pauvres gens qui nous trouvons aux premières loges, ces incertitudes sont bien peu agréables. »
En 1860, l’autoritarisme impérial commença à se libéraliser quelque peu : les grandes guerres de Crimée et d’Italie avaient pris fin et assis le prestige de Napoléon III. Il allait y substituer les intrigues diplomatiques, les négociations secrètes et les marchandages fondés sur la théorie des frontières naturelles. C’est-à-dire, au premier chef, le Rhin et les provinces rhénanes où s’exerça une vive propagande française. En juin 1860 l’empereur rencontra à Bade le prince-régent de Prusse et plusieurs souverains allemands ; il y parla de la Belgique, et le régent lui rétorqua que ce pays était l’ avant-garde de la Prusse (tout comme elle l’était de la France); « qui toucherait à la Belgique toucherait à la Prusse ».
La hargne officielle à l’égard de la Belgique était partagée par nombre de proscrits du coup d’État de 1851, réfugiés dans ce pays. L’un des plus connus, le théoricien socialiste Proudhon, écrivit à Nopoléon III : « Osez, Sire, et cette France teutonique est à vous. La Belgique vous attend. » Et de fait, une partie de la presse catholique belge décernait des éloges à l’empereur ; le comte de Montalembert, fervent catholique, mais libéral convaincu, reprochait à ces journalistes « de se montrer empressés à devenir ses sujets. »
En 1863, le gouvernement impérial suggéra à l’Autriche un curieux marchandage : l’Autriche accepterait la création d’un royaume de Pologne, céderait la Vénétie à l’Italie et recevrait en compensation la région du bas Danube. La Prusse absorberait le Hanovre et d’autres États allemands, mais elle abandonnerait la rive gauche du Rhin, constituée en royaume pour la dynastie belge. La Belgique serait partagée entre France et Hollande.
La Belgique ne restait pas indifférente à cette agitation. Le professeur Trasenster, de l’université de Liège, y consacra un livre : La Belgique et l’Europe, ou la frontière du Rhin ; des journaux rappelèrent les fâcheux souvenirs de la domination française ; on annonça (p.209) la création d’une association patriotique, les Ruwaerts, se donnant comme mission de « signaler à temps au pays les dangers dont il est menacé et de stimuler le patriotisme des masses. » En France, le régime procédait à la mise en condition de l’Opinion publique. En 1864, l’Académie française couronna un ouvrage, les Frontières de la France, salué avec enthousiasme ; cet ouvrage critiquait la création d’une Belgique indépendante, voyait dans le roi des Belges une sorte de « préfet anglais», dans le camp retranché d’ Anvers « une citadelle de la Coalition »; dans la neutralité belge, « une chose chimérique et impossible »; dans les frontières naturelles de la France « le gage de la paix du monde».
Lorsque les élections anticipées de 1864 ne laissèrent au parti libéral, jusqu’alors tout-puissant en Belgique, que deux voix de majorité, l’étranger se demanda si la nationalité belge pourrait résister à la tempête entre les partis. Or Léopold II succéda à son père -mort le 10 décembre 1865 – sans rencontrer une réelle difficulté.
La Prusse venait d’opérer une rentrée à grand fracas sur la scène européenne par la guerre des Duchés contre le Danemark, en 1864, et avait acquis le Schleswig et le Holstein. Napoléon III estima avoir droit à une compensation. Il laisserait les mains libres à la Prusse à la condition que celle-ci, d’ accord avec la Russie, favorisât les vues de Napoléon III en Italie et donnât à la France une compensation du côté du Palatinat. Ce fut l’objet d’une entrevue entre l’empereur et le chancelier von Bismarck, à Biarritz. Ce dernier continua sur sa lancée, et ce fut l’étonnante victoire de Sadowa sur l’Autriche, en 1866. La surprise fut grande pour l’empereur, qui croyait en un conflit prolongé et indécis, en la nécessité d’un arbitrage de la France, assorti d’un honnête courtage.
Pendant que les préliminaires de paix se discutaient, sans elle, à Nikolsburg, la France réclama « des compensations propres à accroître sa force défensive », c’est-à-dire, en clair, la rive gauche du Rhin. Bismarck y opposa un refus fort net, le 7 août 1866. Napoléon fit alors adresser à son ministre à Berlin, Benedetti, des instructions formelles : « Demander à la Prusse un traité « ostensible » attribuant à la France, au minimum, le Luxembourg ; un traité secret valant alliance offensive et défensive ; la faculté pour la France de s’annexer la Belgique au moment jugé opportun ; la promesse par la Prusse d’appuyer cette politique, même par les armes. »
Benedetti rédigea donc un projet de convention dans ce sens et (p.209) commit la maladresse de le laisser entre les mains de Bismarck, sur la demande de ce dernier.
Tout ceci resta évidemment secret, mais les alarmes de la presse belge, sinon d’une opinion publique plutôt endormie, étaient ravivées périodiquement. Ce fut encore le cas en septembre 1866, avec une circulaire du cabinet des Tuileries donnant forme officielle à la théorie des « grandes agglomérations », à l’impossibilité de survie des États secondaires, à l’affirmation de la thèse des frontières naturelles. Les journaux français redevinrent agressifs.
La voix d’un poète se mêlait curieusement à ces attaques. En 1866, Charles Baudelaire, alors âgé de quarante-cinq ans, aigri par l’échec de ses conférences en Belgique, par l’incompréhension d’un public encore « béotien », et miné par une maladie qui précipitait ses crises, publia des poèmes injurieux pour tout et pour tous, y compris pour les souverains belges. Il les réunit un peu plus tard sous un titre suggestif : Amenitas Belgicae. Extrayons-en cette épitaphe, où l’on cherche en vain l’auteur des Fleurs du Mal.
On me demande une épitaphe
Pour la Belgique morte. En vain.
Je creuse, et je rue, et je piaffe.
Je ne trouve qu’un mot : Enfin.
Des historiens récents veulent voir en Napoléon III un esprit pénétrant et quelque peu prophétique dans le sens européen ; il est possible qu’il ait vu clair dans les affaires du Moyen-Orient et d’Algérie, mais ses vues « européennes » coïncidaient avec le vieux rêve d’expansion territoriale. Napoléon III, de caractère obstiné, ne l’abandonna jamais.
La presse officieuse parisienne continua son oeuvre de mise en condition de l’opinion publique. Une occasion se présenta alors d’arrondir de façon pacifique et politiquement indiscutable le territoire français, non pas en Belgique, mais dans le grand-duché de Luxembourg. Rappelons que ce dernier avait été concédé par les traités de 1839 au roi des Pays-Bas, mais à titre personnel, et non pas comme une province relevant du royaume. La Confédération germanique y entretenait une garnison dans la citadelle de Luxembourg. Or le roi des Pays-Bas se trouvait en mal d’argent, et, fort habilement, le gouvernement impérial lui offrit de lui acheter le grand-duché, comme on acquiert une propriété privée. Dès que ce projet fut connu – car il ne pouvait évidemment rester secret – , le gouvernement belge conçut de nouvelles craintes, (p.211) car, comme le dira plus tard l’ambassadeur Benedetti : « Une fois à Luxembourg on serait sur le chemin de Bruxelles ; nous y arriverions plus vite en passant par là. » Le journal officieux français le Pays du 24 mars publia froidement un article intitulé : « L’annexion de la Belgique », où il était affirmé que tous les Belges, sauf cent mille électeurs censitaires, attendaient avec joie leur réunion à la France.
Le roi Guillaume III, qui avait besoin d’argent, fut alléché par cette offre, mais hésita par crainte de la Prusse. Devant la levée de boucliers il estima prudent de sonder les intentions de Bismarck. Ce dernier, qui voulait amener Napoléon III à se compromettre ouvertement, se montra favorable au projet, dont la rédaction fut achevée fin mars 1867. Lorsque le gouvernement français eut annoncé ce grand succès diplomatique, Bismarck recourut à une manoeuvre qui deviendrait classique par la suite : il se fit interpeller au Reichstag par M. von Bennigsen, qui se fit le porte-parole de l’indignation allemande. Bismarck y répondit que la question ne pourrait être réglée sans l’assentiment des puissances signataires des traités de 1839.
Le roi des Pays-Bas renonça à l’affaire. La Belgique entra alors en scène, car certains hommes d’État, nostalgiques de 1831, notamment Charles Rogier, alors ministre des affaires étrangères, crurent le moment favorable pour la récupération du grand-duché. Cette politique pouvait provoquer de nouvelles complications avec le régime impérial.
À la mi-avril, l’Autriche suggéra la cession du Luxembourg à la Belgique, contre celle à la France des cantons compris dans les frontières françaises de 1814, soit cent cinquante mille habitants. La Belgique repoussa l’idée d’une telle transaction, mais en retint la possibilité d’un rachat. Finalement, le souci de ne pas pousser à bout le nationalisme allemand (car le grand-duché faisait alors partie du Zollverein), et celui de ne pas trop irriter Napoléon III, de ne pas se brouiller avec le roi des Pays-Bas, de ne pas rouvrir les traités de 1839, fit renoncer à un projet qui n’intéressait guère les Grands-Ducaux, premiers concernés. L’Autriche intervint une fois encore, et ses propositions provoquèrent la réunion d’une conférence à Londres, le 7 mai ; elle associait les États signataires des traités de 1839. La Belgique n’y montra pas beaucoup de fermeté, ligotée par son statut de neutralité. Elle n’eût accepté le grand-duché qu’offert par toutes les puissances. Il n’en était pas question. Le 11 (p.212) mars 1867, le traité de Londres régla le problème. Le Luxembourg serait érigé en un grand-duché indépendant et neutre, sous la garantie des puissances signataires ; la Prusse évacuerait le territoire, et la forteresse de Luxembourg serait démantelée.
Il restait à la France un moyen d’opérer une mainmise détournée et partielle sur le grand-duché. Le 21 janvier 1868, la Compagnie (française) des chemins de fer de l’Est signa une convention par laquelle elle prenait à son compte pour une durée de quarante-cinq ans l’exploitation des chemins de fer concédés à la société grand-ducale Guillaume-Luxembourg, tant dans le grand-duché qu’en territoire belge. Le gouvernement grand-ducal avait été tenu à l’écart de ces négociations, alors que l’État français accordait sa garantie assortie de son droit de contrôle, à la Compagnie de l’Est. Or la Compagnie Guillaume-Luxembourg avait concédé à deux sociétés belges (avec capitaux anglais) deux réseaux importants : à la Grande Compagnie du Luxembourg (belge), la ligne Pepinster, Spa, Stavelot, Gouvy, Luxembourg ; à la Compagnie du Liégeois-Luxembourg, la ligne Liège, Tongres, Hasselt, vers la Hollande. De plus le Grand-Luxembourg exploitait la ligne axiale Luxembourg, Marloie, Namur, Bruxelles, et la ligne Marloie-Liège.
La Compagnie de l’Est ne tarda pas à revendiquer la prise en charge de cet important réseau en territoire belge. Les négociations pour le rachat aboutirent en janvier 1869, avec extension de la garantie de l’État français, au territoire belge. Le gouvernement belge comprit le danger, à la fois économique et stratégique ; il agit avec décision. La Chambre adopta par soixante et une voix contre seize et deux abstentions un projet de loi affirmant que les chemins de fer appartiennent au domaine public national et ne peuvent être concédés à des intérêts privés étrangers. La presse française entra une fois de plus en action, accusant la Belgique d’une entente avec la Prusse. Napoléon III écrivit à son ministre de la Guerre : « Dans le cas présent, si une guerre avait lieu avec la Belgique, l’Allemagne n’aurait aucun droit de s’ en mêler. Et si elle s’en mêlait, c’est elle qui serait le provocateur. » En réponse à cette campagne d’intimidation, l’opposition catholique du sénat belge joignit ses voix à celles du parti libéral au pouvoir pour voter à l’unanimité moins sept abstentions la loi du 23 février 1869.Le Premier ministre belge Frère-Orban se rendit néanmoins à Paris pour y négocier des questions économiques, et l’empereur en (p.213) profita pour lui suggérer une union politique entre France et Belgique. Ce fut un nouvel échec, avec l’appui de Londres au gouvernement belge.
La neutralité à toute épreuve
Il ne peut être question de refaire ici, même en bref, le procès des responsabilités, lointaines ou immédiates, des deux adversaires dans la guerre de 1870. Il semble clair que Napoléon III était ulcéré par ses échecs diplomatiques et manoeuvré par un entourage partisan d’une grande explication ; que Bismarck voulait, lui aussi, une guerre destinée à consolider les États allemands et à leur faire accepter la prédominance de la Prusse. La France se trouva isolée, et la Prusse bénéficia de la neutralité bienveillante de la Russie, comme de l’Angleterre, et de la passivité de l’Autriche.
Le gouvernement impérial déclara la guerre le 17 juillet 1870. Le 25 juillet, le Times publia le projet de traité secret remis imprudemment par Benedetti à Bismarck, en 1866. Ce projet d’annexion de la Belgique produisit l’effet d’une bombe. L’Angleterre intervint avec énergie pour obtenir des deux belligérants le respect de la neutralité belge. Elle proposa aussi aux pays neutres de s’engager à le rester pendant toute la durée des hostilités.
Quel avait été le rôle de la Belgique? Alors que la France et la Prusse se dressaient l’une contre l’autre, à cause de la candidature d’un Hohenzollern au trône d’Espagne devenu vacant, le comte de Flandre, Philippe, beau-frère de ce candidat, et le roi Léopold II étaient intervenus discrètement pour l’en dissuader. Trop discrètement sans doute, puisque certains journalistes français, et notamment Cassagnac, avaient attaqué une fois de plus le roi des Belges, en l’accusant d’être à l’origine de l’intrigue. Et Emile de Girardin voyait déjà dans la victoire par les armes le moyen pour la France de retrouver ses « frontières naturelles ».
L’évolution des événements eut une influence sur le comportement de l’armée belge. Elle fut mobilisée dès le 15 juillet, à un moment fâcheux de la vie politique du pays, car il y eut en trois mois deux élections législatives et un changement de gouvernement. Cette armée prit tout d’abord une position centrale qui répondait à l’incertitude au sujet de l’agresseur éventuel. Il fallait passer des trente-sept mille quatre cent soixante-seize hommes du pied de paix à quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois (p.214) hommes ; de deux mille neuf cent trente-cinq officiers à trois mille quatre cent six ; on constata un déchet de trente et un pour cent. Une armée dite d’« observation », forte de deux corps d’armée, cinq divisions d’infanterie, quatre brigades de cavalerie, une réserve d’artillerie ; une armée dite « d’ Anvers » (vingt-sept mille hommes) et les garnisons des places de sûreté (Termonde, Gand, Diest, Liège, Namur) constituèrent les « forces » belges.
L’armée d’observation envoya des détachements du génie pour préparer des destructions (quinze à la frontière sud, quatre à la frontière est, deux à la frontière nord : notons la disproportion).Des régiments d’ avant-garde furent installés à Charleroi, Namur et Liège, le gros étant déployé sur une ligne Wavre, Waremme, Saint-Trond. L’inquiétude s’apaisa lorsque les opérations se déroulèrent en Lorraine, mais l’arrivée au pouvoir du général comte de Palikao la réveilla. Le 22 août la guerre se déplaça vers les Ardennes françaises et le dispositif belge fut poussé plus au sud, sur la Sambre, sur une ligne Paliseul, Saint-Hubert, Marche, Ciney, dans les Ardennes belges, et sur la Meuse entre Namur et Liège.
Le danger se précisa le 31 août ; les troupes belges se déployèrent à proximité de la frontière, sur un alignement Beauraing, Gedinne, Florenville, Arlon, et, dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, entre Philippeville et la rivière Eau-Blanche. Elles avaient pour consigne de respecter scrupuleusement les règles de la neutralité : accueillir et secourir les réfugiés fuyant les représailles prussiennes; désarmer les bandes de francs-tireurs ; barrer le passage à un corps de troupe organisé ; exiger son retrait volontaire ou lui faire déposer les armes et l’interner; s’il était poursuivi, s’interposer entre les belligérants, repousser par la force ceux qui ne voudraient pas se retirer. Si un conflit éclatait entre les Belges et l’un des belligérants, l’autre ne pourrait intervenir que si les premiers étaient impuissants à faire eux-mêmes respecter leurs droits. De telles instructions, fort nuancées, exigeaient des exécutants diplomatie et sang-froid.
Par bonheur, tout se passa sans incident marquant, sauf la pénétration, à Pussemange, d’un détachement de cuirassiers français, sans autre suite qu’une protestation diplomatique de Bruxelles. Les deux adversaires reconnurent du reste « la correction et la rigidité » du service chez les Belges.
La Belgique accueillit et interna des milliers de soldats français, (p.215) secourus par des âmes charitables, qui les gâtèrent au point de provoquer l’amertume des soldats belges, si dédaignés dans leur propre pays. Les officiers restèrent prisonniers sur parole. Les blessés, français et prussiens, furent soignés dans infirmeries improvisées, notamment au château royal de Ciergnon.
Il y eut aussi les réfugiés venant des départements envahis ; d’autres, par un renversement des choses, remplacèrent les proscrits du Second Empire par les dignitaires impériaux, parmi lesquels Cassagnac, auteur de tant de textes injurieux pour la Belgique. Quelques Parisiens fuirent la ville assiégée pour vivre confortablement dans un où ils manifestèrent un chauvinisme arrogant.
Une fois de plus, la Belgique, de tolérance, vit se manifester, sans pouvoir y mettre des intrigues bonapartistes, des attaques contre l’Allemagne, des campagnes en faveur de la maison d’Orléans. La presse belge se divisa et la véritable neutralité y fut moins bien représentée que les partisans de la Prusse et surtout ceux de la France. La neutralité était décidément fort malaisée dans la pratique de tous les jours, et les journaux allemands s’en prirent avec véhémence aux Belges pour leurs sympathies affichées envers la France, sympathies assez curieuses au demeurant si l’on songe aux inquiétudes provoquées par le régime impérial.
L’armistice, conclu le 29 janvier un réel soulagement au roi Léopold II, inquiet de l’attitude triomphante de Bismarck et de l’affirmation d’un pangermanisme naissant. Sur le plan militaire, l’évolution permis de dissoudre l’armée d’observation, dès 1870. Lorsque les hostilités se déroulèrent dans la région de la Somme, le commandement belge étendit la surveillance de la frontière jusqu’à Tournai. Il réunit en décembre un corps de troupe à Courtrai. L’armée fut remise sur le pied de paix, le mars 1871. La crise était terminée.
(p.216) CHAPITRE XXIX Le difficile équilibre de la neutralité
Avec l’avènement de la IIIe République succédant au Second Empire, tout danger d’impérialisme disparut au sud, et, si une menace allemande était potentiellement possible, elle ne s’affirmait pas encore. Il semble donc que la Belgique pût alors enfin connaître un climat de totale sécurité en restant attachée au statut de neutralité imposée et garantie par les traités de 1839, qui lui avait épargné les vicissitudes de la guerre en 1870-1871. Cest précisément là que se situe la cause de l’impréparation militaire du pays lorsque surgira la crise. Le moment nous semble venu de préciser en quelques lignes les tendances caractérielles du Belge moyen, vues par deux hommes d’État belges, le libéral Paul Hymans et le catholique Carton de Wiart. Il est « réaliste et positif, peu facile à émouvoir, se défiant de l’enthousiasme (donc aussi du chauvinisme), par prudence, froideur de tempérament, par lenteur d’esprit, par crainte du ridicule », mais « robuste, capable d’effort, énergique dans l’action ». Il est aussi individualiste à l’excès ; son sentiment national est tiède, donnant une impression d’indifférence, « non seulement dans la masse de l’opinion », estime Carton de Wiart, «mais même dans les élites sociales, pour les leçons de notre histoire ». Un « respect humain » mal compris réduisait le patriotisme belge à de timides déclarations officielles pour cérémonies ou anniversaires publics ».
Ces jugements devront être révisés par la suite, mais ils sont exacts à l’époque considérée ; il est peu agréable de le constater, d’autant plus que cette passivité de l’opinion publique provoquait chez nos grands voisins du dédain et de la méfiance. Cette opinion (p.217)
aurait dû être alertée par la montée des périls extérieurs, que jalonnèrent plusieurs incidents graves . Tanger en 1905, Bosnie-Herzégovine en 1908, Agadir en 1911. Mais l’antimilitarisme foncier de la grande majorité de l’électorat censitaire y restera sourd jusqu’en 1909, malgré les efforts inlassables d’un souverain lucide, Léopold II.
La Belgique vit et prospère en vase clos, et c’est presque contre elle tout d’abord, à tout le moins sans elle, que Léopold II tentera puis réussira la grande aventure congolaise. Citons-en brièvement les phases.
1876 : réunion à Bruxelles, à l’initiative du roi des Belges, d’une « Conférence géographique internationale » ; création d’une « Association internationale africaine pour l’exploration de l’Afrique centrale et la répression de la traite des Noirs ». Léopold II s’acquiert les services de l’Anglais Stanley, non écouté dans son pays, et dont les explorations célèbres du fleuve Congo coïncident avec celles de l’Italien Savorgnan de Brazza pour la France, en Afrique équatoriale, jusqu’au même fleuve Congo.
- Léopold 11 crée l’Association internationale du Congo ; il se heurte à l’opposition du Portugal, qui revendique ses droits historiques sur l’embouchure du fleuve ; de l’Angleterre, dépitée d’avoir manqué une aussi belle occasion coloniale ; mais aussi de la France, qui conteste, sur le plan juridique, les contrats signés par Stanley avec les chefs indigènes.
Il faudra toute l’habileté du roi, exploitant ces divergences de vues, pour faire reconnaître par la conférence de Berlin (1885) un État indépendant du Congo, dont il devient le souverain à titre personnel, en attribuant à la France un droit de préemption sur cet État si le roi venait à y renoncer pour une raison quelconque. La Belgique officielle ne fut pas impliquée dans cette entreprise, à laquelle participèrent des capitaux privés et des officiers, des sous-officiers et des civils techniciens recrutés par volontariat en Belgique et dans d’autres pays, surtout scandinaves. Il n’en resta pas moins une suspicion venant s’ajouter aux autres. Lorsque le lieutenant général Brialmont, éminent ingénieur militaire, de réputation européenne, fit campagne pour fortifier Namur et Liège, la presse française y vit une connivence de la Belgique avec l’Allemagne, et la presse allemande réagit de même lorsqu’il fut décidé que ces nouveaux forts seraient partiellement armés de canons français. On peut comprendre qu’une certaine méfiance ait régné dans les sphères (p.218) gouvernementales françaises, car on ne pouvait y ignorer l’action du ministre belge à Berlin, le baron Greindl, en poste de 1888 à 1912. Habile négociateur, mais admirateur convaincu de l’empire allemand, il était tout disposé à justifier dans ses dépêches les manoeuvres de Guillaume II et celles de la Triple Alliance, à affirmer les intentions pacifiques du Kaiser. Il conserva sa confiance à l’Allemagne jusqu’en 1911, et suggéra alors qu’en cas de conflit, la Belgique choisisse ses alliés ; elle en a le droit absolu et, si elle ne l’a pas, elle doit se l’arroger ».
Revenu de Berlin en 1912, le baron Greindl resta un conseiller influent des autorités dirigeantes. Ajoutons-y que le ministre de France à Bruxelles, Klobukowski, ne recevait pas les mêmes égards que son collègue allemand ; il était tenu quelque peu à l’écart de la haute société, pour des raisons personnelles sans doute, mais qui nuisaient aux bonnes relations entre la France et la Belgique.
On constate à cette époque un net «clivage » entre les sympathies pro-françaises et pro-allemandes. À partir de 1905, l’Allemagne était devenue le principal partenaire commercial de la Belgique ; son emprise sur la vie économique belge était accentuée à un point tel qu’il existait une implantation de cinquante-sept mille ressortissants germaniques, avec tout ce qu’elle suppose d’organisation, surtout à Anvers. Ils avaient acquis les sympathies des milieux commerciaux et scientifiques, des éléments conservateurs de la noblesse, comme aussi des militants du flamingantisme, sans toutefois qu’il y eût coordination entre ces derniers et le pangermanisme. Tous ceux qu’effrayaient certaines tendances en France : l’indifférentisme en matière religieuse, les soubresauts de la IIIe République, le boulangisme (1887- 1889), le scandale de Panama (1889-1890), l’ affaire Dreyfus (1894- 1899), la séparation de l’Église et de l’État, penchaient vers l’Allemagne, considérée comme une nation chrétienne et pacifiste ». On ne pourrait mieux résumer la situation que par cette réflexion du roi Léopold II à Bülow. « Toute la Belgique est sous l’influence de la civilisation française…, mais les Belges sont beaucoup trop froids et trop raisonnables pour que cela influe sur leur politique ; ils ont plus de confiance dans l’Allemagne que dans la France. La peur d’être envahis et avalés par la France est ancienne, répandue partout, et accrue encore dans ce pays très (p.219) catholique par les tendances anticléricales de la République française. »
Néanmoins, l’influence française restait grande, non seulement dans le domaine de la culture, mais aussi dans les milieux de la bourgeoisie urbaine, dans les classes moyennes et ouvrières de la Wallonie, voire même de Bruxelles. Trois des journaux qui « formaient » l’opinion publique : le Soir, le Petit Bleu, et surtout l’Indépendance belge, servaient la cause de l’amitié française. Plaquons sur ces tendances opposées : la neutralité, le sentiment de sécurité né des événements de 1870, l’antimilitarisme latent, le refus de charges militaires trop lourdes et des prestations personnelles sous les armes, et l’on en déduira que l’on ne pouvait faire aux puissants voisins nulle peine, même légère.
Toute mesure militaire prise par le pays apparaissait aux yeux de l’immense majorité des citoyens comme superflue dans la situation acquise, comme une intolérable marque de suspicion à l’égard de l’une des puissances. Il n’y avait rien dans cette attitude qui pût valoir à la Belgique de l’estime sur ce plan. Le principe même de cette neutralité était discuté. La Revue de l’Infanterie française déclarait en 1891 : « On peut définir la neutralité belge comme une simple expression diplomatique, c’est-à-dire rien au point de vue militaire. » En 1893, la Deutsche Heereszeitung et d’autres journaux allemands, militaires ou civils, tenaient aussi la neutralité belge pour nulle. La France Militaire estimait que « si les forces belges sont inaptes à couvrir les passages de la Meuse, c’est fatalement à un détachement français que devra incomber cette tâche » ; la Gazette de Cologne dénonçait « une banqueroute morale », et une revue militaire anglaise s’exprimait avec dédain : « S’ils ne font rien, ils ne peuvent guère attendre de nous d’assumer le fardeau. » On pourrait encore ajouter d’autres textes accusateurs, mérités par l’absence de patriotisme actif d’une opinion belge assoupie dans l’illusion de la neutralité.
On découvre pourtant ce sentiment national dans l’armée, disgraciée, dédaignée, prolétarisée, tenue à l’écart de la nation. Les « anciens » s’étaient regroupés dans de nombreuses sociétés qu’ animait l’esprit d’entraide des pauvres. On les vit, sous l’impulsion du lieutenant général Brialmont, faire campagne en faveur du service personnel, pour une meilleure défense du pays, contre les outrances de la presse anglaise, déchaînée Contre la gestion de l’État indépendant du Congo. Léopold II les soutint moralement, convaincu, (p.220) comme Brialmont, que « le temps perdu dans la préparation des moyens de défense ne se récupère jamais à l’heure du péril ». Ceci fut dit en 1897. Il fallut attendre douze ans encore pour donner au problème militaire un modeste début de solution.
Lorsqu’une évolution dans ce sens se dessina, des journaux allemands reprochèrent au journal le Soir de rendre, par sa campagne de 1911 . « Sommes-nous prêts ? », « un mauvais service à son pays en tenant pour rien le respect de sa neutralité par les puissances » ; la Gazette de Cologne affirma que le rapport sur la loi militaire de 1913 se basait exclusivement sur des documents français pour justifier une augmentation de l’armée belge par le service général. D’autres feuilles émirent la même opinion, et aussi le secrétaire d’État aux affaires étrangères, Jagow. Ces reproches allemands faisaient écho aux plaintes françaises provoquées précédemment par un projet de doublement de la voie ferrée Bruxelles-Liège, via Visé, et par les travaux du chemin de fer Malmédy Stavelot, facteurs favorisant une éventuelle pénétration allemande. La Belgique se voyait ainsi ballottée entre les suspicions de ses voisins, qui se révélaient de jour en jour plus aiguës du côté allemand, et pour cause.
L’acceptation, enfin arrachée au parlement, de la loi du 28 mai 1913 instaurant le service général et permettant une restructuration de l’armée – mais trop tard – fut accueillie par la presse allemande comme le résultat d’une pression de la France et d’une menace d’occupation française. La ténacité du roi Albert et l’intelligente souplesse politique de son Premier ministre, Broqueville, avaient enfin atteint le but ; on avait été sensible aux avertissements qui s’étaient multipliés depuis la crise d’ Agadir, en 1911. Mais, en dépit de ces derniers, la Belgique espérait voir respecter son indépendance en s’en tenant rigoureusement aux impératifs de la neutralité. Il se trouvait pourtant des esprits rebelles à cette notion. Une curieuse brochure, signée O’Sax, fut éditée en 1912 sur le thème de la Belgique dans un conflit franco-allemand. L’auteur y prévoyait l’invasion par l’Allemagne, faisait le procès de la neutralité et conseillait à la Belgique de marcher aux côtés de l’ agresseur, promis à la victoire. Ce texte ne pouvait rester ignoré des milieux français. L’auteur en était le général de Witte, alors commandant d’une brigade de cavalerie, qui reçut un an plus tard le commandement de la division de cavalerie. Ce seul fait explique la méfiance dont faisaient montre, et le ministre de France Klobukowski, et son attaché militaire, le commandant Génie. Mais la lucide campagne d’un (p.221) autre officier belge, le major Bremer, en faveur de la défense des Ardennes belges, par des corps de partisans militairement organisés, passa inaperçue.
En rapprochant ces différents faits, et bien d’autres encore, on s’explique plus aisément certaines attitudes. Un romancier militaire français, le capitaine Danrit (alias lieutenant-colonel de réserve Driant), tué glorieusement en 1916 à Verdun, alors député nationaliste et auteur de nombreux ouvrages d’histoire militaire-fiction, consacra plusieurs volumes à la Guerre fatale (entre la France et l’Angleterre, à l’époque de Fachoda), puis à la Guerre de demain, entre la France et l’Allemagne. Dans l’exposé du cadre politique précédant les événements militaires, le rôle de la Belgique était systématiquement tenu pour suspect de complaisance envers l’Allemagne. Or Danrit était lu par beaucoup d’adolescents qui s’y formaient une impression fâcheuse de la Belgique. Si Octave Mirbeau, écrivain réaliste, et féroce, fit entrer l’automobile dans la littérature avec la 628-E8, il accabla dans ce livre la Belgique et ses habitants, de ses sarcasmes. Par ailleurs de rares économistes s’intéressèrent à un autre volet de la vie nationale belge, son extraordinaire expansion industrielle et commerciale, et la vitalité du port d’Anvers. Le clivage de l’opinion publique belge se manifesta en deux grandes occasions. La visite de l’empereur Guillaume II, en octobre 1910, fut chaleureusement saluée par la presse catholique, mais l’accueil de la population bruxelloise fut manifestement plus réservé. Par contre, le voyage du président Fallières, en mai 1911, fut l’objet de commentaires déplaisants dans les mêmes journaux. Le Patriote affirma que « Monsieur Fallières n’a à attendre des catholiques qu’une courtoisie parfaite ». Par contre, l’accueil de la rue fut enthousiaste. Et la libérale Indépendance belge de noter : « Visite de courtoisie ? Non, mais visite d’amitié, d’affection, de cordial voisinage intellectuel. » Cette situation était embarrassante. La Belgique officielle cherchait à sauvegarder un juste équilibre, en étant ni anti-française, ni anti-allemande. Depuis longtemps, l’Allemagne et la France ne comprenaient plus le statut de neutralité dans sa rigueur et ses obligations ; elles interprétaient suivant leurs intérêts ou leurs craintes propres les manifestations belges à leur égard. À la vérité, et en toute objectivité, il était impossible de prévoir en 1913-1914 quelle serait l’attitude de la Belgique en cas d’agression. Du reste bien peu y croyaient en Belgique, nous l’avons déjà dit. Les milieux politiques français envisageaient cette hypothèse.
/1914/
(p.228) L’armée de campagne belge termina son repli dans la position fortifiée d’ Anvers (P. F.A) dans la soirée du 20 août ; elle y trouva de nombreuses formations « de forteresse » totalisant soixante-cinq mille hommes.
…Le commandement belge ignorait les intentions de l’ennemi, et tout autant l’évolution des événements chez les Français et les Britanniques.
(p.231) Moins que jamais le haut commandement français ne comprit que l’utilisation d’Anvers comme tête de pont offensive des Alliés eût été une magistrale illustration de ce débordement. Les Allemands étaient bien décidés à lui enlever cette chance. Le bombardement des forts d’Anvers débuta le 28 septembre. L’armée de campagne était condamnée à l’usure par effritement. Le ministre de Broqueville envisageait déjà une évacuation vers la côte belge. Le 30, avec l’accord du roi, le gouvernement notifia aux ministres accrédités de France et de Grande-Bretagne : « Le moment est à prévoir où l’armée, ayant combattu, et combattant toujours seule, arrive au bout de ses forces… Il prie de prendre en considération les services que la Belgique a pu rendre, et dans cette circonstance critique, il demande aide et protection. »
Que répondit-on à cet appel sans équivoque ? « Le gouvernement français n’ a guère de troupes à envoyer » ; le gouvernement anglais « envoie trois officiers à Anvers pour discuter la possibilité d’une faible aide immédiate ». Le 1er octobre pourtant, le haut commandement français promit l’envoi d’une division, et Londres envisagea le transport de deux mille cinq cents fusiliers marins.
Le 2 octobre, la première ligne des forts fut perdue par la destruction systématique des forts et des redoutes au moyen d’artillerie de gros calibre (420). Ce jour même M. Klobukowski remit une note du général Joffre conseillant de faire sortir au plus tôt l’armée belge de la P.F . Anvers des forces de recueil françaises, dans les régions de Courtrai, Arras et Douai, et anglaises à Lille. La décision fut prise de continuer la résistance sur la rive nord de la Nèthe. Plusieurs hypothèses restaient possibles, sauf précisément la suggestion française qui, dédaignant superbement les réalités, condamnerait l’armée belge à la destruction. Londres commençait à s’inquiéter des bruits d’abandon de la P.F.A. et attira, le 2 octobre, l’attention de Joffre sur la gravité de cette perte éventuelle, en demandant une coopération franco-britannique. Mais le généralissime français estimait un tel envoi de troupes « vain et illusoire ». Du reste le général Kitchener abondait dans le même sens, arguant de l’absence de troupes fraîches. Winston Churchill avait plus de clairvoyance que tous les chefs militaires réunis ; il comprenait la valeur stratégique d’Anvers, mais il savait aussi que désormais le seul espoir serait d’en prolonger la défense, (p.232) sans but bien précis.
/de repli en repli/
(p.233) Ici encore perce un désaccord profond entre le haut commandement français, ne songeant qu’à renforcer son aile gauche en faisant flèche de tout bois, et le roi Albert, dont le but est de sauver son armée d’un désastre. Joffre, en effet, demandait que l’armée se retirât rapidement, non sur Bruges et sur Ostende, sa nouvelle base, mais vers la frontière française, ce qui laisserait ouverte la trouée entre la Lys et Dunkerque. Les Britanniques, pour leur part, se préparaient à protéger la région Eekloo, Bruges, Ostende.
Que fut la bataille de l’Yser?
(p.234) L’armée allait se disposer dans la région Furnes-Dixmude-Nieuport, sa gauche à la mer.
Le haut commandement français ne recevait donc pas satisfaction quant au repli vers le sud, et pas davantage en ce qui concernait une offensive générale. La note de refus précisait : « L’armée belge est entrée en ligne quinze à vingt jours avant les autres. Elle sort d’un siège et d’une retraite des plus pénibles. » Le général Pau fut relevé de sa mission le 12. Son dernier acte fut la remise d’une de Joffre : le 13, la gauche française allait marcher de La Bassée sur Lille, et les Britanniques sur Courtrai, tandis que le groupement Rawlinson et les forces belges devraient aller à la réunion au nord de la Lys pour envelopper la droite allemande. Une fois de plus, ce plan sous-estimait systématiquement la réalité, malgré les enseignements (p.235) cuisants des semaines précédentes. Les informations recueillies par les services belges, régulièrement transmises aux Alliés, et non moins régulièrement dédaignées par eux, confirmaient et précisaient les transports sur la Dendre, tandis que l’armée de siège de Beseler arrivait à hauteur de Gand. Obéir à la directive de Joffre eût été de l’aberration. Foch le comprit mieux, et suggéra d’occuper une position de couverture Ostende, Thourout, Roulers. Il établit dans la région d’Ypres un groupe de deux divisions d’infanterie. Ainsi l’armée belge sera-t-elle finalement amenée à occuper la médiocre position de l’Yser, et à y résister à fond conformément à la proclamation royale du 13 octobre. On alla même plus loin en préparant une action offensive par trois divisions d’armée et une division de cavalerie dans la région de la forêt d’Houthulst pour le 15. Le 14 au soir, on apprit coup sur coup : l’arrivée de quatre colonnes allemandes sur le front Bruges, Thielt, Waereghem; l’impossibilité de l’offensive britannique ; le repli de Rawlinson sur Ypres ; la situation hasardeuse de la brigade Ronarc’h. L’ordre d’armée (belge) du 15, neuf heures dix, stipulait : « La ligne de l’Yser constitue notre dernière ligne de défense et sa conservation est nécessaire pour le développement du plan général des opérations.»
Telle est la genèse de la bataille de l’Yser. Mais, au fait, que fut cette bataille capitale? . Si l’on en croit le très officiel Bulletin des Armées de la République du 25 novembre 1914, une bataille livrée et gagnée par l’armée française, pendant que l’armée belge « se tournait les pouces » entre Saint-Omer et Calais. Ce mythe s’est perpétué malgré les protestations du roi Albert, malgré l’étude du général français Azan, malgré les travaux historiques les plus sérieux. Un ouvrage comme Vie et mort des Français, que nous tenons pour remarquable, est silencieux au sujet du rôle réel de l’armée belge, sans grand espoir de renverser des convictions aussi solidement établies et entretenues, indiquons sèchement les phases de cette bataille.
Le 16 octobre au soir, l’armée belge est déployée le long du fleuve Yser, avec de forts avant-postes à l’est de cet obstacle.
(p.236) Le 16 octobre, il y a sur l’Yser exactement six mille Français, les premiers rencontrés par les combattants belges depuis le 4 août. Contrairement aux supputations de Foch, les Allemands attaquent violemment les avant-postes dès le 18. Une sortie franco-belge de Dixmude ralentit la poussée du IIIe corps d’armée, mais ces troupes doivent se replier sous la menace de quatre corps d’armée de réserve de nouvelle formation. Sur la tête de pont de Dixmude nous avons calculé que, jour après jour, il y éut un Français en ligne pour trois Belges, tous de courage égal. Le général Grossetti, commandant l’excellente 42e division d’infanterie, se présenta au G.Q.-G. belge le 21 au soir ; ses unités n’atteignirent Nieuport que le 23, pour y subir un échec immédiat, sans pouvoir dépasser la ligne défensive tenue par les Belges depuis le début de la bataille. Le 26, ce général prend le commandement de tous les éléments français dispersés le long du front Nieuport-Dixmude. Ici encore se précise le dédain du commandement français. Placé à la tête de la 42e D.l, des fusiliers marins, de deux bataillons de tirailleurs sénégalais, du 3e régiment de chasseurs d’Afrique, d’une brigade provisoire de cavalerie et de quelques batteries lourdes, Grossetti doit « assurer à tout prix, avec ou sans l’armée belge, la défense de ce front ». Il précise que les troupes françaises n’ont pas à obéir à des commandants de troupes belges ; en cas de demande de concours de ceux-ci, il leur appartiendrait de vérifier la situation « pour décider de leur propre initiative dans les cas qui n’auraient pu être prévus par le commandement français » . Ce texte révélateur est exactement le contre-pied d’une solidarité d’armes.
Les Français entrent réellement en ligne le 26 octobre, huit jours après le début de la bataille ; celle-ci est presque terminée et les progrès insidieux de l’inondation, décidée et tendue par les Belges, ne tarderont pas à y mettre fin.
(p.237) Après la bataille de l’Yser
Bientôt va débuter la funeste stabilisation, et l’on pourrait croire que c’en est fini des malentendus. Certes, il est indéniable que le roi Albert s’est acquis un prestige universel; qu’un préjugé favorable existe au plan sentimental populaire envers les «petits Belges ». Il n’en fut pas de même au niveau le plus élevé des responsables politiques et militaires. Le roi avait éprouvé une certaine amertume au souvenir de ces deux mois et demi de complet isolement, de sa lutte de tous les jours contre des tendances dogmatiques qu’il condamnait. Son premier souci sera d’épargner son armée dans toute la mesure du possible en vue d’une tâche d’intérêt uniquement national : libérer la Belgique. Or, dès le 19 novembre 1914, le général Foch lui propose de répartir les forces belges à raison d’une brigade par division française. Le maréchal French ne tarde pas à exprimer le même désir, au bénéfice des Britanniques. La position du roi est tranchante : l’armée belge doit rester une, maîtresse de ses opérations, maîtresse absolue de son organisation.
Son étude attentive des opérations sur le front occidental le confirma toujours dans son obstination ; la funeste tactique du « grignotage » le heurta. À l’époque du drame de Verdun, il se refusa à envoyer des divisions belges dans cette fournaise. En décembre 1916, il note : « Les offensives ne réussissent pas, l’expérience en est faite. Je n’entends pas sacrifier mes hommes dans les opérations au succès desquelles je ne crois absolument pas. » Le 9 avril 1918, au moment de l’offensive allemande sur la Lys, il déclinera encore la demande de deux divisions et de toute sa cavalerie pour la 2e armée britannique. Une telle intransigeance ne pouvait que provoquer le vif mécontentement d’un haut commandement qui, lui, n’hésitait jamais à jeter dans la mêlée ce que l’on appela alors « le matériel humain ». Dès 1915, le réalisme foncier et pessimiste du roi avait été en désaccord avec les idées stratégiques des Alliés, ne voyant de succès que dans les offensives frontales. Cette même opposition se retrouve sur le plan politique. La Belgique ne se voulut jamais l’alliée de droit des autres puissances. Le roi, dans la ligne de son serment constitutionnel, ne voulait qu’une chose : rétablir l’intégrité de la Belgique ; obtenir la réparation totale des dommages ; maintenir les droits acquis au Congo : conclure des traités de commerce favorables. « La Belgique ne doit s’inféoder (p.238) à personne.”
(p.239) On ne peut passer à Stockholm, où figura le secrétaire de la IIe Internationale, roi Albert, qui l’avait reçu en 1917. « Vous avez raison. Il faut négocier.» La France et la Grande-Bretagne interdirent à leurs socialistes d’y participer, et cette conférence n’eut celui de faire passer Huysmans pendant dix ans pour un homme à la solde de l’Allemagne. Il suffisait en effet, à cette époque, de chercher une issue à cette guerre absurde et terrible pour encourir un tel reproche, ou tout au moins l’appellation de “défaitiste”. Le roi Albert n’y échappa en rien. Les archives pourraient révéler nombre de heurts entre autorités françaises et belges au cours de ces années sombres. Le général Galet, conseiller militaire du roi en 1914-1918, voulut donner une suite à son premier ouvrage ; elle eût englobé toute la période ultérieure à la bataille de l’Yser. Elle n’a jamais été éditée, pour éviter de fâcheuses polémiques.
(p.239) L’armée belge était devenue en 1918 une force superbe de quatorze divisions, bien équipée, relativement épargnée depuis 1915, grâce à la clairvoyance du roi Albert. Sa participation aux offensives de septembre et octobre 1918 fut massive et décisive, couronnée d’un total succès. En quelques jours, la percée des crêtes des Flandres fut réalisée dans la région de Passchendaele et Langemarck, où les Britanniques avaient échoué en 1917 au prix de pertes considérables. L’exploitation rapide et la pénétration en profondeur dans les Flandres furent des composantes de la conclusion de l’armistice du 11 novembre.
(p.240) Interférences culturelles au cours du XIXe siècle
Il est assez surprenant que ce soit un écrivain d’origine française, Hendrik Conscience (1812/1883), qui ait « appris à lire à son peuple » et surtout lui ait donné la fierté d’un passé glorieux de lutte contre les Français, avec ses Kerels de Flandre, son Lion des Flandres, et bien d’autres romans historiques ou romantiques.
(p.243) TITRE VI La Belgique souveraine
CHAPITRE XXXII Les difficultés de la paix
De 1919 à 1936
Dès le lendemain de la victoire, les points de vue et les intérêts nationaux s’affrontèrent. Clemenceau reprit à son compte la théorie monarchiste puis jacobine d’une expansion française jusqu’au Rhin, fleuve déjà atteint par la restitution de l’Alsace. L’idéalisme du président Wilson conduisit à un découpage de l’Allemagne et de l’Empire austro-hongrois, germe de conflits dans l’immédiat (Teschen, Memel, Haute-Silésie), ou dans l’avenir (les Sudètes, Dantzig). Lloyd George songeait surtout à se rouvrir le marché économique allemand. Il ne semblait pas que France et Belgique dussent avoir des intérêts divergents. Et pourtant…
Déçue dans ses aspirations rhénanes, la France, sous l’impulsion de Clémenceau et de Berthelot, secrétaire-général des affaires étrangères, souhaita obtenir la cession du grand-duché de Luxembourg, position stratégique de premier ordre, ou tout au moins, s’il ne (p.244) être annexé territorialement, une union douanière, qui serait éventuellement étendue à la Belgique.
C’ était reprendre la politique de Louis XIV et de Napoléon III. Une partie de l’opinion grand-ducale y était acquise. Le maréchal Foch avait eu l’habileté d’installer à Luxembourg son grand quartier général, et la propagande française s’y exerçait avec vigueur. Mais la grande majorité des Grands-Ducaux restaient attachés à leur indépendance, tout comme à leur nouvelle et jeune souveraine. Un référendum économique, effectué le 22 septembre 1919, donna soixante mille cent trente-trois suffrages à la France, vingt-deux mille deux cent quarante-deux à la Belgique. Le problème semblait donc résolu en faveur de la première. La France entendait aussi avoir la mainmise sur le réseau ferroviaire grand-ducal, prolongement de celui de l’Alsace-Lorraine.
Le gouvernement belge fit preuve alors d’une énergique détermination et n’hésita pas à recourir à ce qu’il faut bien qualifier un marchandage. Ou bien régler dans l’intérêt belge la question luxembourgeoise, ou voir différer sine die la politique d’arrangements militaires entre la France et la Belgique. Ce problème avait été abordé le 28 janvier 1920, à une conférence tenue à Ypres, réunissant les plus hautes personnalités des deux pays : pour la France, MM. Poincaré, Mitterand, de Margerie, le maréchal Foch; pour la Belgique le roi Albert, MM. Delacroix, Hymans, le baron de Gaiffier.
Un désaccord très vif subsista jusqu’au début d’avril. Aucune décision n’eût peut-être été prise si la situation ne s’était subitement aggravée en Allemagne: coup d’État de von Kapp, troubles communistes dans la Ruhr. Fermement opposée à l’augmentation demandée des forces armées allemandes, la France voulut alors élargir la zone d’occupation et prendre de nouveaux gages pour les réparations. Sur ce plan elle se trouvait en communauté d’intérêts avec la Belgique.
A l’envoi, le 20 mars, de troupes allemandes dans la zone démilitarisée, l’armée française répliqua le 6 avril par l’occupation de Francfort, Darmstadt et Duisbourg. Après des hésitations fort compréhensibles, car une telle mesure mécontenterait fatalement la Grande-Bretagne, le gouvernement belge décida d’envoyer un détachement plutôt symbolique. Bruxelles et Paris admirent d’une part, qu’il fallait rendre possible une union économique entre le grand-duché et la Belgique, (p.245)
d’autre part que le feu vert serait donné à des conversations militaires dès que le problème luxembourgeois serait en voie de règlement. On a souvent dit que l’accord militaire franco-belge qui en résulta était un acte exclusivement militaire, sans portée politique. Or, dès l’origine des négociations, les plus hautes instances y furent concernées. Le gouvernement français désirait une alliance en bonne forme ; la Belgique n’en voulait pas sans la présence de l’ Angleterre, qui s’y refusait. Elle n’envisagea donc qu’un accord, un plan concerté entre les Etats-majors. Millerand finit par y consentir, à la condition qu’il fût approuvé par les gouvernements.
L’accord militaire défensif fut signé le 7 septembre 1920, par le maréchal Foch et le généra1 Buat, du côté français, par le lieutenant général Maglinse du côté belge. Les deux pays s’engageaient à « maintenir l’occupation des pays rhénans », à en régler l’occupation militaire, à préciser les renforts à y envoyer en cas de menace d’agression. L’accord envisageait une mobilisation partielle des forces dans l’hypothèse d’une « prise d’armes générale en Allemagne ». On y prévoyait aussi l’étude d’un système de défense coordonné de frontières communes avec l’Allemagne, et des mesures de couverture répondant à l’éventualité d’une évacuation de la Rhénanie.
(…) En mars 1921 déjà, les Français avaient créé une cinquième tête de pont englobant Duisbourg, Ruhrort, Wesel et Düsseldorf ; les Belges participèrent à l’occupation de deux grands ports rhénans. Pour la vaste opération de la Ruhr, les Belges reçurent le contrôle de Sterkrade, Botrop et Gladbach, au total cent soixante mille habitants. On sait que le chancelier Cuno ordonna une résistance passive par le refus de toute collaboration des cadres et des ouvriers. En marge de cette inertie organisée se manifesta une résistance active. On compta en mars 1923 plus de quatre-vingts sabotages et de nombreux incidents. La réplique franco-belge fut dure : réquisition des gares; exploitation des réseaux ferroviaires par le personnel français et belge; régie civile; entraves aux communications avec l’Allemagne non occupée ; saisie des marks ; coupe des bois ; création d’un cordon douanier autour du bassin de la Ruhr ; interdiction de la sortie du charbon, de ses dérivés, des produits métallurgiques ; saisie des stocks. Les attentats, sporadiques jusqu’en 1923, devinrent plus nombreux : en douze mois, vingt soldats français et belges tués, soixante-six blessés. Cette même année vit le spectaculaire effondrement de la monnaie allemande, et le chancelier Stresemann estima que le moment était venu de mettre fin à la résistance passive pour assurer la survie de l’État. L’occupation de la Ruhr devint « invisible ».Cette année 1923 avait vu s’effriter un peu plus encore le bloc allié, par l’accord économique germano-russe de Rapallo, le 16 avril, et par les incidences du mouvement séparatiste rhénan, chaudement appuyé par des groupements nationalistes en France (le comité de la Rive gauche du Rhin), en Belgique (le comité de (…).
(p.278) Nous avons signalé plus haut que l’équilibre général des forces (p.279) opposées était vicié à la base par une incompréhensible erreur de calcul du haut commandement français dans la répartition de ses divisions. Sur la haute Meuse française et belge une disproportion inusitée (un contre trois et demi), la surprise totale d’une attaque au centre, débouchant de ces Ardennes dédaignées, sur des divisions étirées au-delà de toute possibilité de défense, l’infériorité aérienne, la révélation brutale de l’arme blindée employée en masse expliquent les événements de Sedan, de Monthermé, de Houx, sans qu’il soit nécessaire ni équitable de mettre en cause la valeur des troupes, leur volonté de combattre, et encore moins une quelconque responsabilité de l’armée belge ou de l’armée britannique.
(p.284) CHAPITRE XXXV Un grave différend franco-belge
La capitulation de l’armée de campagne belge, acte militaire localisé et non pas acte politique engageant la Belgique comme telle – il importe de le souligner -, fut pour le généralissime Weygand, nous l’avons dit plus haut, une douloureuse surprise. Il envoya le 28 mai, dès trois heures quinze, une dépêche au général Champon, chef de la mission militaire française au G.Q.G. belge :« Les gouvernements français et anglais sont d’accord pour que leurs armées sauvent l’honneur du drapeau et se désolidarisent de l’armée belge. »
La deuxième réaction fut d’ordre politique et passionnel. Dans la nuit du 27 au 28, Paul Reynaud, Premier ministre, convoqua les ministres belges Pierlot, Spaak et Denis qui, comme les autres membres du gouvernement, s’étaient séparés et désolidarisés du roi dès le 25, et avaient abandonné le territoire national. Entouré de Pétain et de Weygand, il leur communiqua la nouvelle de la capitulation et leur dit son intention d’annoncer « à la France et au monde » cet « acte de félonie ». À huit heures trente, Reynaud fit cette communication qui, en plusieurs points, violait la vérité. Défendant une stratégie indéfendable, une conduite des opérations inexistante dans le chef du haut commandement français, il ajouta :« Or, voici qu’en pleine bataille, sans prévenir le général Blanchard, sans un regard, sans un mot pour les soldats français et anglais qui, à son appel angoissé, étaient venus au secours de son pays, le roi Léopold III de Belgique a mis bas les armes. C’est là un fait sans précédent dans l’histoire. » Il termina cette longue allocution par: «Sur la nouvelle ligne que vient d’établir notre grand chef Weygand, en plein accord avec le maréchal Pétain, sur la Somme et sur (p.285) l’Aisne, nous tiendrons et, parce que nous aurons tenu, nous vaincrons. »
C’est le même homme qui avait proclamé : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. » C’est aussi le même qui, depuis le 25, savait que les grands chefs, Pétain et Weygand, devant le Comité de guerre français, considéraient la situation militaire comme sans espoir et envisageaient déjà l’ouverture de négociations. Reynaud avait alors déclaré : « Il n’est pas dit que notre adversaire nous accordera un armistice immédiat, et n’est-il pas indispensable d’éviter la capture du gouvernement si l’ennemi entre dans Paris ? » Et c’est encore Reynaud qui n’hésitera pas à falsifier une fois de plus la vérité dans ses souvenirs impudemment titrés : La France a sauvé l’Europe. Ce même 28 mai, Churchill annonça au parlement britannique la capitulation de l’armée belge : «Je n’ ai pas l’ intention de suggérer au parlement que nous devrions en ce moment porter un jugement sur l’action du roi en sa qualité de commandant en chef de l’armée belge. Cette armée a combattu très bravement et a, à la fois, subi et infligé de lourdes pertes. Le gouvernement belge s’est dissocié de l’action du roi et, se déclarant le seul gouvernement légal de la Belgique, a formellement annoncé sa résolution de continuer la guerre aux côtés des Alliés. » Cette attitude pondérée, froide, objective, s’explique aisément par le fait que Churchill avait été le seul à vouloir une bataille alliée, unifiée, conduite par Weygand, à vouloir un repli général vers le sud ; à désirer sauver une partie de l’ armée belge et à savoir que celle-ci avait été délibérément abandonnée à son sort. Il s’attendait donc à sa capitulation.
C’était le fait d’un véritable homme d’État. Les autres, Français, et Belges, n’étaient que des politiciens dépassés par les événements. Les ministres belges le prouvèrent dans le discours de Pierlot à la radio, le 28 mai à dix-huit heures : « Passant outre à l’avis formel du gouvernement, le roi vient d’ouvrir des négociations et de traiter avec l’ennemi. L’ acte que nous déplorons est sans valeur légale et n’engage pas le pays. » Il constatait en conséquence que le roi s’était placé dans l’impossibilité de régner ; il déliait les officiers et les fonctionnaires de leur devoir d’obéissance /au roi/ et affirmait la volonté du gouvernement « de continuer la lutte pour la délivrance du pays ».
Il y eut enfin les conséquences passionnelles de ces discours officiels (p.286), car l’allusion à la trahison éveilla sans tarder des réactions violentes dans le peuple français. La radio et la presse se déchaînèrent, et beaucoup de réfugiés belges se virent manifester hostilité ou mépris.
La réunion à Limoges d’une partie des parlementaires belges, le 31 mai, aggrava le climat. Pierlot accepta que le sénateur-maire Betoulle accusât le roi d’avoir « trahi ses alliés mais aussi son peuple » . Personne ne protesta contre ces attaques virulentes.
Spaak, dans son discours, entérina l’idée de la « trahison », tout en concédant qu’elle n’avait pas été préméditée. Il fit en somme reproche au roi de sa perspicacité en face de l’évolution des événements militaires, de l’« exécution trop scrupuleuse /par le roi/ des indications qui lui étaient données par le haut commandement français ». À la suite de cette réunion, le gouvernement fut confirmé dans l’exercice de ses pouvoirs, à l’exclusion du souverain. On se refusa néanmoins à aller jusqu’à la déchéance de ce dernier.
Le moral de la nation française était fort bas ; pour le ranimer il fallait donner vie et consistance à la thèse de la trahison, dénoncer à une opinion publique atterrée un responsable des catastrophes inouïes s’abattant sur le pays, provoquer une indignation unanime.
Londres ne paraissait pas se prêter à cette manœuvre ; il fallut une démarche française officielle pour modifier l’attitude de Churchill. « Le gouvernement français exprima sa tristesse que mon allusion à l’action du roi fût en contradiction avec celle de M. Reynaud. Je pensai qu’il était de mon devoir, en parlant devant le parlement le 4 juin, après examen attentif des faits plus complets alors utilisables /…/ d’établir la vérité en termes francs. » Cette explication diplomatique et opportuniste de Churchill, dans ses Mémoires, se réfère à la déclaration suivante : « Le roi et son armée, brave et efficiente, forte de près d’un demi-million d’hommes, gardèrent notre flanc gauche, tenant ainsi ouverte notre seule ligne de retraite vers la mer. Soudainement, sans consultation préalable (prior consultation), avec le minimum d’avertissement (the least possible notice), sans l’avis de ses ministres, et de sa propre initiative, il envoya un plénipotentiaire au commandement allemand, rendit son armée et exposa tout notre flanc et nos moyens de retraite. « En prononçant ce discours dénué de violence verbale, Churchill, homme d’État peu enclin au sentimentalisme, n’avait qu’un but : sauver une alliance déjà lézardée profondément, maintenir la France au combat, fût-ce au prix d’une injustice « par omission ». S’abstenant de mentionner les carences (p.287) du haut commandement allié, il permettait au gouvernement français de fortifier, très provisoirement, sa position morale. Le roi, la Belgique et son armée en sortaient lamentablement « diminués » et il nous paraît certain que la suspicion règne encore dans certains milieux ; ils n’admettront jamais que la défaite de mai-juin 1940 fut une responsabilité presque exclusivement française.
Il est regrettable que les premiers témoignages positifs en faveur de l’armée belge soient allemands, tout comme pour Anvers et l’Yser en 1914. Les documents officiels montrent que, du 24 au 26 mai, le plan allemand consistait à faire brèche rapidement dans les positions belges, et qu’une résistance inattendue a empêché l’ennemi de prendre au piège tout le groupe d’armées n°1. Par la suite cette thèse a été étayée par des témoins objectifs, tels l’amiral sir Roger Keyes et l’attaché militaire américain, le colonel Duncan Bower qui, le 31 octobre 1940, déclarait dans son rapport : « En capitulant le 28 mai, le roi des Belges a fait la seule chose qu’il pouvait faire. Ceux qui parlent autrement n’ont vu ni la bataille ni l’aviation allemande. J’ai vu l’une et l’autre. » L’éminent critique militaire anglais, sir Basil Liddell Hatt, n’hésite pas à écrire : «On peut soutenir très raisonnablement que l’armée anglaise a été sauvée par Léopold. » Et le général français Beaufre déclare tranquillement : « Sur le moment » nous avons cru habile de rejeter la responsabilité morale du désastre sur les Belges. Ce fut une faute.» Mais le mal était fait.
L’histoire des relations entre la France et la Belgique, à partir du 18 juin 1940, se réduit aux rapports entre un gouvernement français aux abois et ne songeant plus qu’à une fin des hostilités qu’il entend qualifier d’« honorable » et un gouvernement belge, légal sans doute, mais pratiquement dépourvu de pouvoirs réels et dont l’attitude va se calquer sur celle de son hôte.
Il est pénible d’évoquer cette attitude belge, marquée par le refus, dès le 4 juin, de mettre les navires et les marins belges à la disposition de l’Angleterre ; le 10 juin, par la défense formelle d’entrer en action contre l’Italie, qui venait de déclarer la guerre à la France ; le 17 juin, par le refus d’envoyer en Grande-Bretagne le personnel de l’aviation ; le 18, par la décision du Conseil des ministres, sur proposition de Pierlot : «Nous n’irons pas en Angleterre. (p.288) La France a jeté le dé. Nous abandonnons la lutte avec elle. (…) Quant à nous, notre attitude se conforme à celle de la France. Notre mandat est terminé. Notre devoir est accompli. »
Les positions des gouvernements français et belge sont donc parallèles et le resteront pendant plusieurs semaines : l’acceptation passive et sans grandeur de la défaite et de ses servitudes inévitables. Or ce sont les mêmes hommes qui ont jeté le déshonneur sur le roi des Belges, accusé l’armée belge d’avoir violé la solidarité, abandonné les Alliés au milieu du combat. Cette fois pourtant, il ne s’agit plus d’un acte militaire mettant fin à la résistance, devenue impossible, d’une partie des forces nationales, mais bien d’une cessation totale, militaire et politique, de la lutte commune.
Dès le 19 juin, le gouvernement belge tente de faire parvenir au roi une dépêche en six points, dont le plus important est l’annonce de la démission du gouvernement dès que le sort des soldats belges et des réfugiés de France sera réglé, afin de faciliter les négociations préalables à la paix entre l’Allemagne et la Belgique.
Le roi refuse, le 4 juillet, de faire aucun acte politique et de recevoir des délégués gouvernementaux. Les ministres belges ont d’abord trouvé un refuge précaire dans le village de Sauveterre, puis à Vichy. Ils tentent d’obtenir des contacts avec le Reich par l’intermédiaire du gouvernement français via la commission d’armistice de Wiesbaden. Cette dernière présenta en effet le projet tendant à faire passer la Belgique du régime de la capitulation à celui d’armistice. Sans aucun succès.
Le 27 juin, Pierlot a annoncé par la radio, à ses compatriotes de France que, la guerre étant finie, l’armée démobilisée sera rapatriée. Les documents officiels abondent, démontrant que tout fut fait pour le retour en Belgique des fonctionnaires, des ministères , du personnel et du matériel ferroviaire, des réfugiés et des troupes. À l’annonce de la capitulation française, quelques officiers des forces terrestres et plusieurs aviateurs belges avaient pris le large pour gagner l’Angleterre. Une plainte en désertion fut déposée à leur encontre et des mesures disciplinaires prises en ce qui concerne les aviateurs. Ces diverses mesures n’avaient rien de digne, mais, le choix ayant été fait, elles se situaient dans la ligne de la politique de Vichy.
Les ministres belges désiraient rejoindre, eux aussi, la Belgique ; mais, le 20 juillet, une ordonnance du haut commandement militaire (p.289) allemand à Bruxelles le leur interdit formellement, les rejetant sur Vichy dans une inaction et une impuissance à peu près totales.
Par ailleurs, le gouvernement français entendait exercer son contrôle sur la gestion du gouvernement belge en exil, et Pierlot ne l’admettra pas.
Seuls ministres à le faire, un, puis deux, puis trois ministres belges partirent à Londres. Après eux, Pierlot et Spaak quittèrent le 25 août Vichy pour l’Espagne où ils avaient être retenus quelque temps avant de rejoindre également l’Angleterre.
Les ministres restés en France invitèrent le 28 août tous les Belges à n’avoir qu’une pensée, celle de l’union nationale autour du roi. Le 2 septembre, ils cessèrent leurs fonctions, et une note officielle du 16 septembre précisa que le gouvernement belge avait décidé de se dissoudre ; elle annonçait aussi la suppression des représentations diplomatiques belges à l’étranger, exigée par le Reich. L’ambassade de Belgique près le gouvernement de Vichy fut fermée, sur la demande de ce dernier.
Les dernières relations entre la France et la Belgique étaient ainsi rompues. Plus exactement entre la France officielle et la Belgique en exil. Celle-ci était légalement reconnue par tous les pays, sauf évidemment par l’Allemagne, l’Italie et les pays occupés par eux. Le gouvernement de Pétain était considéré, comme légal, même par la Grande-Bretagne, bien qu’elle n’eût plus aucune relation diplomatique avec la France, tandis que les États-Unis maintenaient à Vichy leur ambassadeur.
Que fallait-il faire ? Le premier souci pour le gouvernement belge restreint reconstitué à Londres autour de Pierlot et Spaak était de s’associer dans la mesure de ses très faibles moyens à la lutte difficile entreprise par la Grande-Bretagne, désormais seule. Un autre, moins urgent : considérer et admettre le fait d’une France libre, en la personne du général de Gaulle, une France illégale dès l’abord. La reconnaissance officielle de cette France par le gouvernement belge ne fut acquise que lorsqu’elle eut pris corps, par une note du 3 octobre 1941. En mai 1942 les deux gouvernements en exil échangèrent des représentants diplomatiques. Lorsque de Gaulle et le Comité de libération nationale s’installèrent à Alger (printemps 1943), le gouvernement Pierlot le reconnut comme l’organisme, qualifié pour la conduite de la guerre et la gestion des intérêts français ; il envoya à Alger un diplomate accrédité auprès de ce comité national.
(p.290) Le général de Gaulle, pris tout entier par ses vues lointaines et hautaines de grandeur, absorbé par ses luttes quotidiennes avec ses « grands alliés », attachait sans doute fort peu d’importance à ces reconnaissances de facto venant s’ajouter à celles d’autres pays. Elles furent complétées du côté belge par la reconnaissance de droit, en mars 1944, du « gouvernement provisoire de la France », reconnaissance officialisée par la nomination d’un ambassadeur.
Deux phrases de M. Spaak, ministre des affaires étrangères, illustrent bien le thème général du présent ouvrage. D’une part, cette politique résolument francophile a été poursuivie pour que « la France ne soit pas tentée de profiter des difficultés intérieures de la Belgique ». D’autre part, « avec la France, les relations de la Belgique ne sont jamais faciles. Il existe un perpétuel décalage entre les bonnes paroles qui sont échangées et la réalité.» /P.-H. Spaak, Combats inachevés, p.170/
Le « commissaire aux affaires étrangères » du général de Gaulle, M. Massigli, restait fidèle à la politique traditionnelle de son pays, tout comme aux rancoeurs de son chef actuel, en réprouvant les relations, jugées trop étroites, entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Or la Hollande était plus proche encore du gouvernement de Londres, et la Belgique ne voulut pas dissocier sa politique de celle des Pays-Bas.
Il y avait aussi le problème de l’or. L’Allemagne n’avait pas respecté – on eût pu s’en douter – les clauses de l’armistice concédé à la France. Les exigences se multiplièrent rapidement et, chaque fois, le gouvernement de Vichy céda. Tel fut le cas notamment pour la rupture des relations diplomatiques avec les gouvernements en exil des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique, de la Norvège ; le cas également de la livraison aux nazis de ressortissants allemands réfugiés politiques. La politique de Laval, d’après ses propres termes, était de « faire le gentil avec les Allemands ».
Une nouvelle occasion lui en fut offerte avec l’or belge. Il s’agissait de deux cents tonnes de ce métal qui, dès l’évacuation du territoire belge, avaient été confiées à la Banque de France, seule dépositaire possible, et envoyées pour plus de sécurité à Dakar. Le 12 septembre 1940, l’Allemagne en exigea le retour à Bruxelles ou à Paris. Le gouvernement français répondit à cette prétention par une proposition : d’accord pour ramener l’or belge à Paris, moyennant une révision plus favorable (à la France) du taux du mark. Mais cela (p.291) ne suffit pas et finalement Bouthillier, ministre des finances, préleva sur les stocks d’or français l’équivalent des deux cents tonnes belges et les remit à l’institut de Bruxelles, opération sanctionnée par une loi du 18 octobre.
Le 23 novembre 1942, l’Afrique-Occidentale française, dernière à le faire, entra en dissidence. À partir de ce jour, l’or belge entreposé à Dakar fut en possession de la France libre, qui ne tint pas du tout à s’en dessaisir. La politique du général de Gaulle n’était nullement de faire des cadeaux, fussent-ils légitimes, à ses alliés, mais plutôt à en attendre d’eux. L’or belge, ou sa contrepartie, avait été cédé à l’Allemagne par le gouvernement Pétain, seul légal, mais désavoué dés le début par de Gaulle. Il estimait donc que cette opération ne liait en rien le nouveau régime.
Quoi qu’il en fût, il fallut en 1944 de longues et pénibles négociations avec le gouvernement provisoire du général de Gaulle avant que satisfaction fût enfin accordée à la Belgique.
(p.296) CHAPITRE XXXVll Les nouvelles relations sur le plan européen
En septembre 1944, les gouvernements en exil des Pays-Bas, du grand-duché de Luxembourg et de Belgique avaient décidé de préparer une union douanière qui allait devenir le Benelux.
Deux mois plus tard, le 26 novembre 1944, de Gaulle effectua sa visite historique chez Staline et tenta de le convaincre que la France devait redevenir une puissance à part entière. Il exposa notamment la thèse de la nécessité pour la France d’une couverture permanente et définitive sur le Rhin par l’absorption de la Rhénanie. Ici se pose la question de l’attitude du général de Gaulle envers la Belgique. Reprenait-il dans son for intérieur l’annexionnisme monarchique ou jacobin ? On a mainte fois cité ce passage écrit alors (p.297) que son auteur ne jouait « Ce pays belge, sans profondeur, sans partagé entre deux races et deux langues rivales ; cet Etat ombrageux, s’il a su prendre récemment un héroïque parti, combien de raisons pourraient un jour le détourner de s’engager à fond? Dans cette phrase, fort caractéristique d’un « certain » survol de l’histoire, on relève certes deux ou trois erreurs, mais une revendication nationaliste.
Nous voyons dans le livre Jamais dit de Tournoux, que, dès février 1944, le général de Gaulle fut approché par un groupe séparatiste wallon lui demandant le rattachement de la Wallonie à la France. De Gaulle y répondait qu’il ne pouvait être question de démanteler la Belgique. En 1963, une nouvelle démarche sera tentée; elle visait cette fois à l’instauration d’un système fédéral belge au sein duquel la Wallonie aurait rapports très étroits avec la France, sans toutefois qu’il y eût fusion. « Nous ne pouvons faire éclater la Belgique » , aurait répondu le général. On peut donc, semble-t-il, accepter l’idée que, sur les réalités et les possibilités, de Gaulle ait renoncé, si jamais il y a pensé, à bouleverser la carte de cette partie de l’Europe, ce qui du reste n’eût pas été sans graves complications politiques.
La France et la Belgique se trouvaient confrontées avec des problèmes autrement importants. Il n’est donc pas inutile de retracer en bref les étapes de la vie politique dans ces pays.
/Le traité de l’Organisation de l’ Atlantique Nord (O.T.A.N.)/
Il apportait la garantie précieuse de la puissance des États-Unis et de leur arme atomique aux cinq pays du traité de Bruxelles, auxquels venaient s’ajouter le Danemark, la Norvège, le Canada, l’Italie et plus tard le Portugal et l’Islande. Dans ce cadre élargi, qui annonçait une prise de conscience européenne, aucun désaccord entre la France et ses associés. Bien au contraire, lorsque le congrès de La Haye, en mai 1948, eût reconnu le principe d’une unification européenne, le gouvernement français émit le voeu, le 18 août 1948, d’une Assemblée européenne. Avec le gouvernement belge il en saisit les cosignataires du traité de Bruxelles. France et Belgique restèrent d’accord sur la création d’une assemblée consultative et d’un conseil où seraient représentés les divers gouvernements intéressés. Ce projet ne put aboutir, à cause de l’opposition britannique. La solution de compromis fut le Conseil de l’Europe, associant tout d’abord dix États : le Benelux, la France, le Danemark, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Irlande, la Norvège, la Suède, et par la suite la Grèce, la Turquie, l’Islande; puis, en 1951, la République fédérale d’ Allemagne.
C’est encore la France qui, sous l’impulsion de Robert Schuman, voulut aller plus loin sur la vote de l’unité, en structurant la Communauté européenne.
Il est curieux dès lors de constater qu’avec la république de Chypre, la France fut le seul pays à refuser son accord à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950.
(p.304) Par ailleurs, de Gaulle poussait à la réalisation de son propre projet d’organisation politique de l’Europe. Il en entretint le chancelier Adenauer; une conférence « au sommet », tenue à Paris, le 10 février 1961, l’étudia, conversations reprises à Bad Godesberg, le 18 juillet 1961. Il en sortit en novembre un « plan Fouchet », créant – et établissant à Paris – une Commission politique permanente, prévoyant des réunions périodiques des chefs d’État et une assemblée parlementaire européenne, avec la règle de l’unanimité. Le chef de l’État français trouva que ce projet était trop timide, et il entendit confier à la Commission politique, donc à Paris, les problèmes de défense et d’économie, au détriment, et de l’O.T.A. N. et de la C.E.E.
Nous insistons sur ces points parce que, le plus souvent, la France et les pays du Bénélux ont eu sur ce plan des conceptions divergentes. Joseph Luns, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, entendait respecter les droits de l’O.T. A. N. et inclure le Royaume-Uni dans ce qui était devenu le Marché commun ; son collègue belge estimait que l’Europe des patries était une notion insuffisante et trop vague ; il envisageait une Europe supranationale, sous la forme d’une fédération politique. Ces attitudes étaient trop tranchantes de part et d’autre. Un fédéralisme européen se révélait utopique; une confédération incluant le Royaume-Uni eût été un grand progrès. Mais les obstinations réciproques allaient faire échouer le projet.
Les grands événements de la seconde période gaullienne s’axent sur la volonté du général de Gaulle, tout d’abord d’être le véritable et seul chef de l’État français. Reconnu comme tel par le référendum de septembre 1958; confirmé par le triomphe électoral des partis de droite en janvier 1959, il put « assumer la France». Il amena alors envers et contre tous la « certaine idée » qu’il se faisait de la France: son indépendance totale dans tous les domaines ; son aptitude à résoudre seule ses problèmes, à commencer par ceux de l’Algérie et par la liquidation « à l’amiable » de l’Empire français.
La France le suivit, mais pas toujours avec l’enthousiasme qu’il attendait d’eux. I (p.305) … Ses étonnantes initiatives et prises de position vont se succéder rapidement : la première bombe atomique française et le développement continu de l’arme de dissuasion nucléaire ; en mars 1966 l’ exigence du retrait du territoire français de tous les organismes de l’O.T.A.N. Ceci impliqua pour la Belgique l’obligation morale de les accueillir, et cela en un temps record. Ce fut ensuite une attitude d’hostilité latente à l’égard des États-Unis ; les expériences nucléaires dans l’océan Pacifique, le voyage agressif, mais sans résultat concret (août-septembre 1966) en Amérique du Sud ; l’offensive monétaire contre l’or américain ; le fameux voyage au Canada français, en juillet 1967 et le cri « Vive le Québec libre », qui permit de craindre une incartade analogue à l’occasion d’un éventuel voyage en Belgique.
Lorsque la France eut refusé de répondre positivement à un nouveau référendum maladroitement engagé, le 27 avril 1969, au sujet de la régionalisation, de Gaulle se retira aussitôt. Des élections présidentielles portèrent, le 15 juin 1969, Georges Pompidou au pouvoir. Une certaine détente se manifesta tout d’abord en politique étrangère, surtout du côté des États-Unis et du Royaume-Uni.
Mais il semble bien qu’il y ait eu un retour en force ultérieur de l’idéologie gaulliste ; que les intérêts français doivent primer tous les autres ; que l’opposition au sein de la C.E.E. soit chaque fois, ou peu s’en faut, le fait du gouvernement français.
Tout cela va à l’encontre de la « vocation européenne » des pays du Benelux. Et c’est sur ce plan uniquement que l’on peut encore parler de relations entre la France et la Belgique. L’on se prend à méditer cette notation du duc de Castries, dans » la postface de son Histoire de France . « La France est le pays qui a empêché l’Europe de se faire, et sa grandeur est issue de son effort constant dans cette ligne, qui n’est toujours pas abandonnée.»
(p.306) À la rigueur, certains consentirent à « faire l’Europe sans défaire la France » ; d’autres, plus ambitieux, veulent la faire à la condition que la France la domine. Il y a certainement un malaise, et la Belgique, au sein du Benelux, ne se sent pas en confiance avec la France.
La France fut longtemps une superpuissance. À deux reprises elle exerça pendant plusieurs dizaines d’années une véritable hégémonie européenne. …
Ce passé est irrémédiablement révolu. D’autres peuples et d’ autres continents sont montés en puissance. Mais une partie de l’opinion publique française et ses milieux dirigeants ont gardé la nostalgie de ce passé. …
La France a trouvé une nouvelle fierté dans le développement de son potentiel militaire nucléaire. Il est certes techniquement redoutable, mais que vaut-il réellement sur le plan de la dissuasion, son objet? …
On ne peut s’empêcher de rapprocher ce dogme militaire du moment des dogmes précédents qui ont imprégné les théories militaires françaises depuis plus de cent ans :
– la stricte observance des méthodes du premier Empire (mais sans le génie de Bonaparte), en 1870 ;
– la théorie de l’offensive à outrance, avant 1914;
-le mythe de la ligne Maginot, avant 1939.
La Belgique possède, elle aussi, une industrie nucléaire puissante et avancée, mais qui a été exclusivement orientée vers les utilisations pacifiques. Près de soixante-dix pour cent de la production d’énergie électrique en Belgique provient de ses centrales nucléaires, à tort ou à raison, peu importe. Il eût été – et est toujours – facile et relativement peu coûteux de fabriquer en quelques semaines une bombe atomique belge. L’idée n’en est jamais venue à personne.
(p.307) CHAPITRE XXXVIII Peuples voisins, amis ou frères ?
Tous les chapitres qui précèdent montrent clairement que la France et les Pays-Bas du Sud – la Belgique actuelle – n’ont jamais eu d’histoire commune, en dehors des vingt années d’incorporation à la République puis à l’Empire, de 1794 à 1814. A toutes les autres époques – et même à l’époque du Directoire – les rapports politiques ont été entre Belgique et France plus souvent tendus, voire conflictuels, qu’amicaux.
La France est un pays originellement hétérogène, produit de conquêtes militaires ou d’acquisitions pacifiques successives. Telle fut la politique séculaire des « rois qui firent la France ». La tendance centralisatrice progressive des rois, puis brutale des Jacobins et de l’Empire, unifia le pays et lui donna un sentiment évident d’appartenance nationale. Même les régions – Languedoc, Franche-Comté, Flandre française, Corse – qui s’étaient farouchement opposées à la conquête se laissèrent ultérieurement assimiler sans trop de problèmes, et sans pour autant perdre leurs caractéristiques propres. La politique de la IIIe République en matière d’instruction primaire et de service militaire paracheva le processus d’unification. La télévision ne fait qu’accentuer le sentiment d’homogénéité culturelle et historique.
La Belgique, elle, quoique de taille très inférieure à celle de 1a–7 France – territoire dix-huit fois plus petit., population six fois – hétérogène. … L’histoire de la Belgique est celle de particularismes féodaux et communaux. Jamais une centralisation quelconque n’y a été réussie, quoiqu’elle fût parfois esquissée, mais en vain.
(p. 311) Anarchiste et frondeur-né, le Belge a toujours récusé l’ autorité politique de quelques dirigeants que ce soient. C’est pourquoi il n’a pas cru souvent utile d’en changer.
La révolution de 1830 est une exception dans son histoire.
La « révolte des gueux » au XVIe siècle n’était pas destinée à substituer un autre chef d’État à Philippe II, mais à exiger de lui le respect des chartes traditionnelles des Pays-Bas. À travers l’histoire de la Belgique, l’acceptation de ses princes légitimes – souverains de ses provinces par mariage ou par héritage – est toujours allée de pair avec l’exigence d’un État minimal, exigence d’ailleurs souvent satisfaite à travers les siècles.
Malgré la complexité actuelle de ses institutions et le poids , excessif de son administration publique, le Belge d’aujourd’hui reste toujours le farouche partisan d’un État minimal. S’il respecte sa monarchie, c est qu’elle règne et ne gouverne pas. Toute législation lui inspire avant tout le souci de la tourner. Les notions de nationalisme et de patriotisme telles qu’on les connaît en France lui sont étrangères. Elles sont remplacées par un attachement viscéral à son indépendance et à ses libertés personnelles, ainsi que par une solidarité sociale bien plus développée que chez sa voisine du sud.
Là peut-être réside la principale différence dans l’ attitude politique des Français et des Belges.
Frères? Non, le mot n’est pas adéquat.
2 Documents

Wallonie jacobine - La France a tenté 54 fois de s'emparer de la Belgique
(Robert Steuckers, in: RE, 78, 2009)


Frankrijk vernietigde de Vlaamse cultuur (Karl van den Broeck)
(Knack, 08/12/2010)
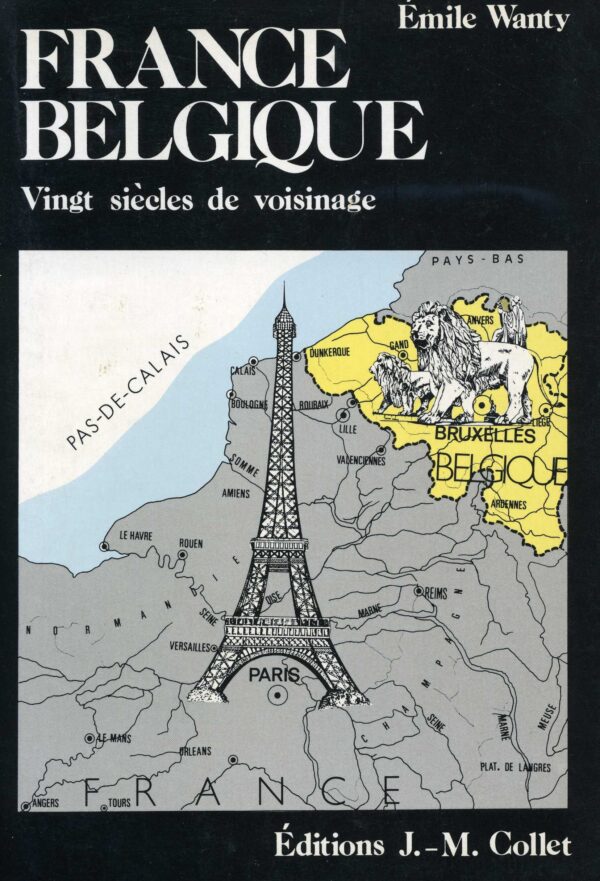

Le tricentenaire du siège de Namur, une arnaque William Raes)
(VA, 23/02/1990)
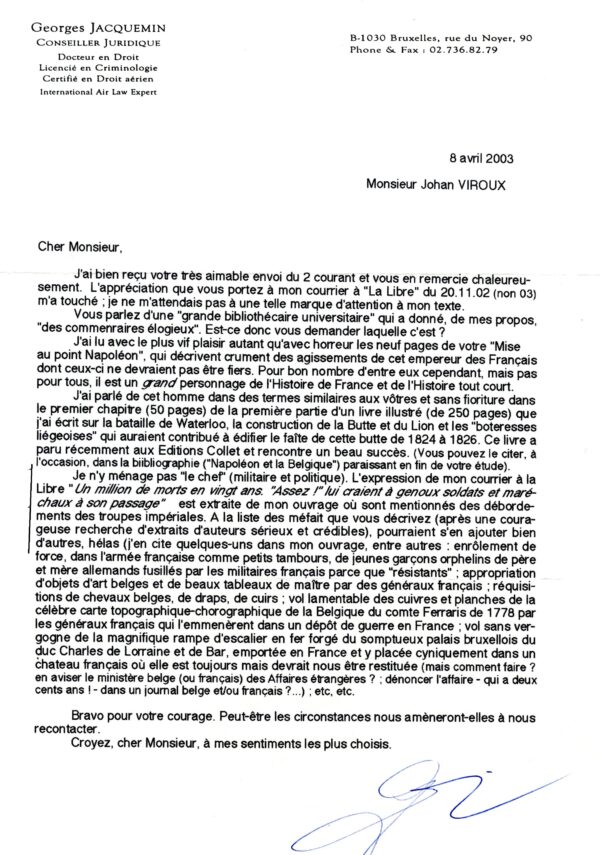
Mise au point concernant l'occupation française en Belgique (Georges Jacquemin)
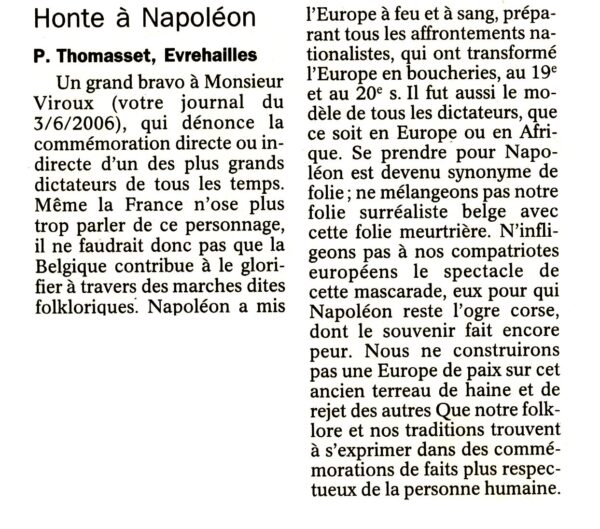
Honte à Napoléon (P. Thomasset (Evrehailles))
(VA, 01/06/2006)

Les guerres napoléoniennes ont décimé la jeunesse belge
(in: René Henry, Vertiges du passé, AO, 12/09/2013)

Au contraire de l'Allemagne avec la 2e guerre mondiale, la France n'assume pas sa responsabilité dans les guerres napoléoniennes (Daniel Defrère (Templeuve))
(VA, 15/09/2014)

L'école nous a bien menti à propos de Napoléon
(DH, 19/06/2015)

