ISLAM DANS LE MONDE : RÉVÉLATIONS

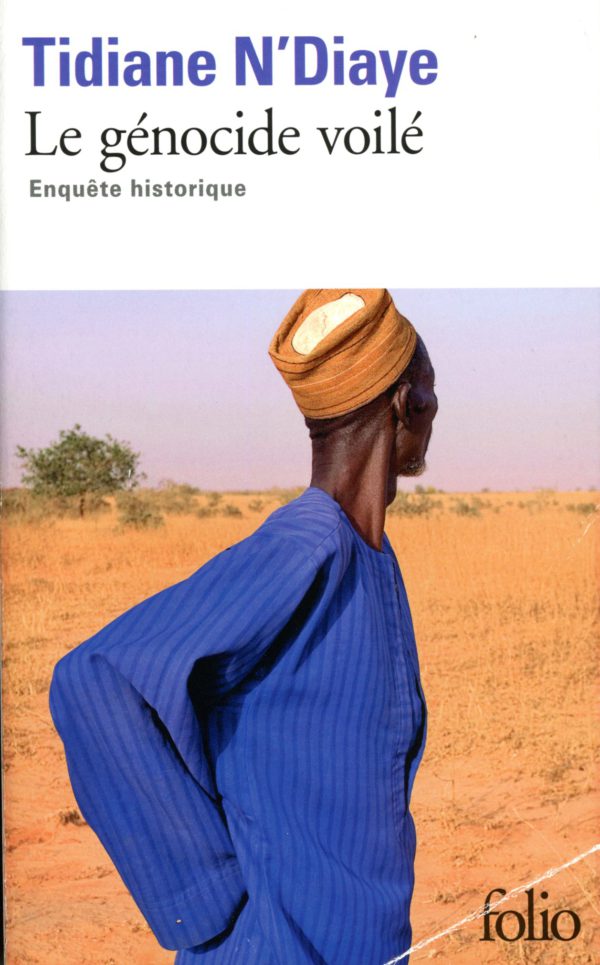


Histoire de l’esclavage arabo-musulman
Tidiane N’Diaye, Le génocide voilé, Gallimard, 2008 (extraits)
(p.9) Les Arabes au cours de leurs mouvements de conquête, ont d’abord pris, soumis et islamisé l’Afrique du Nord, avant de se diriger vers l’Espagne. Dans ce pays, ils développèrent une brillante civilisation, symbolisée par les émirats et califats de Cordoue. Puis, à leur retour en Afrique, dans une nouvelle vague d’islamisation des peuples, ils amenèrent avec eux une cascade de malheurs. Sous l’avancée arabe, la survie était un véritable défi pour les populations. Des millions d’Africains furent razziés, massacrés ou capturés, castrés et déportés vers le monde arabo-musulman. Cela dans des conditions inhumaines, par caravanes à travers le Sahara ou par mer, à partir des comptoirs à chair humaine de l’Afrique orientale. Telle était en réalité la première entreprise de la majorité des Arabes qui islamisaient les peuples africains, en se faisant passer pour des piliers de la foi et les modèles des croyants. Ils allaient souvent de contrée en contrée, le (p.10) Coran d’une main, le couteau à eunuque de l’autre, menant hypocritement une « vie de prière », ne prononçant pas une parole sans invoquer Allah et les hadiths* de son Prophète.
Beaux et nobles principes en vérité, mais que foulèrent aux pieds – avec quelle allégresse, quelle indignité et quelle mauvaise foi ! – ces négriers arabes, qui mettaient l’Afrique à feu et à sang. Car, derrière ce prétexte religieux, ils commettaient les crimes les plus révoltants et les cruautés les plus atroces. Cela fit dire à Edouard Guillaumet : « Quel malheur pour l’Afrique, le jour où les Arabes ont mis les pieds dans l’intérieur. Car avec eux ont pénétré et leur religion et leur mépris du Nègre… »
Si de nos jours, pour ce qui est de l’islamisation de peuples africains, dans la plupart des pays, la religion du prophète Mohamed – avec son prestige social et intellectuel — a fait d’énormes concessions aux traditions ancestrales en s’intégrant harmonieusement sans détruire les cultures et les langues, il n ’en a pas toujours été ainsi : l’histoire de ces Arabes qui plongèrent les peuples noirs dans les ténèbres fut surtout celle du mal absolu.
Alors que la traite transatlantique a duré quatre siècles, c’est pendant treize siècles sans interruption que les Arabes ont razzié l’Afrique subsaharienne. La plupart des millions d’hommes qu’ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée.
La traite négrière arabo-musulmane a commencé (p.11) lorsque l’émir et général arabe Abdallah ben Saïd a imposé aux Soudanais un bakht (accord), conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d’esclaves. La majorité de ces hommes était prélevée sur les populations du Darfour. Et ce fut le point de départ d’une énorme ponction humaine, qui devait s’arrêter officiellement au début du XXe siècle.
Cette douloureuse page de l’histoire des peuples noirs n’est apparemment pas définitivement tournée. Au lendemain du second conflit mondial et de la découverte des horreurs de la Shoah, l’humanité a pris la mesure exacte de la cruauté de l’homme et de la fragilité de sa condition. Sous le choc, la communauté internationale déclara, en l’espèce d’un célèbre et mémorable never again, que plus jamais elle ne laisserait de tels événements se produire. Il apparaîtra d’autant plus absurde aux historiens du futur qu’en ce début du XXIe siècle, au Soudan, se déroule une véritable entreprise de nettoyage ethnique des populations du Darfour.
En avril 1996, l’envoyé spécial des Nations unies pour le Soudan faisait déjà état d’une
« augmentation effrayante de l’esclavagisme, du commerce des esclaves et du travail forcé au Soudan ». En juin de la même année, deux journalistes du Baltimore Sun, qui s’étaient également introduits dans ce pays, écrivaient dans un article intitulé « Deux témoins de l’esclavage » qu’ils avaient réussi à acheter des jeunes filles esclaves, pour les affranchir. Décidément, du VIIe siècle au Darfour XXIe siècle, l’horreur continue avec cette fois le nettoyage ethnique en plus.
(p.12) Il serait grand temps que la génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat, au même titre que la ponction transatlantique. Car, bien qu’il n’existe pas de degrés dans l’horreur ni de monopole de la cruauté, on peut soutenir, sans risque de se tromper, que le commerce négrier arabo- musulman et les jihâd* (guerres saintes) provoqués par ses impitoyables prédateurs pour se procurer des captifs furent pour l’Afrique noire bien plus dévastateurs que la traite transatlantique. Et ce, encore sous nos yeux aujourd’hui (janvier 2008), avec son lot de massacres, avec son génocide à ciel ouvert.
Tidiane N’Diaye
(p.16) On sait que l’homme fut de tout temps soumis « au joug de l’Homme » (saint Augustin) : esclavage, servage*, voire, de nos jours, prostitution et exploitation des enfants… Ce fut le lot des civilisations, aucune n’y a échappé. Aussi, proclamer que telle société fut
« esclavagiste » ou eut telle ou telle pratique immorale est, en quelque sorte, s’ériger en juge d’une tare probablement universelle. Car Africains, Européens (Grecs, Romains, etc.), Arabes, Persans, Chinois, Indiens du Mexique et des Andes, tous, peu ou prou, se sont employés, sous diverses formes, à la pratique d’un système que notre éthique moderne réprouve. La force ou les religions furent les armes qui permirent de l’imposer en toute tranquillité d’esprit. Chrétiens et musulmans en abusèrent.
(p.17) (…) historiquement la traite négrière est une invention du monde arabo-musulman.
L’ampleur de cette tragédie inaugurée par les Arabes est en cela unique : elle correspond à une forme inédite d’esclavage, de par son intensité, sa justification, sa nature mais surtout sa durée – treize siècles – et le nombre de sociétés qui l’ont pratiqué. Cette entreprise gigantesque aurait pu conduire à la disparition totale des peuples noirs sur le continent africain. Tout cela pour satisfaire les besoins expansionnistes, marchands et « domestiques » des nations arabo- musulmanes.
(p.19) Les Romains entretinrent des relations suivies avec les Afris, d’où découle le nom d’Afrique. Ces Afris étaient des guerriers de la tribu des Awragas, qui occupaient le sud de la Tunisie.
(p.24) Mais le cours de l’histoire de leurs relations, notamment avec les Arabes devenus maîtres de l’Egypte islamisée, évoluera à nouveau. Car dès le VIIe siècle de notre ère, les Arabes ayant conquis l’Egypte allaient y asservir de nombreux peuples venant de la Nubie, de Somalie, du Mozambique ou d’ailleurs, au cours de la première expansion islamique. Les Nubiens avaient été durement (p.25) secoués par les foudroyantes attaques des forces arabes. Ils se défendirent courageusement, mais, devant une supériorité numérique et la détermination des soldats du jihâd (la guerre sainte contre les incroyants), ils préférèrent négocier la paix en concluant, en 652, un traité connu sous le nom de bakht. C’est l’émir Abdallah ben Saïd qui se chargea des négociations avec le roi nubien Khalidurat. Un traité fut conclu en ces termes :
Article 1 : Traité accordé par l’émir Abdallah ben Saïd au roi de Nubie et à tous ses sujets auquel tous les Nubiens […], depuis les frontières d’Alwa, sont tenus de se conformer.
Article 2 : Abdallah ben Saïd leur accorde un acte de garantie et un armistice, qui les rendent alliés de tous les musulmans, tant de ceux du Sud que des autres contrées et des peuples tributaires. O peuple de Nubie, vous serez en sûreté sous la protection de Dieu et de son envoyé Muhammad. Nous nous engageons à ne point vous attaquer, à ne susciter contre vous aucune guerre et à ne point faire de razzias dans votre pays, tant que vous serez fidèles à observer les conditions stipulées entre vous et nous et dont voici le détail.
Article 3 : […] Si des esclaves appartenant à des musulmans se réfugient auprès de vous, vous ne les retiendrez point, mais vous les ferez conduire en territoire musulman.
Article 5 : Vous livrerez chaque année trois cent (p.26) soixante esclaves des deux sexes, qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays et envoyés à l’Iinam des musulmans. Tous seront exempts de défauts. On ne présentera ni vieillards décrépits, ni vieilles femmes, ni enfants au-dessous de l’âge de la puberté. Vous les remettrez au gouverneur d’Assouan.
C’est ainsi qu’une traite négrière fut pour la première fois inventée et planifiée par les Arabes lorsque cet émir et général Abdallah ben Saïd imposa aux Nubiens la livraison annuelle et forcée de centaines d’esclaves. La majorité des hommes objets de ce contrat était prélevée sur les populations du Darfour. Il faudra attendre que les Arabes se lassent de la Nubie, leur premier « réservoir » d’esclaves, pour qu’ils se lancent à l’assaut du reste du continent africain.
Mais tout a commencé là, au Darfour, et cela n’a apparemment jamais cessé. C’est le mépris des Arabes pour les Noirs qui continue de s’y manifester cruellement aujourd’hui encore par une pratique de l’esclavage à peine dissimulée et par un véritable nettoyage ethnique. En fait, le bakht conclu en 652 par l’émir et général Abdallah ben Saïd fut le point de départ d’une énorme ponction humaine, qui sera effectuée non seulement dans toute la bande soudanaise mais aussi de l’océan Atlantique à la mer Rouge en passant par l’Afrique orientale. Cette ponction, pratiquée soit localement, soit bien au-delà (p.27) des régions du monde musulman, se prolongera du viie au xxie siècle, sous nos yeux, au Darfour, avec son lot de massacres, pour ne pas parler de génocide.
Les Arabes, bien avant les Européens, allaient ainsi opérer une interminable guerre sainte avec ses razzias sanglantes, ruiner les populations, pour la grande gloire des harems d’Orient. Cette traite fournissait des enfants, des femmes et des hommes tirés de l’intérieur du continent noir. La demande d’esclaves du monde arabo-musulman entraîna la mise en route de deux courants de traite. L’un, terrestre, conduisait les captifs du subcontinent au nord, à travers le Sahara (traite transsaharienne). L’autre, maritime, acheminait les captifs des ports de la côte est de l’Afrique jusqu’en Orient (traite orientale). Nous verrons plus loin que les contrées qui profitaient le plus de cette infamie étaient essentiellement la Turquie, l’Egypte, la Perse, l’Arabie, la Tunisie et le Maroc. Les Arabes avaient ainsi ouvert une voie balisée d’humiliations, de sang et de morts, qu’ils seront les derniers à refermer officiellement au xxe siècle, longtemps après les Occidentaux.
(p.33) Du portugais casto (« pur »), ce mot, symbole de classes strictement hiérarchisées dans beaucoup de civilisations, désigne le plus souvent un système appliqué depuis plus de trois mille ans en Inde.
(p.35) Les sociétés africaines précoloniales étaient, il est vrai, très inégalitaires, comme le rapporte le docteur Livingstone. Selon les récits – confirmés par les griots – des premiers Occidentaux ayant parcouru l’Afrique noire, on estime qu’un quart des hommes avaient un statut de captifs ou de travailleurs forcés, et que quatorze millions d’individus étaient rangés dans cette catégorie.
(p.36) La structure des sociétés africaines, avant l’arrivée des Arabes, pourrait s’apparenter à celle d’une société féodale, avec ses tribus suzeraines (p.37) et d’autres plus ou moins vassales. Pour la plupart des monarques ou chefs africains, les captifs n’en demeuraient pas moins leurs frères : ils pouvaient les servir comme domestiques, guerriers ou autres travailleurs forcés, mais nul n’avait le droit de leur enlever leur dignité, de les séparer violemment de leurs familles, de les vendre aux enchères et de les rouer de coups.
Le servage interne africain n’existait que comme institution quasi patriarcale, sans cruelles chasses à l’homme ni ventes publiques. Dans ce système, les griots gardiens de la mémoire ne rapportent pas de cas de tortures ou d’autres cruautés. Guerrier ou domestique, le captif ne faisait l’objet d’aucun acte de sadisme gratuit, comme le fouet à tout bout de champ ou l’ablation des parties génitales, pratiques courantes chez les Arabo-Musulmans.
(p.39) Dans la plupart des sociétés africaines précoloniales, à leur entrée dans l’âge nubile, les adolescentes libres étaient « mariées » par leur propre père à leur futur maître et époux, en échange d’une valeur symboliquement appelée dot. Mais elles consacraient souvent le restant de leur vie à rembourser cet investissement par leur travail et des prestations sexuelles. Car cette cession n’était en réalité qu’une vente. Ces formes de « contraintes » sont d’autant plus condamnables qu’elles se perpétuent encore de nos jours.
(p.42) Car nombreux sont les témoignages effrayants, rapportant la férocité de certains monarques, notamment de quelques royaumes d’Afrique centrale.
Par exemple, à la cour du roi Mtéza, Stanley rapporte que, pour satisfaire un simple caprice, le monarque faisait couper les têtes de quelques centaines de ses captifs. Quant aux femmes qui composaient sa maisonnée, il ne se passait pas de jour où une ou deux de ces malheureuses n’étaient conduites, une corde enroulée autour du poignet, traînées ou tirées par les gardes (p.43) du corps, vers l’abattoir. La peur du souverain empêchait quiconque de se lever pour les arracher au bourreau.
Quand un roi du Dahomey (actuel Bénin) mourait, on lui érigeait une espèce de cénotaphe entouré de barres de fer, surmonté d’un cercueil en terre, cimenté du sang d’une centaine de captifs sacrifiés, pour servir de gardes au souverain dans l’autre monde. Lors des fêtes sanguinaires nommées « Grandes Coutumes », on égorgeait des centaines de captifs à la fois, pour qu’ils aillent porter au roi défunt la nouvelle du couronnement de son successeur.
Cependant, hormis ces exceptions notables, la condition des captifs africains, employés à cultiver la terre, servant de domestiques ou de soldats, ne ressemblait en rien à celle des Africains qui étaient asservis en terres arabo-musulmanes ou dans le Nouveau Monde. Quelles qu’aient été les formes d’asservissement dans la plupart des sociétés négro-africaines, elles ne sauraient être comparées aux horreurs des traites arabo- musulmane et transatlantique, autrement dit à des pratiques débouchant sur des déportations massives et des traitements mutilants, traumatisants ou meurtriers. Le servage africain, accepté avec résignation par les populations, s’est intégré à leur mode d’existence.
(p.45) En Afrique de l’Ouest tout avait commencé avec l’arrivée des Maures. De son premier voyage, l’Écossais Mungo Park (1771-1805) a rapporté de précieuses indications sur les sociétés africaines précoloniales. Il note qu’en marge du fonctionnement traditionnel de ce monde négro-africain évoluaient de nouveaux venus, les Maures.
Mungo Park insiste sur la haine des Noirs pour ces Maures (Africains blancs arabisants), qui avaient été les premiers à importer sur les terres d’Afrique de l’Ouest des formes d’asservissement très différentes des pratiques en cours avant leur arrivée. Ces négriers et commerçants installés en Mauritanie, qui apportaient aussi la gomme au Sénégal, le général Faidherbe nous les décrit comme des nomades de la partie occidentale du Sahara : « Ils étaient si cruels envers les naufragés et à qui ceux-ci ont fait, dans leurs récits, une si terrible réputation en en traçant un affreux portrait. Beaucoup de (p.46) personnes se figuraient que “Maure” est le vrai nom des populations blanches du nord de l’Afrique, nomades au Sénégal et boutiquiers dans les villes d’Algérie. En fait ce mot qui est d’origine sémitique et qui veut dire “Occidentaux” était parfaitement inconnu aux uns et aux autres. Le mot par lequel les nomades de la rive droite du Sénégal se désignent eux-mêmes et sont désignés dans le pays est “nar”. La contrée qu’ils habitent, jusqu’à une limite indéterminée vers le nord, est désignée par les habitants du Sénégal par le mot “ganar”, qui a peut-être la même origine que les noms de géographie ancienne : cap Ganaria (au sud du Maroc) ; îles Ganaria, donné d’abord à la plus grande île des Canaries. Ces Maures sont d’une grande malpropreté, ce qui s’explique par la rareté de l’eau chez eux et les Mauresques sont encore plus malpropres que les hommes. » Il était notoirement connu que ces Maures étaient avec leurs captifs d’une rigueur qui allait jusqu’à la cruauté, sans parler de leur exigence de labeur, qui était à la limite des forces humaines. Tandis que les maîtres wolofs, toucouleurs ou peuls (négro-africains) étaient humains avec leurs captifs et adaptaient le travail aux forces de chacun. Mungo Park lui-même ne portait pas ces Maures dans son cœur et leur reprochait leurs « menteries ». Il soulignait la fréquence des guerres, qui étaient de deux types ; d’une part des guerres formelles de prestige, à l’européenne, d’autre part – (p.47) surtout depuis l’arrivée des Arabes – des razzias, c’est-à-dire des coups de main ayant pour objectif principal la vengeance et la quête de captifs.
Toutes ces indications rapportées par Mungo Park figurent dans les traductions du Voyage à l’intérieur de l’Afrique. Quant à la cruauté de ces premiers négriers maures arabisants, le général Louis Faidherbe ajoute : « Vers 1850, sous les murs de Dagana, au retour d’une expédition de razzias, deux cavaliers maures trarzas se disputaient un enfant de quelques mois. Ils allaient en venir aux mains, quand survint un troisième Maure, qui, pour rétablir la paix, ne trouva rien de mieux que de supprimer la cause du conflit : il prit l’enfant par un pied, le fit tournoyer au- dessus de sa tête et lui brisa le crâne contre un arbre. Dans notre dernière campagne contre ces Maures trarzas, en 1855, ils nous avaient pris un matelot qui s’était égaré de la colonne, vis-à-vis de Gaé ; il fut à moitié assommé par les femmes, à coups de pilon à mil et désarticulé successivement aux poignets, aux chevilles, aux coudes, aux genoux, aux cuisses et aux épaules. C’est par de semblables cruautés que les Maures arrivent à inspirer une profonde terreur aux Nègres. »
Ainsi, comme nous le verrons, c’est l’arrivée des Arabo-Musulmans et l’islamisation des peuples poussés au jihâd qui ont marqué un tournant dramatique dans les pratiques (p.48) d’asservissement en Afrique. Parce qu’elles furent le point de départ d’une ignoble entreprise de destruction et de ruine par treize siècles de chasses à l’homme sans interruption, d’humiliations, de souffrances, de mépris, de rafles et d’embuscades meurtrières. Il est vrai que depuis l’Antiquité le nombre d’Africains asservis à l’extérieur du continent noir est difficile à estimer. Mais l’énorme ponction humaine que devaient subir les peuples noirs, de façon aussi lente qu’étalée – du vif au xxie siècle -, sera qualifiée par les historiens et anthropologues de premier commerce de traite, avec des pratiques inhumaines et des exportations sur de longues distances. Cette entreprise criminelle sera d’autant plus dure et plus bestiale que, dans l’imaginaire commun des peuples arabo-musulmans, le Noir païen ou fétichiste n’était qu’un sous-homme. Quant au converti, il restera jusqu’à nos jours, à leurs yeux, qu’ils l’avouent ou non, un être invariablement inférieur.
(p.50) Le Guide de l’Islam est universellement connu sous differents noms. Les Arabes l’appellent Muhammad ou Mohammed, qui signifie « Celui qui est louangé ». Mehmet quant à lui est le nom par lequel les Turcs désignent le Prophète. Cette appellation turque est à l’origine de Mahomet, adopté et adapté à la phonétique française par les historiens francophones, à partir d’une transcription qui remonte au xvne siècle. Cependant, de nombreux auteurs contemporains utilisent la version anglaise Muhammad ou Mohammed, Mohamed, Mouhammad… et encore Mamadou, nom sous lequel les musulmans d’Afrique occidentale désignent le Prophète. Quant à Islam*, il signifie « soumission à Dieu ». C’est la troisième grande religion révélée du monde. Rigoureusement monothéiste, l’Islam affirme l’unicité (p.51) absolue d’Allah (Dieu) et sa présence dans la vie quotidienne des hommes.
(p.51) Le mot arabe Ei-Qor’ân, dont on a fait le Coran, signifie « la Lecture » ou « la Récitation ».
(p.52-53) Dans son « Study of History », l’historien anglais Arnold Toynbee semble le confirmer : « Les premiers Arabes, qui constituaient les (p.53) dirigeants du califat omeyyade, se qualifiaient de “peuple basané”, avec une connotation de , supériorité raciale, alors que leurs sujets perses et turcs étaient appelés “les peuples rougeauds”, avec une connotation d’infériorité raciale : (…).
(p.56) Ibn Khaldun développe dans l’introduction de son ouvrage d’histoire universelle, al-Muqaddima (Les Prolégomènes), l’idée que le climat a des influences directes sur l’état des civilisations et sur le caractère des peuples. Les Noirs et les (p.57) Slaves y sont indistinctement décrits comme appartenant aux peuples « à caractère bestial ». Mais il se montre particulièrement méprisant envers les Noirs. Le penseur arabo-berbère prétendait qu’ils sont généralement caractérisés par la légèreté, l’inconstance, l’émotivité et qu’ils ont envie de danser dès qu’ils entendent de la musique. C’est pourquoi on les dit stupides. Et Ibn Khaldun d’ajouter que la joie et le contentement résultent de la dilatation et de la diffusion de l’esprit animal. Inversement la tristesse est due à la contraction de celui-ci. Par une démonstration tortueuse et sélective, ce théoricien musulman prétendait que les Noirs vivent dans des pays où la chaleur domine leur tempérament et leur formation, ce qui expliquerait leur stupidité et leur degré d’infériorité.
Plus précis encore, Saïd ben Ahmad Saïd – probable inspirateur d’Ibn Khaldun -, auteur de plusieurs ouvrages sur la « question raciale » entre 1050 et 1060, classait les peuples en sept grandes familles correspondant aux sept climats.
(p.61) Et au plus fort de la traite arabo-musulmane en Afrique, le père Guillaumet rapportait ceci :
« Puisque j’en suis à Oujiji à la station de Kibanga sur le Tanganyika, je dois en dire un mot en passant. Mais je me sens incapable de décrire cette ville telle que je l’ai vue et la plume se refuse à raconter toutes les horreurs qui s’y commettent. Oujiji est le centre arabe le plus populeux du Tanganyika. C’est là qu’aboutissent toutes les caravanes d’esclaves pris dans l’intérieur et dirigés vers Zanzibar* ; c’est là que se réunissent tous les Arabes, pour concerter entre eux de quel côté et dans quel pays ils feront leurs razzias ; c’est de là que partent toutes les bandes de pillards qui inondent maintenant le Manyéma et qui achèvent d’anéantir ce pays autrefois si peuplé. Véritable Sodome, elle est le théâtre de tous les crimes, de toutes les débauches, de toutes les horreurs, de tous les vices. Quel malheur pour l’Afrique, le jour où les Arabes ont mis les pieds dans l’intérieur. Car avec eux ont pénétré et leur religion et leur mépris du Nègre… »
Chez les Arabes bien des écrits témoignent de leur solide mépris envers les peuples du bilad as-Sudan* (le pays des Noirs). Jusqu’à l’abolition théorique de l’esclavage arabo-musulman au xxe siècle, dans les pays centraux de l’Islam – (p.63) voire dans d’autres comme le Soudan avec ses populations du Darfour -, même affranchi jamais un Noir ne s’élevait au-dessus du niveau le plus bas. Certes de nombreux fils ou petits- fils de concubines noires se sont illustrés à la tête d’armées arabes ou du premier califat, comme Omar et Amr Ibn Al’ As, conquérant de l’Egypte. Et le célèbre eunuque nubien Abû ’l-Musk Kafur devint régent d’Egypte au Xe siècle. Mais cela n’empêcha pas le grand poète arabe Al Mutanabbi de lui dédier cette satire injurieuse :
Jamais je n ’aurais pensé vivre pour voir le jour
Où un chien me ferait du mal et en serait loué
Pas plus que je n ’imaginais voir disparaître
Les hommes dignes de ce nom
Et subsister l’image du père de la générosité
Et voir ce nègre avec sa lèvre percée de chameau
Obéi par ces lâches mercenaires.
……
Qui a jamais enseigné la noblesse à ce nègre eunuque ?
Sa parentèle « blanche » ou ses royaux ancêtres ?
Ou son oreille qui saigne dans les mains du négrier,
Ou sa valeur, car pour deux sous on le rejetterait ?
Il faut l’excuser compte tenu de toute bassesse –
Mais une excuse est parfois un reproche —
Et s’il en est ainsi parce que les étalons blancs
Sont incapables de noblesse, alors que dire
D’eunuques noirs ?
Et le poète d’ajouter:
Celui qui vous tient par sa parole ne ressemble pas à celui qui vous tient dans sa prison –
La mortalité de l’esclave noir est limitée par son sexe puant et ses dents.
Et si tu as des doutes sur sa personne et sa condition
Vois quelle est sa race.
(p.63) En fait les Egyptiens appelaient leur pays Khémit, ce qui veut dire « noir », manifestement parce qu’ils avaient cette couleur de peau.
(p.64) Toutefois, lorsque les données démographiques et les rapports de force commencèrent à évoluer au détriment des Noirs – environ dix-neuf siècles avant notre ère -, était érigée par Sésostris III une stèle qui portait cette inscription : « Frontière sud, stèle élevée en l’an viii, sous le règne de Sésostris III, roi de haute et de basse Egypte, qui vit depuis toujours et pour l’éternité. La traversée de cette frontière par terre ou par eau, en barque ou avec des troupeaux est interdite à tout Noir, à la seule exception de ceux qui désirent la franchir pour vendre ou acheter dans quelque comptoir. Ces derniers seront traités de façon hospitalière, mais il est à jamais interdit à tout Noir, dans tous les cas, de descendre le fleuve en barque au-delà de Heh.»
Et beaucoup plus tard, la conquête arabe de l’Afrique et l’islamisation de ses peuples ne changeront rien à l’image du Noir dans le monde arabo-musulman. La conversion des peuples africains ne les préservera nullement de l’état de « proie », en dépit de leur statut d’« étrangers » et de « récents convertis ». Allait apparaître chez (p.65) les Arabes une « absolutoire » commode, qui est la version arabo-musulmane de la malédiction de Cham*.
Ces lettrés invoquaient la suprématie raciale des Blancs, qui se fondait sur ce récit où les Noirs étaient considérés comme « inférieurs » et « prédestinés » à être esclaves. Selon cette construction où histoire et légende se croisent, « les descendants de Cham étaient condamnés à être les esclaves de ses frères Sem et Japhet ». Cette malédiction de Cham vint au secours des négriers arabo-musulmans, pour tenter de justifier leurs actes barbares. Or, avant le xiie siècle, ce récit, qui avait conservé un caractère très abstrait, n’avait jamais été vraiment associé à une quelconque notion de couleur ou de race. Il faut préciser également qu’avant le véritable essor de la traite, les représentations de l’Afrique et des Africains en Europe n’étaient pas encore péjoratives. Les lettrés arabes furent les premiers à recourir à la malédiction de Cham pour justifier l’esclavage des populations noires. Cette construction a été abusivement « collée » aux peuples noirs, comme un fardeau héréditaire.
En fait l’histoire (ou légende) de cette malédiction concernait les enfants de Canaan, que les Israélites soumirent lors de la conquête de la Terre promise, si loin de l’Afrique noire. Dans la version biblique de cette légende, la malédiction (Genèse, IX, 1-27) tombe sur le plus jeune des fils et pas sur les autres, dont (p.66) Kouch, qui serait, dit-on, l’ancêtre des Noirs. À l’origine, les Cananéens, esclaves des Israélites, étaient leurs proches cousins. Il fallait donc trouver une justification religieuse, voire idéologique, à leur asservissement. En réalité, tout cela n’était qu’un prétexte, racisme et théologie se conjuguant pour donner à la condition réservée aux Noirs en terres arabo-musulmanes un justificatif acceptable. L’interprétation des textes sacrés laissait libre cours à ceux qui en avaient jugé de décider du sort des Africains, convertis ou non.
(p.66) Le mot arabe abid (ou abd), qui signifiait esclave, est devenu à partir du viiie siècle plus ou moins synonyme de « Noir ».
(p.67) Bien avant le Nouveau Monde ou l’apartheid en Afrique du Sud, on avait inventé dans le monde arabe une ségrégation raciale excluant les Noirs, à côté de qui on ne marchait jamais dans la rue. La traite négrière arabo-musulmane a donc été l’une des plus anciennes ouvertures vers la hiérarchisation des « races ». Convertis ou non, les Noirs y étaient toujours traités en inferieurs. Un explorateur colonial français (Charbonneau) notait en 1677 : « On a dit que la conversion à l’Islam était d’un grand bénéfice pour les Noirs car un musulman ne réduisait pas à l’esclavage d’autres musulmans. Cette immunité a peut-être été valable en d’autres pays mais certainement pas au Sénégal. » Il y avait, dit-il, un bon nombre de captifs musulmans dans les baraquements de la traite, y compris un saint homme et pieux musulman.
(p.70) En fait, les négriers arabo-musulmans ont ratissé le continent noir avec un grand mépris, jusqu’au nord de l’actuel Ghana et le long d’une ligne qui sert aujourd’hui de frontière avec la Côte d’ivoire. Là, subsiste la route dite des mosquées. C’est dans ce secteur qu’en même temps qu’ils convertissaient – ce qui pouvait passer pour le meilleur des prétextes – ils n’en rassemblaient pas moins des caravanes de captifs destinées à Djenné et à Tombouctou.
(p.71) Et pour incroyable que cela puisse paraître, un^ rapport de l’ambassadeur de France en Arabie Saoudite datant de 1955 nous apprend que des trafiquants d’esclaves de ce pays envoyaient des émissaires en Afrique noire. Ils se faisaient passer auprès des populations locales pour des missionnaires au service de l’Islam. Ces « rabatteurs » se disaient chargés d’une noble démarche par de riches musulmans arabes désireux d’expier (p.72) leurs péchés en offrant un voyage à La Mecque à des croyants africains nécessiteux. Il s’agissait en fait d’un traquenard, puisqu’une fois arrivés les pèlerins naïfs étaient faits prisonniers et remis aux marchands d’esclaves.
(p.79) Mais, finalement, l’arrivée des Arabes fera le malheur de l’Afrique. Commencée dès le Moyen Âge, la traite qu’ils y inaugurèrent ne s’arrêtera officiellement qu’au début du xxe siècle. Ce trafic, ou traite transsaharienne et orientale, concernait des territoires débordant largement faire arabe. Nous y incluons même la région orientale de l’Afrique colonisée par les Omanais, qui y mettront en place un système esclavagiste sous des formes jusqu’alors inconnues sur le continent noir avant leur arrivée. Voilà pourquoi nous employons le terme d’arabo-musulman, pour qualifier l’odieux commerce humain que ces nouveaux venus inaugurèrent en Afrique.
Certains historiens anglo-saxons l’appellent la Muslim connection. Car les négriers qui ont trempé dans ce trafic n’étaient pas exclusivement arabes. Ils étaient aussi persans, berbères, turcs, javanais, , avec souvent pour seul point commun la religion musulmane. Tous ont cependant participé à cette infamie, à des degrés plus ou moins grands. Les marchands arabes vendaient aussi esclaves noirs jusqu’en Inde. Au milieu du XVe siècle, le roi du Bengale en possédait près huit mille. A partir du Xe siècle, on signale que des Noirs vendus en Chine. Une inscription trouvée à Java et datée de 860 de notre ère (p.80) identifie sur une liste de domestiques des Zendjs originaires d’Afrique orientale. Une autre inscription javanaise mentionne également des esclaves noirs, offerts par un roi javanais à la cour impériale de Chine.
(p.88) C’est ce continent et ces vieilles civilisations que la conquête arabe devait plonger dans les ténèbres : de sanglantes razzias, accompagnées de massacres, d’incendies, de terribles actes de dévastation, dépeupleront et stériliseront cette terre de l’or, des pierreries, des épices, des palmiers et d’une prodigieuse fécondité. L’énergie vitale qui nourrissait par vases communicants tous ces éléments allait s’abîmer au rythme de l’avance du mal arabe.
Les Arabes chasseurs d’hommes transformeront en véritables enfers des régions entières où les habitants vivaient heureux. Si, au début de leurs entreprises criminelles, ces négriers ne s’aventuraient pas à l’intérieur du continent – soit du vne au xixe siècle -, lorsque les explorateurs européens eurent ouvert la voie, ils se hasardèrent à les suivre et bientôt se mirent à razzier les populations de l’intérieur. Equipés de fusils modernes, ces impitoyables prédateurs opéraient de véritables carnages au sein de populations vulnérables, dont beaucoup, contrairement à celles de la côte, n’avaient jamais d’armes à feu, et cela depuis les Grands Lacs jusqu’au fleuve Congo. Quant à l’autre mouvement de conquête arabe, il s’était déjà effectué par le nord, par le Maghreb.
L’Afrique du Nord que les Occidentaux ont longtemps qualifiée de Barbarie, du grec barabaros qui désigne tout étranger à la civilisation gréco-romaine, est une vaste étendue de terres en grande partie désertiques. Ses habitants, appelés Barbaresques, étaient des brigands qui, jusqu’au xixe siècle, pillaient les navires européens en Méditerranée. Ils menaient également de nombreux raids sur la terre ferme en Corse, en Sardaigne, sur les côtes d’Espagne, de France, d’Italie et de Grèce. Ils capturaient des Européens et ne les rendaient à leurs familles que contre rançon ou les réduisaient en servitude. Ces Barbaresques asservirent ainsi pendant des siècles de nombreux captifs chrétiens. On disait d’eux : « Plus que des marchandises pillées, les Barbaresques tiraient profit des captifs. Le chrétien cessait d’être un infidèle qu’on arrachait à son pays pour devenir un objet de négoce, dont on essayait de se débarrasser le plus vite et le plus cher possible. » Pendant des siècles l’Eglise catholique n’eut de cesse de les racheter. C’est cette piraterie qui sera un des motifs essentiels de la colonisation de l’Algérie par la France.
(p.95) La diffusion de l’Islam n’était qu’un prétexte : le but essentiel de l’expansion musulmane en Afrique était la recherche de l’or. Voilà pourquoi les premiers “missionnaires” de l’Islam qui se présentèrent aux portes du monde noir furent des missionnaires armés. » Cette soif de l’or est manifeste dans la quasitotalité des écrits arabes, jusqu’au pèlerinage de Mansa Moussa, empereur du Mali. Les esclaves ne deviendront importants que progressivement, pour supplanter le métal jaune. L’or a été le véritable support du commerce transsaharien médiéval (…).
(p.97 ) Les Almoravides deviendront un ordre militaro-religieux, qui déclenchera une guerre sainte dès 1042, pour s’emparer des mines d’or et contrôler leurs voies d’accès. Car ces moines-guerriers, qui allaient saccager l’empire de Ghana, étaient plus attirés par ses richesses que par la conversion des populations.
C’est à la tête d’une armée de quelque trente 1 mille hommes que ces bonnes âmes mirent à feu et à sang les provinces jugées réfractaires à l’enseignement du prophète Mohamed. Ils menèrent une croisade meurtrière jusqu’à la destruction, en 1076, de Koumbi Saleh, capitale de l’empire de Ghana. Cette ex-grande puissance africaine disparaîtra au profit de petites entités géographiques, démographiques et culturelles comme, entre autres, le Sénégal, le Mali et le Songhaï. La présence des Almoravides, quant à elle, fut très courte. Ils convertirent au passage les peuples du Sénégal, notamment les Wolofs, Sérères et Toucouleurs. Les Almoravides ramenèrent avec eux de l’or et des milliers de captifs.
(p.98) Dans son traité, De l’origine des Nègres d’Afrique, Moreau de Charbonneau, explorateur du Sénégal de 1674 à 1677, décrit avec force détails les entreprises des Marocains de la secte des Tou- bena contre des tribus noires. En fait au sein même de la religion musulmane est née la secte des Assassins. Cette nébuleuse criminelle a vu le jour en 1060 en Perse, à l’initiative de Hasan Ibn Al Sabah. Les croisés disaient d’eux qu’ils étaient drogués au haschisch, mot arabe d’où provient le mot assassin. Les activistes de cette secte ont d’abord opéré en Perse, en Turquie, puis en Occident avant de gagner l’Afrique du Nord en infiltrant des mouvements comme celui des Toubena. Ces « fous de Dieu » s’étaient autoproclamés « bons musulmans » et partirent à l’assaut de villages sénégalais, dont ils qualifiaient les habitants de « mauvais musulmans ». Ces négriers, lancés dans le jihâd contre ceux qu’ils n’appelaient des « relâchés » que pour en faire des proies idéales, accusaient leurs futures victimes de « professer l’Islam tout en buvant du vin de palme et de la bière de mil, tandis que leurs sorciers vendaient des amulettes. Leurs femmes ne se voilaient ni la figure ni les seins. Leurs hommes dansaient de manière impudique au son des tam-tams. Ils n’avaient pas de mosquée, révéraient leurs totems, vénéraient moins (p.99) le Coran que les gris-gris dont ils étaient couverts des pieds à la tête et qui parfois pesaient si lourd qu’il fallait s’y prendre à plusieurs pour les mettre en selle ».
Les chefs de tribus musulmanes d’Afrique du Nord, du Sahara et du Sahel lançaient ces razzias pour persécuter de nombreux peuples noirs environnants. Cela parce que, depuis le Moyen Age, l’islamisation était superficielle dans les régions rurales de l’Afrique du Nord. Quelquefois chez eux les convictions variaient au gré de la perte d’un être cher ou de la survenue d’un danger. À Tunis par exemple, à la mort de l’une des femmes du bey, les notables et ceux qui aspiraient à le devenir achetaient ou razziaient des esclaves noirs pour leur accorder la liberté sur- le-champ. Et souvent ces pelotons de centaines d’hommes suivaient le convoi funéraire portant chacun à la main un long bâton sur lequel était accroché leur certificat d’affranchissement.
En fait ces négriers, berbères ou arabisants du Nord et autres Touaregs prenaient en otage les populations négro-africaines, tels des pirates. Du fond de leur Sahara, ils se ruaient sur les villages sénégalais ou maliens, razziaient les femmes et les enfants avant de les transporter à travers le désert, au milieu d’indicibles souffrances, jusque dans les oasis qui bordaient leurs régions. Ce commerce infâme occasionnait de grands profits pour les négriers à la solde des Arabes. Plusieurs (p.100) cités de la région nord-africaine se sont enrichies et ont prospéré grâce au trafic de captifs noirs.
(p.100) Des négociants arabo-musulmans de confession chiite la baptiseront Zanzibar (de Zenj et bahr, deux mots arabes qui signifient « littoral des Noirs »).
(p.102) La «civilisation » dite swahélie. Cette culture est presque commune à tous les peuples de la côte de l’Afrique de l’Est. Le terme viendrait du pluriel du mot arabe sahel, qui signifie « côte » ou « frontière ».
(p.104) Trop médiatisée par certains historiens, l’île de Gorée, au large de Dakar, est devenue le symbole de la traite européenne. En y implorant le pardon des peuples africains martyrisés, le pape Jean-Paul II a qualifié cette infamie de « crime contre l’humanité ». Alors que l’île de Zanzibar – sans parler d’Ouidah au Bénin – fut pendant plus d’un siècle l’épicentre d’une traite plus importante que la ponction transatlantique. Des millions de captifs transitèrent par cette région, notamment par Stone City, la ville aux belles maisons de corail. Quant au combat pour mettre fin à cette traite, l’examen des faits prouve que, volontairement ou pas (géopolitique oblige), les pays occidentaux en charge d’une telle mission au xixe siècle ont longtemps « piétiné » face (p.105) aux horreurs du mal arabe, avant, il est vrai, d’y mettre un terme. Durant des années, de nombreux officiers anglais ont fermé les yeux lorsqu’il s’agissait de visiter les bâtiments en route vers l’Arabie ou la Turquie afin d’arracher de leurs cales les cargaisons humaines qu’ils pouvaient renfermer. Ainsi les négriers agissaient en toute impunité.
(p.108) Tippou Tip
Ce bandit contrôlait tout le commerce avec l’Océan Indien. Cela sûrement ne pouvait se faire sans la passivité complaisante des Anglais. Tippou Tip exportait de l’ivoire et recevait des armes pour mener ses razzias. Traite négrière et trafic d’ivoire étaient étroitement liés. Que Londres soit devenue en 1873 la place mondiale du marché de l’ivoire suffit dès lors à expliquer l’attitude ambiguë des Anglais dans la lutte contre la traite. Le sinistre Tippou Tip, qui savait tirer parti de tout cela, tentait néanmoins de se justifier par ces arguments : « Si nous achetons des hommes, c’est qu’on nous offre de nous les vendre et que nous ne pourrions pas nous les procurer autrement. Et il vaut beaucoup mieux pour eux qu’ils tombent entre nos mains qu’entre celles des tribus ennemies […] qui les massacrent, les épuisent et les abrutissent. » Et si incroyable que cela puisse paraître, Stanley lui-même dressera un portrait élogieux de ce malfaiteur : « C’est un homme grand à la barbe noire, de physionomie négroïde, un modèle d’énergie et de force. Son visage est intelligent, il est accompagné d’une large suite de jeunes Arabes qui le traitent en chef. Avec son allure d’Arabe cultivé et ses façons courtoises, il m’a accueilli au village de Mwana Mamba, entouré de (p.109) ses esclaves. C’est l’homme le plus remarquable que j’aie jamais rencontré parmi les Arabes, les Swahilis et les métis d’Afrique. »
(p.109) Les Anglais se sont toujours posés en champions de l’abolition. Mais on oublie trop souvent que leur abolition de l’esclavage devait plus à l’économie qu’à la morale. Ils pensaient (p.110) qu’il était plus avantageux de réduire en esclavage les Africains chez eux que de les exporter vers le Nouveau Monde. Non seulement ils n’y étaient plus si rentables, étant donné les évolutions industrielles du moment, mais ils coûtaient cher (il fallait quand même les nourrir !). Si le discours officiel plaçait l’abolition sur un plan moral, nul u’était dupe. Le système esclavagiste était de plus en plus inefficace et improductif, comme le notait l’économiste Adam Smith. L’Angleterre avait tout simplement su anticiper tous ces bouleversements. Au début du xixe siècle, la révolution industrielle y aboutissait au recyclage de l’économie productive. Ce qui fit émerger un nouveau secteur au détriment de l’agriculture en totale perte de vitesse. Ce bouleversement, où le réalisme économique prenait le pas sur le reste, devait bénéficier au mouvement antiesclavagiste anglais.
(p.122) Sans jamais avoir été source de conflits, le matriarcat a toujours été vécu comme une association harmonieuse et complémentaire entre l’homme et la femme. Cette organisation sociale a contribué au bon fonctionnement de ces communautés traditionnellement sédentaires. Et ce, comme l’a noté le professeur Ki-Zerbo, du fait que tout naturellement les activités de la vie quotidienne étaient réparties selon la constitution physique des uns et des autres. Dans la société zouloue, par exemple, ce système est un vieil héritage des ancêtres bantous. Ceux-ci déterminaient depuis des siècles la filiation selon un ordre matrilinéaire (l’adoption par certaines variantes bantouphones émigrées d’un système patrilinéaire peut être considérée comme un épiphénomène). D’une manière plus générale, l’évolution des sociétés africaines vers le patriarcat, qui régit aujourd’hui la majorité d’entre elles, est grandement due à l’arrivée des Arabes et plus tard des Européens. Par le canal des religions islamique et chrétienne, ces « visiteurs » ont progressivement imposé le patriarcat, en même temps qu’une législation coloniale peu favorable aux femmes.
Quant à la polygamie, sa pratique en Afrique
(p.123) En Afrique, pendant très longtemps – du haut Moyen Age au Xe siècle -, la polygamie fut un privilège des couches sociales supérieures, le peuple étant soumis à la règle de la monogamie. La disparité de privilèges en la matière est identique à celle observée chez les Grecs et chez les Aryens.
(p.124) Dans la grande majorité des sociétés du continent noir, les femmes étaient affectées à des tâches plus pacifiques. La guerre y était toujours une affaire d’hommes. Aussi, le taux de mortalité des hommes, généralement combattants, a toujours été supérieur à celui des femmes. Cela explique en partie la généralisation de la polygamie dans ces sociétés, pour reconstituer un nouveau cadre de vie aux veuves et aux orphelins de guerre. C’était déjà une forme très ancienne de recomposition familiale.
(p.126) La traite arabo-musulmane qui saignait l’Afrique était presque exclusivement contrôlée par les Maghrébins alliés, pour la circonstance, à des commerçants arabes. Ces derniers versaient la dîme aux roitelets africains des États par où passaient leurs caravanes.
La traite et l’esclavage existaient bien avant l’Islam qui en a hérité. Mais cette religion, tout en invitant les maîtres à une plus grande bienveillance envers leurs esclaves, n’en a pas moins entériné et validé la possibilité d’asservir des êtres humains. En fait depuis des temps immémoriaux, du judaïsme au christianisme en passant par l’Islam, et autres religions monothéistes, toutes avaient avalisé la pratique de l’esclavage, en prétextant la loi naturelle ou quelque sombre décret de la divinité.
L’esclavage fut béni et légalisé par saint Paul, par saint Augustin et par Aristote. Ce n’est qu’à (p.127) partir du XIXe siècle que l’Église catholique elle- même engagera une campagne antiesclavagiste, mais spécialement dirigée contre les Arabes. Chacun prêche pour sa chapelle, dit-on !… Chez les musulmans, la loi islamique (ou charia), qui s’appuie sur le Coran et les hadiths, autorise la réduction en esclavage de quiconque n’est pas musulman. Pour autant, si un esclave venait à se convertir, il n’était pas réellement affranchi. Comme les chrétiens du haut Moyen Age, si les musulmans étaient tenus de ne pas réduire en esclavage leurs coreligionnaires, cette règle souffrait de nombreuses transgressions. Par exemple, les Arabo-Musulmans ne rechignaient pas à asservir des musulmans noirs, sous prétexte, entre autres, que leur conversion était récente. Le Marocain Ahmed al-Wancharisi, dans une singulière interprétation des textes, décrétait : « Seul un incroyant peut être réduit en esclavage. Mais s’il y a un doute sur la date à laquelle un homme est devenu esclave et s’est converti à l’Islam, on ne peut remettre en question sa vente ou sa possession. » Il ajoute que « la conversion à l’Islam ne conduit pas forcément à la libération, car l’esclavage est une humiliation due à l’incroyance présente ou passée ».
(p.131) Dans tous les pays africains où les chefs s’étaient convertis à l’Islam, le servage traditionnel fut généralement remplacé par la traite et l’esclavage, pratiqués en vertu d’un principe religieux où tous les infidèles devenaient hors la loi. Et les nouveaux convertis, jadis vaincus et humiliés, n’aspiraient plus eux aussi qu’à faire de nouvelles conquêtes chez leurs compatriotes fétichistes ou païens. Après l’islamisation des habitants du Ghana par les Almoravides, les « nouveaux musulmans », alliés à ceux du Fouta Toro et de Silla, opéraient des razzias pour s’approvisionner en lamlam (ou tribus infidèles), qualifiés d’animistes. Ils allaient ensuite les vendre dans les zéribas constitués par les marchands arabes. Ces postes implantés en Afrique pour la traite abritaient des logements et des magasins entourés par une palissade. Là vivaient des (p.132) fakis (ou prêtres musulmans), qui étaient tous de gros marchands de captifs. Ils voyaient la traite des Noirs comme un accessoire ordinaire de leurs attributions. Leur entreprise était des plus criminelles, comme l’a constaté Stanley. Trois cents trafiquants arabes, en moins d’un an, ont mis à sac la région, aussi grande que l’Irlande, qui s’étend entre le Congo et le Loubiranzi. Ils ont fait deux mille trois cents captifs. Durant les transports, les femmes âgées capturées pliaient sous les paniers de charbon ou des sacs de cas- saves et de bananes. Les jeunes gens avaient autour du cou des carcans que des anneaux retenaient à d’autres carcans. Les enfants de plus de dix ans avaient les jambes attachées par des anneaux de cuivre qui gênaient tous leurs mouvements. Les mères portaient des chaînes qui festonnaient leurs seins et y maintenaient les enfants en bas âge. Les captifs s’écoulaient ainsi par le Sahara et par le Nil vers l’Arabie.
Tel était le destin des peuples africains depuis l’arrivée des Arabes. Ces envahisseurs ont perverti les mœurs et transformé de paisibles bourgades en enfer, comme la capitale du Bornou, Kouka, qui fut de son temps le plus ancien et le plus grand marché de captifs d’Afrique de l’Ouest, son sultan noir étant devenu lui-même, après sa conversion, un gros marchand de Noirs au service des Arabes. Chez lui il n’y avait pas à proprement parler de budget. Le souverain et ses fonctionnaires vivaient du commerce des captifs (p.133), que l’on allait prendre sur les frontières de l’empire parmi les populations dites païennes, au moyen de grandes razzias, et au sein de ses propres sujets, aussi longtemps que ceux-ci ne seraient pas convertis à l’Islam. Confortable potentiel ! En 1825, lorsque Clapperton débarqua dans la lagune de Lagos, il ne trouva en fait de musulmans que des Arabes de passage, soit quelques prêcheurs ou négociants. En 1861 et 1862, Burton ne rencontra à Lagos qu’une dizaine de musulmans. En 1865, il y en avait mille deux cents. En 1880 leur nombre atteignait dix mille avec vingt-sept mosquées.
(p.136) Dans cette tragédie, force est de reconnaître la collaboration de potentats autochtones (p.137) qui, pour tirer profit de ce mal, se souciaient peu de la destination ou de la mort de leurs compatriotes. Il n’y eut pas que les négriers berbères, égyptiens et autres crapules et écume des nations à se livrer à ce commerce criminel. La complicité de certains monarques et de leurs auxiliaires africains est une donnée objective. Après les « rapts » isolés effectués par les Arabes, des monarques convertis et tout un ramassis de courtiers et d’intermédiaires vendaient sans vergogne les prisonniers dont ils tiraient bon prix. L’homme pour ses pareils devenait alors une « bonne marchandise », surtout quand l’appât du gain ou le désir de vengeance asservissaient les esprits. Les monarques impliqués furent coresponsables du triste sort réservé à leurs sujets, puisque dépositaires de l’autorité qui devait les protéger. (…)
Dans toutes les guerres, comme partout dans 1 les pays occupés, les vainqueurs se sont largement appuyés sur la collaboration de notables locaux et d’une partie de la population, qui ont livré des « frères » aux forces d’occupation.
(p.138) (…) en France le général de Gaulle – qui disait de son pays qu’il est une dimension spirituelle de l’histoire – comme le président Mitterrand n’ont jamais voulu reconnaître la responsabilité du peuple français dans les crimes de Vichy. Les dirigeants français et leurs auxiliaires « collaborateurs » de l’époque n’engageaient (p.139) qu’eux-mêmes. Vichy, ce n’était pas la France avec trente-huit millions de renégats. Mais c’était un système dans une France où la République – et ses valeurs démocratiques excluant le sexisme, le racisme et l’antisémitisme – avait été mise en veilleuse par une bande d’opportunistes, fascistes et criminels.
(p.143) En fait tout avait commencé au nord du Sahara dominé par le massif de l’Atlas. Les Touaregs y disposaient de campements, d’où ils envoyaient des expéditions pour conquérir des oasis du désert sur les tribus négro-africaines. Celles-ci ont dû reculer partout jusqu’au Niger. Il s’agit d’un exode massif de populations qui n’en pouvaient plus de ces sanglantes razzias. A force de fuir, elles devinrent étrangères sur leurs propres terres et furent dépossédées de leur histoire. Ainsi, dans toute la région du Sahara les peuples noirs ont presque disparu, laissant derrière eux de rares témoignages de leurs anciennes civilisations. En revanche, informés de ces faits, certains chefs de tribus, notamment Toubous, du Sahara oriental, ont su résister avec leurs peuples pour rester les maîtres des lieux, repoussant les invasions des négriers en fermant la route aux caravanes. )
(p.150) Au nord du Sénégal, en Mauritanie, vivaient comme nous l’avons vu des populations maures (p.151) arabisantes qui, lorsqu’elles ne trafiquaient pas dans le commerce de la gomme, opéraient des razzias dans les régions alentour pour se procurer des captifs. A ce propos, le père Labat rapportait ceci : « Le sieur Brüe avait été informé qu’il arrivait souvent des désordres considérables pendant la traite de la gomme, parce que les Maures, qui sont tous naturellement grands voleurs, dérobaient le jour la gomme dans le quintal pendant qu’on la mesurait et, la nuit, au travers des cases où on la renfermait ; et que les commis, pour ne pas demeurer en tête [5t’c] avec eux, souffraient que leurs laptots coupassent les toulons ou sacs de peau dans lesquels on apporte la gomme ; et ne leur permettaient pas de ramasser celle qu’ils en avaient fait sortir. Tous les ans, les Maures allaient opérer des razzias sur la rive des Noirs. Ils allaient surprendre et mettre à feu et à sang quelques villages du Walo, du Cayor et du Djolof et ils revenaient à l’escale avec leur butin vivant. On voyait des cavaliers portant dans leurs bras ou sur le devant de leur selle de jeunes enfants, la mère suivant, attachée à la queue du cheval, si elle n’avait pas péri dans le feu. » Connaissant l’extrême atrocité de ces négriers maures, au Sénégal, au cours du mois de novembre 1819, des femmes se sacrifièrent collectivement pour ne pas tomber vivantes entre leurs mains.
(p.154) Dans l’histoire de la résistance de captifs africains, l’insurrection la plus dure et la plus meurtrière fut celle des Zendjs déportés dans le monde arabo-musulman. Les hommes arrachés à leurs terres ne se laissèrent pas toujours mener à l’abattoir sans réagir. Arrivés sur les lieux de leur calvaire, ils se sont souvent révoltés.
L’une des sources historiques les plus anciennes connues sur cette révolte des Zendjs est celle d’Alexandre Popovic. Ce chercheur nous révèle qu’en 689, 690 et 694, les esclaves africains s’étaient insurgés en Mésopotamie. Ces hommes, en majorité zendjs, originaires d’Afrique orientale, étaient affectés à la construction de villes comme Bagdad et Basra. Ils étaient considérés comme des sous-hommes par les Arabes et (p.155) avaient la réputation, une fois réduits en esclavage, de se satisfaire assez rapidement de leur sort. Autrement dit, leur inertie primitive leur faisait accepter sans rébellion et sans murmure la nouvelle condition qu’on leur faisait.
Les Arabes employaient le mot Zendj dans une nuance péjorative et méprisante : « Affamé, disaient-ils, le Zendj vole ; rassasié, le Zendj viole. » Dans ce pays, les Africains étaient affectés aux tâches les plus rebutantes. Parqués sur leur lieu de travail dans des conditions misérables, ils percevaient pour toute nourriture quelques poignées de semoule et des dattes. Des dizaines de milliers d’esclaves africains étaient contraints > d’assécher les marais. Ils étaient battus, fouettés, affamés, impaludés et mouraient comme des insectes. Ces esclaves laisseront éclater leur colère avec pour objectif, en 869, de détruire Bagdad qu’ils considéraient comme la cité symbole de tous les vices. Mais c’est dès l’an 689 que, armés de simples gourdins ou de houes et formés en petites bandes, ils se soulevèrent. Cette première insurrection se produisit sous le gouvernement de Khâlid ibn ‘Abdallah, successeur de Mus’ab ibn al-Zubayr.
Les révoltés qui s’étaient organisés avaient réussi à se procurer des armes. Ils se fortifièrent dans des camps inaccessibles. Et à partir de ces différents points, ils lançaient des raids. Un grand nombre d’embuscades et de batailles (p.156) tourneront à leur avantage. Ils réussirent à s’emparer de grandes villes du bas Irak et du Khûzistân comme al-Ubulla, Abbâdân, Basra, Wâsit, Djubba, Ahwâz, etc. Les troupes abbas- sides allaient toutefois réussir à réoccuper sans mal toutes ces villes que les Zendjs avaient prises, pillées puis abandonnées. Ils seront finalement vaincus, les prisonniers remis en esclavage ou décapités et leurs cadavres pendus au gibet. Cela ne les dissuadera pas de fomenter une deuxième révolte mieux organisée.
Cette insurrection eut lieu cinq ans plus tard, en 694. Elle semble avoir été plus importante que la première, et surtout mieux préparée. Cette fois, les Zendjs furent rejoints par d’autres Noirs déserteurs des armées du calife, des esclaves gardiens de troupeaux venus du Sind en Inde, et d’autres encore, originaires de l’intérieur du continent africain. Les insurgés infligèrent, dans un premier temps, une lourde défaite à l’armée du calife. Les armées arabes furent obligées de s’y prendre à plusieurs reprises pour les écraser.
Quant à la troisième révolte des Zendjs, elle est la plus connue et la plus importante. Elle secoua très fortement le bas Irak et le Khûzistân, causant des dégâts matériels énormes et des centaines de milliers de morts, voire plus de deux millions selon certaines sources. C’est le 7 septembre 869 que, sous les ordres d’un chef charismatique, Ali Ben Mohammed, surnommé Sâhib al-Zandj (le « maître des Zendjs »), les Africains se soulevèrent. (p.157) L’homme était d’origine assez obscure mais avait visiblement pu approcher les classes dirigeantes de son époque. Il était également un poète talentueux, instruit, versé dans les sciences occultes et socialement engagé dans des actions d’aide auprès des enfants. Il leur apprenait à lire et à se familiariser avec des matières comme la grammaire et l’astronomie. Ali Ben Mohammed avait déjà fomenté plusieurs soulèvements dans d’autres régions du pays, avant de réussir, à la tête des Zendjs, la plus mémorable insurrection d’esclaves de l’histoire du monde musulman.
(p.165) Chaque année plus d’un million d’individus étaient encore enlevés à leurs familles et à leurs tribus. De toutes les pratiques de traite, celle des négriers arabo-musulmans était la plus meurtrière. Avec leur arrivée en Afrique, les razzias et autres « collectes guerrières » furent progressivement très étudiées et bien huilées. Voici l’une de ces « techniques de chasse » : après avoir encerclé un village en pleine nuit et éliminé les guetteurs, un meneur donnait le signal afin que ses complices allument leurs torches. Les villageois, surpris dans leur sommeil, étaient mis hors d’état de se défendre, les hommes et les femmes âgés massacrés. Le reste était garrotté en vue du futur et long trajet. Il arrivait que des fugitifs se réfugient dans la savane, à laquelle les trafiquants mettaient le feu pour les débusquer. Ensuite, pour les rescapés commençait la longue marche vers la côte ou l’Afrique du Nord à travers le désert impitoyable. Les pertes, estimées à environ 20 % du « cheptel », étaient inévitables.
La progression des caravanes de captifs à travers cet océan de sable durait parfois des mois. Imaginons leurs conditions de survie, les adultes mâles « accouplés » à l’aide d’une fourche de bois et retenus par un collier de fer (qui creusait les chairs) au cours de leur interminable et torturant trajet. Le froid des nuits, la chaleur des jours, la faim, les injures, le fouet et les (p.166) maladies… Les enfants n’étaient pas épargnés. L’explorateur allemand, médecin et naturaliste, Gustav Nachtigal, nous en rapporte un témoignage : « Les pauvres enfants des pays noirs semblent rencontrer la mort ici à la dernière étape d’un long, désespérant et pénible voyage. Le long trajet accompli avec une nourriture insuffisante et une eau rare, le contraste entre d’une part les riches ressources naturelles et l’atmosphère humide de leur patrie, et d’autre part l’air sec et anémiant du désert, les fatigues et les privations imposées par leurs maîtres et par les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ont peu à peu ruiné leurs jeunes forces. Le souvenir de la patrie disparue en chemin, la crainte d’un futur inconnu, le voyage interminable sous les coups, la faim, la soif et l’épuisement mortel, ont paralysé leurs dernières facultés de résistance. Si les pauvres créatures manquent de forces pour se lever et marcher de nouveau, elles sont tout simplement abandonnées, et leur esprit s’éteint lentement sous l’effet destructeur des rayons du soleil, de la faim et de la soif… »
(p.169) Stanley constatera que dans certaines régions d’Afrique, après leur passage, il ne subsistait guère plus de 1 % de la population. Dans le Tanganyika, les images des horreurs de la traite étaient partout visibles. Nachtigal, qui ne connaissait pas encore la région, voulut s’avancer jusqu’au bord du lac. Mais à la vue des nombreux cadavres semés le long du sentier, à moitié dévorés par les hyènes ou les oiseaux de proie, il recula d’épouvante. Il demanda à un Arabe pourquoi les cadavres étaient si nombreux aux environs d’Oujiji et pourquoi on les laissait aussi près de la ville, au risque d’une infection générale. L’Arabe lui répondit sur un ton tout naturel, comme s’il se fût agi de la chose la plus simple du monde : « Autrefois nous étions habitués à jeter en cet endroit les cadavres de nos esclaves morts et chaque nuit les hyènes venaient les emporter : mais, cette année, le nombre des morts a été si considérable que ces animaux ne suffisent plus à les dévorer. Ils se sont dégoûtés de la chair humaine. »
Telles étaient les horreurs de la traite arabo-musulmane partout où ses prédateurs opéraient. Et cela se passait à une période relativement récente, c’est-à-dire en plein xixc siècle. Conscient de la dimension économique de cet odieux trafic, de 1840 à 1855, le pacha d’Égypte Méhémet-Ali le réglementa, afin d’en faire un des privilèges exclusifs de son gouvernement.
(p.176) Quant à l’ambiguïté de la position anglaise, elle était on ne peut plus évidente. Les vaisseaux de Sa Majesté, qui draguaient la mer Rouge, surveillaient aussi l’Euphrate en lorgnant du côté de la Perse, voisine de leur perle indienne. Les Anglais intervenaient dans les affaires intérieures de l’État d’Oman, grand importateur d’esclaves africains, mais s’abstenaient de lui imposer la suppression de ce trafic. Ils adoptaient cette attitude envers tous leurs « amis ». C’était en somme un subtil double jeu comme savent faire les Anglais. Ils dénonçaient et combattaient officiellement la traite, mais fermaient les yeux sur les agissements des négriers arabo-musulmans. Cette ambiguïté aggravait le mal au lieu de le réduire. Les Français n’étaient pas en reste. Leurs compatriotes trafiquants, basés sur les îles de l’océan Indien, n’appliquèrent pas l’abolition de 1848. Pour continuer à approvisionner le commerce avec Zanzibar, ils choisirent de s’installer à Kilwa, où les échanges se faisaient à partir du Mozambique. Ainsi, de Kilwa et de Bagamoyo, leurs captifs étaient-ils embarqués pour le Moyen-Orient (p.177) ou l’île de Zanzibar à bord de boutres arabes. Dans ces petits bâtiments munis d’une ou deux voiles, plusieurs rangées de captifs – entre cent et deux cents hommes – étaient transportées dans des conditions abominables. Les malheureux étaient accroupis genoux au menton au-dessus des pierres qui formaient le ballast. A l’arrivée à Zanzibar, on faisait le sinistre compte. Les morts étaient jetés à l’eau et les mourants abandonnés sur la plage. Seuls les hommes valides étaient « bénéfices » et vendus aux trafiquants. Pendant que des hommes d’Eglise et certains administrateurs civils luttaient sans relâche dans les colonies françaises pour éradiquer le mal, il y eut de graves entorses à cette noble mission, notamment du côté des militaires français.
(p.180) On évaluait à trente mille le nombre de captifs qui arrivaient encore en 1870 sur le marché de Khartoum, avant d’être acheminés par bateaux vers le monde arabo-musulman. Cette traite pratiquée au Soudan et dans la vallée du Nil se faisait sur les frontières de l’Empire ottoman, avec la complicité des autorités et fonctionnaires turcs.
(p.184) Il est vrai aussi qu’auprès de certains intellectuels européens les pays arabo-musulmans n’avaient pas si mauvaise presse. Michelet, par exemple, regrettait même la victoire de Charles Martel à Poitiers. Selon lui, la France aurait gagné à devenir musulmane. Quant à Basil Davidson, qui en son temps ne disposait pas d’informations suffisantes sur les horreurs de l’entreprise arabe en Afrique, il minimisait tout simplement les chocs provoqués par ses prédateurs : (…).
(p.186) (…) l’Anglais J. F. Kean, qui visita l’Arabie en 1881, observait : « Le Nègre se trouve là (en Arabie) à sa juste place, celle d’un travailleur utile et facile à diriger. Les Nègres sont portiers, (p.187) porteurs d’eau et accomplissent l’essentiel du travail à La Mecque.
(p.188) Entre 1864 et 1890, la traite arabo-musulmane a ponctionné plus d’hommes du continent noir qu’il n’en sortait auparavant en un siècle avec les Occidentaux.
(p.191) (…) en 1875, le témoignage d’un voyageur anglais à propos de la cruauté des négriers arabes : « La caravane était arrivée cinq jours avant moi… j’en ai vu plus qu’assez pour me convaincre de l’importance et de l’atrocité du trafic d’esclaves à cet endroit… Deux heures avant d’entrer dans l’oasis, nous avons rencontré quatre esclaves menés par un Arabe en route vers Ozla, et, en entrant dans la palmeraie, nous avons rencontré un autre Arabe traînant une esclave par une corde attachée autour de sa taille.
« Ces esclaves étaient arrivés avec la caravane. Un peu plus loin, il y en avait dix ou douze accroupis autour d’un puits. J’allais vers eux pour les examiner… Ils étaient réduits à l’état de squelettes et leurs membres longs et minces, avec la taille apparemment anormale et proéminente de leurs genoux, de leurs coudes, de leurs mains et de leurs pieds leur donnaient l’apparence la plus affreuse et la plus repoussante qui soit. Je n’ai vu, de ma vie, spectacle si révoltant… Les pauvres créatures qu’on amène à Djalo de l’intérieur ne rapportent pas plus de dix à douze livres et, si une sur trois arrive en vie à Djalo, le propriétaire fait encore un profit qui le paie largement de tous les risques encourus, car, à (p.192) Ouaddaï, le prix d’un esclave commence à trois pièces de calicot. Ces êtres pitoyables parcourent vingt-trois degrés de latitude à pied, nus, sous un soleil brûlant, avec une tasse d’eau et une poignée de maïs toutes les douze heures pour leur entretien. Sur le trajet de quatorze jours nécessaires pour aller de Tukkru à Djahuda, on ne trouve pas une goutte d’eau, et la caravane poursuit son épuisant voyage en dépendant, pour sa survie, des gourdes remplies aux puits de Tukkru. C’est en vain que la faim et la soif diminuent le nombre des Noirs épuisés, en vain qu’ils se laissent tomber, lors de ce lugubre voyage, fourbus et perdant connaissance, pour mourir d’une mort affreuse dans le désert. Le marché de Djalo doit être approvisionné et approvisionné il est, mais à quel coût en vies humaines… » Quoique généralement forts et robustes, les survivants africains n’en étaient pas moins sujets, après leur arrivée sur les lieux d’asservissement, à diverses maladies.
(p.195) Mais dans la traite arabo-musulmane, ce sont les femmes noires qui avaient le plus de valeur. Les Nubiennes et les Abyssines – à la beauté proverbiale – étaient très recherchées. Elles servaient le plus souvent à l’esclavage sexuel. Elles étaient aussi appréciées pour leurs aptitudes à la vie domestique et aux travaux traditionnels. Les jeunes filles Nyams-Nyams atteignaient un prix très élevé du fait de leur rareté. Les femmes Dinka, quant à elles, étaient réputées bonnes cuisinières et vendues principalement en Nubie. Toutes ces femmes étaient systématiquement violées sur le parcours les ramenant du continent noir. Le but était de les briser moralement et psychologiquement avant de les mettre en vente. Elles étaient ensuite réduites à un état de dépendance et de soumission totale vis-à-vis de leur propriétaire
(p.200) Lorsque Saladin exécuta le chef des eunuques noirs du Caire, en 1169, il eut à faire face à toute une armée d’Africains décidés à le venger.
Cinquante mille combattants noirs luttèrent durant deux longues journées contre l’armée du conquérant arabe. Mais ils seront lâchement trahis par le calife fatimide al-Adid, comme le rapporte un chroniqueur de l’époque : (…).
(p.202) (…) en fait de polygamie, la sourate IV, verset 3, recommande : « Si vous craignez de n’être pas équitable envers les orphelins, n’épousez parmi les femmes qui vous plaisent, que deux, trois ou quatre. Si vous craignez encore d’être injuste, bornez-vous à une seule. » En réalité, il n’est dit ni prescrit nulle part dans le Coran l’obligation pour un musulman d’être polygame. Ainsi, généralement dans la famille berbère monogame – où la femme n’était pas voilée avant la récente montée de l’intégrisme -, la mère respectée des enfants restait au foyer sans rivale, partageant l’autorité avec le père de famille, tout en prenant part aux affaires de la cité. D’où l’absence de harem en grand nombre et qui aurait nécessité beaucoup de gardiens esclaves. Pour autant, les négriers du Nord opéraient depuis des siècles des razzias à l’intérieur du continent. Al Yakubi écrivait déjà en 891 : « On se rend à un pays [ou une ville] appelé Ghast [Ghana] Audaghust [Aoudagost]. C’est une oasis prospère avec habitations fixes. Il y a là un roi sans religion et sans loi religieuse qui fait des razzias dans le pays des Sudan. »
(p.206) Les convois d’esclaves, expédiés des bords du Nil Blanc, pour atteindre la mer Rouge, traversaient le Nil Bleu et longeaient la pente septentrionale du plateau abyssin. Cette mer Rouge est depuis toujours la limite entre le monde oriental, le monde occidental et l’univers africain. C’est la frontière entre trois mondes et trois idées. C’est le lieu où, au xixe siècle – après que l’esclavage fut partout aboli -, se livrait la bataille entre les Lumières et les ténèbres, entre la vie et la mort, entre la servitude abjecte et la nécessaire liberté.
C’est là que se faisait le sinistre triage d’êtres humains enchaînés, tous descendus vers ce rivage inhospitalier pour quitter l’Afrique à jamais. Ces malheureux, arrachés à leur terre, allaient user le (p.207) reste de leur vie au service de la paresse et de la débauche orientales. Après d’indescriptibles souffrances, ils étaient dispatchés pour être acheminés les uns vers l’Orient et les autres vers les places marchandes de la basse Égypte. Cette région abritait le principal marché fournisseur du monde arabo-musulman, notamment de l’Arabie, destinataire de la plupart des « exportés africains ».
(p.208) Après que la Turquie eut officiellement aboli la traite et l’esclavage, le gouvernement égyptien donna quelques ordres, mais sans en vouloir sérieusement l’exécution. Ses fonctionnaires faisaient hypocritement semblant d’agir contre les négriers. Mais chaque fois qu’une cargaison était saisie, au lieu d’être libérés, les captifs prenaient la destination de casernes dissimulées un peu partout dans le pays. Parce que l’Egypte avait grand besoin de combattants. On y enrôlait de nombreux contingents issus de la traite négrière. L’Annuaire de 1868 nous apprend qu’avec une (p.209) population de 5 125 000 habitants, l’Égypte avait une armée de 48 600 hommes, sans compter la marine. Ce qui était énorme pour un pays à faibles richesses et ressources naturelles. Comme en Allemagne sous la botte nazie, dans presque . tous les rouages de l’administration égyptienne les fonctionnaires étaient au courant et participaient à la gestion de la traite et de l’esclavage avec un zèle indéfectible. Les appointements des employés civils et militaires étaient payés avec des captifs, qui constituaient la monnaie la plus courante. Les officiers égyptiens recevaient une partie de leurs indemnités en captifs. Dans la province du Kordofan, le gouverneur rémunérait ouvertement ses soldats et ses employés par ce moyen. Presque toutes les autorités importantes de ce pays étaient des marchands d’esclaves. Lorsqu’un général égyptien mobilisait une grande armée, il lui fallait une « caisse militaire ». Celle-ci devait normalement être assurée par le trésor public. Mais elle était toujours constituée d’un nombre substantiel de captifs. Pour cela, on s’approvisionnait par de sanglantes razzias sur les voisins soudanais ou nubiens. (…)
(p.210) Prenons par exemple l’Arabie de cette époque, qui avait un besoin pressant d’importation de main-d’œuvre servile. Le pays des Wahhabites est un plateau central qui domine un vaste univers de champs et de déserts. Sur les 2 800 000 kilomètres carrés de son territoire, 700 000 étaient fertiles. Mais au xixe siècle, on manquait de bras pour les cultiver. Comparé à d’autres pays, avec (p.211) les mêmes critères, cet énorme espace aurait dû être peuplé de cinquante millions d’habitants. Il n’en comptait que huit. Manquait donc des travailleurs pour développer son agriculture. Cette dépopulation était due en particulier aux traditions mêmes des Arabes. Dans l’approche la plus élémentaire de la science économique, la survie d’une société peut être assurée par trois sources essentielles, à savoir : l’industrie et l’agriculture, puis le commerce pour distribuer les produits issus des deux premières. Chez les Wahhabites, le système et la diversité des taxes étaient si complexes et onéreux qu’ils ruinaient les agriculteurs. Le commerce et l’industrie étaient tout aussi lourdement taxés. Le résultat était que dans de nombreuses régions d’Arabie, les populations s’enfuyaient devant ces ponctions pesantes et autres réquisitions militaires. Elles abandonnaient champs et maisons pour émigrer vers des deux plus cléments.
Ce système ne favorisait donc pas le développement économique et social du pays par le travail de ses habitants. Il les condamnait à un appel incessant de main-d’œuvre servile fournie par la traite négrière. En outre, pour un Arabe de cette époque-là, l’homme n’est jamais pauvre tant que son voisin possède quelque chose. Les Bédouins, par exemple, étaient réputés pour leur ardeur au combat. Beaucoup de ces nomades – peuple généreux et accueillant pour qui la dignité humaine était sacrée – sont (p.212) les descendants des Napatéens et ancêtres des actuels Jordaniens. On disait d’eux qu’ils étaient capables d’héberger un homme pendant trois jours, avant de lui demander en quoi ils pouvaient lui être utiles. Mais avec leur conversion à l’Islam, nombre d’entre eux deviendront vite des pillards.
La guerre sainte tombait à pic pour s’enrichir. Puisque obligation est faite à tout croyant de mener le jihâd, se disaient-ils, il fallait soumettre et asservir les non-convertis. Ils prenaient abusivement le Coran comme prétexte pour razzier les voisins infidèles en les dépouillant de tout ce qu’ils possédaient. C’est ainsi qu’en toute bonne conscience, et par des moyens aussi commodes que bénits, la plupart de ces tribus arabes converties finissaient par ne plus vivre par elles-mêmes. Elles appliquaient ce principe jusqu’en Afrique même. Lorsqu’un village tombait, ils commençaient par se livrer au pillage en règle. Du chef de tribu aux hommes libres, en passant par les notables, les captifs (de case ou de Couronne), les femmes et les enfants, tous étaient faits prisonniers. Ils enlevaient aux vaincus tout ce qu’ils possédaient, arrachaient les bijoux des femmes, sondaient l’ampleur des boubous pour y prendre l’or ou l’argent que les ourlets pouvaient receler. Ensuite seulement ces malheureuses victimes étaient dirigées vers les marchés du monde arabo-musulman.
Les Arabes ne vivaient donc qu’avec le bien (p.213) d’autrui, ne travaillaient que par les bras du vaincu : pour le vainqueur le repos permanent et l’oisiveté après la lutte, à l’esclave de travailler. Ainsi la constante du fléau de la traite négrière et de l’esclavage arabo-musulman en Afrique – du viie au xxe siècle – était due aux traditions de ces peuples, qui ne pouvaient, pour des raisons de débauche et de paresse, se passer des forces et du sang neuf d’hommes serviles.
(p.216) Les Omanais établirent une véritable colonisation économique et politique sur toute l’Afrique orientale, couvrant ainsi des milliers de kilomètres, de Mombasa (Kenya) ( jusqu’aux limites du Mozambique.
(p.217) Premier producteur mondial de clous de girofle, Zanzibar produisait aussi du riz, des noix de coco, des patates et de la canne à sucre. Entre 1830 et 1872, plus de sept cent mille esclaves ont servi cette entreprise. Les négriers arabes, qui exploitaient ces ressources, étaient tous financés par des banquiers indiens.
(p.218) Quantité de bateaux venaient y déverser leurs cargaisons humaines et les Anglais fermaient les yeux. Ces derniers se souciaient avant tout de protéger la route des Indes, sans contrarier les habitudes locales. Après la guerre de Crimée, l’Angleterre exerçait un contrôle et une autorité sans partage sur toutes les côtes du golfe Persique. Puis, en 1864, la France et l’Angleterre garantirent l’indépendance des Etats de Zanzibar et de Mascate (Oman). Les clauses du partage entre les souverains de Mascate et de Zanzibar furent définitivement fixées sur arbitrage (p.219) de lord Canning, vice-roi des Indes. Un tribut de quarante mille couronnes était alloué au souverain de Mascate à la charge du sultanat de Zanzibar. Chacun devait visiblement y trouver son compte car ce pacte fut ratifié en 1873 par l’Angleterre, qui obtint ainsi une influence prépondérante sur ces territoires. Ces intérêts économiques et géopolitiques ont pesé leur poids dans la tolérance des Anglais à l’égard de la traite. L’une des raisons de leur laxisme était que les marchands de Zanzibar manqueraient d’argent pour acheter des produits européens si on leur coupait les ressources de la traite négrière. Pour justifier cela, John Kirk, le consul britannique en poste à Zanzibar en 1866, disait à qui voulait l’entendre que l’esclavage était partie intégrante de l’Islam arabe. Et que, dans le monde arabo-musulman de l’époque, à côté de chaque maître il fallait nécessairement des serviteurs acquis par la guerre ou fournis par la traite. Aussi les Anglais toléreront-ils l’esclavage à Zanzibar jusqu’en 1911.
(p.220) Au milieu du xixc siècle, un tiers de la population d’Oman était africaine ou d’origine africaine. On comptait environ 500 000 Noirs, sur une population de 2 200 000 habitants. Toute l’agriculture de ce pays fonctionnait grâce au travail des esclaves. Sur ces terres fertiles, où l’on produisait du coton, du vin et du blé, les Africains fournissaient aussi des matelots et des plongeurs pour recueillir les huîtres à perle qui ont fait, jusqu’à une période récente, une des richesses du golfe Persique. Dans ces sociétés arabes, les Africains jouaient un rôle presque central. Sans fonctions précises, ils prenaient (p.221) une grande part aux activités communes, pendant que les Arabes, s’ils ne faisaient pas la guerre, évoluaient dans l’oisiveté des maîtres. Selon le proverbe arabe : « L’esclave se satisfait de la jouissance du maître. »
(p.222) Au Maroc, si le travail des esclaves noirs relevait beaucoup plus du saupoudrage artisanal que de la concentration industrielle, on y fit fonctionner (p.223) pendant longtemps une riche économie de plantation de canne à sucre. L’essentiel de la main-d’œuvre était composé d’esclaves noirs, originaires de régions situées au sud du Sahara.
(p.224) Même les ‘fakirs’ (pauvres) rêvaient de posséder des esclaves. C’est essentiellement pour ces raisons que la traite transsaharienne et orientale a connu un développement exponentiel depuis les abolitions occidentalese au XIXe siècle.
(p.227) Les déportés africains ont été soumis, dans le monde arabo-musulman, à des conditions d’exploitation et de survie comparables à un génocide méticuleusement préparé.
Il y eut bien sûr la privation de liberté et le travail forcé. Mais cette déportation fut aussi – et dans une large mesure – une véritable entreprise programmée de ce qu’on pourrait appeler « une (p.228) extinction ethnique par castration massive ». Déjà au chapitre du mépris envers les Africains, l’historien Ibn Khaldun écrivait : « Les seuls peuples à accepter l’esclavage sont les nègres, en raison d’un degré inférieur d’humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » La question qui se posait donc était de savoir comment faire pour que ces « animaux » ne se reproduisent pas en terres arabo-musulmanes.
Car, dès les débuts de cette traite, les négriers voulaient empêcher qu’ils ne fassent souche. Comme ils ne s’embarrassaient pas de considérations métaphysiques, la castration leur parut une solution bien pratique. Ainsi, dans cette entreprise d’avilissement d’êtres humains, si les Arabes destinaient la plupart des femmes noires aux harems, ils mutilaient les hommes par des procédés très rudimentaires et qui causaient une I effroyable mortalité.
Cependant il est un fait : depuis des temps fort anciens les eunuques étaient une « denrée » recherchée dans le monde arabe. Les premières victimes furent « slaves », massivement capturées par des chrétiens, au mépris des excommunications, puis vendues par les Vénitiens ou les Marseillais aux notables d’Egypte. C’est à l’époque carolingienne qu’eurent lieu ces razzias auprès des peuples installés dans la majeure partie de l’Europe centrale et orientale. Le motif en était qu’ils étaient des païens. Dès le Xe siècle, les monarques saxons Henri l’Oiseleur et Otton Ier, (p.229) par exemple, non seulement encourageaient ces entreprises bestiales, mais y participaient activement. C’est à cette époque que le mot latin slavus, désignant les Slaves, va être progressivement remplacé par sclavus, qui donnera « esclave » et désignera les Européens privés de liberté et considérés comme des « biens meubles » dans le monde musulman.
Cela à la grande satisfaction d’Ibn al-Fakih, géographe et poète arabe qui vivait au Xe siècle et trouvait que l’asservissement de peuples non musulmans était parfaitement naturel : « De la mer occidentale, arrivent en Orient les esclaves hommes, Romains, Francs, Lombards et les femmes romaines et andalouses. » Un autre savant arabe, Ibn Haukal, auteur de traités de physique, de médecine et de grammaire au xiie siècle, d’ajouter : « Le plus bel article importé de l’Espagne sont les esclaves, des filles et de beaux garçons qui ont été enlevés dans le pays des Francs et dans la Galice. Tous les eunuques slaves qu’on trouve sur la terre sont amenés d’Espagne et aussitôt qu’ils arrivent, on les châtre. » Et ils alimentaient alors massivement un commerce prolifique entre Venise et l’empire arabe au sud de la Méditerranée. Une époque et des pratiques immortalisées par le « Quai des Esclaves » à Venise – entre les Schiavoni (littéralement : « Gros-Esclaves »), le Maure et le Ghetto s’enrichissait la Sérénissime… Pour ce qui est des eunuques, il y eut donc, et au commencement, les jeunes Slaves emmenés de force en Espagne pour y subir l’amputation qui les privait de leur virilité. Mais cette source d’eunuques blancs allait très vite tarir avec l’apparition d’Etats puissants en Europe et l’arrêt de l’expansion musulmane aux Pyrénées.
En fait trois facteurs déterminants mirent fin à la traite des Blancs :
- La Russie en soumettant les Tatars et en contrôlant la Crimée empêcha la poursuite de la traite.
- En colonisant le monde musulman, les Européens luttèrent activement contre l’esclavagisme.
- La Turquie, sous la pression des Européens, abandonna la traite des Blancs.
Le « déficit blanc » allait cependant être largement compensé par un approvisionnement accru en esclaves venus du continent noir. Ainsi la traite négrière arabo-musulmane ne sera que le prolongement généalogique de la traite transeuropéenne. Car le trafic finira par tabler sur la facilité en se reportant sur les peuples du continent noir. Peuples que les Arabo-Musulmans considéraient comme naïfs et dépourvus de moyens de défense efficaces.
(p.231) Après les Slaves, les populations noires d’Afri que arrivèrent donc sur les marchés de Bagdad, du Yémen et d’Egypte. Quant aux premiers eunuques noirs qui étaient adultes et en petit nombre, ils firent leur apparition dans l’Empire ottoman vers 1485. Ils étaient pour la plupart originaires d’Ethiopie et de la région du lac Tchad. Ensuite ce fut au tour des garçons du continent noir de subir la terrible opération sexuelle. Leurs chances de survie étaient minimes, la mort emportant les trois quarts des « patients ». Comme le but de ce génocide programmé était avant tout de s’entourer d’esclaves (p.232) africains qui ne pouvaient avoir de descendance, on pratiquait la plupart du temps une opération légère, visant seulement à rendre l’homme stérile. Mais beaucoup plus tard, dans nombre de pays arabo-musulmans, on exigea que les Africains subissent l’opération dite « à fleur de ventre », qui interdisait toute relation sexuelle, et se soldait par une mortalité considérable. On distinguait donc ceux qui avaient subi l’ablation des seuls testicules et ceux dont on avait coupé la totalité des organes génitaux. Seuls ceux de la seconde catégorie étaient commis à la garde des harems, car les autres conservaient une capacité d’érection qui, selon la rumeur publique, faisait des ravages dans les harems.
(p.234) (…) pour la souffrance des victimes, la castration était pratiquée après la traversée du Sahara, très souvent en Egypte où les moines coptes s’en étaient fait une spécialité.
C’est ainsi que se mirent en place des marchés et des réseaux spécialisés, avec leurs centres de castration localisés de préférence chez les voisins infidèles, notamment en Éthiopie, puisque l’Islam interdit aux vrais croyants de pratiquer l’opération. Ainsi les captifs zendjs, originaires d’Afrique orientale, les Noirs des hauts plateaux et même d’autres capturés loin à l’intérieur du continent étaient souvent dirigés sur l’Ethiopie. Le marchand arabe al-Hajj Faraj al- Funi rapporte ceci : « Le souverain musulman d’Amhara avait interdit de castrer les esclaves ; il considérait cet acte comme abominable et tenait fermement la main à sa répression. Mais les brigands arabes s’en vont à une ville appelée Wâslu, qui est peuplée d’une population mélangée et sans religion ; et c’est là qu’on castre les esclaves. Ces gens-là, seuls dans tout le pays abyssin, osent agir ainsi. Quand les marchands ont acheté des esclaves, ils les amènent donc en faisant un détour par Wâslu où on les castre, ce qui en augmente beaucoup la valeur. Puis tous ceux qui ont été castrés sont conduits à Hadiya. Là, on leur passe une seconde fois le rasoir et on les soigne jusqu’à leur guérison, car les gens de Wâslu ne savent pas les soigner et ceux de (p.235) Hadiya ont acquis une habileté particulière pour soigner les eunuques. Pourtant le nombre de ceux qui meurent est supérieur à celui des vivants, car il est pour eux terrible d’être transportés d’un lieu à un autre sans aucun soin. » Un autre lieu d’Ethiopie où se pratiquait cette opération était en pays gallas. En 1885, le géographe, explorateur et ethnologue Philipp Paulitsche notait : « La castration est pratiquée par les Gallas, peuple au sud de l’Ethiopie, sur des garçons de dix à quinze ans, par l’ablation des testicules ; la plaie est soignée au beurre. Il sort des chargements entiers de ces eunuques par le port de Tadjoura, les fatigues du trajet et les mauvais soins en tuaient 70 à 80 %. » La mutilation génitale infligée aux garçons de huit ans, pour fabriquer des eunuques, était courante dans ce pays. Les mêmes opérations se pratiquaient aussi en haute Égypte.
(p.239) Eunuque provient d’un mot grec qui signifie « lit » (de femme) et d’un autre qui signifie « avoir ».
(p.242) Au Maghreb par exemple, dans les familles riches, il était de coutume d’offrir une esclave noire en cadeau de noces. Au xve siècle, beaucoup de femmes africaines servirent ainsi de concubines dans de nombreuses maisonnées marocaines, notamment à Fès.
(p.243) (…) d’une manière générale, ces femmes n’ont pas laissé une importante descendance dans le monde arabo-musulman. Cela bien qu’un compte rendu de l’Anti-Slavery Reporter – organe de la société antiesclavagiste britannique créée le 1er septembre 1856 – rapporte qu’à Constantinople tout homme respectable avait de nombreuses concubines noires. Pour autant, il était extrêmement rare de voir un mulâtre, parce que les enfants nés de ces relations étaient en général victimes d’infanticide. Les femmes noires étaient systématiquement avortées ou leurs enfants réduits en servitude et quant aux garçons ils devenaient le plus souvent eunuques. Quelquefois les enfants nés accidentellement étaient tués par les concubines arabes. C’était une pratique courante que tout le monde trouvait « normale ».
(p.244) Tous les déportés africains en terres arabo- musulmanes furent utilisés durant treize siècles comme une « main-d’œuvre sexuelle », serviles et humiliés tout le long de leur existence. La publication en 1998 d’un livre en turc, par le Dr Hifzi Topuz, apporte de précieux éclairages sur la vie quotidienne des derniers eunuques noirs de l’Empire ottoman au xxe siècle. Ceux-ci ne devinrent libres qu’à partir de 1918, année où fut proclamé le Mesutiet (l’interdiction de l’esclavage en Turquie). Le chapitre VIII du livre de l’auteur turc comporte un récit émouvant sur les souffrances subies par ces malheureux, l’arrachement à leurs familles, au pays natal, la douloureuse opération de castration à laquelle peu d’enfants survivaient, leur transfert final en Turquie. Voici un extrait de cet ouvrage (Meyyale), avec le témoignage (complet en fin de volume [cf. p. 285]) de Hayrettin Effendi, dernier eunuque noir du dernier sultan : «Je me souviens de mon enfance comme d’hier. Je suis originaire du Habesistan. Je suis un Galla. […] Nous vivions dans un petit village. Nous (p.245) étions très heureux. J’avais sept ou huit ans. Je jouais avec des enfants de mon âge sur la place du village. […] Puis un jour, des cavaliers sont venus. Ils ne ressemblaient pas aux hommes de chez nous. Leur visage était plus clair. Ils étaient armés. Ils nous ont attrapés. L’un d’eux m’a fermé la bouche et j’ai failli étouffer. Mes yeux sortaient de leurs orbites. Ils ont pris tous mes amis et nous ont emmenés. Je ne comprenais pas leur langue. C’est après que j’ai su qu’ils parlaient l’arabe. Arrivés dans un village, ils nous ont mis dans une cour. 11 y avait d’autres enfants comme nous. Ils parlaient la même langue que nous. Ils sanglotaient. Nous ne comprenions pas pourquoi ils nous avaient enlevés. Nous partagions le même chagrin. Nous restâmes trois jours sans boire ni manger. Nous étions effrayés.
« Quelques jours plus tard, nous avons été castrés à Massaoua, presqu’île de la côte éthiopienne occupée par les Turcs. Pendant de nombreuses années, je n’ai jamais oublié la douleur et la torture endurées. […] Un officier ottoman, Yakup, en mission à Aden, me prit et me ramena avec lui à Istanbul. C’était l’hiver. C’était la première fois que je voyais la neige. J’avais froid. Yakup m’a offert à quelqu’un de célèbre à Istanbul. J’étais déçu. J’aimais Yakup comme mon père. Il m’a offert au Cerkez Mehmet Pacha. Est-ce qu’on peut offrir un être humain en cadeau ? Je compris alors que cela pouvait arriver. En 1918 avec le Mesutiet on nous a affranchis. On (p.246) a acheté cette maison avec une amie, dame du palais. On se débrouille. C’est notre destin. »
A ceux qui survivaient à cette mutilation, rapporte un voyageur anglais, il était fait des conditions tellement éprouvantes que six à sept ans suffisaient pour supprimer une génération entière d’esclaves. Il fallait à nouveau « refaire le plein ». Les nouveaux venus avaient moins d’avenir encore que ceux tombés au cours des ravages provoqués par les négriers en Afrique. Et les survivants asservis, tous ceux qui atteignaient un certain âge, étaient mis à mort ou abandonnés à la mort comme bouches inutiles.
Encore à une période récente, le 24 juillet 1927, Antoine de Saint-Exupéry chef d’aéroplace à Cap-Juby (Tarfaya), au sud du Maroc, écrivait cette lettre à sa mère :
Bonjour Mère
Je vais bien. La vie est peu compliquée et peu fertile en récits. Nous employons comme manœuvres des Maures et un esclave. Ce malheureux est un Noir volé il y a quatre ans à Marrakech où il a sa femme et ses enfants. Ici l’esclavage étant toléré il travaille pour le compte du Maure qui l’a acheté et lui remet sa paie chaque semaine. Quand il sera trop fatigué pour travailler, on le laissera mourir, c’est la coutume. Je l’embarquerais bien en fraude sur (p.247) un avion pour Agadir mais nous nous ferions tous assassiner. Parfois l’esclave noir, s’accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captif, les souvenirs ne remontent plus. À peine se souvient-il de l’heure du rapt, de ces coups, de ces cris, de ces bras d’homme qui l’ont renversé dans sa nuit présente […]. Un jour pourtant, on le délivrera. Quand il sera trop vieux pour valoir ou sa nourriture ou ses vêtements, on lui accordera une liberté démesurée. Pendant trois jours, il se proposera en vain de tente en tente, chaque jour plus faible, et vers la fin du troisième jour, toujours sagement, il se couchera sur le sable. J’en ai vu ainsi à Juby mourir nus. Les Maures coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté, et les petits des Maures jouaient près de l’épave sombre, et, à chaque aube, couraient voir si elle remuait encore, mais sans rire du vieux serviteur. Cela était dans l’ordre naturel […]. Il se mêlait peu à peu à la terre. Séché par le soleil et reçu par la terre.
(p.255) Cette ignominie imposée aux peuples africains n’a fait l’objet d’aucune contestation par les intellectuels arabes. Pourtant, au cours des périodes abbasside, andalouse et fatimide, les Arabo-Musulmans, pour ne pas dire l’Islam, ont eu leur époque des Lumières.
(p.256) Mais dans le monde arabo-musulman on n’a jamais privilégié la tradition critique et encore moins celle de l’autocritique, dès lors qu’il s’agit de pratiques non réfutées par l’Islam.
Les intellectuels, philosophes et autres libres- j penseurs, voire de rares monarques probablement aussi tolérants que Constantin, furent marginalisés dans un univers où les tenants de la raison ont rarement pu se faire entendre face aux doctrinaires de la foi. Ainsi, pour la cause des Noirs, les Lumières arabes ne furent, au mieux, que d’une obscurantiste clarté dans un monde d’ombres. Même aux pires moments de la traite transsaharienne et orientale, pendant que des hommes comme Livingstone et Mgr Lavigerie manifestaient leur confiance dans l’avenir des (p.257) peuples noirs, les Arabes les condamnaient, d’avance et sans appel, à une condition toujours inférieure.(…)
Certains monarques, dont celui du Maroc, rappelaient et avec quel obscurantisme ! qu’il est dit dans le Coran (XVI, 71) que : « Allah a favorisé les uns d’entre vous par rapport aux autres dans [la répartition] de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu’ils possèdent de plein droit [esclaves] au point qu’ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d’Allah ? » Arguments bien commodes, puisque le Coran ne dit ni plus ni moins que ce que l’interprète lui fait dire. Aussi, pour nombre d’érudits arabes, ce qui est important, c’est l’interprétation qu’on en fait.
(p.263) Dans le Nouveau Monde la plupart des déportés ont assuré une descendance. De nos jours, plus de soixante-dix millions de descendants ou de métis d’Africains y vivent. Voilà pourquoi nous avons choisi d’employer le terme d’« holocauste » pour la traite transatlantique. Car ce mot signifie bien sacrifice d’hommes pour le bien-être des autres hommes, même si cela a pu entraîner un nombre incalculable de victimes.
(p.269) (…) l’étude la plus crédible sur le sujet est celle de l’historien américain Ralph Austin. Les travaux de ce chercheur, qui est sans doute le meilleur spécialiste de la question et n’a jamais essayé de minimiser le crime des Occidentaux, font autorité. Ses estimations ont été constamment affinées. Elles nous permettent d’avoir une idée suffisamment réaliste des effectifs globaux de captifs africains déportés à travers le Sahara, la mer Rouge et l’océan Indien depuis le haut Moyen Age. D’après son étude, nous pouvons estimer (p.270) à 7 400 000 le nombre d’Africains déportés au cours de la traite transsaharienne entre le VIIe et le début du xxe siècle. À quoi il faut ajouter 1 565 000 captifs décédés au cours du voyage et 372 000 autres demeurés en bordure du désert ou dans les oasis. Ce qui donne pour le Sahara un chiffre de 9 337 000 captifs. Dans les régions proches de la mer Rouge et de l’océan Indien, 8 000 000 d’Africains environ auraient été transférés.
On aboutit ainsi à un total de plus de 17 000 000 d’Africains.
À elle seule, cette traite serait à l’origine d’un peu plus de 40 % des 42 000 000 de captifs africains déportés. Ce chiffre serait même, selon certaines sources, vraisemblablement en deçà de la réalité. Il faudrait lui appliquer une marge d’erreur d’au moins 25 %, sur une période s’étalant du milieu du vue siècle au xxe siècle. Compte tenu du fait que, pour un déporté « arrivé à bon port », trois ou quatre autres auraient péri, directement ou indirectement, des conséquences des « guerres saintes d’approvisionnement », de l’incendie des villages, des greniers, des famines et des épidémies, on imagine aisément l’ampleur d’une telle tragédie à l’échelle d’un continent.
(p.270-271) Chose curieuse pourtant, très nombreux sont ceux qui souhaiteraient la voir recouverte à jamais du voile de l’oubli, souvent au nom d’une certaine solidarité religieuse, voire idéologique. C’est en fait un pacte virtuel, scellé entre les descendants des victimes et ceux des bourreaux, qui aboutit à ce déni. Ce pacte est virtuel, mais la conspiration bien réelle. Dans cette sorte de « syndrome de Stockholm à l’africaine », tout ce beau monde s’arrange sur le dos de l’Occident. Tout se passe comme si les descendants des victimes étaient devenus les obligés, amis et solidaires des descendants des bourreaux, sur qui ils décident de ne rien dire.
Ce silence sélectif entourant le crime arabo-musulman envers les peuples noirs, ou sa sous- estimation, pour mieux braquer les projecteurs sur la seule traite transatlantique est un ciment destiné à pérenniser la fusion des Arabes et des populations négro-africaines longtemps « victimes solidaires » du colonialisme occidental.
(p.272) En revanche, il est difficile de comprendre l’attitude de nombreux chercheurs – et même d’Africains américains qui se convertissent de plus en plus à l’Islam -, attitude pas toujours très saine, fortement animée qu’elle est par une sorte d’autocensure. Comme si évoquer le passé négrier des Arabo-Musulmans revenait à minimiser la traite transatlantique.
(p.273) Le débat n’est pas encore franchement ouvert sur la genèse et les conséquences apocalyptiques du saignement séculaire de l’Afrique par les Arabes, si officiellement le dernier marché aux esclaves i été fermé au Maroc en 1920, cette calamité se perpétuerait encore de nos jours, notamment dans les Emirats du Golfe et dans certains pays du Moyen-Orient. Un autre pays « arabo-musulman » entretient encore cette hideuse institution sociale sous diverses formes : la Mauritanie. Un observateur note : « L’esclavage reste un sujet tabou. Ni les autorités traditionnelles ni les pouvoirs publics ne veulent être mis sur la sellette et désignés du doigt. Aussi, pour éviter l’accusation de complaisance sinon de complicité, les uns et les autres s’efforcent-ils d’étouffer toute tentative de poser le problème sur la place publique et d’en débattre. Faire silence sur les problèmes tiendrait lieu ainsi paradoxalement de solution. Or, cette politique du silence crée les conditions mêmes de la pérennité de l’esclavage. Derrière ce mutisme défensif se profile la crainte de voir les esclaves revendiquer une plus grande participation à l’exercice du pouvoir. » Bien que partageant la même religion et « politiquement solidaires », en Libye, au Maroc comme en Algérie, les immigrés d’Afrique noire se sont toujours plaints d’être traités avec mépris, honteusement exploités et souvent violentés.
La route transsaharienne de l’esclavage en Afrique du Nord est toujours opérationnelle. (p.274) La seule différence est que, cette fois, ce sont les émigrés clandestins africains qui y transitent.
(p.274) Les Arabes libyens considèrent que les habitants de la côte africaine sont des êtres inférieurs. Avant, ils traversaient le Sahara pour les acheter et les revendre comme esclaves. Maintenant, ils les amassent sur des camions, et les traitent plus mal que des bêtes. Personne ne s’inquiète si ces clandestins meurent dans le désert. »
(p.281-282) Les versets du Coran encourageant l’esclavage des non-musulmans par les musulmans
XXXIII, 52. Il ne t’est plus permis désormais de prendre [d’autres] femmes. Ni de changer d’épouses, même si leur beauté te plaît, à l’exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose.
XVI, 71. Allah a favorisé les uns d’entre vous par rapport aux autres dans [la répartition] de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu’ils possèdent de plein droit [esclaves] au point qu’ils y deviennent égaux. Nieront-ils les bienfaits d’Allah ?
V, 43. L’épouse n’a aucun droit de s’opposer à son mari de posséder des esclaves femelles et d’avoir des rapports [sexuels] avec elles [de les violer]. Et Allah sait mieux.
IV, 24. Vous sont encore interdites : les femmes mariées, à moins qu’elles ne soient vos captives de guerre. [… ] Allah est celui qui sait, il est juste.
XXIII, 1. Bienheureux sont les musulmans […]
-, 5. qui préservent leurs sexes [de tout rapport]
-, 6. si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent.
XXXIII, 50. Ô Prophète ! Nous t’avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur dot, celles que tu as possédées légalement parmi les captives [esclaves] qu’Allah t’a destinées, les filles de tes oncles. […]
XXIV, 33. Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer pour vous procurer les biens de la vie de ce monde, alors qu’elles voudraient rester honnêtes. Mais si quelqu’un les y contraignait […], Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux.
LXX, 29-31. Les hommes qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses et avec leurs captives de guerre ne sont pas blâmables, tandis que ceux qui en convoitent d’autres sont transgresseurs.
(p.283) La malédiction de Cham
Noé, explique la Genèse, IX, 20-27, homme de sol, commença à planter une vigne. Il but du vin, s’enivra et se dénuda au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et en fit part à ses deux frères au-dehors. Sem et Japhet prirent un manteau et le mirent, à eux deux, sur leurs épaules, puis marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Leur visage étant tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé s’éveilla de son vin et apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Il dit : « Maudit soit Canaan. Il sera pour ses frères l’esclave des esclaves ! » Puis il dit : « Béni soit Jahvé, le dieu de Sem, et que Canaan lui soit esclave ! Qu’Elohim dilate Japhet et qu’il habite dans les tentes de Sem ! Que Canaan soit leur esclave ! »
Jusqu’au xf siècle, cette histoire, qui avait conservé un caractère très abstrait, n’avait jamais été vraiment associée à une quelconque couleur ou race. Il faut préciser également qu’avant le véritable essor de la traite, les représentations de l’Afrique et des Africains en Europe n’étaient pas encore péjoratives. Les Rois mages noirs, dans les scènes de la Nativité, étaient alors représentés de manière neutre. En Europe du Nord, les statues et peintures figurant saint Maurice, le martyr thébain qui, vers le (p.286) milieu du XIIe siècle, était devenu un saint germanique présidant à la christianisation des Slaves et des Magyars, le montraient avec des traits négroïdes. Les musulmans furent les premiers à recourir à la malédiction de Cham pour justifier l’esclavage des populations noires. Ils furent suivis par les commentateurs européens.
Dans l’histoire originelle, la faute retombait plutôt sur Canaan : les Cananéens, en fait, étaient les esclaves des Israélites. Mais finalement, dans la Genèse, c’était Cham qui avait fauté. Faire des Noirs les descendants de Cham permettait donc de s’appuyer sur les textes sacrés pour légitimer leur asservissement. Ce furent ensuite des créoles d’origine espagnole, Buenaventura de Salinas y Cordova et Leon Pinelo, qui, afin de légitimer la traite atlantique, cherchèrent au XVIe siècle à s’en servir.
(p.285) Témoignage de Hayrettin Effendi, dernier eunuque du dernier sultan
Je me souviens de mon enfance comme d’hier. Je suis originaire du Habesistan. Je suis un Galla. Mon nom était Gülnata. Nous vivions dans un petit village. Nous étions très heureux. J’avais sept ou huit ans. Je jouais avec des enfants de mon âge sur la place du village. Nous pratiquions toujours le même jeu. Nous courions les uns après les autres. Puis un jour, des cavaliers sont venus. Ils ne ressemblaient pas aux hommes de chez nous. Leur visage était plus clair. Ils étaient armés. Ils nous ont attrapés. L’un d’eux m’a fermé la bouche et j’ai failli étouffer. Mes yeux sortaient de leurs orbites. Ils ont pris tous mes amis et nous ont emmenés. Je ne comprenais pas leur langue. C’est après que j’ai su qu’ils parlaient l’arabe. Arrivés dans un village, ils nous ont mis dans une cour. Il y avait d’autres enfants comme nous. Ils parlaient la même langue que nous. Ils sanglotaient. Nous ne comprenions pas pourquoi ils nous avaient enlevés. Nous partagions le même chagrin. Nous restâmes trois jours sans boire ni manger. Nous étions effrayés.
Quelques jours plus tard, nous avons été castrés à Massaoua, presqu’île de la côte éthiopienne occupée par les Turcs. Pendant de nombreuses années, je n’ai jamais oublié la douleur et la torture endurées. Deux semaines (p.286) après la castration, nous avons commencé à guérir. On nous conduisit dans des ports. Il y avait des garçons et des filles comme nous. Nous ne parlions pas tous la même langue mais nous partagions le même sort. Tous les garçons étaient castrés. Il y avait une parfaite entente entre nous. Puis on nous embarqua à bord d’un bateau. Nous nous réjouissions d’avoir échappé à des monstres. Mais où nous emmenait-on ? Nous pensions qu’ils allaient nous jeter dans l’océan. Nous ne savions rien. Nous étions dans l’incertitude totale. Nos villages, nos frères, nos sœurs, nos mères étaient loin derrière. Serait-il possible de les revoir à nouveau un jour ? Certains parmi nous pleuraient sans cesse. Nous avions tous peur d’être noyés. Nous voyions la mer pour la première fois et nous avions peur. Nous nous étions regroupés dans le bateau. Nous regardions les vagues. Quel autre malheur nous attendait ? Pendant la traversée, le bateau négrier fut arraisonné par un patrouilleur anglais et les négriers arabes furent arrêtés. Tous furent conduits au port d’Aden au Yémen. Les enfants ont commencé à crier de joie croyant que nous allions regagner nos villages.
Notre joie fut de courte durée. L’interprète nous fit savoir qu’il serait très difficile de nous ramener dans nos villages. L’esclavage était aboli. Nous étions libres. A Aden, on nous a fait sortir du bateau. Nous avons été conduits à la place du marché. Le commandant anglais a prononcé un discours traduit en arabe. Nous n’avions rien compris. On nous l’a ensuite traduit en habesh. Comme la vente d’esclaves était interdite, on allait nous donner à des familles d’officiers et de fonctionnaires en qui ils avaient confiance. Les officiers étaient ottomans et les fonctionnaires sanjaks. Un officier ottoman, Yakup, en mission à Aden me prit et me ramena avec lui à Istanbul. C’était l’hiver. C’était la première fois que je voyais la neige. J’avais froid. Yakup m’a offert à quelqu’un de célèbre à Istanbul. J’étais déçu. J’aimais Yakup comme mon père.
(p.287) Il m’a offert au Cerkez Mehmet Pacha. Est-ce qu’on peu offrir un être humain en cadeau ? Je compris alors qui cela pouvait arriver. En 1918 avec le Mesutiet on nous ; affranchis. On a acheté cette maison avec une amie, darm du palais. On se débrouille. C’est notre destin.


