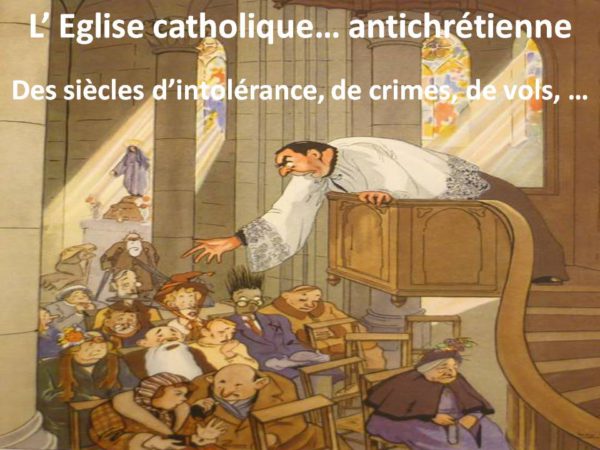
"L'Eglise antichrétienne", un hommage à toutes les victimes et aux résistants face à ce totalitarisme, dont 2 de mes grands-parents
PLAN
1 Analyses
2 Documents
1 Analyses
Un avant-goût de la raison de cette étude:
Pendant des siècles, l’Eglise catholique eut une emprise sur l’esprit ET sur le corps de toute une population: une forme de totalitarisme.
Un de mes membres de ma famille fut privé de faire ses études en section latin-grec car son père était boucher. Elle n’allait tout de même pas côtoyer les enfants de médecins, d’avocats, de dentistes, …
Que de carrières brisées (dans l’enseignement, …) !
Il y eut des équivalents de Gezelle et de Daens dans le sud du pays, et l’Eglise fit là aussi tout pour les casser.
Le mépris de la femme Ainsi, au théâtre, les pièces étaient uniquement jouées par des hommes. Ainsi à Nadrin (Ardennes), à Vitrival (prov. de Namur), où ma grand-mère (brabançonne) préférait se rendre dans les années 1930 aux représentations de la troupe socialiste où les femmes jouaient les rôles féminins. Bien lui en a pris.
Toujours à Vitrival, un de mes oncles, mort jeune, ne fut pas enterré à l’église, sur ordre de mon grand-père, brabançon comme sa femme. Le prêtre tenta d’entrer dans la maison de mes grands-parents, où se trouvait le cercueil de cet oncle. Interdit d’entrée, il repartit non sans s’empêcher de traiter mon grand-père de « mécréant ». Merci pour mon oncle et bonjour tristesse !
Le racisme anti-wallophone, anti-néerlandophone de la part du haut-clergé, suivi par une belle brochette de prêtres, tout heureux d’assouvir librement leur penchant pour la torture psychique.
L’espionnage des paroissiens (comme notre père, grand défenseur de la langue wallonne, mentionné dans le registre secret du prêtre du village, l’abbé Paquet, comme un « flamingant »; si mon père l’avait su…)
Des sermons pour -tenter d’interdire des fêtes, des bals, de travailler le dimanche (quitte à ce que la récolte soit partiellement perdue), … – voter anti-socialiste
Les populations furent terrorisées par la menace de l’Enfer.
Il y eut les chouchous et les « chouchoutes » des curés et sœurs enseignants…
Les pressions sur les premiers enseignants ‘libéraux’ et non-prêtres…
La pédophilie, du premier stade (comme poser gentiment la main sur la jambe partiellement dénudée de deux membres féminins de ma famille, portant une jupe, lors de la leçon de piano … un réel traumatisme pour l’une d’entre elles) au dernier (tout le monde peut le deviner).
La mutation malvenue de prêtres aimés de tous.
Oui, il y eut et il y a encore de bons prêtres, justes et de confiance, mais qui ont été et sont salis par toute cette crasse…
|
|
De katolieke kerk die veel schade heeft aangericht:
pedofilie, mensen bespioneren (zoals mijn vader die als « flamingant » beschouwd was in het geheime register van de priester van het dorp), de zogenaamde katolieke scholen met de kinderen van de rijken die begunstigd werden (één van mijn familieden mocht geen Grieks-Latijn studeren: haar vader was mar een slager), enz.
|
|
Wikipedia Oremus et pro perfidis Judaeis
Le thème de l’« aveuglement » du peuple juif1 contenu dans la prière est illustré par la Synagogue aux yeux bandés, cathédrale de Strasbourg, portail sud, milieu du xiiie siècle. L’expression latine Oremus et pro perfidis Judaeis était l’exorde d’une oraison prononcée dans la liturgie catholique lors de la prière du Vendredi saint. Introduite au viie siècle, elle signifiait originellement « Prions aussi pour les Juifs incroyants »2 ou « Prions aussi pour les Juifs infidèles », au sens où ces derniers n’adhéraient pas à la foi chrétienneN 1,N 2. Cependant, avec l’évolution de la liturgie et les traductions dans les langues communes, notamment le français (« Prions aussi pour les Juifs perfides afin que Dieu Notre Seigneur enlève le voile qui couvre leurs cœurs et qu’eux aussi reconnaissent Jésus, le Christ, Notre-Seigneur »), l’expression a rapidement changé de sens. Elle est devenue très vite, dans un contexte d’antijudaïsme, synonyme de « déloyauté », « fourberie »3, puis perçue par certains comme étant gravement offensante, voire antisémite. Cette terminologie a suscité des controverses depuis le début du xixe siècle aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Église catholique. Les discussions officielles au sein de la hiérarchie catholique pour l’abolir ou la réformer commencèrent dans les années 1920. En 1959, le pape Jean XXIII fit supprimer les termes contestés (perfidis ainsi que perfidiam4, qui figurait dans l’oraison). L’historien Jules Isaac dénonce ce qu’il appelle « l’enseignement du mépris », à travers des siècles de catéchèse qui ont persuadé les chrétiens de la perfidie juive et de son caractère satanique, soulignant le lien entre les pratiques de l’antisémitisme chrétien et le système hitlérien. Il évoque notamment les « préjugés antijuifs, les sentiments de méfiance, de mépris, d’hostilité et de haine à l’égard des Juifs, qu’ils soient de religion israélite ou simplement de famille juive »5. Après le concile Vatican II, ces termes ne réapparaissent pas. De plus, les allusions à la conversion des juifs sont supprimées. Depuis le missel de Paul VI, promulgué en 1970, la formulation est devenue : « Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la fidélité de son Alliance6. » Elle souligne l’élection d’Israël en tant que peuple de Dieu et ne lui demande plus de reconnaître le Christ, acceptant ainsi le judaïsme. Le motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI, paru en 2007, facilite l’utilisation du missel de 1962 pour satisfaire les traditionalistes. L’oraison a été modifiée dans l’édition de 2008 : les propos sur l’« aveuglement » des Juifs sont supprimés mais la phrase introductive demande l’illumination des Juifs à la connaissance du Christ, « Sauveur de tous les hommes ». Cette initiative a soulevé des inquiétudes chez les Juifs ainsi que dans le milieu du dialogue judéo-chrétien7, car l’intention demeure, selon l’ancienne tradition, la conversion des Juifs au christianisme.
|
|
Stéphane Courtois, éd., Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, éd. Robert Laffont, 1997
AUTRES TOTALITARISMES (p.39) Le Vatican a pendant des siècles et au nom de sa foi justifié le massacre des Infidèles, développé l’Inquisition, muselé la liberté de pensée et allait appuyer des régimes dictatoriaux comme celui de Franco ou de Salazar.
|
|
Marcos Sylvia, Experta en religión y género, El País 21/12/2004
En la teología cristiana y en especial la católica, subyace una animadversión hacia la mujer que la sitúa en una categoría inferior. La mujer es el símbolo de la carne y de la tentación. Es perniciosa. El hombre es el spiritu, la mujer la materia, la que se reproduce. Según esta visión, la mujer ideal es la que niega su sexualidad. Un antiguo profesor mío decía que la verdadera feminidad es la frigidez. Ahora ya no se atreven a decirlo, pero algunos lo piensan. (…) La religión es absolutamente androcéntrica. Pero en el protestantismo, al menos, hay mujeres pastoras.
|
|
1000s |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.86) La société féodale est aussi une société figée, où chacun est cloué dès la naissance à une place donnée comme éternelle. L’Église en a théorisé l’ordonnancement, comme, notera-t-on perfidement, elle apprendra à théoriser les systèmes sociaux successifs qui s’imposeront. Aujourd’hui, on présente le plus souvent la parole de Jésus comme une parole émancipatrice, une parole donnant aux hommes (p.87) leur liberté. C’est louable. Notons simplement qu’à l’époque féodale, pour ne citer que celle-là, les théologiens n’étaient pas du tout de cet avis. Un évêque franc, Adalbéron de Laon, contemporain d’Hugues Capet, avait résumé l’organisation du monde convenant à Dieu d’une formule que reprendront à sa suite tous les grands esprits du Moyen Âge. Pour fonctionner, le ciel avait voulu que la société des hommes fût partagée en trois ordres, où chacun devait se tenir jusqu’à la mort : oratores, bellatores, laboratores – ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. On s’en doute, à ces derniers, l’ici-bas n’offrait pas grand-chose d’autre que la misère, la faim, les coups et l’échiné courbée sous l’arbitraire des deux autres. Puisqu’à eux aussi le ciel était promis après la mort, pourquoi aurait-il fallu que la vie soit autrement ?
|
|
1095 |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.126) Il fallait attendre les malheurs du pauvre capitaine accusé à tort d’avoir trahi son pays pour découvrir une réalité presque jamais évoquée dans le reste des manuels : il y avait donc des Juifs en France. Depuis quelques décennies, on a voulu remédier à cet oubli, et on a commencé à parler des Juifs au Moyen Âge sous un autre angle : celui de leur persécution. Il y a de quoi dire, en effet. L’antijudaïsme est une réalité de la chrétienté médiévale. Un spécialiste du haut Moyen Âge comme Bruno Dumézil fait remonter à Dagobert une première grande tentative d’en finir avec ceux qui étaient alors les derniers non chrétiens de la Gaule mérovingienne, en les forçant à la conversion. De son côté des Alpes, le roi des Lombards, écrit l’historien, les força à choisir « entre le glaive et l’eau du baptême » et le roi des Wisigoths d’Espagne chercha à les réduire en esclavage. Triste période. D’autres, pires encore, suivront. On a parlé, déjà, des violences terribles commises contre les Juifs en 1095, partout où ont déboulé ces foules fanatisées qui partaient à la première croisade. Délire eschatologique qui faisait croire que la mort des « perfides » hâterait le retour tant attendu du Messie ? Ou folie de troupes tellement désireuses d’en finir avec les « infidèles » qu’elles se firent la main sur les premiers infortunés rencontrés en chemin ? On discute toujours entre spécialistes pour connaître les raisons profondes de (p.127) cette hystérie collective. On est sûr que des milliers de gens en furent les victimes, les Juifs de Rouen et surtout ceux de la vallée du Rhin, de Cologne, de Mayence. Bientôt, on impute aux fils d’Israël des forfaits imaginaires que toute l’Europe chrétienne tiendra pour aussi vrais que la résurrection du Seigneur et le bleu de la robe de la Sainte Vierge : ce sont les accusations de « crimes rituels », ces rapts d’enfants dont les Juifs se rendraient coupables aux alentours de Pâques pour leur faire subir mille tortures, comme « ils » en ont fait subir au Christ, et peut-être même les manger. La première accusation est attestée à Norwich, en Angleterre, vers 1150, et concerne l’enlèvement d’un certain petit Guillaume. À Pontoise, un petit Richard aurait subi le même sort, les accusations sont identiques. On en retrouvera un peu partout. Lors des massacres de 1095, les évêques souvent, les seigneurs parfois font ce qu’ils peuvent pour sauver des populations qui sont de leurs villes et de leurs villages depuis des siècles. L’empereur Henri IV signe des textes qui permettent aux Juifs de reprendre leur religion, car aucune conversion ne saurait être valide qui ait été imposée par la force. Au milieu du XIIe, saint Bernard de Clairvaux, au moment des massacres déclenchés au début de la deuxième croisade, celle qu’il a prêchée lui-même, se met en colère : « Pourquoi tourner votre fureur contre les Juifs ? Ils sont l’image vivante de la passion du seigneur. » En d’autres termes, il ne s’agit pas d’aimer les Juifs puisqu’on sait qu’« ils » ont tué le Christ, mais c’est précisément parce qu’ils sont les témoins vivants de ce crime affreux qu’il ne faut pas les faire disparaître. C’est alors la position officielle de l’Église, elle est un peu alambiquée, c’est indéniable, mais elle a au moins un côté appréciable : elle pousse nombre d’ecclésiastiques à s’opposer aux exactions. Pourtant, peu à peu, les autorités vont elles aussi déchaîner la haine. En 1182, Philippe Auguste avait déjà chassé les Juifs de ses terres, ce qui lui avait permis de leur voler leurs biens, mais il les avait rappelés en 1198, se rendant compte qu’ils lui rapportaient plus d’argent quand il pouvait les écraser d’impôts. Le contexte (p.128) général du début du XIIIe siècle tend les choses un peu plus. L’époque est à la lutte contre les hérésies, à l’idée d’une domination sans partage du christianisme. Au quatrième concile de Latran (en 1215), l’Église décide de faire porter aux Juifs des signes distinctifs, pour qu’on ne les confonde plus avec les chrétiens, ici ce sera un chapeau, là la couleur jaune, ailleurs un insigne représentant les tables de la Loi. Saint Louis, on l’a écrit déjà, impose la rouelle, une pièce ronde de tissu. C’est lui aussi qui organise le procès public du Talmud (en 1240), le grand livre de la foi. Il a ouï dire que ce texte comportait des offenses aux chrétiens, il convient donc de le juger. Courageusement, des rabbins vont le défendre. Leur cause était évidemment perdue d’avance. Le Talmud et bien d’autres manuscrits précieux sont brûlés publiquement en 1242. Et peu à peu la situation des hommes, des femmes, des familles qui vivaient dans le royaume depuis des temps immémoriaux se précarise. De plus en plus de métiers leur sont interdits. Philippe le Bel les expulse à nouveau d’un royaume devenu bien plus vaste qu’il n’était un siècle plus tôt. Plus de 100 000 personnes, dit-on, doivent fuir dans la douleur, les pleurs, l’effroi. C’est une catastrophe pour le pays, qui perd des forces vives, et pour les exilés qui sont chassés de terres où ils vivaient depuis des siècles. Louis X les rappelle, mais sous conditions et peu ont le courage de réaffronter des lieux devenus si inhospitaliers. Le XIVe siècle qui s’ouvre est le pire. Il est celui de la Grande Peste, et dans ce contexte de panique les superstitions se déchaînent. Maintenant on accuse les Juifs d’empoisonner les puits : ils tuent bien les enfants à Pâques, pourquoi pas les pauvres paysans qui cherchent à boire ? Le pape essaie de démonter cette accusation en en montrant l’absurdité : pourquoi accuser les Juifs d’avoir propagé un mal dont ils meurent eux aussi ? Ses paroles portent peu. L’époque est sourde à tout argument, surtout les plus rationnels. En 1394 enfin, sur ordre du roi Charles VI, les Juifs sont définitivement expulsés de ce qui est maintenant la France. Beaucoup iront se réfugier en Alsace, qui est une terre d’Empire, ou en (p.129) Provence, qui l’est aussi. Hélas, la Provence devient française à la fin du XVe, il faut partir à nouveau. Certains trouveront refuge dans les États du pape, ces quelques communes autour d’Avignon. Les pontifes y protègent leur vie, mais quelle vie ? Des existences rendues misérables, dans les carrières, ces quartiers où nul n’a le droit d’entrer ou de sortir après la tombée du jour, et où presque tout leur est interdit.
L’enseignement du mépris À bien des égards, c’est vrai, l’histoire du judaïsme médiéval en Europe est une sombre histoire. À l’époque, sur notre continent, seule la Pologne, dont les rois accueillent ceux que les croisés ont pourchassés, fait preuve de tolérance, et l’Espagne musulmane, bien sûr, qui se conforme à l’usage du monde islamique : les gens du Livre – Juifs et chrétiens – sont soumis à un régime d’impôt spécial, ils ne sont pas considérés comme des égaux des musulmans, ils sont soumis à certaines mesures discriminantes qui nous apparaissent aujourd’hui choquantes, mais au moins ils sont protégés. Partout ailleurs, et tout particulièrement en France et en Angleterre, la persécution est la règle. On a évidemment raison de rappeler ce passé détestable. D’abord, il aide à comprendre les racines lointaines de l’antisémitisme, ce fléau du XXe siècle, même s’il est d’une structure différente : au Moyen Âge, l’obsession est religieuse, nul ne parle encore de « race » juive, comme le feront les nazis. Les rois, l’Église y ont leur part, dispensant ce que le grand historien Jules Isaac a appelé « l’enseignement du mépris », c’est-à-dire cette haine officialisée et sciemment répandue. Les enfants disparus, Guillaume de Norwich et Richard de Pontoise, ont été canonisés comme « martyrs des Juifs » peu après leur mort, et jusqu’au milieu du XXe siècle on trouvait tout naturel d’en célébrer le culte. Il faudra attendre le grand concile de Vatican II, c’est-à-dire le début des années 1960, pour que cette théologie soit enfin abandonnée.
|
|
1096 |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.117) Lors de la première croisade, en 1096, ils sont 300 000 à quitter tout ce qu’ils ont, famille, champ et village, pour suivre des gens qu’ils n’ont jamais vus qui leur demandent de délivrer un endroit dont ils ne savent rien. Sitôt qu’ils aperçoivent les tours d’une ville de Rhénanie, ou des Balkans, les croisés hurlent : « Jérusalem ! Jérusalem ! », parce qu’ils se croient au terme du voyage. Ils n’y arriveront jamais. Seuls quelques milliers échappent au soleil du désert et au sabre des Turcs, et moins encore réussissent à se greffer à la croisade des chevaliers, celle de Godefroy de Bouillon, partie à leur suite. Les quelques survivants y deviendront les « tafurs » – on croit savoir que ce nom curieux dérive du patronyme de celui qui dirigeait leur bande. Cette appellation oubliée était connue de tous, à l’époque. Il suffisait de l’évoquer pour semer la terreur dans les deux camps. Apôtres du dénuement, armés de leur seul bâton mais d’une férocité, d’une folie devenues proverbiales, les tafurs se rendront célèbres, entre autres, en organisant des repas de cadavres d’infidèles.
|
|
1096 |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.135) Les historiens sont d’accord aujourd’hui pour montrer que l’entreprise avait plus à voir avec la géopolitique qu’avec de réelles motivations spirituelles. Emmenée par les petits seigneurs du Nord, vassaux de Philippe Auguste, dont le cruel Simon de Mont-fort, la croisade permet surtout au roi de France de mettre la main sur le comté de Toulouse, traditionnellement allié à la Catalogne d’outre-Pyrénées. On ne peut toutefois oublier, pour ajouter . encore un peu de noir à ce tableau déjà bien sombre, une des conséquences strictement religieuses de la répression anti-Cathares : pour éradiquer enfin les mauvaises croyances, la papauté décide au début du XIIIe siècle de confier une justice à l’ordre nouveau des Dominicains. Tout pouvoir d’enquête lui est donné, sans contrôle, sans appel, dans le secret. Son seul nom fait frémir : l’Inquisition.
|
|
1100s |
Véra Dupuis, Samuel Dhote, Jeux, fêtes et traditions dans le Nord et le Pas-de-Calais, éd. Ouest-France, s.d. Le noble jeu de tir à l’arc, de l’arbalète et du javelot
(p.50) A cette époque de croisades, l’arbalète avait une telle image d’arme militaire meurtrière que même le pape fit publier un édit interdisant l’usage de cette arme « détestable aux yeux de Dieu, contre les chrétiens et les catholiques » (Robert Hardy, « Le Grand Arc », éditions Edita-Denoël).
|
|
1100s |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.138) /Abélard/
Il aimait considérer les textes des Pères de l’Eglise les uns après les autres pour en faire éclater les contradictions. Non pour montrer qu’ils disaient n’importe quoi, mais pour chercher à mieux faire ressortir l’intention de Dieu dans sa complexité. En bref, il aimait réfléchir et apprendre à ses élèves à penser. C’était audacieux. Surtout quand on croise sur sa route un ennemi aussi redoutable et haineux que Bernard de Clairvaux, le futur grand saint dont nous avons parlé plus haut. On peut être grand aux yeux de Rome et petit quand il s’agit de faire appliquer ses lois. Bernard qui, à Vézelay, a prêché la deuxième croisade avec un immense succès, Bernard qui fait la morale par ses lettres à tous les rois d’Europe est aussi, à ses heures, une diva jalouse. Il s’agace d’un clerc dont il lui revient aux oreilles qu’il développe des thèses bien hardies. Abélard, de façon loyale, demande à pouvoir s’expliquer en réunion publique pour discuter avec le futur saint, et montrer à tous que les positions qu’il défend ne sont pas les brûlots que l’on dit. Le 3 juin 1140 est réuni le concile de Sens qui doit examiner cette question. Mais le perfide Bernard, craignant d’être dépassé par le trop brillant esprit (p.139) d’Abélard, a préparé le terrain. Il s’est entendu dès la veille avec tous les grands personnages présents et les évêques pour sceller le sort de l’accusé avant même le procès. Le jour dit, Abélard se retrouve interdit de stupeur en découvrant une telle ignominie et ses thèses sont condamnées sans qu’il ait pu ouvrir la bouche.
|
|
1215 |
Marie-Rose Bonte (BXL), Afghanistan / Quand l’hisoire se répète, LB 11/06/2001
Le 4e Concile du Latran, en 1215, décrète que les juifs doivent porter un signe distinctif sur leurs habits.
|
|
1252 |
Alain de Benoist, Vu de droite, Anthologie critique des idées contemporaines, 1977, éd. Copernic
(p.498) En 1252, par la bulle « Ad extirpenda », le pape Innocent IV autorise les inquisiteurs à utiliser la torture.
|
|
1300- |
André Spineux, Histoire et folklore de Vitrival, 1958
(p.18) Histoire et folklore du Bois des Mazuys
Trame de fond de l’histoire de Vitrival, la forêt intervient largement aussi dans son folklore. Dès le XIIIe siècle, un différend exista entre les habitants de Vitrival et le Chapitre des Chanoines de Saint-Feuillen, de Fosses, seigneur du lieu, au sujet d’usages forestiers exercés dans le bois appartenant au Chapitre et qui était dit Bois des Chanoines. Un arbitrage eut lieu le 30 avril 1287 : les arbitres n’étaient autres que le prince-évêque de Liège et l’avoué de Fosses, désignés par les deux parties en cause. Au XVIe siècle, pour mettre fin à un autre conflit, le Chapitre, par acte du 6 juin 1522, cantonna les droits d’usage dans 200 bonniers de bois pris dans le Bois des Chanoines, lesquels furent dénommés Bois des Mazuys, du nom des principaux bénéficiaires de ces droits ; mais une rétrocession de propriété ne tarda pas à se produire à la propriété des 200 bonniers : les Mazuys de Vitrival préféraient l’usage des 600 bonniers du Bois des Chanoines, surtout pour le champiage et la glandée. Une autre contestation surgit au XVIIe siècle. La Haute Cour de Vitrival, après avis de la Cour des Echevins de Liège, premier degré d’appel de la juridiction civile et répressive, admit le point de vue du Chapitre par jugement du 2 mai 1672. Les Mazuys appelèrent de ce jugement devant le Conseil ordinaire du prince-évêque, qui rejeta leur appel le 19 janvier 1673. Mais les Mazuys, par requête du 17 septembre 1673, n’hésitèrent pas à porter le débat devant la Chambre impériale de Wetzlar, juridiction suprême pour l’Empire tout entier : le procès y sommeilla jusqu’en 1715, année où le dossier fut rouvert, pour ne trouver cependant une solution que grâce à une transaction intervenue le 21 avril 1750 entre le Chapitre et les Mazuys (1).
(1) Paul ERRERA, « Les Masuirs », 1891. L’auteur de cet important ouvrage ne s’est pas demandé comment la communauté de Vitrival, composée d’une quarantaine de petits cultivateurs, fut amenée à cette procédure qui lui permit de garder pendant trois quarts de siècle des droits selon une mesure qui était contestée : cette période coïncide, avons-nous constaté, avec celle où des Grady, de Fosses, propriétaires de la cense de la Spinette à Vitrival, siégèrent à la Cour des Echevins de Liège.
(p.19) Ce sont là autant de faits qui montrent l’obstination de la modeste communauté rurale de Vitrival, au cours des siècles, pour maintenir des droits d’usage médiévaux : Vitrival prouve ainsi, à coup sûr, l’ancienneté de ses institutions. Pareille obstination continua à se déployer après la Révolution française quand Vitrival devint une Commune : l’administration française ayant interdit tout usage forestier, la municipalité de Vitrival plaide en 1804 le maintien des droits ancestraux dans le Bois des Mazuys en faveur des « habitants de la commune »; elle se garde bien de parler des Mazuys, expression qui aurait compromis les chances de succès par le relent de « ci-devant » attaché au Mazuyage exercé sous forme de privilège. L’arrêté du Conseil de Préfecture en date du 10 septembre 1812 maintint les droits d’usage forestiers au bénéfice des « habitants de la commune »; mais ces droits continuèrent à s’exercer, comme sous l’ancien régime, et jusqu’en 1946, au profit uniquement des « Mazuys », c’est-à-dire ceux qui possédaient à Vitrival leur maison et un bonnier et demi de terre (soit un hectare trente ares depuis 1864). Pour mettre un terme à des contestations qui avaient surgi entre la Commune et l’Etat, successeur du Chapitre dans la propriété du Bois des Mazuys, la Commune acheta le bois par acte du 16 mars 1829, n’hésitant pas à contracter un emprunt, opération hardie à l’époque, pour couvrir son paiement.
|
|
1500s |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.245) /Les guerres religieuses/
/Les protestants étaient d’un humanisme relatif. Deux exemples./
Le premier se passe dans l’Empire. Dès 1525, poussés par le vent que Luther lui-même a suscité, des paysans se révoltent en Allemagne contre les horribles conditions de vie qui sont les leurs. Le moine protestataire est effrayé par cette rébellion contre l’autorité et contre les princes dont il a tant besoin. Alors même que des milliers de ces malheureux sont victimes de la plus abominable répression, il écrit textuellement qu’il faut les frapper et les éventrer « comme on assomme un chien enragé ». Le second a lieu à Genève. En 1553, un érudit espagnol, Michel Servet, y cherche abri parce qu’il défend des thèses audacieuses, lui aussi. Il attaque le dogme de la Trinité. Hélas pour lui, ce dogme-là ne plaît pas à Calvin : sur son ordre, Servet est donc brûlé. Un seul de ses lieutenants contestera cette condamnation et rompra avec son maître. Il s’appelle Sébastien Castellion et écrira à propos de cette affaire une phrase admirable : « Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. » II était bien seul à penser de la sorte à l’époque. La Genève du XVIe siècle – comment le nier ? – a plus de parenté avec un Etat taliban qu’avec le paradis des droits de l’homme : la danse, l’amusement, la fête y sont interdits et le seul fait d’oser porter un vêtement à la mode ou de laisser échapper un Ave Maria du bout des lèvres est un moyen très sûr de se faire traîner devant le « conseil », l’impitoyable tribunal de la moralité qui contrôle tout et chacun.
(p.246) Ce siècle a laissé un autre legs durable : une haine farouche entre protestants et catholiques. Aujourd’hui elle paraît loin. Dans une société déchristianisée, la plupart des gens font mal la distinction entre les branches du christianisme, et cela pousse à des approximations qui auraient fait sortir les fusils il n’y a pas si longtemps. À la radio, à la télé, par exemple, le pape est souvent présenté comme « le chef des chrétiens ». Non, le pape est le chef des catholiques. Une partie des chrétiens se réclament de Luther et de Calvin, qui, précisément, ont fondé leur doctrine sur le rejet de cette hiérarchie, et avec quelle violence ! Celle-là aussi est oubliée. On croit souvent que l’hostilité anticléricale est une spécialité du XIXe siècle ou du XXe. Il faut alors relire les pamphlets calvinistes contre « la putain romaine », les « papes sodomites » et les couvents qui sont autant de « bordels » (on disait « bordeaux », mais le sens est le même). Le protestantisme rejette le culte des saints et des vierges : cela se traduira par d’innombrables dévastations d’églises, dont on brûle les reliques, les tableaux, les statues dans des manifestations de violence dont aucun des pires « bouffeurs de curé » du siècle dernier n’aurait été capable. (p.247) Les catholiques ne sont pas en reste, évidemment, quand il s’agit de rendre la pareille. Ils continueront à entretenir une haine qui durera fort longtemps et structurera profondément leur pensée politique. Nous avons tous une idée des ravages qu’a pu produire la haine antisémite, en France, au moment de l’affaire Dreyfus par exemple. Jusqu’au début du XXe siècle, pour les catholiques conservateurs, la haine antiprotestante était largement aussi forte. Pour Maurras, le très influent penseur de l’extrême droite, le protestantisme est un des poisons qui menacent la « fille aînée de l’Église », un protestant est un pilier de « l’anti-France », il est largement aussi dangereux pour l’identité nationale qu’un Juif ou un franc-maçon. C’est dire à quel niveau il le situe.
Mourir pour son Dieu
L’idée la plus commune à propos de guerres de Religion, c’est : « comme c’est bête de se faire la guerre pour des raisons religieuses. » Un des points de dissension les plus aigus entre protestants et catholiques portait sur la présence réelle ou non de Jésus dans l’hostie consacrée. Pour tout esprit un tant soit peu éloigné du christianisme, concevoir qu’on ait pu s’entre-massacrer pour savoir si oui ou non on mange vraiment Dieu quand on communie à la messe paraît surréaliste. En même temps, la religion prétend jouer avec des questions fondamentales, des questions de vie ou de mort, littéralement. Quoi de plus naturel, quand on y croit, que d’aller jusqu’au sacrifice suprême, précisément, pour des choses d’une telle importance ? Luther, Calvin sont intimement persuadés d’agir pour le salut des âmes et pour sauver l’humanité tout entière. Nombre de protestants vont au bûcher comme on va au martyre, avec la certitude de gagner le paradis. Si les catholiques veulent « extirper l’hérésie », c’est parce qu’il en va du salut public d’éliminer ceux qui défient Dieu et qui vont donc hâter la fin des temps. Il ne s’agit pas d’excuser, il s’agit de comprendre la logique à l’œuvre.
|
|
1600- |
Jean-Pierre Mandy, 7 siècles d’histoire au pays d’Arlon, 1998
(p.335) Un décret de la Chambre des Comptes, daté du 17 août 1649 nous apprend que les religieux carmes d’Arlon ont depuis toujours coutume de prendre le bois de chauffage et de construction dans le bois du Beinnert et qu’ils ont donc le droit de prendre autant de bois qu ‘ils ont besoin (30). En 1750, rien que dans les grueries d’Arlon et de Chiny, il y a plus de 2.280 ménages qui n’ont d’autre source que les forêts domaniales pour se procurer, à titre plus ou moins onéreux, les chênes dont ils ne peuvent se passer et auxquels ils ont droit en vertu de titres établis. La Chambre des Comptes considère en 1760 que les bois de la gruerie d’Arlon sont « épuisés » ou hors d’état de fournir avant longtemps une coupe exploitable. Charles VI, considérant les coupes extraordinaires comme une aliénation de son domaine, a prohibé par des instructions formelles, d’y procéder sans son ordre ou permission. Par l’article 3 de son ordonnance de 1754, il change les dispositions des coupes. Il informe les seigneuries sur l’état des bois et les informe des mesures à prendre. Dans le Ronbusch (voir p. 331, n°58), petit bois de chênes, jadis arrenté, Vos Seigneuries ont fait abattre 26 chênes en 1756… ce bois est épuisé. Pour le bois le Beinert (350 arpents) nous voyons en partie par les comptes rendus et en partie par les avis du baron Cassai, que cette coupe a été triplée et qu ‘on en a coupé, tantôt plus, et tantôt moins, au delà de 36 arpents en moyenne tous les ans au lieu de 10 arpents et 166 verges; ainsi dans 5 ou 6 ans, il sera épuisé. Les officiers de gruerie, joints aux RR.PP. Carmes d’Arlon ont eux-même tellement dégradé et traité d’une manière si inouïe ces bois, que si le gouvernement avait statué sur les procès-verbaux du Commissaire envoyé par le Conseil des Finances en 1741, ces officiers auraient au moins mérité d’être casses… (31).
(30) VANNERUS (J), Cartulaire des Carmes d’Arlon, A.I.A.L.A., t. LXXIV, 1943, p. 105, acte n°363. (31) d’ALVIELLA (G), Histoire des Bois et Forêts de Belgique, t. Il, 1927, p. 298.
|
|
1700 |
in : MA, 11, 1984, p.210-212
Les sanctuaires à répit dans la région du Centre
« La mort du nouveau-né, qu’elle intervienne avant ou pendant la naissance, a toujours été vécue d’une manière tragique par le couple. Dans les siècles passés, lorsque l’enfant mourait avant le baptême, les parenls non seulement étaient affectés douloureusement, quoiqu’on en ai dit, par la perte de leur « fruit », mais ils étaient angoissés par la destinée de l’âme de leur enfant (…) et pour que l’enfant puisse recevoir le sacrement et être enseveli en terre consacrée, les parents inconsolables se tournaient vers le seul recours qui leur restait, le sanctuaire à répit. Là, ils attendaient que des « signes de vie » se manifestent sur le petit corps jusqu’alors inerte; on pouvait ensuite conférer le baptême et empêcher l’âme du nouveau-né de « rester éternellement dans les ténèbres effroyables des limbes, où ils n’auraient jamais vu Dieu » (1). Dans la région du Centre, j’ai dénombré six sanctuaires à répit. Bien que ceux de Cambron-Casteau et de Tongré-Notre-Dame soient situés en dehors de l’aire que je prospecte, je les ai pris ici par des habitants du Centre, et en particulier de Soignies et environs, y vont encore en pèlerinage. La belle chapelle de Notre-Dame au Puits (ou du Puits), èl capèle du Pus’, à Trivières, a été bâtie en 1664. Au printemps de 1984, j’ai visité ce sanctuaire et j’ai eu le plaisir de « découvrir » une pierre tombale (118 x 72 cm) scellée dans le mur à l’intérieur. Voici l’inscription qu’on peut lire : ICY GIST L’ENFANT DE PHILIPPE / WAUQUIER CENSIE DU FONTINY / A PERON-NE LEQUEL ENFANT / ESTOIT MORT VENANT AU / MONDE ET A MIRACULEUSEMENT / RECEU LA VIE ET LE BAPTEME / PAR L’ENTREMISE DE LA STE VIERGE / NRE DAME DU PUITS A TRIVIER / LE 18 DE MAY 1705 / PAR ATTESTATION DE PLUSIEURS / TEMOINS ET SIGNE DU CUREZ. A noter que PERONNE désigne Péronnes-lez-Binche et TRIVIER le village de Trivières. On peut voir, gravée sur cette pierre, l’effigie d’un enfant emmailloté : seule la figure est découverte et tout le corps, bras, jambes et tête sont entourés de bandes de tissus (voir la figure ci-contre que j’ai reproduite d’après la pierre tombale). A Houdeng-Aimeries, dans le bois de la Muchotte, èl bos dèl Muchote, une chapelle consacrée jà N.-D. du bois du Sart, Notre-Dame du bos ou N.-D. du Sârt fut fondée en 1244. Elle a été démolie, remplacée par une autre chapelle vers 1600 et agrandie en 1900. (p.205) On lisait autrefois sur une planche dans le sanctuaire dit èl capèle du Bos ce’-te inscription « L’enfant de Ghislp.in Drugman et de Marie Les-crinier, du village de Gœgnies, après este 24 heures en terre fut porté devant cette image et aîant monstre signe de vie a esté baptisé 1658» (2). C’est propblablement ce miracle qui explique qu’on va encore invoquer cette madone pour veiller sur les enfants malades, et sur les malades en danger de mort.
La chapelle Notre-Dame de Bon Vouloir a été érigée à Havre en 1625. Ce sanctuaire contient 11 ex-voto peints. Sur l’un d’eux, on peut lire «1632. Crucie delboue femme de Jean dufour enfanta le 29 avril 1632 une fille morte, et déjà demi consommée dans la tristesse de son cœur elle s’adressa à la vierge de bon vouloir et la fit transporter à havre ou étant exposée devant l’image de miséricorde, elle jetta du sang par les narines, ouvrit la bouche, reçut la vie et fut enfin baptisée » (3). On prie Notre-Dame de Cambron dans l’église de Cambron-Casteau dont la construction remonte à la ‘fin du 13e siècle ou au début du 14e siècle. Les « répits » ci-après ont été notés dans l’ouvrage de R. Paternotte (4) : — Une femme de Lombise eut un enfant mort-né. Elle se tourne vers N.-D. de Camb’on et le petit être se ranima (citation sans date). — A Cambron-Casteau, une femme met au monde deux fils privés de vie. On va les placer sur l’autel; ils s’animent, reçoivent le baptême, et le chœur des moines entonne le Te Deum (citation également sans date).
A Tongre-Notre-Dame, une première chapelle dédiée à N.-D. de Tongre fut fondée en 1801. « Sa grâce s’étend particulièrement aux enfants morts-nés. Ceux-ci n’ont pas connu le baptême. Ils sont donc condamnés aux limbes. La Vierge leur rend la vie et leur offre donc la responsabilité de recevoir le sacrement et par là-même leur permet d’accéder au salut. Le 20 avril 1643, Waudru du Pont, femme de Thomas Jaspar de Maffle, accouche d’un garçon mort. Les parents le portent immédiatement à la chapelle Notre-Dame de Tongre. Ils y passent douze jours et douze nuits en prières continuelles. Ils sont résolus à ne quitter l’endroit qu’après avoir impétré le baptême à l’enfant. Le 2 mai dans l’après-midi, le petit garçon recouvre progressivement la vie. Le pasteur Georges Huart le baptise aussitôt et le prénomme Joseph. Le 9 mai, Monseigneur François van der Burch, archevêque de Cambrai, approuve le miracle. Après son baptême, l’enfant vivra encore pendant six heures. Dans la relation des miracles de Tongre, on trouve douze cas de ce genre » (5).
La statue de N.-D. de Trazegnies trône dans l’église paroissiale de cette localité. On attribue à cette madone 17 miracles dont une résurrection d’enfant morts-né. Une mère fait, à deux reprises, déterrer son enfant mort-né. En présence du curé et des paroissiens, le cadavre, déposé sur l’autel de Notre-Dame, donne des signes de vie. Le prêtre s’empresse de baptiser l’enfant ressuscité. Deux témoins oculaires relatèrent l’événement (l’un vivait en 1488 et fit son testament en 1515, l’autre en 1525) (6).
Robert DASCOTTE
|
|
1700s |
in: René-P. Hasquin, Les grandes colères du Pays Noir, éd. Londot, 1972
/18e siècle/
(p.17) L’instruction n’est donnée qu’à de rares privilégiés. La masse, subjuguée par la puissance cléricale, n’a pas le droit à l’instruction. Toute la vie, en ces temps-là, était conditionnée par deux facteurs primordiaux : la religion et le travail. Le clergé était si puissant et si peu social, qu’il paralysait toute émancipation. Dans ces régions sambriennes où la vigne pourtant croissait généreuse et savoureuse, (1) où le grain donnait le plus revigorant des « pèkèts », les membres du clergé n’avaient pratiquement d’autres mérites que celui d’alléger les misères morales. Et de combattre l’alcoolisme. Car on buvait sec dans nos chaumières de Charleroy et environs ! En 1709, il n’y avait pas moins de treize brasseurs installés sur le territoire du seul Charleroy et les distilleries s’y trouvaient au nombre de sept en 1767, neuf en 1772 et sept à nouveau en l’année 1781. Le clergé, pourtant, montait bonne garde. Durant tout le XVIIe siècle, il fut interdit de débiter des boissons alcoolisées pendant l’exercice du culte religieux. En 1614, un mandement de l’archidiacre du Hainaut interdisait même d’étaler et de vendre des marchandises les dimanches et les jours de fête. A 20 heures, tous les cabarets devaient être fermés. L’instruction pouvait être
(1) Il y avait de la vigne un peu partout sur les coteaux sambriens. On la cultive encore à Ransart et à Huy.
(p.18) dispensée aux enfants de familles fortunées, mais le plus souvent, seuls les prêtres avaient quelqu’instruction. Autre détail significatif quant à la moralité de l’époque : les bâtards ne trouvaient pas place sur les registres de la paroisse ; on les inscrivait sur des tablettes confidentielles. Par contre, les enfants trouvés avaient droit à l’enregistrement officiel paroissial. Quoi d’étonnant qu’en ces temps-là, la plupart des enfants sans père connu, fussent abandonnés sur le parvis des églises ou à l’entrée des cures !
|
|
1800s |
in : Michel Lagrée, dir., Les parlers de la foi, Religion et langues régionales, PUR 1995
(p.23) /Alsace/ Avant 1848 la diffusion du français dans les écoles catholiques de filles est assurée principalement par les sœurs membres de congrégations enseignantes. Elle se heurte bien des fois aux parents, aussi bien dans des villages catholiques du Haut-Rhin que dans certains villages luthériens de l’Alsace du Nord.
(p.27-28) Très vite les Églises se trouvent confrontées au nouveau personnel politique qui veut étendre la politique scolaire d’assimilation et les lois laïques à l’Alsace. Le milieu politique et administratif, marqué par le jacobinisme et une incompréhension totale des réalités locales ne voit en Alsace qu’une « terre de mission ». Par les instructions du recteur Charléty en 1920, l’allemand n’est autorisé qu’à partir de la troisième année scolaire à raison de trois heures hebdomadaires en dehors du catéchisme. Les résultats de cette politique sont catastrophiques. En 1926 le pasteur de Soultzeren lance Théophile Birmelé un véritable cri de détresse : baisse du niveau scolaire, méconnaissance des deux langues, recul de la lecture, du niveau culturel et de la compréhension des concepts spirituels. Les pasteurs se voient contraints de baisser le niveau de la langue dans les prédications pour se faire comprendre.
(p.37) Les académiciens dénoncent les différents moyens mis en place par les gouvernements pour détruire tout caractère breton, afin de normaliser l’espace linguistique étatique, de réduire les « poches » de résistance et la toute-puissance du clergé, accusé de participer à leur préservation: le choix d’administrateurs et également d’évêques parmi des personnes extérieures à la Bretagne, la conscription qui éloigne les Bretons de leur pays et les envoie dans des régions où ils se voient contraints d’apprendre quelques rudiments de français pour échapper aux risées de leurs camarades de chambrée ; l’école où la langue bretonne est proscrite, les élèves punis, humiliés29. Nos gouvernements athées savent bien, déclare Charles Paul, que dans une nation composée comme la France de races différentes, l’unification complète des mœurs et des idiomes entraînera avec elle l’étiolement des caractères et des volontés, lequel n’est lui-même que le prélude de l’indifférence religieuse et finalement de l’irréligion, leur but final30.
29. Ibid., p. 97-100. Conférence Miossec, « Ar brezonek erskoliou », 2 mars 1902. 30./A/W., p. 123.
(p.38) Les membres de l’Académie bretonne n’hésitent pas à reprocher au clergé son absence de conviction, voire sa complicité, ouverte ou passive, à la politique linguistique de l’État à l’école. J.-M. Perrot ne s’embarrasse pas, comme à son habitude, de précautions oratoires et juge sévèrement les « prétentions » des parents et des instituteurs, même parmi les chrétiens, […] qui croient de leur devoir d’empêcher les enfants de parler le breton. Les prêtres eux-mêmes ne font rien pour extirper ces croyances. Il faut, disent-ils, suivre la mode et quand on leur parle de soutenir la langue bretonne, ou les confréries qui ont été fondées pour la défendre, beaucoup secouent la tête en disant : « ce n’est pas à nous de nous mêler de ces histoires-là ! » Le dimanche suivant, on les entendra faire leur sermon appris rapidement dans un livre français quelconque, et ils s’imagineront avoir fait leur devoir 32 ! Le président de la Kenvreuriez constate que « l’attitude du clergé en général a été l’indifférence, quand elle n’a pas été l’hostilité, chose étrange mais réelle », dont la cause doit être attribuée, selon lui, à l’ignorance ou au fatalisme, même s’il reconnaît qu’il a joué un « beau rôle » dans la renaissance littéraire au XIXe siècle : « indifférence pour la langue qu’il laissait corrompre par le mauvais goût des formes étrangères », pour la littérature, « méconnue trop souvent », pour les mélodies qu’il a « négligées et souvent maladroitement remplacées », pour les coutumes sur lesquelles il n’a pas veillé et qui ont disparu33.
31. Ibid., p. 76. « Nous sommes toujours Bretons. Bretons gens résistants », Brizeux. 32. Ibid., p. 44, discours d’ouverture, 24 octobre 1901. 33. Ibid., p. 69-76. Discours lors du huitième anniversaire de l’Académie bretonne, 20 février 1902 et AEQ2H312, séance du 18 novembre 1902.
(p.52) Polarisation avec un mouvement wallon anticlérical
À partir de 1884 se forma un « mouvement wallon » s’opposant au mouvement flamand et aux concessions que les gouvernements catholiques lui faisaient. Les premières « ligues wallonnes » furent créées à Anvers, Bruxelles et ses environs, et Gand ; à partir de 1888 d’autres suivirent en Wallonie. Il s’agissait de la défense du droit des Wallons à la francité de toute la Belgique6. Il était d’ailleurs inévitable que, alors que la Flandre se donnait de plus en plus une identité distincte, les Belges francophones s’interrogeassent sur leur identité. À l’encontre de « la Flandre catholique », ils se formaient l’image de la Wallonie libérale, progressiste et libre-penseuse. Jusqu’en 1900, cette antithèse était renforcée par le système électoral majoritaire. Le mouvement flamand apportait au parti catholique le supplément de votes qui lui donnait à partir de 1884 la majorité, et doncto«* les sièges, même dans les arrondissements traditionnellement libéraux des grandes villes d’Anvers, Gand et Bruxelles. Par contre, dans les arrondissements industriels de Liège et du Hainaut, c’était le parti libéral qui gagnait tous les sièges. De 1884 jusqu’à 1919 « la Wallonie libérale devait subir la domination cléricale flamande ». Pourtant, à partir de 1900 les sièges parlementaires furent répartis proportionnellement, de sorte qu’une minorité de parlementaires libéraux et de socialistes était élue en Flandre, tout comme une minorité de catholiques en Wallonie. La résistance libérale wallingante avait pour effet de renforcer encore l’union entre le flamingantisme et le catholicisme, tant politique que religieux. Mais elle freinait les gouvernements catholiques dans leur disposition à faire des concessions aux flamingants, en élargissant l’emploi du néerlandais par des mesures administratives et législatives. Déjà en 1894, lors de l’introduction du suffrage universel, des flamingants impatients avaient créé un parti démocrate-chrétien dissident. Au début, le parti socialiste avait repoussé aussi bien le mouvement wallon « bourgeois » que le mouvement flamand « clérical », tout en proclamant « l’égalité des langues » et en votant avec les catholiques certaines lois garantissant l’emploi de la langue du peuple. Après 1900 les idées flamingantes pénétrèrent enfin un peu dans les rangs socialistes, mais surtout les idées wallingantes. L’échec en 1912 d’un cartel électoral des gauches pour en finir avec « la domination cléricale flamande » qui durait depuis déjà vingt-huit ans, causa une radicalisation du wallingantisme, et sa percée définitive dans le parti socialiste.
6. Voici la formulation dans un manifeste de la Ligue Wallonne de Saint-Gilles (lez Bruxelles) en 1886 : « II est aisé, en attendant que l’instruction primaire obligatoire généralise la connaissance du français, de donner satisfaction aux Flamands qui l’ignorent, en envoyant dans leur contrée des fonctionnaires flamands. Mais, dût cette minorité continuer à pâtir de son ignorance, faut-il pour cela tyranniser les Wallons et tous les Flamands instruits avec cette moedertaal ridicule et qui ne remédie à rien, l’introduire de force au Parlement, dans les lois, dans l’enseignement, à l’armée, dans toutes les fonctions publiques, et donner ainsi le désavantage à la race wallonne, qui est la plus intelligente et la plus éclairée des deux ? »
|
|
1800s |
Marianne Oertl, Der gnädige Schlaf – Narkose, P.M., 10/2002, S.102-108
Keine Erfindung hat unsere Lebensqualität so verbessert wie die Narkose.
(S. 107) Die Kirche verdammte die Narkose bei Geburten. Frauen sollten unter Schmerzen gebären – wie es die Bibel befiehlt. Sir James Young Simpson (1811-1870), Leibarzt der englischen Königin, führte die Chloroformnarkose bei Geburten ein. Nach erbittertem Kampf konnte er sich schliesslich gegen den Widerstand der Kirche durchsetzen.
|
|
1800s |
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.469) Au sommet de la pyramide, les pontifes se vivent comme des martyrs assiégés par l’impiété. Presque tous ceux du XIXe sont réactionnaires, étroits, bornés. L’un d’entre eux, Pie IX, a donné l’exemple le plus révélateur de la tournure d’esprit de ses pairs avec un petit texte qui accompagne sa grande encyclique Quanta Cura de 1864 : le Syllabus. Le mot, à l’origine, signifie sommaire, ou catalogue. Celui-là, en effet, se contente d’énumérer de nombreuses propositions qui ne frappent guère quand on les lit : « il faut défendre la liberté de conscience » ; « la raison humaine est suffisante pour assurer le bien des hommes » ; « l’Eglise n’a pas le monopole de la vérité » ; « le pouvoir civil doit être supérieur au pouvoir religieux », etc. La stupéfaction arrive dans un deuxième temps, quand on comprend le sens de cette liste : le Syllabus fait la liste des « erreurs de notre temps », c’est-à-dire de tout ce qu’il est formellement interdit d’accepter ou de défendre quand on est catholique. En gros, toutes les idées qui forment aujourd’hui la base de la pensée commune à tous les démocrates sont rejetées alors comme filles de Satan. Le pape Jean-Paul II, à la fin du XXe siècle, passait dans les médias pour être le « pape des droits de l’homme ». Tous les défenseurs des libertés humaines ne pouvaient que se réjouir de trouver à leurs côtés un allié d’un tel poids. Il ne leur est pas interdit de se souvenir que, cent ans plus tôt, la juxtaposition même des termes « pape » et « droits de l’homme » aurait valu l’excommunication à qui l’aurait risquée. Les hommes n’ont pas de droits, disait le catholicisme du 7 XIXe siècle, ils ont des devoirs envers Dieu. Parmi les catholiques, certains refusent cette voie qui leur semble sans issue. Durant la première moitié du XIXe siècle, le plus grand nom parmi ces rebelles est celui de Félicité de Lamennais. Dans sa jeunesse, il a été un prêtre ultramontain, c’est-à-dire un défenseur inconditionnel du pouvoir des papes – ceux qui règnent à Rome et sont donc, vus de France, au-delà des monts. Puis il évolue, et (p.470) cherche en permanence à concilier sa foi avec les idées nouvelles. Obsédé par la question ouvrière, il ira jusqu’au socialisme. Dès 1830, il fonde L’Avenir, un journal qui a pour devise « Dieu et liberté », et cherche à défendre la liberté de la presse et la liberté de conscience tout en restant catholique. Il sera impitoyablement condamné par Rome. » Cinquante ans plus tard, au début du XXe siècle, un théologien cherche lui aussi à faire évoluer son domaine de pensée. Il s’appelle Alfred Loisy (1857-1940). Il suggère que l’on peut faire de la Bible une lecture critique, qui tienne compte du contexte, de l’histoire. Une telle impudence déclenche les foudres vaticanes. Loisy est excommunié et déclaré « vitandus » (littéralement « à éviter »), c’est-à-dire qu’il est interdit expressément à tous les catholiques de lui parler. Les séminaires sont placés sous un contrôle très strict et les prêtres sous surveillance absolue, pour être bien sûr que le « modernisme », comme on appelle les thèses de Loisy, soit écrasé dans l’œuf. Léon XIII, pape de 1878 à 1903, est le seul de l’époque que l’on peut considérer comme ouvert. Il publie Rerum Novarum. Cette grande encyclique sur le monde ouvrier est toujours le texte de référence du « catholicisme social », c’est-à-dire de la tendance de cette religion qui promeut un système économique plus humain, plus conforme aux espérances de l’Évangile. Léon est aussi celui qui pousse dans le sens du « ralliement », c’est-à-dire l’acceptation de la République par les catholiques. Son successeur, le terrible Pie X, renoue avec la tradition la plus réactionnaire. La Séparation a lieu à l’époque de son pontificat. Il condamne immédiatement et sans appel cette décision « funeste » par une encyclique enragée. Une société « ne peut prospérer ni durer longtemps lorsqu’on n’y fait point sa place à la religion… ». La démocratie ? La liberté individuelle ? Allons ! La multitude « n’a d’autre devoir que de se laisser conduire et, troupeau docile, suivre ses pasteurs ». Il faudra attendre le concile de Vatican II, dans les années 1960, pour que l’Église fasse son aggiornamento, sa « mise à jour », et qu’elle ; accepte les principes qui sont les nôtres. Elle y aura mis le temps.
|
|
1830-1884 |
Marie-Thérèse Pipeaux, Anloy, un siècle d’histoire 1900-2000, éd. Weyrich, 2004
(p.98) Commentaires de Paul Hermand sur « la loi de malheur »
Le tournant le plus tragique de la vie de mon grand-père fut sans conteste sa démission de sa fonction d’instituteur à Libin lors de la mise en vigueur de la fameuse loi scolaire appelée à l’époque par les catholiques la «Loi de Malheur». Mon grand-père ne put accepter cette loi qui créait une situation inacceptable pour sa conscience ; il demanda sa mise en disponibilité et sa retraite, et l’obtint en 1882 à l’âge de 49 ans. Dans notre enfance, nous étions fiers de notre grand-père parce qu’il était resté fidèle à ce que lui dictait sa conscience. Encore ne savions-nous pas très bien ce qui s’était passé ni comment la situation avait évolué et c’est pourquoi j’ai fait quelques recherches pour mieux comprendre le problème aujourd’hui ; voici le résultat de ces recherches. Tout partit du programme du parti libéral, fort anticlérical à l’époque, arrivé au pouvoir en 1879 ; en résumé : « L’enseignement donné aux frais de l’État doit être placé sous la direction et sous la surveillance exclusive de l’autorité civile ». Ce programme de laïcisation totale de l’enseignement allait à rencontre des idées de l’Église catholique qui, il faut le dire, avait pris, depuis 1830, une part importante dans l’organisation scolaire. Immédiatement, l’épiscopat belge réagit de façon extrêmement violente. Des lettres épiscopales virulentes furent envoyées et diffusées dans les paroisses. La lecture de la prière suivante fut prescrite chaque dimanche aux messes paroissiales : «Des écoles sans Dieu et des maîtres sans foi, préservez-nous Seigneur.» En 1879, les Évêques donnèrent des instructions pratiques aux confesseurs : il fallait refuser l’absolution (p.99) aux parents qui confiaient leurs enfants aux écoles de l’État, aux élèves, parents d’élèves et professeurs des écoles normales de l’État et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, aux enseignants qui continueraient à exercer leurs fonctions dans des écoles de l’État, sauf pour certains motifs et sous certaines conditions, bien restrictives d’ailleurs. En 1880, il fut précisé que la communion devait être refusée, même publiquement, à ces instituteurs. Le Gouvernement tenta bien de donner des garanties quant à la neutralité de l’enseignement et quant à l’enseignement religieux fourni par les écoles publiques. Rien n’y fit. On comprend la situation sensible dans laquelle se trouva mon grand-père durant ces années-là, dans ce village de Libin presque entièrement catholique qui suivait à la lettre les directives de la hiérarchie ; il fut manifestement la victime de la pression irrésistible de son milieu : il abandonna sa fonction ayant encore à ce moment-là à sa charge cinq enfants de moins de vingt ans. Et pourtant, dans l’ensemble du pays, les positions excessives de l’épiscopat furent plutôt mal reçues par l’opinion publique ; les parlementaires catholiques essayèrent de réagir tant en s’adressant aux évêques qu ‘en se tournant vers Rome ; leur position, de même que celle du Pape, d’ailleurs, étaient beaucoup plus modérées que celle des évêques. Mais le pouvoir de l’épiscopat était tel à l’époque que rien n’y fit : leur pression fut même si forte que les relations diplomatiques furent rompues en 1880 entre Rome et la Belgique. Ces positions extrêmes ne furent pas bénéfiques au parti catholique et provoquèrent son échec aux élections de 1880 et 1882 ; on constata même à ce moment une nette chute de la pratique religieuse. Par contre, du point de vue de l’épiscopat, on assista à un effort de générosité exceptionnel de tous les catholiques, en particulier des propriétaires fonciers appartenant à la noblesse, en vue de créer partout en Belgique des écoles libres. C’est de ce moment que provient ce puissant réseau d’écoles libres qui s’établit (p.100) aussi grâce à l’impulsion extraordinairement énergique et courageuse d’un clergé galvanisé par son épiscopat. Mais finalement, ce ne fut pas de l’opposition à ce que les catholiques avaient appelé «la loi de malheur» que vint l’échec ultérieur du parti libéral mais bien de l’habileté manoeuvriers du parti catholique qui amena les libéraux à donner l’impression de vouloir tout centraliser au niveau de l’Etat, au détriment de l’autonomie communale et provinciale si chère au cœur des Belges. Comment se créa cette impression ? À l’origine, il y eut la résistance des administrations communales catholiques, voire de certaines provinces qui mirent tout en oeuvre pour gêner l’évolution de l’école publique en refusant de voter les budgets adéquats relatifs aux écoles, aux enseignants, à tout ce qui touchait aux activités scolaires ou parascolaires ; un désordre administratif inextricable s’installa même parfois. Il en résulta des interventions répétées et de plus en plus résolues du Gouvernement libéral à l’égard des communes et des provinces contestataires : cela renforça, dans l’opinion publique, l’impression d’un glissement vers une centralisation à outrance qui suscita un mécontentement général. C’est ainsi que le parti catholique gagna les élections de 1884, ce qui mit une fin rapide à la «Loi de Malheur». |
|
1850-1900 |
Pierre Milza, Musolini, Libr. Arthème Fayard 1999
(p.48) Le monopole de la culture par les classes dirigeantes se double d’une semblable mainmise sur les affaires politiques. Jusqu’en 1882 ne pouvaient voter que les Italiens adultes payant un impôt direct d’au moins 40 lires ou pourvus de certains diplômes, ce qui réduisait à 2 % de la population totale le nombre des électeurs potentiels. Situation qui se trouvait encore aggravée par l’interdiction faite aux catholiques de participer à la vie politique du pays. À la suite de l’occupation de Rome par les Piémontais et de l’installation du nouveau pouvoir dans l’ancienne capitale de ses États, Pie IX avait en effet donné aux catholiques italiens la consigne formelle (dite du non expedit) de ne participer en aucune façon aux consultations électorales, soit à titre de candidat, soit même à titre d’électeur. Cette décision eut pour effet de restreindre encore le nombre des votants, ramené à 150 000 personnes environ sur une population de 30 millions d’habitants.
|
|
1875- |
in : GSHA, 6, 1977, p.5-15
Notes techniques relatives à la fabrication des ardoises dans la région salmienne.
Après 1875 encore, il n’était pas rare de voir des enfants âgés de (p.15) sept ans entrer en service, surtout les fillettes que l’on « place » dans les fermes. Leur travail : aller chercher l’eau potable à la fontaine publique, surveiller des enfants à peine moins âgés qu’elles et déjà parfois conscients d’être les enfants du « maître », surveiller le bétail à un moment où les enclosures sont encore très rares 7. Leur salaire annuel : le gîte et le couvert, une robe et une paire de souliers. S’il ne gagnait pas d’argent à proprement parler, du moins l’enfant assurait-il son entretien. Il n’était pas question de poursuivre des études : on n’allait à l’école qu’en hiver. Et cependant, c’était déjà un progrès car les parents pouvaient être illettrés. Et de l’avis général, il importait seulement que les filles soient à même de « suivre la messe dans leur missel ». C’est seulement après la seconde guerre mondiale que la situation s’améliorera : à une hausse des salaires correspondra une régression de l’alcoolisme tandis que l’obligation de la scolarité pourra enfin faire pièce à l’analphabétisme « . Les enfants fréquentent l’école primaire jusqu’à quatorze ans. En effet, il faudrait se rendre à Stavelot pour suivre les études du cycle secondaire et rares sont les familles qui peuvent faire face à une telle dépense. Les enfants resteront donc en primaire jusqu’à ce qu’ils soient libres de leur obligation scolaire, ensuite ils iront travailler : aux garçons les carrières, aux filles le « service ». Durant huit années cependant, ils se seront familiarisés aux arcanes de la grammaire et de l’arithmétique. Ils auront aussi, quels que soient leurs résultats, doublé deux années. C’est seulement à partir de 1930 que des enfants quitteront régulièrement l’école primaire de Bêche pour l’Ecole Moyenne de Stavelot.
Guy MAILLARD.
Avant 1920. La loi scolaire, votée en 1914, instaurait le régime de l’instruction obligatoire et gratuite de 6 à 14 ans mais elle ne fut mise en application, du fait de la guerre, qu’en 1919.
|
|
1890- |
in : MA, 2, 1982, p.42
Les relevailles
La cérémonie des relevailles s’appelle èl ralâdje, retour, à la messe, èl ralâdje à l’église. Elle a toujours lieu après le baptême, soit le lendemain, soit la semaine suivante. Jusqu’alors, èl mére èn’ pût nîn vûdî, èlefét seûlemint s’n-ouvrâdje dins s’ méson. Pour la cérémonie, èle met ses pus bêles lokes, vêtements, ses lokes de dîmince. Tenant son bébé dans les bras, elle va s’agenouiller devant l’autel de la Sainte Vierge et le baise. Pendant que le prêtre r’bènit l’mére et l’èfant, elle tient en main ène candêye bénite. Selon son désir et ses moyens, elle dépose une offrande. Cette première sortie de la mère et de l’enfant est suivie, à quelques jours d’intervalle, d’ène voye, pèlerinage, à lès sangn’ que l’feme avoût promis d’chèrvi, servir, honorer, pou que s’n-acouch’mint dalisse bîn.
Anne-Marie Fossoul-Risselin (1)
Une vieille personne nous a renseignés sur la façon dont se déroulait chez nous le scénario de cette coutume, vers le milieu du siècle dernier. En ce temps là, la cérémonie avait déjà perdu beaucoup de son cachet. L’accoucheuse allait chercher la mère et l’enfant avec le cierge bénit de Chandeleur allumé. Sur le chemin de l’église, la mère ne pouvait pas se retourner et le groupe entrait directement à l’église. La mère ne pouvait pas travailler avant d’avoir accompli ses relevailles. La vieille dame nous a d’ailleurs déclaré : « On moustroût du doût èl ciène qu’ âroût ieû travayî avant d’ daler à l’ églîse ». Aujourd’hui encore, beaucoup de femmes croyantes réservent à l’église leur première sortie, très souvent avec leur enfant qu’elles font parfois bénir par le prêtre. Elles se rendent de préférence dans une église où il y a un saint protecteur des maladies enfantines
Maurice DENUIT (2)
J’ajoute à ces lignes que pendant la cérémonie des relevailles, le prêtre pose l’étole sur la tête ou l’épaule de la jeune maman et récite le début de l’Evangile de saint Jean. Pendant ce temps, la maman tient en main un cierge bénit le jour de la Chandeleur, tchandêye du Tchand’lé. A Godarville (3), la mère doit recevoir l’eau bénite, yau d’font, de la main de la sage femme, elle ne peut la prendre elle-même dans le bénitier (bènwatî). Les relevailles sont pratiquement tombées en désuétude dans les années 70. Cette cérémonie rappelle la visite de la Sainte Famille au temple de Jérusalem et la purification de la Sainte Vierge.
Robert DASCOTTE
(1) Le vocabulaire de la vie familiale à Saint-Vaast (1890-1914), Liège, 1969, p. 35. Cs lignes sont valables pour tout le Centre. (2) « El Mouchon d’Aunia », février 1965, p. 33. (3) A. Harou, Le folklore de Godarville, Anvers, 1893, p. 78.
|
|
1890-1914 |
Anne-Marie FOSSOUL-RISSELIN, in : MA, 3, 1982, p.60-61
Le baptême à Saint-Vaast
C’est généralement une quinzaine de jours après la naissance qu’a lieu l’batème, quand l’mouman set se l’ver (peut se lever) ; c’ èst toujoûrs in dîmince (dimanche) après mèsse ou après vièpes (vêpres) qu’ on batîje l’ èfant, pace queu l’ pârin èyèt l’ mârène travayetin aute temps. Le cortège se rend à l’église ; la sage-femme, en tête, porte l’èfant à batème. Derrière elle, viennent èl pére, èl pârin, èl mârène, et souvent èl pârin ou l’ mârène à l’ candêye (chandelle), garçon ou fillette de la famille qui a le privilège de tenir le cierge pendant la cérémonie. La mère ne fait pas partie du cortège, non tant à cause de son état de santé, mais surtout parce qu’avant les relevailles elle est impure.
Ces lignes sont tirées de « Le vocabulaire de la vie familiale à Saint-Vaast » (1890-1914), Liège, 1969, pp. 32-35. A noter que ce texte est aussi valable pour toute la région du Centre.
|
|
1894 |
in: Groupe Qualité Village, Orgeo, 1980
Le 1er juillet 1969, le journal «L’Avenir du Luxembourg» fêtait son 75ème anniversaire. A cette occasion, il reproduisait plusieurs articles de l’époque (1894). En voici un: « On danse à la fête…si Mr le curé le permet ». La salle de danse se trouve dans une petite chambre sans plafond, aux poutres noires de fumées. Les paysannes aux formes massives ont chaussé leurs lourds sabots et mis leur tablier noir. Les jeunes gens crient, fument, ôtent leur blouse s’ils ont trop chaud et dansent bravement, la poitrine découverte.
|
|
1895 |
in: Singuliers, 1, 2011
La dicâce (2e partie) (gaumais)
An n’ î rwâte mi d’ si près : ène, deûs’, trwèch, an n’ èst me prèssé « Pou achève, c’ èst la dèrnière, Fifine ; bayez-me ène lârmète d’ amêr dudins ‘ne goûte du fine ». V’làa é bon ptit coumincemint ! Pourvu qu’ la feume n’ î vwèyiche rin. Èle dèroût : peûsqu’ t’ ès bu coume é vatchî, va-st-a soupe su 1′ aran du Midjot ! Dudins l’ timps, on-z-oyout co lès-ambârdes ; mas tout ça èst bin tchandji. Dupeûs qu’ à la mâjân, lès feumes sont mates, vaut mieus lay coûtchi sins moufeti. Lu djèmindje au matin, lès vies lalant à la basse mèsse,
lès djônes fîyes lalant à la grand-mèsse pou-z-î fâre vwèr leû gneu gadin. Mossieû 1′ keurè n’ prétchrè me lontimps : « Chers frères, c’est aujourd’hui la fête ! Vous n’irez pas danser, j’espère bien ! Autrement, je vous donnerais la planchette » ! An peut dère qu’ il a fat, dès-ambaras, du promète la plintchète pou ça ! Dansi ! Siyè, tâjez, dj’ î vèrâns ! èt dj’ arâns 1′ absolucion… A Èrlon. (…)
Jules et Arsène ANTOINE (Habay-la-Neuve) Texte écrit en 1895
Malêjis mots
âk= quelque chose. / lès-ambârdes (toujours au pluriel) = sérénades, aubades jouées le jour précédant la fête du village. / aran = cage, écurie à cochon ; ici expression proverbiale, usitée en pareil cas. / bayi = donner. / brandvin = eau-de-vie. / cowèt = petite casserole en fonte munie de trois pieds et d’un manche, comme un poêlon. / clisse = clifoire, seringuette d’enfant faite avec du sureau. / Èrlon = Arlon. / èrprinre = imiter, singer. / fradji = frapper avec force. / gadin = jupon. / quinzêne = soûlerie qui dure quinze jours. / Mombak – nom propre Maubacq. / mujé = museau. I plintchète = petite planche, dans l’usage courant : se voir refuser la communion à l’église. / plintchètes (lès) = jeu de roulette où l’on gagne des ustensiles en porcelaine, et où les planchettes portent des numéros comme au jeu de lotto. / pouché = pourceau. / pôrdjière = fosse à fumier. / siyè = si. / Swèl = nom propre du propriétaire du carrousel. / tâjez = bien sûr. / ûy = œil. / tchikèt = petit verre à alcool. / vèrans (dju) = irons (nous), 3e personne du pluriel de l’indicatif futur simple. / zous = eux.
|
|
1900-1950s |
Joël Derenne, in: Manhay, Histoire de nos villages, 1999
(p.10) Vaux-Chavanne
Nous voici au centre du village où furent érigés au siècle dernier quatre bâtiments publics: l’église (403,5 mètres d’altitude au seuil ) en 1865, le presbytère en 1840,l’école en 1874 et la maison communale. Pratiquement tous les villages de notre commune connurent cette évolution, ce qui laisse deviner une dépense énorme pour l’Etat. Quels bouleversements pour nos aïeux avec l’apparition des écoles! Il faut savoir que la plupart d’entre eux, en ce début de siècle, ne parlaient que le wallon. Les enseignants durent l’interdire même dans les cours de récréation. Sur la prise de vue du dessus, éditée par Job-Lepouce en 1911, nous apercevons l’école, cachée partiellement par l’église. Elle accueillit ses derniers bambins en 1974. Elle fut fermée pour cause de vétusté. A l’époque, les deux personnes les plus instruites de nos villages étaient l’instituteur et le curé. Ils profitaient parfois de leur savoir et de leur fonction pour asseoir leur autorité sur les villageois. Surtout, paraît-il, dans le chef des ecclésiastiques. Il était par exemple interdit de travailler le dimanche, même au temps de la fenaison et de la moisson. Si par malheur, la récolte prête à être engrangée était menacée par la pluie, il fallait l’autorisation du prêtre pour effectuer cette tâche. L’abbé Choffray laisse un souvenir mémorable aux personnes de Vaux-Chavanne qui l’ont connu. Nombreuses sont les anecdotes qui m’ont été contées. Lors du décès d’un ou d’une célibataire, la tradition était que les jeunes gens se cotisent pour une messe pour le (la) défunt(e). Un jour Elizabeth Bréda ne put réunir la somme exorbitante demandée par le curé. Elle déposa néanmoins sa récolte sur le banc de communion estimant que cela était amplement suffisant. Le prêtre, en furie, prit l’argent et alla le jeter dans le petit ruisseau coulant devant l’église. Il refusa de dire la messe. Les paroissiens se souviennent également de ses homélies qui sortaient de temps à autre du cadre religieux. Aujourd’hui, avec le recul, ils en parlent de façon humoristique. Du côté de l’enseignement, les Vaux-Chavannais ne furent guère plus privilégiés avec l’arrivée au début des années 20 d’Armand Jame. D’une sévérité excessive, il brutalisait ses élèves, courait parfois sur les bancs pour en attraper un ! Il lança un jour Lucien Voz au-dessus de la buse du poêle ! Souleva un autre jour Willy Cornet par une joue pour le conduire au tableau ! Son entente avec son voisin religieux laissait à désirer. L’abbé Choffray venait tous les jours à midi chercher les élèves pour leur enseigner le catéchisme. Quand l’instituteur le voyait sortir du presbytère, il renvoyait les écoliers qui, après une prière très brève, filaient sans demander leur reste! Le prêtre essayait néanmoins d’en récupérer quelques uns! Les jeunes de l’époque disent malgré cela qu’il était très bon instituteur. (Manhay) (p.99) (Grand Menil) (…) l’imposante tour de l’église. Baptisée Saint Maurice et ses compagnons, elle fut construite en 1889 à une altitude de 435,34 mètres pour la somme de 43.783 francs, alors que l’ancienne, située dans l’ancien cimetière, était toujours debout. A côté, les anciens se rappellent encore du presbytère (restauré en 1880) qui brûla en 1944. Il aurait dû être reconstruit grâce aux dommages de guerre, mais malgré quatre projets dont le dernier coûta plus de quatre cent mille francs, il n’en n’est rien. A ce jour, un parking a pris sa place. Le vicaire Bosquée d’Oster ayant pris du galon succéda à l’abbé Rolin rentré affaibli des camps de prisonniers allemands en 14-18. Certains se souviennent encore de ses vigoureux prêches qu’il disait du haut de sa chaire de vérité contre les premiers bals donnés lors de la Pentecôte à Manhay. Il allait pratiquement jusqu’à excommunier les organisateurs. On installa une guinguette pour la fête de 1938. La colère que montra notre ecclésiastique dans son sermon fut telle que seules deux personnes osèrent se risquer au bal ! L’abbé Louis sera le dernier habitant du presbytère. En 1945, le père Hokay, attaché à la paroisse, s’installa dans celui de La Fosse, Toujours en soutane, il se déplaçait uniquement à vélo. En venant à Grand-Menil, il traversait, paraît-il, la grand route sans freiner ni regarder, faisant confiance à la providence. Outre la bonne parole, et suivant la tradition de son illustre prédécesseur, il prêcha de toutes ses forces contre un bal organisé à Noël, le qualifiant de « bal du diable ». Joignant le geste à la parole, il inscrivit sur le baraquement destiné aux festivités « la salle du diable ». L’abbé trouva la mort en traversant la nationale à Dinez en 1983, renversé par un bus. L’abbé Georges le remplace depuis ce jour.
|
|
1900-1950s |
Marie-Thérèse Pipeaux, Anloy, un siècle d’histoire 1900-2000, éd. Weyrich, 2004
(p.82) La mission
Tous les dix ou quinze ans, la paroisse se lançait aussi dans une mission dont le but était de réchauffer la foi des moins croyants et de ramener à l’église l’un ou l’autre mécréant. Préparée de longue date, la mission durait trois ou quatre jours pendant lesquels des offices religieux étaient célébrés matin et soir, voire l’après-midi ; un prédicateur réputé et spécialisé, appartenant à un ordre religieux, y prenait la parole ; les rédempto-ristes, avec leur grand crucifix à la ceinture, étaient connus pour leurs sermons dramatiques sur le péché, la mort, l’enfer. Tout le village ou presque participait à la mission. |
|
1900s |
in: Léon Poliakov, Le mythe aryen, éd. Calmann-Lévy, 1971
(p.321-322) LA MYSTIQUE ARYENNE (…) L’exégèse théologique s’ingéniait à solliciter à cet effet la Bible, et plus spécialement la malédiction de Cham; du reste, à l’apogée de l’européocentrisme racial, c’est-à-dire dans la seconde moitié du XIXe siècle, le concile du Vatican lui aussi refusait de lever cet anathème, et le cardinal Lavigerie, l’apôtre de l’anti-esclavagisme, pensait que seule la conversion de la race noire lui permettrait d’y échapper. Il reste que le sectarisme protestant permettait de s’engager infiniment plus loin dans les théologies de ce genre.
|
|
1900s |
in: Louis Piron, Facteûrs, jendârmes èt Cîe …, 1978
(Bièrtcheû / Bercheux)
À l’ Laîterîe à Bièrtcheû, gn-avét on cabarèt Qu’ avét on fwart bê nom; ç’ astét « La Tempérance ». Ç’ n’ èst nîn là qu’ on-z-alét quand on v’lét fère bombance. Èl curé avét dit: « L’alcool est interdit; De la bière légère, un petit vin clairet, Limonade et cigares : voilà votre cabaret. Et qu’à onze heures du soir, se termine la fête Quand la cloche sonnera l’heure de la retraite! »
|
|
1920-1930s |
in : Les Amis de Logbiermé, 15, 1993-1994, p.78
RAPWETROULES
Je continue ci-dessous la publication des diverses notes récoltées lors d’interviews en vue de conserver la mémoire des faits qui se sont passés dans le temps. Ci-dessous poursuite de l’interview de Léonie ARROZ de Petit -Thier.
(…) Le chapelet était récité dans de nombreuses familles, à haute voix et à genoux. L’arrivée de quelqu’un ne mettait pas un terme à la prière. Le nouveau venu s’agenouillait et achevait la récitation avec les autres. Il arrivait aussi que certains, entendant la prière, attendaient la fin sur le seuil de la porte. C’était la mode pratiquement partout dès la fin du souper, avec interruption quelquefois pendant la période estivale. Certaines vieilles personnes se retiraient dans leur chambre pour réciter déjà une prière après le déjeuner. C’était le cas du père de Rosalie FOURGON. Le chapelet était suivi de la récitation des litanies, d’autres prières et des actes de foi, d’espérance, de charité et de contrition. Chez Fourgon, les litanies étaient dites en latin et Léonie ARROZ les avait apprises de les avoir entendues en allant à la soirée. Le père DONDRI ne partait jamais dans le bois le matin, sans se mettre à genoux et dire ses prières, et cela aussi tard qu’il fut. La foi des gens à l’époque était très profonde. Dans la région, les gens se levaient tôt, mais modérément, les besognes du matin n’étant pas tellement importantes. La messe était célébrée, elle, fort tôt ; à sept heures du matin. Les écoliers étaient tenus d’y aller avant de se rendre à l’école, et cela tous les jours, et même pour les enfants des villages éloignés. Comme on ne pouvait manger avant d’aller à la communion, les enfants allaient déjeuner dans une famille près de l’église avant d’aller à l’école. La famille accueillante offrait le café. La fréquentation à la communion déterminait la place pour faire ses « Pâques » (communion solennelle). Cela variait toutefois d’après le curé. Alphonse ESSER racontait à ce sujet : « Moi, j’étais le plus « lourd », mais je fus le premier parce que mon prénom commençait par un A : Alphonse. L’ordre alphabétique avait donc été retenu.
|
|
1920-1930s |
Léa Nivarlet, in: GSHA, 19, 1983, p.36-42
Souvenirs de la vie quotidienne à Gouvy et Rettigny dans la première moitié du XXe siècle1. Les mois d’hiver du bon vieux temps à Gouvy
(p.41) Il y avait des filles pour aller travailler aux champs. Pour partir, elles mettaient des beaux souliers, dans le champs, elles mettaient des galoches. Il ne fallait pas aller chez Emile pour avoir un service ou un outil : réponse : « Chez nous, on ne prête rien ». Il ne fallait pas aller demander la permission chez Monsieur le Curé Bastin pour travailler le dimanche. Réponse : « C’est le jour du Seigneur ». |
|
1920-30s |
in: Gaziaux, Parler wallon et vie rurale au pays de Jodoigne, 1987
(p.258) Lorsque les intempéries retardaient le bon déroulement de la moisson, les paroissiens scrupuleux allaient demander au curé l’autorisation de travailler le dimanche (4) . « Nos-ôtes, on-n-a tchèri ‘charrié’ on côp on dimègne dë l’ aous’ èt maman l’ ot sti d’mander à l’ këré. On-n-a sti acôrdé ‘on a reçu l’accord’. N-a dès kërés qu’ savin’ bén cë qu’ c’ èst dè l’ këltëre èt tot ça, mins n-a dès cës qu’ vos n’ariz sàyë l’zi rén fé comprinde ! One ôte anêye, ‘l avot plou ‘plu’, plou, plou ! Insë, l’ djou dè l’ quénze d’ aous’, après l’ porcèssion, n’ avin’ sëti soyi ‘faucher’ saquants dijas d’ avin.ne. Èt n’ avin’ ni yë l’ timps d’ aler rèpèter po l’ porcèssion. » Dans son sermon, le curé avait critiqué ces paroissiens (sans les nommer). « I nos-a prétchi, il a dët së l’ tchiyêre dë vèrëté’ (…) en chaire , cë qu’ ë pinséve. »
|
|
1920s |
Georges Maurice, El fi do chayeteû, Le fils de l’ardoisier, Musée de la Parole en Ardenne, 2006
(p.43) Pus târd, âs soûdârds, à l’ ûjine èt partout adû qu’ on d’vét r’çûre dès gros bonèts, on trukét l’ bazâr.
(p.47) Dins lès-anées 20, la rlijion avét, dins nous viadjes, brâmint pus d’importance k’ anut’. Çu tins la, cand 1′ djâle et lès fiâmes de 1′ anfêr astint, djoûr et nut’, dins 1′ esprit dès djins, è fwart markè nosse Justin. I mrè wârdu on tas d’ souvnîrs. I n’ è jamês rouviè ces messes basses dès djoûrs de vraie, cand i dvét dmeuru a gnos, adjalè sur lès grés an mârbe à pîd d’ 1′ âtè, surtout a 1′ îvièr. Gn-avét pont d’ cantike, pont d’ muzike, on n’ atindét min.me câzi nin lès priyères do keurè et lès rèspons do sièrveû. Justin cnuchét bin tos ses rèspons. Gn~è rin k’ ok k’ i n’ è jamês savu u bin k’ i n’ è jamês voulu aprinde. C’ è~st-a 1′ ofèrtware, cand 1′ keurè s’ rètoûne et k’ i dit » Orate, fratres « , Justin rèspondèt : » Suscipiat Dominus gn-è… gn-è… gn-è… sanctae ! »
(p.49) Ç’ astét cate coméres ki la / = la statûe do l’ Sinte Vièrje/ pwartint. À dbout dol porcèssion, ç’ astét 1′ keurè ki pwartét èl sint sacreumint à rotant dzos èl dé k’ astét pwartu pa dès-ornes dol Confrérie. Dès deûs costès d’ zols retint lès pwarteûs d’ flambôs, dès ptites lanternes ki s’ balancint à dbout d’ one hampe. Tôt 1′ long dol vouye, on-z-avét planté dès mêy et lès gamines avint samè dès fleurs su 1′ passadje. A totes lès fgnèsses, i gn-avét dès boujîes ki lumint dvant dès-imâdjes do Bon Dieu, dol Vièrje u dès sints. O passadje do sint sacreumint, lès djins s’ agnolint à s’ signant. La porcèssion s’ arètét a totes lès tchapèles do viadje, pus elle a ralét a 1′ èglîje, todi avu dès priyères et dès cantikes. A one cèrtin.ne date de 1′ anée, gn-avét lès rogâcions. Ç’ astét one sorte de porcèssion tote simpe, sins-ôrneumints, mes t’t-â matin. On-z-alét pa lès ptites vouyes dins lès tchamps, à priyant 1′ ciel d’ apwate sa bènèdicsion po-z-avèr dès bêles dinrées. Justin n’ è jamês rouviè k’ après one de ces rogâcions, à rpassant dvant la mâjon d’ one méchante vie famé k’ on lumét la pelée mozète, cand 1′ afant ki pwartét la creû avét passé dvant lèy, aradjée k’ elle astét pask’ il avét djalè assè fwart la nut’ de dvant, elle lî avét criyè ‘• « Lève lu pus hoût, k’ i vèye çu k’ i nos-è foutu dol nut’ !» Tôt 1′ monde avét stî chokè, mes pèrsone ne wazét rin lî dire pask’ on la crwayét on pou sorcière. Lès-afants an.n-avint pour, lès famés retint pus vite cand èles devint passé dvant s’n-uch, mes lès-omes, zols, lî kèrint sovint mizére po la fè mâvrè.
(p.51) C’ astét ossu lu seûl djoûr dè l’ année qu’ on vèyét dès cèrîjes, (…).
(p.53) Dins 1′ èspwar de lès vèy on djoûr tenante et tni 1′ ârmognom’ a 1′ èglîje, lu keurè avet fêt inscrire Justin et ok de ses camarades po sûre dès leçons d’ muzike et d’ tchant grégoryin a Sîbrèt. Cand il è savu k’ Justin alét kitè 1′ viadje po-z-alè al sècole mwayène o Tchèstê, il è intrè dins one radje tèribe, 1′ è prétchè 1′ dîmègne, è djeurè kè Justin n’ ârit pont d’ pièce pus tard. I n’ plét nin dijèrè kè 1′ chayteû voye su fi al sècole mwayène, la scole sins Dieu, corne i djét, alors k’ il ârit tôt’ si bin stî a 1′ Institut Sint-Michèl. Corne èl chayteû astét abonè al gazète La Dernière Heure, c’ è stî lontins la guère avu 1′ keurè. Surtout k’ èl chayteû astét o consey comunâl cand on-z-avét nome one djon.ne institutrice et kè 1′ candidat kè 1′ keurè avet prezante al djèrin.ne minute avet stî bûzè. Pus d’ on coup il è foutu la seûr da Justin a 1′ uch de 1′ èglîje avu one de ses camarades pask’ elle avint stî dansé. Mâgré tôt, il avet sayè d’ distrêre on pou ses parwassyins an montant dès pièces de téyâte dins one rèmîze k’ on-z-avét on pou aranjè. Justin s’ è todi sovnu dès cris d’ oreûr dès djins cand on brûlét lès-ûs da Julyin Fré Djilèt ki tnét 1′ rôle de Michel Strogoff. El keurè ârit bin voulu avèr one sale po s’ petit téyâte, i n’ 1′ è jamês u. A costè d’ ça, lès djins lî rprotchint brâmint dès chôzes. Surtout cand i pwartét lès djèrins sacreumints a dès cultivateurs célibatêres a trin d’ mouru. I tèrorizét lès malèreûs an lès mnaçant dès flâmes de 1′ anfêr si i n’ dènint nin leûs tèrins a 1′ Èglîje ! On savét ossu k’ il avet bin 1′ mwayin et Justin atindét dire k’ il avet kchèrè tote sa fortune pask’ il émet bin la botèye et k’ i le vêt facilmint 1′ keûde.
(p.57) Cand i n’ grimpint nin partout dins la vî mâjon, lès-afants avint bin sûr dès-oûtes djeûs. D’ après lès sêzons, il alint as frézes dins lès bwès, âs-ampon.nes, as meures, as frambâjes, as neûjes et, maleûreûsmint ossu, as nids. I n’ avint pont d’ pitié po lès ptits’ujês.
(p.57) Lès gamines, zoles, djouwint o paradis, al poupée, soutlint al cwade, fint 1′ institutrice, djouwint al baie, u bin elle alignint su 1′ horlê dès vis bwasses de conserve, dès botèyes, dès bokèts d’ assiètes et dès cassons. Eles lumint ça leû boutike. Pa dès coups, elle alint o bî avu lès gamins u bin al vî mâjon. On-z-î djouwét o jandarme et o voleur, o papa et al man.man et sovint, o médcin et o malade. Nin bièsse, èl Justin ! I s’ arandjét todi po k’ su malade seûche one gamine. A 1′ ocâzion d’ ces consultâcions, on s’ livret, pa dès coups, a dès-èksplorâcions nin inoçantes. I falét bin d’ sayè d’ comprinde çu k’ on n’ apèrdét nin a scole ! Mes la pour do péché mortel et dès fiâmes de 1′ enfêr apétchint todi d’ alè trop Ion, surtout k’ i fârit nalè l’ dîre a cfèsse !
(p.59) Gn-avét ossu èl bî ki, do tins d’ Justin, astét plin d’ péchons d’ totes lès sortes. On-z-î trouvét dès çantin.nes dé grèvîs, dès tchacâs, dès lotchètes, dès cawès vièrs et ossu dès treûtes. Avu one baguète, on bokèt d’ fier et one èpingue ployée a deûs, lès gamins arivint a-z-atrapè dès dîjin.nes de grèvîs kè leû mère cûjét dins la grande pèle su 1′ fornê. Justin, èl tins dol grande sètchrèsse de 1921, cand i-gn-avét câzi pus pont d’ êwe o bî, avét atrapè one anwîe de pus d’ cinkante çantimètes. El tins d’ 1′ esté, lès gamins avint tortos on cèke. Ç’ astét Justin k’ avét 1′ pus bê. Nin trop grand ni trop ptit, nin trop pesant non pus, i F fét son.nè an tapant dsus partout dû k’ i courét. I 1′ pèrdét min.me po nalè a scole. Dins lès-anées 20, lès-afants n’ avint rin d’ oûte po djouwè kè ç’ k’ i fint zols min.mes. A prétins, i fint dès chouflas k’ i tayint dins one brantche de pètrê. A d’ oûtes momints, i fabrikint dès tire-baies. I pèrdint one brantche de seûri, a fint sorti la miyoûle po-z-a fè on tuwô! one longue ponte clawée su on mantche sièrvét d’ piston, et 1′ tire-baie astét prêt’. On fét lès baies avu dol tchanve k’ on trouvét dins lès guèrnîs. I falét la mâché et cratchè tote la saloprîe ki vnét fû: ç’ astét vrêmint dèsgostant, mes on-z-arivét a avèr dès bêles baies k’ on wârdét précieûsmint. Deurant 1′ îvièr, partout dû k’ on trouvét dol glèce, lès-afants 1′ afroyint, pus i s’lancint dsus après s’ avèr anondè. Chake anée, conte l’acloûs do chayteû, gn-avét todi one grande fagne adjalée et tos lès-afants î vnint glissé. Su dès ptits trin.nôs k’ i fint zols min.mes, lès gamins su lêchint ossu dchinde al valée dès tiers. El tins dès sîzes, on djouwét al kine, sovint avu lès parints. Ok dès djouweûs tiret on biblot d’ on satchèt et i criyét èl numéro k’ astét markè dsus. Lès cis k’ avint èç’ numéro la sur one dé leûs cwâtes lu markint avu on boton u one pièce d’ on sou. El preumî k’ avét catchè tos lès chifes d’ one de ses cwâtes criyét » kine! « , et il avét gangnè.
(p.61) Mês brâmint dès parints n’ avint nin lès moyins do l’s-achetè.
(p.63) I gn-avét pupont d’ êwe nule pârt.
(p.65) La poûve bièsse wîkelét qu’ on l’ atindét dins tot l’ viadje.
(p.67) la djivondre : le givre
(p.67) On lit tot simpe, qu’ il avét !
(p.73) èl toubakî : marchand de tabac
(p.77) lès courtiadjes : les potagers
(p.83) likète dè d’zos : linge de corps
(p.87) Dèdins ç’ vrê p’tit bazâr portant fwart sètrwat, on trouvét, (…) dès chorseûx, dès lâvètes, (…).
(p.89) A Nive, travayét on m’nûjî qu’ astét ossu tchèrpètî. On l’ lumét Dèdè-Colas-Djâke. ça vlét dîre := Josèf, fis da Nicolas èt p’tit-fis da Djâke.
(p.91) (…) la dint astét à l’ tère èt lès frês dè dentisse sèpârgnès.
(p.91) On grésîmint qui fêt poûr provokét one sèpèsse fumée èt one fwate odeûr qui fét poûfèrgnè èl timp qu’ èl fièr pèrdét sa plèce dins l’ sabot.
poûfèrgnè : tousser
(p.91) mûzée : musée
(p.91) A d’pus do keurè, do mêsse dè scole, dès cultiateûrs èt dès ouvrîs, i gn-avét, dins lès viadjes do l’ Hoûute-Sûre, quékes foncsionêres, emplwayés èt profèssions libèrâles. = outre …
(p.95) A Bastogne, o Tchèstê, a Rmwavèye et a Sîbrèt, giravét dès notêres. I s’ ocupint dès vantes publikes, dès-èritadjes et dès sous spârgnès pa lès cinsîs. On n’ kènuchét nin la banke, po totes lès~ opérâcions d’ sous, on-z-alét addé Mossieu 1′ notêre. Sovint, brâmint trop confiants, lès djins l’zî confyint leû magot !
(p.95) a Cobrêvèye, èl long do Beûlè
(p.96) La preumière bièsse dè chake sètâle astét tuwé, (…). Ç’ avét stî one vrê catastrofe.
(p.99) on poûve djon.ne ome dè Visemba, qui rèvenét d’ avèr sèti vèy sa comére, (…)
(p.99) Si l’gros jibié – cèrs, biches, tchèvreûs – vikét surtout dins lès forêts d’ Sint-Ubêrt et d’ Anliè, lès bièsses sâvadjes dol Hoûte-Sûre astint dé pus ptite taye. Il est vrê k’ lès singles, atirès pa lès tchamps d’ trukes, s’ avanturint sovint jusk’â bord do viadje. Dins nous bwès, on trouvét surtout dès pus ptites bièsses : lapins d’ garène, lièves, tassons, rnâds, skirons, vècheûs, bascolètes, fouwines, èrmines… Dins lès bîs, on rascontrét de tans-an tans one loutre, tèreûr dès péchons et èn’mîe djeuré dès pècheûs. Dins lès fagnes, a Cobrêvèye, gn-avét dès çantin.nes dé rin.nes ki, surtout dvins la nut’ dès tchoûdes ajournées d’ esté, ôrgânizint on-èkstraôrdinêre concert dé coasmints ! Lès basses meurayes ki markint co lès limites dé brâmint dès tèrins astint F domin.ne dès clouktrês. Leûs cris lancinants pârticipint o décor sonore dès nut’ d’ esté dins tos lès viadjes. Brâmint d’ tchâwes-sèrus razint lès twats a grande vitesse, an zigzag et sins k’ on lès-atinde. Dins lès tchamps, s’ lès tiers, dzos lès hayes et F long do bî vikint on tas d’lézards, dès sèrpants d’ vêre, dès rognètes, dès rats, dès sèrus, dès tchîproûles, dès fouyants et dès mulots. (p.101) Il astint co dins orrèkilibe naturel kè lès « progrès » mécanikes et chimikes n’ avint nin co vnu boulvèrsè. Dins cès-anées 20, èl ciel, lès-ârbes, lès bouchons et lès hayes astint plin.nes d’ ujês. Partout on vèyét dès volées d’ pièrots ki s’ ocupint surtout a fè la dicâce âtoûr dès plats tchoûds et fumants kè lès tchfôs lêchint tumè por zols su lès voûyes et lès pâtures. Gn-avét ossu dès bandes de nwars corbâs et dès bagâreûses aguèsses. A prétins, rèvnus de leûs vacances an.n-Afrike, lès-arondes bâtichint leû nid d’ boûze sètchîe tôt 1′ long dès corniches. Corne pindu dins 1′ ciel surtchâfè dès tchoûdes djoûrnées d’ esté, F âlouwète, sins boudji, lancét a piède 1′ alon.ne su cri stridant, intèrminâbe. De tans-an tans, on-z-atindét 1′ coucou, mes on nol vèyét jamês. El long do bwès, on vèyét pa dès coups on fêzan, u bin, surprîze o cwin d’ on tchamp, one volée d’ piètris su le vêt dins on brut d’ trin èksprès’ alors’ kè dins lès nwares sapignêres roucoulint lès ramiés. La campagne astét parcouru pa lès vols de totes sortes d’ ujês. El chayteû avét apris a Justin a lès rèknuchi a 1′ mon.nant sovint o bwès. A prétins et al Sint-Rmi, corne one litanie de porcèssion, dès cris plintifs et répètes fint sorti lès djins dès mâjons et, plins d’ admirâcion, i wêtint passé lès grues. Volant an formâcion, de leû vol pèzant, elle anoncint 1′ arivée dol bone u dol môvêze sêzon selon k’ èles volint après 1′ nord u après 1′ sud’. La nut’ astét peuplée d’ on tas d’ rapaces, surtout dès hourètes ki fint leû nid dzos l’twat d’ paye, su la meuraye dol vî mâjon. De tans-an tans, on héron razét lès bords do bî po sayè d’ atrapè on pèchon. Dins lès brouyârds dol sint-Rmi, brâmint dès grives, atirées pa lès roudjes pètches, finichint leû vie pindues a on colèt d’ crin de tchfô k’ lès tindeûs pôzint dins lès bwès dès-anvirons. Po-z-a fini avu ces ptites bièsses dol Hoûte Ardène, Justin è vèyu kékes copes de sprèwes et d’ miyots ki plânint dins 1′ ciel. I lès wêtèt, tôt d’ on coup, tumè corne one pière, et foncé su lès ptits rondjeûs k’ il avint repérés dins lès tchamps. I lès-apiçint dins leûs grifes et lès rpwartint po leûs djon.nes, dins leû nid, kéke part à fond dès bwès.
(p.109) El timp qu’ on-z-astét à mèsse, lu tch’vau rawârdét dins on stâle (…).
(p.115) Djustin à l’ sècole mwayène
(p.123) L’ ôrganizâcion dès cours m’ impôzét on-orêre fwart tchèrdjè. Kitè Hâmîprè a set’ eûres et dmi po-z-arivè a scole a wit’ eûres. Lès catre eûres dé cours de 1′ advant non.ne, rmontè an vitesse a Hâmîprè po-z-alè marèdè, rèvnu a scole po lès cours d’ après non.ne ki rèkmincint a one eûre. Après ces cours, deûs-eûres d’ étude, on batmint d’ one eûre, deûs-eûres de scole industrièle et, anfin, catrième trajet po Hâmîprè ! Dj’ ê roté insi dîj kilomètes par djoûr deurant cink ans, âke corne doze mile kilomètes, a pîd ! Lès deûs djèrin.nes-années, dj’ ave one biciclète, mes ç’ astét po fè la vouye intèr Nîve et la scole. Ça fét trante cink kilomètes tos lès djoûrs avu on vélo ki pèzét kinze kilos, one pèzante malète dé lîves su 1′ porte pakèts, ma marinde dins one sacoche apicée dins 1′ câde… Djè m’ sovin d’ avèr dvu pwate la biciclète su ma spale po plèr contourné dès conzières ki bouchint complètmint la vouye. Dj’ ê roulé insi a pou près vint mile kilomètes an deûs-ans. Djè deû dire kè ces marches fwarcées intèr Hâmîprè et 1′ Tchèstê et ces courses an vélo intèr Nîve et la scole, sovint dins la plue, dins 1′ îvièr et, d’tans-an tans su 1′ verglas, m’ ant fôrdjè one santé d’fièr. K’ est-ce k’ on-z-apèrdét al sècole do Tchèstê dins lès-anées vint’ ? On tas d’ matières. Po n’ cité k’ lès principales, gn-avét lès langues : francès, néèrlandès, angles, almand, latin et grec. Vènint après, 1′ istwâre et la jéografîe. Cink brantches dès siances astint étudiées • la fizike, la chimie, la biolojîe, la zolojîe et la botanike.
(p.143) Po-z-a fini avu ç’ chapite dol sècole mwayène, djè dire co kè 1′ orêre dès cours prévwayét one demi djoûrnèye d’ condjî lès djûdis et lès sam’dis. Dj’ avins one sèmin.ne de vacances à Noyi, one kinzin.ne de djoûrs a Pake et deûs mwès an fin d’ anée, do 15 djulè o 15 sètambe. A dzeû dès-intèrogâcions, câzi tos lès djoûrs po cote nosse travay, dj’ avins, chake anée, deûs séries d’ compôzicions, one an fèvri, 1′ oûte an jwin. Po lès-ègzâmints d’ fin d’études, après la trawazième mwayène et la fin dol preumière siyantifike, lès-èpreûves contint on-ègzâmint oral ki nos fét pour !
(p.143) Dins on-oûte domin.ne, djè m’ sovin kè, deurant lès deûs-anées 1930 et 31, dj’ ê stî lôrèyat do Fond dès mis douwès dol province dé Luksambourg. Po ça, il avét alouwè deûs coups 750 francs a mes parints, çu ki, a 1′ èpoke, astét fwart bin vnu po payé one partie d’ mes frês. Èm’ directeur m’ avét prèzantè a on djuri ki siéjét a 1′ Hôtel de Vile de Bastogne et ki m’ avét pôzè totes sortes de kèstions. Djè m’ sovin, k’ an fin d’sèance, on ptit vikêre ki n’ savét nin sinte la scole oficièle, avét voulu m’ pôzè one djèrin.ne kèstion. Sins tchiktè, i m’ avét dmandè kèbin k’ ça fét, lu tièr et dmi d’ çant ! Mu dotant bin k’ ç’ astét one atrape, al pièce d’ èm’ lancé dins dès calculs complikès, mu sovnant d’ on vecteur divizè an trwas min.mes longueurs, dj’ ave rèspondu 50, al grande satisfacsion d’ èm’ directeur, M. Racoux.
(p.159) (…) is s’ avint pièrdus.
(p.165) Come i fât brâmint do timp po mouru!
(p.165) Gn-è pont d’ fil, qu’ on lî rèspond, il èst tumè do potau. |
|
1924 |
in : GSHA, 19, 1983, p.36-42
Souvenirs de la vie quotidienne à Gouvy et Rettigny dans la première moitié du XXe siècle1. Une kermesse à Gouvy en 1924
(…) le soir, c’était bal dans le café de la gare. On s’y amusait bien, on dansait le lancier, la valse, le tango et la mazurka. Tant pis si le dimanche suivant l’abbé Bastin grondait dans son sermon. C’est comme l’ivrogne à sa femme : « Trop tard de gronder après ! » |
|
1930-50s |
Duvîses â d’fêt do timps passé, in : Amis de Logbiermé, 19, 1997, p.24-27
Les enfants faisaient leur communion solennelle à 11-12 ans. J.G. fit ses pâques à 12 ans, parce qu’il y fut obligé à cause des élections. On nomma Servais instituteur à l’école libérale, ce fut la dispute avec le curé Meyers et il ne put faire sa communion. Il en fut de même pour Joseph Raskin. Le père de J.G. avait voté pour Servais.
|
|
1930-50s |
Duvîses â d’fêt do timps passé, in : Amis de Logbiermé, 19, 1997, p.24-27
Nous arrivons à la guerre scolaire. Alexandre Décret, dont Petit-Thier conserve le souvenir d’un saint homme, était instituteur pour les catholiques et Ernest Maquet l’était pour les libéraux. Alexandre Décret avait fait des études pour être curé mais dut les interrompre pour raisons de santé. Jules Englebert fut aussi maître d’école (messe du s’cole) pour les libéraux. Les parents comme les enfants, pâtissaient de cette lutte scolaire. Alphonse Esser racontait bien des fois que sa maman allait à confesse et que le curé reclapait la planchette quand c’étaient des enfants des écoles libérales.
|
|
1930-50s |
in: Laurent Dabe, L’Ardenne entre bruyère et myrtille, 2003
(p.142) Les Ardennais bon teint vous rappelleront, un sourire en coin, l’homélie du brave curé de Redu. Celui-ci voyait d’un mauvais œil ces rassemblements de jeunes gens dans la forêt. Il ne pouvait les surveiller sur place et il se décide donc de les haranguer le dimanche du haut de sa chaire à prêcher ! « Mes biens chers frères, méfiez-vous car on se salit tout aux myrtilles. Non seulement les mains et la bouche mais encore autre chose ! » Les paroissiens, face à cette façon maladroite de présenter les choses, pensèrent à une autre partie de leur anatomie, moins glorieuse ! Des sourires éclairèrent les visages et quelques rires étouffés firent rapidement prendre conscience au curé de son lapsus. /Il se reprit : (…) on se salit l’âme./
|
|
1930s |
in Roger Cochart, Durnal, 1992
(p.307) VENIR AU MONDE ET … LE QUITTER
Si le bébé d’aujourd’hui peut compter sur les soins tutélaires et exclusivement matériels de tout son entourage, ses aïeux bénéficiaient davantage des protections célestes. A commencer par le baptême. Généralement administré le dimanche suivant la naissance, ce sacrement précoce s’expliquait par une mortalité infantile importante: si le petit meurt sans être baptisé, disait le curé, son âme ira aux limbes! C’était en quelque sorte l’antichambre du paradis, qu’il convenait d’éviter à tout prix; d’où la grande sollicitude pastorale pour les prématurés fragiles.
|
|
1930s |
in : AO 21/10/2010
CUEILLIR LES MYRTILLES UN DIMANCHE… UN PÉCHÉ ?
Madame Maria Lambotte, de Werbomont, nous livre, avec sa verve habituelle, une anecdote savoureuse à plus d’un titre, mais jugez plutôt. «Loin des faits bien regrettables qui secouent en ce moment l’Eglise, je voudrais vous soumettre ici ce petit fait savoureux qui s’est passé il y à bien des années au village. Il est vrai qu’en ce temps-là tous les dimanches s’accompagnaient d’une assistance à la messe pour la plus grande partie des villageois, du plus petit jusqu’au plus grand. Les travaux de la fenaison pouvaient, quant à eux, s’effectuer, il fallait bien traiter le foin coupé pour avancer la récolte, mais pas question de faucher l’herbe un dimanche.
|
|
1930s |
in : GSHA, 22, 1985, p.26-30
Nosse vî blanc d’Tavny (2e partie)
1. Ses leçons de « catéchisme »
Dès l’âge de 7 ans, époque à laquelle chacun atteint, paraît-il, l’âge de raison et ce, jusqu’à la sortie de l’école primaire (14 ans, en ce temps-là), nous étions « abreuvés » c!e leçons de catéchisme. Aujourd’hui, nous en éprouverions un « ras-le-bol » tout aussi spontané que réel. Seulement voilà : nous sommes dans les années 1920-1930 et il faut obligatoirement assister aux leçons, fussent-elles fastidieuses ou ennuyeuses. Elles se déroulaient, soit à l’école communale, soit au presbytère, tous les jours de 11 à 11,30 h, et chaque dimanche de 13,30 à 14 h, en l’église paroissiale, juste avant l’office des Vêpres. Précisons, en passant, que les cours de l’école primaire, donnés à cette époque par l’instituteur M. Alphonse Potelle, avaient lieu chaque jour de 8 à 11 heures et de 13 à 16 heures, samedi compris. Le demi-jour de congé hebdomadaire était le jeudi après-midi. Plus ou moins six semaines de vacances s’échelonnaient du 15 août au premier lundi d’octobre. Rien à Noël ni à Pâques, ni à la… Trinité. Deux, trois ou quatre jours, tout au plus ! Tous ceux (filles et garçons) qui ont fréquenté ces cours de catéchisme vous diront qu’ils y ont, bien souvent, vécu des sentiments de crainte et de peur. Crainte de ne pas savoir répondre correctement à la question posée. Peur de la gravité plus ou moins sévère de la punition éventuelle. En effet, nosse vî blanc n’admettait pas que nous ne connaissions pas, tous, les 50 leçons du petit catéchisme sur le bout des doigts. Si la plupart des catéchisés n’éprouvaient pas trop de difficultés à donner une réponse valable, gare cependant aux distraits, aux indisciplinés ou aux « têtes dures » ! Ceux-là se voyaient administrer illico une volée de son légendaire petit béret, sur la tête ou, même, un « saqué » coup de poing entre les deux yeux. Il était impitoyable envers ceux-là. « Je vais te secouer la mèyôle (cervelle) », disait-il assez sèchement. Sitôt dit, sitôt fait. Et, stupéfaction, parfois, le miracle s’accomplissait : le « secoué » trouvait la bonne réponse. Sa tactique, osée, quoiqu’indigne d’un curé, nous semble-t-il, se révélait payante. Il va sans dire que ces années de catéchisme, données entre les deux grandes (p.27) guerres mondiales par ce bon vieux curé de naguère, resteront gravées en nos mémoires jusqu’à ce que, l’un après l’autre, nous le rejoignions là-haut.
2. Ses punitions, ou plutôt… nos punitions. « Usez, mais de grâce, n’abusez pas de votre pouvoir, s’il vous plaît, Monsieur le Curé » aurions-nous bien souvent pu crier afin de l’implorer de nous épargner des punitions ou des pénitences plus ou moins sévères et humiliantes. Aujourd’hui, nous avons l’intime conviction qu’il aurait inexorablement considéré notre démarche comme irrespectueuse et, par surcroît, comme punissable. De fait, le rôle d’un supérieur consiste à établir une certaine discipline parmi l’ensemble de ses subordonnés et, surtout, à la faire admettre par ceux-ci. Hélas, pour nous, nosse w blanc ne badinait pas avec la discipline et, lorsqu’il se permettait de punir l’un ou l’autre d’entre nous, il le faisait souvent sévèrement, parfois avec une certaine rigueur, et généralement sur-le-champ. Nous avons toutefois le sentiment qu’il le faisait avec justice et discernement, avec l’unique intention de rendre meilleur celui qui avait commis une faute. Aussi, que de cent lignes telles que : « Je dois savoir mon catéchisme » – « Je dois assister chaque jour à la Sainte Messe » –« Je suis un, paresseux » – etc. et que de cinq ou dix fois telle ou telle leçon, tel ou tel devoir de catéchisme n’avons-nous pas été contraints de copier le soir avant nous coucher. A cet égard, la sanction s’avérait particulièrement pénible les soirs d’hiver, car il nous fallait écrire ces cent lignes ou ces cinq ou dix copies à la lumière bien faible du kinkèt à pétrole. De fait, rappelez-vous, chers amis, de l’époque : notre Tavigny ne fut « électrifié » que le 31 décembre 1934 à cinq heures du soir. Gageons que ce soir-là, le réveillon du nouvel-an se prolongea davantage que ceux des années précédentes ! Evolution que nous considérions plutôt comme une « révolution » car, quelle métamorphose eu égard à notre vie « paysanne » ! Pour en terminer avec ce chapitre « punitions », figurez-vous qu’un beau jour, quelques-uns d’entre nous (probablement les enfants de chœur — ceux-là même qui buvaient parfois le vin de messe du curé —) découvrirent avec une certaine joie que nosse vî blanc confiait nos punitions et nos copies au foyer du poêle de l’église. Comme l’on n’y faisait du feu, en principe, que pour les offices du dimanche — et encore, seulement durant l’hiver —, vous pensez bien qu’un nombre plus ou moins respectable de ces précieux documents furent récupérés par certains pour « resservir » une prochaine fois. Pour une fois, nosse w blanc avait été bien attrapé !
Jules Morsomme
|
|
1930s |
in: Julie Muller-Barthélemy, Erënnerungen aus engem beweegte Joerhonnert, éd. RBS, izerg 2009
(p.37) De Paschtouer vu Miesdref huet et sech och net huele gelooss, fir vun der Kanzel erof vun deem ,,gewësse Café mat der Keelebunn » ze schwätzen an ze soen, d’Mamme solle besser op hir Jongen oppassen. Wéi wa se do eppes Schlechtes gemaach hätten!
|
|
1930s |
in: Julie Muller-Barthélemy, Erënnerungen aus engem beweegte Joerhonnert, éd. RBS, izerg 2009
(p.41) Mir haten den Dechen am Katchëssem an de Kaploun an der Bibel. Ech hunn ëmmer schéi geschriwwen. Awer wann den Dechen äis déi schrëftlech Prüfung erëm ginn huet, da koum e bei mech an huet gesot: ,,Wat fir eng Héngerféiss hues du dann do gekropelt! » Ech war deemools nach e Kand an hunn alles fir bor Mënz geholl, wat den Deche gesot huet. Ech konnt him näischt gutt genuch maachen. Et pour cause: mäi Papp hat d’Escher Tageblatt a meng Eltere sinn net an d’Kierch gaang.
|
|
1930s |
in: Julie Muller-Barthélemy, Erënnerungen aus engem beweegte Joerhonnert, éd. RBS, Izeg 2009
(p.49-50) Mäi Papp war nach esou rosen, wéinst dem Marion sengem Dout, dass hien de Jim net wollt deefe loossen. No dräi Woche sot meng Mamm: ,,Dir hutt dach hei zu Lëtzebuerg e Sproch: Maach ewéi d’Leit, da geet et der wéi de Leit. » Wéi de Jong bal sechs Wochen hat, huet de Papp dem Dechen endlech telefonéiert. ,,Ah, Dir sidd deeeen Här Barthélémy », sot den Dechen. Hien huet sech alt zréckgehalen an net gesot ,,de roude Barthélémy ». ,,Jo, ech géing mai Jong gären deefe loossen. » ,,Ma da kommt, ech hunn och nach en Hinnche mat Iech ze rupfen. » Mäi Papp war annerhallef Stonn bei him, a si hu sech alles gesot, wat hinnen net gefall huet. Beim ,,Hinnchen ze rupfen » ass et ëm eng Saach gaangen, déi 1930 geschitt war: D’Germaine Barthel aus menger Klass ass am Summer mat kuerzen Äerm an d’Schoul komm, an du seet den Dechen zu him: ,,Komm du mal her. Geh nach Haus und zieh eine Schürze an! » An d’Kand ass heem gaangen an huet e Schiertech ugedoen. Ech hu mengem Papp des Geschicht gezielt. Hei war kuerz drop eng Karikatur am Tageblatt vum Albert Simon, op där den Dechen an e Meedche virun der Tafel stinn. Den Deche weist mam Fanger op d’Meedchen. An ënnendrënner stung: ,,Geh nach Haus und zieh eine Schürze an! » Du hat mäi Papp dem Albert Simon telefonéiert an him déi Geschicht verzielt.
|
|
1930s |
in: Julie Muller-Barthélemy, Erënnerungen aus engem beweegte Joerhonnert, éd. RBS, izerg 2009 (p.61-62) De Clan des Jeunes
1938 hunn zwee Mierscher, de Vie Simon, hie war deemools op Première, an den Emil Laux e Clan des Jeunes gegrënnt. Donneschdes mettes hu sech déi Jonk bei äis am Sall zesummefonnt. Mir ware sou ëm déi 40 Leit. Meng Mamm huet äis mat Geback a Gedrénks verwinnt, et war ëmmer lëschteg. Dat ass e puer Méint esou gaangen, bis dass de Vie an den Emile bei den Deche geruff gi sinn. Wa si net géingen ophale beim roude Barthélémy d’Jugend ze versammelen, da misst de Vie kucken, wéi e seng Première géing kréien an den Emil géing seng Plaz verléieren, huet den Deche gemengt. Du war et eriwwer mat eisem Club! Sou war et déi Zàit.
|
|
1930s |
in: Marie-Thérèse Pipeaux, Anloy, un siècle d’histoire 1900-2000, éd. Weyrich, 2004La vie religieuse
(p.79) Textes et souvenirs de Paul Hermand L’un des traits les plus typiques de la vie au village était l’atmosphère religieuse qui y régnait, héritage d’une tradition familiale séculaire, génératrice de foi, une foi de gens simples, «la foi du charbonnier». Cet esprit profondément religieux allait de pair avec une morale catholique stricte, de façade en tout cas ; dans la réalité, des accrocs se produisaient de temps à autre, commentés malicieusement sous le manteau par les bons chrétiens du village dont la charité et la tolérance n’étaient certes pas les vertus dominantes.
|
|
1930s |
in: Omer Marchal, Au pays de mon père en Ardenne, 1936-1945, Hatier, 1990
/Ochamps/
(p.80) Notre foi et notre religion étaient présentes à l’école. C’était une école communale, mais la commune étant chrétienne, le bourgmestre chrétien, les échevins et les conseillers municipaux chrétiens, qui nommaient les maîtres d’école, l’instituteur était chrétien lui aussi et l’école communale était une école chrétienne. Comment ne l’aurait-elle pas été? La plupart de nos maîtres avaient été formés chez les frères des écoles chrétiennes à Saint-Joseph-de-Carlsbourg. Et pour les institutrices on n’en connaissait point de laïque à cinq lieues à la ronde: c’étaient des ma-chère-sœurs, que les communes invitaient à venir enseigner les filles de nos villages, leur fournissant à cette fin le toit, le bois, et elles, logées, chauffées et jadis nourries, acceptaient avec une certaine hauteur de leur faire cet honneur.
|
|
1930s |
in: Omer Marchal, Au pays de mon père en Ardenne, 1936-1945, Hatier, 1990
/Ochamps/
(p.81) Chez nous, en Ardenne belge, on dînait à midi, quand la France déjeunait, et on soupe au soir, quand elle dîne. Le dîner dominical était le meilleur des repas de toute la semaine. Les hommes, eux, allaient à grand’messe, où à l’époque on ne communiait pas. Cela arrangeait tout le monde, à commencer par les ménages. Certes nul n’était tenu, en conscience, de se déclarer publiquement pécheur, mais plus d’un mari, gaulois et paillard, n’aurait peut-être pas trop aimé montrer à sa femme qu’il n’était pas digne en conscience de s’approcher de la sainte table. La communion sacrilège où l’hostie (p.82) descendait sur la conscience chargée de péché mortel valait à qui mourrait en cet état l’exposition éternelle aux flammes de l’enfer, recta! La liturgie du temps, encore tout empreinte de jansénisme, ne rendait pas la piété facile, il fallait bien le dire, sauf aux bigots et aux femmes à curés bien entendu. On ne communiait qu’avant la messe basse du matin ou à la communion du prêtre en cette messe-là. Aussi la communion était-elle plus le fait des femmes que des hommes, car si celles-là étaient requises à la cuisine dès les dix heures, ceux-ci ne pouvaient guère quitter l’étable et l’écurie avant la demie de neuf, sur quoi il leur fallait encore se faire la barbe et, pour certains qui n’avaient pas pu le faire le samedi au soir, se tremper le cul dans la tine. Les hommes qui voulaient communier, à moins d’habiter au pied du clocher — nous, nous en étions loin —, devaient se faire briller le poil à l’aube, se présenter tout propres à la sainte table sous la nappe brodée de laquelle il fallait joindre des mains nettes, retourner à leur chaise tout tournés vers l’intérieur, prolonger l’oraison et l’action de grâces, rentrer à la maison, manger la trempinette, troquer le moyen beau costume d’avant basse messe contre le beau costume et les bas souliers du dimanche, trouver à la maison quelqu’un de capable de leur nouer la bonne cravate sur la belle chemise, et reprendre le chemin de l’église en s’efforçant d’y arriver à temps. Car le curé Maréchal prêchait les personnes qui troublaient la liturgie, et s’il n’allait pas jusqu’à les citer nommément, il n’était pas agréable de se sentir au front le rouge de ceux qui avaient été prêches. (p.84) Une autre raison empêchait les hommes d’aimer la messe basse. La sortie de grand’messe était un des bons moments de la semaine. Tout le monde à cette heure-là était endimanché et on se sentait vraiment dimanche. L’angélus transfigurait les visages et les façades. Les tas de fumier, devant les maisons de cultivateurs, étaient peignés au carré pour le jour du Seigneur, le village fleurait bon le bouillon qui mitonnait sur la plate-buse, la bouse des chemins et la fumée des feux de hêtre sentaient meilleur, ils sentaient dimanche. Et puis, les hommes repassaient chez le Marcel Jacquemin ou l’Emile Mouzon, qui tenaient café en même temps que boulangerie. La boule roulait sur la planche du jeu de quilles, on buvait la goutte ou le faro, la chopine ou le stout, les jeunes hommes s’envoyaient quelques demis, et puis on rentrait dîner. Ah ! les beaux dimanches qu’on se faisait alors, lentement, savourant une à une les demi-heures qui tombaient du clocher comme des gouttes de vin de messe dans le ciboire de notre curé. Tous les dimanches avaient leur odeur, leur saveur, leur grâce particulières. Ceux de l’hiver évoquaient autant de chaleur que les chauds dimanches estivaux. Car si la chaleur de ceux-ci était dans l’espace, celle de ceux-là était tout intérieure, recueillie, méritée.
|
|
1930s |
in: Roger Cochart, Durnal, 1992
(p.308) Les relevailles de la maman
Bien entendu, la maman du petiot était exclue de tout ce cérémonial; il ne lui était pas permis de pénétrer dans un lieu saint sans avoir été réhabilitée. Les relevailles, communément appelées ralè à messe, étaient prescrites par l’Eglise afin de laver la mère des souillures de la maternité; le rite prévoyait in fine l’offrande de l’enfant à la Vierge Marie, comme celle-ci le fit lors de la présentation de Jésus au temple. Cette cérémonie se déroulait trois à quatre semaines après l’accouchement, lorsque la mère, restée alitée pendant neuf jours, avait surmonté les maux de la délivrance. Le père, dans toute cette histoire, joue un second rôle. Comme il y a deux mille ans, il se contentera de mener son petit monde sur les chemins ardus de la vie, en assumant pleinement les charges paternelles.
Post mortem
Au terme de ses pérégrinations terrestres, l’homme voit sa dépouille de baptisé prendre le chemin de la terre bénite où reposent ses aïeux. Mais l’âme, où va-t-elle ? Eternel mystère, aujourd’hui encore inexpliqué et contesté. Bien moins préoccupant en ces dernières décennies du 20e siècle, l’enfer était mieux connu des vieilles personnes. C’était, paraît-il, une immense fosse à purin, comme il en existait dans toutes les fermes, alimentée par les résidus biologiques de tout être vivant au sein de l’exploitation. Ceux qui avaient mené une mauvaise vie naviguaient dans cet infâme brouet, tandis que le Prince des Ténèbres, Satan, armé d’une gigantesque faux, balayait l’onde pestilentielle tout en s’écriant: gâre aus tièsses, gare aux tièsses! (p.309) Dans les remous provoqués par cette panique, les malheureux perdaient la tête, au figuré d’abord, au propre ensuite, non sans avoir ingurgité moult rasades de cette potion affreuse et nauséabonde. Dans ces conditions, les prescriptions pastorales reprenaient quelque vigueur, au plus grand dam de l’ange infernal. Pour donner plus de force à l’enseignement de l’Eglise, il arrivait que le curé appelle à la rescousse des prédicateurs étrangers, spécialistes du péché et virtuoses en matière de récupération d’âmes dévoyées. Satan lui-même, disait-on, les craignait.
|
|
1930s |
Philippe LEJEUNE, in : GSHA, 21, 1984, p.42-45
Nosse vî blanc d’ Taveni
Monsieur Jules Morsomme a récemment édile un intéressant travail de 94 pages consacré presqu’exclusivement à ses souvenirs du pastorat de l’abbé Jean-Baptiste Jacqmin (1868-1954), curé de Salmchâteau de 1907 à 1920 et de Tavigny de 1922 à 1938. Il nous a, très aimablement, autorisé à reproduire de larges extraits de son volume et nous donnons ci-dessous, à nos lecteurs, un premier extrait qui illustre bien, avec humour et sérieux à la fois, la mentalité d’une paroisse ardennaise et de son pasteur il y a un demi siècle.
Le short
Figurez-vous que, vers les années trente, un jeune couple (en stage de vacances au vieux château du village, si notre mémoire est fidèle) osa se promener en short dans les rues de notre paroisse. Notre curé en avait été si profondément offusqué qu’il consacra l’entièreté de son sermon du dimanche suivant à cet événement… inhabituel, à Tavigny tout au moins. A l’époque, nous avions douze ou treize ans et, rien qu’en pensant aux termes disgracieux qu’il prononça tout au long de son homélie — disons plutôt de son réquisitoire —, nous en frissonnons encore. « Le diable en personne et sa compagne ont souillé les rues de notre beau village… Prions pour eux… » Jamais, au grand jamais, nous n’avions vu nosse vî blanc étaler autant d’agressivité à l’égard de ce « scandale » qu’il qualifia de noms que la décence ne nous permet pas de rappeler ici. Vous me direz certainement, amis lecteurs, que le port d’un short ne devait pas provoquer pareille colère de la part d’un curé et, assurément, pas en chaire de vérité. Et vous vous demandez probablement quelle serait sa réaction en 1984, devant toutes ces processions de mini-jupes, de décolletés plus ou moins généreux ou, même, de seins nus sur nos plages ! D’accord avec vous, mais… il y a cinquante ans, la tenue vestimentaire était toute autre, (p.43) surtout dans nos villages ardennais. Vous en avez l’illustration patente sur toutes les photos prises il y a cinquante ans et plus, qui paraissent régulièrement dans L’Avenir du Luxembourg pour le moment. Savez-vous, par exemple, que certains curés refusaient catégoriquement l’hostie consacrée à toute femme qui osait se présenter bras nus, ou même demi-nus, au banc de communion ? La discipline vestimentaire était très stricte à l’époque de nos bons vieux curés d’autrefois. Dans tous les domaines, tout a évolué. Est-ce un bien ? Est-un mal ? Seul l’avenir nous édifiera à cet égard. Quoique, tout est relatif, et fonction de l’époque. Son aversion vis à vis des bals. Le dernier dimanche de septembre, c’était la kermesse au village et, ma foi, c’était le jour attendu par tous pour se détendre un peu ou… un peu beaucoup. Et, généralement, à cette époque, une salle de danse était montée sur place. Seulement cette « guinguette démontable » était située à vingt mètres à peine de l’église paroissiale. Nous concevons facilement que nosse vî blanc passe des nuits blanches à la fin septembre de chaque année. S’il détestait notamment le mensonge et l’oisiveté, c’est une « antipathie » assez prononcée qu’il éprouvait envers les bals ou les danses populaires. Aussi, en pénétrant dans l’église pour assister à la Sainte Messe de ce dernier dimanche de septembre, nous nous interrogions déjà : « qu’allons-nous devoir encore subir comme réquisitoire aujourd’hui… en guise d’apéritif ? » C’est ainsi, qu’invariablement, tout son sermon de la kermesse était concentré sur les conséquences néfastes de la danse, chrétiennement parlant, cela va de soi. Il nous exprimait ouvertement, et sans détours, ce qu’il pensait de ceux qui allaient oser pénétrer dans cette guinguette pour y danser. En termes peu flatteurs, et sans mâcher ses mots, il nous disait d’un ton fort sévère : « le diable suivra chacun de vos pas, et vous entraînera avec lui dans le feu éternel de l’enfer ». Là, alors là, Monsieur le Curé, vous exagériez un peu, même beaucoup, car pour une fois par an où nous pouvons nous amuser un peu, nous irons danser, ne vous en déplaise I Voyons, Monsieur le Curé, soyez compréhensif et envisagez sainement la situation : après une bien lourde saison de travail campagnard, nous avons un réel besoin de nous défouler. Surtout nos quelques jeunes filles, qui ne sortent jamais et qui, durant 365 jours, attendent ce tout petit plaisir de danser un peu. Peu nous importe la fatigue, nous sommes jeunes et nos facultés de récupération nous permettront d’assister à la messe que vous célébrerez lundi matin à la mémoire denos chers défunts et de commencer, selon la tradition, dès mardi matin, l’arrachage (p.44) de nos pommes de terre. D’ailleurs, Monsieur le Curé, si notre envie de danser est évidente, vous savez fort bien que, selon votre souhait, nous acceptons volontiers d’interrompre le bal entre 18 et 19 heures pour assister nombreux à votre « salut solennel de la kermesse ». Dès lors, donnant… donnant… Monsieur le curé ! D’accord ? Avant d’en terminer avec ce chapitre « sermons » ne nous laissez pas oublier de vous confier, ou de vous rappeler, amis lecteurs, que les enfants du degré supérieur de l’école primaire devaient remettre chaque lundi, à leur vénérable pasteur, un bref résumé de son sermon de la veille. Initiative… impopulaire, cela va sans dire ! Cependant, rassurez-vous. Ce travail supplémentaire ne constituait pas une punition. Mais, bien sincèrement, nous le considérions comme une angoissante corvée. Seulement, comme notre prédicateur éprouvait une sainte horreur envers l’oisiveté, il nous trouvait là une petite occupation. Par ailleurs, comme il tenait absolument à ce que nous soyons fort attentifs pendant qu’il nous inculquait les vénérables principes de la doctrine chrétienne, il avait le vif sentiment que son initiative ne pouvait que nous être profitable. Et, tout bien considéré, il avait pleinement raison, car, manifestement, son heureuse décision nous apportait une plus-value de nos connaissances, tout en éveillant davantage nos facultés intellectuelles. A cet égard, nous ne pensons pas dévoiler un petit secret en révélant, ici, que certains parents donnaient volontiers un petit coup de main à leur progéniture pour l’aider à rédiger ce résumé. La mémoire est assurément une faculté capricieuse, et la rédaction constitue, en elle-même, un exercice que certains n’affectionnent pas plus que cela.
Jules MORSOMME
|
|
1930s |
D’après m’ pa, il èsteûve, di s’ timps, intèrdit – èt c’ èsteûve sicrît dins l’ catèjime – di critiker lès curés…
|
|
1930s |
Pascale Leyder, Le rexisme dans la province de Luxembourg 1935-1940, Mémoire de licence en histoire, ULG 1984
(p.6) Le père de Léon Degrelle est français. Il est natif de Solre-le-Château.
(p.12) la ‘dictature du profitariat’
(p.14) Le 26 décembre 1934, Léon Degrelle est invité à prendre la parole à l’Institut Sainte-Marie d’Arlon, à l’occasion de l’assemblée générale de son « Amicale », et ce, en présence de l’Association catholique d’Arlon.
(p.60) Le Luxembourg est une terre très catholique, et sans doute est-ce là la raison principale du succès rexiste ; REX dénonçait le vieux Parti catholique et ses leaders, leur incapacité, voire même leur malhonnêteté.
|
|
1930s |
Yves Raisière, (concernant l’étude de Flore Plisnier : Ils ont pris les armes pour Hitler ; la collaboration armée en Belgique francophone) Collabos: aussi en Wallonie, VA 23/02/2008
Le monde catholique. Selon Fabrice Maerten (CEGES), il ne pourrait plus ignorer que le rejet du suffrage universel et l’attirance vers les régimes d’ordre a conduit une partie de ses plus fervents adeptes à suivre Degrelle dans l’aventure rexiste.
Le monde socialiste. Selon le CEGES, une des contributions les plus originales de ce travail est d’avoir démontré que le gros du contingent de la collaboration armée vers la fin de l’Occupation provenait de la population ouvrière du sud du pays, en particulier du Hainaut. Soit de l’électorat traditionnel du parti socialiste.
|
|
1935 |
Arthur Schmitz, La mission
En 1935, c’èst l’anéye di ma comunion èt c’èstot ossu l’anéye do l’ mission.
Elle avot stî prétchi pa deûs rèvèrend péres : on p’tit gros èt on grand mégue. Li p’tit gros prétchot en fèjant rîre lès djins. I grand mégue, lu, i prétchot en fèjant poûr à lès djins en parlant d’ l’ enfèr èt di totes lès miséres qui leû toum’rint su l’ dos s’i n’ priyint nin asséz. Nos-ôtes, lès gamins èt lès gamines do viadje, dji deujins aller à mèsse èt à salut tos lès djours. Li salut durot pus lontimp qui d’abitude, pace qui ouk ou l’ôte dès pères prétchint après qu’on-z-avot fini di dîre li tchèplèt. Dins la djournée, lès deûs pères alint dins lès mâjons po dècider lès djins a vnu à salut. Addé li vî Jowakim qui n’ fèjot pus sès Pâques dispûs dès-anéyes. I lî avint d’mandé : – Est-ç’ qui vos savoz bin çou qu’ c’èst qu’one mission ? Sins s’ mâvrer, li vî Jowakim l’zî avot rèspondu : – Dimandoz ça à on gamin. Mi, dj’ ènn’é vèyu co 13 divant du r’claper l’uch . Addé l’ mônî qui n’ pratiquot nin, il avint dit qu’i deujot tûzer au dièrin juj’mint. Li mônî lzî avot rèspondu : – Li dièrin juj’mint, ça srè po tortos… po vos deûs ossu . Li dièrin djour do l’ mission, il avint fêt one procèssion po planter one creux su l’ Tièr Charneux. Li mégue, qu’on loumot L’ Tène, èstot drèssi à pîd do l’ creux èt i criyot su lès djins en djant qu’i falot priyi èt co priyi si on n’ vlot nin si ktaper su lès brézes di l’enfèr. Après ça, li ptit gros nos-è fét tchanter on cantique qui l’ rèfrin, c’èstot : Je n’ ai qu’une âme qu’il faut sauver. De l’ éternelle flamme, je veux la préserver. Li lendemwin advant non.ne, lès deûs rèvèrends péres dischindint li pazê qui va à l’ gâre di Bènonchamps po-z-aller ôte pârt po prétchî one ôte mission. Après la mission, gn-avot quékes djins do viadje qu’èstint rivenu à mèsse, li dîmègne. Mês … chîs mwès pus târd, c’ èstot rivenu come divant.
|
|
1935-1965- |
Begin oktober zal het 50 jaar geleden zijn dat Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie opende. De oude paus wilde ramen en deuren opengooien om een frisse wind door de kerk te laten waaien. Een halve eeuw later, stelt theoloog Jiïrgen Mettepenningen vast, is het de hoogste tijd voor een nieuw concilie. ‘Dat hoeft geen Derde Vaticaans Concilie te zijn. Ik denk liever aan het Eerste Concilie van Rio.’
door walter pauli
Jürgen Mettepenningen ‘Ik hoop op een nieuw concilie om de kerk te redden’, in: Knack, 13/10/2012, p.6-10
Tot dan was de katholieke kerk wat vandaag ‘preconciliair’ heet: triomfalistisch (alleen de kerk had de waarheid in pacht), strikt hiërarchisch (Rome sprak, Rome bepaalde, Rome veroordeelde, Rome schreef voor enzovoort), centralistisch (met aïs officiële voertaal voor de mis niet toe-vallig een dode taal, het Latijn), en over het algemeen vooral behept met het veroordelen van wat niet goed was: het protestantisme, het modernisme, het socialisme, het marxisme, het libéralisme, het féminisme. Na afloop van het concilie in 1965 was – of leek – in die katholieke kerk misschien niet allés maar toch erg veel fundamenteel veranderd. Het Latijn was niet langer de verplichte taal, de kerk zou zich opener, deemoediger en zelfs democratischer opstellen, en vooral: de kerk zou voortaan de moderne maat-schappij omarmen. Niet om de wereld zoals vroeger te mis-sioneren of te bestoken met de katholieke boodschap, maar ook om er omgekeerd te leren, om zich te laten doordringen van ‘het leven zoals het is’, en tegelijk om een positieve impuis te geven aan wat toen nieuw en vooruitstrevend was. (…)
(p.8) Men durft een Derde Vaticaans Concilie niet aan?
Mettepenningen: Ik pleit niet voor een kopie van hetTweede Vaticaans Concilie. Toen waren het alleen gemijterde heren die vergaderden en beslis-ten. De gewone gelovigen, ‘de leken’, waren nergens. En de vrouwen al helemaal niet. Vandaag kan een kerk zich maar vernieuwen aïs die impuis niet alleen van allé priesters komt, maar van allé gedoopten. (…) Ik hoop op een concilie met een boodschap voor alle gelovigen. Waar dus ook leken en vrouwen aan deelnemen, en niet alleen bisschoppen. (p.9) De rol van theologen was geweldig. Hun inbreng zorgde ervoor dat het concilie intellectueel op niveau stond. Vooral de Belgische ploeg was bijzonder actief. Het was tekenend dat de Franse toptheoloog Yves Congar al vrij snel in het Belgisch Collège logeerde aïs hij in Rome verbleef. Ook de ‘Nederlandse Vlaming’ Edward Schillebeeckx kwam daar lezingen geven. U noemt namen die zelf het slachtoffer waren geweest of zouden worden van Vaticaanse repressie. Maar er was dus een tijd dat Rome oor had naar de argumenten van dissidente theologen. Mettepenningen: Mijn onderzoeksdomein is de nouvelle theologie. Dat was een vernieuwingsbeweging die de toen gebetonneerde theologische méthode wilde openbreken. De Franse dominicaan Yves Congar is een van de grote figuren. Al in januari 1935 had Congar een fameus opiniestuk geschreven waarin hij sprak van le déficit de la théologie. Hij voorspelde toen al dat er toekomst was voor een théologie die los kwam te staan van het concrete leven.
Waarop een nietsontziende repressie volgde.
Mettdepenningen: Het spreekt voor zich dat het Vaticaan zich prompt tegen die vernieuwingsbeweging keerde. Het woord ‘nieuw’ uitspreken volstond als versoorder van de orde en bedreiger van e ware beer. Duc Congar werd verketterd. Hij werd uit Parijs verbannen, zwierf naarEngeland, dan naar Jeruzalem. Toen zijn moeder 80 werd, schreef hij haar een brief: ‘Ik zie het leven eigen-lijk niet meer zitten.’ Zo diep had de kerk hem geduwd. Het is een schrijnend en aangrijpend verhaal. Maar Johannes XXIII viste Congar op, en maakte hem voor zijn concilie ‘peritus’of expert’. Hij zou zich er ontpoppen tot een van de leidende theologen. En door hem in ere te herstellen, werd eigenlijk ook de nouvelle théologie gerehabiliteerd. Toch voor even, want nadien werd die erfenis weer losgelaten. Pas in 1994 kreeg Congar de eer die hem toekwam, en werd hij kardinaal. Dat was pijnlijk laat: hij was oud en ziek en kon niet meer zelf naar Rome komen. Kardinaal Willebrands is toen namens de paus naar Parijs gereisd om een rol-stoelpatiënt tot kardinaal te creëren. De plechtigheid vond plaats in de Dôme des Invalides, kan het symbolischer? Het was een beeld voor de ziekte die de hele kerk had aangetast. Het was ook een symptoom van een wrange erfenis. Het concilie wilde de ‘free speech’ van theologen stimuleren. Nadien werd die klok teruggedraaid.
Mettepenningen: Dat is inderdaad een erg pijn-lijke evolutie. Het vrijmoedig spreken aïs theoloog is wereldwijd in de verdrukking. Mijn doctoraat ging overde Nederlandsejezuïet Piet Schoonenberg (1911-1999). Ook hij heeft aan het eind van de jaren zeventig last gekregen met Rome. Schoonenberg heeft ooit een schitterend artikel geschreven over de roi van de theoloog. Hij vertrekt van een ‘knielende theologie’. Maar niet knielen ten aanzien van Rome, maar ten aanzien van God. En intussen moet de theoloog aanvaarden dat hij nooit het hèle mysterie kan doorgronden: dat komt alleen God toe. Maar intussen moet de theoloog als gelovige in alle vrijheid kunnen nadenken. Dat is een vorm van juist begrepen ‘nederigheid’, en dat is niet hetzelfde aïs slaafs Rome moeten volgen. Veel theologen die dat de voorbije decennia hebben gedaan, kregen dus problemen: Jacques Dupuis, Hans Kiïng, Leonardo Boff en zo veel anderen. Rome ligt vooral wakker van dejuiste belijdenis van het geloof: ‘Volgen de theologen wel wat wij aïs lijn hebben uitgezet?’ Juist denken is voor Rome veel belangrijker dan goed handelen. Kijk naar het schrijnende voorbeeld van Roger Vangheluwe: Rome zal een bevrijdingstheoloog die verdacht wordt van marxistische inzichten, strenger en sneller bestraffen dan een bisschop die zich bezondigde aan pedoseksuele vergrijpen.
|
|
1938 |
in: De Bruyne, /La collaborationen Belgique/, p.260-261
Né à Châtelineau le 13 janvier 1899, Frère Gérard était entré en religion le 14 décembre 1916. Assez taciturne, austère même, il vivait son idéal sacerdotal. En 1938, le Père Abbé le délégua au couvent des Trappistes en qualité d’aumônier. Cette situation lui permit d’avoir des contacts fréquents avec l’extérieur. Sans avoir été, avant la guerre, un fervent militant de rex, il manifesta envers ce Parti une sympathie assez prononcée. Pendant l’occupation, il fréquenta, à Chimay, toutes les familles rexistes et entretint des rapports fréquents avec le chef local de la Jeunesse légionnaire, Arthur Calvi. Il s’occupait également de membres de la JL rejetés par leur famille.
|
|
1940s |
in: Adler Laure, Dans les pas de Hannah Arendt, éd. Gallimard, 2005
(p.409) /Eichmann/
A Gênes, un moine franciscain lui procure un faux passeport pour l’Argentine où il fait venir deux ans plus tard sa famille.
|
|
1940s |
Le pape Pie XII « savait pour l’Holocauste et s’est tu », affirment les historiens qui ont eu accès aux archives du Vatican
De nouveaux documents que des historiens de l’Eglise allemands ont déterrés au Vatican montrent, selon eux, que le pape Pie XII avait connaissance d’une importante lettre américaine sur les atrocités de l’Holocauste. Le Pape Pie XII, encadré par le cardinal Lienart et le cardinal Gerlier, novembre, 1953 au Vatican. C’est ce que rapporte un groupe de chercheurs rassemblés autour de l’historien Hubert Wolf dans le nouveau numéro de l’hebdomadaire allemand Die Zeit. Tout comme d’autres scientifiques internationaux, l’équipe allemande a, depuis le mois de mars, fouillé dans un certain nombre d’archives qui sont restées longtemps enfermées au Vatican. Plus de 60 ans après sa mort, la controverse sur le « pape de guerre » Pie XII persiste. Le pontificat de l’Italien, né en 1876 sous le nom d’Eugenio Pacelli, s’est déroulé de 1939 à 1958. L’actuel pape François a annoncé la décision d’ouvrir ces archives il y a un an, dans l’espoir que cela permette de laver le nom de l’intéressé des accusations selon lesquelles il ne s’est pas opposé à l’Allemagne nazie dans la persécution des Juifs et l’Holocauste. Début mars, les documents conservés dans les Archives Apostoliques ont été rendus accessibles. Les chercheurs se demandent pourquoi Pie XII n’avait pas protesté plus clairement contre la persécution des Juifs. Les historiens allemands de l’Eglise affirment maintenant, dans Die Zeit, qu’en septembre 1942, ses collaborateurs ont remis une lettre au pape de l’envoyé américain au Vatican, Myron Charles Taylor. Ce courrier fait mention du meurtre des Juifs dans l’Allemagne nazie. Si ce courrier était déjà connu, les chercheurs allemands ont cependant démontré que Pie XII l’avait vu. La lettre mentionne, entre autres, la déportation de centaines de milliers de Juifs vers les camps de concentration allemands, les exécutions de masse et les massacres dans l’est de la Pologne. Le président américain Franklin D. Roosevelt voulait, via cette lettre, informer le pontife et le persuader de protester publiquement. « Ce n’est que maintenant qu’il est évident que le pape a eu un aperçu personnel de la lettre », peut-on lire dans l’article « Le pape, il savait et s’est tu » de Die Zeit.
|
|
1940s |
J. Pirenne (Fléron), Le Pape et la Croatie: la canonisation d’un proche du régime oustachi est jugée plus que malheureuse: insultante, LS 19/10/1999
Ainsi, Stepinac donna de facto sa caution morale à Ante Pavelic pendant la deuxième guerre mondiale, qu’il a laissé torturer sans mot dire, dans son diocèse même, au nom de l’idéologie fasciste, des résistants qui se battaient pour les même raisons que tous les résistants de l’Europe opprimée! Bon nombre des assassins qu’il protégea et dont il cautionna l’action purent fuir en Amérique latine, dès 1945, grâce aux ‘Red Lines’, les filières si sûres qui utilisaient les passe-droits diplomatiques de l’Etat Vatican! Il s’obstina même à convertir par la force et la torture ses ‘frères’ orthodoxes! Après la canonisation éclair de José Maria Escriva de Balaguer; fondateur de l’Opus Dei, ex-chantre de Franco.
|
|
1940s |
A.V., « La Soutane », une vocation forcée, AL 09/11/2007
Son livre « La soutane» sort en librairie. Albin Georges termine la trilogie du petit monde d’Engreux, souvenirs des blessures d’adolescents de la terre. Il était une fois deux abbés. Nous sommes au sortir de la guerre, dans un collège. L’abbé Preud’homme est épanoui dans sa soutane, et l’abbé Lagneau, frustré. Son habit de lumière à lui s’est transformé en chape de plomb. Toute la symbolique est reprise sur la couverture : son rêve eut été de fonder lui aussi une famille; la femme et l’enfant, la blancheur du rêve. «Je raconte mes souvenirs d’adolescent, mes années d’internat au collège. Je n’ai pas voulu que l’on reconnaisse l’établissement. En fait, ce que j’écris, c’est une synthèse de ce que les gens autour de moi m’ont raconté, d’histoires qui sont déroulées dans d’autres collèges aussi», lance le septuagénaire d’Engreux, ex-instituteur, ex-correspondant de presse qu’est Albin-Georges Terrien, qui assure à ceux qui risquent de trouver le récit invraisemblable, que tout y est réel. Devoir de mémoire Au rythme d’un livre tous les quatre ans, l’auteur boucle sa trilogie du petit monde d’Engreux. Après La Glèbe, qui lui a valu le prix Georges Garnir et Vive la guerre, c’est La Soutane qui se sort aujourd’hui en librairie. L’auteur y raconte sans tabous et sans concessions «ces années d’avant l’abolition de l’Index et de la tenue du concile Vatican II, au cours lesquelles une Eglise toute-puissante, héritière de l’Inquisition, tenait sous le joug un peuple d’autant plus crédule que tout manque de soumission était puni du châtiment suprême : l’enfer.
J’ai eu peur des femmes pendant longtemps
Albin Georges se souvient de la censure du courrier… « Les plus délurés, ceux qui avaient une copine, devaient leur écrire en cachette, le directeur avait prévenu, sinon, on était foutu à la porte. Moi, c’est bien simple, j’ai eu peur des femmes pendant longtemps. Elles étaient tellement diabolisées. » … Et des livres à l’index « On ne pouvait pas lire Le fleuve de feu de Mauriac. Je me souviens, deux élèves ont été mis à la porte pour l’avoir lu. Flaubert et Balzac étaient eux aussi à l’index. On ne lisait que des extraits, disons, choisis. Zola, n’en parlons pas, il n’existait tout simplement pas. Inconnu au bataillon! Notre choix était limité, comment dès lors s’ouvrir l’esprit sur le monde ? Dans les dictionnaires, par exemple, il nous fallait prendre la paire de ciseaux et découper des photos sur lesquelles on voyait des seins nus, même dans une œuvre d’art, même la mère qui allaite son enfant. Quoi de plus beau, pourtant Ces images seraient passées quasi inaperçues. La censure créait l’effet contraire, évidemment. On avait l’attention attirée. Il s’agissait là de relents de la sorcellerie car les images découpées, on devait les brûler… avec les ordures. » Un autre livre, dans quatre ans Albin Georges ne rend pas encore les armes. Toujours allergique à l’ordinateur et donc au crayon et en ses cahiers d’écolier, il prépare, pour dans quatre ans, une histoire qui n’a plus rien à voir avec la trilogie du petit monde d’Engreux. Celle de deux couples dont l’un a toutes les chances, et dont l’autre est confronté à la naissance d’un enfant trisomique. C’est finalement ce dernier couple qui va se souder, alors que le premier à qui tout sourit va se fissurer, se lézarder et éclater.
Albin Georges évoque ses souvenirs d’adolescence, au collège. Sans tabous, sans complexes. Sa démarche est celle qui anime les défenseurs du devoir de mémoire, à propos d’une période révolue qu’il n’hésite pas à assimiler à de l’obscurantisme religieux : «II faut rester vigilant cependant, face a une résurgence de l’absolutisme religieux.» Frustration, diabolisation, censure L’abbé Lagneau se rend compte, en famille, que ses neveux et nièces ne viennent pas sur ses genoux à lui. La soutane les rebute. Frustré de sa part de tendresse, il recherche celle-ci auprès de jeunes élèves: «C’est l’un des thèmes du livre. J’ai côtoyé, au pensionnat, la pédophilie» , se rappelle Albin Georges. Un autre thème évoqué est celui de la femme, qui représentait tout simplement le péché, et de l’éveil de la sexualité. « On rentrait en septembre et restait deux mois durant sans sortir du pensionnat. On avait deux jours à la Toussaint, et ainsi de suite pendant toute l’année. Il suffisait qu’un élève double, il avait alors 20 ans! On était coupé du monde. Les plus grands tombaient alors amoureux de plus petits. On avait des dortoirs communs. Il arrivait que des garçons dorment ensemble. Le climat était malsain.» Le troisième thème, c’est la destinée, le drame de Jean. L’histoire d’une vocation forcée par la maman. « La plus grande grâce, dans une famille, souvent nombreuse, surtout pour une maman, c’était qu’un fils devienne prêtre. Je me souviens, on est sorti à huit de primaire et six d’entre nous ont travaillé dès 14 ans. On a connu le cas, le gamin ne voulait pas devenir prêtre, il aimait la musique. Il a obéi pour ne pas déplaire à sa mère. Frustré, il a compensé par la boisson et on l’a trouvé mort à l’âge de 47 ans…» La grande souffrance de ces adolescents Albin Georges aime citer en exemple le film Ainsi soit-il de Manu Bonmariage qui explique l’histoire du Père Jean, qui s’est marié à Champion (Tenneville) il y a peu. Un film dans lequel lui, Albin, joue le rôle du journaliste qui interroge et le Père Jean et Mgr Léonard : « Un seul prêtre sur cinq a la vocation…», y explique le Père Jean. Son témoignage est à l’image de ceux exprimés dans le livre : « Certains, portés avec véhémence, d’autres avec amertume. Ils attestent de la grande souffrance de ces adolescents qui eurent a subir les contraintes d’un règlement impitoyable où toute trace d’humanité et d’affection était bannie », lit-on dans l’avant-propos du livre.
A. V.
La soutane, Albin-Georges Terrien, Memory Press, Erezée, 21
|
|
1940s |
Albin-Georges Terrien, La soutane, Memory Press 2007
Les adolescents qui ont vécu dans un collège catholique des années d’après-guerre, avant l’abolition de l’Index et la tenue du concile Vatican II, pourront témoigner des conditions insoutenables imposées par un clergé professoral maudissant l’image de la féminité et fermé à toute ouverture sur la société moderne. Les Ardenneux Pierre et Victor, le fragile Jean Lhermite, les abbés professeurs plus ou moins asservis à l’implacable hiérarchie et les parents des élèves tenus en laisse se croisent, s’entrecroisent, deviennent les acteurs involontaires d’une véritable tragédie. Après La Glèbe et Vive la guerre, La soutane, qui clôture la trilogie du petit monde d’Engreux, évoque les blessures des adolescents de la terre, après celles de leurs parents, de leurs aïeux, et de tous les paysans du monde, derniers esclaves des temps modernes. Fils et frère de paysans, Albin-Georges Terrien est né en 1934 à Engreux, au cœur de l’Ardenne. Instituteur rural de 1956 à 1986, correspondant de presse, chroniqueur au Sillon belge, il est considéré comme un des meilleurs spécialistes des problèmes économiques et agricoles de sa région. La Glèbe, a obtenu le prix George Garnir décerné par lAcadémie Royale et continue à connaître un vif succès dans toute la Wallonie et le Nord de la France, de même que Vive la guerre pour lequel un projet de traduction en russe est en cours. (p.73) S’il pleut, la promenade sous le préau s’impose. Plus de cent jeunes poulains qui ne demandent qu’à galoper, obligés de vaquer d’un mur à l’autre, comme dans une cour de prison. Et avec des contraintes qui interdisent à un grand de se promener avec un petit. Défense de parler wallon, sous peine de sanctions. Quelle contrainte pour les Ardenneux dont c’est la langue maternelle. Couper les racines vives est un des objectifs majeurs du collège. Treize heures trente. Coup de sifflet, fin des jeux. Court passage à la salle d’études pour emporter livres et cahiers en vue des cours de l’après-midi qui commenceront et finiront comme toujours par une prière. (p.100) Il était le seul professeur de l’établissement à ne jamais utilsier ce terme de mépris en vogue à l’époque : ‘paysan’ ! Ses confrères en usaient, en abusaient à tout propos et hors de propos. Si un élève trébuchait, le professeur l’apostrophait : « Lève tes pieds, paysan ! » ; s’il avait les mains en poche : « Sors les mains de tes poches, paysan ! » Cette injure, synonyme de lourdaud, de maladroit, de malappris, était particulièrement humiliante pour les fils d’agriculteurs qui la ressentaient comme une insulte à la profession de leurs parents. (p.105) Tout le monde sait que le jour où un barrage vient à céder, la masse d’eau contenue cause des ravages d’autant plus importants que la retenue des flots aura été longue.
(p.108) A propos de l’Index, qui scandalisait les amateurs de litérature, il / = l’abbé Lagneau/ expliquait : – L’Index est le catalogue officiel des livres interdits aux catholiques. (p.129) Au sujet de Villon déjà, mais surtout de Montaigne et plus encore de Rabelais, Paternoster avertit ses élèves. — Dans le souci de vous inculquer une bonne culture générale, je ne puis passer sous silence quelques extraits de ces grands écrivains, mais je vous préviens d’emblée : il vous est interdit de lire leurs livres qui figurent à l’Index. Ces écrivains, grands par le talent, ont été animés par une âme basse. Dans le meilleur des cas, si je puis dire, ils ignoraient la foi. Mais beaucoup d’entre eux s’en sont pris à Dieu et à ses saints, à l’Église et à ses ministres, ce qui est un blasphème abominable qui les a conduits à la damnation éternelle. Paternoster prit alors un dossier sur le coin de son bureau et énonça une liste d’immenses artistes, penseurs et philosophes mis à l’index par les censeurs du Vatican, parmi lesquels ont retrouvait Rabelais, Montaigne, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade, Lamartine, Sand, Balzac, Hugo, Flaubert, Baudelaire, Dumas père et fils, Zola, Maeterlinck, Renan, Gide, Sartre, Machiavel, Spinoza, Fénelon (un évêque pourtant!), Sainte-Beuve, Lamennais et des centaines d’autres. Il déposa la liste maudite sur le coin de son bureau et poursuivit : — Qu’arrive-t-il à celui qui lit un de ces livres ? — Il commet un péché mortel, répondit Arille, à peine remis de ses blessures au fondement, et cependant dispos à se lever et à se rasseoir très vite pour abonder dans le sens du professeur. Très bien, Lechanteur. Non seulement, il commet un péché mortel, mais en plus il est excommunié. Et qu’est-ce que cela signifie, être excommunié ? Cela veut dire être retranché de la communion des fidèles. Un chrétien qui lit un de ces livres est privé du droit de recevoir les sacrements. S’il ne se repent pas et que son curé en a connaissance, il ne pourra non seulement avoir des funérailles religieuses, mais de plus ne pourra être enterré en terre bénite.
(p.135) Face à la cohue qui courraient dans tous les sens, (…).
(p.177) Pour le compte de la direction, ils exerçaient deux types de surveillance : l’une visible et officielle dans les dortoirs, à l’étude, au réfectoire, à la cour de récréation, en promenade. L’autre, plus sournoise, quadrillait les recoins et autres lieux moins éclairés. Invisibles rapaces enveloppés dans leur noire soutane, tapis dans l’ombre, ils étaient perpétuellement en quête d’un délit mineur ou d’une conversation subversive. Au début de chaque année scolaire, le directeur invitait les élèves à repasser par la chapelle après le souper pour y faire une courte méditation. Un bon tiers des élèves environ répondait à ce souhait. Comme professeur de religion, l’abbé Lagneau, pratiquement chaque soir, allait s’embusquer dans la galerie supérieure. De là, il tenait une comptabilité précise des étudiants venant se recueillir. Ceux-ci recevaient un bonus à leur examen de religion et à l’appréciation de leurs points de conduite, tandis que les absents étaient pénalisés. Krémer se rendait-il compte de l’aspect nauséabond de cette délation érigée en système? Il la justifiait ainsi : — Le règlement est la colonne vertébrale du système d’éducation qui fait notre réputation. Tout élève qui commet la moindre effraction à ce règlement ébrèche un tant soit peu cette colonne.Que les professeurs, les surveillants ou moi-même fassions preuve de laxisme et, petit à petit, cette colonne va se lézarder, s’effriter pour bientôt s’écrouler, réduisant ainsi en cendres tout notre système éducationnel. Il est donc du devoir de chacun d’entre vous de montrer du doigt tout condisciple qui contreviendrait peu ou prou à ce règlement. Soyez sans crainte, vos supérieurs ne dévoileront aucun nom, et jamais ils ne vous feront grief d’avoir dénoncé un condisciple. Bien au contraire, ils vous sauront gré d’avoir contribué à préserver la bonne réputation de votre établissement. Rappelez-vous souvent les paroles du Christ : « Qui n’est pas avec moi est contre moi. »
(p.179) Un observateur extérieur à l’établissement, face à des conditions de vie aussi inhumaines, à cette entreprise systématique de dépersonnalisation propres à toutes les unités d’élite de toutes les armées du monde, ne manquerait pas de se poser la question : « Mais comment ces collégiens pouvaient-ils accepter un tel régime ? » L’explication est assez simple. Pour la plupart d’origine modeste et issus de milieux chrétiens, ces jeunes avaient appris très tôt à incliner le front et à baisser les yeux face à tous les détenteurs de l’autorité : le maître d’école, le curé, le comte, le notaire, quiconque détenait une parcelle d’autorité si infime soit-elle. L’obéissance et l’humilité faisaient partie de leur nature, tout comme le mysticisme entretenu par les innombrables cérémonies religieuses. Ils marchaient donc, intégrés à un troupeau docile, pendant toutes leurs humanités, sur la voie tracée par le directeur. Si l’un d’eux, exceptionnellement, osait ruer dans les brancards, il était aussitôt cassé d’une manière spectaculaire et exclu du système, taché de honte et de déshonneur et désavoué par sa famille.
(p.182) Entre les lits, pas de paravents ni de séparations fixes. Chaque élève s’y trouvait, par le fait du silence absolu et de la vigilance du pion, aussi seul que dans une cellule de prison ou de moine, car là aussi, il était formellement interdit de communiquer. Ainsi les élèves, dans la peau de parfaits nombrilistes par la force des choses, s’endormaient sans se dire bonsoir, s’éveillaient sans se dire bonjour, sans se préoccuper de qui que ce soit, comme si la société des autres n’existait pas. Un chauffage central était installé depuis 1’entre-deux-guerres : radiateurs de fonte à débit plus que limité. Par exemple, l’eau chaude n’était pas puisée jusqu’aux dortoirs. La salle d’études et les classes étaient à peine tiédies de sorte que l’hiver, les élèves y conservaient leur écharpe. La bise venue, la chapelle se transformait en glacière; les élèves assistaient aux offices recroquevillés dans leur manteau.
La nourriture saine et abondante promise dans les prospectus était dispensée en quantité parcimonieuse. La margarine y remplaçait le beurre, chaque ravier de cet ersatz étant divisé en huit parts égales par le couteau du chef de table. Quatre tranches de pain blanc, insipide, par élève au déjeuner et au goûter avec ravier de confiture ou de sirop, partagé lui aussi. La sauce brune, toujours la même, ne tachait pas les vêtements : elle ne contenait pas de graisse. Le même menu fait de pommes de terre cuites à l’eau, d’un légume et de carbonades revenait inlassablement. Jamais de friture, ni de pâtes, ni de cacao, ni de sauces un peu relevées. Malgré cela, durant les six années d’humanités, ces internes y grandissaient, s’y développaient, s’y fortifiaient. Les appoints fournis par les parents lors des congés ou des visites, n’y étaient sans doute pas étrangers. Par-dessus tout cela, le silence, presque partout, presque toujours. Des jeunes qui marchent, travaillent, écoutent, se couchent, se lèvent dans le plus total des silences, qui parlent à voix basse et rarement. Comment ces jeunes, inhibés, déshabitués du monde extérieur, complexés vis-à-vis des gens libres, moroses au lieu d’être joyeux, modérés au lieu d’être excessifs – ce qui aurait été normal à leur âge -, bridés dans leurs élans, cassés dans leur dynamisme, allaient-ils pouvoir s’intégrer dans un monde mouvant qu’ils ne connaissent pas ou plus ? (p.183) Des drames se préparaient ainsi au collège avec la peur de la vie, de la femme, de l’amour, avec des préjugés et des principes rigides qui conduisaient certains à l’extrémisme ou au désespoir. Quant à la psychologie, il fallait éviter de l’évoquer auprès de l’abbé Krémer qui répondait invariablement : — La psychologie? C’est tout simple : je décide, j’ordonne. Vous exécutez et vous vous taisez, un point c’est tout. Et si vous n’êtes pas contents, faites vos valises !
(p.211) Jusqu’alors, dans les régions rurales surtout, l’enseignement libre possédait un quasi monopole en ce qui concerne l’enseignement secondaire et supérieur. Mais dès après la guerre, on vit des écoles de l’État s’ériger dans différents bourgs et petites villes. L’école libre devait maintenant faire face à la concurrence, ce qui était inédit pour elle.
(p.216) Depuis quand la délation était-elle en usage au collège ? Sans doute existait-elle avant l’arrivée de l’abbé Krémer. Mais dès que celui-ci fut en charge de la direction de l’école, il l’avait érigée en système. Il y revenait régulièrement dans les méditations qui suivaient la prière du matin. Il utilisait toujours la même comparaison de la pomme pourrie. (p.217) A ce sujet, l’abbé Preud’homme ne partageait nullement l’attitude de ses confrères. Il avait en horreur ce climat de délation dans lequel baignait l’établissement. Le régime nazi était trop proche encore, où les enfants allaient jusqu’à dénoncer leurs parents, pour que cette attitude du directeur et de ses subordonnés ne lui donne pas des haut-le-coeur.
(p.236) Sur la bonne centaine d’élèves que comptait le collège, on peut estimer que nonante étaient de parfaits agneaux, ayant perdu toute personnalité, subissant sans regimber les directives, diktats et autres interdictions des professeurs et de l’impitoyable Krémer. Une dizaine seulement, que le directeur et ses adjoints n’étaient par encore parvenus à mettre au pas, n’acceptaient pas cette discipline aveugle. Ils râlaient, mais intérieurement seulement, sous peine de se faire renvoyer. Les Ardenneux en faisaient partie. Le directeur et les professeurs n’étaient pas dupes. Ils connaissaient les fortes têtes, régulièrement sanctionnées par leur cote en conduite. Alors que les agneaux obtenaient ou frôlaient le maximum de 10/10, les insoumis flirtaient souvent avec le 5/10, mais se retrouvaient quelquefois avec un zéro pointé pour quelque peccadille. Comme ces points étaient comptabilisés pour les bulletins de Noël et de fin d’année, les agneaux partaient avec plusieurs longueurs d’avance sur les contestataires.
(p.274) Les comportements équivoques de l’abbé Lagneau ne représentaient que de légères déviances en regard des agissements de certains religieux qui sévissaient dans l’un ou l’autre collège. Ce n’est que plus tard, bien plus tard que les langues se délieraient et que, par la presse, le grand public allait apprendre les souffrances de ces petits malheureux. Personne, dans les internats concernés, n’était au courant de ces pratiques perverses. Personne, sauf les victimes bien évidemment. Des témoins l’eussent-ils appris qu’ils auraient jeté le manteau de Noé sur ces turpitudes : la réputation du collège ne pouvait être entachée. Quant aux jeunes garçons traumatisés par ce que l’on allait qualifier plus tard de pédophilie, ils n’osaient en parler à personne, même pas à leur meilleur ami. Ils étaient seuls à porter le poids de l’ignominie. Jamais ils n’auraient osé se confier à leurs parents lors de leur retour en congé. En admettant qu’ils fussent parvenus à surmonter la honte et le sentiment de culpabilité qu’ils éprouvaient, ils se seraient heurtés à l’incrédulité de leur famille qui vénérait l’Église et ses serviteurs. Et puis, comme les prédateurs des pensionnats s’attaquaient aux plus doux, aux plus timides, aux plus soumis des collégiens, il leur était aisé de faire croire à leurs proies que le traitement qu’ils leur infligeaient était destiné à les rendre meilleurs, à les rapprocher du Ciel et de tous ses anges aux ailes blanches et aux lèvres avides de tendresse.
(p.299) la délation étant érigée en système et récompensée par des points supplémentaires en conduite.
(p.310) A première vue, Pierre aurait dû se sentir soulagé d’être mis à la porte de ce bagne. Mais il n’en était rien. D’abord, il serait séparé de son ami Victor, de ses copains footballeurs, de son professeur Preud’homme. Ensuite et par-dessus tout, l’idée de devoir affronter ses parents et leur immense déception, eux qui pendant presque deux ans, s’étaient saignés aux quatre veines pour le placer à Tarbe. Tout cela pour aboutir à une expulsion humiliante et radicale, car Pierre le savait, Krémer userait de tout son pouvoir pour l’empêcher d’être admis dans un autre établissement catholique et n’hésiterait pas pour cela à l’accabler de tous les péchés du monde.
(p.350) Et Galderoux éprouvait une terreur indicible de l’enfer. La même terreur que tous ses condisciples, que tous les habitants de son village, de sa commune, de sa province, de son pays. La même terreur que les habitants des régions où l’Église s’était implantée, et ne parlait pas de Dieu, mais du « Bon Dieu ». « Dieu est amour » répétaient à longueur de sermons les curés et toute leur hiérarchie. Mais ce « Bon Dieu » noyait la terre entière sous un déluge impitoyable, faisait tomber le feu du Ciel sur les villes impies, y foudroyant les innocents comme les luxurieux. Ce « Bon Dieu » dont on devine qu’au jugement dernier, « dies irae, dies illa » (Jour de colère, jour de vengeance), il séparera les brebis des boucs, envoyant ceux-ci aux flammes éternelles, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un « Bon Dieu » qui rejette de son paradis tous les petits innocents de quelques jours morts sans baptême, sourd au désespoir des parents qui avaient pourtant l’intention de faire baptiser leur petiot, qui choisira ses élus parmi les membres de la « vraie Eglise » uniquement, c’est-à-dire l’Église catholique romaine, rejetant d’office tous les autres dans les ténèbres extérieures : protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, païens… Sans doute les plus grands esprits des différentes époques partageaient-ils cette crainte : Racine qui, à la fin de sa vie, ne voudra plus écrire que des tragédies à sujets religieux; Luther qui, malgré son combat juste et courageux contre les abus de l’Église en matière d’indulgences, redoutait de plus en plus les affres de la mort et du jugement de Dieu à mesure qu’il avançait en âge; Michel-Ange (…) vivra ses dernières années dans une angoisse croissante, toujours dans cette tereur du jugement particulier. Nous n’en citons que trois, mais la liste est immense de ces grands esprits qui ont traîné, pendant toute leur existence, comme un bolet, cette peur du jugement et de l’enfer, boulet de plus en plus lourd à mesure que la mort approchait.
|
|
1949 |
in: Groupe Qualité Village, Orgeo, 1980
Mars 1949 – Les jeunes filles d’Orgeo en ont assez
Le petit village d’Orgeo repose sur les rives de la Vierre et n’a que le glou-glou de ce ruisseau comme distraction le dimanche. Cependant, quelques sociétés se préoccupent du divertissement de la jeunesse. Football, dramatique, anciens combattants, vélo-club et les pêcheurs de la Vierre. Malgré cela, il n’y a pas foule d’amusements. Un groupe de jeunes filles éplorées nous écrit à ce sujet. Les jeunes gens ne participent pas aux délassements du village et les jeunes Orgeotoises font « tapisseries ». Voici un passage de leur lettre : « Si Monsieur « Untel » se dévoue et se dépense à tout instant pour mettre une fête sur pied, ses éléments lui tournent le dos lorsqu’il y a lieu de payer une maigre cotisation ou un droit d’entrée. Et vous, Messieurs les organisateurs des Combattants, qu’aviez-vous à votre bal de dimanche dernier ? A peine une bonne trentaine de jeunes filles et quelques jeunes gens étrangers. Nous autres, jeunes filles l’avons remarqué et nos réflexions étaient amères. Nous sommes franchement mécontentes; les jeunes gens d’Orgeo nous abandonnent pour aller porter leurs amours à des étrangères. Pourtant, nous ne les avons pas oubliés lorsqu’ils étaient dans le besoin. Quel travail nous avons eu pour les colis du prisonnier. Il fallait collecter, fabriquer des paquets, se dévouer sans arrêt pour faire parvenir, Messieurs, ces colis qui vous faisaient tant plaisir dans les stalags. Avez-vous déjà oublié ? Nous autres, jeunes filles d’Orgeo, nous y pensons toujours. Allons, de grâce, faites nous danser. Manifestez un peu de tendresse que diable ! Ce que nous avons fait pour vous était fait de grand cœur. Un groupe de jeunes filles d’Orgeo». Nous n’avons pas hésité à ouvrir les colonnes de notre journal à un appel aussi touchant. Vraiment, Messieurs d’Orgeo, vous êtes sans excuses, pensez un peu ! Vos charmantes compagnes doivent faire appel à la presse pour attirer votre attention. Pareille invitation à la danse ne pourrait être plus directe; c’est presque une mise en demeure. Le printemps arrive. Espérons que les bords de la Vierre retentiront bientôt de rire joyeux des couples Orgeotois et que toute ombre de souci quittera à jamais les belles jeunes filles du pays de Neuf château. Suite à l’article précédent, certes, ces jeunes filles ont eu raison de proclamer leur mécontentement, mais si elles avaient vécu en 1894, qu’auraient-elles pu revendiquer ? Voyons plutôt ! Le 1er juilet 1969, le journal « L’Avenir du Luxembourg » fêtait son 75ème anniversaire. A cette occasion, il reproduisait plusieurs articles de l’époque (1894). En voici un: « On danse à la fête…si Mr le curé le permet ». La salle de danse se trouve dans une petite chambre sans plafond, aux poutres noires de fumées. Les paysannes aux formes massives ont chaussé leurs lourds sabots et mis leur tablier noir. Les jeunes gens crient, fument, ôtent leur blouse s’ils ont trop chaud et dansent bravement, la poitrine découverte. |
|
1950s |
in: Michel Wavreille, Si la Géronne me racontait …, Ebly 1991
(p.297) La montée du libéralisme à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle ne fait pas que des heureux, spécialement dans nos petits villages où les curés détiennent le monopole de la conduite des esprits. Ils ne tolèrent pas que leurs ouailles ne suivent pas à la lettre leurs recommandations et s’écartent ainsi des chemins rigoureux de la foi catholique. Les annotations prises dans le Liber Memorialis (notees prises par l’abbé Arnould) témoignent de ce souci constant de maintenir fermement, contre vents et marées, l’esprit chrétien au sein de la population : – « 9 communiandi (personnes en âge de communier) n’ont pas fait leur pâques en 1908″ ; – « Ebly ne possède plus d’école catholique, mais deux écoles mixtes ; les deux instituteurs font partie de l’Association des Instituteurs chrétiens » ; – « le 15 octobre 1911, nous avons eu des élections communales qui ont éliminé du conseil, et à plus de 40 voix, les sieurs Jullien Arthur et Lecomte Henri ; les quatre candidats catholiques ont été élus » ; – « je fus moins heureux dans mes efforts pour la réforme scolaire. Après avoir fait nommer à Ebly un instituteur chrétien et modèle, j’ai dû renoncer à faire la séparation des sexes » ; – « en 1910, pour la préparation du devoir pascal, une mission fut donnée (…) elle eut un plein succès. Une dure épreuve ne me permit pas de compter les abstentions, qui vraisemblablement furent au nombre de deux ». A certains moments, les passions peuvent s’exacerber. Ce fut le cas après l’échec de Félix Jullien aux élections communales de 1884. Paradoxe que cette défaite dans le contexte de la victoire libérale au niveau national ! Serait-elle par conséquent due plus spécifiquement à l’homme ? Ou à cause du système électoral ca-pacitaire qui supplante en 1884 le système censitaire ? Ou à la grogne générale de cette époque : dépression, surproduction, baisse des prix et des salaires ? Ou bien la communauté villageoise catholique, soutenue à bras-le-corps par le clergé local, a-t-elle fait bloc face à l’anticléricalisme en progrès ? Quoi qu’il en soit, il semble bien que Félix Jullien ne digère pas facilement le revers subi. Atteinte a moral, mais surtout à l’amour-propre ! Il n’aura de cesse dès lors de chicaner à propos de quel ques dossiers relatifs à la paroisse. En voici un exemple : « l’affaire du jubé ».
L’affaire du jubé
Ce litige somme toute mesquin et futile s’inscrit bien dans le climat passionnel de cette époque. Le décor théâtral s’installe. Le jubé récemment réaffecté dans l’église en est la pièce maîtresse. Les protagonistes s’avancent : le curé qui par souci de piété en a interdit l’accès. Félix Jullien qui ne l’entend pas de cette oreille. Premier acte : Jullien écrit au Gouverneur, en posant ses griefs : « A Monsieur le Gouverneur de la Province a Luxembourg, Le soussigné Jullien Félix prend la respectueux liberté, en ma qualité d’ancien bourgmestre, de vous exposer l’état des choses suivant : il s’est fait en 1884 sous mon administration une adjudication de travaux de réparation à l’église d’Ebly. La réception de ces travaux vient d’avoir lieu ; parmi ceux-ci figure l’établissement d’u jubé. Il a été reconnu que l’église était trop petite pour la population de la paroisse et c’e. uniquement et spécialement pour servir d’agrandissement de l’église que l’administration communale s’est décidée à ajouter au travaux la construction d’un jubé dot jusqu’alors l’église était dépourvue. Or il se fait que le desservant de la paroisse ne tenant ni compte de la destination expresse du jubé prédésigné, n’ayant pas même l’assentiment duConseil de Fabrique, vient défaire placer de sonpropre chef un système de barrière dont il tient la clef et qui rend impossible l’accès au jubé. Acause de cet acte arbitraire et vexatoire, u grand nombre de paroissiens ne peuvent trouve place dans les bancs et sont obligés de rester debout dans le fond de l’église durant les offices ou ce qui arrive souvent en plein air, cependant l’église dont la porte d’entrée est absolument exposée à la pluie n’a ni porche ni parvis (…) » Deuxième acte : la réponse du Conseil de Fabrique qui, unaniment, prend fait et cause pour son curé, contestant point par point les motifs avancés par Félix Jullien : (p.298) « Monsieur le Gouverneur, La plainte du sieur Juîlien Félix, ex-bourgmestre de Juseret, est une triste chicane et une audacieuse fausseté. Personne n’ignore que le dit Jullien ne sait pas digérer sa défaite d’il y a trois ans ; tout le monde doit en pâtir, surtout le desservant d’Ebly. Il y avait un ancien jubé, malgré l’assertion contraire du sieur Juîlien. L’église a toujours été reconnue comme suffisamment grande, et le nouveau jubé a permis même d’ajouter quatre bancs nouveaux aux bancs existants. Il est de notoriété publique que si on voulait monter plus haut dans l’église et occuper les bancs inoccupés qui sont nombreux, ne pas rester dans le fond du temple ou même en plein air, clore la porte, le bon ordre et la piété y gagneraient. Mais le sieur Juîlien et ses adhérents (en moyenne chaque dimanche seulement à la grand-messe de huit à dix) ne le veulent pas. Il faut monter au jubé, malgré le curé. Là peu ou pas de prières, on s’asseyait sur le plancher, on s’adossait contre la muraille, on s’appuyait sur la balustrade, on chiquait, on crachait. Etait-ce tolérable ? Le curé a fait clôturer, à ses frais, l’entrée du jubé. Jamais on n’a pensé, en reconstruisant le jubé, à l’agrandissement de l’église. Il a été reconstruit pour les chantres. L’ancien servait au même usage. Lorsque les circonstances le permettront, ils iront réoccuper leurs anciennes places, mais auparavant nous avons besoin d’un bon règlement (…) Après l’époque « Juîlien », la forte personnalité du curé Arnould continuera à s’attaquer à tout ce qui s’oppose à l’Eglise. Il n’aura de cesse à pourfendre, même du haut de la Chaire de Vérité, les libéraux de Neufchâteau, dont notamment quelques bourgeois bien en vue dans cette cité teintée de libéralisme. Excessif, il se laissera aller à certains débordements et, poussant le bouchon un peu trop loin, s’attirera finalement des ennuis qui l’amèneront devant la Justice. Le calme reviendra par après, en même temps qu’un climat plus serein et tolérant au sein du clergé. Le bon sens entreprit alors une tranquille reconquête. |
|
1950s |
René Dislaire, Degrelle et Cardijn : à quelles dérives l’éloquence peut-elle mener ?, in : Ardenne Web magazine, 39, 03/2011, p.31
On m’a conduit, adolescent, écouter et applaudir Monseigneur Cardijn au Patton, à Bastogne. (…) Je réentends (…) la phrase top du discours, la phrase de fonds de commerce du subjuguant apôtre : « Devenez prêtre parce que Dieu a besoin de vous comme instrument de la justice sociale : une famille qui ne compte pas un prêtre en son sein est une famille insignifiante pour Dieu et pour les hommes. »
|
|
1950s |
14/01/2004 : témoignages de Maurice Geuzaine et de Rita Georges : L’abbé Leboutte (de Bastogne), curé à Boeur, avait conservé une machine appartenant au cordonnier Julot Cremer de Hardigny, peu après la guerre. Cette machine avait été cachée dans sa cure. Après les hostilités, le curé ne voulut pas la lui rendre et la revendit …
l’abbé Schartz qui, seul, commandait et consommait avec excès du vin assez cher lors d’une communion solennelle (celle de Josy Geuzaine ?) l’abbé Jacques était venu rechercher ‘sa’ bouteille de Cabernet-Sauvignon devant nous lors de la soirée de la communion solennelle d’Anne-Lise Cremer sans la partager…
|
|
1970s |
Johan Viroux (Li Banbwès / Bambois (Fosse / Fosses-la-Ville)),
L’ Èglîje m’ a displaît quand, dispôy èfant, dj’ a vèyu :
(a) l’ sabotadje pa dès curés do walon (li cia d’ Sint-Djuraud, li dwèyin d’ Fosse, 2 curés au Banbwès, (b) li distrûjadje di l’ en-d’dins d’ l’ èglîje do Banbwès pau curé d’ adon (tot ç’ qui lès djins do viladje î inmin.n bin a stî tapé au …diâle), (c) qui l’ èvèché ‘dèpôrteûve’ dès bons curés (tot près dès p’titès djins come lès-abés socialisses (oyi, dès vraîs!) Pier(r)ard èt Cornet (co dins m’ viladje) adon qu’ ça toûrneûve bin.
|
|
1976 |
in: DS, 15/03/2013
Gefolterde jezuïeten Verbitsky tekende net verhaal op van Orlando Yorio en Francisco Yalics, twee jezuïeten die op 23 mei 1976 gekidnapt werden in de arme buurt Bajo Flores. Beiden stonden onder supervisie van Bergoglio, destijds provinciaal van zijn orde. Yorio en Yalics werden overgebracht naar de Escuela Mecânica (‘Esma’), een vandaag tot gedenkteken verbouwde school van de marine op de oevers van de Rio de la Plata. Daar werden ze gefolterd en zaten zevijfmaanden vast. Uit Verbitsky’s research blijkt dat Yorio en Yalics één week voor hun ontvoering van hun pastorale opdracht ontlast waren. Met de maatregel gaf de katholieke kerk destijds niet enkel te kennen dat de religieuzen uit de gratie waren wegens subversief en revolutionair, het zou ook het discrete signaal zijn geweest dat de militairen hun gang mochten gaan. Yorio en Yalics kwamen later vrij en vertrokken in ballingschap. Maar ze hielden vol en Yorio verklaarde in een eerste proces in 1985 dat Jorge Mario Bergoglio en de kerk hen « gediaboliseerd » hadden en dus ook « aan de militairen uitgeleverd ». « Ik ben er zeker van », zei Yorio aan de rechter, « dat hij een lijst met namen aan de marine heeft doorgespeeld. » In zijn autobiografie El Jesuita (‘De jezuïet’), uit 2005, spreekt Jorge Mario Bergoglio die versie tegen en stelt hij, integendeel, dat hij het mogelijke deed om beide geestelijken te beschermen. Het gevolg was dat hij nieuwe reacties uitlokte en dat bijkomende getuigen de kardinaal in een onfris daglicht stelden. Bergoglio was destijds een favoriet voor het pausschap maar liet zelf blijken daar geen zin in te hebben. De kwestie van de verdwenen jezuï-eten zou daarin een roi gespeeld hebben. Geen uitzondering In hun pas verschenen boek Het gedroomde land. Reis naar het hart van Argentinië (De Bezige Bij) schrijven de Nederlandse journalisten Vera Keur en Theo van Stegeren dat Bergoglio hoe dan ook « een man met een vloeibare identiteit » is. « Hij spreekt veel over zijn medeleven met de armen en gebruikt het openbaar vervoer en niet de limousine met chauffeur waarop hij recht heeft. (…) Maar toen de (progressieve en geëngageerde, ld)bisschoppen Angelelli en Ponce de León vermoord werden, hield deze jezuïet zijnmond. » Aan de telefon vanuit Argentinië zegt Van Stegeren dat « Bergoglio als provinciaal van de jezuïeten de kant van de junta opkeek, niet die van het volk. Namens de jezuïtische universiteit schonk hij in november 1977 zelfs een eredoctorat aan juntalid generaal Emilio Massera. Hoewel Bergoglio toen niet op het podium stond, was hij applaudisserend getuige van Massera’s redevoering. In zijn vertoog had de generaal het onder meer over e jeugd als zwakke plek, waarlangs onvaderlandse verdorvenheid en decadentie Argentinië insijpelden. « Iedereen wist het », schrijven Keur en Van Stegeren, « uit Massera’s mond legtimeerde dit mateling en moord. »
Of er is het uitvoerig gedocumenteerde feit van de in gevangenschap geboren baby’s van opposanten. De baby’s werden voor adoptie afgestaan aan kinderloze echtparen uit de militaire kaste. Van Stegeren: « Op basis van wat Verbitsky ons vertelde, stapten de nabestaanden van de verdwenen of vermoorde ouders met hun klachten en vragen over de adopties naar Bergoglio. Maar hij bleef tôt 1990 ontkennen dat hij iets van die babyverdwijningen wist Volgens Verbitsky wist hij dat wél – en loog hij. » Van Stegeren en Keur « schatten Verbitsky’s journalistieke werk over de Argentijnse kerk erg hoog » maar vonden « geen andere bewijsstukken dan de zijne » in de zaken-Yorio en Yalics – reden waarom ze daar niet over berichtten in hun werk. « Je mag ook niet vergeten », beklemtoont Van Stegeren, « dat Jorge Bergoglio weliswaar een belangrijk vertegenwoordiger van het kerkelijke establishment was, maar geenszins een uitzondering. Kijk maar naar kardinaal Primatesta, die een actieve medewerker was van de dictatuur. De uiterst conservatieve Argentijnse kerk heeft het regime niet alleen gelegitimeerd, maar deelde de katholieke culturele agenda van de junta en heeft daar mede richting aan gegeven. » Historici zeggen dat als de kerk tijdig afstand genomen had van de junta, zoals in Brazilië en Chili was gebeurd, ze haar zou hebben verzwakt. Maar de Argentijnse katholieke hierarchie deed net het omgekeerde. Ze was op de hoogte van de folteringen en verdwijningen, maar in naam van een soort nationaal-katholicisme en van de strijd tegen het ‘goddeloze’ communisme – en omdat ze de moderniseringen na het concilie van Vaticaan II nooit verteerd had – koos ze de zijde van Massera en diens kompaan generaal Videla.
|
|
1979 |
religion et jacobinisme : un paradoxe Pierri ZIND, Elsass-Lothringen, une nation interdite, 1870-1940, Copernic, Paris, 1979 Division de l’ Alsace-Lorraine en 3 départements à partir de 1919. “Ainsi se trouvait le voeu de l’ abbé Wetterlé en 1915:
(p.146) Nous voulons que l’ Alsace-Lorraine disparaisse pour se transformer en 3 départements qui ne se distingueront en aucune manière des 86 autres.”
(p.388-390) dans les années 20
“L’étude d’ensemble de l’attitude nationaliste des évêques face aux revendications ethniques, tant dans les colonies que dans les états européens, reste à faire.” A cette époque, l’ évêque de Bruges condamnait les autonomistes flamands, l’évêque de Quimper, les autonomistes bretons, et l’ évêque de Strasbourg les autonomistes alsaciens-lorrains. Ils semblaient confondre leurs propres conceptions politico-religieuses avec l’Eglise, sans /’ocendre ce’ ?/ (incompréh.) , tout au moins en France, du jacobinisme anti-chrétien et païen qui divisait les catholiques sur l’autonomie et qui véhiculait un “état d’ âme non catholique”.
|
|
1980s |
(Claudia Viroux) I gn-a ieû cès-anéyes-là on curé pèdofile à Fosse (Fosses-la-Ville). Après dès plintes, on l’ a simplèmint transfèré dins one ôte parotche, à Chaltin (Schaltin)…
|
|
1980s |
Chartier Claire, Voyage à l’intérieur de l’Opus Dei, Le Vif 12/10/2007, p.37
Le livre d’une ex-fidèle décrit les coulisses de cette organisation catholique très conservatrice. Et dérange son goût du secret. Pas une image pieuse, pas un crucifix qui traîne : rien, dans le salon jonché de jouets, ne laisse deviner le passé de sa propriétaire. Et pourtant. Véronique Duborgel, 45 ans, neuf enfants et un ex-mari, a passé treize ans (1983-1996) à l’Opus Dei, l’une des institutions les plus conservatrices et les plus secrètes du monde catholique. Treize ans de trop. Cette femme fluette et souriante, assistante maternelle de profession, livre aujourd’hui un témoignage unique – Dans l’enfer de l’Opus Dei, Albin Michel -où elle dépeint une organisation insensible, misogyne et sectaire. Genève, début des années 1980. Véronique, 20 ans, étudiante en géographie, croit trouver sa boussole en la personne d’un prof de maths avec lequel elle se fiance. Il est de l’Opus, elle l’ignore. Un jeune Après treize ans à l’Opus Dei, Véronique Duborgel a choisi de témoigner. homme croisé à la messe invite le couple à dîner. « J’étais la seule femme, raconte-t-elle. La discussion est venue sur l’Œuvre, mais personne n’a semblé particulièrement connaître le sujet. » Elle apprendra plus tard que tous les convives appartenaient à l’organisation. A la demande de son futur époux, Véronique fréquente un centre culturel pour jeunes filles, à Genève, puis suit des cours de doctrine. Ce n’est qu’en 1983, au cours d’un voyage à Rome – en réalité à l’Univ, le rassemblement annuel des « opusiens » – qu’elle entend ouvertement parler de l’institution. « Tout le monde est très sympathique, une fille se lie avec vous, vous lui faites des confidences. Très vite, on ne vous parle plus que d’appel à la sainteté. Je me suis dit : pourquoi pas ? » La jeune femme rédige sa lettre de candidature et intègre l’Opus comme surnuméraire, l’échelon le moins contraignant. Elle doit tout de même prier et méditer quarante minutes par jour, se rendre à une discussion hebdomadaire et s’entretenir tous les quinze jours avec une directrice spirituelle imposée… « J’avais beau répéter que je n’étais pas sûre de ma vocation, ma directrice me répondait : si tu as des doutes, c’est que tu as la foi ! » Pour avoir croisé les jambes à la messe, Véronique découvre la « correction fraternelle » : un membre dénonce la fautive à la directrice spirituelle, qui charge ce même membre ou une tierce personne de réprimander la coupable. Laquelle doit remercier sa sœur de l’avoir « amicalement » tancée. Enfin, celle qui a été chargée du rappel à l’ordre remercie à son tour la directrice de l’avoir choisie. « L’Opus ne m’empêchait pas de partir, mais je ne me sentais pas assez forte », reconnaît Véronique Duborgel. Il suffisait d’attendre. •
300 membres en Belgique Le récit d’une «femme en souffrance » qui refait l’histoire «à sa façon «.C’est ainsi que l’Opus Dei qualifie le livre de Véronique Duborgel. Quelques jours avant sa publication, l’organisation ultracatholique, fondée en 1928 par le prêtre espagnol José Maria Escriva de Balaguer, a tout de même pris soin d’organiser une rencontre avec des journalistes. Au menu:le cinquième anniversaire de la canonisation de son fondateur, mais aussi une réponse au brûlot à venir. L’institution compte 85 ooo membres dans le monde-300 en Belgique-dont une faible proportion de prêtres (i 900). Les laïques, majoritairement issus de l’élite intellectuelle, sont à 75% surnuméraires -mariés et investis dans la vie active – et à 25% numéraires -célibataires, voués totalement à l’Œuvre. Depuis Da Vinci code, où elle est dépeinte comme une confrérie de tueurs en robe de bure, l’organisation multiplie les «journées portes ouvertes».
|
|
1993 |
in: Manuel Abramowicz, Extrême-droite et antisémitisme en Belgique, De 1945 à nos jours, EVO 1993
Préface
Comment cela a-t-il été possible ? la réponse fondamentale tient au problème du mal. Cela nous dépasse. Mais en même temps, il y a une réponse claire et nette : les gens au cœur droit n’ont pas réagi d’une manière adéquate aux premières insultes et aux premières attaques contre le peuple juif, à une époque où le nazisme commençait à s’organiser. Plus jamais nous ne pouvons risquer qu’une telle terreur recommence contre le peuple juif. Pour cette raison, chaque forme d’antisémitisme doit être rejetée catégoriquement dès ses premières prémices.
Introduction
(p.7) Pourquoi un être antisémite ?
Difficile interrogation. Pour Jean-Paul Sartre, « c’est un homme qui a peur. Non des Juifs, certes : de lui-même, de sa conscience, de sa liberté, de ses instincts, de ses responsabilités, de la solitude, du changement, de la société et du monde; de tout sauf des Juifs. C’est un lâche qui ne veut pas s’avouer sa lâcheté; un assassin qui refoule et censure sa tendance au meurtre sans pouvoir la refréner et qui, pourtant, n’ose tuer qu’en effigie ou dans l’anonymat d’une foule; un mécontent qui n’ose se révolter de peur des conséquences de sa révolte. En adhérant à l’antisémitisme, il n’adopte pas simplement une opinion, il se choisit comme personne ». Pour le philosophe français, « l’antisémitisme, en un mot, c’est la peur devant la condition humaine » i.
(p.9) Le rapprochement avec une certaine conception de la « Nation » développée jadis dans les plus sombres périodes de notre continent est démontré dans ce livre.
(p.12) La collaboration en Belgique concernait divers secteurs : économique, culturel, politique et militaire. Pour le militaire, plus de 10.000 volontaires flamands et 8.000 wallons partirent, par exemple, pour le Front de l’Est combattre « la barbarie communiste » (sic) 2. Plus de deux pour-cent de Belges baignèrent dans la collaboration 3. A la Libération, les autorités légitimes rétablies demandèrent des comptes à ces traîtres.
(p.13) Le Standaard exprimait alors parfaitement ce sentiment. « Le premier et le plus important remède au communisme est et doit être : la liquidation de la répression. La liquidation est un moyen positif : elle permet de renforcer nos forces anti-communistes de dizaines de milliers d’éléments de valeur », pouvait-on lire dans le journal catholique flamand en mars 1948. Un organe de presse qui n’hésita pas, en juillet 1950, à réclamer auprès de la police des étrangers l’expulsion du groupe de « Juifs, nègres et autre racaille » arrivé en Belgique afin d’aider la « subversion communiste ». (p.19) Nier une réalité, certes embarrassante, voilà une stratégie maintes fois menée par l’ultra-droite ou les milieux nationaux-révolutionnaires pour pouvoir réhabiliter un passé des plus obscurs.
(p.22) •* 9 L’AGRA (Amis du Grand Reich allemand), également dénommé Mouvement Socialiste Wallon (MSW-AGRA), fut fondé à Liège en mars 1941 à l’instigation du Sicherheitsdienst (SD), le service de renseignement et de contre-renseignement de la SS. Animé par des dissidents rexistes opposés à la conception de « Nation » du parti de Degrelle (qui prône, non l’annexion, mais la constitution d’un Etat bourguignon indépendant du Reich), l’AGRA est caractérisé par des positions pan-germaniques. Son programme doctrinal se base sur l’idée d’une communauté ethnique wallonne, au nom de la race, intégrée au Reich nazi. Ce cercle culturel compte dans ses rangs une kyrielle de militants issus de la gauche révolutionnaire d’avant-guerre. L’AGRA, fort en 1942 de 2.500 adhérents (ils sont 1.500 en 1943 et 21 à la Libération), fut marqué par un antisémitisme exacerbé.
(p.25) DERIVE ANTISEMITE
Deux ans après la parution de son livre, Jo Gérard, journaliste au journal d’extrême-droite belge Europe Magazine, publia un article relativisant le génocide hitlérien à rencontre des Juifs. Europe Magazine était lui aussi un fervent adepte de la dénonciation des complots fomentés par les « forces occultes ». A d’autres moments, Jo Gérard se rendra responsable de nouveaux dérapages suscités par la fréquentation d’un « univers intellectuel judéophobe ». Il faut rappeler qu’il fut lié à la Jeunesse belge-Belgische jeugd qui apporta plus tard son soutien militant aux milieux maurrassiens bruxellois.
(p.26) Jo Gérard, compagnon de route de Paul Vanden Bœynants (futur premier ministre, dirigeant du Parti Social Chrétien et président dans les années septante de sa fraction ultra-conservatrice, le CEPIC), ne peut pas être accusé d’antisémitisme patent (il est parfois même considéré comme étant un véritable philosémite !), mais doit être considéré comme une « victime » consciente du syndrome du complot. Un syndrome qui désigne derrière chaque crise ou institutions politiques des forces occultes se trouvant là afin de s’approprier le pouvoir, forces de l’argent (le « capitalisme apatride » ou « cosmopolite », imagé par l’empire Rothschild) et forces idéologiques (les judéo-bolchévistes, les judéo-ploutocrates, etc.) manipulant des marionnettes (ici, pour l’Algérie, le général De Gaulle) à leur fin personnelle 9.
(p.27) / Jean Thiriart/
Le mouvement thiriartien ne fut pas idéologiquement marqué par un antisémitisme probant, malgré la présence dans ses sections de partisans anti-juifs et la rédaction de certains articles dans La Nation Européenne par Jean Thiriart lui-même, essentiellement autour de l’année 1967, après la défaite des armées coalisées arabes de la guerre des Six jours. Dans les rangs des troupes de Thiriart, l’antisémitisme et toutes références au nazisme furent d’ailleurs prohibés… officiellement !. Ce qui n’empêcha pas des journalistes ou des chercheurs en sciences politiques d’accuser Thiriart d’antisémitisme larvé, comme nous allons le voir.
(p.35) Mouldi M’Barek, un Tunisien auteur d’une carte blanche écrivait dans le quotidien Le Soir du 26 mai 1986 : « L’extrême-droite occidentale comme l’intégrisme musulman, ces deux mouvements tirent leurs succès de la même plaie : la crise, et mènent le même combat : le retour aux valeurs traditionnelles, le rejet de l’autre et l’adhésion aux pulsions autoritaires et fanatiques ».
(p.36) Israël, le foyer national des Juifs sionistes, est le premier Etat hébreu moderne. Le rassemblement unitaire des Juifs désireux d’y vivre. Une véritable concentration cosmopolite; tous les visages mondiaux sont présents en Israël. La Diaspora toutefois reste mondiale, Israël ne regroupe qu’une minorité de Juifs. Et cependant dès sa naissance en 1948, cet Etat sera bien vite identifié à l’Etat DES Juifs. D’ailleurs, souvent le Juif ne sera plus défini comme « Juif », mais comme « israélien » ou « sioniste », métamorphose sémantique moderne pouvant permettre une judéophobie constante et légendaire sous le couvert d’un antisionisme politique. Ce n’est plus le judaïsme ou les Juifs qui sont désignés dans les textes de propagande judéophobe mais les « sionistes », « l’internationale sioniste », « le pouvoir sioniste », « les lobbys sionistes »…
(p.40) En octobre 1990, le vice-président du Front National, Georges Demoulin, démissionna de son poste en compagnie de Roland Lemaigre, un militant d’origine juive. Ils dénoncèrent la présence constante au FN d’antisémites et de négationnistes. Pour sa part, le Conseil national de ce parti ethnocentriste, réuni le 12 octobre de la même année, exclura Georges Demoulin, pour avoir « tenu en privé des propos qui relèvent d’un antisémitisme primaire, viscéral, voir hystéroï-de »10. L’argument, bien entendu, est totalement faux, il s’agit d’un prétexte pour devancer la démission de leur vice-président. Georges Demoulin sera d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises comme étant un philosémite véritable, mais également un anti-arabe radical. L’analyse de l’affaire par le groupe néo-hitlérien l’Assaut, en relation avec les éléments philo-nazis du FN, est intéressante et démontre l’utilisation du terme « sioniste » afin de salir l’image des militants démissionnaires : « … Le récent départ en fanfare de deux militants du FN, sionistes acharnés, démontre que de pactiser avec cette sorte de gens est inutile et dommageable. Espérons que maintenent le FN va enfin et définitivement prendre une voie réellement nationaliste… » 11.
(p.59) Les négateurs, les prédateurs de la mémoire, nient la totalité de la politique de la Solution finale, les « révisionnistes » veulent en minimiser la réalité.
(p.64) Mais dans son livre La Belgique sous l’occupation : 1940-1944, publié en 1984, Jo Gérard occulta les étapes de la déportation juive (25.257 personnes) et l’extermination des 24.052 Juifs de Belgique. Par contre, il dénonça avec indignation les bombardements de 1944 effectués par l’aviation alliée. Une erreur de taille pour un historien… Erreur assortie d’une certaine complaisance naïve pour les « thèses faurissoniennes » et le IIIe Reich? (p.92) Nonobstant ces quelques exemples révélateurs, une autre globalisation s’est faite dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la libération des camps, l’extermination des Juifs d’Europe fut récupérée à des fins politiques ou religieuses. Pour l’Etat polonais stalinien de l’après-guerre, la singularité juive fut occultée. Cette position de récupération idéologique fut identique à celle de certaines « fondations de mémoire » dans une perspective anti-fasciste. L’Eglise de Pologne fera de même. Auschwitz devint le lieu de toutes les convoitises, afin de récupérer la symbolique de celui-ci. Le pape Jean-Paul II, parti en 1979 en pèlerinage dans ce haut lieu de la mort collective, encouragea les milieux ecclésiastiques désirant « christianiser » le génocide. Plus tard un carmel fut érigé dans l’ancien camp. C’est la récupération religieuse. Autre globalisation, cette fois à des fins étatiques, celle opérée par l’Etat d’Israël. Un Etat, faut-il le rappeler, qui n’a pas été fondé à la suite du Judéocide, mais dont la découverte des camps de la mort précipita le processus inévitable d’indépendance amorcé dès la fin du siècle dernier et renforcé avec la déclaration Balfour (1917). Israël tente de centraliser la Mémoire du peuple Juif, d’être le dépositaire de l’Histoire des victimes. L’Etat hébreu singularisera cette tragédie à sa création et, par la force des choses, confisquera la mémoire des Autres, celle des Juifs non sionistes, des Juifs communistes, des Juifs assimilés et de tous les autres « boucs émissaires » du système nazi.
(p.94) Faurisson ne fut jamais professeur d’histoire mais de littérature.
(p.122) TINTIN, DEGRELLE ET LES PIRATES…
Selon Léon Degrelle, le jeune reporter fut inspiré de son physique et de son dynamisme « rexiste » 3. Le « Beau Léon » conforte cette hypothèse aujourd’hui, allant jusqu’à affirmer : Tintin c’est moi 4. Il faut se souvenir que le père de ce héros de la BD et le futur chef de REX étaient des amis de jeunesse dans les années trente, qui se sont rencontrés dans la salle de rédaction du quotidien catholique Le Vingtième siècle. Durant l’Occupation, Degrelle s’engagea militairement dans le soutien à l’Ordre Nouveau, Hergé le fit de manière plus culturelle. Ce dernier était alors l’auteur de caricatures antisémites 5. Degrelle affirma en 1988 : « II (Hergé, Ndla) est toujours resté un grand copain et, quand j’étais caché en Espagne ici après la guerre, il a continué à m’envoyer tous ses livres » 6. Cette relation entre le fùhrer belge et le dessinateur restera un sujet occulté et tabou de la biographie officielle. Encline à la récupération à des fins bassement politiques, l’extrême-droite européenne prit durant les année quatre-vingts exemple sur Tintin et sa morale. Il représente pour ces « pirates » d’ultra-droite l' »homme blanc européen ». Dans sa propagande, il ne sera pas rare de trouver des autocollants repiquant des dessins issus des aventures de Tintin 7. Ce jeune garçon blond deviendra, à l’insu de Hergé, une des coqueluches de la droite subversive… Dans le domaine de la BD, nous pouvons encore citer les aventures des Schtroumpfs ainsi que celles de Tif et Tondu… dans lesquelles un antisémitisme sournois fut parfois développé. Le scénariste de bande dessinée Serge Algcet, co-fondateur en 1981 de la Chambre belge des experts en bande dessinée, est l’auteur de Front de l’Est, une BD élo-gieuse qui retrace T’épopée » de la « croisade des soldats perdus »: les volontaires SS wallons. Elle fut publiée dans un souci historique, purement (p.123) motivée par une optique de réhabilitation des « croisés » partis combattre le « bolchévisme ». Le texte d’introduction fait référence à trois sources : Guy Sajer, auteur du livre Le soldat oublié (Robert Laffont), feu Saint-Loup et Jean Mabire. Les deux derniers sont des écrivains clairement de « droite », spécialistes de la SS. Saint-Loup était un ancien volontaire français de ce corps d’élite. Mabire est l’un des intellectuels les plus en vue des « cercles » mystiques pré-chrétiens et ethniques. Tous deux apportèrent leur connaissance historique et doctrinale à la Nouvelle Droite. Quant à Serge Algœt, il collabore depuis 1990 au National, le mensuel du Front National belge et serait proche, selon l’un de ses anciens vice-présidents, de l’amicale des « Bourguignons », regroupant des Wallons partis dans la SS sur le Front de l’Est…
HONNEUR A EVOLA
Si la réhabilitation d’un certain passé se réalise de manière subtile dans des ouvrages de bandes dessinées, c’est surtout autour d’associations et de publications littéraires que cette manœuvre idéologique se produira. Inconnues du grand public, elles développent des ramifications et des confluents non négligeables au sein de la périphérie des « écrivains de droite » et de leurs lecteurs. Objectif : réhabiliter, entre autres, la mémoire des auteurs bannis durant l’épuration pour faits de collaboration. Mais surtout accuser la démocratie de les avoir condamnés. Ce sont des revanchards, n’ayant jamais oublié l’humiliation de la défaite de 1945. Onze ans après la Libération, une revue intellectuelle fut fondée en Flandre. Elle se nomme Dietsland-Europa et s’inspira de Défense de l’Occident de Maurice Bardèche. L’un des fondateurs de la nouvelle publication flamande, Karel Dillen (son rédacteur en chef jusqu’en 1975), fut en 1952 le traducteur en néerlandais du premier livre néga-tionniste de Bardèche. Les initiateurs de Dietsland-Europa, comme les rédacteurs de Défense de l’Occident, s’inspirèrent d’un certain passé historique. Karel Dillen est un inconditionnel de Rudolf Hess et sa revue se revendique alors du solidarisme, un des leviers de la collaboration flamingante. Ce périodique doctrinal – édité par les nationalistes de Were Di – publia en 1985 un numéro spécial consacré à l’œuvre et à la personne de Julius Evola (1898-1975), un théoricien raciste italien proche de l’idéologie de la SS et qui resta actif après la guerre. Idéologue du courant « traditionnaliste-révolutionnaire », il devint une référence des nationalistes ethno-centristes purs et durs. Des articles du numéro de Dietsland-Europa, publiés dix ans après le décès du baron Evola, furent écrits par le sociologue flamand Piet Tommissen, l’un des premiers animateurs de la Nouvelle Droite en Belgique, (…)
(p.125) MON AMI BRASILLACH…
En 1948, un cercle militant de lecteurs, à vocation internationale, est fondé en Suisse romande afin de perpétuer le souvenir de l’écrivain fasciste Robert Brasillach (1909-1945), proche de Charles Maurras et fusillé à la Libération pour son ralliement au nazisme. Cette association dénommée les Amis de Robert Brasillach (ARB) reçut immédiatement le soutien décisif de Maurice Bardèche, le confrère et beau-frère de Brasillach, auteur en 1948 du premier document négationniste. Des cercles français et belges furent bien vite créés. En 1985, les ARB comptaient plus de 750 membres 9. Le but de l’association était de « faire sortir de l’ombre l’œuvre de Brasillach » 10. Dans ce sens, un appel fut lancé. Jean Anouilh, Marcel Aymé, Jean de La Varende… y répondirent favorablement. Par la suite, on tenta d’interdire en France l’association et une interpellation parlementaire fut faite condamnant l’ARB pour reconstitution de ligue dissoute (interdit par la Constitution française). Si ce collectif de lecteurs fut rapidement soutenu par toute une série de personnalités « – dédouanées d’une quelconque sympathie à l’égard du national-socialisme comme tel, l’association a toujours reçu le soutien militant de groupuscules et de revues agressivement néo-fascistes racistes (Nouvel Ordre Européen, l’Œuvre française, Rivarol… ) et de la mouvance intégriste (Lectures françaises, Lecture et Tradition, Présent, etc.). Elle bénéficia du soutien du belge Emile Lecerf (NEM), de Benoist-Méchin, de la Maréchale Pétain, de Robert Poulet et de la Nouvelle Droite. En 1985, Bernard Antony, alias Romain Marie, adhéra aux ARB 12. Fondateur du quotidien Présent, Antony est le dirigeant de l’aile intégriste du Front National français. En 1990, l’association rendit un hommage (sous le titre « nos deuils ») dans son bulletin de liaison à Arno Breker (le « sculpteur du fùhrer »), à Pierre Gripari (intellectuel néo-droitiste aux propos antisémites) et à Saint-Loup (ex-SS français, un des idéologues de la Nouvelle Droite). (p.126) Le 6 février 1963, la section belge des ARB organisa une soirée de commémoration de la mort de Brasillach. Y étaient présents Maurice Bardeche, l’écrivain belge Pol Vandromme et les responsables du mensuel néo-nazi L’Europe Réelle13. Les ARB ne sont pas les seuls à commémorer l’anniversaire du décès de l’écrivain « naziphile ». Le Cercle Franco-Hispanique, une officine politico-religieuse française disciple des pouvoirs franquiste et vichyste, organise chaque année à Paris une telle manifestation nostalgique. Des délégations belges s’y rendent régulièrement. Ce fut le cas de l’ancien VMO et du groupe l’Assaut. En 1991, ce dernier y était présent avec un ancien SS collaborateur au mensuel judéophobe Le Choc du Mois, le fils et la femme de Paul Touvier, deux élus du Front National, l’Association Nationale Pétain-Verdun et Pierre Sidos, le leader « antisioniste » de l’Œuvre française.
(p.127) BAGATELLE POUR CELINE
En 1979, trois admirateurs belges sans bornes de Louis-Ferdinand Céline fondèrent une association publiant La Revue célinienne. Devenant une « amie » de l’association des disciples de Brasillach, cette revue reçut un accueil des plus favorables auprès des cercles de la Nouvelle Droite. Le bulletin du GRECE-Belgique, dirigé par un maurras-sien de longue date, se félicita de l’apparition de La Revue célinienne. En 1982, ce périodique changea de nom, pour devenir Le Bulletin Célinien (BC), un mensuel confidentiel vendu exclusivement par abonnement. Tout ce qui est publié, écrit ou dit sur cet écrivain qui cultivait des sentiments judéophobes est mentionné, analysé et critiqué par le BC. Marc Laudelout en devint le dynamique directeur. Cet enseignant collabora au Nouvel Europe Magazine. A la même époque, un « LFC Club fut fondé à Liège et diffusa un catalogue Célinien.
(p.130) TEL L’AIGLE…
En 1974, une revue du nom d’Altaïr 23 fut fondée par Jean-Pierre Ham-blenne, un professeur de religion catholique à Namur, né en 1953, aujourd’hui proche du culte orthodoxe. Son périodique de « poésies et tradition » est diffusé en Belgique, en France, en Suisse et en Hollande à environ 250 exemplaires 24. Par la suite, le directeur de cette revue nationaliste mit sur pied les Editions Altaïr, afin de publier divers documents et pamphlets antisémites, intégristes et littéraires.
Jean-Pierre Hamblenne fonda en 1983 une seconde revue, intitulée Les Amis de Paul Démulède, diffusée exclusivement en France, et consacrée à l’étude et à l’analyse des écrits littéraires de cet écrivain et homme politique partisan du putch contre le régime parlementaire en France. Paul Déroulède (1846-1914) fut l’une des références marquantes, mais peu connue, du nationalisme chauvin préfasciste d’outre-Quiévrain. Le numéro un des Amis de Paul Déroulède prit en exemple l’association des Amis de Robert Brasillach. Les ARB n’hésitèrent jamais à citer les publications et la « bourse aux livres » de Jean-Pierre Hamblenne. Contrairement au Bulletin Célinien et aux Amis de Brasillach, la sensibilité politique de Hamblenne a toujours été clairement revendiquée.
(p.131) Militant d’extrême-droite de longue date, Jean-Pierre Hamblenne fut, en 1975, le responsable de la section belge de l’Union Universelle des Poètes et Ecrivains Catholiques (UUPEC), une officine intégriste menée par Mgr. Ducaud Bourget. Il côtoya la section du Tournaisis du CLAN (Cercle de Liaison et d’Action Nationaliste) à la fin des années septante, une structure idéologique influencée par la méthodologie élaborée par la Nouvelle Droite. Membre du comité d’honneur en 1981 de la section française du CEDADE (néo-hitlérien) avec Maurice Bardèche, Francis Dessart, Saint-Loup,… 25, il écrivit, ensuite dans L’Eveil nationaliste, l’organe bruxellois du Mouvement Social Nationaliste, d’obédience rexiste pro-lepéniste. En 1984, Jean-Pierre Hamblenne se rapprocha du Parti des Forces Nouvelles, pour s’occuper de la rubrique littéraire de son périodique de presse. Cette même année, le jeune activiste réédita le document Le Mensonge d’Auschwitz, traduit en français par Michel Caignet, l’ancien leader de la FANE et du Mouvement Européen26. Hamblenne ne se limita pas à ce pamphlet falsificateur. Effectivement, dans la collection « L’Histoire vraie » des Editions Altaïr, il proposa en 1987 un opuscule niant le massacre perpétré par les nazis à Oradour-sur-Glane. Il est membre avec G.A. Amaudruz (NŒ), feu Saint-Loup… du comité de parrainage de la revue Militant, du Parti Nationaliste Français. En 1988, les Editions Altaïr éditèrent le manifeste du Rassemblement d’Action pour la Renaissance Européenne (RARE), animé par des dissidents radicaux de la Nouvelle Droite, dont l’objectif était « l’organisation de la race blanche » et de son « bastion, l’Europe » 27. Jean-Pierre Hamblenne manifesta ouvertement ses sympathies pour la revue NS Euro-Forum (par la suite il fut régulièrement cité par L’Assaut, confectionné par des anciens de Euro-Forum ), le Vlaams Blok et les volontaires SS belges partis combattre sur le Front de l’Est.
(p.133) EN BON FRANÇAIS
L’extrême-droite est aussi représentée par des férus de textes littéraires. Ils pavoisent au sein d’associations vouées au culte et à la mémoire d' »écrivains maudits », ceux qui mirent leur plume durant l’occupation au service de l’Ordre Nouveau nazi. Faisant fi de la propagande antisémite préparant la déportation vers l’Est et la Solution finale, ces auteurs de talent par la force des choses se sont rendus coupables, par leur complicité et leur judéophobie, du crime prémédité et collectif. Ceux qui veulent aujourd’hui excuser, amnistier et finalement justifier l’action de ces intellectuels durant cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale, à leur tour, deviendront des thuriféraires du racisme politique. Et c’est le cas, puisque nous venons d’observer par l’étude de ces milieux intellectuels la présence singulière et constante d’activistes néo-fascistes, nationaux-socialistes, négationnistes et bien entendu antisémites. Tout ceci, en très bon français…
(p.134) 15. Pol Vandromme est l’un de nos plus illustres essayistes et romanciers. Collaborateur journalistique de nombreuses publications grand public, Vandromme, auteur d’ouvrages sur Céline, Drieu la Rochelle, Maurras et du premier consacré à Brasillach, est qualifié d' »écrivain de droite » proche des milieux traditionnalistes. En 1976, il collabora à Item, une « revue d’opinion libre » avec Jean Mabire (spécialiste de la SS), Louis Pauwels (du Figaro, alors lié à la Nouvelle Droite), Jacques Ploncard d’Assac (ex-collabo, antisémite notoire), Alain Renault (responsable des Cahiers-Européens, du Front National et collaborateur lui aussi à Défense de l’Occident), Mgr. Lefebvre, Jean-Marie Le Pen… Mais Pol Vandromme est aussi l’auteur de critiques positives concernant des livres sur le génocide juif !
(p.135) 13. NOUVELLES CROISADES
La tradition antisémite, et plus particulièrement l’anti-judaïsme, s’exprimait voici peu dans des sermons chrétiens. L’histoire de la Chrétienté est assortie d’étapes s’arc-boutant sur une dérive dogmatique -officielle- de rejet du peuple Juif. L’obscurantisme est alors à l’ordre du jour. Accusés du meurtre de Dieu, par la crucifixion de Jésus-Christ, les Juifs furent au cours des siècles expulsés et massacrés au nom de la croix. L’accusation de déicide sur le « grand frère » fut maintenue jusqu’il y a peu. En 1992, le Pape Jean-Paul II reconnaissait la non-responsabilité des Juifs dans le meurtre du « premier socialiste ».
L’Eglise de Belgique, en matière de combat contre le fascisme, est exemplaire. Si le rexisme trouva son énergie de départ dans le monde catholique, très vite ce dernier devint un adversaire catégorique de Degrelle. Néanmoins, durant la guerre, une partie du clergé rejoignit les rangs de l’Ordre Nouveau, à l’ombre de la croix gammée; comme l’abbé Cyriel Verschaeven, continuellement adulé maintenant encore par des officines identitaires en liaison avec le Vlaams Blok. Autre cas, celui du père flamand initiateur de la collecte d’argent en 1985 pour le carmel d’Auschwitz. Accusé après la guerre de collaboration avec l’occupant nazi, il est maintenant soupçonné d’être lié à l’ultra-droite raciste. Son action consiste à christianiser l’image historique du génocide perpétré par le régime hitlérien, à occulter la singularité juive et par la force des choses, indirectement peut-être, à apporter sa pierre à l’édifice des thèses falsificatrices.
L »‘Autre Eglise » fut l’honneur de la religion catholique. L’Eglise de la résistance contre le fanatisme politique. Celle qui sauva des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes juifs pourchassés par les nazis et leurs lâches complices locaux. Des prêtres, des scouts, des religieuses et des paroissiens, au péril de leur vie, ont sauvé celle des victimes de l’idéologie raciste d’Hitler. Sans eux, le prix payé par le peuple juif aurait été bien plus terrible. L’action de Paix de toutes ces personnes ne pourra jamais être oubliée par leurs protégés et leurs descendants. Mais les thèmes xénophobes (contraires à la Bible) pénètrent le monde catholique. En France plus particulièrement, puisque 25 % des catholiques pratiquants étaient prêts à voter en 1992 pour le Front National ±.
(p.143) L’intégrisme catholique enduit d’un vernis judéophobe et antijudaïque est bel et bien récurrent, comme nous venons de l’étudier par cette radioscopie, mais son profil minoritaire -marginal- est caractéristique. Les antisémites chrétiens sont des racistes virulents, des partisans d’un pouvoir totalitaire, d’une Eglise isolationniste, des adversaires de l’ouverture religieuse et de la diversité culturelle. Ce sont des « modernophobes ». Par peur de l’évolution humaniste, ils rejettent l’Autre. Leur prochain…
(p.150) L’anti-judaïsme, synthétisé au rejet de la civilisation judéo-chrétienne dans son ensemble, des néo-païens et des nationaux-chrétiens intégristes est un avatar de plus (et un des premiers !) de l’antisémitisme moderne. Outre sa filiation au sein même de la doctrine philosophique SS, le paganisme germano-Scandinave raciste instrumentalisé par la (p.151) myriade d’organisations néo-nazies se rassemblant bi-annuellement afin de fêter les solstices est également vénéré par la Nouvelle Droite. Cette religiosité politique s’alimente d’aspects anti-juifs complémentaires, puisque beaucoup de néo-païens sont séduits par les autres créneaux antisémites. Ainsi, Le Partisan Européen (éditant le supplément Combat-Païen ) mettra en cause « … les mythes résistancialistes et exterminationistes sur lesquels s’appuie l’ordre établi (…) en Europe occidentale depuis 1945… » 6. Les familles de l’ultra-droite révolutionnaire, conservatrice, contre-révolutionnaire, chrétienne, laïque ou païenne boivent en général l’eau de la même source… |
|
1996 |
Enfants indiens violés au Canada, in: LB 21/10/1996
Un pensionnat catholique fait l’objet de poursuites judiciaires dans l’Ontario. Des centaines d’enfants indiens (des Indiens Cri et Ojibwa de communautés isolées du nord de l’Ontario) ont été violentés jusqu’en 1973 dans un pensionnat de Fort Albany (Ontario), l’école Sainte-Anne, tenu de 1904 à 1973 par les missionnaires Oblets de Marie Immaculée et par les soeurs de la Charité d’Ottawa. Selon certains témoignages, les enfants étaient forcés de manger leurs vomissures. Il existait une chaise électrique artisanale où l’on atachait les enfants et où on leur envoyait des décharges pour les punir. Ce cas n’est pas isolé. Une loi fédérale avait imposé, en effet, pendant des dizaines d’années , que les enfants aborigènes fréquentent des pensionnats catholiques pour faciliter leur assimilation dans la société canadienne. Ainsi, des Indiens Micmac ont demandé auprès du gouvernement fédéral et de l’église catholique des cmpensations aux mauvais traitements subis dans le pensionnat des Indiens Shubenacadie, qui était géré jusqu’à sa fermeture en 1967 par l’ordre des Soeurs de la charité.
|
|
1999 |
Gérald Papy, Démarche vaticane en faveur de Pinochet, LB 20/02/1999
(Pinochet, accusé en Angleterre où il est prisonnier)
|
|
2005 |
El criminal se oculta en un monasterio, El P. 21/09/2005
La Haya acusa al Vaticano de esconder al general croata perseguido. El silencio del militar, antiguo miembro de la Legió francesa, Ante Gotovina. Esta acusado de permitir el asesinato de 150 civiles serbios en los, noventa y la deportación de hasta 200.000 más..
|
|
2007 |
in: Albin-Georges Terrien, La soutane, Memory Press, 2007
Les adolescents qui ont vécu dans un collège catholique des années d’après-guerre, avant l’abolition de l’Index et la tenue du concile Vatican II, pourront témoigner des conditions insoutenables imposées par un clergé professoral maudissant l’image de la féminité et fermé à toute ouverture sur la société moderne. Les Ardenneux Pierre et Victor, le fragile Jean Lhermite, les abbés professeurs plus ou moins asservis à l’implacable hiérarchie et les parents des élèves tenus en laisse se croisent, s’entrecroisent, deviennent les acteurs involontaires d’une véritable tragédie. Après La Glèbe et Vive la guerre, La soutane, qui clôture la trilogie du petit monde d’Engreux, évoque les blessures des adolescents de la terre, après celles de leurs parents, de leurs aïeux, et de tous les paysans du monde, derniers esclaves des temps modernes. Fils et frère de paysans, Albin-Georges Terrien est né en 1934 à Engreux, au cœur de l’Ardenne. Instituteur rural de 1956 à 1986, correspondant de presse, chroniqueur au Sillon belge, il est considéré comme un des meilleurs spécialistes des problèmes économiques et agricoles de sa région. La Glèbe, a obtenu le prix George Garnir décerné par l’Académie Royale et continue à connaître un vif succès dans toute la Wallonie et le Nord de la France, de même que Vive la guerre pour lequel un projet de traduction en russe est en cours.
(p.73) S’il pleut, la promenade sous le préau s’impose. Plus de cent jeunes poulains qui ne demandent qu’à galoper, obligés de vaquer d’un mur à l’autre, comme dans une cour de prison. Et avec des contraintes qui interdisent à un grand de se promener avec un petit. Défense de parler wallon, sous peine de sanctions. Quelle contrainte pour les Ardenneux dont c’est la langue maternelle. Couper les racines vives est un des objectifs majeurs du collège. Treize heures trente. Coup de sifflet, fin des jeux. Court passage à la salle d’études pour emporter livres et cahiers en vue des cours de l’après-midi qui commenceront et finiront comme toujours par une prière.
(p.100) Il était le seul professeur de l’établissement à ne jamais utilsier ce terme de mépris en vogue à l’époque : ‘paysan’ ! Ses confrères en usaient, en abusaient à tout propos et hors de propos. Si un élève trébuchait, le professeur l’apostrophait : « Lève tes pieds, paysan ! » ; s’il avait les mains en poche : « Sors les mains de tes poches, paysan ! » Cette injure, synonyme de lourdaud, de maladroit, de malappris, était particulièrement humiliante pour les fils d’agriculteurs qui la ressentaient comme une insulte à la profession de leurs parents.
(p.105) Tout le monde sait que le jour où un barrage vient à céder, la masse d’eau contenue cause des ravages d’autant plus importants que la retenue des flots aura été longue.
(p.108) A propos de l’Index, qui scandalisait les amateurs de litérature, il / = l’abbé Lagneau/ expliquait : – L’Index est le catalogue officiel des livres interdits aux catholiques.
(p.129) Au sujet de Villon déjà, mais surtout de Montaigne et plus encore de Rabelais, Paternoster avertit ses élèves. — Dans le souci de vous inculquer une bonne culture générale, je ne puis passer sous silence quelques extraits de ces grands écrivains, mais je vous préviens d’emblée : il vous est interdit de lire leurs livres qui figurent à l’Index. Ces écrivains, grands par le talent, ont été animés par une âme basse. Dans le meilleur des cas, si je puis dire, ils ignoraient la foi. Mais beaucoup d’entre eux s’en sont pris à Dieu et à ses saints, à l’Église et à ses ministres, ce qui est un blasphème abominable qui les a conduits à la damnation éternelle. Paternoster prit alors un dossier sur le coin de son bureau et énonça une liste d’immenses artistes, penseurs et philosophes mis à l’index par les censeurs du Vatican, parmi lesquels ont retrouvait Rabelais, Montaigne, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade, Lamartine, Sand, Balzac, Hugo, Flaubert, Baudelaire, Dumas père et fils, Zola, Maeterlinck, Renan, Gide, Sartre, Machiavel, Spinoza, Fénelon (un évêque pourtant!), Sainte-Beuve, Lamennais et des centaines d’autres. Il déposa la liste maudite sur le coin de son bureau et poursuivit : — Qu’arrive-t-il à celui qui lit un de ces livres ? — Il commet un péché mortel, répondit Arille, à peine remis de ses blessures au fondement, et cependant dispos à se lever et à se rasseoir très vite pour abonder dans le sens du professeur. – Très bien, Lechanteur. Non seulement, il commet un péché mortel, mais en plus il est excommunié. Et qu’est-ce que cela signifie, être excommunié ? Cela veut dire être retranché de la communion des fidèles. Un chrétien qui lit un de ces livres est privé du droit de recevoir les sacrements. S’il ne se repent pas et que son curé en a connaissance, il ne pourra non seulement avoir des funérailles religieuses, mais de plus ne pourra être enterré en terre bénite.
(p.135) Face à la cohue qui courraient dans tous les sens, (…).
(p.177) Pour le compte de la direction, ils exerçaient deux types de surveillance : l’une visible et officielle dans les dortoirs, à l’étude, au réfectoire, à la cour de récréation, en promenade. L’autre, plus sournoise, quadrillait les recoins et autres lieux moins éclairés. Invisibles rapaces enveloppés dans leur noire soutane, tapis dans l’ombre, ils étaient perpétuellement en quête d’un délit mineur ou d’une conversation subversive. Au début de chaque année scolaire, le directeur invitait les élèves à repasser par la chapelle après le souper pour y faire une courte méditation. Un bon tiers des élèves environ répondait à ce souhait. Comme professeur de religion, l’abbé Lagneau, pratiquement chaque soir, allait s’embusquer dans la galerie supérieure. De là, il tenait une comptabilité précise des étudiants venant se recueillir. Ceux-ci recevaient un bonus à leur examen de religion et à l’appréciation de leurs points de conduite, tandis que les absents étaient pénalisés. Krémer se rendait-il compte de l’aspect nauséabond de cette délation érigée en système? Il la justifiait ainsi : – Le règlement est la colonne vertébrale du système d’éducation qui fait notre réputation. Tout élève qui commet la moindre effraction à ce règlement ébrèche un tant soit peu cette colonne.Que les professeurs, les surveillants ou moi-même fassions preuve de laxisme et, petit à petit, cette colonne va se lézarder, s’effriter pour bientôt s’écrouler, réduisant ainsi en cendres tout notre système éducationnel. Il est donc du devoir de chacun d’entre vous de montrer du doigt tout condisciple qui contreviendrait peu ou prou à ce règlement. Soyez sans crainte, vos supérieurs ne dévoileront aucun nom, et jamais ils ne vous feront grief d’avoir dénoncé un condisciple. Bien au contraire, ils vous sauront gré d’avoir contribué à préserver la bonne réputation de votre établissement. Rappelez-vous souvent les paroles du Christ : « Qui n’est pas avec moi est contre moi. »
(p.179) Un observateur extérieur à l’établissement, face à des conditions de vie aussi inhumaines, à cette entreprise systématique de dépersonnalisation propres à toutes les unités d’élite de toutes les armées du monde, ne manquerait pas de se poser la question : « Mais comment ces collégiens pouvaient-ils accepter un tel régime ? » L’explication est assez simple. Pour la plupart d’origine modeste et issus de milieux chrétiens, ces jeunes avaient appris très tôt à incliner le front et à baisser les yeux face à tous les détenteurs de l’autorité : le maître d’école, le curé, le comte, le notaire, quiconque détenait une parcelle d’autorité si infime soit-elle. L’obéissance et l’humilité faisaient partie de leur nature, tout comme le mysticisme entretenu par les innombrables cérémonies religieuses. Ils marchaient donc, intégrés à un troupeau docile, pendant toutes leurs humanités, sur la voie tracée par le directeur. Si l’un d’eux, exceptionnellement, osait ruer dans les brancards, il était aussitôt cassé d’une manière spectaculaire et exclu du système, taché de honte et de déshonneur et désavoué par sa famille.
(p.182) Entre les lits, pas de paravents ni de séparations fixes. Chaque élève s’y trouvait, par le fait du silence absolu et de la vigilance du pion, aussi seul que dans une cellule de prison ou de moine, car là aussi, il était formellement interdit de communiquer. Ainsi les élèves, dans la peau de parfaits nombrilistes par la force des choses, s’endormaient sans se dire bonsoir, s’éveillaient sans se dire bonjour, sans se préoccuper de qui que ce soit, comme si la société des autres n’existait pas. Un chauffage central était installé depuis 1’entre-deux-guerres : radiateurs de fonte à débit plus que limité. Par exemple, l’eau chaude n’était pas puisée jusqu’aux dortoirs. La salle d’études et les classes étaient à peine tiédies de sorte que l’hiver, les élèves y conservaient leur écharpe. La bise venue, la chapelle se transformait en glacière; les élèves assistaient aux offices recroquevillés dans leur manteau. La nourriture saine et abondante promise dans les prospectus était dispensée en quantité parcimonieuse. La margarine y remplaçait le beurre, chaque ravier de cet ersatz étant divisé en huit parts égales par le couteau du chef de table. Quatre tranches de pain blanc, insipide, par élève au déjeuner et au goûter avec ravier de confiture ou de sirop, partagé lui aussi. La sauce brune, toujours la même, ne tachait pas les vêtements : elle ne contenait pas de graisse. Le même menu fait de pommes de terre cuites à l’eau, d’un légume et de carbonades revenait inlassablement. Jamais de friture, ni de pâtes, ni de cacao, ni de sauces un peu relevées. Malgré cela, durant les six années d’humanités, ces internes y grandissaient, s’y développaient, s’y fortifiaient. Les appoints fournis par les parents lors des congés ou des visites, n’y étaient sans doute pas étrangers. Par-dessus tout cela, le silence, presque partout, presque toujours. Des jeunes qui marchent, travaillent, écoutent, se couchent, se lèvent dans le plus total des silences, qui parlent à voix basse et rarement. Comment ces jeunes, inhibés, déshabitués du monde extérieur, complexés vis-à-vis des gens libres, moroses au lieu d’être joyeux, modérés au lieu d’être excessifs – ce qui aurait été normal à leur âge -, bridés dans leurs élans, cassés dans leur dynamisme, allaient-ils pouvoir s’intégrer dans un monde mouvant qu’ils ne connaissent pas ou plus ? (p.183) Des drames se préparaient ainsi au collège avec la peur de la vie, de la femme, de l’amour, avec des préjugés et des principes rigides qui conduisaient certains à l’extrémisme ou au désespoir. Quant à la psychologie, il fallait éviter de l’évoquer auprès de l’abbé Krémer qui répondait invariablement : — La psychologie? C’est tout simple : je décide, j’ordonne. Vous exécutez et vous vous taisez, un point c’est tout. Et si vous n’êtes pas contents, faites vos valises !
(p.211) Jusqu’alors, dans les régions rurales surtout, l’enseignement libre possédait un quasi monopole en ce qui concerne l’enseignement secondaire et supérieur. Mais dès après la guerre, on vit des écoles de l’État s’ériger dans différents bourgs et petites villes. L’école libre devait maintenant faire face à la concurrence, ce qui était inédit pour elle.
(p.216) Depuis quand la délation était-elle en usage au collège ? Sans doute existait-elle avant l’arrivée de l’abbé Krémer. Mais dès que celui-ci fut en charge de la direction de l’école, il l’avait érigée en système. Il y revenait régulièrement dans les méditations qui suivaient la prière du matin. Il utilisait toujours la même comparaison de la pomme pourrie. (p.217) A ce sujet, l’abbé Preud’homme ne partageait nullement l’attitude de ses confrères. Il avait en horreur ce climat de délation dans lequel baignait l’établissement. Le régime nazi était trop proche encore, où les enfants allaient jusqu’à dénoncer leurs parents, pour que cette attitude du directeur et de ses subordonnés ne lui donne pas des haut-le-coeur.
(p.236) Sur la bonne centaine d’élèves que comptait le collège, on peut estimer que nonante étaient de parfaits agneaux, ayant perdu toute personnalité, subissant sans regimber les directives, diktats et autres interdictions des professeurs et de l’impitoyable Krémer. Une dizaine seulement, que le directeur et ses adjoints n’étaient par encore parvenus à mettre au pas, n’acceptaient pas cette discipline aveugle. Ils râlaient, mais intérieurement seulement, sous peine de se faire renvoyer. Les Ardenneux en faisaient partie. Le directeur et les professeurs n’étaient pas dupes. Ils connaissaient les fortes têtes, régulièrement sanctionnées par leur cote en conduite. Alors que les agneaux obtenaient ou frôlaient le maximum de 10/10, les insoumis flirtaient souvent avec le 5/10, mais se retrouvaient quelquefois avec un zéro pointé pour quelque peccadille. Comme ces points étaient comptabilisés pour les bulletins de Noël et de fin d’année, les agneaux partaient avec plusieurs longueurs d’avance sur les contestataires.
(p.274) Les comportements équivoques de l’abbé Lagneau ne représentaient que de légères déviances en regard des agissements de certains religieux qui sévissaient dans l’un ou l’autre collège. Ce n’est que plus tard, bien plus tard que les langues se délieraient et que, par la presse, le grand public allait apprendre les souffrances de ces petits malheureux. Personne, dans les internats concernés, n’était au courant de ces pratiques perverses. Personne, sauf les victimes bien évidemment. Des témoins l’eussent-ils appris qu’ils auraient jeté le manteau de Noé sur ces turpitudes : la réputation du collège ne pouvait être entachée. Quant aux jeunes garçons traumatisés par ce que l’on allait qualifier plus tard de pédophilie, ils n’osaient en parler à personne, même pas à leur meilleur ami. Ils étaient seuls à porter le poids de l’ignominie. Jamais ils n’auraient osé se confier à leurs parents lors de leur retour en congé. En admettant qu’ils fussent parvenus à surmonter la honte et le sentiment de culpabilité qu’ils éprouvaient, ils se seraient heurtés à l’incrédulité de leur famille qui vénérait l’Église et ses serviteurs. Et puis, comme les prédateurs des pensionnats s’attaquaient aux plus doux, aux plus timides, aux plus soumis des collégiens, il leur était aisé de faire croire à leurs proies que le traitement qu’ils leur infligeaient était destiné à les rendre meilleurs, à les rapprocher du Ciel et de tous ses anges aux ailes blanches et aux lèvres avides de tendresse.
(p.299) la délation étant érigée en système et récompensée par des points supplémentaires en conduite.
(p.310) A première vue, Pierre aurait dû se sentir soulagé d’être mis à la porte de ce bagne. Mais il n’en était rien. D’abord, il serait séparé de son ami Victor, de ses copains footballeurs, de son professeur Preud’homme. Ensuite et par-dessus tout, l’idée de devoir affronter ses parents et leur immense déception, eux qui pendant presque deux ans, s’étaient saignés aux quatre veines pour le placer à Tarbe. Tout cela pour aboutir à une expulsion humiliante et radicale, car Pierre le savait, Krémer userait de tout son pouvoir pour l’empêcher d’être admis dans un autre établissement catholique et n’hésiterait pas pour cela à l’accabler de tous les péchés du monde.
(p.350) Et Galderoux éprouvait une terreur indicible de l’enfer. La même terreur que tous ses condisciples, que tous les habitants de son village, de sa commune, de sa province, de son pays. La même terreur que les habitants des régions où l’Église s’était implantée, et ne parlait pas de Dieu, mais du « Bon Dieu ». « Dieu est amour » répétaient à longueur de sermons les curés et toute leur hiérarchie. Mais ce « Bon Dieu » noyait la terre entière sous un déluge impitoyable, faisait tomber le feu du Ciel sur les villes impies, y foudroyant les innocents comme les luxurieux. Ce « Bon Dieu » dont on devine qu’au jugement dernier, « dies irae, dies illa » (Jour de colère, jour de vengeance), il séparera les brebis des boucs, envoyant ceux-ci aux flammes éternelles, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un « Bon Dieu » qui rejette de son paradis tous les petits innocents de quelques jours morts sans baptême, sourd au désespoir des parents qui avaient pourtant l’intention de faire baptiser leur petiot, qui choisira ses élus parmi les membres de la « vraie Eglise » uniquement, c’est-à-dire l’Église catholique romaine, rejetant d’office tous les autres dans les ténèbres extérieures : protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, païens… Sans doute les plus grands esprits des différentes époques partageaient-ils cette crainte : Racine qui, à la fin de sa vie, ne voudra plus écrire que des tragédies à sujets religieux; Luther qui, malgré son combat juste et courageux contre les abus de l’Église en matière d’indulgences, redoutait de plus en plus les affres de la mort et du jugement de Dieu à mesure qu’il avançait en âge; Michel-Ange (…) vivra ses dernières années dans une angoisse croissante, toujours dans cette tereur du jugement particulier. Nous n’en citons que trois, mais la liste est immense de ces grands esprits qui ont traîné, pendant toute leur existence, comme un bolet, cette peur du jugement et de l’enfer, boulet de plus en plus lourd à mesure que la mort approchait.
|
|
2008 |
in: VA 18/06/2008
Nécrologie « Révérendissime Père Marc Paul Mouton, O. Praem 56e Abbé de Notre-Dame de Leffe » (…)
|
|
2008 |
Nécrologie, VA 18/06/2008 « Révérendissime Père Marc Paul Mouton, O. Praem 56e Abbé de Notre-Dame de Leffe » (…) |
|
2010 |
Abbé Guy Gilbert, in : DH, 11/12/2010
/Noël Bafoué/
« Je trouve les gueuletons d’un très mauvais goût, tout comme le jeûne des musulmans en journée pour s’empiffrer au coucher du soleil est hypocrite. L’amour, le partage et la pauvreté ne sont plus au centre des préoccupations à Noël. »
|
2 Documents
19e siècle - Quand le clergé s'opposait à une école primaire neutre et menaçait les familles y envoyant leur enfants
(source: Musée Piconru / Bastogne)

Burnot (Profondeville) - cimetière particulier pour les anciens prêtres du collège

Le R.P. Léon Stockman, collabo, aumônier de la "Légion Wallonie"
(in: Eddy De Bruyne, La collaboration francophone en exil. Septembre 1944-mai 1945, Housse, Eddy De Bruyne éditeur, 1997, p.261)

