
Communism: a disaster for humanity
PLAN
1 Analyses
1.0 Generalities – assessment / balans / bilan
1.1 PAST
1.1.1 The life in the communist countries, position of the communists elsewhere
1.1.2 Revisionism
1.2 PRESENT
1.2.1 Everyday life
1.2.2 Revisionism
1.2.3 Aftermath
2 Documents
1 Analyses
1.0 Generalities – assessment / bilan / balans
|
Stéphane Courtois, éd., Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, éd. Robert Laffont, 1997
COMMUNISME : des ORIGINES FRANCAISES
LA REVOLUTION FRANCAISE avec la Terreur (p.18) “Lénine assimilait les Cosaques à la Vendée pendant la Révolution française, et souhaitait leur appliquer le traitement que Gracchus Babeuf, “l’inventeur” du communisme moderne, qualifiait dès 1795 de “populicide”. (Gracchus Babeuf, La Guerre de Vendée et le système de dépopulation, Tallandier, 1987)”
(p.68) Lénine était friand de parallèles historiques entre la Grande Révolution – française – et la révolution russe de 1917. Il avait fait part à son secrétaire de la nécessité de trouver d’urgence “notre Fouquier-Tinville, qui nous matera toute la racaille contre-révolutionnaire.” Ce fut Dzerjinski, futur patron de la sinistre Tcheka.
(p.684) “On a souligné plusieurs influences possibles pour les Khmers rouges. L’examen de la “piste française” s’impose: presque tous les dirigeants khmers rouges furent étudiants en France, et la plupart y adhérèrent au PCF, y compris le futur Pol Pot. Un certain nombre de leurs références historiques proviennent de cette formation: Suong Sikoeun, second de Ieng Sary, assure: “J’ai été très influencé par la Révolution française, et particulièrement par Robespierre. De là, il n’y avait qu’un pas pour être communiste. Robespierre est mon héros. Robespierre et Pol Pot: les deux hommes ont les mêmes qualités de détermination et d’intégrité.” – Sur l’admiration du jacobinisme comme vecteur du communisme, cf François Furet, Le Passé d’une illusion: Essais sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris, Robert Laffont, 1995.
(p.711) “Fidel Castro se référait sans cesse à la révolution française: le Paris jacobin avait eu Saint-Just, La Havane des guérilleros avait son Che Guevara, version latino-américaine de Netchaïev.” (p.712) c’est lui qui a inventé en 1960 le premier camp de concentration cubain, dans la péninsule de Guanama.
(p.795) Tout au long du 19e siècle, la réflexion sur la violence révolutionnaire a été dominée par l’expérience fondatrice de la Révolution française. Celle-ci a connu, en 1793-1794, un épisode de violence intense adoptant trois formes principales. La plus sauvage apparut avec les “massacres de septembre” au cours desquels mille personnes furent assassinées à Paris par des émeutiers, sans qu’interviennent aucun ordre du gouvernement ni aucune (p.796) instruction d’aucun parti. La plus connue reposait sur l’institution du Tribunal révolutionnaire, des comités de surveillance (de délation) et de la guillotine, qui envoyèrent à la mort 2.625 personnes à Paris et 16.600 dans toute la France. Longtemps occultées fut la terreur pratiquée par les “colonnes infernales” de la république, chargées d’exterminer la Vendée et qui firent des dizaines de milliers de morts parmi une population désarmée. (…)
François Furet (in: Terreur, in: Furet, F., Ozouf Mona, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988) montre comment apparaît une certaine idée de la Révolution, inséparable de mesures extrêmes: “La Terreur est le gouvernement de la crainte, que Robespierre théorise en gouvernement de la vertu, née pour exterminer l’aristocratie, la Terreur finit en moyen de réduire les méchants et de combattre les crime. Elle est désormais coextensive à la Révolution, inséparable d’elle, puisqu’elle seule permet de produire un jour une République de citoyens. (..)” Par certains côtés, la Terreur préfigurait la démarche des bolcheviks – la manipulation des tensions sociales par la fraction jacobine, l’exacerbation du fanatisme idéologique et politique, la mise en oeuvre d’une guerre d’extermination contre une fraction révoltée de la paysannerie. Robespierre a incontestablement posé une première pierre sur le chemin qui, plus tard, mena Lénine vers la terreur. Lors du vote des lois de Prairial, n’avait-il pas déclaré devant la Convention: “Pour punir les ennemis de la patrie, il suffit d’établir leur personnalité. Il ne s’agit pas de les punir, mais de les détruire”?
|
|
Hannah Arendt, Le gouvernement totalitaire, p. 86-93, in : Attila Özer, L’Etat, Flammarion 1998
(p.92) Le totalitarisme, tel que nous le connaissons aujourd’hui dans ses variantes bolchevique et nazie, est issu de dictatures à parti unique qui, comme les autres tyrannies, ont employé la terreur comme moyen pour instituer le désert de l’absence de compagnie et de l’esseulement. Or, lorsqu’il est parvenu au calme bien connu qui est celui des cimetières, le totalitarisme, loin d’être satisfait, transforme aussitôt et avec une vigueur accrue l’instrument que constituait la terreur en une loi objective du processus. Dans les conditions qui sont celles du totalitarisme, la terreur ne se contente pas de survivre à toute opposition politique témoignée à celui qui dirige, elle s’accroît après qu’une persécution particulièrement impitoyable a liquidé tous les ennemis, réels et potentiels. La crainte devient sans objet lorsque le choix des victimes se trouve entièrement libéré de tout rapport avec les pensées ou les actions des individus. Si la crainte est, sans conteste, la tonalité absolument dominante des pays totalitaires, elle ne peut plus servir de (p.93) guide pour des actions particulières : elle a cessé d’être un principe d’action. […] Pour insuffler le mouvement à un corps politique dont la terreur constitue l’essence, aucun principe d’action, emprunté au champ de l’action humaine – vertu, honneur, crainte — n’est plus utile ni nécessaire. Ce corps politique se fonde, au contraire, sur un principe nouveau qui, lui, fait entièrement litière de l’action humaine comme acte libre, et il substitue au désir et la volonté mêmes d’agir la soif de connaître la loi du processus selon lequel opère la terreur. Les êtres humains, pris ou jetés dans le processus naturel ou historique, à seule fin d’en accélérer le mouvement, ne peuvent être que les instruments ou les victimes de sa loi interne. Or, selon celle-ci, ils peuvent être aujourd’hui ceux qui procèdent à l’élimination des « races et des individus inaptes » ou « des classes vouées à disparaître et des peuples décadents » et, demain, ceux qui devront, pour les mêmes motifs, être eux-mêmes sacrifiés. Ce dont la domination totalitaire a besoin, en guise de principe d’action, c’est d’une préparation des individus qui les destine à remplir aussi bien la fonction de bourreau et celle de victime. Or, cette double propédeutique, succédané du principe d’action, n’est autre que l’idéologie.
|
|
Philippe Forest, 50 mots clés de la culture générale contemporaine, éd.Marabout, 1991
(p.331-332) Alexandre Zinoviev : la réalité du communisme
Mathématicien, philosophe et romancier, Alexandre Zinoviev, non sans provocation, se situe délibérément à rebours de toutes les interprétations habituelles du communisme et du totalitarisme. «L’idée dominante, écrit-il, que l’on se fait du communisme à travers le monde est celle d’une invention de malfaiteurs (ou de génies), introduite de l’extérieur et imposée par le mensonge et la force. » Les soviétologues occidentaux, dans le confort de leurs bibliothèques et de leurs universités, considèrent le communisme comme une gigantesque erreur qui ne saurait être que passagère et prédisent, de manière aussi vaine que répétitive, l’écroulement prochain du système : asservi, le peuple russe va secouer ses chaînes et renverser un pouvoir qui ne se maintient que par le mensonge idéologique et la répression policière; colosse fragile, le communisme est condamné à disparaître et de ses ruines, naîtra une humanité réconciliée dans le respect de la démocratie. Rien de plus naïf et de plus criminel que cette conception simpliste du communisme, affirme Zinoviev : et rien, pas même la perestroïka, ne justifie que l’on s’y rallie. Le communisme n’est pas l’exception aberrante d’un système sain dont la règle serait la liberté et la démocratie. Malgré tous les discours lénifiants de la bonne conscience occidentale, c’est l’inverse qui est vrai. C’est la liberté qui est l’exception fragile dans un système dont la règle rigide est celle de la servitude : « Le communisme n’est pas une invention de malfaiteurs, un défi au bon sens et à la nature de l’homme, comme le supposent ses adversaires, il est au contraire un phénomène naturel dans l’histoire de l’humanité et découle pleinement de la nature de l’homme dont il est le reflet. Né de cet irrésistible appétit de survie qui habite dans chacune de ces créatures bipèdes appelée homme, de son désir d’adaptation parmi la foule de ses semblables et de son besoin de sécurité, il est le fruit de ce que j’appellerai l’esprit communautaire. Ce sont justement les moyens mis en place pour faire écran à cet esprit communautaire (autrement dit la civilisation), tels que le droit, la morale, la publicité, la religion, l’humanisme et tous les moyens qui, dans une certaine mesure, visent à protéger l’homme de ses voisins et à le défendre contre le pouvoir du groupe, qui font figure d’inventions et de fables. » Le communisme n’est donc pas un accident de l’histoire mais la traduction la plus stable, la plus profonde, mais aussi la plus néfaste des composantes de la nature humaine : ce que Zinoviev nomme le « communautarisme » et qui n’est rien d’autre que cette force d’inertie qui pousse les individus et les groupes à rechercher la satisfaction la plus immédiate au prix du moindre effort, à instaurer dans chaque cellule sociale des relations de servitude, de dépendance, d’incurie et de violence. Il est donc vain d’espérer la fin du communisme car il est le régime le plus « naturel » qui soit, celui qui, enserrant l’individu dans la collectivité, lui permet de traduire dans la vie sociale ses instincts les plus vils mais aussi les mieux enracinés en lui. Ainsi, l’avertissement que Zinoviev, avec urgence, nous adresse est le suivant. Le communautarisme n’est rien d’autre que la pente la plus profonde de notre nature et, déboulant à leur tour cette pente, les pays occidentaux pourraient bien en être les prochaines victimes.
|
Stéphane Courtois, “Les communistes sont des professionnels du mensonge”, LB 09/12/1997
Bilan: pas loin d’une centaine de millions de morts, victimes des purges et des famines, des exécutions sommaires et des camps de travail.
“En 1945, les vainqueurs se sont emparés des archives des vaincus, et, depuis, les chercheurs n’ont pas cessé d’étudier le phénomène nazi. Pour le communisme, on commence à peine.”
|
|
Stéphane Courtois, éd., Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, éd. Robert Laffont, 1997
LE COMMUNISME DANS LE MONDE
BILAN
(p.14) Nous pouvons établir un premier bilan chiffré qui n’est encore qu’une approximation minimale et nécessiterait de longues précisions mais qui, selon des estimations personnelles, donne un ordre de grandeur et permet de toucher du doigt la gravité du sujet:
URSS: 20 millions de morts Chine: 65 millions de morts
Vietnam: 1 Corée du Nord: 2 Cambodge: 2 Europe de l’Est: 1 Amérique latine: 150.000 Afrique: 1,7 Afghanistan: 1,5 mouvement communiste international et partis communistes non au pouvoir: une dizaine de milliers.
Le total approche la barre des cent millions. (p.25) le nazisme 25 millions.
(p.25) “Les méthodes mises en oeuvre par Lénine et systématisées par Staline et leurs émules non seulement rappellent les méthodes nazies, mais bien souvent leur sont antérieures.” (p.469) Les haines et les jalousies réciproques, si fréquentes dans toute société de valets d’un maître colonial, ne sont pas à négliger.
METHODES COMMUNISTES
(p.26) Transport des déportés par wagons à bestiaux. (p.99) Le vieux fond d’antisémitisme populaire, toujours prêt à refaire surface, associa immédiatement Juifs et bolcheviks en 1919. Cet amalgame était favorisé par la présence parmi les dirigeants les plus connus de Trotski, Zinoviev, Kamenev, Rykov, radek, etc., tous juifs. (p.100) Une des armes les plus efficaces du poivoir bolchevique était l’arme de la faim.
(p.124) Contre les révoltes paysannes en 1922, bombardement de villages aux gaz asphyxiants. (p.197) En 1933, déportation de Tsiganes. (p.249) Déportation de Kurdes en 1944. (p.272) limogeage des Juifs à partir de 1949, exécutions (p.275) chasse aux Juifs dès 1952 dans les appareils des partis de toute l’Europe de l’est (p.302) antisémitisme en Hongrie communiste (rafles en 1919) (p.350) 400.000 Juifs polonais périrent en déportation en Russie. (p.384) /Comme les communistes grecs le feront plus tard, au cours de la guerre civile, avec la déportation vers les pays communistes limitrophes d’enfants raflés dans les zones qu’ils occupaient,/ pendant la guerre civile, des milliers d’enfants espagnols âgés de 5 à 12 ans avaient été envoyés en URSS. Sur 5000 enfants, 2000 moururent. (p.432) Les derniers pogroms ou tentatives de pogrom de l’Histoire européenne ont eu lieu en 1946 en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie. (p.530) Un mythe a longtemps couru en Occident: bien sûr, la Chine n’était pas un modèle de démocratie, mais “au moins Mao a réussi à donner un bol de riz à chaque Chinois.” Il n’ a malheureusement pas plus faux. Mao et le système qu’il créa furent directement responsables de ce qui restera (on l’espère …) la plus meurtrière famine de tous les temps, tous pays confondus, en valeur absolue. (p.534) Lors de cette grande famine de 1959-1961 (entre 20 (chiffre quasi officiel en Chine depuis 1988) et 40 millions de personnes), en 1959, dans le ‘Quotidien du Peuple, “des professeurs en médecine insistent sur la physiologie particulière des Chinois, qui leur rend superflues graisses et protéines”. (p.536) En 1960, des activistes et Mao soutiennent que cete famine est due au fait que des paysans cachent le grain. Répression et dérapages terrifiants: dans le Henan, on tuera des enfants, mis à bouillir, puis utilisés comme engrais – alors même qu’une campagne nationale incite à “apprendre du Henan”. (p.545) le système concentrationnaire chinois, le laogai (/cf le goulag russe/) (p.557) Des “boîtes à dénonciations’ figurent partout, en Chine, dans les rues des villes. (p.566) Les plus jeunes furent toujours les plus violents, les plus acharnés à humilier leurs victimes. (lors de la Révolution culturelle chinoise) (p.572sv) La xénophobie, vieille tradition chinoise. Persécutions des minorités, mongole, tibétaine, dans le Yunnan…) (p.612) /Comme dans d’autres contrées dirigées par des communistes,/ en Corée du Nord, les handicapés sont victimes d’un ostracisme sévère. ils sont déplacés à l’extérieur des villes. En outre, les nains sont envoyés dans des camps et là, isolés, on les empêche d’avoir des enfants/ “La race des nains doit disparaître”, a ordonné Kim Jong Il lui-même … (p.618) Le communisme ne fut nulle part incompatible avec le nationalisme ou même la xénophobie, et en Asie moins encore qu’ailleurs. (p.723) En 1980, Castro fit libérer les malades mentaux et les petits délinquants. Exode massif vers l’étranger.
(p.730) Au Nicaragua, les sandinistes s’attaquèrent en 1979 aux quelque 150.000 Indiens (Miskito, Sumu ou Rama) installés sur la côte atlantique ainsi qu’ à des Créoles et des Ladinos: meurtres, emprisonnements et déportations. (p.790-791) Près de 30.000 enfants afghans de 6 à 14 ans furent envoyés en URSS. Les parents qui s’y opposaient étaient emprisonnés. On les formait comme enfants espions chargés d’infiltrer la Résistance. Pour les terroriser, on n’hésita à pendre des enfants récalcitrants devant eux ou de les torturer à mort à l’électricité.
|
|
Stéphane Courtois, éd., Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, éd. Robert Laffont, 1997
(p.779) Le communisme en Afghanistan Durant ces 14 années de guerre, les Soviétiques et les communistes afghans ne maitrisèrent guère plus de 20 % du territoire. ils se contentèrent de tenir les grands axes, les principales villes, les zones riches en cérales, en gaz et en pétrole dont la production était bien sûr destinée à l’Union soviétique. “L’exploitation des ressources et la mise en valeur de l’Afghanistan entrent dans le cadre d’une économie d’exploitation coloniale typique: la colonie fournit les matières premières et doit absorber les produits industriels de la métropole, faisant ainsi tourner son industrie.”
(p.825) En pleine période brejnevienne, l’URSS a édité un timbre commémorant le 50e anniversaire de la Tcheka et publia un recueil d’hommage à la Tcheka.
|
|
Stéphane Courtois, éd., Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, éd. Robert Laffont, 1997
(p.534) Lors de cette grande famine de 1959-1961 (entre 20 (chiffre quasi officiel en Chine depuis 1988) et 40 millions de personnes), en 1959, dans le ‘Quotidien du Peuple, “des professeurs en médecine insistent sur la physiologie particulière des Chinois, qui leur rend superflues graisses et protéines”. (p.557) Des “boîtes à dénonciations’ figurent partout, en Chine, dans les rues des villes. (p.661) Au Cambodge, sous Pol Pot, “pour survivre, il fallait d’abord et avant tout savoir mentir, tricher, voler, et rester insensible.”
LA COLLABORATION CHEZ LES BOLCHEVIKS (RUSSES,…)
(p.73) Dzerjinski avait recruté une centaine d’hommes, pour la plupart d’anciens camarades de clandestinité, en majorité polonais ou baltes. (p.274) Beria, originaire de Mingrélie, région de Géorgie. (p.397) Feliks Djerzinski, un Polonais, n’hésita pas, /comme Beria, bras droit de Staline, en Mengrélie, région de Géorgie d’où il provenait,/ a diriger une répression terrible contre ces compatriotes polonais. (p.420) En 1955, en Pologne, le réseau d’informateurs comptait toujours 34.000 collaborateurs … (p.823) Staline, un Ossète du Caucase
|
|
Stéphane Courtois: “Choisir entre Satan et Belzébuth”, in: LS, s.r.
La terreur, dites-vous, est au centre du modèle communiste. Pourquoi? – On ne connaît aucun régime communiste qui n’ait pas pratiqué la terreur. Une partie des crimes commis par ces régimes, ceux de tuer les gens pour ce quels sont et non pas pour ce quels font, sont des crimes contre l’humanité. Quand, par exemple, on laisse crever de faim des millions de paysans ukrainiens parce qu’ils sont des koulaks et des Ukrainiens…
Les communistes français refusent cette hypothèse… – Ils ne peuvent pas l’admettre car accepter qu‘il s’agit de crimes contre L’humanité nous amène automatiquement vers la comparaison entre le commik nisme et le nazisme.
Comment expliquer la dimension planétaire du communisme? Qu’ont en commun des régimes si différents que ceux de Hanoï et Moscou, ou de Pékin et La Havane? – Le coeur du régime est toujours le même: un parle unique, une idéologie unique obligatoire, un principe de chef, un asservissement de l’appareil d’Etat au parti, la terreur de masse…
Hitler ne l’a pas réussi… ? A cause de son ultranationalisme. Comment voulez-vous qu’Hitler, qui annonce l’asservissement des autres nations, puisse les rallier? Par contre, Lénine a fait une promesse de libération mondiale pour tous les pauvres. Son génie, c’est la mystification, son art de la mise en scène. Les bolcheviques sont quand même les inventeurs de la propagande moderne, la désinformation…
|
|
La Longue Marche de Mao ne fait en fait pas plus de 9000 km suivant la propagande chinoise, mais seulement (sic) 5550, LB 06/11/03
|
|
Michel Paquot, Avec Stéphane Courtois, voyage au bout de la terre communiste, AL 12/01/1998
Directeur de recherches au CNRS en France, il a dirigé une équipe d’une dizaine d’historiens qui ont fait, pour la première fois, le bilan des crimes commis par les régimes communistes dans le monde. “Le Livre noir du communisme” – Robert Laffont, 840 pages.
– L’intelligence de Lénine est d’avoir créé un mythe. – Les grands systèmes totalitaires, comme également le nazisme, ont tous fonctionné sur des mythes. Le mythe léniniste, celui de la révolution prolétarienne mondiale, était totalement mensonger. En 1918, les bolcheviques tirent au canon sur des ouvriers mécontents, puis sur les marins de Kronstadt, etc. Or, actuellement, des gens croient toujours à ce mythe. Ou à celui de Staline, “le petit père des peuples”, à la gloire de qui, par exemple, les éditions belges EPO, établies à Bruxelles, ont consacré un ouvrage. Comment peut-on encore contester aujourd’hui, dénonçant la “propagande impérialiste”, que ce tyran soit responsable de millions de morts?
– Une des caractéristiques de tous les régimes communistes est la volonté d’abattre les élites, qu’elles soient culturelles, scientifiques ou autres. cela s’est vu aussi dans le Cambodge de Pol Pot, dans la Chine de Mao, etc. – Il y a, dans la pensée marxiste-léniniste, une dimension messianique aberrante qui est le renversement des valeurs: ceux qui sont en haut passent en bas et inversement. C’est une ruse de la part d’intellectuels ratés qui ont trouvé des compensations dans l’action et qui préfèrent s’entourer de gens incultes – en face de qui ils passent pour des génies – plutôt que plus intelligents qu’eux.
|
|
“ Le Livre noir du communisme ” démonte un système et étale ses horreurs. Bien sûr, la controverse est au rendez-vous.
Un grand livre d’histoire ou une imposture intellectuelle, des chiffres manipulés, voire faux?
Aucun livre historique n’a, ces dernières années, suscité autant de critiques, de polémiques et d’attaques. Il est vrai qu’il y a de quoi discuter. Six auteurs (Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin), quatre collaborateurs, 850 pages, 15 pages d’index recensant quelque 1.500 noms: “Le Livre noir du communisme – (Ed. Laffont), avec pour sous-titre : -Crimes, terreurs, répression-, c’est la première initiative qui vise la mise à jour globale et planétaire de l’essence même du phénomène communiste.
Dans sa préface, durement attaquée, le maitre d’oeuvre, Stéphane Courtois, prétend avoir pris toutes les précautions avant de formuler le constat que la terreur fut dès l’origine l’une des dimensions fondamentales du communisme moderne, propre à l’ensemble du système, durant toute sa période d’existence. Autrement dit, que le crime de masse a été érigé par les communistes en véritable système de gouvernement.
Le livre tente de dresser un premier bilan chiffré de la terreur, certes une approximation, mais qui permet de toucher du doigt la gravité du sujet
Gravité-, c’est un euphémisme. C’est effroyable. URSS: 20millions de morts; Chine:65millions; Europe de l’Est, Cambodge, Afghanistan, … Le total, selon Courtois, approche la barre des 100 millions de morts. Hallucinant? Sans doute. Mais l’accumulation des colonnes comptables n’est que le moyen de comprendre le phénomène communiste qui a marqué au fer rouge (au propre et au figuré) le XXe siècle et qui le marque encore. Le communisme est au pouvoir en Chine ou à Cuba, et il est significatif en France… Le livre, un grand succès, a fait des vagues, avant même sa parution. Les critiques, extérieures mais venant aussi de certains coauteurs, portent aussi bien sur des questions scientifiques que sur des enjeux (ou des… nostalgies) idéologiques.
Pas étonnant. -Le Livre noir tente de prouver que le crime de masse était au coeur même du système communiste, que la terreur communiste a commencé non pas sous Staline mais était déjà – dans Lénine.
Il constate, dans la foulée, qu’on peut – qu’on doit – comparer le nazisme et le communisme, deux totalitarismes intrinsèquement criminels dans leurs fondements mêmes.
Bref, le défi que ce livre essaie de relever, c’est de comprendre comment un énorme espoir a tourné au cauchemar. Ce pari est-il gagné? Trop tôt pour le dire. Une première victoire est évidente: on en parle. Le “ Livre noir” est une étape désormais incontournable sur le chemin de la connaissance et de la compréhension du phénomène communiste, crucial pour l’histoire du XXesiècle.
L’histoire, a-t-on dit, a d’abord été celle des pouvoirs, puis celle des sociétés, et maintenant elle est aussi celle des opprimés et des victimes. Pour un livre, c’est un résultat remarquable. Pour qu’on puisse y arriver, il fallait ouvrir le débat. Le -Livre noir – y a parfaitement réussi. Peut-être même trop parfaitement.
P. Mi
|
|
Michael Klonovsky, “Vieh, Menschendreck”, Focus 4/2000, p.119-122
Konrad Löw, ein Bayreuther Professor kämpft einsam gegen das Klischee vom Humanisten Karl Marx.
(p.120) Ferdinand Lasalle? Ein “jüdischer Nigger”, ein “Vieh”, dessen “zudringlichkeit” “niggerhaft” sei. Wilhelm Liebknecht? “Esel”, “Narr”, “Biederindvieh”, “wird jeden tag dümmer”, (…) (p.121) das Privateigentum müsse “vermittels despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht” eliminiert, die Familie als Keimzelle aller Bürgerlichkeit “theoretisch und praktisch vernichtet werden”. Das “letzte Wort der sozialen Wissenschaft” laute: “Kampf oder Tod; blutiger Krieg oder das Nichts”.
(p.122) “Sind das Worte eines Menschen, in dessen Trachten Gulag, Massaker, Stasi mitnichten lagen? Löw, dessen Buch sich streckenweise wie ein Verfassungsbericht liest, ist anderer Meinung: “Bei Marx und Engels sind es Tausende Worte, die den Weg in den Archipel Gulag weisen”.
|
|
Nadia Selezneff /Bruxelles/, Lénine démystifié, LB 03/04/2000
Note de Lénine au Politburo le 19 mars 1922: “C’est précisément maintenant, et maintenant que les régions en famine mangent de la chair humaine …, que nous pourrons écraser toute velléité de résistance, avec une telle brutalité, qu’on en parlera pendant des dizaines d’années.”
|
|
P.V., Le socialisme de Marx à Hitler, LB 30/03/2000
George Watson, prof. de littér. anglaise, Univ. de Cambridge: De ” bon nombre d’écrits “oubliés”, les grands classiques du socialisme et du communisme, émerge une “idéologie qui ne fut pas toujours, loin s’en faut, ni vertueuse, ni soucieuse des pauvres gens, ni raciste, ni pacifiste, … Même des ferments des pratiques génocidaires du XXe siècle ne sont pas absents de ces sources. Ainsi quand Engels, en 1849, appelle à l’extermination des Hongrois soulevés contre l’Autriche (entre autres) ou quand Marx lui-même, dans un article de sa revue “Neue Rheinische Zeitung” publié en 1852, condamne sans appel “ces peuplades moribondes, les Tchèques, les Slovènes, les Dalmates, etc.” Ainsi encore, quand Bernard Shaw, grand admirateur de l’Union soviétique, presse avec un bel esprit d’anticipation, dans “The Listener” en 1933, les chimistes de découvrir, pour accélérer l’épuration des ennemis du socialisme, “un gaz humanitaire qui cause la mort instantanée et sans douleur, en somme un gaz policé” … Ce n’est pas sans raison qu’Adolf Hitler se réclamera du socialisme et déclarera qu’il a “beaucoup appris du marxisme” … Antisémitisme, courants totalitaires, conservatisme aussi – les dirigeants travaillistes britanniques s’opposèrent aux projets de service national de santé de William Beveridge – …: le dossier est impr(…) et ses données dûment contrôlables, même s’il y a peu de chance que l’Internationale socialiste pose, un de ces prochains jours, un acte solennel de repentance.”
(George Watson, Le littérature oubliée du socialisme. Essai sur une mémoire refoulée, Nil Editions, 224 p., 748 F (18,54 euros))
|
|
Risack Maurice (BXL), Extrémismes, Le Vif 07/09/2001
Combien de fois faudra-t-il rappeler que, face aux assassins communistes, les fascistes, tout odieux qu’ils sont, font figure de débutants inexpérimentés et d’amateurs même pas éclairés ? (…) Le seul allié de Hitler fut Joseph Staline. Entre la « peste brune » et la « lèpre rouge », il ne faut pas choisir, il faut éradiquer les deux… Hue et Le Pen, même combat : il n’y pas plus de néocommunistes que de néofascistes. Les tenants de ces deux idéologies ont toujours pour but d’éliminer les démocraties par la ruse d’abord ; par la force, la terreur et les massacres ensuite.
|
|
Rudd Alyson, The greatest dictator, he Times 04/06/2005
Mao: 70 million dead, a nation taken back to the stone Age.
|
|
Stalin and his cursed cause, in: The Economist, 30/03/2013
First and foremost, Stalin was a communist, who believed that the sacred cause justified the most extreme measures: what non-believers would call unparalleled barbarity. (…) Communism probably killed around 25m: roughly the same toll of death and destruction as that wrought by the Nazis.
|
|
Hannah Arendt, Le système totalitaire, éd. du Seuil, 1972
(p.42) Après la liquidation du pouvoir des soviets, obstacle au pouvoir absolu du parti, les bolchéviques passèrent alors à la liquidation des classes. D’abord les classes possédantes: la nouvelle classe moyenne des villes et les paysans. (p.43) “Ensuite fut liquidée la classe des ouvriers.”
|
|
Chine / Mao : quatre-vingt millions de morts, LB 18/07/1994
Jusqu’à 80 millions de Chinois seraient morts de «causes non naturelles,, pendant que le président Mao a dirigé la Chine, selon le « Washington Post » qui a entamé dimanche le premier de deux articles qu’il consacre au sujet. Ce chiffre est supérieur d’une vingtaine de millions à ceux qui étaient retenus jusqu’à présent. Ces nouvelles données, figurant dans un document de l’Institut pour la Réforme du Système dirigé par Zhao Ziyang, ancien chef du parti communiste chinois, sont citées par Chen Yizi, un ancien responsable du parti aujourd’hui à l’université de Princeton. Rien que pendant la période du « grand bond en avant », entre 1959 et 1961, ajoute-t-il, quelque 43 millions de personnes seraient mortes de faim, sans compter les dizaines de milliers d’opposants qui ont été liquidés. Simultanément, d’après le « Post -, qui cite un rapport interne préparé en 89 par l’Académie des Sciences sociales, 6à cas de cannibalisme ont été relevés dans la région de Fengyang. (AFP)
|
Mao, in: Knack Historia, sept. 2016
(p.38) 19,6 MILJARD DODE MUSSEN
Wat de landbouw al evenmin helpt, zijn de energieverslindende campagnes waarmee Mao zijn volk almaar bestookt. Een van de meest bizarre is in de lente van 1958 de campagne te- gen ‘de vier pesten’: muggen, vliegen, ratten én mussen (omdat die graan eten). Iedereen moet minstens tien vliegen per dag doodslaan en ze in een luciferdoosje verzamelen. Vindingrijke Chinezen beginnen vliegenlarven te kweken om hun quotum te halen. De strijd tegen de mussen wordt gevoerd met gongs en pannen waarop dag en nacht wordt geroffeld. Volgens de partijpers va lien er tussen maart en novem- ber 19,6 miljard mussen dood uit de lucht. Met hen sterven ook massaal veel insecteneters. In de plaats van de mussen duiken er overal sprinkhanen op die veel meer schade aan de landbouw aanrichtten. Na één jaar wordt de ‘vergissing’ stilletjes toegegeven. Bedwantsen worden uitgeroepen tôt vervangende pest.
(p.39) Ook in 1959 eten de boeren noodgedwongen gras en boomschors, wilde kruiden en wortels. Kannibalisme is volgens diverse politierappor- ten in opmars. Hongerlijdende boeren ruilen onder elkaar hun dochters om ze te kunnen op- eten. Mao’s lievelingsslogan ‘Revolutie is geen gezellig etentje’ klinkt hen gruwelijk in de oren.
Vrouwen zijn de grootste kwetsbare groep tijdens de Grote Sprong Voorwaarts. Frank Dikotter beschrijft hoe vrouwen in de winter soms naakt moeten werken of naakt door de straten paraderen, om ‘feodale taboes’ te door- breken en ‘voorrang te geven aan de revolutie’. Hun dochters worden voedsel.
(p.54) De beulen van de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie worden onder zijn bewind nooit systematisch berecht — niet onder Deng, noch later. Met de afkondi- ging van de eenkindpolitiek in 1979 wordt een campagne gelanceerd die in wreedheid soms niet onderdoet voor Mao’s uitwassen. Vrouwen worden tôt abortus gedwongen of gesterili- seerd in abominabele omstandigheden. Deson- danks wordt Deng in datzelfde jaar 1979, in de VS ontvangen als een bevrijder.
(p.62) LUSHAN, MEER DAN EEN VAKANTIEOORD, 1961
Het vakantieoord Lushan ligt op een hoog- te, dikwijls gehuld in wolken, die nadien weer even snel verdwijnen. Het is in de negentiende eeuw door Europeanen aangelegd, op zoek naar verfrissing tijdens de zomerse hitte. Er staan meer dan achthonderd villa’s in verschillende Europese stijlen. Jarenlang is Lushan het zomerverblijf van Chiang Kai-Shek, tot zijn vlucht in 1948. Aanvankelijk verblijft Mao in dezelfde villa, maar die bevalt hem niet. Daarom laat hij een nieuw landgoed optrekken vlakbij een meer of réservoir, zodat hij geregeld kan zwemmen.
(p.65) DE VERRASSING VOOR TINDEMANS, 1975
Een van de laatste buitenlandse politici die Mao ontmoet heeft, is de Belg Léo Tindemans. Hij brengt van 18 tôt 27 april 1975 een zorg- vuldig voorbereid bezoek aan China. Hij wordt er met zijn delegatie vorstelijk ontvangen en in zwarte, zware wagens met gordijntjes rondge- reden. « Bij de Chinese prominenten bleven die gordijntjes dicht, ik was de enige die nieuwsgierig naar buiten keek en de bevolking (p.66) begroette », schrijft hij in zijn memoires. Op een dag wacht hem een verrassing: een bode komt hem melden dat Mao hem en zijn delegatie wil ontvangen. « Bij de begroeting rees hij traag uit zijn zetel. Hij sprak moeilijk. Het geluid dat hij voortbracht, deed denken aan de pogingen tot blaffen van een oude hond. » Mao vraagt Tindemans uit welk land hij komt en begint nadien een tirade tegen de Sovjet-Unie. Hij waarschuwt het Westen voor de onbetrouwbaarheid van het land. Nadien heeft Tindemans nog een gesprek met Zhou Enlai, die volgens hem een « westers, intelligent en karaktervol gezicht heeft ». Tindemans zal zijn reis naar China nooit vergeten.
(p.102) China-kenner Jan van der Putten zet Mao op zijn plaats. ‘t Is te zeggen: kent hem zijn juiste plek toe in de eeuwenlange (geo)politie- ke geschiedenis van China. « Als reactie op de vernederingen van de negentiende eeuw komt er een nationalistische beweging op gang. In die période beginnen de Chinezen zichzelf ‘het gele ras’ te noemen. Of bestempelen zichzelf plots als Han-Chinezen, een verwijzing naar de tweede dynastie, de Han (206 v. Chr.- 220 na Chr.). Twee mentale constructies, want wat Han-Chinezen heten te zijn, zo ongeveer 90 procent van de bevolking, is een verzamelnaam voor verschillende groepen die zoveel talen en dialecten spreken dat ze elkaar nauwelijks verstaan. Een amalgaam, kunstmatig in het leven geroepen door de Chinezen zelf om een nationalistisch gevoel te kweken. Ook het idee ‘gele ras’ bestaat daarvoor niet: Chinezen beschouwden zichzelf altijd als blank. »
‘Het gele ras,’ dat klinkt behoorlijk racistisch en pejoratief. Vreemd dat een volk zichzelf een dergelijke term aanmeet.
(p.102) « Racisme is behoorlijk Chinees. Wanneer Barack Obama in 2009 president wordt van de Verenigde Staten, zijn de racistische opmerkingen in China niet van de lucht. Vraag aan Afrikanen die in China wonen hoe ze worden aangekeken en behandeld… Officieel is er geen racisme, er is zelfs een enorme samenwerking tussen China en Afrika, maar in de praktijk… »

1.1 PAST
1.1.1 Life in the communist countries
Cambodia / Kampuchea / Cambodge
Le comptable de la mort, LB 01/08/2007
Dans les romans du Tchèque Bohumil Hrabal, témoin d’un autre génocide, l’espoir succédant au temps des tortionnaires étouffe sous l’absurdité d’une « trop bruyante solitude ». Le non-sens pénètre tous les acteurs du drame, comme une « cruauté ramassée du destin ». Professeur de mathématiques, le Cambodgien Duch avait appliqué une précision numérique à la machine à tuer du régime Pol Pot. « Il supervisait avec soin le service des morts. Il avait même attribué des jours spécifiques en fonction des types de prisonniers à exécuter: un jour pour les épouses des ennemis, un autre pour les enfants, un autre pour les travailleurs », écrit la journaliste Elizabeth Becker dans « Les Larmes du Cambodge ». Comme à Nuremberg, comme Eichmann, comme Mengele, Duch a toujours nié les accusations de « crimes contre l’humanité ». Son avocata répété que son client n’avait fait « qu’obéir aux ordres ». Son parcours est pourtant édifiant. Communiste, il rejoint les Khmers rouges mais est arrêté et torturé par les forces de sécurité du prince Norodom Sihanouk. En 1970, il prend la responsabilité des prisons. A Phnom Penh, le centre Tuol Sleng ne désemplit pas. Méticuleux, Duch tient des archives exhaustives, gardant photos et « aveux » extorqués qui permettront plus tard aux historiens de retracer les horreurs subies par les victimes du régime. Ultime épisode: en 1995, Duch se convertit au christianisme, comme si cet acte devait se déduire de l’absurde. (O.S.)
Cuba
|
Farkas Alessandra, « Novemila cubani uccisi dalla dittatura del líder máximo », CDS 06/01/2006
Fidel Castro che in passato è riuscito a sedurre luminari quali Norman Mailer, Jean-Paul Sartre, Jesse Jackson e Ted Turner. (…) In New Jersey, il ‘Cuba Archive Project’ lavora da anni per documentare il costo, in vite umane, di cinque decenni di dittatura cubana. Fino a oggi l’archivio ha catalogato la morte di 9.240 persone. Secondo l’economista Armando Lago, direttore delle ricerche, « circa 77.000 cubani hanno perso la vita cercando di scappare dall’ isola. »
|
|
Zdenek Kedroutek, , in: Geschichte 11/2003, S.60
(…) Ernesto Guevara wurde in den 1960er-Jahren von der Wohlstandjugend des Westens begeistert gefeiert. Doch war es nie Guevaras Ziel, irgendwo demokratische Strukturen zu schaffen – ihm ging es höchstens darum, Diktatoren durch Diktatoren zu ersetzen, und dieses Ziel verfolgte er mit brutalem Elan. Hunderte Mitstreiter liess er im Gefängnis La Cabana hinrichten; er, nicht Castro, führte das System der Arbeitslager in Kuba ein, und auch kein Wort über sein Luxusleben in Havanna nach der geglückten Revolution…
|
|
dreuzinfo 27/11/2016 Jean-Patrick Grumberg le 26 novembre 2016 Se souvenir des crimes de Fidel Castro Fidel Castro est mort à l’âge de 90 ans. Voici quelques-uns des pires crimes du dictateur communiste. En janvier 2003, Castro a été poursuivi en Belgique par José Basulto, le président de l’ONG « Frères du secours » pour crime de guerre et crimes contre l’humanité. Grâce à l’aide du gouvernement d’alors, le procès fut ajourné et la Cour de cassation lui accorda le 12 décembre 2003 « l’immunité fonctionnelle » (1). Fidel Castro ne s’est pas contenté de torturer, terroriser, et exécuter ses opposants, il rechercha aussi à en tirer une vente, rappelle le Wall Street Journal (2) dans un article du 30 décembre 2005 : Le 27 mai 1966, 3,5 litres de sang par personne furent médicalement ponctionnés sur 166 civils et militaires cubains par décision de Fidel Castro, et vendus au Vietnam communiste au prix de 100 dollars le litre. Après la prise de sang, les 166 condamnés, en état d’anémie cérébrale, paralysés et inconscients, furent emmenés sur des brancards et exécutés. · Le Projet des Archives de Cuba, une association sans but lucratif basée dans le New Jersey à Chatham, et qui s’est donnée comme mission de documenter les crimes de Castro depuis mai 1952, a jusqu’à ce jour, réussi à documenter avec précision 9 240 des victimes de Castro. · La présidente de Archivo Cuba Maria Werlau estime que le nombre total de victimes est probablement de 10 fois supérieur. · Armando Lago, économiste de Harvard, a étudié le coût de la révolution cubaine et estime que près de 78 000 innocents ont été tués par le dictateur. · Dans The Black Book of Communism*, Armando Lago écrit qu’au moins deux sources différentes ont documenté pour chaque mort, l’assassinat d’environ 97 000 personnes par le régime de Castro. 30 000 exécutées par les pelotons d’exécutions, 2 000 lors d’assassinats extrajudiciaires, 5 000 en prison, battus ou torturés par les gardiens ou refus de soins médicaux, et 60 000 qui ont tenté d’échapper à l’enfer cubain par la mer. · Dans les « vrais chiffres des archives de Cuba » (3), du 1er janvier 1959 au 25 mars 2005, le nombre des victimes non combattantes de Castro se monte à 87 073 morts. · Miguel A. Faria, dans Cuba in Revolution* paru en 2002, écrit à la page 415 : · A ces massacres d’innocents, il faut ajouter les 5 300 personnes qui ont trouvé la mort en combattant le régime dans les montagnes Escambray (principalement des fermiers et leurs enfants) et la baie des Cochons. · Et environ 14 000 Cubains furent exécutés à l’étranger, notamment par les 50 000 soldats qu’il a envoyés en Angola dans les années 1980 pour aider le régime soutenu par l’URSS dans son combat contre Unita. « La méthodologie de Castro, explique Archivo Cuba, était très semblable à celle utilisée en Pologne et en Allemagne de l’est, moins mortelle que les purges de Staline, mais tout aussi efficaces pour éliminer les opposants. » Dès les tout premiers jours de la révolution, Castro ordonna des exécutions sommaires dans le but — très vite atteint — d’établir une culture de la peur qui élimina rapidement toute résistance. Puis, dans les décennies suivantes, il s’assura de la soumission du peuple cubain en prolongeant l’état de terreur. Emprisonnements dans des conditions inhumaines qui débouchaient presque toujours sur la mort, torture systématique et d’une cruauté extrême, et privations. Archiva Cuba a également documenté que 5 600 Cubains ont été exécutés devant des pelotons d’exécution, et environ 1 200 lors « d’exécutions extrajudiciaires». Le criminel Che Guevara, sanguinaire acolyte, fut l’un des bourreaux qui exécuta certains de ces crimes. · En 1959, à La Cabaña Fortress, au moins 151 personnes innocentes furent alignées et assassinées par lui. · Parmi les 94 enfants dont on a pu documenter la mort sous les ordres du Che, 22 ont été exécutés par ses escadrons et 32 lors d’exécutions extrajudiciaires. Ne ratez aucun des articles de Dreuz, inscrivez-vous gratuitement à notre Newsletter. En 1981, un jeune de 15 ans, Owen Delgado Temprana, fut battu à mort sur ordre de Fidel Castro pour donner l’exemple, quand ses agents pénétrèrent de force dans l’Ambassade d’Equateur où sa famille s’était réfugiée. En 1995, Flores Diaz, 17 ans, trouva la mort dans une cellule punitive d’une prison de la Havane où il lui fut refusé tout traitement médical. On la retrouva morte dans une mare de vomi et de sang. A ce jour, Archivo Cuba a ainsi réussi à documenter 2 200 morts en prison, principalement des prisonniers politiques. · En 1971, trois enfants et leur mère qui tentaient de fuir Cuba ont été noyés lorsque leur embarcation a été intentionnellement heurtée par un vaisseau de l’armée cubaine. · En 1994, les garde-côtes cubains ont coulé un bateau de Cubains qui tentaient de rejoindre l’Amérique. A bord, 12 enfants âgés de 6 mois à 11 ans furent noyés parmi les 45 passagers. · En 1980, un bateau d’excursion qui fuyait vers la Floride avec 52 Cubains à bord fut coulé par l’aviation cubaine dans la rivière Canimar. A bord, il y avait 4 enfants. Selon les sources, entre 16 000 et 75 000 « balseros », c’est le surnom donné aux Cubains qui fuyaient l’enfer communiste dans des embarcations de fortune — ont été tués en mer par le régime Castro. Associated Press (4) rapporte qu’en 2015, le nombre de Cubains qui ont tenté de fuir Cuba et ont été interceptés par les autorités maritimes américaines était de 3 000, le double de l’année précédente. AP cite Dairon Morera, un de ces rescapés : « le plus grand rêve d’un Cubain, c’est de partir ». Il ne faut jamais oublier. Le livre noir du communisme* de Stéphane Courtois estime à 100 millions le nombre de personnes tuées pour imposer cette folie contraire à la nature humaine appelée communisme. Dans The Communist*, Paul Kengor estime que le livre de Courtois est largement en dessous de la réalité. Courtois évalue à 20 millions les crimes de Staline, mais Alexandre Yakovlev, le collaborateur du réformateur Gorbatchev cité par Kengor, place la barre entre 60 et 70 millions. Le communisme est avec le nazisme et l’islam, l’un des trois plus grands fléaux politiques sortis du cerveau humain. Fidel Castro était une des courroies de cette entreprise du crime dont le procès, contrairement au nazisme, n’a jamais été fait. La gauche et les soi-disant défenseurs des droits de l’homme posent tous un regard très tendre sur le criminel Castro. C’était un monstre, un communiste. Selon les sources, il y a aujourd’hui entre 50 et 150 prisonniers politiques à Cuba. Aucune enquête officielle contre le régime castriste n’ayant jamais été engagée par l’ONU, il n’est pas possible de savoir exactement à combien s’élèvent les crimes du dictateur Fidel Castro. Les médias se contentent de ne jamais les aborder afin de rendre romantique l’idéologie communiste. Leur espoir un jour de l’imposer à l’Occident ayant échoué, c’est vers l’islam qu’ils se sont maintenant tournés pour imposer une idéologie de mort aux Occidentaux. Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info. Sources : (3) cubaarchive.org/CA03.pdf
|
|
Gilles William Goldnadel Publié le 28/11/2016 à 13:29 Mort de Fidel Castro : l’anticommunisme est un humanisme, sauf en France !
FIGAROVOX/CHRONIQUE – Le «lider Maximo» est mort ce 25 novembre. Pour Gilles-Willes Goldnadel, au pays de Georges Marchais, le procès du communisme reste à instruire, comme en témoignent les éloges funèbres prononcés en hommage au boucher de La Havane. Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain. Il est président de l’association France-Israël. Toutes les semaines, il décrypte l’actualité pour FigaroVox. Ce n’est pas la première fois qu’ils nous font cette mauvaise farce. C’est toujours la même chose, on la croit morte. On se dit que cette fois ils ont compris. Qu’ils ne recommenceront pas. La sotte grandiloquence. Les hommages obscènes. Le déni de la réalité. Eh bien, non, ils ont recommencé. Ils ont pleuré Castro. Même la soeur, Juanita, n’ira pas à l’enterrement de son frère: «il a transformé l’île en une énorme prison entourée d’eau». Mais certains, en France sont plus fraternels envers Fidel que la soeur du geôlier. Castro n’était pas qu’un dictateur sud-américain. C’était un boucher et un équarisseur. Avant que de tenter d’expliquer l’inexplicable, un bref rappel de la réalité minimisée. Castro n’était pas seulement qu’un dictateur sud-américain. C’était un boucher et un équarisseur. Il ne s’est pas contenté de torturer et d’exécuter ses opposants, il a vendu leur sang, comme le rappelait le Wall Street Journal dans un article du 30 décembre 2005: le 27 mai 1966, 3,5 litres de sang par personne furent médicalement ponctionnés sur 166 détenus par décision de Fidel Castro et vendus au Vietnam communiste au prix de 100 $ le litre. Après la prise de sang, 866 condamnés, en état d’anémie cérébrale, paralysés et inconscients, furent emmenés sur des brancards et assassinés. Miguel A. Faria dans Cuba, une révolution écrit à la page 415 de son livre: «Depuis que Fidel Castro a pris le contrôle de l’île en 1959, les estimations les plus crédibles précisent que de 30 000 à 40 000 personnes ont été exécutées par le peloton d’exécution ou dans les geôles cubaines.» Castro ordonna des exécutions sommaires dans le but d’établir une culture de la peur qui annihila rapidement toute résistance. Dès les premiers jours de la révolution, Castro ordonna des exécutions sommaires dans le but d’établir une culture de la peur qui annihila rapidement toute résistance. Les révolutionnaires d’opérette qui le soutiennent en France lui pardonnent avec indulgence ses exactions en même temps qu’ils maudissent ordinairement la peine de mort appliquée aux assassins de droit commun. Ils passent volontiers sous silence que dans les décennies suivantes, Castro s’assura de la soumission de son peuple en prolongeant l’État de terreur. Profitons du deuil cruel qui frappe la galaxie communiste et ses compagnons pour régler aussi son compte à celui dont l’icône christique ornait les thurnes estudiantines des seventies et encore de nos jours les T-shirts de quelques attardés. Che Guevara avant que de faire le guérillero en Bolivie, dirigeait dès 1959 la sinistre prison de la Cabana, où il avait acquis le tendre sobriquet de «carnicerito» (le petit boucher). Selon Stéphane Courtois, auteur du Livre noir du communisme, ladite prison était un lieu où la torture et les mutilations étaient quotidiennes. Selon Archiva Cuba, une association basée dans le New Jersey, et qui s’est donné comme mission de documenter les crimes de Castro, en 1959, à la Cabana, au moins 151 personnes innocentes furent assassinées. Parmi les 94 enfants dont on a pu établir la mort, 22 ont été exécutés par les escadrons de l’idole de l’extrême gauchisme. Cuba demeure au 171e rang (sur 180) au classement mondial de la liberté de la presse. Quant à la situation actuelle, et sans même évoquer la faillite économique, Christophe Deloire, président de Reporters Sans Frontières, rappelait samedi que Cuba demeurait au 171e rang (sur 180) au classement mondial de la liberté de la presse. Ils ont pleuré Castro. Je ne parle pas des communistes. De Pierre Laurent, fils de Paul: «l‘artisan de l’une des plus importantes révolutions initiées au XXe siècle… La démonstration de la possibilité de bâtir une société juste et souveraine pour tous les peuples». Je ne parle pas de notre Président de la République actuel, tout content d’avoir imaginé effleurer l’Histoire en touchant un vieillard et dont les euphémismes dégoutants dans son hommage funeste: «manquements aux droits de l’homme… désillusions» montrent à quel point les socialistes évaporés n’ont pas totalement coupé le cordon ombilical ensanglanté. « À Fidel Castro, pour la révolution cubaine, la résistance à l’impérialisme U.S, l’expérience ‘socialiste’ d’un autre siècle. Hasat siempre ! » Clémentine Autain Je parle des compagnons de déroute, je parle des camarades de carnaval: Christiane Taubira, jamais économe d’une hyperbole: «le dernier géant du XXe siècle…». Je parle de Clémentine Autain, invitée gentiment sur France Inter dimanche matin pour admonester ceux qui fêtent Kissinger mais cognent sur Castro et qui mériterait d’être engagée comme humoriste de la radio active de service public pour ce tweet mémorable et émouvant: «à Fidel Castro, pour la révolution cubaine, la résistance à l’impérialisme U.S, l’expérience «socialiste» d’un autre siècle. Hasta siempre!» Je parle enfin de Jean-Luc Mélenchon, dont Onfray disait samedi au Point qu’il avait «fumé la moquette», en tous les cas un havane hallucinogène, en écrivant ce twitt halluciné: «Fidel! Fidel! Mais qu’est-ce qui s’est passé avec Fidel? Demain était une promesse. Fidèle! Fidel! L’épée de Bolivar marche dans le ciel.» Je conseille encore à tous ceux qui ne l’aurait pas regardé, de visionner l’hommage du futur candidat fraîchement adoubé par les communistes à la rapière envolée dans les cieux: Samedi matin, à l’ambassade de Cuba. Une homélie larmoyante. C’est sans doute lors d’un même petit matin blafard de 1953, que des staliniens aux yeux rougis rendirent hommage au petit père des peuples qui attend aujourd’hui son fidèle suivant. J’imagine déjà certains scandalisés par cette dernière ligne. Ces hommages publics au boucher de La Havane sont rendus par des personnes publiques qui ont pignon sur rue. Le scandale habite ailleurs. Il demeure dans le fait que, précisément, il n’y ait pas scandale quand ces hommages publics au boucher de La Havane sont rendus par des personnes publiques qui ont pignon sur rue. Et l’explication vient. D’abord l’anti-occidentalisme pathologique, dans sa version antiaméricaine. Tout fut pardonné à Fidel au nom de la lutte sacrée contre l’impérialisme yankee. Tout, y compris le massacre et la mise au pas de son peuple. Mais cette anti occidentalisme radical n’est pas seulement politique, il est aussi racial. Qu’on me permette de me citer dans mes Réflexions sur la question blanche (2011): «Il faut se faire à la déraison: un sombre salaud cubain, vénézuélien, bolivien ou mexicain basané, qui sait? mâtiné d’indien, ne sera jamais aussi honni qu’un bon vieux salaud chilien tel que Pinochet, poursuivi jusqu’au bord du tombeau, et que Sartre charriait pour «sa gueule de salaud latin» classique, à la Franco.». Le procès du communisme reste à instruire en France. Ensuite et surtout en raison du fait que le procès du communisme reste à instruire en France. Il s’agit d’une triste spécificité française. Il n’y a qu’en France que les archives du KGB n’aient pas été exploitées, après l’effondrement de l’URSS ce dont se désolait ma chère Annie Kriegel. Même dans l’Italie si communisante du compromis historique, les archives ont parlé, et l’on sait quel compagnon de route ou quel journaliste émargeait au budget soviétique. Il n’y a qu’en France où des syndicats politisés peuvent reconnaître leurs liens avec le PC sans être pour autant démonétisés. Il n’y a qu’en France où le parti communiste peut encore oser s’appeler par son nom et s’affubler d’un marteau et d’une faucille. Il n’y a qu’en France où des artistes sentencieux peuvent se produire à la fête du journal de l’organe central du parti communiste sans risquer la sentence. Il n’y a qu’en France où le parti de la gauche morale peut s’allier électoralement avec un parti communiste sans rougir ni être déconsidéré. Car c’est en France encore que ceux qui ont combattu extrêmement le communisme et ses épigones d’extrême-gauche ont été médiatiquement rangés dans le ghetto de l’extrême droite. Stéphane Courtois, qui faillit connaître la mort civile pour avoir écrit Le livre noir du communisme. Ce fut notamment le sort de Stéphane Courtois, qui faillit connaître la mort civile pour avoir écrit Le livre noir du communisme. Pour avoir eu le courage suicidaire d’estimer à 100 millions le nombre d’êtres humains assassinés pour imposer le communisme. Paul Kangor dans The Communist estime que le livre de Courtois est largement en dessous de la réalité. Courtois évaluait à 20 millions les crimes de Staline, mais Alexandre Yakovlev , adjoint de Gorbatchev, cité par Kangor, estime le carnage entre 60 et 70 millions d’humains. L’anticommunisme est un humanisme. Post-scriptum citoyen: dimanche à 13h sur TF1, on pouvait voir les cubains réfugiés en Floride, ces anciens boat-people, fêter la mort du dictateur. Pas sur la chaîne de service public France 2 à la même heure. Seulement des cubains éplorés. Pour ceux qui, comme moi, n’arrivent pas à accepter comme un fléau naturel, la mainmise de l’idéologie sur le bien indivis des citoyens payant la redevance, je signale la naissance du «Collectif des usagers du service public audiovisuel» (contact@collectif-uspa.fr).
|
Europe / Europa / l’Europe
Tv. et M. V. H., Une formation de très haut niveau mais un mur de sillence difficile à vaincre, LB 15/11/1999
EUROPE DE L’EST / SPORT Les exploits sportifs étaient utilisés comme instrument de propagande et comme étalons de grandeur du pays.
Les dirigeants du sport des anciens pays de l’Est n’hésitaient pas à mettre tous les moyens possibles en oeuvre pour obtenir des résultats probants.
Surtout en gymnastique, en natation et en athlétisme.
Ainsi, pour le premier cité, on appris que des filles étaient “volontairement mises enceinte pour les compétitions, afin d’avoir une composante hormonale plus performante. Ensuite, on les obligeait à avorter. Certaines filles ont témoigné mais bien d’autres n’osent pas.”
the Baltics
Russes et Polonais en quête d’un langage commun, LB 01/07/1998
Vilnius / Tallinn:
Les minorités (russe surtout) représentent, non plus un dixième, mais un tiers de la population. “Cela en dit long sur le respect des Russes envers les pays où ils sont venus s’installer, le fait qu’en un demi-siècle, ils n’ont jamais fait l’effort d’en apprendre la langue”, tonne le ministre estonien des Affaires étrangères, Thomas Hendrik Ilves, dont la mère est russe. “Sous l’occupation soviétique, quand vous leur parliez autrement qu’en russe, ils vous sommaient de vous exprimer dans une langue humaine!”
Československo / Czecoslovakia / die Tschechoslowakei / Tsjechoslowakije / la Tchécoslovaquie
Police secrète et lettres dévoilées, LB 20/03/2001
L’ex-police secrète communiste tchécoslovaque (StB) ouvrait des dizaines de millions de lettres privées par an et réalisait des centaines d’écoutes téléphoniques, a révélé, lundi, l’Office de documentation et d’investigation des crimes de communisme (UDV) dans une étude publiée à Prague.
Deutschland / Germany / Duitsland / Allemagne
|
Allemagne / Des pratiques dignes de la RDA, VA 04/03/2008
Dix-huit ans après la chute du mur, un Etat d’Allemagne vient d’être reconnu coupable de pratiques dignes de la RDA, pour avoir sciemment évité de rendre leurs biens à des propriétaires expropriés par les Soviétiques. La Cour fédérale de justice a jugé que le Land de Brandebourg, qui entoure Berlin au cœur de l’ancienne Prusse, s’était approprié «illicitement» à la fin des années ’90 entre 6 000 et 10 000 parcelles de terres, au bas mot près de 200 000 hectares, jadis grands domaines ou simples champs de paysans. Ce comportement, «indigne d’un État de droit», rappelle «les méthodes des administrateurs immobiliers de la RDA», a tranché la Cour. Les juges fédéraux ont donné raison en décembre à deux frères auxquels le Brandebourg refusait de restituer des terres : selon la Cour, Potsdam s’est donné bien peu de mal pour retrouver ces héritiers et s’est arrogé hâtivement leurs biens. Des milliers de particuliers seraient dans le même cas. Les autorités régionales sont désormais sommées de retrouver tous les ayants droit et de leur rendre leurs hectares, ou de les indemniser si les terres ont été revendues. Un standard téléphonique a déjà reçu des centaines d’appels et des petites annonces doivent être passées dans les journaux. Au-delà du Brandebourg, l’arrêt de la Cour risque de déclencher une avalanche de procédures dans les autres Länder d’ex-RDA : Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe.
|
|
De nazi à la Stasi, il n’y avait parfois qu’un pas, L’Histoire nov. 2005, p. 92-93
La Stasi, police secrète de l’ex-RDA, a employé sans vergogne d’anciens SS, ou protégé d’ex-nazis pour raison d’Etat en classant leurs dossiers.
|
|
Hagemeister Volker, Wenn die Stasi den Traum vom Studium zerstörte, FAZ, den 17. April 2001
„Schüler, die aus politischen Gründen in der DDR kein Abitur machen oder nicht studieren durften, wurden bislang nicht für das erlittene Unrecht entschädigt.“ Wenn jemand verhaftet und verurteilt worden war, liess die Stasi die Familie nicht aus den Augen. |
|
Thomas Scheuer, OLYMPIA 72, Focus 4/2006, S.42
Der Organisator des Münchner Attentats, Abu Daud, wurde selbst bei einem Anschlag verletzt und in der DDR gepflegt. Er wurde ins Klinikum Buch – dort war damals ein Regierungskrankenhaus der DDR untergebracht – gebracht. In den folgenden Jahren verbrachte er immer wieder längere Zeit in Ostberlin.
|
|
Nina Toussaint, Massimo Iannita, documentaire : La décomposition de l’âme, ARTE, 03/11/2003
La Stasi pratiquait la méthode de la « décomposition de l’âme », par l’isolement des « opposants au régime » afin de mieux les « désintégrer ».
|
|
Jan Von Flocken, Ulbrichts willige Nazis, Focus, 50/2000 (Dez.)
Viele ehemalige Wehrmachtoffiziere machten in der frühen DDR Karriere. « Obwohl die SED-Propaganda den Antifaschismus für sich reklamierte, bedienten sich die Gefolgsleute Walter Ulbrichts ohne Skrupel aus den Reihen der « Hitlerwehrmarkt ». (aus: Peter Lapp, Ulbrichts Helfer, Bernhard & Graefe Verlag Bonn, Dezember 2000, 244 S., 48 DEM) |
España / Spain / Spanje / Spanien / l’Espagne
in : Delta, 1, 2007, p.23
Spaanse burgeroorlog. Een aspect dat door onze linkse broeders maar al te gretig wordt vergeten wanneer zij tekeergaan tegen het regime van generaal Franco is dat de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 een ware godsdienstvervolging is geweest. Niet minder dan 34 bisschoppen, 4.184 priesters, 2.365 religieuzen en 283 kloosterzusters werden brutaal en meedogenloos vermoord. En dan hebben wij het nog niet eens over de talrijke kerken, conventen, enz… die werden geplunderd en in brand gestoken door de rode troepen.
France / Frankreich / Frankrijk
Alain de Benoist, Vu de droite, Anthologie critique des idées contemporaines, 1977, éd. Copernic
(p.527) « Le 19 mars 1947, précise le trotskyste Jacob Moneta (Le PCF et la question coloniale, 1920-1965. Maspero 1971), le comité central du PCF a même trouvé bon que les ministres communistes, et parmi eux le ministre de la Défense, M. François Billoux, votent les crédits qui devaient financer la guerre au Vietnam. »
Polska / Poland / Polen / la Pologne
Margot Zeslawski, Sendlers Liste, Focus 2/2002, S. 170-171
Eine Polin hat 2500 jüdischen Kindern im Warschauer Ghetto das Leben gerettet.
Im Nachkriegs-Polen erduldet die Ghetto-Helferin Diskriminierung von Seiten der Kommunisten. Weil sie Juden gerettet hat, bekommt sie den Antisemitismus der neuen Machthaber zu spüren. Sie verschweigt die Vergangenheit und erzählt ihren eigenen Kindern erst davon, als die Tochter erzürnt nach Hause kommt. Der Mutter wegen wird ihr der Studienplatz verweigert. 1965 würdigt die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Irena mit der Medaille der Gerechten.
Romania / Rumänien / Roemenië / la Roumanie
Sabine Verhest, Roumanie / Le communisme sème la tempête, LB 19/12/2006
Se basant sur un rapport de 660 pages, rédigé par une commission d’experts, pour la plupart écrivains, historiens et philosophes réputés, chargés « d’éclairer les Roumains sur ce passé sombre de leur histoire et non de porter des accusations », le président Basescu a condamné fermement l’ancien régime au Parlement.
Ce rapport a suscité la colère de plusieurs politiciens.
Le rapport est plein d’« erreurs culturelles et historiques », a tempêté l’extrémiste Corneliu vadim Tudor, tandis que la conservatrice Daniela Popa assénait qu’il faisait preuve de « superficialité et d’absence de professionnalisme ».
Rossija / Russia / Russland / Rusland / la Russie
|
Bailey Geoffrey, La guerre des services secrets soviétiques, éd. Plon, 1960
(p.2) « (…) l’organisation du gouvernement soviétique et l’Armée Rouge se trouvaient tellement infestés par ceux que Lénine qualifiait sarcastiquement de radis – rouges extérieurement et blancs à l’intérieur – (…).
(p.31) La terreur qui est, selon la formule si exacte d’Engels, « la domination exercée par des hommes qui sont eux-mêmes terrorisés » (…) .
|
|
FR3 /La vie comme un roman. Macha et Dacha, LB 04/02/2002
1950. Naissance à Moscou de 2 bébés siamois, reliés par le bassin. Aussitôt retirées à leurs parents à qui l’on fait croire qu’elles sont mortes, les fillettes sont emmenées dans un institut de recherche scientifique où, pendant seize ans, elles feront l’objet d’expériences médicales.
|
|
Toumanov Boris, Dinamo : l’Intérieur de Kiev, LB 18/10/2000
Le Dinamo de Kiev, comme bon nombre de clubs de l’ex-URSS, dépendait d’un département de l’Etat. |
|
TRADITIONS / Pays de l’Est – On gardait la carpe dans la baignoire, VA 21/12/2002
Héritage direct de la tradition païenne des pays du nord, le sapin de Noël (..) Lors de la période communiste, en URSS, Noël n’était pas un jour férié. Et les instituteurs de l’époque se rendaient chez leurs élèves avec pour mission d’espionner les récalcitrants.
|
Yugoslavia / Jugoslawien / Joegoslavië / la Yougoslavie
| Karl-Peter Schwarz, Die Mörder haben sich in nichts aufgelöst, FAZ 30/07/2007
KRAINBURG, im Juli. ,,Der jugoslawische Kommunismus », sagt Ljubo Sire, ,,war um nichts weniger kommunistisch als der sowjetische und alle anderen. » Sire ist 87 Jahre ait. 1947 hatte ihn ein Schau-prozess in Laibach (Ljubljana) zum Tode verurteilt. Der linken Legende nach haben Titos Partisanen Jugoslawien von der deutschen Besatzung ,,befreit », während sie es in Wirklichkeit nur von einer Diktatur in die andere beförderten. Titos Sozialismus gilt heute noch als mild und moderat, doch die Bilanz des Terrors in Jugoslawien in Relation zur Bevölkerungszahl unterschied sich wenig vom Grossen Terror unter Stalin: Nach unterschiedlichen Schätzungen wurden 200 000 bis 300 000 Jugoslawen in den Jahren 1945/46 ermordet. Ljubo Sirc hat berechnet, dass mindestens eine Million Menschen zwischen 1945 und 1950 in die Mühlen der kommunistischen Justiz un der Geheimpolizei geraten sind, also etwa jeder zehnte Einwohner Jugoslawiens. (…)
Ende der sechziger Jahre in einer Gesprächsrunde von linken Intellektuellen sagen lassen, er habe das Todesurteil reichlich verdient, denn schliesslich habe er ja nicht an den Kommunismus geglaubt. Sircs Heimat Slowenien geniesst heute den Ruf eines demokratischen Musterschülers im postkommunistischen Europa. In dem kleinen, wenig mehr als 20 000 Quadratkilometer umfassenden EU-Mitgliedsland, das zwei Millionen Einwohner zählt, sind bisher 512 Massengräber mit Tausenden Opfern des kommunistischen Terrors entdeckt worden. Immer wieder stösst man bei Bauarbeiten oder auch nur beim Umpflügen der Felder. Die slowenischen Kommunisten, die sich nun Liberaldemokraten und Sozialdemokraten nennen, haben seit dem Ausscheiden des Landes aus der jugoslawischen Föderation 1991 bis zum Wahlsieg der konservativen Parteien 2004 die Macht ausgeübt. Entsprechend stark sind ihre Positionen noch immer in Wirtschaft und Finanzen, in den Medien, an den Hochschulen und vor allem in der Justiz. Die neun Richter des Verfassungsgerichtshofs wurden samt und sonders vom früheren Präsidenten Milan Kucan eingesetzt, einst kommunistischer Parteichef in Slowenien, acht von ihnen waren selber Kommunisten. Einer ist Ciril Ribicic, der den Partisanennamen seines Vaters als Vornamen trägt. 2006 blockierte ein Gericht in Laibach ein Verfahren, das die Staatsanwaltschaft gegen Mitja Ribicic beantragt hatte. Ribicic war nach dem Krieg stellvertretender Leiter des Departments II des kommunistischen Geheimdienstes OZNA in Slowenien gewesen, das für den Kampf gegen den ,,inneren Feind » zuständig war und die summarischen Erschiessungen von tatsächlichen und potentiellen Gegnern des Regimes organisierte. Wie ein von der Staatsanwaltschaft vorgelegtes Dokument bezeugt, hatte ein ,,Oberst Mitja » schriftlich die Ermordung von 270 angeblichen NS-Kollaborateuren angeordnet. Das Gericht hielt dies für keinen ausreichenden Grund, um ein Verfahren gegen den prominenten slowenischen Politiker zu eröffnen. Ribicic, der Hunde liebt und Gedichte schreibt, hatte es unter Tito Ende der sechziger Jahre zum jugoslawischen Ministerpräsidenten und später zum Vorsitzenden des Zentralkomitees des Bundes der Kommunisten gebracht. Ljubo Sirc und Mitja Ribicic kennen einander seit sechzig Jahren. Am 24. Mai 1947, dem Vorabend von Titos Geburtstag, war Sirc kurz vor Mitternacht auf dem Weg nach Hause vom kommunistischen Geheimdienst OZNA festgenommen worden. In der früheren Psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses in Laibach (Ljubljana), die schon die Gestapo als Gefängnis genutzt hatte, wurde en bis in die frühen Morgenstunden von Ribicic und seinen Leuten verhört. Vier Wochen lang wurde er jede Nacht aus der Zelle geholt, tagsüber war ihm das Schlafen verboten. Der Geheimdienstoffizier und sein Opfer sind nahezu gleich alt – Ribicic ist 1919 in Triest geboren, Sire 1920 im slowenischen Krainburg (Kranj). 1938 hatten sich beide an der juristischen Fakultät der Universitàt Laibach immatrikuliert. Nach dem deutschen Einmarsch in Jugoslawien am 6. April 1941 hatte sich Sirc der linksnationalistischen Widerstandsgruppe ,,Stara Pravda » angeschlossen. Die jugoslawischen Kommunisten entdeckten ihren Patriotismus erst zwei Monate später, als mit dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion am 22. Juni der Hitler-Stalin-Pakt hinfällig wurde. Ribicic achtete als politischer Kommissar im Rang eines Obersten auf die Linien-treue der Partisaneneinheiten im deutsch besetzten Norden Sloweniens. ,,Seine wichtigste Funktion », sagt Sirc, ,,bestand darin, zu verhindern, dass sich Nicht-Kommunisten dem bewaffneten Widerstand anschlossen. » Die Kommissare unterzogen die Freiwilligen einem strengen Verhör, Folter eingeschlossen. Forstarbeiter fanden die Leichen von Partisanen, die die Kommissare mit Knüppeln erschlagen hatten. Das sogenannte ,,Schutzgesetz » des slowenischen Volksbefreiungsausschusses vom September 1941 sah die Liquidierung der Widerstandskämpfer vor, die sich nicht der kommunistisch kontrollierten Befreiungsfront (OF) unterstellten. – Die Antifaschisten der ,,Stara Pravda » wurden aus der OF ausgeschlossen. Sirc flüchtete in die Schweiz, in der vergeblichen Hoffnung, die Alliierten vor den Plänen der Kommunisten warnen zu können. Als Tito auf massives Drängen der Alliierten 1944 zum Schein in die Zusammenarbeit mit der königlichen Regierung Ribisic einwilligte, kehrte Sirc ins besetzte Jugoslawien zurück und schloss sich der Befreiungsarmee an. Seine Hoffnung, dass Briten und Amerikaner Subasic stützen und Tito zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zwingen könnten, wurde bitter enttäuscht. Die Kontakte, die Sire als Übersetzer der slowenischen Regierung zu Ausländern unterhielt, wurden ihm im Schauprozess zum Verhängnis. Von den vierzehn Angeklagten wurden drei zum Tode verurteilt, eines dieser Urteile wurde vollstreckt. Zu zehn Jahren Haft und Zwangsarbeit wurde auch sein Vater verurteilt, der keine Verbindung zur demokratischen Opposition hatte. Franjo Sirc starb nach vier Jahren Gefängnis. Zu seiner Verurteilung ‘ hatte es ausgereicht, dass sein Sohn ein ,,Volksfeind » war und er selbst ein ,,Klassenfeind »: Franjo Sire war ein erfolgreicher Unternehmer gewesen, bis die Nazis seinen Besitz beschlagnahmten, Maschinen abbauten und Industrieanlagen zerstörten. Was die Nazis übrig liessen, konfiszierten nun die Kommunisten. Ljubo Sire sass siebeneinhalb Jahre im Gefängnis. Im November 1955 gelang ihm die Flucht über die schneebedeckten Berge nach Italien. Er lehrte Wirtschaftswissenschaften in Dacca, in Dundee und in Glasgow und gründete in London das renommierte ,,Centre for Research into Post-Communist Economies » (CRCE). Er hat mehrere Bücher über das Versagen der Planwirtschaft verfasst sowie die Autobiographie ,,Between Stalin and Hitler » (1989), die zum Besten und Anschaulichsten zählt, was man über diese Zeit in Jugoslawien lesen kann. (…) Noch immer, sagt Sirc, fänden sich im Westen genügend Leute, die bereit seien, den Kommunisten als ,,nützliche Idioten » zu dienen.
|
Asia / Azië / Asien / l’Asie
China / la Chine
|
Erik Raspoet, De verdwaalde kinderen van de Volksrepubliek, in : Knack, 06/01/2010, p.31-35
Meneer Zhang (79) (Brussel) ‘Ik kom uit een dorp in Shaanxi, de provincie van de terracotta krijgers. Een speciaal dorp, want er woonden bijna uitsluitend katholieken. Dat waren geen nieuwe bekeerlingen, mijn dorp is al katholiek sinds vijftien generaties. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, weet ik niet. Feit is dat onze streek in mijn kindertijd door Italiaanse franciscanen werd bediend. Ik wist al heel vroeg dat ik priester wilde worden. Ik ging iedere dag naar de mis, ook al werd dat thuis helemaal niet verplicht. Zelfs in het putje van de winter, aïs het stenen uit de grond vroor, liep ik gewillig naar de kerk. Vraag me niet waarom, het was gewoon zo. Het zal wel een roeping geweest zijn. ‘Je kunt gerust zeggen dat ik een barre jeugd heb gekend. Tijdens de Japanse bezetting was er hongersnood. Op de velden viel geen plant meer te bespeuren, alles werd kaalgevreten. Op de duur aten de mensen zelfs boomschors. Graanproducten zoals tarwe of sorgo waren nergens te verkrijgen. Het probleem was dat de Japanners de handel tussen de dorpen hadden stilgelegd. Ze bezetten alleen de steden, het platteland werd met wegblokkades gecontroleerd. Honger maakt creatief, er werd wel degelijk gesmokkeld tussen de dorpen. Ook met de fiets, al waren die toen nog erg zeldzaam en was fietsen erg riskant. De Japanners hadden de gewoonte fietsen aan te slaan en de eigenaars mee te nemen voor dwangarbeid. En weet je hoe ze de Japanners beetnamen? Ze draaiden het stuur van hun fiets los en gaven het een kwartdraai, zodat het evenwijdig stond met het kader. Ik snap nog altijd niet hoe ze het presteerden, maar ze slaagden erin op die manier te fietsen. De Japanners stonden perplex en lieten hen begaan. Met dat soort fietsen konden ze toch niets aanvangen. (…)
‘Officieel is de burgeroorlog afgelopen op 1 oktober 1949, maar dat is propaganda. De waarheid is dat Chang Kai Chek nog in 1954 boven Sichuan kon rondvliegen om vanuit de lucht zijn posities te inspecteren. Ook in mijn streek heeft het nog een jaar geduurd vooraleer de communisten hun macht konden vestigen. In 1951 hebben een paar honderd rebellen zelfmoord gepleegd door gif te slikken, liever dan zich over te geven aan de communisten. Helaas, er zijn weinig Chinezen die de echte geschiedenis van hun land kennen. Ik merk dat ook bij jonge mensen die naar Europa komen studeren. Het bloedbad van Tiananmen, daar weten ze niks van. ‘In 1981 ben ik voor het eerst teruggekeerd, mijn moeder lag op sterven. Sindsdien ben ik er geregeld geweest. Met de autoriteiten onderhoud ik een dubbelzinnige relatie. Uiteraard weten ze wie ik ben en wat ik in België doe. Ze behandelen me met veel égards. Bij ieder bezoek word ik op drie banketten getrakteerd: een van de provincie, een van het district en een van het dorp. Maar tegelijkertijd zijn ze erg wantrouwig. Telkens wanneer ik naar China ga, wordt dat in ieder politiekantoor van Shaanxi gesignaleerd. Hoe vaak ze me al hebben meegenomen voor een verhoor, ik moet telkens weer mijn hele leven vertellen. Wat doe je in Europa? Wat denken ze daar van China? En met wie heb je hier gesproken? Tegenwoordig laat mijn geheugen me weleens in de steek. Zoek het maar op in mijn dossier, zeg ik dan, daar staat toch alles in. Ik heb het hen ooit vlakaf gevraagd: waarom zijn jullie bang voor mensen zoals ik? Een land met een leger van vier miljoen soldaten? Ik heb geen antwoord gekregen, maar ik kan het zelf bedenken. Het regime is als de dood voor mensen die de waarheid durven zeggen. |
1.1.2 Revisionism
|
« Ich bin für Stalin », FOCUS 11/2003, S. 82
Louis Aragon, 1936 Pablo Picasso, 1949 George Bernard Shaw, 1949 Heinrich Mann, 1936
|
|
Cinquante ans sans Staline, LB 05/03/2003
Qui veut se faire dieu doit d’abord traquer ceux qui l’ont fait roi…
« Si pour arriver à nos fins, nous devons éliminer à nos fins, nous ne devons pas hésiter un instant », disait Lénine. Dans un univers où, au militant de base, il est demandé de faire abstraction de tout scrupule, d’appeler bien le mal et vérité le mensonge, ne peuvent s’élever et s’imposer que les plus parfaits scélérats. Et ceux-ci, une fois au sommet, veilleront à ce que l’avilissement demeure toujours collectif. »
« Et Staline dissipe le malheur. La confiance est le fruit de son cerveau d’amour. » (Paul Eluard, 1950)
« Staline n’est-il pas l’homme qui aura fait le plus pour tous les enfants ? Nul homme ne sait plus fortement témoigner de la valeur qu’il attache à la personne humaine ? » (Charles Tillon, ministre communiste dans le gouvernement français en 1949) (LB 05/03/03)
|
|
Die Intellektuellen sind das moralische Gewissen einer Nation, in: Krämer Walter, Trenkler Götz, Das Beste aus dem Lexikon der populären Irrtümer, Piper Verlag, 2002
Intellektuelle, also Leute, die ihren Lebensunterhalt mit Schreiben und Reden bestreiten beziehungsweise gerne bestreiten wùrden, sind, wenn wir die letzten hundert Jahre als ein Zeugnis nehmen, eher leichter denn schwerer als »normale« Menschen weltanschaulich zu verführen. Von Josef Stalin und Mao Tse-tung über Fidel Castro bis zu Ho Chi Minh, Pol Pot und Saddam Hussein gibt es kaum einen Diktator auf der Welt, der sich nicht mit einer staatlichen Schar westlicher Intellektuellengroupies schmucken könnte. Einzige Bedingung: Der Diktator muss den Intellektuellen schmeicheln. Dann aber ist die Einäugigkeit dieser Wahrheitssucher nicht zu übertreffen. Der unbestechliche Sozialkritiker George Bernard Shaw zum Beispiel warf auf seiner Russlandreise 1930, als gerade Millionen Russen Hungers starben, seine mitgebrachten Lebensmittel aus dem Fenster seines Zuges – wer braucht ins Paradies noch Brot und Butter mitzubringen! » Ich bin noch nie im Leben so luxuriös gereist«, schreibt André Gide aus Russland 1938, zur Zeit der grofen Säuberungen. » Immer das beste Abteil im Zug, das beste Zimmer im Hotel, das beste Essen, das man sich nur denken kann. Und was fur ein Empfang! Was fur eine Aufmerksamkeit! Alles applaudierte, feierte.« Dieser Applaus ist Chloroform fur die sonst so aggressive Kritikfähigkeit moderner Literaten; solange man ihnen applaudiert, sehen sie die Welt vor allem durch die Augen derer, die sie loben. Jean-Paul Sartre war entzückt von Castro – dieser hatte anders als Charles de Gaulle den Literaten fast als Staatsgast aufgenommen. (Was bedeutet dagegen schon die Tatsache, dass die Kubaner unter Castro zu einem der ärmsten Völker dieser Welt verkommen sind.)
Salman Rushdie und Franz Xaver Kroetz dichten Hymnen auf die Diktatoren Nicaraguas – dort wird man anders als in Deutschland oder England vom Kulturminister eingeladen (dass zur gleichen Zeit ein staatlich organisierter Massenmord an Indianern stattfand, ist dagegen cher nebensächlich). Graham Greene berichtet mit Tränen in den Augen von einer Rede des Generalsekretärs der KPdSU, und Schriftsteller und Fernsehmacher, die in Frankfurt, London oder Kopenhagen jeden Obdachlosen wachen Auges registrieren würden, lassen sich durch die Elendsviertel Moskaus oder Pekings fahren und sehen nichts als glückliche Gesichter. (Oder, um mit einem bei Paul Hollander zitierten Russland-reisenden der dreissiger Jahre zu sprechen: »Anderswo ist Dreck und Unrat irgendwie deprimierend, aber hier erschien er uns so romantisch proletarisch.«) Da kann auch die Ausrede nur wenig überzeugen, man habe, wenn auch spät, das wahre Gesicht der einstmals verehrten Lichtgestalten durchaus gesehen; denn die nächste Lichtgestalt ist schon gefunden. Gegen diese Masse kollektiver Blindheit sind die wirklich kritischen Intellektuellen wie Hans-Magnus Enzensberger, George Orwell oder Bertrand Russell an den Fingern von zwei Händen abzuzahlen.
|
|
Hurta Henryk, Un monde à part, LB 09/05/1985
Vers 1950, Gustaw Herling écrivit un des premiers livres sur le goulag. Malgré l’enthousiasme de Camus, il n’est publié en français qu’aujourd’hui. L’éditeur contacté craignait le boycottage total d’un des premiers récits sur le ‘goulag’. A l’époque, le mot était inconnu, la mode était au stalinisme, surtout chez les intellectuels dits de gauche. « Ce qui a le plus frappé Gustaw Herling, semble-t-il, c’est le besoin chez les bourreaux de se fournir un alibi légal. N’écrit-il pas : « Seigneur ! cette manie de vouloir liquider leurs victimes en respectant le plus grand cauchemar de tout le système soviétique. Il ne leur suffit pas de tirer une balle dans la tête de quelqu’un, non : ce quelqu’un doit lui-même demander poliment qu’on lui fasse un procès. (…) »
|
|
in: Michel Grodent, De Simenon à Simon Leys, in: LS, 15/11/2009
“La mémoire de la bêtise occidentale est toujours susceptible de nous éviter de fatales erreurs.” ’Au détour des années 70, on vantait les vertus sociales du régime chinois, prétendu égalitaire, on croyait à la révolution permanente qui déplace les montagnes.’ Mais Simon Leys (Pierre Ryckmans) montrait que la révolution culturelle n’était qu’un paravent soi-disant symbolique au moyen duquel un chef de bande tentait de reconquérir le pouvoir qu’il avait perdu 10 ans auparavant.
|
|
Jean-Paul Marthoz, Staline et les mal-pensants, LB 05/03/2003
L’aveuglement de nombreux intellectuels face au stalinisme et leur impunité laissent en effet perplexe. Ainsi : Aragon, Frida Kahlo.
|
|
Stéphane Courtois, éd., Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, éd. Robert Laffont, 1997
DESINFORMATION DE LA PART DES INTELLECTUELS
GENERALITES
(p.36) Des fractions plus ou moins larges des sociétés occidentales ont refusé de voir dans le système communiste une dimension fondamentalement criminelle. par ce refus, elles ont participé au mensonge, au sens où l’entendait Nietzsche: “Refuser de voir quelque chose que l’on voit, refuser de voir quelque chose comme on le voit”.
FRANCAIS
(p.28) Louis Aragon dirigeait un journal communiste, Les Lettres françaises. En 1949, il attaqua en justice Victor Kravchenko, ex-haut fonctionnaire soviétique qui avait écrit “J’ai choisi la liberté” où il décrivait la dictature stalinienne. Aragon couvrit Kravchenko d’injures. (p.30) “Un écrivain français, prix Goncourt 1916, Henri Barbusse, n’hésita pas, moyennant finances, à encenser le régime stalinien, en publiant en 1928 un livre sur la “merveilleuse Géorgie”, – où précisément, en 1921, Staline et son acolyte Ordjonikidze, s’étaient livrés à un véritable carnage, et où Beria, chef du NKVD, se faisait remarquer par son machiavélisme et son sadisme – et, en 1935, la première biographie officieuse de Staline. Plus récemment, Maria-Antonietta Macciochi a chanté les louanges de mao, Alain Peyrefitte lui fit écho en mineur, tandis que Danielle Mitterrand emboîtait le pas à Castro. Cupidité, veulerie, vanité, fascination pour la force et la violence, passion révolutionnaire: quelle que soit la motivation, les dictatures totalitaires ont toujours trouvé les thuriféraires dont elles avaient besoin, la dictature communiste comme les autres.” (p.312) Si surprenant que cela paraisse, quelques jeunes cadres de confiance du parti communiste français suivaient encore, au début des années soixante-dix, un entraînement en URSS (tir, montage et démontage d’armes courantes, fabrication d’armes artisanales, transmissions, techniques de sabotage) aurpès des Spetsnaz, les troupes spéciales soviétiques mises à la disposition des services secrets. (p.324) “Que dire alors d’un Romain Rolland, d’un Langevin, d’un Malraux, qui admirent et approuvent le régime dit soviétique, sa “culture” et sa “justice”, sans être contraints par la faim ou quelque torture?” (Le Figaro littéraire, 1er juillet 1937)
(p.342) Paul Eluard, communiste, refusa de soutenir, à la demande d’André Breton, un homme qu’ils connaissaient tous deux, en 1950: le Tchèque Zavis Kalandra, condamné en Tchécoslovaquie pour avoir écrit une brochure dénonçant les procès de Moscou. Ce dernier fut exécuté. (p.352) Côté français, le ‘Bulletin’ du gouvernement militaire en Allemagne affirmait qu’au 1er octobre 1945 101.000 “personnes déplacées” avaient été renvoyées côté soviétique (à la demande du pouvoir russe). En France même, les autorités françaises acceptèrent la création de 70 camps de regroupement. (p.601) Au cours de la guerre de Corée, Jean-Paul Sartre et de nombreux autres intellectuels français de gauche, appuyèrent la position communiste faisant de la Corée du Sud l’agresseur d’un pays pacifique. Il n’en était rien. (p.752-753) L’efficacité de l’action de Mengistu – dictateur en Ethiopie – / il a repoussé les offensives du front populaire de libération de l’Erythrée et de l’armée somalienne après avoir tué des milliers d’opposants et en 1977 un millier d’enfants, pour la plupart âgés de 11 à 13 ans, à Addis-Abeba, dont le corps gisait dans les rues, la proie des hyènes errantes (p.751)/ fut telle que, lors de la 39e session du Bureau de la Fédération syndicale mondiale, tenue à Addis-Abeba en 1988, l’organisation – dans laquelle la CGT française, alors dirigée par Henri Krasucki, assumait d’importantes responsabilités – lui décerna sa médaille d’or pour “sa contribution à la Lutte pour la pais et la sécurité ds peuples, pour leur indépendance nationale et économique”. (p.819) Sartre, en 1952, s’écriait: “Tout anticommuniste est un chien!”
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.496) Mais qui n’était pas douteux, hors du Parti ? Un des livres les plus retentissants de l’époque du Front populaire est le Retour de l’URSS, d’André Gide. Le grand intellectuel, alors proche des communistes, est allé durant l’été 1936 visiter la patrie des travailleurs. Il y a été accueilli en prince. Staline était trop content d’une prise de (p.497) ce calibre. À son retour, il ose un exercice qui semblerait presque banal : raconter ce qu’il a vu. Par rapport à ce que l’on sait aujourd’hui du pays, il n’a d’ailleurs pas vu grand-chose. On peut lui en faire grief. Il ne dit rien des millions de morts, des déportés, des purges, pour la simple raison qu’il n’en a rien su : d’aimables guides étaient là durant tout le périple pour être bien sûrs qu’il suivrait la bonne route. Il faut croire qu’ils n’étaient pas si doués. Gide a quand même réussi à percevoir un malaise à travers le rideau opaque que la propagande a tiré tout au long de son passage. Il parle des belles réalisations du pays, des grandes rencontres, mais il ajoute au tableau d’autres teintes qui le nuancent : la peur qui suinte dans le pays, le culte de la personnalité gênant qui entoure Staline, la pensée empêchée, la servilité de tous à l’égard de la « ligne ». Dans le contexte de l’époque, son livre fait l’effet d’une bombe. Il est traduit dans presque tous les pays. Il contribue à ébranler bien des consciences. Seules celles des communistes restent d’airain. Ils n’ont à la parution qu’une réaction : ils dénoncent le livre comme un tissu de mensonges et insultent son auteur.
|
|
Michael Klonovsky, Interview mit Sloterdijk Peter (lehrt Philosoph in Karlsruhe und Wien), „Die Freigabe aller Dinge“, in: FOCUS 31/2005, S.51-54
Die Demokraten nach 1945 haben in ihrem antifaschistischen Eifer das Faschismusphänomen in seiner globalen Ausdehnung chronisch unterschätzt. Die Wahrheit ist, dass der Faschismus von Lissabon bis nach Shanghai reichte. Das ganze 20. Jahrhundert ist vom faschistischen Affekt, vom Enthusiasmus des Ressentiments durchzogen. Dass sich der linke Faschismus als Kommunismus zu präsentieren beliebte, war eine falle für Moralisten. Mao Tse-Tung war nie etwas anderes als ein linksfaschistischer chinesischer Nationalist, der anfangs den Jargon der Moskauer Internationale pflegte. Gegen Maos fröhlichen Exterminismus gehalten, erscheint Hitler wie ein rachitischer Briefträger. Doch man scheut noch immer den Vergleich der Monstren. Das massivste ideologische Manöver des Jahrhunderts bestand ja darin, dass der linke Faschismus nach 1945 den rechten lauthals anklagte, um ja als dessen Opponent zu gelten. In Wahrheit ging es immer nur um Selbstamnestie. Je mehr die Unverzeihlichkeit der Untaten von rechts exponiert wurde, desto mehr verschwanden die der Linken aus der Sichtlinie. In dem Zusammenhang muss man die Plakate über den Köpfen der Revoltierenden von damals verstehen. Die radikale Linke hatte sich selbst die Absolution erteilt, und die Ikone Mao war ein Garant ihres Verständnisses für den guten Terror. Die Zersetzungsprodukte dieser Hyperlüge gehen uns bis heute auf die Nerven. Das 98-er Idol Mao liess geschätzte 65 Millionen Menschen umbringen.
Martin Scherer, Väterchen /=Stalin/ Tod, in : Focus 38/2005, p.72-74 (S.73) Heinrich Mann hielt ihn für „gütig“ und von „bedeutender Tatkraft“; George Bernard Shaw sah in ihm „den grössten Verteidiger des Friedens“, (…). Joschka Fischer nannte ihn noch 1978 einen „Typen wie wir“.
|
1.2 Present
1.2.1 Everyday life in the communist countries
|
« J’ai dû, dans le cadre de mon travail, arracher la peau et la cornée de plus de cent prisonniers exécutés », LB 29/06/2001
Tel est le témoignage d’un médecin chinois, Wang Guoqi, exilé aux Etats-Unis, dénonçant le trafic d’organes. Ainsi, après une exécution dans la province de Hebei, le prisonnier n’était pas encore mort. Il a été dans une ambulance où trois docteurs « lui ont retiré ses reins (…) Lorsqu’ils ont eu fini, le prisonnier respirait encore et son coeur continuait de battre. (…) Nous sommes restés dans l’ambulance pour retirer la peau. Nous pouvions entendre des gens dehors et craignant qu’il s’agît de la famille de la victime, (…) nous avons abandonné notre travail en cours de route et le corps à moitié mort a été jeté dans un sac en plastique ».
Le trafic d’organes, selon un autre dissident chinois, Harry Wu, exilé aux USA, est un commerce juteux pour l’Armée populaire de libération (APL).
|
|
Bjorn Maeckelbergh, Shin Dong-Huyk (24) raakt als eerste burger weg uit Noord-Koreaans werkkamp, De Morgen 14/11/2007
Geboren, gefolterd en bijna gestorven in Kamp 14
Hij zat er 22 jaar opgesloten, zag zijn moeder en broer voor zijn ogen verhangen worden en werd zelf boven een vuur geroosterd. En toch heeft de Noord-Koreaan Shin Dong-Hyuk (24) nog geluk gehad. Hij kon aïs enige burger ooit ontsnappen uit het kamp.
Voor de famille Dong-Hyuk begon de gruwel lang voor Shin geboren werd. Omdat twee broers van zijn vader destijds collaboreerden met de Zuid-Koreanen, viel de politie op een ochtend in 1965 bij hen binnen. ‘Mijn vader was toen nog maar 19 jaar. Ze haalden alle meubels in en duwden de hele familie in een truck.’ Zijn vader vertelde hem later dat de hele familie in Kamp 14 meteen van elkaar gescheiden werd. ‘Vader kreeg een job aïs mécanicien. Omdat hij hard werkte, mocht hij trouwen met een jonge medegevangene.’ Vijf dagen mochten de twee samen blijven. Daarna mochten ze elkaar enkel zien op feestdagen. Het paar kreeg twee zonen: Shin was de jongste. ‘De eerste 12 jaren van mijn leven bracht ik bij mijn moeder door. Zij werkte aïs boerin. Veel tijd had ze niet voor me. Ze werkte van 5 tot 23 uur.’ Tijdens zijn gevangenschap liep hij vijf jaar school. ‘We leerden lezen, schrijven, optellen en aftrekken. Maar meer niet. Ik denk dat er in het kamp zeker 400 kinderen zaten.’ Shin heeft slechte herinneringen aan de school. Zoals toen hij 9 jaar was. ‘De leraar doorzocht al onze zakken. Bij een meisje vond hij vijf graankorrels. Voor straf sloeg hij haar op het hoofd. Wij moesten toekijken. Het duurde zeker een uur voor ze bewusteloos raakte.’ Vanaf zijn twaalfde moest Shin werken. ‘Onkruid wieden, oogsten. Maar ook helpen met de bouw van een dam. Elke dag kwa-men kinderen om. Op een keertje stierven er zelfs acht toen een muur instortte. We mochten de slachtoffers niet zoeken in het puin. We moesten verder werken.’ Op een dag werd Shin opgesloten in een kelder in Kamp 14. ‘Ik zat in een klein kamertje met een lampje aan het plafond. Daar vertelden ze me dat mijn moeder en broer waren gearresteerd tijdens een ontsnappingspoging. Ze zagen er een familiecomplot in en brachten me naar een folterkamer. Ze kleedden me helemaal uit en bonden mijn handen en voeten vast.’ Omdat Shinbleef zwijgen, hielden de bewakers hem boven een vuur. ‘Ik probeerde mijn lichaam uit de vlammen te houden, maar toen hingen ze me vast met vleeshaken door mijn lies. Uiteindelijk werd het allemaal zwart.’ Nadat hij bijkwam, werd Shin samen met zijn vader naar een pleintje gebracht. ‘Er was veel volk. Plots brachten de bewakers twee gevangenen: mijn moeder en mijn broer! Ze dwongen ons te kijken. Eerst verhingen ze haar, daarna hem. Toen ik naar mijn vader keek, zag ik dikke tranen over zijn wangen rollen.’ Daarna moest Shin weer aan het werk. Van vermoeidheid liet hij een naaimachine vallen. Voor straf hakten de bewakers zijn middelvinger af. Het duurde tot 2 januari 2005 voor Shin-Dong Hyuk kon ontsnappen. ‘We waren hout aan het sprokkelen en plots ontdekte ik een prikkeldraad. Ik dacht aan de executie van mijn moeder en broer. En ik besefte: ik moet nu weg.’ Shin vluchtte naar China, waar hij een jaar in de houtkap werkte. Een Zuid-Koreaanse zakenman hielp hem naar Seoel verhuizen. Daar schreef hij zijn autobiografie, Ontsnapping naar de buitenwereld. Op de voorstelling van zijn biogra-fie had hij één verzoek aan de Noord-Koreaanse président: ‘Breng eens één uurtje door in Kamp 14. Eén uurtje maar.’
|
|
Chine / Rome dénonce l’arrestation d’un évêque, LB 08/04/2004
Il s’agit de l’arrestation par la police secrète chinoise de Mgr Jia Zhiguo, un évêque catholique qui a déjà passé 20 ans de sa vie en prison. Cet évêque refuse la mainmise du Parti communiste sur les affaires religieuses, à Zhending, dans la province de Hebei qui entoure Pékin.
|
|
Let Beijing beware of xenophobic nationalism, IHT, 23/01/2002
It is time that the Chinese authorities continue to hold exhibitions falsely asserting that the United States used biological weapons against Chinese during the Korean war. For that matter, it is time that China stopped refering to the Korean wars as “the War to Resist America and Help Korea.”
|
|
V. Li., Cosmétique : vendre ses os !, DH 24/12/2005
En Angleterre et en Chine, un nouveau type de commerce voit le jour. Les êtres vivants profitent des restes des morts
BRUXELLES Inquiétant. Odieux. Difficile de trouver les mots. Alistair Cooke, une figure réputée de la BBC, a fait l’objet d’un dépouillement de… son corps alors qu’il était décédé. Concrètement, alors qu’il allait passer au crématorium, on lui a pris ses os pour la somme de plus ou moins 7.000 €. Pourquoi? Le journal anglais, le Daily Mail, a mené son enquête et il a découvert que des personnes se servent dans les crématoriums sur les corps frais des personnes décédées pour les besoins de la chirurgie esthétique. Selon leur enquête, tout est bon à prendre: os, peau, même appareil cardiaque… c’est un nouveau marché qui prend forme. Les objets humains ou tissus prélevés servent ensuite pour le bien-être d’hommes ou de femmes vivants ! Au fur et à mesure de l’enquête, le Daily Mail a trouvé d’autres cas tout aussi cocasses et qui ne manquent pas d’inquiéter au niveau éthique.
La Chine dans l’œil d’Amnesty
Si on peut s’étonner de cette démarche en Grande-Bretagne, Am-nesty International a déjà condamné ce type de pratique en Asie et plus particulièrement en Chine. Pour rappel, le quotidien anglais The Guardian avait mené une enquête sur les pratiques d’un groupe fabriquant des cosmétiques dans la province de Heilongjiang, en Chine. Selon le journal britannique, la société chinoise prélevait régulièrement des morceaux de peau, des os et des tendons sur les corps des condamnés à mort. Le but était d’en faire des produits de beauté, grâce au collagène extrait des tissus humains de ces cadavres. Des produits revendus sur le marché européen. Wang Guoqi, ancien médecin militaire chinois, avait révélé, en juin 2001, devant le Congrès américain, qu’il avait participé à « des prélèvements ‘d’organes sur plus de 100 prisonniers exécutés ». Il avait ajouté: « j’ai prélevé la peau et les cornées des cadavres de plus d’une centaine de prisonniers exécutés. Les responsables de la prison sont payés 37 dollars par cadavre pour avertir l’hôpital des exécutions, les reins sont vendus 15.000 dollars. Une fois que les médecins ont vérifié leur groupe tissulaire, les prisonniers sont exécutés et immédiatement transportés dans des ambulances où leurs reins sont prélevés dans les deux minutes. » Des pratiques qui donnent froid dans le dos et qui ont déjà été jugées inacceptables par Amnesty…
V.Li.
|
1.2.2 Revisionism
|
Jean-François Revel, La grande parade / Essai sur la survie de l’utopie socialiste, éd. Plon 2000
(p.16) N’oublions jamais en effet qu’en Europe comme en Amérique latine, la certitude d’être de gauche repose sur un critère très simple, à la portée de n’importe quel arriéré mental : être, en toutes circonstances, d’office, quoi qu’il arrive et de quoi qu’il s’agisse, antiaméricain. On peut être, on est même fréquemment (p.17) un arriéré mental en politique tout en étant fort intelligent dans d’autres domaines. Parmi d’innombrables exemples, l’auteur dramatique anglais Harold Pinter explique1 l’intervention de l’Otan contre la Serbie en avril 1999 par le fait que, selon lui, les États-Unis n’ont, en politique internationale, qu’un seul principe : « Baise mon cul ou je t’assomme. » Avoir du talent au théâtre n’empêche pas, chez le même individu, la débilité profonde et la nauséabonde vulgarité dans les diatribes politiques. C’est l’un des mystères de la politique que sa capacité à provoquer la brusque dégradation de maintes personnalités par ailleurs brillantes. Comment réagirait Pinter si un critique dramatique se permettait de tomber aussi bas dans l’imbécillité injurieuse en « commentant » une de ses pièces ?
(p.88) CHAPITRE SIXIEME PANIQUE CHEZ LES NÉGATIONNISTES
Les négationnistes pronazis ne sont qu’une poignée. Les négationnistes procommunistes sont légion. En France, une loi (loi Gayssot, du nom du député communiste qui l’a rédigée et qui, cela se comprend, n’a vu les crimes contre l’humanité que de l’oeil droit) prévoit des sanctions contre les mensonges des premiers. Les seconds peuvent impunément nier la criminalité de leur camp préféré. Je parle non seulement de camp politique, au singulier, mais aussi de camps de concentration au pluriel : le goulag soviétique de jadis et le laogaï chinois d’aujourd’hui, celui-ci en pleine activité, avec en prime ses milliers d’exécutions sommaires chaque année. Ce ne sont d’ailleurs là que les principaux exemplaires d’un genre d’établissements consubstantiel à tout régime communiste. On conçoit donc qu’habitués à cette inégalité de traitement, les négationnistes procommunistes aient été frappés de stupeur lors de la publication du Livre noir, qui établit solidement deux vérités : le communisme fut toujours, est toujours intrinsèquement criminogène ; et, en cela, il ne se distingue en rien du nazisme.
(p.110) Les véritables principes du socialisme n’ont pas été violés par Staline ou Mao quand ils ont pratiqué leurs génocides : ces principes ont été, au contraire, appliqués par eux avec un scrupule exemplaire et une parfaite fidélité à la lettre et à l’esprit de la doctrine. C’est ce que montre avec précision George Watson1. Dans l’hagiographie moderne, toute une partie essentielle de la théorie socialiste a été refoulée. Ses pères fondateurs, à commencer par Marx lui-même, ont très tôt cessé d’être étudiés de façon exhaustive par les croyants mêmes qui se réclamaient d’eux sans arrêt. Leurs œuvres, de nos jours, semblent jouir du rare privilège d’être comprises de tout le monde sans que personne les ait jamais complètement lues, même pas leurs adversaires, ordinairement rendus incurieux par la peur des représailles. Dans sa majeure partie, l’histoire est un réarrangement et un tri, donc une censure. Et l’histoire des idées n’échappe pas à cette loi. L’étude non expurgée des textes nous révèle par exemple, écrit Watson, que « le génocide est une théorie propre au
1. George Watson, La Littérature oubliée du socialisme, Nil Éditions, 1999. Traduit de l’anglais par Hugues de Giorgis. Édition originale : The Lost Literature of Socialism, The Lutterworth Press, Cambridge, 1998. George Watson est professeur à St. John’s Collège, Cambridge. Plusieurs passages de ce chapitre sont tirés de la préface que j’ai rédigée pour la traduction française de l’ouvrage de Watson.
(p.111) socialisme ». Engels, en 1849, appelait à l’extermination des Hongrois, soulevés contre l’Autriche. Il donne à la revue dirigée par son ami Karl Marx, la Neue Rheinische Zeitung, un article retentissant dont Staline recommandera la lecture en 1924 dans ses Fondements du léninisme. Engels y conseille de faire disparaître, outre les Hongrois, également les Serbes et autres peuples slaves, puis les Basques, les Bretons et les Écossais. Dans Révolution et Contre-Révolution en Allemagne, publié en 1852 dans la même revue, Marx lui-même se demande comment on va se débarrasser de « ces peuplades moribondes, les Bohémiens, les Carinthiens, les Dalmates, etc. ». La race compte beaucoup, pour Marx et Engels. Celui-ci écrit en 1894 à un de ses correspondants, W. Borgius : « Pour nous, les conditions économiques déterminent tous les phénomènes historiques, mais la race elle-même est une donnée économique… » C’est sur ce principe que s’appuyait Engels, toujours dans la Neue Reinische Zeitung (15-16 février 1849) pour dénier aux Slaves toute capacité d’accéder à la civilisation. « En dehors des Polonais, écrit-il, des Russes et peut-être des Slaves de Turquie, aucune nation slave n’a d’avenir, car il manque à tous les autres Slaves les bases historiques, géographiques, politiques et industrielles qui sont nécessaires à l’indépendance et à la capacité d’exister. Des nations qui n’ont jamais eu leur propre histoire, qui ont à peine atteint le degré le plus bas, de la civilisation… ne sont pas capables de vie et ne peuvent jamais atteindre la moindre indépendance. » Certes Engels attribue une part de l’« infériorité » slave aux données historiques. Mais il considère que l’amélioration de ces données est rendue impossible par le facteur racial. Imaginons le tollé que s’attirerait aujourd’hui un « penseur » qui s’aviserait de formuler le même diagnostic sur les Africains ! Selon les fondateurs du socialisme, la supériorité raciale des Blancs est une vérité « scientifique ». Dans ses notes préparatoires à VAnti-Duhring, l’évangile de la philosophie marxiste de la science, Engels écrit : « Si, par exemple, dans nos pays, les axiomes mathématiques sont parfaitement (p.112) évidents pour un enfant de huit ans, sans nul besoin de recourir à l’expérimentation, ce n’est que la conséquence de « l’hérédité accumulée ». Il serait au contraire très difficile de les enseigner à un bochiman ou à un nègre d’Australie. » Au vingtième siècle encore, des intellectuels socialistes, grands admirateurs de l’Union soviétique, tels H.G. Wells et Bernard Shaw, revendiquent le droit pour le socialisme de liquider physiquement et massivement les classes sociales qui font obstacle à la Révolution ou qui la retardent. En 1933, dans le périodique The Listener, Bernard Shaw, faisant preuve d’un bel esprit d’anticipation, presse même les chimistes, afin d’accélérer l’épuration des ennemis du socialisme, « de découvrir un gaz humanitaire qui cause une mort instantanée et sans douleur, en somme un gaz policé — mortel évidemment — mais humain, dénué de cruauté ». On s’en souvient, lors de son procès à Jérusalem en 1962, le bourreau nazi Adolf Eichmann invoqua pour sa défense le caractère « humanitaire » du zyklon B, qui servit à gazer les Juifs lors de la Shoah. Le nazisme et le communisme ont pour trait commun de viser à une métamorphose, à une rédemption « totales » de la société, voire de l’humanité. Ils se sentent, de ce fait, le droit d’anéantir tous les groupes raciaux ou sociaux qui sont censés faire obstacle, fût-ce involontairement et inconsciemment — en jargon marxiste « objectivement » — à cette entreprise sacrée de salut collectif. Si le nazisme et le communisme ont commis l’un et l’autre des génocides comparables par leur étendue sinon par leurs prétextes idéologiques, ce n’est donc point à cause d’une quelconque convergence contre nature ou coïncidence fortuite dues à des comportements aberrants. C’est au contraire à partir de principes identiques, profondément ancrés dans leurs convictions respectives et dans leur mode de fonctionnement. Le socialisme n’est pas plus ou pas moins « de gauche » que le nazisme. Si on l’ignore trop souvent, c’est, comme le dit Rémy de Gourmont, qu’« une erreur tombée dans le domaine public n’en sort jamais. Les opinions se transmettent héréditairement ; cela finit par faire l’histoire ». (p.113) Si toute une tradition socialiste datant du dix-neuvième siècle a préconisé les méthodes qui seront plus tard celles d’Hitler comme celles de Lénine, Staline et Mao, la réciproque est vraie : Hitler s’est toujours considéré comme un socialiste. Il explique à Otto Wagener que ses désaccords avec les communistes « sont moins idéologiques que tactiques! ». L’ennui avec les politiciens de Weimar, déclare-t-il au même Wagener, « c’est qu’ils n’ont jamais lu Marx ». Aux fades réformistes de la social-démocratie, il préfère les communistes. Et l’on sait que ceux-ci le payèrent largement de retour, en votant pour lui en 1933. Ce qui l’oppose aux bolcheviques, dit-il encore, c’est surtout la question raciale. En quoi il se trompait : l’Union soviétique a toujours été antisémite. Disons que la « question juive » (malgré le pamphlet de Marx publié sous ce titre contre les Juifs) n’était pas, pour les Soviétiques, comme pour Hitler, au premier rang des priorités. Pour tout le reste, la « croisade antibolchevique » d’Hitler fut très largement une façade, qui masquait une connivence avec Staline bien antérieure, on le sait maintenant, au pacte germano-soviétique de 1939. Car, ne l’oublions pas, tout comme, d’ailleurs, le fascisme italien, le national-socialisme allemand se voyait et se pensait, à l’instar du bolchevisme, comme une révolution, et une révolution antibourgeoise. « Nazi » est l’abréviation de « Parti national socialiste des travailleurs allemands ». Dans son État omnipotent2 Ludwig von Mises, l’un des grands économistes viennois émigrés à cause du nazisme, s’amuse à rapprocher les dix mesures d’urgence préconisées par Marx dans le Manifeste communiste (1847) avec le programme économique d’Hitler. « Huit sur dix de ces points, note ironiquement von Mises, ont été exécutés par les nazis avec un radicalisme qui eût enchanté Marx. » 1. Otto Wagener, Hitler aus nachster nahe : Aufzeichnungen eines Vertrauten, 1929-1939, Francfort, 1978. 2. 1944. Et 1947 pour la traduction française. Livre rédigé aux États-Unis pendant la guerre et dont le titre original est The Omnipotent Government, The Rise of the Total State and thé Total War. J’ai déjà signalé cette observation de von Mises dans mon livre La Connaissance inutile, 1988, Grasset et Hachette-Pluriel.
(p.114) En 1944 également, Friedrich Hayek, dans sa Route de la servitude1, consacre un chapitre aux «Racines socialistes du nazisme ». Il note que les nazis « ne s’opposaient pas aux éléments socialistes du marxisme, mais à ses éléments libéraux, à l’internationalisme et à la démocratie. » Par une juste intuition, les nazis avaient saisi qu’il n’est pas de socialisme complet sans totalitarisme politique.
(p.116) Car tous les régimes totalitaires ont en commun d’être des idéocraties : des dictatures de l’idée. Le communisme repose sur le marxisme-léninisme et la « pensée Mao ». Le national-socialisme repose sur le critère de la race. La distinction que j’ai établie plus haut entre le totalitarisme direct, qui annonce d’emblée en clair ce qu’il veut accomplir, tel le nazisme, et le totalitarisme médiatisé par l’utopie, qui annonce le contraire de ce qu’il va faire, tel le communisme, devient donc secondaire, puisque le résultat, pour ceux qui les subissent, est le même dans les deux cas. Le trait fondamental, dans les deux systèmes, est que les dirigeants, convaincus de détenir la vérité absolue et de commander le déroulement de l’histoire, pour toute l’humanité, se sentent le droit de détruire les dissidents, réels ou potentiels, les races, classes, catégories professionnelles ou culturelles, qui leur paraissent entraver, ou pouvoir un jour entraver, l’exécution du dessein suprême. C’est pourquoi vouloir distinguer entre les totalitarismes, leur attribuer des mérites différents en fonction des écarts de leurs superstructures idéologiques respectives au lieu de constater l’identité de leurs comportements effectifs, est bien étrange, de la part de « socialistes » qui devraient avoir mieux lu Marx. On ne juge pas, disait-il, une société d’après l’idéologie qui lui sert de prétexte, pas plus qu’on ne juge une personne d’après l’opinion qu’elle a d’elle-même. En bon connaisseur, Adolf Hitler sut, parmi les premiers, saisir les affinités du communisme et du national-socialisme. Car il n’ignorait pas qu’on doit juger une politique à ses actes et à ses méthodes, non d’après les fanfreluches oratoires ou les pompons philosophiques qui l’entourent. Il déclare à Hermann Rauschning, qui le rapporte dans Hitler m’a dit : «Je ne suis pas seulement le vainqueur du marxisme…. j’en suis le réalisateur. «J’ai beaucoup appris du marxisme, et je ne songe pas à m’en cacher….. Ce qui m’a intéressé et instruit chez les (p.117) marxistes, ce sont leurs méthodes. J’ai tout bonnement pris au sérieux ce qu’avaient envisagé timidement ces âmes de petits boutiquiers et de dactylos. Tout le national-socialisme est contenu là-dedans. Regardez-y de près : les sociétés ouvrières de gymnastique, les cellules d’entreprises, les cortèges massifs, les brochures de propagande rédigées spécialement pour la compréhension des masses. Tous ces nouveaux moyens de la lutte politique ont été presque entièrement inventés par les marxistes. Je n’ai eu qu’à m’en emparer et à les développer et je me suis ainsi procuré l’instrument dont nous avions besoin… » L’idéocratie déborde largement la censure exercée par les dictatures ordinaires. Ces dernières exercent une censure principalement politique ou sur ce qui peut avoir des incidences politiques. Il arrive d’ailleurs aux démocraties de le faire également, comme on l’a vu en France pendant la guerre d’Algérie, sous la Quatrième République comme sous la Cinquième. L’idéocratie, elle, veut beaucoup plus. Elle veut supprimer, et elle en a besoin pour survivre, toute pensée opposée ou extérieure à la pensée officielle, non seulement en politique ou en économie, mais dans tous les domaines : la philosophie, les arts, la littérature et même la science. La philosophie, de toute évidence, ne saurait être pour un totalitaire que le marxisme-léninisme, la « pensée Mao » ou la doctrine de Mein Kampf. L’art nazi se substitue à l’art « dégénéré », et, parallèlement, le « réalisme socialiste » des communistes entend tordre le cou à l’art « bourgeois ». Le pari le plus risqué de l’idéocratie, et qui en étale bien la déraison, porte toutefois sur la science, à laquelle elle refuse toute autonomie. On se souvient de l’affaire Lyssenko en Union soviétique. Ce charlatan, de 1935 à 1964, anéantit la biologie dans son pays, congédia toute la science moderne, de Mendel à Morgan, l’accusant de « déviation fasciste de la génétique », ou encore « trotskiste-boukhariniste de la génétique ». La biologie contemporaine commettait en effet à ses yeux le péché de contredire le matérialisme dialectique, d’être incompatible avec la dialectique (p.118) de la nature selon Engels, lequel, nous l’avons vu, affirmait encore, dans l’Anti-Duhring, vingt ans après la publication de L’Origine des espèces de Darwin, sa croyance dans l’hérédité des caractères acquis. Soutenu, ou, plutôt, fabriqué par les dirigeants soviétiques, Lyssenko devint président de l’Académie des Sciences de l’URSS. Il en fit exclure les biologistes authentiques, quand il ne les fit pas déporter et fusiller. Tous les manuels scolaires, toutes les encyclopédies, tous les cours des universités furent expurgés au profit du lyssenkisme. Ce qui eut en outre des conséquences catastrophiques pour l’agriculture soviétique, déjà fort mal en point après la collectivisa-tion stalinienne des terres. La bureaucratie imposa en effet dans tous les kolkhozes l’« agrobiologie » lyssenkiste, proscrivant les engrais, adoptant le « blé fourchu » des… pharaons, ce qui fit tomber de moitié les rendements. On proscrivit les hybridations, puisque, pérorait Lyssenko, il était notoire qu’une espèce se transformait spontanément en une autre et qu’il n’était point besoin de croisements. Ses folles élucubra-tions portèrent le coup de grâce à une production déjà stérilisée par l’absurdité du socialisme agraire. Elles rendirent irréversibles la famine chronique, ou la « disette contrôlée » (disait Michel Heller), qui accompagna l’Union soviétique jusqu’à sa tombe. (…) Le critère extra-scientifique de la vérité scientifique chez les nazis découle du même schéma mental, à cette différence près (p.119) que, chez eux, ce critère est la race au lieu d’être la classe. Mais les deux démarches sont intellectuellement identiques, dans la mesure où elles nient la spécificité de la connaissance comme telle, au bénéfice de la suprématie de l’idéologie.
(p.122) Cette association délirante entre judéité, individualisme et capitalisme motive les éructations antisémites de Karl Marx, dans son essai Sur la question juive (1843). Essai trop peu lu, mais qu’Hitler, lui, avait lu avec attention. Il a presque littéralement plagié les passages de Marx où celui-ci vomit contre les Juifs des invectives furibondes, telles que celle-ci : « Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, la cupidité (Eigennutz}. Quel est le culte profane du Juif ? Le trafic. Quel est son dieu ? L’argent. » Et Marx enchaîne en incitant à voir dans le communisme « l’organisation de la société qui ferait disparaître les conditions du trafic et aurait rendu le Juif impossible ». Dans le genre appel au meurtre, il est difficile de faire plus entraînant.
(p.123) D’où la conception de l’État qui est commune à Lénine et à Hitler. Dans La Révolution prolétarienne et le renégat Kautzky, Lénine écrit : « L’État est aux mains de la classe dominante, une machine destinée à écraser la résistance de ses adversaires de classe. Sur ce point, la dictature du prolétariat ne se distingue en rien, quant au fond, de la dictature de toute autre classe. » Et, plus loin dans le même livre : « La dictature est un pouvoir qui s’appuie directement sur la violence et n’est lié par aucune loi. La dictature révolutionnaire du prolétariat est un pouvoir conquis et maintenu par la violence, que le prolétariat exerce sur la bourgeoisie, pouvoir qui n’est lié par aucune loi. » Si l’on veut bien se reporter au second volume de Mein Kampf, on y verra que, dans le chapitre consacré à l’État, Hitler s’exprime à ce sujet en des termes presque identiques. La « dictature du peuple allemand » y remplace celle du prolétariat. Mais, si l’on tient compte des multiples diatribes anticapitalistes du Fùhrer, les deux concepts ne sont pas très éloignés l’un de l’autre. Tout système politique totalitaire établit invariablement un mécanisme répressif visant à éliminer (p.124) non seulement la dissidence politique mais toute différence entre les comportements individuels. La société se sait inconciliable avec la ‘variété’.
(p.143) C’est ainsi qu’en 1990, l’Unesco organise une célébration de la « mémoire » d’Hô Chi Minh à l’occasion du centenaire de la naissance du dictateur. Tous les thèmes de cette commémoration reproduisent sans examen les mensonges de l’antique (p.144) propagande communiste provietnamienne des années soixante et le mythe de Hô Chi Minh qui avait été fabriqué jadis à coups de dissimulation et d’inventions des « organes ». Le sigle Unesco signifie « Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ». Si l’Unesco servait la science, elle aurait convoqué d’authentiques historiens, qui n’auraient pu que mettre à mal la légende forgée pour transfigurer Hô Chi Minh. Si elle servait l’éducation, elle ne se serait pas mise au service d’un bourrage de crâne totalitaire. Si elle servait la culture, au lieu de la censure, elle n’aurait pas verrouillé ce colloque pour en bannir toute fausse note « viscérale anticommuniste ». Peu convaincu par cette « mémoire » sauce Unesco, Olivier Todd, un des meilleurs connaisseurs au monde des questions du Vietnam, où il fut de longues années envoyé spécial et même prisonnier du Viet-cong, consacre avant l’événement au « mythe Hô Chi Minh », une étude où il déplore « l’extraordinaire naïveté flagorneuse de nombreux publicistes et diplomates, preuve des manipulations politiques au sein de l’Unesco. Cette organisation internationale, émanation de l’ONU, s’apprête à célébrer en Hô Chi Minh un « grand homme d’Etat », un « homme de culture », un « illustre libérateur » de son peuple. La communauté internationale est invitée à subventionner l’héroïsation et la mythi-fication de « l’Oncle » communiste, et ce, l’année qui suit le passage du communisme mondial aux poubelles de l’Histoire1. »
1. Olivier Todd, « Le mythe Hô Chi Minh » dans Hô Chi Minh, l’homme et son héritage. Ouvrage collectif, Duông Moï, La Voie nouvelle, Paris, 1990. Repris dans Commentaire n » 50, été 1990.
(p.155) Rappeler que Castro a fait fusiller 17 000 personnes dans un pays de 10 millions d’habitants et Pinochet 3 197 dans une pays de 15 millions d’habitants permet de comparer une terreur à l’autre, sans excuser aucune des deux.
(p.157) (…) la gauche française persiste dans son attitude protectrice envers le stalinisme cubain. Elle veille à sauvegarder l’immunité dont jouit Castro. Je serais presque tenté de dire : avant, au moins elle mentait ! Maintenant, elle reconnaît que le régime cas-triste repose entièrement sur les violations les plus extrêmes des droits de l’homme et pourtant elle ne lui retire pas sa solidarité. C’est presque pire. Tous les gens de gauche ne souscrivent pas aux propos de Mme Danielle Mitterrand : « Cuba représente le summum de ce que le socialisme peut réaliser », phrase qui constitue la condamnation la plus accablante du socialisme jamais énoncée. Mais tous — et la droite aussi — n’en confirment pas moins de plus belle leur attachement à ce principe (déjà respecté dans les cas des anciens chefs Khmers rouges et d’Erich Honecker) : même quand on sait tout des forfaits d’un bourreau totalitaire « de gauche », il doit rester exempt des peines et même du blâme que l’on doit infliger par « devoir de mémoire » aux bourreaux totalitaires « de droite ».
(p.158) Tous ceux qui ont voyagé en RDA pendant les quinze dernières années de son existence étaient édifiés par l’état de délabrement du pays : immeubles tombant en miettes au point qu’on tendait des cordes le long des trottoirs pour empêcher les piétons d’y marcher, de peur qu’ils ne reçoivent quelque moellon sur la tête ; infrastructures déplorables ; industrie inadaptée, travaillant avec des machines datant des années vingt, et qui crachait du haut de ses cheminées antiques une pollution noirâtre et poisseuse. Ce cataclysme socialiste fut d’ailleurs attribué par la gauche, aussitôt après la réunification allemande, à… l’irruption de l’économie de marché ! N’oublions pas qu’entre 1990 et 1998 ont été transférés aux Lander de l’Est 1 370 milliards de marks, soit, par an, un tiers du budget annuel de la France ! A cet argent public s’ajoutent les investissements privés. Malgré ce flot de capitaux, les Lander de l’Est, tout en ayant considérablement progressé, n’ont pas, en 1999, rattrapé le niveau de vie de l’ex-Allemagne de l’Ouest, tant le socialisme est difficile à guérir.
(p.162) Les nazis avaient rétabli l’esclavage en temps de guerre, dans des camps de travail où les esclaves étaient des déportés provenant des pays vaincus. Les communistes ont fait mieux : ils ont partout réduit en esclavage une part substantielle de leur propre population, et ce en temps de paix, au service d’une économie « normale », si l’on ose dire. Cet aspect souvent ignoré tend à prouver que, si improductive qu’elle soit, l’économie socialiste réelle le serait encore davantage sans le recours à la main-d’œuvre servile.
(p.167) /Mao/ Quant à l’examen multilatéral des textes complets, il révèle que Mao n’est pas un théoricien ou du moins pas un inventeur. Les rares écrits théoriques, « À propos de la pratique », « À propos de la contradiction », se bornent à vulgariser et à simplifier le Matérialisme et Empiriocriticisme de Lénine. Ce sont, d’ailleurs, comme tous ses textes, des écrits de circonstance, de combat, destinés à véhiculer une pression politique précise sur telle tendance concrète au sein ou en dehors du PC chinois. En fait, l’idéologie léniniste-staliniste, adoptée une fois pour toutes, n’est jamais en tant que telle repensée par Mao. Quand il fait apparemment de l’idéologie, c’est, en réalité, de la tactique.
(p.168) Dans le discours où il parle des Cent Fleurs, intitulé « De la juste solution des contradictions au sein du peuple » (1957), comme dans des textes plus anciens : « De la dictature démocratique populaire » (1949) ou « Contre le style stéréotypé dans le Parti » (1942), ce raisonnement, toujours le même, est celui-ci : la discussion est libre au sein du Parti ; mais, dans la pratique, les objections contre le Parti proviennent de deux sources : des adversaires de la Révolution, et ceux-là ne doivent pas avoir le droit de s’exprimer, et des partisans sincères de la Révolution, et ceux-ci ne sont jamais réellement en désaccord avec le Parti. Donc, les méthodes autoritaires sont du « centralisme démocratique », tout à fait légitime, et, dans le peuple, « la liberté est corrélative à la discipline ». (…) En art et en littérature aussi, les Cent Fleurs peuvent intellectuellement s’épanouir, mais comme il importe de ne pas laisser se mêler les « herbes vénéneuses » aux « fleurs odorantes », Mao en revient vite à un dirigisme culturel identique à celui de Jdanov. L’idée d’« armée culturelle » est très ancienne chez Mao. Là encore, il n’innove pas : la culture est toujours le reflet de la réalité politique et sociale. Une fois accomplie la révolution économique, il faut donc aligner sur elle la culture. Cette vue est entièrement conforme au léninisme militant, sans la moindre variante personnelle. Entendons-nous : je ne porte ici aucun jugement politique sur la Chine, et je suis peut-être « chinois », qui sait ? Mais l’étude des textes oblige à dire que, philosophiquement, il n’y a pas de « version chinoise » du marxisme, il n’y pas de maoïsmel.
1. Le Petit Livre rouge. Citations du président Mao Tsé-toung. Seuil, 190 pages. Écrits choisis en trois volumes, par Mao Tsé-toung. Maspero, chaque volume 190 pages.
(p.177) Le communisme conserve sa supériorité morale. On le sent à des symptômes parfois anecdotiques, presque puérils. Quand fut réédité, en janvier 1999, le premier album d’Hergé, épuisé depuis soixante-dix ans, Tintin au pays des Soviets, on le décrivit dans plusieurs articles comme une charge outrée et excessive. Or c’est au contraire une peinture étonnamment exacte, pour l’essentiel, et qui dénote, à cette époque lointaine, chez le jeune auteur « une prodigieuse intuition », ainsi que le signale Emmanuel Le Roy Ladurie répondant à un questionnaire dans Le Figarol. Mais le même Figaro ne semble pas d’accord avec l’historien, puisqu’il juge que la vision d’Hergé « souffre certainement, avec le recul du temps, de manichéisme ». Vous avez bien lu : avec le recul du temps. Ce
1. 6 janvier 1999. Répondent également au questionnaire Alain Besançon, Pierre Daix, qui abondent dans le même sens et Alain Krivine, secrétaire général de la Ligue communiste révolutionnaire (trotskiste), qui déplore pour sa part que L’Humanité se soit livrée à « un mea culpa affligeant ».
(p.178) qui signifie : les connaissances acquises depuis 1929 et plus particulièrement depuis 1989 sur le communisme, tel qu’il fut réellement, doivent nous inciter à l’apprécier de façon plus positive qu’à ses débuts, quand l’illusion pouvait être excusable, vu que l’ignorance était soigneusement entretenue. En somme, si je comprends bien, plus l’information est disponible sur le communisme, moins défavorable est le jour sous lequel nous devons le voir. Dans un commentaire sur la même réédition, la station de radio France-Info (10 janvier 1999), nous assure que Tintin au pays des Soviets était « une charge idéologique au parfum aujourd’hui suranné» (je souligne). Conclusion : ce n’était pas l’adulation du communisme qui était idéologique, c’était d’y être réfractaire. Et, surtout, les événements survenus depuis la Grande Terreur des années trente jusqu’à l’invasion de l’Afghanistan, en passant par le complot des blouses blanches et les répressions de Budapest ou de Prague, le Grand Bond en avant, la Révolution culturelle et les Khmers rouges nous invitent clairement à nous départir par rapport au communisme d’une sévérité que l’histoire objective envoie de toute évidence au rancart. Beaucoup de commentateurs n’ont pas manqué d’insinuer qu’Hergé avait peu d’autorité en la matière puisqu’il s’est « mal conduit » sous l’Occupation. Mais je pose la question : va-t-on prétendre qu’une condamnation du nazisme dégage « un parfum suranné » quand elle émane de la bouche d’un ex-stalinien ? Non, car la question de fond n’est pas celle du parcours politique du juge. Elle est de savoir si oui ou non, le nazisme par lui-même a été monstrueux. Le stalinien qui le dit a, sur ce point-là, raison, tout stalinien qu’il soit. Alors, pourquoi y a-t-il un interdit en sens inverse ? Parce que, je l’ai dit, le communisme conserve sa supériorité morale. Ou, plus exactement, parce qu’on s’acharne, au prix de mille mensonges et dissimulations, à entretenir la tromperie de cette supériorité. Devant cette histoire écrite à l’envers, on doit pardonner (p.179) beaucoup aux journalistes lorsqu’ils se laissent glisser dans le sens de la pente. Car les désinformations qui les abusent trouvent souvent leur origine chez des historiens malhonnêtes. Trop d’entre eux persévèrent, avec une vigilance inaltérable, dans leur défense de la forteresse du mensonge communiste. Ainsi l’auteur du tout récent livre de la collection « Que sais-je ? » sur Le Goulag! trouve le moyen d’épargner Lénine, dont Staline aurait « trahi » l’héritage. Vieille lune mille fois réfutée, mirage faussement salvateur, que la recherche de ces dernières années a dissipé sans équivoque. Néanmoins, pour notre plaisantin, Staline serait en réalité l’héritier… du tsarisme, et non du léninisme! Les camps soviétiques datent de Lénine lui-même, c’est bien établi, et les prisonniers politiques tsaristes, si répressif que fût le régime impérial, ne se montaient qu’à une part infime de ce qu’allaient être les gigantesques masses concentrationnaires communistes. Tout en cherchant à faire passer Staline pour le seul responsable du goulag, notre homme déverse sa bile sur Soljénitsyne, sur Jacques Rossi (à qui l’on doit Le Manuel du Goulag, déjà cité) et sur Nicolas Werth (auteur de la partie sur l’URSS dans Le Livre noir), récusant le témoignage des deux premiers et contestant les capacités d’historien du troisième.
1. Jean-Jacques Marie, Le Goulag, PUF, 1999. Voir sur ce livre le compte rendu de Pierre Rigoulot paru dans le n° 12 (été 1999) des Cahiers d’Histoire sociale.
(p.181) Le révisionnisme procommuniste s’avère /donc/ être de bon aloi.
(p.182) L’Ethiopie du Parti unique emplit tous les critères du classicisme communiste le plus pur. Que les tartufes assermentés ne prennent pas la tangente habituelle en gémissant qu’on n’avait pas affaire à du « vrai » communisme. La « révolution » éthiopienne engendra en Afrique la copie certifiée conforme du prototype lénino-staliniste de l’URSS, laquelle, d’ailleurs, lui accorda son estampille, lui octroya des crédits et lui envoya ses troupes pour la protéger, en l’espèce des troupes cubaines, avec de surcroît le concours d’agents de la police politique est-allemande, l’incomparable Stasi. La junte des chefs éthiopiens, le « Derg », se proclame sans tarder héritière de la « grande révolution d’Octobre », et le prouve en fusillant, dès son arrivée au pouvoir, toutes les élites qui n’appartenaient (p.183) pas à ses rangs ou n’obéissaient pas à ses ordres, encore que, comme dans toutes les « révolutions », la servilité totale ne fût même pas une garantie de vie sauve. Suit la procession des réformes bien connues : collectivisation des terres — dans un pays où 87 % de la population se compose de paysans — nationalisation des industries, des banques et des assurances. Comme prévu — ou prévisible — et comme en URSS, en Chine, à Cuba, en Corée du Nord, etc., les effets immanquables suivent : sous-production agricole, famine, encore aggravées par les déplacements forcés de populations, autre classique de la maison. La faillite précoce oblige à inventer des coupables, des saboteurs, des traîtres puisqu’on ne saurait envisager que le socialisme soit par lui-même mauvais et que ses dirigeants ne soient pas infaillibles. Et, comme d’habitude, le pouvoir totalitaire trouve les canailles responsables du désastre parmi les affamés et non parmi les affameurs, parmi les victimes et non parmi les chefs. Déprimante monotonie d’un scénario universel dont les avocats du socialisme s’acharnent à présenter chaque nouvel exemplaire comme une « exception » — et encore aujourd’hui maints historiens ! Dix mille assassinats politiques dans la seule capitale en 1978 ; massacre des Juifs éthiopiens, les Falachas, en 1979. Mais ce n’est pas de l’antisémitisme, puisque le Derg est de gauche. Et les enfants d’abord ! En 1977, le secrétaire général suédois du Save thé Children Fund relate, dans un rapport, avoir été témoin de l’exposition de petites victimes torturées sur les trottoirs d’Addis-Abeba. « Un millier d’enfants ont été massacrés à Addis-Abeba et leurs corps, gisant dans les rues, sont la proie des hyènes errantes. On peut voir entassés les corps d’enfants assassinés, pour la plupart âgés de onze à treize ans, sur le bas-côté de la route lorsqu’on quitte Addis Abeba ‘. »
1 Cité par Yves Santamaria, dans le chapitre du Livre noir consacré aux afro-communismes : Ethiopie, Angola, Mozambique.
(p.189) L’écart de traitement entre les deux totalitarismes du siècle se décèle également à une foule d’autres petits détails. Ainsi les opérations mani pulite en Italie, et « haro sur l’argent sale des partis » en France ont, ô miracle, contourné avec soin les seuls partis communistes, ou, du moins, s’en sont occupées avec autant de douceur que de lenteur. Pourtant leurs escroqueries ont été percées à jour, qu’il s’agisse des « coopératives rouges » en Italie ou des « bureaux d’étude » fictifs, simples machines à blanchir l’argent volé, du PCF. S’y ajoutaient les sociétés écrans, officiellement vouées au commerce avec l’URSS, façon indirecte pour celle-ci de rétribuer les PC de l’Ouest. Sans parler des sommes directement mais clandestinement envoyées par Moscou, jusqu’en 1990, devises non déclarées, tantôt en espèces, tantôt en Suisse (pour le PCI) et (p.190) relevant, pour le moins, du délit de fraude fiscale, et peut-être en outre de celui d’inféodation stipendiée à une puissance étrangère. Chaque fois que de nouveaux documents sont venus confirmer l’ampleur de ce trafic illégal, documents souvent corroborés, après la chute de l’URSS, par des indiscrétions de personnalités soviétiques ou est-allemandes, on était frappé par la somnolente équanimité des médias et la consciencieuse immobilité de la magistrature. Ces pratiques de pillage des entreprises avaient été décrites et bien établies dès les années soixante-dixl. Pourtant ce n’est qu’en octobre 1996 qu’un secrétaire national du PCF, en l’occurrence Robert Hue, a été mis en examen pour « recel de trafic d’influence ». L’instruction s’engloutit dans les profondeurs d’un bienveillant oubli jusqu’au 18 août 1999, date à laquelle le bruit se répandit que le parquet de Paris avait décidé de requérir le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. Hue et du trésorier du PC2. Fausse alerte. On apprenait l’après-midi même le démenti du parquet : « Les réquisitions sont en train d’être rédigées. Nous démentons les informations faisant état de ces réquisitions. Il est trop tôt pour affirmer que nous allons requérir dans tel ou tel sens. Les réquisitions ne seront prises que pendant la première semaine de septembre. » Elles le furent finalement fin octobre. Parfois, l’inégalité du traitement dont sont l’objet les héritiers lointains ou proches de l’un et l’autre totalitarismes suscite des comportements si dérisoires qu’ils frisent le grotesque. En 1994, la coalition Forza Italia, Ligue du Nord et Alliance nationale gagne les élections en Italie. Silvio Berlusconi devient président du Conseil et prend comme ministre de l’Agriculture un des dirigeants d’Alliance nationale, qui, comme on sait, est issue du renouvellement de l’ancien MSI néo-fasciste mais s’est métamorphosée en se
1. Voir notamment Jean Montaldo, Les Finances du PCF, Albin Michel, 1977. 2. Le Parisien-Aujourd’hui : « Robert Hue menacé de correctionnelle », 18 août 1999. Cet article est malicieusement placé dans les « faits divers » et non dans la politique.
(p.191) démarquant du passé et en abjurant le mussolinisme. Plusieurs vieux fascistes membres de feu le MSI claquent la porte. Malgré cette transformation démocratique, plusieurs dirigeants européens réunis à Bruxelles refusent de serrer la main au nouveau ministre italien de l’Agriculture. Or les dirigeants actuels de l’Alliance nationale n’ont ni l’intention ni les moyens de restaurer la dictature fasciste. Ils ont au contraire rompu avec l’héritage mussolinien et provoqué le départ des nostalgiques du fascisme historique. Ils se sont toujours hermétiquement coupés tant du Front national français que des Republikaners allemands ou de Haider en Autriche. Si le Parti communiste italien redevient fréquentable et digne du pouvoir parce qu’il s’est rebaptisé Parti démocratique de la gauche en abjurant le communisme, pourquoi n’en irait-il pas de même pour l’Alliance nationale, qui, elle aussi, a changé d’étiquette et abjuré le fascisme ? Tant que durera cette dissymétrie dans le traitement réservé aux convertis de gauche et aux convertis de droite, parler de justice ou de morale et de progrès démocratique ne sera qu’imposture. Le drapeau des droits de l’homme claquera haut dans le vide. De notre temps plus que jamais, ce n’est pas la politique qui a été moralisée, c’est la morale qui a été politisée.
(p.192) Dès que pointe la plus petite vérité menaçant de profanation les icônes communistes, les pitbulls de l’orthodoxie déchirent en lambeaux le porteur de la mauvaise nouvelle. On s’étonne que des universitaires souvent de haut niveau quand ils travaillent sans passion ne soient pas plus habiles dans la polémique quand leurs passions entrent en jeu. On les voit tomber dans des pratiques avilissantes, indignes d’eux : fausses citations, textes amputés ou sciemment retournés, injures pires que celles que les communistes lancèrent à Kravtchenko, le dissident qui avait commis le sacrilège d’écrire J’ai choisi la liberté, il y a un demi-siècle. On trouvera une anthologie de ces exploits de la haute intelligentsia dans L’Histoire interdite de Thierry Wolton2. J’y renvoie.
1. 18 novembre 1997. 2. Jean-Claude Lattes, 1998.
(p.227) (…) c’est le roi Victor-Emmanuel qui, en 1943, signifie à Mussolini son congé et le démet de son poste de chef du gouvernement. Qui, au moment où se dessinait l’effondrement militaire de l’Allemagne, aurait pu occuper encore une position constitutionnelle qui lui eût permis en vertu de la loi d’en faire autant vis-à-vis d’Hitler ? Quant aux lois antijuives de 1938, plusieurs historiens italiens ont récemment contesté qu’elles fussent imputables seulement à un opportunisme lié à l’alliance avec Hitler. Ils ont cherché des sources enracinées dans le passé italien. Sans doute y en a-t-il, mais Pierre Milza, étudiant les textes, ne manque pas de constater que, dans la mesure, au demeurant très faible, où ont été esquissées des théories antijuives en Italie, à la fin du dix-neuvième siècle ou au début du vingtième, elles furent empruntées principalement… à la littérature antisémite française, fort luxuriante à cette époque. Dans la pratique, le peuple italien est l’un des moins antisémites du monde et les lois raciales de Mussolini n’entraînèrent aucune destruction massive. Malgré ces lois, en effet, l’Italie fut le pays d’Europe où le pourcentage de la population juive tuée fut le plus basl. Là encore, en matière d’homicide, un abîme sépare le fascisme mussolinien de la haute productivité du nazisme et du communisme. Ces deux derniers régimes appartiennent à la même galaxie criminelle. Le fascisme appartient à une autre, qui n’est pas la galaxie démocratique, bien sûr, mais qui n’est pas non plus la galaxie totalitaire. Si l’on n’a pas encore rétabli les véritables frontières entre tous ces régimes, c’est qu’il y a eu dénazification après 1945, mais qu’il n’y a pas eu décommunisation après 1989.
1. Voir L.S. Dawidowicz, The War against thé ]ews 1933-1945. Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 480. Cité par Emmanuel Todd, Le Destin des immigrés, 1994, Seuil, p. 273. Voir aussi Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, 1961, rééd. 1972.
(p.228) Malgré les efforts de dissimulation et d’escamotage déployés par les contorsion-nistes du distinguo procommuniste, la grande menace inédite qui a pesé sur l’humanité au vingtième siècle est venue du communisme et du nazisme, successivement ou simultanément. Ces deux régimes seuls, et pour des raisons identiques, méritent d’être qualifiés de « totalitaires ». Le terme « fascisme » est donc impropre pour désigner autre chose que la dictature mussolinienne et ses répliques, latino-américaines par exemple.
(p.230) Il y a un noyau central, commun au fascisme, au nazisme et au communisme : c’est la haine du libéralisme.
(p.232) (…) on répond souvent que les partis communistes ont au moins été, dans les pays capitalistes, des forces revendicatives qui par les « luttes » ont contraint les Etats bourgeois à
1. Cité par Nicolas Werth dans Le Livre noir du communisme, première partie : « Un État contre son peuple », chapitre 4.
(p.233) étendre chez eux les droits des travailleurs. Cela aussi est faux. Disons-le derechef : les plus fondamentaux de ces droits, relatifs au syndicalisme et à la grève, furent instaurés dans les nations industrielles avant la guerre de 1914 et la naissance des partis communistes. Quant à la protection sociale — santé, famille, retraites, indemnités de chômage, congés payés etc. — elle fut mise en place à peu près au même moment, soit entre les deux guerres, soit après 1945, dans les pays où les partis communistes étaient inexistants ou négligeables (Suède, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne) et dans ceux où ils étaient forts (France ou Italie). Elle fut due aussi souvent à des gouvernements conservateurs qu’à des gouvernements sociaux-démocrates. C’est un démocrate réformiste, Franklin Roosevelt, qui créa aux États-Unis le système des retraites et le Welfare, prodigieusement étendu, trente ans plus tard, par Kennedy et Johnson. C’est un libéral, Lord Beveridge, qui, en Grande-Bretagne, élabora, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le futur système britannique de protection sociale, que les travaillistes n’acceptèrent qu’à contrecœur, craignant qu’il n’endorme les ardeurs révolutionnaires du prolétariat1. En France, la politisation de la centrale syndicale CGT, devenue en 1947 un simple appendice du PCF, fit s’effondrer à la fois le taux de syndicalisation des salariés et l’efficacité du syndicalisme.
1. Beveridge avait, dès 1911, déjà sous un gouvernement Churchill, fait adopter les premières mesures d’indemnisation du chômage.
(p.243) On se prend parfois à se demander si le goût le plus profond d’une assez grande quantité d’intellectuels ne serait pas le goût de l’esclavage. D’où leur propension et leur adresse à reconstituer, au sein même des civilisations libres, une sorte de totalitarisme informel. En l’absence de toute dictature politique externe, ils reproduisent en laboratoire, in vitro, dans leurs rapports les uns avec les autres, les effets d’une dictature fantôme, dont ils rêvent, avec ses condamnations, ses exclusions, ses excommunications, ses diffamations, convergeant vers le vieux procès en sorcellerie pour « fascisme », intenté à tout individu qui renâcle aux vénérations et exécrations imposées. Bien entendu, dans chaque étouffoir de la liberté de l’esprit, la tyrannie est mutuelle.
(p.250) Certaines réactions irraisonnées, moutonnières et quotidiennes sont plus révélatrices des mentalités que les querelles des économistes. Ainsi, au matin du 5 octobre 1999, dans une collision entre deux trains, à Paddington, dans la banlieue de Londres, environ trente voyageurs sont tués et plusieurs centaines blessés. Aussitôt bruissent en France sur toutes les ondes, toute la journée, les mêmes commentaires : depuis la privatisation des chemins de fer britanniques, les nouvelles compagnies propriétaires ou concessionnaires, mues par la seule recherche du profit, ont économisé sur les dépenses consacrées à la sécurité, notamment dans les infrastructures et la signalisation. Conclusion qui va de soi : les victimes de l’accident ont été assassinées par le libéralisme. Si c’est vrai, alors les cent vingt-deux personnes tuées dans l’accident ferroviaire de Harrow en 1952 furent assassinées
1. Tiré d’un roman policier de Manuel Vazquez Montalban qui, paraît-il, vaut mieux que sa dégradation télévisuelle.
(p.251) par le socialisme, puisque les British Railways étaient alors nationalisés. En France, en pleine gare de Lyon, le 27 juin 1988, un train percute un convoi arrêté : cinquante-six tués et trente-deux blessés, victimes évidentes, par conséquent, de la nationalisation des chemins de fer français en 1937, donc assassinées par le Front populaire. Le 16 juin 1972, la voûte du tunnel de Vierzy, dans l’Aisne, s’effondre sur deux trains : cent huit morts. Là non plus, l’entretien des structures ne paraît pas avoir été d’une perfection éblouissante, tout étatisée que fût la compagnie qui en était chargée. Après quelques heures d’enquête à Paddington, il s’avéra que le conducteur de l’un des trains avait négligé deux feux jaunes qui lui enjoignaient de ralentir et grillé un feu rouge qui lui enjoignait de s’arrêter. L’erreur humaine, semble-t-il, et non l’appât du gain, expliquait le drame. Que nenni ! rétorquèrent aussitôt les antilibéraux, car le train fautif n’était pas équipé d’un système de freinage automatique se déclenchant dès qu’un conducteur passe par inadvertance un signal rouge. Sans doute, mais dans l’accident de la gare de Lyon, ce système, s’il existait, ne semble pas avoir beaucoup servi non plus pour pallier l’erreur du conducteur français. Pas davantage le 2 avril 1990 en gare d’Austerlitz à Paris, lorsqu’un train défonça un butoir, traversa le quai et s’engouffra dans la buvette. S’agissant d’infrastructures, la vétusté des passages à niveau français, mal signalés et pourvus de barrières fragiles ne s’abaissant qu’à la dernière seconde, cause chaque année entre cinquante et cent morts, et plus souvent autour de quatre-vingts, d’ailleurs, que de cinquante. L’infaillibilité du « service public à la française », en l’occurrence, ne saute pas absolument aux yeux. Ce sont là des faits et des comparaisons qui, naturellement, ne vinrent même pas à l’esprit des antilibéraux. Ajoutons à ces quelques rappels que les chemins de fer britanniques, même du temps où ils appartenaient à l’État, étaient réputés dans toute l’Europe pour leur médiocre fonctionnement. Enfin, leur privatisation ne s’est achevée qu’en 1997!
(p.252) Comment la déficience des infrastructures et du matériel roulant se serait-elle produite de façon aussi soudaine et rapide en moins de deux ans ? En réalité, British Railways a légué aux compagnies privées un réseau et des machines profondément dégradés, qui mettaient en péril la sécurité depuis plusieurs décennies. La mise en accusation du libéralisme dans cette tragédie relève plus de l’idée fixe que du raisonnement. Que l’on me comprenne bien. Je l’ai souvent écrit dans ces pages : il ne faut pas considérer le libéralisme comme l’envers du socialisme, c’est-à-dire comme une recette mirobolante qui garantirait des solutions parfaites, quoique par des moyens opposés à ceux des socialistes. Une société privée est très capable de faire courir des dangers à ses clients par recherche du profit. C’est à l’État de l’en empêcher, et cette vigilance fait partie de son véritable rôle, que précisément, d’ailleurs, le plus souvent il ne joue pas. Mais la négligence, l’incurie, l’incompétence ou la corruption ne font pas courir de moindres risques aux usagers des transports nationalisés. Il faut pousser l’obsession antilibérale jusqu’à l’aveuglement complet pour prétendre ou sous-entendre qu’il n’y aurait jamais eu d’accident que dans les transports privés… Les trente morts dus à la collision entre deux trains de la Compagnie nationale norvégienne, le 4 janvier 2000, furent-ils victimes du libéralisme ? Il en va de même pour les automobiles. Les Renault, à l’époque où cette société avait l’Etat pour actionnaire unique, n’étaient ni plus ni moins sûres que les Peugeot, les Citroën, les Fiat ou les Mercedes, fabriquées par des sociétés privées. Elles l’étaient même plutôt moins, puisque la Renault « Dau-phine », par exemple, devint vite célèbre pour sa facilité à se retourner sur le toit. Etant donné que Renault nationalisée avait en permanence un compte d’exploitation déficitaire, les voitures sorties de ses ateliers, n’étant source d’aucun profit, au contraire, auraient dû, si l’on suit la logique antilibérale, ne provoquer jamais aucun accident dû à des défaillances dans la mécanique ou l’aérodynamisme.
(p.253) Je viens de donner deux exemples illustrant l’omniprésence d’un fonds presque inconscient de culture antilibérale, qui jaillit comme un cri du cœur en toute occasion et qui est d’autant plus étonnant qu’il persiste à l’encontre de toute l’expérience historique du vingtième siècle et même de la pratique actuelle de la quasi-totalité des pays. La pratique diverge de la théorie et de la sensibilité. L’instinct tient compte, plus que l’intelligence, des enseignements du passé. L’antilibéral est un mage qui se proclame capable de marcher sur les flots mais qui prend grand soin de réclamer un bateau avant de prendre la mer. Comment expliquer ce mystère ? Une première cause en est cette inertie de la pensée que j’ai appelée la « rémanence idéologiquel ». Une idéologie peut survivre longtemps aux réalités politiques et sociales qu’elle accompagnait. On trouvait encore en France, à la fin des années trente, cent cinquante ans après la Révolution, un remuant courant royaliste, avec de nombreux partisans de la monarchie absolue et non pas même constitutionnelle. Sans prendre part directement à la vie politique au Parlement ou au gouvernement, ce courant exerçait sur la société française une influence notable, tant par sa presse que par les auteurs de talent qui propageaient ses idées hostiles à la République. Malgré l’irréalisme de son programme de restauration monarchique, cette école de pensée jouait dans le débat public et la vie culturelle un rôle qui n’avait rien de marginal.
1. Voir La Connaissance inutile (1988) et Le Regain démocratique (1992).
(p.256) Homme de gauche, et il l’a prouvé en payant le prix fort, idole vénérée par les socialistes français au vingtième siècle, Zola était néanmoins assez intelligent pour comprendre que toute société est inégalitaire.
(p.266) Le plus piquant est que l’Etat, quand il veut corriger — lisez : escamoter — ses erreurs économiques, les aggrave. Il peut se comparer à une ambulance qui, appelée sur les lieux d’un accident de la route, foncerait dans le tas et tuerait les derniers survivants. Pour masquer, autant que faire se pouvait, le trou creusé au Lyonnais par sa sottise et sa canaillerie, l’État crée, en 1995, un comité baptisé Consortium de réalisation (CDR), chargé de « réaliser » au mieux les créances douteuses de la banque. Prouesse : le CDR a augmenté les pertes d’au moins cent milliards1 ! C’est la droite, alors au pouvoir, qui, désirant, avec son dévouement habituel, effacer les fautes et les escroqueries de la gauche, inventa cette burlesque « pompe à phynances ».
1 Voir les détails dans le mensuel Capital, n° 94, juillet 1999.
(p.268) L’élévation meurtrière de la fiscalité en France ne sert principalement ni à créer des emplois ni à soulager ceux qui n’en ont pas, ni à la productivité ni à la solidarité. Elle sert avant tout à combler les trous creusés par les gaspillages et l’incompétence d’un État qui refuse de réformer sa gestion, comme le refusent les collectivités locales, caractérisées, elles aussi, par les folies dépensières et le mépris des contribuables.
(p.269) Tout individu qui accepte de s’anéantir devant le Parti se voit garantir en échange un emploi. Sans doute cet emploi est-il très médiocrement payé (en moyenne l’équivalent de dix dollars par mois, soixante francs, en 1999 à Cuba, par exemple) ; et c’est bien pourquoi, en échange, très peu de travail est exigé. L’emploi presque sans travail et presque sans salaire est garanti à vie. D’où la plaisanterie mille fois entendue par les voyageurs de jadis en URSS : « Ils font semblant de nous payer, nous faisons semblant de travailler. » Orlov, chercheur scientifique lui-même, cite des cas où des collaborateurs scientifiques sont demeurés des mois absents de leur laboratoire ou bien ont fourni des résultats truqués, sans faire l’objet de la moindre sanction. En effet, les promotions découlent de la fidélité idéologique plus que de la compétence professionnelle. « L’affectation de travailleurs à des fonctions ne correspondant pas à leur qualification mais donnant droit à une rémunération supérieure, l’exagération des travaux exécutés dans le calcul des primes » sont des gratifications courantes, mais qui ne s’octroient qu’aux citoyens loyaux. Cette servilité politique sans restriction implique pour celui qui s’y plie le sacrifice de sa liberté et de sa dignité. Mais l’existence qu’elle lui procure n’est pas dénuée de confort psychique. On peut comprendre qu’une population élevée depuis plusieurs générations dans cette médiocrité douillette et docile supporte mal d’être brutalemenT
1. Op. cit.
(p.270) plongée dans les eaux tourbillonnantes de la société de concurrence et de responsabilité. Quand on écoute certains ressortissants des sociétés anciennement communistes d’Europe centrale, on se rend compte qu’ils escomptaient de la démocratisation et de la libéralisation de leur pays qu’elles maintiennent le droit à l’emploi à vie dans l’inefficacité tout en leur octroyant le niveau de vie de la Californie ou de la Suisse. L’idée ne les effleure pas qu’à partir du moment où existe un choix entre une automobile de mauvaise qualité « Trabant », fabriquée en Allemagne de l’Est, et une meilleure voiture fabriquée à l’Ouest pour le même prix, les clients, à commencer par les Allemands de l’Est eux-mêmes, achèteront la deuxième. Ainsi, à bref délai, les usines Trabant devront fermer — ce qui s’est effectivement passé.
(p.280) L’erreur de la gauche archaïque est de méconnaître que la libéralisation ne contraint pas à l’abandon des programmes sociaux. Elle oblige, il est vrai, à mieux les gérer. Pour les socialistes français, le critère d’une bonne politique sociale, c’est l’importance de la dépense, pas l’intelligence avec laquelle elle est faite. Le résultat est secondaire.
(p.280) Les Pays-Bas, la Suède (qui était quasiment en faillite en 1994) ont réussi à libéraliser leurs économies un peu à la manière de la Nouvelle-Zélande et sans renoncer pour autant à leurs budgets sociaux, mais en les gérant mieux. Et, surtout, en libéralisant fortement la production. La Suède s’est lancée dans la concurrence et l’entreprise. Elle aussi a privatisé les industries, les télécommunications, l’énergie, les banques et les transports
1 Le 26 février 1985, le dollar atteint le cours record de 10,61 francs. Il était à environ 5,50 francs en 1981. Mais, naturellement, si le franc est tombé de moitié, c’est la faute… des Américains.
(p.303) L’intolérance d’un groupuscule d’intellectuels, lorsqu’il sert de modèle, finit par imprégner ce qu’on pourrait appeler le bas clergé de l’intelligentsia. Ainsi, en 1997, une documentaliste du lycée Edmond-Rostand à Saint-Ouen-l’Aumône, soutenue par un « collectif d’enseignants », ce qui est alarmant, expurge la bibliothèque dudit lycée. Elle en retire des ouvrages d’auteurs considérés par elle comme d’« extrême droite », fascistes, entre autres ceux de deux éminents écrivains et historiens, Marc Fumaroli et Jean Tulard. Pis : le tribunal de Pontoise débouta les auteurs censurés, qui avaient porté plainte pour atteinte à la réputation. Il allégua « qu’on ne saurait considérer que Mme Chaïkhaoui a commis une faute en établissant une liste de titres qu’elle jugeait dangereux»1. En quoi Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, de Fumaroli, ou le Napoléon de Tulard sont-ils dangereux, de quel point de vue et pour qui ? En vertu de quelle légitimité, de quel mandat et de quelle compétence Mme Chaïkhaoui est-elle qualifiée pour se prononcer sur le « danger » d’une œuvre de l’esprit et pour la censurer ? A-t-on rétabli l’Inquisition ? Acte injustifiable et déshonorant.
1 Voir à ce sujet mon article « L’index au xxe siècle », dans mon recueil Fin du siècle des ombres, Fayard, 1999, p. 585.
(p.304) En revanche, lorsqu’en 1995, le maire du Front national d’Orange avait entrepris de rétablir lui aussi l’« équilibre idéologique » dans la bibliothèque municipale, qui comptait, selon lui, trop d’ouvrages de gauche, la presque totalité de la presse fut fondée à comparer ce sectarisme avec les autodafés de livres sous Hitler. Mais lorsque l’autodafé vient de la gauche, même s’il repose de surcroît sur une inculture crasse et une ignorance flagrante des auteurs censurés, l’Éducation nationale et l’Autorité judiciaire lui donnent leur bénédiction. Nous vivons dans un pays où un simple employé peut expurger une bibliothèque en se bornant à imputer, contre toute vraisemblance, aux épurés des sympathies fascistes ou racistes et pourquoi pas ? la responsabilité de l’holocauste. Nos élites réprouvent la censure et la délation calomnieuse lorsqu’elles viennent du Front national, rarement quand elles émanent d’une autre source idéologique. L’idéologue, quant à lui, ne perçoit le totalitarisme que chez ses adversaires, jamais en lui-même puisqu’il est sûr de détenir la Vérité absolue et le monopole du Bien. Les intellectuels flics et calomniateurs ont proliféré ces dernières années plus encore à gauche qu’à l’extrême droite. Or, quand elles atteignent le stade du sectarisme persécuteur, la droite et la gauche cessent de se distinguer pour fusionner au sein d’une même réalité, le totalitarisme intellectuel. Les principes dont elles se réclament respectivement l’une et l’autre n’ont plus aucun intérêt. Ils s’effacent devant l’identité des comportements, qui les rend indiscernables.
1. 18 septembre 1998. R. Redeker appartient à la rédaction des Temps modernes, dont, comme on sait, Claude Lanzmann est le directeur.
(p.307) Ce populisme, qui se réduit à l’affirmation sans cesse réitérée de ce que son « élite » aux abois souhaite qu’on lui dise, tend, ne l’oublions pas, vers ce but éternel et primordial : rétablir la croyance selon laquelle le marxisme reste juste et le communisme n’était pas mauvais, en tout cas moins que ne l’est le capitalisme. D’où le zèle que déploie, par exemple, Le Monde diplomatiquel pour assurer la diffusion en français de l’ouvrage du marxiste anglais Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes (1914-1941), impavide négationniste s’il en fut, qui va jusqu’à refuser d’admettre, aujourd’hui, que les Soviétiques soient les auteurs du massacre de Katyn, bien que Mikhaïl Gorbatchev lui-même l’ait reconnu en 1990 et que plusieurs documents sortis des archives de Moscou l’aient confirmé depuis lors.
1. Voir le résumé de l’« affaire Hobsbawm » dans Le Monde, 28 octobre 1999.
(p.308) Depuis la fin de l’Empire soviétique, il en subsiste au fond un seul, c’est l’antiaméricanisme. Prenez la France, pays auquel je me réfère volontiers parce qu’il est le laboratoire paradigmatique de la résistance aux enseignements de la catastrophe communiste. Si vous enlevez l’antiaméricanisme, à droite comme à gauche, il ne reste rien de la pensée politique française. Enfin, ne lésinons pas, il en reste peut-être, mettons (p.309) trois ou quatre pour cent, du moins dans les milieux qui occupent le devant de l’éphémère. La mondialisation, par exemple, est rarement analysée en tant que telle, pas plus que les fonctions de l’Organisation mondiale du commerce. L’une et l’autre font peur. Pourquoi ? Parce qu’ils sont devenus synonymes d’hyperpuissance américaine1. Si vous objectez que la mondialisation des échanges ne profite pas unilatéralement aux États-Unis, lesquels achètent plus qu’ils ne vendent à l’étranger, sans quoi leur balance du commerce extérieur ne serait pas en déficit chronique ; ou si vous avancez que l’OMC n’est pas foncièrement néfaste aux Européens ou aux Asiatiques, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi tant de pays qui n’en sont pas encore membres (la Chine, par exemple, dont l’entrée a finalement été décidée en novembre 1999) font des pieds et des mains pour s’y faire admettre, alors vous haranguez des sourds. Car vous vous placez sur le terrain des considérations rationnelles alors que votre auditoire campe sur celui des idées fixes obsessionnelles. Vous ne gagnerez rien à lui mettre sous les yeux des éléments réels de réflexion, sinon de vous faire traiter de valet des Américains. Pourtant, l’OMC a tranché en faveur de l’Union européenne plus de la moitié des différends qui l’opposaient aux États-Unis et a souvent condamné ceux-ci pour subventions déguisées. Loin d’être la foire d’empoigne du laissez-passer, l’OMC a été au contraire créée afin de rendre loyale la concurrence dans les échanges mondiaux. La haine des États-Unis s’alimente à deux sources distinctes mais souvent convergentes : les États-Unis sont l’unique superpuissance, depuis la fin de la guerre froide ; les États-Unis sont le principal champ d’action et centre d’expansion du diable libéral. Les deux thèmes d’exécration se rejoignent, puisque c’est précisément à cause de son « hyperpuissance » que l’Amérique répand la peste libérale sur l’ensemble de la planète. D’où le cataclysme vitupéré sous le nom de mondialisation.
1. Voir le sondage paru dans Les Échos, 2 novembre 1999.
(p.310) Si l’on prend au pied de la lettre ce réquisitoire, il en ressort que le remède aux maux qu’il dénonce serait que chaque pays mette ou remette en place une économie étatisée et, d’autre part, se ferme hermétiquement aux échanges internationaux, y compris et surtout dans le domaine culturel. Nous retrouvons donc là, dans une version post-marxiste, l’autarcie économique et culturelle voulue par Adolf Hitler. En politique internationale, les États-Unis sont plus détestés et désapprouvés, même par leurs propres alliés, depuis la fin de la guerre froide qu’ils ne l’étaient durant celle-ci par les partisans avoués ou inavoués du communisme. C’est au point que l’Amérique soulève la réprobation parfois la plus haineuse, même quand elle prend des initiatives qui sont dans l’intérêt évident de ses alliés autant que d’elle-même, et qu’elle est seule à pouvoir prendre. Ainsi, durant l’hiver 1997-1998, l’annonce par Bill Clinton d’une éventuelle intervention militaire en Irak, pour forcer Saddam Hussein à respecter ses engagements de 1991, fit monter de plusieurs degrés le sentiment hostile envers les États-Unis. Seul le gouvernement britannique prit position en leur faveur. Le problème était pourtant clair. Depuis plusieurs années, Saddam refusait d’anéantir ses stocks d’armes de destruction massive, empêchait les inspecteurs des Nations unies de les contrôler, violant ainsi l’une des principales conditions acceptées par lui lors de la paix consécutive à sa défaite de 1991. Étant donné ce dont le personnage est capable, on ne pouvait nier la menace pour la sécurité internationale que représentait l’accumulation entre ses mains d’armes chimiques et biologiques. Mais, là encore, le principal scandale que trouvait à dénoncer une large part de l’opinion internationale, c’était l’embargo infligé à l’Irak. Comme si le vrai coupable des privations subies de ce fait par le peuple irakien n’était pas Saddam lui-même, qui avait ruiné son pays en se lançant dans une guerre contre l’Iran en 1981, puis contre le Koweït en 1990, enfin en entravant l’exécution des résolutions de l’ONU sur ses armements. Le soutien que, par haine des États-Unis, (p.311) les censeurs de l’embargo apporteraient ainsi à un dictateur sanguinaire venait aussi bien de l’extrême droite que de l’extrême gauche (Front national et Parti communiste en France) ou des socialistes de gauche (l’hebdomadaire The New States-man en Grande-Bretagne ou Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur, en France), et de la Russie autant que d’une partie de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un commun dénominateur antiaméricain plus que d’un choix idéologique ou stratégique cohérent. Beaucoup de pays, dont la France, ne niaient pas la menace représentée par les armements irakiens, mais déclaraient préférer à l’intervention militaire la « solution diplomatique ». Or la solution diplomatique était, précisément, rejetée depuis sept ans par Saddam, qui avait tant de fois mis à la porte les représentants de l’ONU ! Quant à la Russie, elle clama que l’usage de la force contre Saddam mettrait en péril ses propres « intérêts vitaux ». On ne voit pas en quoi. La vérité est que la Russie ne perd pas une occasion de manifester sa rancœur de ne plus être la deuxième superpuissance mondiale, ce qu’elle était ou croyait être du temps de l’Union soviétique. Mais l’Union soviétique est morte de ses propres vices, dont la Russie subit encore les conséquences. Il y a eu dans le passé des empires et des puissances d’échelle internationale, avant les Etats-Unis de cette fin du vingtième siècle. Mais il n’y en avait jamais eu aucun qui atteignît à une prépondérance planétaire. C’est ce que souligne Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller à la Sécurité du président Jimmy Carter, dans son livre, Le Grand Échiquier1. Pour mériter le titre de superpuissance mondiale, un pays doit occuper le premier rang dans quatre domaines : économique, technologique, militaire et culturel. L’Amérique est actuellement le seul pays — et le premier dans l’histoire — qui remplisse ces quatre conditions à la fois.
1 Trad. fr., Bayard éditions, 1997.
(p.313) Car la prépondérance de l’Amérique est venue, sans doute, de ses qualités propres, mais aussi des fautes commises par les autres, en particulier par l’Europe. Récemment encore, la France a reproché aux États-Unis de vouloir lui ravir son influence en Afrique. Or, la France porte une accablante responsabilité dans la genèse du génocide rwandais de 1994 et dans la décomposition du Zaïre qui a suivi. Elle s’est donc discréditée toute seule, et c’est ce discrédit qui a creusé le vide rempli ensuite par une présence croissante des États-Unis. (…) (p.314) La superpuissance américaine résulte pour une part seulement de la volonté et de la créativité des Américains. Pour une autre part, elle est due aux défaillances cumulées du reste du monde : la faillite du communisme, le suicide de l’Afrique débilitée par les guerres, les dictatures et la corruption, les divisions européennes, les retards démocratiques de l’Amérique latine et surtout de l’Asie. À l’occasion de l’intervention de l’Otan au Kosovo la haine antiaméricaine s’est haussée encore d’un cran. Dans la guerre du Golfe, on pouvait plaider que, derrière une apparente croisade en faveur de la paix, se cachait la défense d’intérêts pétroliers. On négligeait ainsi, d’ailleurs, ce fait que les Européens sont beaucoup plus dépendants du pétrole du Moyen-Orient que ne le sont les États-Unis. Mais au Kosovo, même avec la pire foi du monde, on ne voit pas quel égoïsme américain pouvait dicter cette intervention dans une région sans grandes ressources ni grande capacité importatrice et où l’instabilité politique, le chaos ethnique, les crimes contre la population faisaient courir un grave danger à l’équilibre de l’Europe, mais aucun à celui des États-Unis. Au cours du processus de mobilisation de l’Otan, ce sont plutôt les Américains qui ont eu le sentiment d’être entraînés dans cette expédition par les Européens, et plus particulièrement par la France, après l’échec de la conférence de Rambouillet. Ame de cette conférence, en février 1999, Paris avait déployé tous ses efforts et engagé tout son prestige pour convaincre la Serbie d’accepter un compromis au sujet du Kosovo. Si le refus des Serbes ne leur avait valu ensuite (p.315) aucune sanction, c’est l’Europe, et en premier lieu la France, qui auraient ainsi donné le spectacle d’une pitoyable impuissance, au demeurant réelle. La participation américaine à l’opération militaire de l’Otan eut pour fonction à la fois de la pallier et de la masquer. Sur neuf cents avions engagés, six cents étaient américains, ainsi que la quasi-totalité des satellites d’observation1. Car les crédits que les États-Unis à eux seuls consacrent à l’équipement et à la recherche militaires sont deux fois plus élevés que ceux des quinze pays de l’Union européenne ; et, en matière de défense spatiale, dix fois plus. Si la volonté d’agir au Kosovo fut européenne, les moyens, dans leur majorité, furent et ne pouvaient être qu’américains. De surcroît, la barbarie qu’il s’agissait d’éradiquer résultait de plusieurs siècles d’absurdités d’une facture inimitablement européenne dont la moindre n’était pas la dernière en date : avoir toléré le maintien à Belgrade, après la décomposition du titisme, d’un dictateur communiste reconverti en nationaliste intégral. Mais, puisqu’il fallait comme d’ordinaire imputer aux Américains les fautes européennes, cette constellation d’antécédents historiques presque millénaires et de facteurs contemporains visibles et notoires fut recouverte du voile de l’ignorance volontaire par de copieuses cohortes intellectuelles et politiques en Europe. À la connaissance on substitua une construction imaginaire selon laquelle les exterminations interethniques au Kosovo étaient une invention américaine destinée à servir de prétexte aux États-Unis pour, en intervenant, mettre la main sur l’Otan et asservir définitivement l’Union européenne. Pascal Bruckner a dressé un inventaire édifiant de ce sottisier2. (…)
1. Pierre Beylau, « Défense : l’impuissance européenne », Le Point, 14 mai 1999. 2. Pascal Bruckner, « Pourquoi cette rage antiaméricaine ? », « Point de vue » publié dans Le Monde, 1 avril 1999. Et « L’Amérique diabolisée », entretien paru dans Politique internationale, n° 84, été 1999.
(p.316) La convergence entre l’extrême droite et l’extrême gauche frôle ici l’identité de vues. Jean-Marie Le Pen est indiscernable de Régis Debray et de quelques autres quand il écrit dans l’organe du Front national, National Hebdo2 : « Le spectacle de l’Europe (et de la France !) à la botte de Clinton dans cette guerre de lâches et de barbares moralisants est écœurant, ignoble, insupportable. J’ai été pour les Croates et contre Milosevic. Aujourd’hui, je suis pour la Serbie nationaliste, contre la dictature que les Américains imposent. » Pour Didier Motchane, du Mouvement des citoyens (gauche socialiste), le but secret des Américains était d’attiser l’hostilité entre la Russie et l’Union européenne. Pour Bruno Mégret, de l’extrême droite (Mouvement national), il était de créer un précédent dont pourraient s’autoriser un jour les Maghrébins, bientôt majoritaires dans le sud de la France,
1. Le Monde, 1″ avril 1999. 2. 22 avril 1999.
(p.317) pour exiger un référendum sur l’indépendance de la Provence, voire son rattachement à l’Algérie. Pour Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire de gauche Marianne, le même calcul pervers tendait à inciter à la même démarche les Alsaciens, s’il leur venait à l’esprit de vouloir redevenir Allemands. En cas de refus du gouvernement français, l’Oncle Sam se sentirait alors en droit de bombarder Paris, tout comme il a bombardé Belgrade en 1999. Jean Baudrillard confie de son côté à Libérationl sa version de l’événement : le dessein réel de l’Amérique est selon lui d’aider Milosevic à se débarrasser des Kosovars ! Allez comprendre… C’est d’ailleurs également l’Amérique, affirme Baudrillard, qui a provoqué la crise financière de 1997 au Japon et dans les autres pays d’Asie. Ni ces pays ni le Japon n’ont donc la moindre responsabilité propre dans leurs malheurs boursiers. Pas plus que les Européens dans la genèse de l’inextricable écheveau des haines balkaniques. La conscience morale de ces philosophes n’est pas effleurée par l’hypothèse que l’Union européenne aurait été déshonorée si elle avait laissé se poursuivre, au cœur de son continent, la boucherie du Kosovo. Il est vrai que, selon eux, le projet global de Washington est de « barrer la route à la démocratie mondiale en lente émergence2 ». Le nettoyage ethnique du Kosovo était donc « une démocratie en lente émergence ? » Avec ce passe-partout en main, plus n’est besoin de se casser la tête à étudier les relations internationales ou même à s’en informer. Comme le souligne judicieusement Jean-Louis Margolin3, «la lecture du monde est alors simple : Washington est toujours coupable, forcément coupable ; ses adversaires sont toujours des victimes, forcément victimes ». J’ajouterai : ses alliés aussi ! Toujours coupable, c’est bien le mot. Si les Américains renâclent à s’engager dans une opération humanitaire, ils sont stigmatisés pour leur peu d’empressement à secourir les affamés et les persécutés. S’ils
1. 29 avril 1999. 2. Denis Duclos, Le Monde, 22 avril 1999. 3. Le Monde, 29 mai 1999.
(p.318) s’y engagent, ils sont accusés de comploter contre le reste de la planète (…) C’est nous surtout, Européens, qui nous adonnons à cette projection sur les États-Unis des causes de nos propres erreurs. L’« unilatéralisme » américain que dénonce le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, Hubert Védrine, n’est souvent que l’envers de notre indécision ou de nos mauvaises décisions. Pour la France, se figurer tenir tête à cet « unilatéralisme » en tapant du pied pour imposer la vente de nos bananes antillaises au-dessus du prix (p.319) du marché ou pour protéger outrageusement Saddam Hussein est dérisoire. De même, l’obséquiosité avec laquelle la France a reçu le président chinois en octobre 1999 découlerait, a-t-on dit, d’un « grand dessein » consistant à promouvoir le géant chinois pour contrebalancer le géant américain. Ainsi, la France, en août 1999, est allée jusqu’à dénoncer comme « déstabilisant pour la Chine » le projet américain d’installer des boucliers antimissiles aux Etats-Unis et dans certains pays d’Extrême-Orient. Nous reconnaissons là un vieux canasson de la propagande pro-soviétique de jadis, selon laquelle c’était la défense occidentale qui constituait la seule menace pour la paix car elle semait l’angoisse au Kremlin.
(p.322) Les deux pilotes de la réunification furent d’abord, naturellement, le président soviétique et le chancelier ouest-allemand. Mais il leur fallait une garantie internationale et un soutien extérieur, pour le cas où une partie des responsables soviétiques et notamment des généraux auraient décidé de s’opposer à Gorbatchev et d’intervenir militairement pour prolonger par la force l’existence de la RDA. Cette garantie internationale et ce soutien extérieur, ce furent les États-Unis qui les leur apportèrent. Le président américain, George Bush, par des signaux dénués d’ambiguïté, fit comprendre aux éventuels va-t-en-guerre de Moscou qu’une reprise de l’opération « Printemps de Prague » en RDA se heurterait, cette fois-ci, à une riposte américaine. N’ayant saisi ni l’importance ni la signification des événements qui arrachèrent l’Europe centrale au communisme, et n’y ayant joué aucun rôle positif, les Européens occidentaux n’ont aucun droit de déplorer l’« hyperpuissance » américaine, laquelle provient de ce que l’Amérique a dû combler leur propre vide politique et intellectuel, dans des circonstances où, (p.323) cependant, c’étaient les intérêts vitaux de l’Europe, une fois de plus, qui étaient en jeu. Appartenir à l’Europe, être l’allié de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, ne fut d’aucun secours à Helmut Kohi en 1989 et en 1990 dans la conduite de l’opération la plus risquée, la plus lourde de conséquences de l’histoire récente de son pays. En revanche, être l’allié des États-Unis lui permit de mener la réunification à bien dans la paix tout en parachevant la décommunisation de l’Europe centrale. En outre, George Bush sut s’abstenir de tout triomphalisme susceptible d’irriter les opposants soviétiques à la politique de Gorbatchev. Le président américain refusa, en particulier, de suivre l’avis de ses conseillers, qui l’incitaient à se rendre à Berlin au lendemain de la chute du Mur. Il eut la décence de respecter la résonance purement allemande des retrouvailles des deux populations. Il ne fut pas du spectacle, mais il avait été du combat. L’Europe en avait été absente. Voilà pourquoi ni Jacques Chirac, ni Tony Blair, ni Massimo D’Alema n’assistèrent à la commémoration du 9 novembre 1999 au Bundes-tag, dans Berlin réunifiée. L’antiaméricanisme onirique provient de deux origines distinctes, qui se rejoignent dans leurs résultats. La première est le nationalisme blessé des anciennes grandes puissances européennes. La deuxième est l’hostilité à la société libérale chez les anciens partisans du communisme, y compris ceux qui, sans approuver les sanguinaires totalitarismes soviétiques, chinois ou autres, avaient fait le pari que le communisme pourrait un jour se démocratiser et s’humaniser. Le nationalisme blessé ne date pas de la fin de la guerre froide. Il apparaît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Son plus brillant et catégorique porte-parole fut le général de Gaulle. « L’Europe occidentale est devenue, même sans s’en apercevoir, un protectorat des Américains », confie-t-il en 1963 à Alain Peyrefitte1. Pour le premier président de la
1. Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, op. cit., tome II, dont sont extraites également les citations qui vont suivre.
(p.324) Cinquième République, il existe une équivalence entre la relation de Washington avec l’Europe occidentale et celle de Moscou avec l’Europe centrale et orientale. « Les décisions se prennent de plus en plus aux États-Unis… C’est comme dans le monde communiste, où les pays satellites se sont habitués à ce que les décisions se prennent à Moscou. » Malheureusement les Européens de l’Ouest, hormis la France, « se ruent à Washington pour y prendre leurs ordres ». « Les Allemands se font les boys des Américains. » D’ailleurs, déjà pendant la guerre, « Churchill piquait une lèche éhontée à Roosevelt ». « Les Américains ne se souciaient pas plus de délivrer la France que les Russes de libérer la Pologne. » De Gaulle développera publiquement cette thèse dans sa conférence de presse du 16 mai 1967 : les États-Unis ont traité la France après 1945 exactement comme l’URSS a traité la Pologne ou la Hongrie. Rien ne l’en fait démordre. En 1964, le président Johnson adresse aux Départements d’État et de la Défense un mémorandum leur disant qu’il n’approuvera aucun plan de défense qui n’ait au préalable été discuté avec la France. De Gaulle déclare alors à Peyrefitte : «Johnson cherche à noyer le poisson. » S’il n’avait pas prescrit de consulter la France, Johnson aurait assurément montré par-là son « hégémonisme ». Quand il proclame au contraire la liberté de choix française et la volonté américaine de n’adopter aucun plan sans l’accord de Paris, alors c’est qu’il désire « noyer le poisson ». Le dispositif mental que nous connaissons est bien en place : les États-Unis ont toujours tort. Chez le nationaliste, donc, la pensée tourne dans le labyrinthe passionnel de l’orgueil blessé. Même dans la science et la technologie, le retard de son propre pays ne provient pas, selon lui, de ce qu’il a fait fausse route, ou d’une inaptitude — pour des raisons, par exemple, de raideur étatique — à voir et à prendre la direction de l’avenir. Si un autre pays saisit avant lui les occasions de progrès, ce ne saurait être que par malveillance et appétit de domination. L’intelligence n’y est pour rien, ni le système économique. Ainsi, en 1997, (p.325) Jacques Toubon, alors ministre français de la Justice, déclare à l’hebdomadaire américain US News and World Report que « l’usage dominant de la langue anglaise sur l’internet est une nouvelle forme de colonialisme ». Bien entendu, la cécité technologique d’une France crispée sur son Minitel national n’a joué aucun rôle dans cette triste situation. En 1997, nous avions dix fois moins d’ordinateurs reliés à l’internet que les Etats-Unis, deux fois moins que l’Allemagne et arrivions même derrière le Mexique et la Pologne ! Mais la faute en est toujours à l’autre, qui a eu le front de voir plus clair plus tôt que nous et dont la souplesse libérale a permis l’initiative des créateurs privés. En France, la bureaucratisation d’une recherche confite dans le CNRS, la distribution de l’argent public à des chercheurs stériles, mais amis du pouvoir, n’est-ce pas un boulet ? Dans un texte de 1999, intitulé Pour l’exemption culturelle, Jean Cluzel, président du Comité français pour l’audiovisuel, persiste dans la voie protectionniste et peureuse. Il écrit : « Face à l’irruption fracassante des nouvelles technologies de la communication, au service de la culture dominante américaine, la souveraineté culturelle française est fortement menacée. » Irruption fracassante ? Pour quelles raisons ? Est-elle tombée du ciel ? Le remède ? Etudier les causes de cette irruption ? Que non pas ! Il faut instaurer des quotas, subventionner nos films et feuilletons télévisés, revendiquer l’universelle francophonie, tout en laissant la langue française se dégrader dans nos écoles et sur nos ondes. Toute interprétation délirante par laquelle le moi blessé impute ses propres échecs à autrui est intrinsèquement contradictoire. Celle-là ne manque pas à la règle. En effet, les Français haïssent les Etats-Unis, mais, si quelqu’un proteste contre les américanismes inutiles qui envahissent le parler des médias de masse, on traite aussitôt le récriminateur de vieux ringard, de puriste étriqué et de pion ridiculement accroché au passé. Nous réussissons ce tour de force de conjuguer l’impérialisme francophonique et le hara-kiri langagier. Nous voulons imposer (p.324) au monde une langue que nous parlons nous-mêmes de plus en plus mal, et que nous méprisons donc, délibérément. La contradiction règne avec le même brio au cœur de l’antiaméricanisme de la gauche. Mais le sien est idéologique plus que nationaliste. Dans les cas aigus, il est souvent les deux à la fois. Lorsque Noël Manière, député vert, et Olivier Warin, journaliste télévisuel pour Arte, intitulent un livre commun Non, merci, Oncle Sam1, cela ne peut signifier qu’une chose, à la lumière de l’histoire et non de l’illusion : ces deux auteurs auraient préféré voir l’Europe hitlérienne ou stalinienne plutôt qu’influencée par les États-Unis. Cependant l’Amérique est exécrée à gauche surtout parce qu’elle est le repaire du libéralisme. Or, le libéralisme, quand on gratte un peu, cela continue pour les socialistes à être le fascisme. L’ul-tragauche procède ouvertement à cette assimilation. Et il ne faut pas pousser très loin un interlocuteur de la gauche « modérée » pour qu’il y vienne aussi, trahissant le fond de sa pensée. Combien de fois, dans les pages qui précèdent, n’avons-nous pas rencontré, chez les orateurs qui ne donnaient par ailleurs aucun signe d’aliénation, l’expression « libéralisme totalitaire » et autres équivalents ? L’inférence naturelle de ce verdict devrait donc être de préconiser la restauration de la société communiste, le retour aux racines du socialisme, l’abolition de la liberté d’entreprendre et de la liberté des échanges. Et c’est là qu’est la contradiction. Car, vu le bilan du communisme, et même celui du social-étatisme à la française des années quatre-vingt, aujourd’hui trop bien connus, la gauche recule devant cette conclusion, encore qu’une proportion substantielle de ses prédicateurs les plus ardents la couvent du regard. Mais, comme un tel programme ne peut donner lieu désormais à aucune politique concrètement menée par un gouvernement responsable quel qu’il soit, ce sont surtout les intellectuels de gauche qui, fidèles à leur mission historique, n’ont pas manqué cette occasion trop belle de s’en faire les hérauts.
1. Ramsay, 1999.
(p.327) Ainsi Günter Grass, dans un roman paru en 1995, Ein mettes Feld (« Une longue histoire ») chante rétrospectivement les charmes berceurs de la République démocratique d’Allemagne, réservant toute sa sévérité à l’Allemagne de l’Ouest. La réunification allemande ne fut rien d’autre à ses yeux qu’une « colonisation » (nous avons déjà rencontré ce terme dans ce contexte) de l’Est par l’Ouest et donc une invasion de l’Est par le « capitalisme impérialiste ». Il aurait fallu faire l’inverse, dit-il, se servir de la RDA comme du soleil à partir duquel le socialisme aurait rayonné sur l’ensemble de l’Allemagne. Façon de parachever la beauté de la démonstration, le héros du roman de Grass est un personnage que vous et moi considérerions naïvement comme infect et nauséabond, puisqu’il a passé sa vie à espionner ses concitoyens et à les moucharder, en servant d’abord la Gestapo, ensuite la Stasi. Mais Grass le juge, quant à lui, tout à fait respectable, dans la mesure où cet homme a toujours servi un État antilibéral et s’est inspiré des antiques vertus de l’esprit prussien ! Tels sont la sûreté de vues historiques et les critères de moralité du prix Nobel de littérature 1999 ‘. Ils sont logiques dans la perspective d’une « résistance » à l’influence américaine, puisque les deux seules productions politiques originales de l’Europe au vingtième siècle, les seules qui ne doivent rien à la pensée « anglo-saxonne » sont le nazisme et le communisme. Restons donc fidèles aux traditions du terroir !
1. Voir le compte rendu plus détaillé de ce roman par Rosé-Marie Mercillon, < La nostalgie de Gunter Grass », Commentaire, n » 72, hiver 1995-1996.
(p.329) LA HAINE DU PROGRES
L’opération qui absorbe le plus l’énergie de la gauche internationale, en cette fin du vingtième siècle, et pour probablement plusieurs années encore au début du siècle suivant, a ainsi pour but d’empêcher que soit traitée ou même posée la question de sa participation active ou de son adhésion passive, selon les cas, au totalitarisme communiste. Tout en feignant de répudier le socialisme totalitaire, ce qu’elle ne fait qu’à contrecœur et du bout des lèvres, la gauche refuse d’examiner, sur le fond, la validité du socialisme en tant que tel, de tout socialisme, de peur d’avoir à découvrir ou, plutôt, à reconnaître explicitement que son essence même est totalitaire. Les partis socialistes, dans les régimes de liberté, sont démocratiques dans la proportion même où ils sont moins socialistes.
(p.330) Le bruit assourdissant et quotidien de l’orchestration du « devoir de mémoire » à l’égard de ce passé déjà lointain semble en partie destiné à épauler le droit à l’amnésie et à l’autoamnistie des partisans du premier totalitarisme, lequel a sévi plus tôt, plus longuement, beaucoup plus tard et sévit encore par endroits sur de vastes étendues géographiques et un peu partout dans bien des esprits. Ces partisans couvrent ainsi la voix de ceux qui voudraient l’évoquer et ils expliquent au besoin cette honteuse insistance à parler du communisme par une sournoise complicité rétrospective avec le nazisme.
(p.331) Le communisme est, pour la gauche, comme un membre fantôme, un bras ou une jambe disparus, mais que l’amputé continue à sentir comme s’il était encore présent. Et si l’on a vu disparaître le communisme en tant qu’idéologie globale, façonnant tous les aspects de la vie humaine dans les pays où il était implanté et destinée à régir un jour la totalité de la planète, cela ne signifie pas qu’il ait cessé de contrôler des pans entiers de nos sociétés et de nos cultures. C’est ce que Roland Hureaux, dans Les Hauteurs béantes de l’Europe2, appelle « l’idéologie en pièces détachées ». L’idéologie n’est pas nécessairement un bloc, observe-t-il. « Des phénomènes de nature idéologique peuvent être à l’œuvre dans tel ou tel secteur de la vie politique, administrative ou sociale sans que l’on soit pour autant dans une société totalitaire. » Un bon échantillon de ces idéologies en pièces détachées est fourni par le courant d’émotions négatives suscité par la mondialisation des échanges. La guérilla urbaine qui se déchaîna en novembre-décembre 1999 à Seattle contre l’Organisation mondiale du commerce, plus enragée encore que celle de Genève en 1998, incarne bien la survivance de la folie totalitaire. On n’ose même plus dire, devant une telle dégradation, « idéologie » totalitaire. L’idéologie, en effet, préserve au moins les apparences de la
1. Éditions F X. de Guibert, 1999.
(p.332) rationalité. A Seattle, le spectacle était donné par des primitifs de la pseudo-révolution. Ils braillaient des protestations et revendications d’une part hors de propos, sans rapport avec l’objet réel de la réunion ministérielle de l’OMC, d’autre part hétéroclites et incompatibles entre elles. Hors de propos parce que l’OMC, loin de prôner la liberté sans frein ni contrôle du commerce international, a été créée en vue de l’organiser, de le réglementer, de le soumettre à un code qui respecte le fonctionnement du marché tout en l’encadrant de règles de droit. Les manifestants s’en prenaient donc à un adversaire imaginaire : la mondialisation « sauvage ». Elle se révéla l’être bien moins qu’eux-mêmes et à vrai dire l’être si peu que ce fut le protectionnisme, gavé de subventions, auquel s’accrochèrent certains grands partenaires de la négociation, qui provoqua au contraire l’échec de la conférence. Un autre reproche gauchiste, celui fait aux pays riches de vouloir imposer le libre-échange, en particulier la libre circulation des capitaux, aux pays moins développés pour exploiter la main-d’œuvre locale, ses bas salaires et l’insuffisance de sa protection sociale, se révéla être un autre de ces fruits de la pensée communiste qui survivent sous forme de paranoïa. En effet, ce furent les pays en voie de développement qui, à Seattle, refusèrent de s’engager à adopter des mesures sociales, le salaire minimal garanti ou l’interdiction du travail des enfants. Ils arguèrent que les riches voulaient, en leur imposant ces mesures, réduire leur compétitivité, due à leur faibles coûts de production, prometteurs d’un décollage économique et donc d’une élévation ultérieure de leur niveau de vie. Contrairement aux préjugés des gauchistes, c’étaient les pays les moins développés, en l’occurrence, qui réclamaient le libéralisme « sauvage » et les pays capitalistes avancés qui, grevés d’un coût élevé du travail, demandaient une harmonisation sociale parce qu’ils redoutent la concurrence des pays moins avancés. C’est aux moins riches que la liberté du commerce profite le plus, parce que ce sont eux qui ont, dans certains secteurs importants, les produits les plus (p.333) compétitifs. Et ce sont les plus riches, avec leurs prix de revient élevés, qui, dans ces mêmes secteurs, craignent le plus la mondialisation. Au vu des divisions qui, à propos de la mondialisation commerciale, opposent aussi bien les pays riches entre eux que l’ensemble des pays riches à l’ensemble des pays moins avancés, on constate que l’idée fixe selon laquelle régnerait partout une « pensée unique » libérale n’existe que dans l’imagination de ceux qui en sont hantés. De même, au rebours des slogans écologistes, fort bruyants eux aussi chez les casseurs de Seattle, ce ne sont pas les multinationales, issues des grandes puissances industrielles, qui rechignent le plus à la protection de l’environnement, ce sont les pays les moins développés. Ils font valoir qu’au cours d’une première phase au moins leur industrialisation, pour prendre son essor, doit, comme le fit jadis celle des riches actuels, laisser provisoirement au second plan les préoccupations relatives à l’environnement. Argument également formulé par les pêcheurs de crevettes d’Inde ou d’Indonésie, auxquels les écolos de Seattle entendaient faire interdire l’emploi de certains filets capturant aussi les tortues, espèce menacée. Quel spectacle comique, ces braillards bien nourris des grandes universités américaines s’efforçant de priver de leur gagne-pain les travailleurs de la mer peinant aux antipodes ! Pourquoi nos écolos ne s’en prennent-ils pas plutôt à la pêche européenne, à la sauvagerie protégée avec laquelle, persistant à employer des filets aux mailles étroites qui tuent les poissons non encore adultes, elle extermine les réserves de nos mers ? Il est vrai qu’aller affronter les marins pêcheurs de Lorient ou de La Corogne ne va pas sans risques. Et charrier des pancartes vengeresses contre la liberté du commerce, dans une ville comme Seattle, où quatre salariés sur cinq, à cause de Microsoft ou de Boeing, travaillent pour l’exportation, ne va pas sans ridicule. Autre détail amusant : les mêmes énergumènes qui manifestent par la violence leur hostilité à la liberté du commerce militent, avec une égale ardeur, en faveur de la levée de l’embargo (p.334) qui frappe le commerce entre les États-Unis et Cuba. Pourquoi le libre-échange, incarnation diabolique du capitalisme mondial, devient-il soudain un bienfait quand il s’agit de le faire jouer au profit de Cuba ou de l’Irak de Saddam Hussein ? Bizarre ! Si la liberté du commerce international est à leur yeux un tel fléau, ne conviendrait-il pas de faire l’inverse et d’étendre l’embargo à tous les pays ? On ne saurait expliquer ce tissu de contradictions affichées collectivement par des gens qui, pris chacun isolément, sont sans doute d’une intelligence tout à fait normale, sans l’envoûtement par le spectre regretté du communisme, qui a conditionné et conditionnera encore longtemps certains sentiments et comportements politiques. Selon ces résidus communistes, le capitalisme demeure le mal absolu et le seul moyen de le combattre est la révolution — même si le socialisme est mort et si la « révolution » ne consiste plus guère qu’à briser des vitrines, éventuellement en pillant un peu ce qu’il y a derrière. Ce simplisme confortable dispense de tout effort intellectuel. L’idéologie, c’est ce qui pense à votre place. Supprimez-la, vous en êtes réduit à étudier la complexité de l’économie libre et de la démocratie, ces deux ennemis jurés de la « révolution ». L’ennui est que ces bribes idéologiques et les mimes révolutionnaires qu’elles inspirent servent de paravent à la défense d’intérêts corporatistes bien précis. Derrière la cohue des braillards incohérents s’engouffraient à Seattle les vieux groupes de pression protectionnistes des syndicats agricoles et industriels des pays riches qui, eux, savaient fort bien ce qu’ils voulaient : le maintien de leurs subventions, de leurs privilèges, des aides à l’exportation, sous le prétexte en apparence généreux de lutter contre « le marché générateur d’inégalités ». Les cris de joie de la révolte « citoyenne! », proclamée telle
1. Ce terme est, depuis quelques années, employé adjectivement dans le sens de l’adjectif « civique », qui existait déjà et n’avait pas besoin d’un doublet incorrect. Civique : « propre au bon citoyen » (Grand Robert, 1985) ; « qui concerne les citoyens, qui appartient à un bon citoyen » (Littré) ; « qui concerne le citoyen comme membre de la cité » (Académie française).
par elle-même, des ONG, de l’ultragauche anticapitaliste, des écologistes, de tous les troupeaux hostiles au libre-échange, qui se sont attribué la gloire du fiasco de la conférence de Seattle, ce triomphe bruyant est un véritable festival d’incohérences. Répétons-le, ce qui a provoqué l’échec de Seattle n’est pas du tout l’« ultralibéralisme » supposé de l’Union européenne et des États-Unis, mais au contraire leur protectionnisme excessif, notamment dans le domaine de l’agriculture, protectionnisme générateur de ressentiments dans les pays émergents, en développement ou dits « du groupe de Cairns », qui sont ou voudraient être gros exportateurs de produits agricoles. Le vainqueur, à Seattle, ce fut le protectionnisme des riches, n’en déplaise aux obsédés qui stigmatisent leur libéralisme. Là où les pays en voie de développement ont marqué un point, c’est en refusant les clauses sociales et écologiques que l’OMC souhaitait leur faire accepter. En les soutenant, la gauche applaudit par conséquent le travail des enfants, les salaires de misère, la pollution, l’esclavage dans les camps de travail chinois, vietnamiens ou cubains. Rarement la nature intrinsèquement contradictoire de l’idéologie se sera manifestée avec une aussi béate fatuité. Nous saisissons là sur le vif une autre propriété de la pensée idéologique, outre son ignorance délibérée des faits et son culte des incohérences : sa capacité à engendrer, sous des mots d’ordre progressistes, le contraire de ses buts affichés. Elle prétend et croit travailler à la construction d’un monde égalitaire et elle fabrique de l’inégalité. Une autre de ces inversions de sens entre les intentions et les résultats a été accomplie par la politique française de l’Éducation depuis trente ans. Elle aussi est un bon exemple d’une idéologie totalitaire s’appropriant un secteur de la vie nationale au sein d’une société par ailleurs libre. Le 20 septembre 1997, je publie dans Le Point un modeste éditorial intitulé «Le naufrage de l’École»1. Modeste parce
1.Repris dans mon recueil Fin du siècle des ombres, op. cit., p. 589.
(p.336) que je n’y développais, je l’avoue, rien de bien original, tant fusaient depuis des années de toutes parts les lamentations sur la baisse constante du niveau des élèves, sur les progrès de l’illettrisme, de la violence et de ce que l’on appelle par pudeur l’« échec scolaire », apparemment une sorte de catastrophe naturelle ne dépendant en aucune façon des méthodes suivies ou imposées par les responsables de notre enseignement public. Dès le lendemain, je reçois une lettre à en-tête du ministère de l’Education nationale, signée d’un nommé Claude Thélot, « directeur de l’évaluation et de la prospective ». Tout en me servant ironiquement du « Monsieur l’Académicien » et du « Cher Maître », cet important personnage daignait me notifier que mon éditorial était d’une rare indigence intellectuelle et, pour tout dire, « navrant ». Obligeant, le magnanime directeur se tenait à ma disposition pour me fournir sur l’école les lumières élémentaires dont j’étais visiblement dépourvu. Or voilà que, dès la semaine suivante, la presse rend public un rapport de cette même Direction de l’évaluation et de la prospective. Il en ressort, entre autres atrocités, que 35 % des élèves entrant en sixième ne comprennent pas réellement ce qu’ils lisent et que 9 % ne savent même pas déchiffrer les lettres’. Au vu de cet accablant constat, largement diffusé, je me posai aussitôt la question de savoir si par hasard il était tombé sous les yeux de M. Claude Thélot. Celui-ci ne serait-il pas ce qu’on appelle en anglais un self confessed idiot, un sot qui se proclame lui-même être tel, puisque la Direction de l’évaluation, au sommet de laquelle il trône, corroborait mon article ? Ou alors un paresseux qui n’avait même pas pris la peine de lire les études réalisées par ses propres services ? J’écartai ces deux hypothèses pour me rallier en fin de compte à l’explication
1. Voir dans Le Point du 27 septembre 1997 l’article où Luc Ferry, lui-même président du Conseil national des programmes, expose, analyse et commente longuement ce rapport. Voir aussi, dans le même numéro, l’éditorial de Claude Imbert sur le sujet.
(p.337) que l’arrogant aveuglement de M. Thélot était dû à la toute-puissance de l’idéologie, qui s’était emparée de son cerveau et de toute sa pensée. De même qu’un apparatchik était jadis incapable fût-ce d’envisager que l’improductivité de l’agriculture soviétique pût provenir du système même de la collectivisation, ainsi les bureaucrates du ministère de l’Education nationale ne peuvent pas concevoir que l’écroulement de l’école puisse être dû au traitement idéologique qu’ils lui infligent depuis trente ans. Pour un idéologue, obtenir durant des décennies le résultat contraire à celui qu’il recherchait au départ ne prouve jamais que ses principes soient faux ou sa méthode mauvaise. Nous saisissons-la sur le vif ce phénomène fréquent d’un « segment totalitaire » au sein d’une société par ailleurs démocratique1. De nombreux tronçons idéologiques, aujourd’hui surtout de filiation communiste, continuent ainsi de flotter ça et là de par le monde, alors même que disparaît le communisme comme entité politique et comme projet global. Comment et pourquoi ont pu apparaître, comment et pourquoi peuvent se perpétuer, en quelque sorte à titre posthume, ces trois caractéristiques souvent évoquées dans ces pages, des idéologies totalitaires et plus particulièrement de l’idéologie communiste : l’ignorance volontaire des faits ; la capacité à vivre dans la contradiction par rapport à ses propres principes ; le refus d’analyser les causes des échecs ? On ne peut entrevoir de réponse à ces question si l’on exclut une réponse paradoxale : la haine socialiste pour le progrès2.
1. Voir Liliane Lurçat, La Destruction de l’enseignement élémentaire. Éditions F.-X. de Guibert, 1998. À l’occasion du Salon de l’Éducation, organisé par le ministère gour la première fois en novembre 1999 (il est plus facile d’organiser un Salon de l’Education que l’éducation), Mme Ségolène Royal, ministre chargée de l’Enseignement scolaire, « déclare la guerre à l’illettrisme » (journal du dimanche, 28 novembre 1999). Si elle lui déclare la guerre, c’est donc qu’il existe, n’en déplaise à M. Thélot. Pis : grâce à une enquête de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, rendue publique fin novembre 1999, nous apprenions qu’une proportion croissante des élèves admis en sixième non seulement ne savent pas lire mais ne sont même plus capables de parler ! 2. Sur les rapports ambigus de la gauche avec l’idée et la réalité du progrès au cours des deux siècles écoulés, Jacques Julliard a en préparation un ouvrage à paraître chez Gallimard. Je me borne ici à quelques notations.
(p.338) Nous avons vu au chapitre treizième comment les théoriciens du Parti communiste et ceux de l’ultragauche marxiste condamnent en bloc tous les moyens modernes de communication comme étant des « marchandises » fabriquées par des « industries culturelles ». Ces prétendus progrès n’auraient pour but selon eux que le profit capitaliste et l’asservissement des foules. L’édition, la télévision, la radio, le journalisme, l’internet, pourquoi pas l’imprimerie ? n’auraient ainsi jamais été des instruments de diffusion du savoir et des moyens de libération des esprits. Ils n’auraient au contraire servi qu’à tromper et à embrigader. Ce qu’il faut se rappeler, c’est que cette excommunication de la modernité, du progrès scientifique et technologique et de l’élargissement du libre choix culturel plonge ses racines dans les origines de la gauche contemporaine et, de façon éclatante, dans l’œuvre de l’un de ses principaux pères fondateurs : Jean-Jacques Rousseau. Nul ne l’a mieux vu et mieux dit que Bertrand de Jouvenel dans son Essai sur la politique de Rousseau1, sinon, bien longtemps avant lui, mais cursivement, Benjamin Constant dans De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Le texte qui a rendu Rousseau instantanément célèbre est, chacun le sait mais rares sont ceux qui en tirent les conclusions appropriées, un manifeste virulent contre le progrès scientifique et technique, facteur, selon lui, de régression dans la mesure où il nous éloigne de l’état de nature. Ce texte va donc à l’encontre de toute la philosophie des Lumières, selon laquelle l’avancement de la connaissance rationnelle, de la science et de ses applications pratiques favorise l’amélioration des conditions de vie des humains. L’hostilité que les philosophes du dix-huitième siècle, notamment Voltaire, vouèrent rapidement à Rousseau ne découle pas seulement d’animosités personnelles, comme on le répète sans trop d’examen : elle a pour cause une profonde divergence
1. 1947. Repris en Introduction de l’édition du Contrat social dans la collection Pluriel, 1978.
(p.339) doctrinale. Au rebours du courant majeur de son temps, Rousseau considère la civilisation comme nocive et dégradante pour l’homme. Il vante sans cesse les petites communautés rurales, il prône le retour au mode de vie ancestral, celui de paysans éparpillés dans la campagne en hameaux de deux ou trois familles. L’objet de son exécration, c’est la ville. Après le tremblement de terre de Lisbonne, il clame hautement que ce séisme n’aurait pas fait autant de victimes… s’il n’y avait pas eu d’habitants à Lisbonne, c’est-à-dire si Lisbonne n’avait jamais été bâtie. L’ennemi, à tous points de vue, c’est la cité. Elle est corruptrice et, de plus, expose les humains à des catastrophes qui ne les frapperaient pas s’ils continuaient à vivre dans des cavernes ou des huttes. Ainsi, l’humanité se porterait beaucoup mieux, culturellement et physiquement, si elle n’avait jamais construit ni Athènes, ni Rome, ni Alexandrie, ni Ispahan, ni Fez, ni Londres, ni Séville, ni Paris, ni Vienne, ni Florence, ni Venise, ni New York, ni Saint-Pétersbourg. Une fois de plus, les visions passéistes et le protectionnisme champêtre d’une certaine gauche, celle d’où est issu le totalitarisme, coïncident avec les thèmes de l’extrême droite traditionaliste, adepte du « retour aux sources ». Cette convergence se retrouve jusque dans les débats les plus brûlants de la dernière année du vingtième siècle : certains réquisitoires contre l’« ultralibéralisme » et la « mondialisation impérialiste » étaient à ce point identiques sous des plumes communistes ou ultragauchistes et sous des plumes « souverainistes » de droite qu’on aurait pu intervertir les signatures sans trahir le moins du monde la pensée des auteursl. Dans sa logique hostile à la civilisation, tenue pour corruptrice, Rousseau est l’inventeur du totalitarisme culturel. La
1. C’est le cas de deux articles parus le même jour, 8 décembre 1999 : l’un dans Le Monde, de Charles Pasqua, président du Rassemblement pour la France (droite gaulliste) et intitulé « La mondialisation n’est pas inéluctable » ; l’autre d’Alain Krivine et Pierre Rousset, tous deux membres de la Ligue communiste révolutionnaire, intitulé « Encore un effort, camarades ! » et publié dans Libération. Ces deux « Libres opinions » sont exquisément interchangeables.
(p.340) Lettre à d’Alembert sur les spectacles préfigure le jdanovisme « réaliste-socialiste » du temps de Staline et les œuvres « révolutionnaires » de l’Opéra de Pékin du temps où c’était Mme Mao Tsé-toung qui le dirigeait. Pour Rousseau, comme pour les autorités ecclésiastiques les plus sévères des dix-septième et dix-huitième siècles, le théâtre est source de dégradation des mœurs. Il incite au vice en dépeignant les passions et pousse à l’indiscipline en stimulant la controverse. Les seules représentations qui soient à son goût sont celles de pièces de patronage, de ces saynètes édifiantes que l’on improvise quelquefois dans les cantons suisses, les soirs de vendanges. Si Jean-Jacques s’était appliqué à lui-même l’esthétique de Rousseau, il se serait interdit d’écrire les Confessions et aurait ainsi privé la littérature française d’un chef-d’œuvre. Quant aux institutions politiques, Le Contrat social garantit la démocratie exactement de la même manière que la constitution stalinienne de 1937 en Union soviétique. Partant du principe que l’autorité de leur État émane de la «volonté générale » du « peuple tout entier », nos deux juristes stipulent que plus aucune manifestation de liberté individuelle ne doit être tolérée postérieurement à l’acte constitutionnel fondateur. C’est dans Le Contrat social que s’exprime, avant la lettre, la théorie du «centralisme démocratique» ou de la « dictature du prolétariat » (dans un autre vocabulaire, bien sûr). Du reste, il est un symptôme qui ne trompe pas : Rousseau exalte toujours Sparte au détriment d’Athènes. Au dix-huitième siècle et jusqu’à Maurice Barrés, c’était presque un code, un signe de ralliement des adversaires du pluralisme et de la liberté. Benjamin Constant relève bien ce penchant pour le permanent camp de rééducation Spartiate, cher à la fois au redoutable abbé de Mably, l’un des plus inflexibles précurseurs de la pensée totalitaire, et au bien intentionné Jean Jacques : « Sparte, qui réunissait des formes républicaines au même asservissement des individus, excitait dans l’esprit de ce philosophe un enthousiasme plus vif encore. Ce vaste couvent lui paraissait l’idéal d’une parfaite république. Il avait (p.341) pour Athènes un profond mépris, et il aurait dit volontiers de cette nation, la première de la Grèce, ce qu’un académicien grand seigneur disait de l’Académie française : « Quel épouvantable despotisme ! Tout le monde y fait ce qu’il veut. » » Comme le note avec ironie Bertrand de Jouvenel, Rousseau a été loué depuis deux siècles en tant que précurseur d’idées en complète opposition avec celles qui avaient été vraiment les siennes. Il préférait « les champs plutôt que la ville, l’agriculture plutôt que le commerce, la simplicité plutôt que le luxe, la stabilité des mœurs plutôt que les nouveautés, l’égalité des citoyens dans une économie simple plutôt que leur inégalité dans une économie complexe et… par-dessus tout, le traditionalisme plutôt que le progrès ». Mais en ce sens, s’il ne fut pas, contrairement à la légende, un fondateur intellectuel de la démocratie libérale, il le fut bel et bien de la gauche totalitaire. À l’instar de Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Engels, dans sa célèbre Situation des classes laborieuses en Angleterre, publiée en 1845, dépeint l’industrialisation et l’urbanisation avant tout comme des facteurs de destruction des valeurs morales traditionnelles, notamment familiales. Dans les nouvelles cités industrielles, les femmes sont, dit-il, amenées à travailler hors du foyer. Elle ne peuvent donc remplir le rôle qui leur a été dévolu par la nature : « veiller sur les enfants, faire le ménage et préparer les repas ». Pis : si le mari est au chômage, c’est à lui qu’incombé cette tâche. Horreur ! « Dans la seule ville de Manchester, des centaines d’hommes sont ainsi condamnés à des travaux ménagers. On comprend aisément l’indignation justifiée d’ouvriers transformés en eunuques. Les relations familiales sont inversées1. » Le mari est privé de sa virilité, cependant que l’épouse, livrée à elle-même dans la grande ville, s’expose à toutes les tentations. Il n’échappera pas au lecteur que nous n’avons pas précisément affaire là, dans le sermon du révérend Engels, à un programme annonciateur de la libération de la femme.
1. Chapitre septième.
(p.342) Les sociétés créées par le « socialisme réel » furent de fait les plus archaïques que l’humanité ait connues depuis des millénaires. Ce « retour à Sparte » caractérise d’ailleurs toutes les utopies. Les sociétés socialistes sont oligarchiques. La minorité dirigeante y assigne à chaque individu sa place dans le système productif et son lieu de résidence, puisqu’il y est interdit de voyager librement, même dans le pays, sans une autorisation, matérialisée par le « passeport intérieur ». La doctrine officielle doit pénétrer dans chaque esprit et constituer sa seule nourriture intellectuelle. L’art même n’existe qu’à des fins édifiantes et doit se borner à exalter avec la plus hilarante niaiserie une société nageant dans le bonheur socialiste et à refléter l’extase de la reconnaissance admirative du peuple envers le tyran suprême. La population est, bien entendu, coupée de tout contact avec l’étranger, qu’il s’agisse d’information ou de culture, isolement qui réalise le rêve de protectionnisme culturel cher à certains intellectuels et artistes français depuis qu’ils se sentent menacés par le « danger » de la mondialisation culturelle. Ils dénoncent en celle-ci un risque d’uniformisation de la culture. Comme si l’uniformité culturelle n’était pas, au contraire, de façon éclatante la marque des sociétés closes, au sens où Karl Popper et Henri Bergson ont employé cet adjectif ! Et comme si la diversité n’était pas, tout au long de l’histoire, le fruit naturel de la multiplication des échanges culturels ! C’est dans les sociétés du socialisme réel que des camps de rééducation ont pour fonction de remettre dans le droit chemin de la « pensée unique » tous les citoyens qui osent cultiver une quelconque différence. Cette même rééducation a en outre l’avantage de fournir une main-d’œuvre d’un coût négligeable. Encore en l’an 2000, plus d’un tiers de la main-d’œuvre chinoise est constituée d’esclaves. Point d’étonnement à ce que les produits qu’ils fabriquent ainsi presque gratuitement parviennent sur les marchés internationaux à des prix « imbattables ». Et qu’on ne vienne pas dire qu’il s’agit-là d’un méfait du libéralisme : le libéralisme suppose la démocratie, avec les lois sociales qui en découlent.
(p.343) Il paraît incroyable qu’il puisse y avoir encore aujourd’hui des gens assez nombreux qu’habité la nostalgie de ce type de société, soit en totalité, soit en « pièces détachées ». Et pourtant c’est un fait. La longue tradition, échelonnée sur deux millénaires et demi, des œuvres des utopistes, étonnamment semblables, jusque dans les moindres détails, dans leurs prescriptions en vue de construire la Cité idéale, atteste une vérité : la tentation totalitaire, sous le masque du démon du Bien, est une constante de l’esprit humain. Elle y a toujours été et y sera toujours en conflit avec l’aspiration à la liberté.
|
|
SOLIDAIRE – feuillet publicitaire pour cette revue du PTB – 1999
SOLIDAIRE soutient Cuba, la Corée du Nord et la Chine dans leur lutte pour la sauvegarde du socialisme.
|
|
Jean Vogel, Vous avez dit stalinien?, in: Journal du mardi, 09/05/2000
Le président du PTB, Ludo Martens, flirte parfois avec l’antisémitisme. Il qualifie de “falsification de l’histoire” l’idée que le génocide juif a été le “crime principal” des nazis et il cherche de façon perverse à en atténuer la portée: “(…) La grande masse des juifs pauvres a été gazée. Mais beaucoup de juifs riches ont réussi à se sauver aux Etats-Unis. Après la guerre, ils se sont mis au service de l’impérialisme américain et d’Israël.” “En novembre 1997, le PTB a signé une déclaration à Saint-Pétersbourg qui accuse le “sionisme international” d’être coresponsable de l’effondrement de l’URSS. Comme chacun sait, c’est le terme codé utilisé par les antisémites russes pour désigner les Juifs.”
|
|
Berlusconi provoque un incident avec la Chine, LB 29/03/2006
Des propos musclés sur le communisme suscitent l’indignation de Pékin. La campagne électorale en Italie a provoqué mardi tin ‘incident diplomatique avec la Chine, irritée par les propos du chef du gouvernement Silvio Berlusconi sur les enfants « bouillis par le régime communiste pour servir d’engrais dans les champs ». « La Chine est indignée par les propos infondés du chef du gouvernement Berlusconi », a protesté l’ambassade de Chine à Rome dans une déclaration officielle. « Les propos et les comportements des dirigeants italiens devraient plutôt favoriser la stabilité et le développement de relations amicales entre la Chine et l’Italie », a ajouté le communiqué.
• Romano Prodi indigné
La protestation des autorités chinoises a été aussitôt exploitée par le chef de l’opposition italienne, Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne. « Vous rendez-vous compte de l’image donnée à notre pays avec de tels propos tenus par le chef du gouvernement ? C’est une offense faite à un peuple de 1,3 milliard de personnes. Nous sommes discrédités à l’étranger », a-t-il lancé à la foule venue assister à une réunion électorale à Formia, près de Latina, dans le sud de l’Italie. Dimanche, Silvio Berlusconi, candidat les 9 et 10 avril à sa propre succession lors des élections législatives, a affirmé que le régime communiste chinois faisait bouillir les enfants. « On m’accuse d’avoir dit que les communistes mangeaient les enfants, a-t-il lancé dans une réunion électorale, mais lisez « Le livre noir du communisme », et vous découvrirez que dans la Chine de Mao, ils ne mangeaient pas les enfants, mais ils les faisaient bouillir pour servir d’engrais dans les champs ». (AFP)
|
|
Irène de Pahlen / Wezembeek-Oppem/, Lénine honoré par La Poste, VA 28/12/1999
La Belgique a émis un timbre à l’effigie de Lénine, cet homme qui est à la source de la tragédie des Etats totalitaires, la principale honte du 20e siècle.
L.H., Lénine est-il digne d’un timbre-poste?, LB 03/12/1999
Polémique autour de l’ “hommage” fait à l’ égard de Lénine, figurant sur une timbre-poste dans une série consacrée au Xxe siècle. Le timbre est finalement quand même sorti en décembre 1999.
|
|
Les nouveaux amis de Lamberto Dini / ministre italien/, LB 30/03/2000
L’ouverture des monts Kumgang aux visiteurs étrangers aurait permis à la Corée du Nord de financer la fabrication de missiles balistiques.
|
|
Ludo Martens, figure de proue des marxistes-léninistes belges, le président du PTB persiste. (P.V., LB 05/03/2003)
|
|
Ludo Martens, Un autre regard sur Staline, EPO éd., s.d.
|
|
Roland Planchar, Pierre Carette rejoint ses amis libres, LB 26/02/2003
Bertrand Sassoye, numéro des CCC (Cellules Combattantes Communistes) , arborant le drapeau rouge, avec les emblèmes des vieilles républiques socialistes soviétiques : « Quant aux républiques, c’est dommage pour leurs habitants. Est-ce que cela va mieux maintenant ? Du temps des communistes, ils avaient une espérance de vie supérieure de 10 ans à ce qu’ils connaissent maintenant ! »
|
|
Plus de rue Staline!, in : LSM 21/08/2008
Je ne puis comprendre ni admettre que depuis des années, une rue d’Eugies (Frameries) porte le nom d’un criminel célèbre : Joseph Staline. Comble de l’ironie, cette rue débouche dans la rue des Déportés, alors que ce chef d’Etat, outre ses célèbres grandes purges et exécutions massives, est responsable de plus de 600000 déportations dans des goulags, dont celle de l’écrivain Alexandre Soljénitsyne, qui vient de décéder. C’est une véritable insulte à la mémoire de toutes les victimes du stalinisme. Alors que depuis l’effondrement du bloc soviétique, plus aucune rue ni aucun édifice ne portent ce nom dans les pays de l’Est, dans le Borinage, c’est encore le cas ! Quand va-t-on mettre fin à cette abomination ?
Bernard Beugnies, conseiller provincial du Hainaut
|
1.2.3 Aftermath
|
Ricardo M. de De Rituerto, El fin del parque temático de Stalin, in : EP 12/05/2007
La guerra de los monumentos es el ûltimo episodio de la lucha de los tres paises bálticos por dotarse de una identidad, iras largas décadas de dominio soviético. La suerte de Letonia de tener un monumento a la Libertad, erigido en 1935 para conmemorar la Guerra de la Independencia con Rusia librada tras la I Guerra Mundial, es la envidia de su vecino del norte, que no da con la formula que simbolice el ser nacional.
|
|
Denkmalstreit zwischen Estland und Russland, FAZ 23/01/2007
Tallinn will Denkmal für Sowjetsoldaten entfernen lassen / Schafe Reaktion Präsident Putins
Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten geschaffen wurde. In Estland wurde schon seit Jahren über eine Entfernung des Kriegerdenkmals debattiert, das von vielen Esten als Symbol der Unterdrückung und der sowjetischen Okkupation nach 1944 empfunden wurde. Die in der sowjetischen Propaganda als ,,Befreiung » bezeichnete Einnahme Estlands durch sowjetische Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs ist aus estnischer Sicht der Beginn einer nahtlos auf die deutsche Besatzung folgenden weiteren Okkupation. Vor allem in den ersten Jahren der sowjetischen Herrschaft wurden Zehntausende Esten nach Sibirien deportiert, von denen viele auf dem Transport oder in den Lagern umkamen. (…) Umfangreichen Untersuchungen von in Estland erreichbaren Unterlagen der Kommunistischen Partei und der Sowjetbehörden ergaben nach estnischer Darstellung aber, dass es unklar ist, ob sich dort überhaupt Soldatengräber befinden. Wahrscheinlich waren 1944 nach den Kämpfen um Tallinn einige Soldaten dort begraben und möglicherweise später umgebettet worden. Die namentlichen Dokumentationen der am Denkmal genannten Soldaten soll aber so widersprüchlich sein, dass der Verdacht aufkam, sie seien später von den Propagandaabteilungen der Sowjetarmee und der Behörden erfunden worden.
|
|
Marcel Linden, Le coeur à gauche, la raison à droite, LB 05/11/1999
40 ans de régime communiste laissent des séquelles chez les jeunes est-allemands, suivant plusieurs experts de l’Ouest qui tentent d’expliquer la montée de la xénophobie en ex-RDA. “L’enseignement dans les écoles communistes a des effets à long terme qui peuvent encore s’exercer dans 20 ou 30 ans.”
|
|
Paul Witteman, Gorbatchev, Regard sur le siècle et l’avenir, in: JDM, 31, 2000, p.29-31
Gorbatchev (p.29): “Je vous énumère à présent tous les slogans de la révolution d’Octobre, essayez seulement de les contrecarrer, maintenant que presque un siècle s’est écoulé: “Toutes les usines aux ouvriers”, “La terre aux paysans’, “La paix à tous les peuples” et “La liberté pour les opprimés”. Essayez un peu de contredire cela. Ils avaient un impact énorme , qui a perduré pendant des décennies.”
|
2 Documents
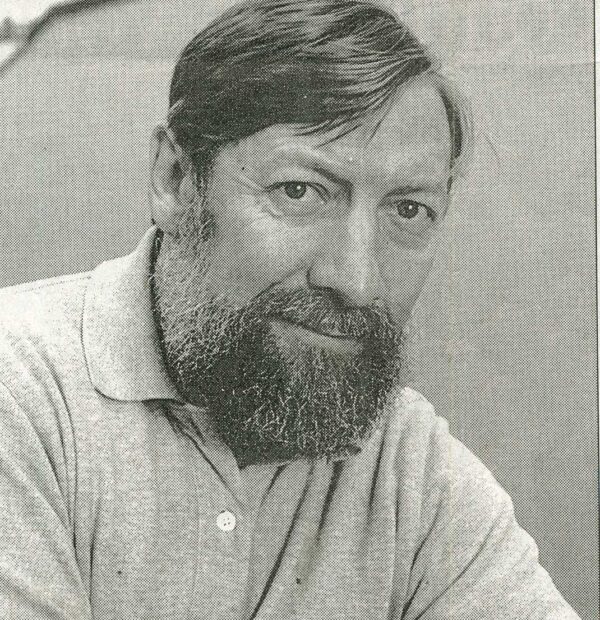
Stéphane Courtois, Le livre noir du communisme / Communisme et totalitarisme
(extraits)
Stéphane Courtois, Communisme et totalitarisme, éd. Perrin, 2009
(p.9) (…) l’existence démontrée du fameux « Clément » – Eugen Fried – qui fut le véritable patron du PCF durant les années 1930, les négociations officieuses entre la direction du PCF et le représentant de Hitler à Paris de juin à août 1940, la responsabilité du NKVD soviétique dans l’assassinat de plus de 4 400 officiers polonais à Katyn, l’organisation par Staline d’une famine-génocide contre la paysannerie ukrainienne faisant environ 4 millions de morts en 1932-1933, l’ampleur de la Grande Terreur stalinienne de 1937-1938 qui entraîna l’assassinat de plus de 700 000 personnes en quatorze mois… La liste est interminable.
(p.9) Comment comprendre la ruse, l’audace et la cruauté de Staline au pouvoir si l’on ignore les relations intimes du jeune Staline bolchevique d’avant 1914 avec le grand banditisme du Caucase, mêlant allègrement (p.10) « expropriations » (hold-up), racket révolutionnaire et règlements de comptes de type mafieux ? Peut-on continuer de présenter Nikita Khrouchtchev comme un quasi démocrate antistalinien, quand on découvre qu’il fut le chouchou de Staline dans les années 1930, le bourreau de Moscou puis de 1’Ukraine lors de la Grande Terreur puis de la Pologne orientale occupée par l’Armée rouge le 17 septembre 1939, l’homme qui demanda par télégramme à Staline l’autorisation de déporter les femmes et les enfants des officiers polonais assassinés, et celui qui réaffirma la dimension totalitaire du régime après 1957 en rétablissant l’omnipotence du parti sur l’appareil d’Etat ? Que comprendre à la Grande Terreur de 1937-1938 si l’on ignore l’itinéraire stupéfiant de celui qui en fut l’exécuteur sous les ordres de Staline, Nicolaï Iejov ? Georges Dimitrov n’est-il que le héros du procès de Leipzig contre Goering et le chantre de l’antifascisme au VIIe congrès du Komintem en 1935, quand son Journal et les archives nous révèlent sa soumission totale à Staline, sa participation aux plus hautes sphères du pouvoir soviétique et son rôle majeur dans la soviétisation particulièrement brutale de la Bulgarie ? Que dire de Jacques Duclos, ce candidat à la présidence de la République française en 1969, dont les relations constantes avec le NKVD/KGB – organisation éminemment criminelle – sont désormais avérées par les archives et qui adressa des rapports circonstanciés sur la négociation avec l’occupant nazi à Paris à l’été 1940 ? Et d’Artur London, devenu à travers son livre et le film éponyme L’Aveu, le héros du communisme antistalinien, mais dont les archives tchèques révèlent le rôle d’agent de la police politique tant durant la Guerre d’Espagne que dans la Tchécoslovaquie des années 1940 ? Et de Maurice Thorez, désertant son régiment début octobre 1939 sur ordre du Komintern pour rejoindre Moscou en avion sous passeport soviétique ? Ou, du même Thorez (p.11) recevant de Staline, au Kremlin le 19 novembre 1944, la directive de se débarrasser au plus vite du général de Gaulle… objectif atteint le 30 janvier 1946 ?
(p.14) (…) à condition de s’appuyer sur une documentation incontestable et copieuse, l’historien ne peut se contenter d’une approche positiviste destinée à contourner l’interrogation sur les valeurs portées par un phénomène historique, voire par toute une époque. Même si cette interrogation dérange profondément – des hommes se réclamant d’un Bien supérieur ont instauré un Mal absolu – et renvoie, une nouvelle fois, à la comparaison avec le nazisme.
(p.25) Pourquoi la guerre est inéluctable sous l’impérialisme
Estimant avoir démontré la nature économique de la crise du capitalisme, Lénine aborde la question politique. Plaquant le poids de la guerre sur sa vision de l’avant-guerre, il écrit : « L’impérialisme est l’époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également ; tel est le résultat de ces tendances. De même se renforcent particulièrement l’oppression nationale et les tendances à l’annexion10. »
On se demande de quelle absence de liberté et de quelle réaction parle Lénine, alors que la période d’avant 1914 a été l’âge d’or de l’avant-gardisme esthétique, de la montée en puissance du suffrage universel et des mouvements socialistes et syndicalistes dans toute l’Europe, à commencer par l’Allemagne et la France. Quant à l’oppression nationale et à l’annexion, l’Europe était encore, avant 1914, travaillée en profondeur par les poussées nationalitaires et 1919 a marqué un formidable mouvement de libération de trois des grands empires : Tchécoslovaquie, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, Yougoslavie, Autriche, Hongrie ; autant de nouveaux Etats créés en Europe. Lénine s’est donc trompé du tout au tout sur la tendance de fond. Ou plutôt, il lui était impossible d’admettre que le capitalisme en expansion entraînait à sa suite un développement des arts, des techniques, du sentiment national, de la démocratie et même du niveau de vie des classes populaires tant urbaines que rurales. Seule la guerre et son spectacle de désolation lui permettent d’affirmer le contraire.
(p.38) Pour Lénine, « la charpente de la société socialiste » doit être formée des « grandes banques [qui] constituent l’“appareil d’Etat” dont nous avons besoin pour réaliser le socialisme et que nous prenons tout prêt au capitalisme. […] Une banque d’Etat, unique, vaste parmi les plus vastes, qui aurait des succursales dans chaque canton, auprès de chaque usine, voilà déjà les neuf dixièmes de l’appareil socialiste. Voilà la comptabilité à l’échelle nationale, le contrôle à l’échelle nationale de la production et de la répartition des produits28. » Pour renforcer son argumentation et prouver qu’il ne s’agit pas d’élucubrations socialistes, Lénine insiste sur le fait que ces nouveaux moyens de contrôle ont été « créés non pas par nous, mais par le capitalisme dans sa phase de guerre impérialiste ». Lénine envisage donc de construire le socialisme en utilisant conjointement les puissants appareils bureaucratiques mis en place par l’Etat et par le capital privé. Il va même jusqu’à annoncer que sous le pouvoir bolchevique cette bureaucratie sera fortement accrue. En 1921, on comptait déjà en URSS cinq fois plus de fonctionnaires civils que dans la Russie de 1917, alors que l’économie produisait huit fois moins de richesses29.
(p.39) Or Lénine au pouvoir va immédiatement sortir la statistique de ce contexte démocratique. Le signe en sera donné dès novembre 1917 quand la grande majorité de la bureaucratie d’Etat russe, qui avait accepté de travailler pour le Gouvernement provisoire, refusera de se mettre au service d’un pouvoir illégitime. Dès 1921, le pouvoir soviétique décida de rejeter les données du service de statistique quand elles ne répondaient pas à sa volonté politique. Ainsi la grande famine de 1921-1923 fut-elle en partie provoquée par la décision politique de majorer fortement les estimations de la récolte proposées par les services compétents et de calculer les réquisitions de blé en conséquence30. Ayant supprimé la bureaucratie des entreprises privées et refusant de se soumettre aux indications de la bureaucratie d’Etat, le régime bolchevique était condamné à pratiquer la terreur et le mensonge officiel.
(p.41) (…) nous savons, en particulier depuis les synthèses du Livre noir du communisme, que l’arme de la faim – au quotidien à travers la nomenclature du rationnement selon la catégorie à laquelle chaque individu est rattaché, mais aussi lors (p.42) des gigantesques famines résultant de réquisitions de céréales – a été l’un des éléments majeurs de définition du totalitarisme d’obédience communiste, et par la suite nazie (par exemple dans les ghettos juifs).
(p.42) Dans l’approche traditionnelle du totalitarisme, cette dimension du contrôle total de l’économie, c’est-à-dire des moyens de subsistance de l’ensemble de la population, est trop sous-estimée, au bénéfice de certaines dimensions du phénomène : la politique (parti unique, idéologie, principe du chef) et le crime (terreur, camps, déportations, etc.). En soulignant le phénomène des famines, Le Livre noir du communisme a fait toucher du doigt à quel point l’arme de la faim avait été un facteur majeur de la puissance totalitaire.
(p.44) (…) l’étatisation des moyens de production aboutirait à la confusion des administrations publiques et privées et allait entraîner une toute-puissance de l’Etat-patron face aux salariés. Il n’y aurait plus le contrepoids des syndicats et des partis ouvriers face à l’autorité désormais dominante de l’Etat. L’histoire lui donna presque immédiatement raison, les bolcheviks n’hésitant pas à bombarder les usines récalcitrantes, à fusiller massivement à Petrograd en 1921 les ouvriers révoltés, ou à proposer, comme Trotski, la création d’« armées du travail ». La liquidation du rôle revendicatif des syndicats – symbolisée en 1936 par le suicide de Tomski, le chef des syndicats soviétiques -, l’instauration en 1939 en URSS du livret ouvrier et la création du Goulag ne seront que des développements logiques confirmant l’analyse de Max Weber.
(p.45) Or, avec la prise du pouvoir, toutes les barrières sont rompues. Le parti qui était le moyen de la révolution devient sa propre fin, avec une seule préoccupation : ne pas perdre ce pouvoir qui fait qu’il est sa propre fin. Arrivera alors ce que Max Weber n’avait pas osé imaginer. En effet, face aux fins rationnelles imposées par la démocratie et le marché, Lénine – et à sa suite Staline et bientôt Hitler – a voulu créer un autre type de domination reposant sur des fins que Weber qualifierait d’« irrationnelles » mais qui, en réalité, relèvent d’un autre type de rationalité commandé par un impératif : conserver à tout prix pour le parti le monopole du pouvoir.
(p.46) Cette fin implique « rationnellement » la nécessité d’interdire – voire d’exterminer par la Terreur – tout groupe ou individu susceptible de contester le monopole du pouvoir, tant dans les domaines politique – principe du parti unique -, que culturel – principe de l’idéologie unique et obligatoire -, qu’économique – principe de la destruction de la propriété privée des moyens de productions, mais aussi souvent de la propriété individuelle réduite au minimum (les habits, la gamelle pour manger).
(p.123) Poussée à son extrémité, la logique de la terreur peut aboutir à des phénomènes stupéfiants. Ainsi, dans la prison roumaine de Pitesti, entre 1949 et 1952, est expérimentée une ingénierie psychologique destinée à détruire, par une torture physique et psychique intense, la personnalité d’étudiants nationalistes et chrétiens afin de les transformer, par un réflexe pavlovien de peur/ obéissance, en « hommes nouveaux » destinés à devenir des cadres communistes7.
Sous les Khmers rouges, dans la prison de Tuol Sleng, plus de 15 000 prisonniers, souvent membres du parti – y compris des enfants de quinze ans – sont torturés jusqu’à ce qu’ils « avouent » des crimes imaginaires, puis assassinés ; au Cambodge, la terreur atteint une telle intensité qu’elle désintègre la société et suscite un stress si intense que nombre de victimes sont résignées à la mort.
Enfin, la terreur, tant contre les pouvoirs en place que contre les populations, est pratiquée par nombre de groupes communistes menant des luttes armées, en Asie, en Amérique latine ou en Afrique.
(p.124) Conditions d’efficacité de la terreur
Pour fournir son efficacité maximale, la terreur doit s’appuyer sur une puissante police politique, mais elle doit aussi bénéficier de quatre autres conditions : la surprise, le secret, la délation et l’enfermement. Le fait que, comme lors de la Grande Terreur, l’on ne sache ni qui est visé, ni pourquoi, ni quand, contribue grandement à susciter l’angoisse. Le secret entretient à la fois peur et espoir – des personnes disparaissent du soir au matin, mais leurs proches espèrent toujours les revoir, alors qu’elles ont été assassinées depuis longtemps -, et il permet de cacher au reste du monde l’ampleur des massacres qui pourrait ternir l’image du régime. La délation généralisée désagrège la société de l’intérieur, chacun craignant que ses collègues de travail, ses voisins, voire ses proches, ne le dénoncent, pour des propos ou actes hostiles au régime, ou par vengeance ; il est symptomatique que le régime soviétique ait proposé comme héros à la jeunesse le petit Pavel Morozov, qui avait dénoncé ses propres parents à la police politique lors de la collectivisation et qui, pour cela, avait été assassiné par ses oncles. Enfin l’enfermement dans des frontières sévèrement gardées – comme le mur de Berlin – éteint tout espoir d’échapper à la soumission et nourrit la résignation et la collaboration avec le régime.
La RDA est un bon exemple de l’efficacité du couple délation-enfermement. Disposant de dossiers sur plus de 4 millions de citoyens « suspects » – sur une population de 17 millions d’habitants -, la Stasi tenait le record du quadrillage policier, avec 91 015 salariés, soit 1 tchékiste pour 180 habitants – en URSS, le rapport n’était que de 1 pour 595. C’est d’ailleurs l’un des succès de ces polices politiques : une fraction de la population s’associe à la répression de la société. (p.125) Les informateurs – y compris des enfants – sont recrutés en fonction de leur utilité opérationnelle. Les formes de collaboration sont multiples ainsi que les motivations. Certains le font sous la contrainte, d’autres par adhésion à l’idéologie ; d’autres enfin – une part croissante – sont des carriéristes ou des opportunistes qui espèrent favoriser leur ascension sociale ou professionnelle, et l’accès à des privilèges8.
Le bilan de la terreur
Il n’est pas aisé de dresser un bilan général de la terreur communiste, eu égard au caractère souvent anonyme des victimes, à la nature diverse des violences, au secret dont elles sont entourées et à la fermeture des archives pour des pays aussi importants que la Chine, le Vietnam ou Cuba. Un bilan provisoire indique des ordres de grandeur. En URSS, sous Lénine, environ 6 millions de morts et sous Staline plus de 10 millions – collectivisation et famines de 1931-1933, 5 millions et 1 million en 1947 ; Grande Terreur, 700 000 ; déportés au Goulag 2 millions -, plus de 18 millions de personnes étant passées par le Goulag. En Pologne, de septembre 1939 à juin 1941 : plus de 50 000 fusillés, au moins 330 000 déportés au Goulag, sur une population de 12 millions d’habitants9. En Estonie, de juin 1940 à juin 1941, puis à partir de 1945 : 40 000 fusillés, 135 000 déportés au Goulag, sur une population de 1 million d’habitants10. En Lituanie, Lettonie et Bessarabie, pas de chiffres exactement établis, mais les mêmes ordres de grandeur que pour l’Estonie. En Roumanie et en Hongrie, des centaines de milliers de personnes internées ou condamnées au travail forcé, voire déportées au Goulag soviétique. En Bulgarie, au moins 30 000 disparitions à l’automne 1944. (p.126) En Yougoslavie, plus de 100 000 assassinats par les titistes à la Libération et des dizaines de milliers de déportés et d’exilés. En Chine de 1949 à 2007 : environ 70 millions de morts, dont 40 à 50 millions dus à la famine du Grand Bond en avant. Cambodge, de 1975 à 1979 : 1 700 000 morts sur moins de 8 millions d’habitants. Corée du Nord : environ 2 millions de morts. Afrique : 1 700 000 morts (famines, guerre civile). Afghanistan : 1 500 000 morts.
Soulignons en outre qu’une terreur courte mais de haute intensité – comme sous les Khmers rouges de 1975 à 1979 – a eu autant, voire plus d’effets destructeurs que la mise en œuvre d’une terreur de basse intensité pendant plusieurs décennies – par exemple en Roumanie. Par ailleurs, au-delà du bilan comptable, il faut prendre en compte les profonds traumatismes psychologiques, tant individuels que collectifs, qu’ont subi les sociétés, en particulier le phénomène généralisé de déresponsabilisation individuelle qui explique en partie les difficultés de mise en œuvre des économies post-soviétiques.
(p.128) La « dékoulakisation », engagée par Staline en 1929 sur le slogan « Liquidons les koulaks en tant que classe », vise l’extermination de l’élite paysanne. Quant à la famine organisée par Staline en Ukraine en 1932- 1933, elle relève à la fois du génocide de classe et de nation : environ 30 % de la population qui, sur le plan ethnique, peut être considérée comme ukrainienne, disparaît alors de son territoire par fusillade, mort de faim, déportation ou exil – principalement les élites politiques, intellectuelles et paysannes. (p.129) Quant aux Khmers rouges, ils ont pratiqué un génocide sur leur propre peuple, ce que certains historiens nomment un démo- cide. Et au Tibet, la Chine communiste poursuit depuis des décennies un ethnocide.
(p.131) Lénine et la destruction de l’intelligentsia russe
Après avoir écrasé les révoltes ouvrières à Saint- Pétersbourg et Cronstadt au printemps 1921, puis avoir mis à genou la paysannerie russe lors de la grande famine de 1920-1922, le pouvoir soviétique s’attaqua à l’été 1922 aux dernières forces sociales encore indépendantes, les personnalités de l’intelligentsia dont il expulsa à l’étranger ou envoya en exil intérieur 167 des plus éminents représentants.
(p.139) Une fois la Russie « nettoyée », Lénine pouvait enfin proclamer, en décembre 1922, la création de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le premier Etat totalitaire.
STALINE
(p.143) Dans un livre remarquable, Simon Sebag Montefiore a récemment éclairé un aspect fondamental de la personnalité de Staline qui explique en partie ce succès : les relations étroites, tissées bien avant 1914, du jeune bolchevik géorgien avec le grand banditisme du Caucase2. Dès 1869, Netchaïev écrivait : « Nous devons nous unir au monde hardi des brigands, les seuls et authentiques révolutionnaires en Russie3. » Staline suivit ce précepte et, grâce aux attaques à main armée, au racket révolutionnaire et au chantage, il devint celui que Lénine nomma « le merveilleux Géorgien» – parce qu’il abondait le trésor du groupe bolchevique -, qu’il coopta en 1912 à son Comité central, puis qu’il nomma en 1922 secrétaire général du parti.
(p.146) Le soixante-dixième anniversaire du vainqueur de Stalingrad, en 1949, fut d’ailleurs l’occasion du plus stupéfiant déferlement d’adoration qu’un humain ait pu connaître au XXe siècle. Le PCF ne fut pas en reste qui publia une brochure et diffusa un film intitulés « L’homme que nous aimons le plus ». L’Humanité du 8 décembre 1948 publia à sa gloire un poème intitulé « Joseph Staline », dû à la plume de l’un des plus grands poètes français du XXe siècle :
« Et mille et mille frères ont porté Karl Marx Et mille et mille frères ont porté Lénine Et Staline pour nous est présent pour demain Staline dissipe aujourd’hui le malheur La confiance est le fruit de son cerveau d’amour La grappe raisonnable tant elle est parfaite
[…] Staline dans le cœur des hommes est un homme Sous sa forme mortelle avec des cheveux gris Brûlant d’un feu sanguin dans la vigne des hommes Staline récompense les meilleurs des hommes Et rend à leurs travaux la vertu du plaisir Car travailler pour vivre est agir pour la vie Car la vie et les hommes ont élu Staline Pour figurer sur terre leur espoir sans bornes6. »
C’était signé Paul Eluard… Mais Louis Aragon ne fut pas en reste qui, lors de la remise d’un prix Staline, à Ilya Ehrenbourg à Moscou le 28 janvier 1953, quelques semaines seulement avant la mort du tyran, déclamait avec des accents pathétiques cet improbable dithyrambe :
« Ce prix porte le nom de l’homme en qui les peuples du monde mettent leurs espoirs de triomphe de la cause (p.147) de la paix ; de l’homme dont chaque parole retentit à travers le monde ; de l’homme qui a amené le peuple soviétique au socialisme. […] Cette distinction porte le nom du plus grand philosophe de tous les temps. De celui qui éduque les hommes et transforme la nature ; de celui qui a proclamé que l’homme est la plus grande valeur sur terre ; de celui dont le nom est le plus beau, le plus proche, le plus étonnant dans touts les pays pour tous ceux qui luttent pour leur dignité, le nom du camarade Staline7. »
(p.148) (…) la guerre contre la paysannerie qui accompagna la collectivisation forcée des années 1929-1933, avec le slogan lancé par Staline : « Liquidons les koulaks en tant que classe ». Le « koulak » désignait celui qui manifestait la moindre opposition à la collectivisation, forme modernisée du servage. En 1930-1931, environ 30 000 « koulaks » furent fusillés, 1 680 000 déportés avec leurs familles, pendant que 1 million d’autres fuyaient leur village et que 2 millions étaient exilés dans d’autres régions. Puis de l’été 1932 au printemps 1933, (p.149) ce fut la grande famine organisée contre la paysannerie ukrainienne ; en décrétant la réquisition par l’Etat de l’ensemble des récoltes, en envoyant des dizaines de milliers de commandos communistes s’emparer par la force de l’ultime ravitaillement des récalcitrants, Staline a provoqué un véritable génocide de classe et d’ethnie, entraînant la mort de 5 à 6 millions de personnes en neuf mois12.
Après l’assassinat de Kirov le 1er décembre 1934, Staline commença à programmer la Grande Terreur, inaugurée à l’été 1936 par le premier des trois Grands Procès de Moscou. A cet effet, il nomma à la tête du NKVD l’un de ses affidés les plus proches, Nikolaï Iejov13. En dehors de toute procédure judiciaire digne de ce nom et dans des délais déterminés, Iejov fut chargé de « traiter » des populations d’« ennemis du peuple », selon des quotas fixés à l’avance, et des modalités ne comprenant que deux catégories : la lre – fusillés – et la seconde – déportés. Désormais, les ordres opérationnels du NKVD, directement inspirés par Staline, scandèrent les quatorze mois qui courent du 30 juillet 1937 au 1er novembre 1938 :
- ordre opérationnel n° 00447 du 30 juillet 1937
visant les « koulaks » ayant terminé leur peine ou évadés du Goulag, les religieux et croyants, les ex-membres des partis non-communistes, les criminels et en général les « gens du passé », autorisant l’arrestation de 767 397 personnes, dont 386 798 fusillées.
- ordre opérationnel n° 00486 du 15 août 1937,
défini par le Bureau politique le 5 juillet 1937, autorisant l’arrestation de plus de 18 000 femmes d’« ennemis du peuple » et de 25 000 enfants de plus de quinze ans.
- ordre opérationnel n° 00439 du 25 juillet 1937
visant les Allemands travaillant en URSS et les Soviétiques ayant eu des relations avec l’Allemagne, soit au (p.150) total 68 000 personnes arrêtées dont 42 000 furent exécutées.
- ordre opérationnel n° 00485 du 11 août 1937 visant tous les Soviétiques ayant eu des relations avec la Pologne ou des Polonais en URSS, soit au total 144 00 personnes arrêtées dont 110 000 furent exécutées, y compris la plupart des dirigeants et cadres du Parti communiste polonais réfugiés en URSS et dont le parti fut officiellement dissous par le Komintem en août 1938.
- ordre opérationnel n° 00593 du 20 septembre 1937 visant les Soviétiques originaires de Harbin revenus de Mandchourie en URSS après le règlement de la question du chemin de fer de l’Est chinois en 1935 avec le Japon. 25 000 personnes furent arrêtées.
- d’août à octobre 1937, le NKVD déporta des frontières d’Extrême-Orient au Kazakhstan plus de 170 000 Coréens.
Le 31 janvier 1938, le Bureau politique autorisa le NKVD à étendre son action aux opérations lettone, estonienne, grecque, iranienne, roumaine, finlandaise, chinoise, bulgare et macédonienne. Le 1er août 1938, le Bureau politique autorisa le NKVD à étendre ses activités à l’opération afghane. Le total des victimes de ces « opérations nationales » se monte à 350 000 personnes arrêtées dont 247 157 exécutées.
Le 19 septembre 1937, le Bureau politique autorisa le NKVD à intervenir en Mongolie extérieure, ce qui aboutit en quatre mois à l’arrestation de 10 728 « conspirateurs » dont 7 814 lamas, 322 propriétaires féodaux, 300 officiers ministériels, 180 responsables militaires, dont 6 311 étaient déjà fusillés au 31 mars 1938.
Parallèlement, Staline signa personnellement 383 listes transmises par Iejov, concernant plus de 44 000 membres du Parti communiste et de l’appareil d’Etat, dont 39 000 furent exécutés et les autres déportés.
(p.151) Au total, du 1er octobre 1936 au 1er novembre 1938,
- 565 000 personnes furent arrêtées – 365 805 pour les « opérations nationales » et 767 397 en vertu de l’ordre n° 00447, dont 668 305 furent exécutées et 668 558 envoyées en camp de concentration. Encore ces chiffres sont-ils sous-estimés et le nombre d’exécutés se monte- t-il à plus de 700 000. C’est ainsi que Staline mit en œuvre la « solution finale » au problème des « éléments anti-soviétiques »14. Il fut personnellement responsable de la Grande Terreur, trop souvent mise sur le compte du seul Iejov – d’où le terme de Iejovshina – alors qu’en 1937-1938, le chef du NKVD fut reçu 278 fois par Staline au Kremlin – « en moyenne tous les deux jours et demi ! -, à peine moins que Molotov, le bras droit du tyran.
Les accords Molotov-Ribbentrop du 23 août et du 28 septembre 1939, en provoquant la conquête par l’Armée rouge de la partie orientale de la Pologne, puis en juin 1940 des Etats baltes, de la Bessarabie et de la Bukovine du nord, entraînèrent de nouvelles vagues de terreur contre ces nations immédiatement soviétisés.
En Pologne, les Soviétiques firent en quelques jours environ 230 000 prisonniers de guerre dont la moitié – considérés comme Biélorusses et Ukrainiens – fut rapidement libérée. Mais 30 000 autres furent envoyés au Goulag et beaucoup d’autres incorporés de force dans l’Armée rouge comme nouveaux « citoyens soviétiques ». Et surtout, le 5 mars 1940, sur rapport de Beria, Staline et le Politburo décidèrent de faire assassiner 25 700 Polonais internés, dont 14 587 officiers prisonniers de guerre – au moins 4 243 d’entre eux furent tués d’une balle dans la tête à Katyn. Précisons que le mars 1940, Staline donna suite à la demande de Nikita Khrouchtchev, Premier secrétaire du PC d’Ukraine, (p.152) qui sollicitait l’autorisation de déporter les 22 000 à 25 000 familles des hommes condamnés à mort trois jours plus tard par le Politburols !
Parallèlement, le NKVD lança quatre grandes opérations de déportation visant en priorité les couches dirigeantes polonaises : le 10 février 1940 (140 000 personnes), le 13 avril 1940 (61000), le 29 juillet 1940 (75 000) et en juin 1941 ; l’ensemble toucha 330 000 personnes – dont un tiers d’enfants de moins de 14 ans – selon les chiffres actuellement disponibles du NKVD, et 800 000 selon les chiffres du gouvernement polonais en exil pendant la guerre16. En outre, après le 22 juin 1941, le NKVD massacra sur place ou lors de transferts plusieurs dizaines de milliers de prisonniers polonais. Au total, le régime soviétique fît – morts et déportés – plus de 440 000 victimes en Pologne orientale du 17 septembre 1939 au 22 juin 1941, sur une population de 12 millions d’habitants. Massacres et déportations reprirent en 1944-1945 lors du retour de l’Armée rouge dans ces territoires occupés en 1939 et lors de son entrée dans les autres territoires appartenant en principe à la Pologne indépendante reconnue par Moscou.
L’invasion de l’Estonie par l’Armée rouge le 12 juin 1940, entraîna dans ce pays une vague de terreur communiste : de juin 1940 à juin 1941, plus de 2 200 personnes assassinées (dont 800 officiers, la moitié de ce corps !), 12 500 soldats et plus de 10 000 civils déportés en URSS ; puis à nouveau lors du retour de l’Armée rouge dans l’hiver 1944-1945 : 75 000 personnes arrêtées dont au moins 25 000 furent fusillées ou moururent dans les camps, et 75 000 exilés dont environ 6 000 furent tués en chemin par les Soviétiques ; en mars 1949, une nouvelle vague de déportation envoya plus de 22 000 personnes au Goulag. En outre, de 1944 à 1953, plus de 2 000 résistants maquisards furent tués au combat, (p.153) 1 500 assassinés et 10 000 arrêtés. Au total, ce sont environ 175 000 Estoniens qui ont été victimes de la terreur soviétique, soit 17,5 % de la population – ce qui rapporté à la population française correspondrait à 10,5 millions de personnes17 !
Les mêmes méthodes furent pratiquées en Lituanie et en Lettonie, ainsi qu’en Bessarabie et en Bukovine du Nord.
La guerre fut l’occasion pour Staline de poursuivre ses opérations génocidaires avec la déportation de près de 900 000 Allemands de la Volga à l’automne 1941, de 93 000 Kalmouks du 27 au 30 décembre 1943, de 521 000 Tchétchènes et Ingouches du 23 au 28 février 1944, de 180 000 Tatars de Crimée du 18 au 20 mai 1944, auxquels s’ajoutent les Grecs, les Bulgares et les Arméniens de Crimée, ainsi que les Turcs, les Kurdes et les Klemchines du Caucase.
Après guerre, la terreur de masse continua et fut exportée dans les pays d’Europe de l’Est récemment conquis, s’accompagnant d’innombrables actes de barbarie.
(p.158) S’étant emparé du parti, Staline le remodela à sa main, assurant la promotion de millions de jeunes issus des campagnes, au capital scolaire très faible – Iejov n’avait fait qu’une année d’école primaire -, fascinés par les situations qui leur étaient promises, mais contraints de démontrer en actes aussi souvent que nécessaire leur allégeance totale à leurs chefs et au premier d’entre eux, Staline – y compris par leur compromission dans les assassinats de masse. En retour, ce parti formé de jeunes gens frustes, brutaux et grossiers, s’est reconnu dans ce chef issu, comme lui, du petit peuple – à la différence de la plupart des chefs bolcheviques historiques qui étaient des lettrés marxistes issus de la petite noblesse, de la bourgeoisie russe ou des communautés juives des villes.
(p.160) Cette industrialisation à marche forcée, placée sous le signe du Premier Plan quinquennal inauguré en 1928, développa une sidérurgie lourde et une industrie automobile et aéronautique, au prix de la surexploitation des ouvriers – leur salaire réel baissa de moitié entre 1928 et 1934.
(p.167) Une Anne Frank au pays de Staline1
L’effondrement du communisme soviétique en 1991 a libéré une masse gigantesque d’archives, tenues jusque- là secrètes, qui ont permis de lancer des coups de projecteur dans les profondeurs d’un système totalitaire largement opaque. Cette révolution documentaire a donné accès à d’innombrables documents émanant du sommet de ce pouvoir – le Bureau politique du Parti bolchevique et ses leaders, en particulier Lénine et Staline -, mais aussi de ses succursales à l’étranger.
Un certain nombre de grandes querelles historiques ont ainsi trouvé leur dénouement : la responsabilité soviétique dans l’assassinat des officiers polonais à Katyn au printemps 1940, le processus de la Grande Terreur qui, en 1937-1938, entraîna en URSS l’exécution de plus de 700 000 personnes, ou encore, plus près de nous, les négociations entre le PCF et Otto Abetz, le représentant de Hitler à Paris, durant l’été 1940.
Ces archives recèlent également d’autres types de documents qui, s’ils ne concernent pas la « grande Histoire », n’en sont pas moins révélateurs d’un climat politique et social, d’une époque, d’un régime. Tel est le journal intime de Nina Lougovskaïa, miraculeusement préservé et retrouvé dans les archives du NKVD, ancêtre du tristement fameux KGB.
(p.168) C’est Irina Ossipova, historienne de l’association russe Memorial – laquelle, depuis 1988 et en dépit de constantes tracasseries, travaille sans relâche à la réhabilitation de la mémoire des victimes du bolchevisme -, qui a retrouvé ce journal en étudiant le dossier de répression de la famille Lougovski.
Le père, de son vrai nom Sergueï Rybine, était né en 1885 dans une famille de paysans. Autodidacte, diplômé de commerce à Moscou, militant socialiste- révolutionnaire (SR), exilé en Sibérie sous le tsar, il fut élu, après la révolution démocratique de mars 1917, dans diverses instances, puis se retrouva, comme la plupart des SR, dans l’opposition aux bolcheviks après le coup d’Etat de Lénine, le 7 novembre 1917.
Autorisé à rentrer à Moscou au début de la NEP – la Nouvelle politique économique lancée par Lénine en 1921, qui limitait l’instauration du communisme et autorisait le retour à des activités privées -, Rybine créa avec d’autres camarades SR une coopérative commerciale qui fut rapidement florissante.
En 1928, considérant que le pouvoir était assez consolidé pour mettre fin à la NEP, Staline relança la révolution communiste, avec le premier plan quinquennal et son industrialisation accélérée, puis la collectivisation forcée des terres, et leur corollaire, la création du Goulag. Ayant refusé de laisser des fonctionnaires communistes prendre la direction de sa coopérative, Rybine fut arrêté en janvier 1929 et condamné à trois ans d’exil dans le Nord. Revenu à Moscou en 1932, il fut interdit de séjour. Arrêté à nouveau en janvier 1937, ramené à Moscou, il fut condamné à dix ans de Goulag comme chef d’une organisation contre-révolutionnaire SR. Ayant survécu, il fut relâché en 1947 et mourut à la fin des années 1950 sans avoir revu sa famille.
Sa femme, Lioubova Vassilievna Samoïlova, née en 1887, était elle aussi originaire de la campagne. (p.169) Diplômée de l’Institut supérieur de filles de Moscou et enseignante de mathématiques, elle épousa Rybine en 1914 et ils prirent le nom de Lougovski, formé d’après celui de la ville natale de Sergueï. Bibliothécaire dans la coopérative de son mari, Lioubova fut licenciée dès l’arrestation de celui-ci en 1929 et, après 1932, resta seule à entretenir la famille. En 1915, les Lougovski avaient eu deux filles jumelles, Olga (Lalia) et Euguenia (Genia). Puis Nina était née à Moscou, le 25 décembre 1918.
Le sort de toute la famille bascula le 4 janvier 1937 quand leur appartement fut perquisitionné et que furent saisis toute la correspondance de Rybine, sa bibliothèque d’ouvrages SR et les deux journaux intimes de Nina et d’Olga. Ayant refusé de collaborer avec le NKVD contre son mari, Lioubova fut condamnée, en même temps que ses trois filles, à cinq ans de Goulag et envoyée dans l’un des plus terribles lieux de déportation, la Kolyma, magnifiquement évoquée par Varlam Chalamov dans ses Récits de la Kolyma2. Ayant survécu, les quatre femmes furent libérées du Goulag en 1942. Si leur mère mourut à Magadan en 1949 – elle sera « réhabilitée » en 1957 « à titre posthume » -, les filles purent quitter la Kolyma en 1947 pour être transférées dans l’Oural. En 1959, Nina et son mari – Viktor Templin, ex-prisonnier politique et artiste – furent autorisés à s’installer à Vladimir, à 200 kilomètres de Moscou. En 1963, Nina écrivit à Khrouchtchev pour demander sa réhabilitation, et sa sentence fut annulée pour… « manque de preuves ». Artiste peintre, Nina a réalisé une œuvre importante, couronnée par plusieurs expositions. Elle a disparu en 1993, avant que son journal ne soit retrouvé.
Ce journal, commencé en octobre 1932 par une adolescente qui n’avait pas encore quatorze ans, et tenu jusqu’au 3 janvier 1937 par une désormais jeune fille, est un document tout à fait unique dont cette édition (p.170) traduite du russe présente l’essentiel. Elle se lit sur deux registres paradoxaux.
Le premier est celui d’une vie « normale ». La famille d’abord : le père, souvent absent, mais très présent dans les pensées de sa fille ; la mère, qui travaille jour et nuit pour assurer le quotidien, tout en restant le cœur du foyer et la confidente de ses filles ; les trois sœurs – Lalia, Genia et Nina -, toujours en mouvement, en train de se chamailler et formidablement complices.
Une famille qui bénéficie d’un appartement confortable de quatre pièces – un privilège à l’époque -, chauffé en hiver et où Nina dispose de sa propre chambre. Et qui l’été part à la « datcha », soit chez le père exilé près de Mojaïsk, soit chez un oncle ou une tante. Une famille où l’on mange, semble-t-il, à sa faim en cette période de grande pénurie alimentaire et où l’on a les moyens d’entretenir un chien, le caniche Betka. Lors du réveillon de 1935, on y déguste même des mandarines. Une famille où l’on peut s’habiller correctement, avec manteau, chapeau et cartable – sa mère rapporte à Nina, le 18 janvier 1933, un manteau de fourrure.
Les filles mènent une vie d’adolescentes « petites- bourgeoises ». Les jumelles chantent, dansent, jouent du piano – il y a un piano à la maison -, dessinent, partent en promenade à cheval – avec une veste d’équitation -, vont patiner avec des amies. Nina fréquente le théâtre, où elle croise « la foule bariolée des femmes en robes de soie », et aussi l’Opéra. Des filles cultivées qui lisent Lermontov, Tourgueniev, Tolstoï, Tchékhov, Essenine et même Pokrovski.
Bref, une famille typique de la petite intelligentsia révolutionnaire moscovite, mais non bolchevique, d’avant la Grande Terreur. Nina en est d’ailleurs bien consciente et le note le 8 juillet 1934 quand elle prend le train avec sa mère : « De tous les passagers du wagon, nous étions les seules à appartenir à l’intelligentsia (p.171) et à aller à la “datcha”, et j’en éprouvais une honte affreuse devant ces gens à demi affamés et qui ne connaissaient pas un instant de repos. »
Autre dimension « normale » du journal, Nina elle- même. Une adolescente pleine de vie, de questions, d’angoisses, comme la plupart des filles de son âge. Son leitmotiv : « Je veux vivre ! », « La liberté, la liberté, voilà ce dont mon cœur a soif », « Vis pendant que tu es vivante ». Sa grande préoccupation, les garçons, comme elle le note le 1er mai 1935 : « Je passe ma vie entière à ne penser qu’aux garçons ; tout autre sujet me paraît sans intérêt et sans importance. » Mais une préoccupation dominée par l’angoisse de sa « laideur » – elle est atteinte de strabisme -, qui développe chez elle un complexe, une grande timidité et la pousse même par moments au suicide.
Nina est aussi une écolière moscovite « normale », confrontée aux garçons – les classes sont mixtes -, mais aussi à des professeurs et à une administration qu’elle n’apprécie guère, comme elle le note le 26 novembre 1936 : « Impertinence envers les professeurs, dissimulation et méchanceté. Dans nos rapports avec eux, il n’y a rien qui puisse rappeler ces liens nouveaux et excellents qu’on nomme désormais “rapports soviétiques”. » Avec, à la clef, une interrogation lancinante sur son avenir et ses possibilités universitaires réduites en raison de la priorité donnée par le régime aux enfants des cadres du Parti communiste et aux jeunes issus des classes populaires.
Une inquiétude nourrie par sa réflexion sur le statut inférieur de la femme en Russie, même aux yeux d’un révolutionnaire comme son père. Car son second grand problème, c’est son père qu’elle adore et déteste alternativement, selon qu’il est à la maison et la tarabuste de questions, ou qu’il est en exil, voire enfermé à la prison de la Boutyrka où elle pourra, une fois, lui rendre visite.
(p.172) Et alors, elle déborde d’amour et de respect : « Je l’aime quand il se montre révolutionnaire. J’aime ses idées d’homme, d’homme d’action, d’homme qui conserve ses opinions, qui ne les renie pas en échange de bienfaits dans la vie quotidienne. » Même si elle ne l’indique qu’en passant, il est certain qu’une bonne part de ses réflexions politiques et sociales, qui constituent le second registre de lecture du journal, viennent de son père et de ce qu’elle a retenu des discussions entre ses parents.
Ce second registre est aisément repérable : il a été presque entièrement souligné par l’enquêteur du NKVD chargé de lire cette terrible pièce à conviction qu’était le journal intime d’une fille de quinze ans. Ces soulignements indiquent que le NKVD n’était plus une traditionnelle police politique, mais une police totalitaire, une police de la pensée. Il faut dire que Nina ne reste pas la plume dans l’encrier et qu’on voit peu à peu émerger de son récit, à la surface assez lisse de sa vie « normale », des signaux de plus en plus inquiétants qui révèlent la mise en place du régime totalitaire inauguré par Lénine, et réactivé puis généralisé par Staline à partir de 1928.
Le premier signal apparaît le 1er novembre 1932, avec la perquisition surprise de l’appartement des Lougovski à 23 h 30. Le lendemain, Nina évoque en riant les réactions de sa copine Irina, «terrifiée […] à la seule idée de prononcer le mot “perquisition” ». Mais le 21 janvier 1933, le père d’Irina est arrêté et Nina n’a plus envie de rire : « Ils ont détruit leur bonheur et leur tranquillité, réduit à néant le mode de vie de toute sa famille, leurs habitudes, tout ce qui leur tient à cœur. […] Oh !, les salauds, les ordures ! Comment osent-ils faire des choses pareilles. Ah ! bolcheviks, bolcheviks ! Jusqu’où êtes-vous tombés ? Que faites-vous ? »
Le deuxième signal se situe le 24 mars 1933, lorsque Rybine se voit refuser son passeport. Fin 1932, le (p.173) régime a instauré un système de passeport intérieur autorisant à résider dans un certain nombre d’agglomérations. Ce système visait à empêcher les paysans ruinés et affamés par la collectivisation forcée de se sauver vers les villes – désormais le kolkhozien est attaché comme un serf à son kolkhoze – et à purger les villes des « éléments indésirables », définis en fonction de leurs opinions oppositionnelles – connues ou supposées – et de leur position sociale. En tant que SR antibolchevique et ex-responsable d’une coopérative privée, le père de Nina était parfaitement ciblé. Ainsi a été inauguré un vaste processus de marginalisation officielle de toute une partie de la population désormais désignée à la vindicte publique. Sergueï Rybine a donc été contraint de quitter son travail et sa famille, de s’installer à plus de cent kilomètres de Moscou, et de revenir clandestinement voir les siens au risque d’être arrêté ou de devoir quitter son domicile en catastrophe quand une rafle s’annonçait dans l’immeuble.
A partir de ce moment, Nina se désintéresse de la vie sociale – même si elle est parfois encore attirée par quelque événement exceptionnel comme lors du sauvetage du Tcheliouskine, un navire pris dans les glaces de la banquise -, elle délaisse les manifestations traditionnelles du 7 novembre et du 1er mai, elle est de plus en plus sensible au côté mensonger de la propagande. Lors de l’accident de l’avion géant Maxime Gorki, en mai 1935, elle note : « Oh, comme il y en a chez nous, de cette vantardise, de cette volonté de prouver qui nous sommes en dépit du bon sens. Et c’est à cause de ça, de cette vantardise, que nous nous retrouvons tous à souffrir. » Il lui arrive même de passer à l’acte, comme ce 18 mai 1933 où elle arrache l’affiche placardée sur son immeuble, qui clame les mérites d’un nouvel emprunt obligatoire.
(p.174) Parallèlement, Nina repère la montée de l’endoctrinement à l’école, critique le professeur de sociologie qui vante « le renouvellement des cadres et de nombreuses institutions » et la rembarre quand elle s’interroge à haute voix. Elle dénonce l’installation de la délation jusqu’au sein des classes ou encore la transformation d’une blague de potache – la rédaction par les garçons d’un édit émanant de l’empereur Krok II ! – en « organisation clandestine contre-révolutionnaire ». Convoquée chez le directeur, elle dresse le portrait du parfait apparatchik : « […] antipathique, sorti du rang grâce à sa carte du Parti, à ses vilenies et à sa capacité à remplir toutes les tâches exigées d’en haut, sans zèle et sans réfléchir. Il donnait l’impression d’avoir, avant ce poste, uniquement évolué parmi les bandits de grand chemin et peut-être les prostituées. Certainement pas au milieu des écoliers. […] Un sacré dictateur. C’était la première fois de ma vie que je me frottais à ce qu’il est convenu d’appeler “le pouvoir en place”. »
Nina en tire les bonnes conclusions : « Il règne en URSS une réaction comme on n’en a encore jamais vue. Terrifiante ! […] Cependant, je comprends en partie les bolcheviks. Ils sont grossiers et d’une cruauté barbare mais, de leur point de vue, ils ont raison : s’ils n’épouvantent pas les gens dès l’enfance, ils ne verront pas plus leur pouvoir s’instaurer sur la terre qu’ils ne voient leurs propres oreilles. Par conséquent, ils nous éduquent en vue de faire de nous des esclaves soumis et ils tuent impitoyablement dans l’œuf le plus petit souffle de rébellion. La moindre manifestation d’esprit critique, le plus léger signe d’indépendance ou de liberté de pensée est puni effroyablement. »
Nina constate comment ce climat étouffant et toutes les difficultés quotidiennes changent le comportement des gens. Et d’abord sa mère : « Mon Dieu, pauvre maman. […] Elle est devenue vieille, malade, apathique. […] (p.175) On dirait un cheval qui s’est épuisé au travail mais continue, par inertie, à tirer sa charrette tout au long de la journée alors qu’elle n’a plus de force. » Mais aussi ses sœurs avec qui elle a de violentes algarades, ainsi le 4 juillet 1933 : « Je ne peux pas être d’accord avec mes sœurs. Pour elles, le socialisme est un régime véritable et les horreurs d’aujourd’hui sont dans l’ordre des choses. » Ou encore le 11 décembre 1934 : « Journée épouvantable. […] Je ne sais pas comment la conversation a roulé sur le sujet le plus dangereux qui soit : le pouvoir soviétique, les bolcheviks et la vie actuelle. Nous nous sommes retrouvées, elles et moi, sur des positions totalement opposées. »
Ces querelles peuvent aussi être provoquées tout simplement par la faim et la promiscuité que Nina expérimente à la campagne en juillet 1933. Elle note très justement comment ces circonstances particulières provoquent un processus de brutalisation jusque dans sa famille: «Nous sommes à couteaux tirés. […] Il s’est produit des choses incroyables. On n’arrêtait pas de crier l’une sur l’autre. Du matin au soir, l’air retentissait de “Brute !”, “Imbécile !”, “Idiote !”. C’est insensé la brutalité qui peut jaillir de nous ! »
Cette violence, Nina la remarque aussi dans la société, largement provoquée par la dégradation constante de la situation économique depuis 1928-1929. Le 21 août 1933, elle dresse un tableau très réaliste des différents types de magasins moscovites, depuis ceux de la nomenklatura communiste, jusqu’aux coopératives d’Etat, qui connaissent des queues interminables. Relevant les prix, elle s’indigne : « Dans les files d’attente, les gens se disputent et maudissent la vie. Ils sont méchants, affamés, épuisés. Nulle part on n’entend s’élever un mot de défense des bolcheviks haïs. […] Qu’est-ce que les ouvriers mangeront cet hiver ? » Revenue d’un séjour de vacances en province, elle note : (p.176) « Au lieu de la solidarité ouvrière si hautement célébrée, il y régnait un antagonisme viscéral entre les ouvriers locaux et les saisonniers. Querelles et coups de poing dans la gueule étaient monnaie courante. »
Et surtout, elle est particulièrement sensible au sort des paysans – peut-être en souvenir de ses origines familiales et de sa grand-mère, qu’elle voit souvent. En août 1933, elle écrit : « Des choses étranges se passent en Russie. Famine, cannibalisme… Ceux qui arrivent des provinces racontent de drôles de choses. Ils disent qu’ils n’ont pas le temps de ramasser les cadavres dans les rues, que les villes de province sont remplies de paysans en guenilles et affamés. Partout il y a des vols horribles et du banditisme. Et l’Ukraine, ce grenier à blé, qu’en reste-t-il ? On ne la reconnaît plus. » Le 11 décembre 1934, elle envoie à la tête de ses sœurs, lors d’une violente dispute, les « 5 millions de morts en Ukraine ». Et il est exact qu’en 1932-1933, le pouvoir soviétique a organisé, par ses réquisitions forcées et l’interdiction de toute aide aux affamés, une gigantesque famine qui a touché principalement l’Ukraine, faisant autour de 5 millions de victimes3. On constate donc qu’en dépit des efforts considérables du pouvoir pour cacher cette tragédie dont il était directement responsable, et de la gigantesque campagne de désinformation et de propagande déclenchée pour en nier l’existence, l’information a transpiré jusque chez une collégienne moscovite dès l’été 1933.
Autant de malheurs, familiaux et généraux, suscitent chez Nina une véritable haine des bolcheviks, et elle n’hésite pas à s’attaquer aux figures sacrées du régime. En novembre 1932, elle a assisté aux obsèques d’Ali- louïeva, la femme de Staline, qui s’est suicidée ; elle remarque qu’il y avait dans la foule « une joie mauvaise » contre cette « bolchevique ». En juin 1933, elle se moque d’une statue de Lénine, une vraie « caricature ». (p.177) Elle en vient à vouloir la mort des chefs bolcheviques. Lors de l’assassinat de Kirov, le 1er décembre 1934, elle en ressent de la joie : « J’ai regretté de ne pas avoir assisté à cet événement terrible et tonitruant. Il y allait avoir un sacré pétard, maintenant. » Effectivement, quel pétard : les grands procès de Moscou, la Grande Terreur et la suite…
Elle en veut tout particulièrement à Staline, « ce salaud, cette ordure, ce vil Géorgien » qui « mutile la Russie » : « J’en suis venue à la conclusion qu’il faut tuer ces salauds. […] Pendant plusieurs jours, couchée dans mon lit, j’ai rêvé à la façon dont je le tuerais, ce dictateur. […] Je serrais les poings de fureur. Le tuer, et le plus tôt possible. Me venger, et venger papa. Le tuer. » On imagine le choc de l’inspecteur du NKVD à cette lecture…
Néanmoins, le caractère progressif de la mise en place de la terreur par Staline, en particulier à Moscou, est bien souligné par l’insouciance de la dernière notation de Nina, le 3 janvier 1937 : « Trois mots sur le réveillon du Nouvel An. L’atmosphère a été assez joyeuse et animée, mais ça aurait pu être mieux. » Ce sera bien pire que tout ce que Nina pouvait imaginer. Le lendemain, c’est la perquisition et le début de la tragédie pour toute la famille.
Et pourtant, si celle-ci avait été arrêtée après juillet 1937, son sort aurait probablement été pire encore. En effet, par son ordre n° 00447 du 30 juillet 1937 qui inaugura la Grande Terreur, Nikolaï Iejov, le chef du NKVD placé sous les ordres directs de Staline, décidait de condamner en « catégorie n° 1 » – fusillé – ou en « catégorie n° 2 » – déporté au Goulag -, « les exmembres des partis non communistes, les criminels et, en général, les gens du passé », soit 767 397 personnes, dont 386 798 furent immédiatement fusillées. Nina et sa mère auraient pu également tomber sous le coup de (p.178) l’ordre n° 00486 du 15 août 1937, défini par le Bureau politique le 5 juillet 1937, autorisant l’arrestation des familles des « ennemis du peuple » déjà arrêtés, soit de plus de 18 000 femmes et de 25 000 enfants (de plus de quinze ans).
Le 28 septembre 1933, Nina notait déjà : « Ce matin, je me suis dit : “Vivement que je grandisse et quitte ce pays de barbares et de sauvages.” » Staline l’a expédiée dans un pays encore plus barbare, la Kolyma, mais son journal nous la rend, intacte, authentique, accusatrice. Un grand document qui fait irrésistiblement penser au Journal d’Anne Frank, même si les circonstances dans lesquelles ils ont été écrits sont assez différentes. Même lucidité impitoyable dans les yeux de ces deux adolescentes, et même fraîcheur d’écriture. Même témoignage d’une vie palpitante écrasée par un pouvoir totalitaire. N’oublions jamais.
(p.184) Alexander Afinogenov est né en 1904. Dès l’âge de 13 ans, en 1917, il est élu secrétaire de l’union locale des étudiants communistes, près de Riazan, et se vante d’être allé en classe « en effrayant les professeurs avec mon attitude dominatrice et le revolver à la ceinture ». Admis au Parti bolchevique à 17 ans, il s’installe en 1927 à Moscou et devient l’un des leaders de l’organisation radicale nommée Association russe des écrivains prolétariens (la RAPP). Sa première pièce de style « réaliste prolétarien » – L’Excentrique – est présentée devant Staline qui la recommande aux membres du Comité central. Sa pièce la plus connue – Peur – oppose une jeune communiste enthousiaste à un professeur de la vieille intelligentsia russe qu’elle pousse à rejoindre la construction du socialisme. Lorsqu’en octobre 1932 Staline réunit des intellectuels et les incite à soutenir à la campagne d’industrialisation du pays et à devenir « des ingénieurs des âmes », Afinogenov fait partie des invités. Et il est coorganisateur du congrès de fondation de l’Union des écrivains, qui deviendra la structure unique et obligatoire des intellectuels.
Ces promotions s’accompagnent de fortes gratifications : appartement de quatre pièces confortablement aménagé, salaire très élevé, accès aux magasins spéciaux, autorisation de voyager à l’étranger et d’en rapporter une automobile, mise à disposition d’une datcha.
(p.190) La guerre civile déclenchée par la prise de pouvoir des bolcheviks, le 7 novembre 1917, donna lieu à une nouvelle vague de pogroms, tant du côté des « Blancs » que des nationalistes ukrainiens ou de l’Armée rouge. Les bolcheviks une fois solidement installés au pouvoir, la situation des Juifs de la nouvelle URSS sembla s’améliorer notablement. Ils s’investirent en nombre dans les instances du nouveau régime, affluant dans les grandes villes qui, jusque-là, leur étaient interdites. Au début des années 1930, Moscou comptait ainsi plus de 250 000 Juifs sur une population juive soviétique d’environ 3 millions de personnes. Ce monde yiddishophone connut alors une sorte « d’âge d’or » culturel, à travers journaux, théâtres, groupes ^musicaux, clubs de toutes sortes.
(p.192) De très nombreux Juifs gravitaient dans les sphères du pouvoir, au point qu’en 1936 près de 40 % des hauts cadres de la police politique étaient des Juifs. Et deux des hommes les plus proches du « petit père des peuples », Kaganovitch et Mekhlis, étaient juifs.
(p.193) Entre septembre 1939 et juin 1940, Staline toucha les dividendes de son alliance avec les nazis et l’Armée rouge put envahir sans coup férir la partie orientale de la Pologne, les Etats baltes et les provinces roumaines de Bessarabie et de Bukovine du nord. Et soudain le problème juif se posa avec acuité. L’URSS, qui comptait environ 3 millions de Juifs, en « récupérait » 2 millions supplémentaires – 1 270 000 de Pologne, 250 000 des Etats baltes et 375 000 de Roumanie. Certes, ils furent « soviétisés » comme le reste des populations, mais, n’appartenant la plupart du temps ni aux élites autochtones ni à la paysannerie, ils eurent moins à souffrir de la terreur qui accompagna la conquête ; pourtant, plus de 250 000 Juifs polonais, qui ne voulaient ni retourner dans la zone d’occupation allemande ni adopter la nationalité soviétique, furent déportés au Goulag, de même qu’environ 25 000 Juifs de Lettonie.
(p.195) Du 27 au 30 décembre 1943, il fit déporter 93 000 Kalmouks, puis 521 000 Tchétchènes et Ingouches du 23 au 28 février 1944, 180 000 Tatars de Crimée du 18 au 20 mai 1944, et enfin des dizaines de milliers de Grecs, Bulgares, Arméniens, Turcs, Kurdes du Caucase. Lors du toast de la victoire, le 24 mai 1945, Staline désigna le peuple russe comme « le peuple dirigeant » et s’orienta plus nettement vers un national- communisme.
Dès lors, les Juifs et le CAJ apparurent de plus en plus comme les prochaines victimes. Un antisémitisme d’Etat commença à se faire jour : les Juifs étaient écartés des postes de responsabilité, voire même privés de travail. Le 19 novembre 1946, un jeune apparatchik montant, Mikhaïl Souslov, adressa au secrétariat du parti une lettre où il dénonçait le danger nationaliste représenté par le CAJ ; et simultanément, Staline interdisait la publication du Livre noir sur l’extermination des Juifs d’URSS, ensemble de témoignages recueillis et mis en forme par deux des écrivains juifs les plus connus, Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman5. Fin 1947, Staline donna personnellement son feu vert pour la liquidation, (p.196) maquillée en accident, de Solomon Mikhoels, acteur juif très connu, qui avait été la figure de proue du CAJ ; Mikhoels fut assassiné le 12 janvier 1948.
(…) Le 20 novembre 1948, ordre fut donné de dissoudre le CAJ et, dès 1949, commençait en URSS une violente campagne contre les Juifs qui, après avoir été accusés de nationalisme sioniste, devenaient désormais des « cosmopolites apatrides ». L’antisémitisme d’Etat se montra dès lors sans fard, discriminant moralement et matériellement les Juifs et créant dans l’opinion un climat favorable à une persécution de grande ampleur.
(p.197) Au printemps 2001, alors que Vladimir Poutine était déjà président de la République de Russie, près du tiers des députés de la Douma ont refusé d’observer une minute de silence à la mémoire des Juifs d’URSS assassinés par les nazis.
(…) Car si les Juifs d’URSS furent massivement des persécutés – exterminés par les nazis et discriminés par le régime après 1945 -, ils furent aussi, très minoritairement il est vrai, du côté des persécuteurs, dans les instances du Parti communiste, de la police politique et de l’Armée rouge.
(p.199) La Terreur « douce »
Ce fichage général, ce réseau omniprésent de délateurs et cette surveillance constante n’ont pas été les seuls supports de la « terreur douce ». Tous les régimes communistes ont instauré une économie administrée et planifiée centralement par le parti-Etat qui s’est ainsi emparé des monopoles de la propriété, de la production et de la distribution des biens matériels. Si ce système a fortement appauvri les pays qui y ont été soumis – voire les a ruinés comme au Cambodge -, il a assuré au pouvoir une formidable position dominante sur la société, par le biais du ravitaillement, des biens de consommation de base (vêtements, souliers, etc.) et du logement. La gestion discrétionnaire de la pénurie a contribué à porter la terreur au cœur de la vie quotidienne.
(p.203) La faim a donc été une arme terrible aux mains des pouvoirs communistes et si elle n’a pas toujours abouti à ces drames, elle n’en est pas moins restée une menace constante.
Les pénuries chroniques de biens de consommation 1 de base, communes à tous les régimes communistes, y ont engendré le phénomène caractéristique de la « queue ». Pour se procurer une demi-douzaine d’œufs, une paire de chaussure ou un costume neuf, le citoyen ordinaire devait faire la queue pendant des heures, sans d’ailleurs avoir la garantie qu’une fois arrivé au guichet l’objet convoité serait encore disponible. Le temps ainsi perdu, après les heures de travail ou lors des temps de congé, a été un moyen de pression sur les populations, créant un climat d’incertitude, de convoitise et de violente hostilité entre citoyens.
Autre moyen parmi les plus efficaces de la « terreur douce » : le logement. Avec le pouvoir, la nomenklatura du parti-Etat s’est emparée des palais, des villas et des appartements des anciennes élites mises en état d’arrestation puis exterminées. Par la suite, les personnes arrêtées ont été expulsées de leur logement sans autre forme de procès ; et nombre de dénonciations n’ont été motivées que par le désir du délateur de s’emparer du logement de sa victime.
Quant au citoyen ordinaire, il était contraint de vivre dans des conditions de logement désastreuses – cabanes, caves, baraques. S’il avait la chance d’habiter un appartement, il devait le partager avec plusieurs familles dans des conditions de promiscuité qui favorisaient jalousies, agressivité, conflits et délation, et contribuaient à la dissolution des solidarités naturelles de voisinage.
Autre forme de « terreur douce », celle qui a touché à l’espace et au paysage, afin de détruire certains des symboles les plus marquants de la société « bourgeoise » ou « féodale ». Dès les années 1930, Staline avait (p.204) ordonné la destruction de milliers d’églises, allant jusqu’à faire dynamiter la cathédrale orthodoxe de Moscou.
(p.204) Cette « terreur douce » pouvait aller jusqu’à chercher à modifier totalement le cadre de vie des populations pour mieux les contrôler. En Roumanie dans les années 1980, Ceausescu a imposé la « villagisation », obligeant les paysans à quitter leur ferme pour s’installer dans des sortes de HLM. En Chine aujourd’hui le pouvoir cherche à imposer par tous les moyens l’urbanisation forcée, et donc la sédentarisation, de plus de 700 000 bergers tibétains des hauts plateaux, sous prétexte de les « civiliser ».
La « terreur douce » s’impose jusque dans les domaines les plus intimes. En Roumanie à partir de 1966, Ceausescu a exigé, pour raisons « patriotiques », que les femmes aient plusieurs enfants. Il a donc interdit la contraception et l’avortement, et les femmes en âge de procréer ont été placées sous surveillance gyné- ^ cologique forcée. Cette politique a provoqué d’innom- ( brables avortements illégaux et l’abandon de dizaines de milliers d’enfants regroupés dans de tristes orpheli- / nats d’Etat. En outre, les femmes qui, à la suite d’un avortement, étaient contraintes d’aller se faire soigner à l’hôpital, ne recevaient de soins qu’à condition de
(p.205) dénoncer aux agents de la Securitate, la police politique, le nom de leurs « complices ». Le film du jeune réalisateur roumain, Christian Mungiu, 4 mois, 3 semaines,
2 jours – palme d’or du festival de Cannes 2007 – est le récit du traumatisme provoqué chez une jeune femme par un avortement sous l’ère Ceausescu, et témoigne des cicatrices que, vingt ans après, cette pratique inhumaine a laissées dans la société roumaine.
En Chine, la politique de l’enfant unique continue de provoquer de violentes réactions des populations face aux méthodes inquisitoriales, voire terroristes, des services du « planning familial ».
Si le pouvoir terrorisait en s’immisçant dans la part la plus intime de chaque individu, il s’attaquait également à la société tout entière avec un moyen d’une simplicité biblique : il fermait hermétiquement ses frontières, non pas pour empêcher l’invasion de quelques intrus, mais pour interdire à ses citoyens de fuir « le paradis des travailleurs ». Les passeports permettant de voyager en dehors du « camp socialiste » n’étaient distribués qu’au compte-gouttes et à des personnes ayant donné toutes les garanties – qu’elles fussent des membres de la nomenklatura ou que le pouvoir détînt des gages (famille gardée en « otage » ou engagement signé avec la police politique).
(p.206) Et ce n’est pas par hasard si, dans les régimes communistes, la statistique des suicides était un secret bien gardé.
Des élites de « type nouveau »
(p.215) Et cette élite de type nouveau était mondiale ; en furent membres la plupart des dirigeants historiques des partis communistes : en France, Thorez, Duclos, Marty, Frachon, Jean Jérome, etc. ; en Europe, le Bulgare Georges Dimitrov, l’Italien Palmiro Togliatti, l’Espagnole Dolorès Ibarruri, le Tchèque Klement Gottwald, le Hongrois Matyas Rakosi, la Roumaine Ana Pauker, le Yougoslave Tito, l’Allemand Walter Ulbricht, etc. ; et dans le monde, l’Indochinois Hô Chi Minh, le Chinois Chou En lai, l’Américain Earl Browder.
(p.216) Le Komintem était dirigé par un Comité exécutif, composé en 1935 de dix secrétaires à la tête de différents secrétariats, commissions et départements, soit d’ordre géographique, par pays ou groupe de pays – par exemple, le Secrétariat latin comprenait les pays européens de langue latine (France, Italie, Espagne, Portugal, Suisse romande, Belgique et colonies françaises, belges et portugaises) -, soit d’ordre fonctionnel – (…).
(p.232) La conquête puis le maintien au pouvoir des mouvements totalitaires reposent sur deux moyens complémentaires : la séduction – à travers la propagande, les mobilisations de masse, le culte du chef, l’enthousiasme organisé, la fascination de la force procurée par une discipline absolue et les privilèges accordés aux partisans du pouvoir – et la répression des opposants, voire des indifférents, qui peut aller de la simple stigmatisation et marginalisation d’individus ou de groupes sociaux, jusqu’à la terreur de masse, aux crimes contre l’humanité et aux génocides – de race ou de classe -, en passant par la « pédagogie infernale » des procès truqués et l’enfermement de peuples entiers dans des frontières infranchissables.
(p.237) Après son triple échec de 1948 – celui du blocus de Berlin, de la dissidence représentée par Tito, puis de la défaite des communistes dans la guerre civile grecque -, Staline comprit que l’expansion du système communiste était provisoirement contrariée en Europe par une présence de plus en plus active des Américains.
(p.276) Rappelons que les auteurs les plus sérieux ont avancé des chiffres bien supérieurs aux nôtres : Conquest 40 millions de morts, Volkogonov 35 millions, Panine 60 millions, Soljénitsyne 66 millions, Kourganov 66 millions. Un complément de cinq millions de victimes est donc extrêmement raisonnable.
En ce qui concerne les chiffres pour l’Europe de l’Est – à l’exception de la Pologne -, les investigations les plus récentes dans tous ces pays indiquent des chiffres à la hausse ; nous avons fortement sous-estimé les crimes du régime de Tito, que ce soit en Bosnie, en Slovénie ou à Trieste ; dans ces deux dernières régions, des fosses communes sont régulièrement mises à jour. Pour la RDA, nous avons ignoré la période où cette partie de l’Allemagne était une zone d’occupation où l’Armée rouge et le NKVD ont pratiqué une répression massive portant (p.277) sur des dizaines de milliers de victimes. (Puis en Pologne de septembre 1929 à juin 1941: 130.000 plus des centaines de milliers de déportés polonais qui n’ont jamais rejoint la Pologne ou sont décédés en déportation.)
Au total, ces estimations (…) approchent le million pour l’ensemble de l’Europe de l’Est.
(p.275) On n’a jamais vu des repentis du nazisme, d’anciens militants nazis qui critiquaient ou tentaient de réformer le système de l’intérieur. Le nazisme, au contraire, c’est l’adéquation totale de la doctrine et de la réalité. Le communisme c’est le décalage entre la doctrine et la réalité37. » (Nicolas Werth)
(p.275) Qu’il y ait eu des déçus du bolchevisme au pouvoir, c’est indéniable, mais cela prouve seulement qu’ils n’avaient pas bien saisi la nature du parti dans lequel ils militaient ; peut-être porteurs d’un idéal humaniste, ils se sont aperçus trop tard qu’ils s’étaient trompés de parti. Quant à affirmer qu’il n’y a pas eu de déçus du nazisme, les faits sont trop nombreux qui le contredisent, (p.276) à commencer par les crises ouvertes ou secrètes – ponctuées de crimes – qui ont secoué ce régime depuis la Nuit des longs couteaux jusqu’aux dernières années, Himmler lui-même devenant un opposant à la ligne hitlérienne, en passant par le Front noir antihitlérien des frères Strasser actif jusqu’en 1939. Et on ne dispose pas sur Lénine ou sur Staline d’un témoignage et d’une réflexion de la qualité de ceux du « repenti nazi » Hermann Rauschning et de ses deux livres – Hitler m’a dit et La Révolution du nihilisme -, écrits avant la guerre mais alors que leur auteur était déjà sorti de l’univers nazi. Trotski, lui, n’est pas sorti de l’univers bolchevique quand il écrit sur la révolution d’Octobre ou sur l’URSS stalinienne. Souvarine lui-même, dans son Staline de 1935, reste encore attaché à l’image mythique de Lénine.
(p.283) L’expropriation, la concentration – ou mise en camps de concentration – et la déportation ont été pratiquées par le régime bolchevique dès ses premières années. Les « opérations mobiles de tuerie », symbolisées du côté nazi par l’action des Einsatzgruppen, sont apparues dans le système communiste dès les années 1930 : la purge et ses quotas – les 700 000 assassinés de 1937-1938 -, et la liquidation des élites dans les pays occupés – par exemple les 25 700 Polonais promis à l’exécution par ordre du Bureau politique du 5 mars 1940, dont les 4 400 officiers de Katyn. Comme la Tcheka des années de guerre civile, puis comme le NKVD, les Einsatzgruppen ont exterminé par balle et de manière artisanale plus d’un million de Juifs des territoires soviétiques occupés.
(…). (p.284) Les régimes communistes aussi ont connu des centres de mise à mort. La Loubianka, en plein centre de Moscou, en fut un où ont péri des milliers de personnes. La prison de Tuol Sleng à Pnomh Penh a vu entrer plus de 15 000 prisonniers : presque aucun n’en est sorti vivant. La forêt de Katyn a été un centre de mise à mort, celles de Vinnitsa et de Kouropatki également. Et nous ne sommes qu’au début de la découverte de ces fosses communes gigantesques qui étaient le réceptacle de centres de mise à mort voisins. La différence principale tient à ce que ces mises à mort n’étaient pas industrielles – par les gaz – mais « traditionnelles », par balle, et que les corps n’étaient pas brûlés (ce qui a permis aux nazis de faire disparaître l’essentiel des traces). Je ne suivrai donc pas plus Marc Lazar quand il écrit que « le génocide de race aboutit à l’établissement de camps d’extermination, et pas le génocide de classe50 ». Staline et Pol Pot ont prouvé qu’il n’y avait pas besoin de camps spécialisés pour exterminer y compris des populations de plusieurs millions de personnes.
En ce qui concerne la famine, rappelons que des centaines de milliers de Juifs sont morts de faim – de froid et de maladie, ce qui en général va de pair – dans les grands ghettos de l’Est, mort provoquée par une politique délibérée de restriction de plus en plus drastique des ressources alimentaires. Là encore, les communistes ont été les premiers à pratiquer cette méthode, et de la même manière. En 1933, les paysans ukrainiens qui fuyaient leurs villages pour trouver secours en ville étaient impitoyablement ramassés par la milice et le NKVD et ramenés nuitamment dans les régions de famine. Dix ans plus tard, les nazis n’ont pas opéré autrement : ils ont concentré dans le ghetto de Varsovie plus de 500 000 Juifs et ont empêché quiconque d’y entrer ou d’en sortir, sous peine de mort. Simplement, Staline s’attaquait à une population paysanne nettement (p.285) localisée qu’il n’avait pas besoin de chercher aux quatre coins de l’Union soviétique, il suffisait d’affamer à mort les habitants sur leurs lieux mêmes d’habitation. En dehors des territoires soviétiques occupés, où ils assassinaient sur place, les nazis ont décidé d’aller chercher les Juifs là où ils étaient, dans toute l’Europe ; et ce pour une raison fondamentale : l’extermination des Juifs devait rester secrète, on ne pouvait donc les assassiner au vu et au su de tous en France, en Belgique, en Hollande etc. Il était indispensable de les emmener dans des lieux de tuerie cachés et secrets.
(p.288) Reste enfin un point de différenciation en apparence irréductible entre nazisme et communisme. Marc Lazar, mais aussi Nicolas Werth et Jean-Louis Margolin, pour ne citer qu’eux, soulignent que le contenu des deux idéologies est radicalement différent : l’une serait fondamentalement raciste et inégalitaire, alors que l’autre serait liée à la pensée égalitaire – « le bonheur pour tous » disait Babeuf – et universaliste issue de la Révolution française, point de vue qui est aussi celui de François Furet. Marc Lazar illustre sa position d’une citation de Primo Levi qui écrit : « Ces deux enfers ne poursuivaient pas le même but. Le premier était un massacre entre égaux : il ne se fondait pas sur une prééminence raciale, il ne divisait pas l’humanité en surhommes et en sous-hommes56. » Comment un homme aussi sensibilisé à la tragédie du xxe siècle a-t-il pu écrire cette phrase ? Comment croire que Staline considérait comme ses égaux les 700 000 personnes qu’il envoya, pour beaucoup nommément, à la mort en 1937-1938 ? Comment croire qu’il considérait comme ses égaux les millions de paysans ukrainiens condamnés à mourir de faim en 1932-1933 ? Pour Staline, ces hommes ne méritaient pas de vivre. Certes, il n’utilisait pas le terme de « sous-homme », mais il en utilisait d’autres dont la signification ne doit pas tromper : « bourgeois », « koulak », « contre-révolutionnaire », « bandit trotskiste », « espion japonais », etc. Ce que Pierre Hassner appelle « l’ennemi total »S7 demeure la figure centrale, aussi bien pour les nazis que pour les communistes. D’ailleurs, n’est-ce pas Boukharine, ce prétendu humaniste, qui en 1925, dans sa polémique contre Karl Kautsky, après avoir décrété que ce dernier n’avait « dans son encrier que de la bave de chien enragé », concluait logiquement : « Quelle déchéance, même pour un renégat ! Et pourtant, Kautsky fut autrefois un homme58.» «Autrefois»… S’il ne l’est plus, qu’est-il donc ? (p.289) Une bête ? Un parasite ? Un vivant déjà mort et qui, par conséquent doit être assassiné afin de faire coïncider sa mort clinique avec sa mort politique proclamée ? Comme Trotski ? Comme Boukharine lui-même en 1938 ?
(p.289) Derrière cette fausse dissymétrie de l’universel et du particulier, se cachent les véritables rapprochements idéologiques : le rejet radical de la société moderne – avec son individu, son Etat de droit, sa démocratie représentative, sa liberté d’entreprendre dans tous les domaines -, le projet utopique, le scientisme qui fonde la nécessité historique ou biologique de réaliser le projet,(p.290) la désignation de la figure de l’ennemi qui fait obstacle à la réalisation du projet et la légitimité de l’utilisation de la violence ; et tout cela au nom du bonheur des « Germains » ou de « l’Humanité ». Il faudra d’ailleurs revenir de manière beaucoup plus approfondie sur certains textes « racistes » et « extermination nistes » chez les pères du communisme, Marx et Engels, comme viennent de s’y employer Konrad Loew60 ou George Watson61. Et il y avait bien dans le marxisme- léninisme un projet exterminationniste à l’encontre de i la « bourgeoisie » et de toute la « vieille société ».
(p.291) Cependant, même si l’on admettait le point de vue d’un « bon idéal communiste », resterait la question de Jacques Julliard : « En quoi des criminels se réclamant du bien sont-ils moins condamnables que des criminels se réclamant du mal63 ? » Question qu’Alain de Benoist précise : « Le raisonnement qui consiste à opposer la “doctrine de haine” du nazisme à l’“idéal d’émancipation humaine” du communisme est parfaitement biaisé. Il revient à opposer une définition du communisme donnée par ses partisans à une définition du nazisme donnée par ses adversaires. […] Le nazisme, en réalité, ne prétendait pas moins que le communisme faire le “bonheur” de ceux auxquels il s’adressait. Il ne proposait pas moins de perspectives “radieuses” à ses partisans64. » Et de conclure : « On ne peut faire comme si le jugement que nous portons sur le nazisme correspondait à celui qu’il portait sur lui-même. Sinon, nous pourrions tout aussi bien dire que le communisme se réclamait, non pas du bien mais du mal, à proportion de l’horreur que peuvent nous inspirer ses idées65. »
(p.292) En août 1941, Heydrich se vit refuser par Hitler un plan de déportation vers l’Est des Juifs du Reich. Et encore en octobre et novembre 1941, les nazis déportèrent des dizaines de milliers de Juifs allemands vers l’Est (Lodz, Minsk) mais sans les assassiner. Le 30 novembre, mille Juifs de Berlin, déportés à Riga, furent fusillés, ce qui provoqua une forte réaction de Himmler exigeant l’arrêt de ces massacres ; ces Juifs furent alors parqués dans des camps improvisés où ils moururent rapidement de faim, de froid et de maladie, exactement comme des dizaines de milliers de koulaks sont morts (p.293) dans l’improvisation des premières grandes vagues de déportation soviétiques en 1930-1931. Dans le système nazi, comme dans le système communiste, encore en 1941, déportation n’implique pas nécessairement extermination.
(…) Cette décision ne semble donc nullement être la réponse à une pulsion non raisonnée, mais être la conséquence logique de la rencontre entre une doctrine politico-idéologique, une nouvelle conjoncture et le constat d’un rapport de forces. Dans son discours au Reichstag du 30 janvier 1939, Hitler avait déclaré : « Si la juiverie financière internationale devait réussir dans et hors d’Europe à propulser encore une fois les peuples dans une guerre mondiale, alors le résultat ne serait pas la bolchevisation de la terre et, par là, la victoire du judaïsme, mais bien l’anéantissement de la race juive en Europe. » Or l’entrée en guerre des Etats-Unis et du Japon est le signe indubitable que l’Allemagne est impliquée dans une guerre désormais mondiale. Par ailleurs, litler doit se rendre à l’évidence : l’ennemi bolchevique st plus puissant que prévu et devient plus dangereux ncore en raison de sa contre-offensive. Eu égard à sa vision du monde, anticommuniste et antisémite, la (p.294) décision de Hitler apparaît donc comme parfaitement rationnelle : la « lutte finale » est engagée, c’est une lutte à mort et il a l’opportunité d’exterminer l’un de ses ennemis qui est à sa merci, le Juif. Staline a-t-il raisonné autrement dans sa grande bataille de la collectivisation dont la phase terroriste a duré de 1929 à 1933, et au cours de laquelle il a connu des revers avant de se décider à appliquer ce que l’on pourrait appeler la « solution finale » de la question paysanne en URSS ?
(p.297) A travers leurs discours, Hitler comme Staline se sont placés dans des logiques exterminatrices – que nous appelons aujourd’hui génocidaires -, annonçant publiquement leur volonté d’éliminer des catégories d’ennemis nommément désignées. C’est sur cette base et au gré des circonstances, qu’ils ont glissé d’une logique à des intentions plus précises avant de passer à l’acte.
(p.300) On ne peut comprendre la singularité de la Shoah qu’en référence à la singularité du Sinaï. Sur ce fond culturel, le nazisme se présente comme un reniement, comme une négation des Commandements. » La négation radicale de l’idée de Dieu me semble en effet à la base de la démarche tant nazie que marxiste-léniniste. En dernière analyse, elle seule peut expliquer le comportement d’hommes qui croyaient, par un effet de leur volonté, pouvoir dominer la nature et l’histoire, et qui donc se croyaient délivrés de toute contrainte pour atteindre leurs objectifs. Et, comme Alain Besançon l’a démontré, c’est sans doute au niveau théologique que l’on pourra enfin parler avec pertinence de la « singularité de la Shoa ». Et que les esprits forts ne sourient pas : nolens volens, ils sont eux aussi soumis à ces Commandements de la culture judéo-chrétienne qui sont aussi les fondements moraux de la démocratie.
(p.304) (…) l’impossibilité pratique d’organiser un Nuremberg du communisme n’invalide en rien l’idée qu’un tel procès eût été légitime, eu égard à la nature et à l’ampleur des crimes commis.
(p.305) (…) la réflexion générale sur les crimes du communisme ne pourra pas échapper à une phase de définition claire des victimes et des bourreaux. En effet, un discours dominant imposé par la puissance du système communiste mondial a longtemps fait passer les victimes (du communisme) pour les bourreaux (contre- révolutionnaires), et les bourreaux (communistes) pour les victimes (de la contre-révolution).
(p.309) Qu’est-ce que le communisme ?
Le communisme, compris comme société égalitaire et harmonieuse, a d’abord existé en tant que philosophie sociale et politique très ancienne, remontant même à Platon, et a ouvert le champ à d’innombrables utopies qui considéraient souvent l’abolition de la propriété privée des moyens de production, mais aussi des biens personnels, comme la clé du bonheur et de la fraternité.
(p.313) La tragédie communiste peut s’apprécier à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, le désastre a été général ; l’ex-URSS, l’un des pays les plus riches en matières premières, a connu le fiasco que l’on sait et dont les (p.314)
conséquences continuent et continueront encore longtemps de peser sur les populations4. Les pays de l’Est ont pris, après 1945, un retard très net sur l’Europe occidentale, avec parfois des conséquences dramatiques, comme pour l’Albanie qui a sombré dans l’anarchie et le règne généralisé des mafias, ou la Roumanie où les communistes ont été de fait au pouvoir jusqu’en 1996 et ont ruiné l’économie. Plusieurs d’entre eux font un effort important pour accéder à l’Union européenne mais sont malheureusement encore loin du compte : le temps perdu ne se rattrapera pas en quelques années.
Le communisme a laissé le Cambodge, la Corée du Nord et l’Ethiopie exsangues. Le Vietnam et Cuba sont en situation de faillite permanente. Quant à la Chine, elle doit faire face à la reconversion d’une production entièrement administrée en une économie de marché, à un gigantesque chômage et aux explosions sociales qui s’ensuivent.
Le désastre a été également culturel avec la fermeture au monde pendant des décennies, l’abrutissement inévitable, conséquence du matraquage idéologique, la répression systématique d’une intelligentsia, d’une presse, d’éditions libres. A cela s’ajoute la destruction de civilisations, à travers le saccage systématique des églises en ex-URSS, des objets d’art en Chine au temps de la Révolution nommée par antiphrase « culturelle », d’ensembles architecturaux d’une valeur historique et esthétique inestimable dans la Roumanie de Ceausescu et, aujourd’hui encore, l’annihilation de la civilisation tibétaine par les Chinois.
Sans oublier les catastrophes écologiques telles celle de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 et celle de l’assèchement de la mer d’Aral lié aux travaux d’irrigation massive en ex-URSS.
Cependant, ces désastres ne sont que la toile de fond sur laquelle se déploie la tragédie humaine. D’abord (p.315)
celle de l’exil, largement oubliée parce que cachée et silencieuse. Dès 1920, Berlin comptait plusieurs centaines de milliers de Russes dits « blancs », en fait contraints de fuir la révolution pour échapper au châtiment réservé aux aristocrates, aux bourgeois et autres « contre-révolutionnaires ». Depuis des décennies, on a vu les boat people tenter de s’enfuir du Vietnam, puis les balseros de Cuba ; plus de 190 Allemands ont été tués en essayant de franchir le mur de Berlin. Des dizaines de milliers de ces fuyards ont été repris ou ont perdu la vie dans leur tentative. De même, les Européens de l’Est, les Baltes et les Ukrainiens constituent en Europe occidentale et aux Amériques une considérable diaspora.
Ensuite, celle de la mort. Le communisme au pouvoir a en effet prémédité et organisé le massacre de millions d’individus, selon trois modalités principales.
1 ) L’exécution pure et simple
Au moment de la prise du pouvoir et dans la période d’installation du régime – soit parfois pendant plusieurs dizaines d’années, comme en URSS -, les communistes ont instauré la terreur à la fois comme moyen immédiat de conserver leur mainmise sur le pays et comme solution à plus long terme pour promouvoir la révolution communiste, en exterminant tous ceux qui pouvaient constituer un pôle de résistance, si minime soit-il.
Furent ainsi liquidés les militaires, les policiers, les juges, les grands propriétaires, les industriels, les prêtres, les intellectuels. Parmi les massacres les plus significatifs, notons celui de la famille impériale des Romanov sur ordre de Lénine le 16 juillet 1918, celui des 50 000 soldats blancs faits prisonniers en Crimée en 1920, celui des dizaines de milliers de paysans révoltés traités aux gaz de combat par l’Armée rouge dans la (p.316) région de Tambov en 1920, celui des 700 000 personnes exécutées durant la Grande Terreur soviétique en 1937- 1938 – y compris sur la base de listes visées personnellement par Staline et d’autres dirigeants soviétiques-, des 25 700 responsables polonais assassinés sur ordre du Bureau politique du PC soviétique en date du 5 mars 1940 – parmi lesquels les 4 400 officiers de Katyn -, en Chine l’assassinat systématique des propriétaires fonciers au cours d’abominables séances collectives dans les villages ; ou encore la liquidation systématique dans le Cambodge de Pol Pot de tous ceux qui portaient lunettes et stylo, soupçonnés d’être des intellectuels, donc irrécupérables.
Et aussi en Slovénie, la liquidation par les partisans de Tito de 15 000 hommes, femmes, enfants et vieillards, réfugiés dans la zone d’occupation des Britanniques en Autriche et « rendus » à leur allié, et dont on a découvert les fosses communes à l’été 1999. La liste de ces crimes est infinie et commence seulement à être dressée de manière rigoureuse.
2) La déportation et l’enfermement en camp de travail forcé
La déportation de masse – arracher des populations entières à leur lieu d’origine, leur mode de vie, leurs coutumes – a été inaugurée par les communistes soviétiques lors de la collectivisation forcée de 1929-1932, et appliquée à certains peuples du Caucase, dont les Tchétchènes, en 1943-1944. Elle a été utilisée à nouveau de manière spectaculaire par Pol Pot qui, en quelques jours, a vidé les villes cambodgiennes de leur population pour les « rééduquer » par le travail manuel à la campagne – il ne faisait que copier la méthode maoïste de rééducation des intellectuels et des jeunes urbains, appliquée lors de la Révolution culturelle.
(p.317) Dans les premiers camps de concentration soviétiques, créés à l’été 1918, une forte majorité des détenus, souvent des otages, étaient condamnés à une mort rapide, tout comme dans le bagne des îles Solovki (monastères de la mer Blanche qui furent les premiers bagnes de déportation créés par les bolcheviks) ou, en 1920, dans les camps d’internement des Cosaques du Don, qualifiés par le gouvernement lui-même de « camps de la mort ».
A partir de 1928-1929, le régime soviétique invente le Goulag, qui sera généralisé à l’ensemble des régimes communistes, les experts du KGB poussant même la sollicitude jusqu’à former leurs collègues chinois à l’encadrement de ce système concentrationnaire après 1949.
Officiellement, le Goulag est un système de rééducation par le travail. En réalité, c’est un système de destruction psychologique et physique des individus. Le caractère sauvage de cet univers est aggravé par le fait que, s’ils se trouvent bien sous l’autorité de la police politique, les camps sont en fait gérés au quotidien par des condamnés de droit commun qui y font régner une seconde terreur. Dans les camps chinois et vietnamiens, le travail de rééducation était pris au sérieux et aboutissait à un véritable « lavage de cerveau » bien décrit par le témoignage de Jean Pasqualini5.
En Roumanie, le pouvoir avait entre 1949 et 1952 inventé une méthode encore plus inhumaine, si possible : dans la prison de Pitesti, un grand nombre d’étudiants, en général nationalistes et chrétiens, ont été impliqués dans un processus de rééducation de groupe où chacun était contraint, lors de séances collectives, de torturer les autres, afin de les obliger à « se démasquer », en dénonçant leurs proches et en « avouant » leurs propres « fautes » évidemment imaginaires (viol de leur sœur, relations incestueuses avec leur mère, etc.)6.
(p.318) Une méthode assez proche fut pratiquée dans la prison centrale de Phnom Penh, Tuol Sleng, où 15 000 prisonniers furent contraints sous la torture de rédiger des autobiographies où ils « avouaient » nombre de crimes imaginaires au nom desquels ils étaient condamnés : pas un n’en est sorti vivant.
3) La famine
Le monopole de la production et de la distribution de la nourriture a été, dès l’origine, un moyen puissant mis en œuvre par le pouvoir communiste pour contrôler et réprimer les populations. Dès septembre 1917, avant même la prise du pouvoir, Lénine avait vanté les mérites du rationnement du ravitaillement, à appliquer selon le slogan « Qui ne travaille pas ne mange pas » – passablement inquiétant dans un régime où c’est le pouvoir qui attribue les emplois…
Ce contrôle absolu des approvisionnements a été commun à tous les régimes communistes car étroitement lié au dogme de la collectivisation des moyens de production, dont la terre était le principal dans des pays encore largement agraires comme la Russie de 1917 ou la Chine de 1949. Il a à plusieurs reprises abouti à la famine, avec cette caractéristique extraordinaire que, sauf exception (au Cambodge), ce sont les populations paysannes, productrices de la nourriture, qui en ont été les victimes.
Il est arrivé que ces famines soient aussi le résultat d’une politique aberrante du pouvoir communiste, comme en URSS en 1921 ou en Chine en 1959-1961. L’homicide n’est pas, alors, volontaire, mais il laisse indifférent un pouvoir qui, souvent, ne tient pas à demander à l’étranger une aide susceptible de révéler la tragédie et de contredire l’image radieuse que diffuse la propagande. C’est ce qui s’est passé lors de la terrible (p.319) famine chinoise provoquée par le Grand Bond en avant, et aussi ces dernières années en Corée du Nord où des dizaines de milliers de personnes, en particulier des enfants, sont morts de sous-alimentation.
Il est arrivé enfin que la faim soit utilisée comme une arme contre des populations rebelles ou soupçonnées de l’être. Cette famine programmée peut être assimilée à un génocide, tuant en priorité les enfants, les malades et les vieillards, comme en Ukraine en 1932-1933 (4 à 5 millions de morts de faim en dix mois), ou au Cambodge (environ 800 000 morts de faim en trois ans, entre 1975 et 1978). Volontaires ou fruits de politiques absurdes, ces famines fournissent la grande majorité des victimes du communisme : 10 à 12 millions de morts en URSS, 30 à 40 millions au moins en Chine, 800 000 au Cambodge…
Si l’on additionne les victimes provoquées directement, sous tous ces régimes (l’URSS, la Chine, le Cambodge, la Corée du Nord, l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Afghanistan et le Vietnam), par les exécutions, la déportation, le travail forcé et les famines – et sans compter les morts de la guerre -, le total avoisine les 100 millions, même si les chiffres font encore l’objet de débats et de recherches7.
(p.320) Qui étaient les bourreaux ?
Ces pratiques criminelles n’ont pu se développer que dans certaines conditions. La première est la croyance idéologique : au nom du « sens de l’histoire » et de la « nécessité historique », les chefs communistes se sont crus autorisés à tuer des personnes désignées comme 1’« ennemi ». C’est ce fanatisme idéologique qui, chez des individus ayant bénéficié d’une éducation familiale, d’une formation intellectuelle bien au-dessus de la moyenne, comme Lénine ou Trotski, a provoqué la levée des interdits moraux élémentaires au nom d’une « autre morale », celle de la nécessité révolutionnaire.
Trotski, l’un des leaders bolcheviques les plus frottés au socialisme européen des grandes capitales comme Berlin, Vienne ou Paris, ne s’est pas détaché de cet ancrage fondamental : il titra l’un de ses derniers ouvrages, publié en 1939, Leur morale et la nôtre, opposant la morale « bourgeoise » à la morale « prolétarienne », revendiquant le principe que la fin justifie les moyens et confirmant, à vingt ans de distance, ses appels à la guerre civile8.
La seconde motivation des pratiques criminelles, beaucoup plus triviale, a été la crainte, chez ces révolutionnaires, de perdre le pouvoir qui, bien souvent, leur était échu comme une « divine surprise ». Ce qui aurait été à la fois perdre le moyen d’expérimenter la théorie – appliquer la « dictature du prolétariat », mettre en œuvre le collectivisme dans l’industrie et l’agriculture -, mais aussi abandonner les avantages et privilèges bien réels d’un pouvoir absolu.
Le messianique et le trivial se sont donc conjugués pour nourrir le fanatisme, interdire tout retour en arrière et alimenter la radicalisation des régimes. En 1918, Lénine préféra brûler ses vaisseaux plutôt (p.321) qu’admettre qu’il s’était trompé. Il dispersa l’Assemblée constituante – la première assemblée élue au suffrage universel dans l’histoire russe -, fit massacrer les manifestants qui la soutenaient, abandonna la Russie occidentale aux Empires centraux, provoqua la ruine de toute l’industrie, suscita la révolte d’une grande partie de la paysannerie, plutôt que de reconnaître qu’il avait fourvoyé le pays.
En 1929, Staline préféra déclencher une véritable guerre contre les paysans – la collectivisation forcée avec son cortège de tragédies – plutôt que d’admettre que le système n’était pas viable.
En 1958, Mao lança le Grand Bond en avant qui, vaticinait-il, allait permettre à la Chine de rejoindre les pays occidentaux en dix ans, provoquant un désastre économique qu’il refusa de reconnaître et qui entraîna la grande famine. Ce qui n’empêcha pas Pol Pot, quinze ans plus tard, de considérer que le Cambodge pouvait en une nuit passer au communisme : on sait la catastrophe que cela produisit.
Cette mégalomanie paranoïaque des dirigeants relève moins, à notre sens, d’un dérèglement psychologique que de l’adoption d’une philosophie strictement matérialiste et historiciste, selon laquelle les masses ne sont qu’une pâte que l’on peut travailler à volonté. Mais qui ! étaient les bourreaux ordinaires du communisme ?
On commence seulement, grâce à l’ouverture des *7 archives, à mieux les connaître : des hommes jeunes, issus du peuple, sélectionnés et recrutés pour leur fidélité à un système où l’organisation du crime de masse était un élément de la carrière dans un corps, la police politique, considéré comme particulièrement prestigieux, j
Dans un tel contexte, où la chasse aux « ennemis du peuple » était une tâche d’« honneur », il était inévitable que la machine répressive s’emballe, soit que l’on assiste à toutes sortes de règlements de comptes personnels, (p.322) soit que des « stakhanovistes » de la terreur exigent que le pouvoir leur accorde des quotas supplémentaires de fusillades afin de montrer leur zèle, comme ce fut le cas en URSS dans les années 1930.
Mais, souvent, c’est l’impéritie et le mépris de la vie qui, du sommet à la base, étaient responsables de catastrophes humaines ; ainsi, en URSS, lors des grandes vagues de déportation, il n’était pas rare que des milliers de personnes soient abandonnées en pleine nature, taïga de Sibérie ou steppes du Kazakhstan, où elles mourraient à petit feu. Parfois, comme dans le cas des convois des 29 et 30 avril 1933, des déportés, débarqués sur l’île de Nazino, ont été contraints de pratiquer le cannibalisme pour survivre ; sur 6 700, 2 200 seulement étaient encore en vie trois mois plus tard.
Le système de délation généralisé était lui-même un facteur d’emballement : ne pas dénoncer un ennemi du peuple vous désignait comme ennemi du peuple, et tenter d’échapper à la purge impliquait que l’on devienne un délateur. Cependant, la pratique des « aveux », l’irruption des Grands Procès truqués, le phénomène récurrent de la purge, ne concernaient principalement que les cadres du parti et du régime. Or, la très grande majorité des victimes n’appartenait pas à cette sphère du pouvoir, mais au petit peuple, ouvrier et paysan.
Enfin, les emballements ponctuels de la machine ne doivent pas nous faire oublier que celle-ci était étroitement contrôlée et dirigée par les chefs du parti communiste. Tous les dirigeants des services de sécurité leur obéissaient : Dzerjinski à Lénine, Iagoda, Iejov et Beria à Staline, Kang Sheng à Mao et Duch à Pol Pot. Les chefs du parti donnaient l’impulsion des grandes vagues de répression ou des purges et souvent les diri geaient dans le détail, approuvant les listes de victimes
(p.323) précisant les modalités d’exécution, vérifiant les résultats.
Peut-on comparer les crimes communistes et les crimes nazis ?
Le crime de masse, en ce XXe siècle, n’aura pas été l’apanage des pouvoirs communistes. Dès 1915, les Jeunes Turcs avaient montré la voie avec le génocide des Arméniens. On a connu plus récemment des massacres de grande ampleur et de même type en Indonésie, en 1966 et plus récemment, où un fanatisme musulman a dressé des populations pauvres contre la communauté chinoise commerçante, au prétexte qu’elle serait communiste, faisant plus de 600 000 morts. Au Rwanda où l’ethnie hutu a cru le moment venu d’en finir avec son étemelle rivale tutsi, faisant là aussi plus . de 700 000 morts.
(…) Si les crimes communistes peuvent se comparer aux crimes nazis, tant par leur ampleur que par leur férocité, certains observateurs estiment que la comparaison s’arrête là, le nazisme se distinguant du communisme (p.324) sur deux points essentiels : le caractère racial du crime, et sa méthode industrielle.
Or, l’assassinat industriel, dont le camp d’Auschwitz est devenu emblématique, s’il frappe les imaginations et s’il est extraordinairement symbolique, ne recouvre qu’en partie la réalité ; le système sélection/gazage/ crémation a été inventé pour exterminer d’abord plus de 70 000 Allemands « aryens » (malades mentaux et vieillards) entre l’automne 1939 et le printemps 1941. Les chambres à gaz n’ont commencé à fonctionner pour les Juifs qu’à partir du début 1942 ; jusque-là, les nazis avaient massacré au revolver, au fusil et à la mitrailleuse, sans oublier la faim, le froid et la maladie dans les ghettos – toutes méthodes pratiquées depuis déjà plus de deux décennies par les communistes L soviétiques.
L’ensemble des Juifs de l’ex-URSS occupée exterminés par les nazis le furent par ces méthodes qui, pour être « artisanales », n’en étaient pas moins terriblement meurtrières. Dans le Cambodge de Pol Pot, bon nombre de victimes furent tuées d’un simple coup de bâton ou de pelle derrière la tête. Et la déportation massive par train était déjà pratiquées par Staline depuis 1930 dans le cadre de 1’« extermination des koulaks en tant que classe ».
L’utilisation de la chambre à gaz pour l’extermination systématique des Juifs et des Tziganes à partir de 1942 n’a pas d’équivalent dans l’histoire. Mais elle ne suffit pas, à mon sens, à faire de ce génocide un événement qui interdit toute comparaison avec les autres génocides ou crimes de masse. Les observateurs opposés à la comparaison avancent alors un argument de plus de poids : les crimes de Hitler, par leur caractère racial, et en particulier par la fixation homicide sur les Juifs, sont le fait d’un malade mental et ne relèvent d’aucune justification rationnelle.
(p.325) A l’inverse, les crimes commis par Lénine, Trotski, Staline et les autres répondraient à la logique d’une lutte politique pour la mise en œuvre et la défense d’une société plus juste ; la lutte contre les « ennemis du peuple » et les « contre-révolutionnaires » serait légitime et aurait été justifiée par le combat contre le nazisme.
Cette distinction, selon moi, relève d’une erreur méthodologique et mérite d’être discutée.
L’antisémitisme n’était pas le seul moteur de Hitler : ’
l’ultra-nationalisme et la peur/haine du bolchevisme étaient chez lui au moins aussi importants et se mêlaient étroitement, comme l’indique sa hantise du « judéo-bolchevisme »9.
D’autre part, Hitler eut d’abord pour objectif de débarrasser l’Allemagne des Juifs, mais pas forcément de les exterminer. Ce n’est qu’en juin 1941 que commença le massacre systématique par les Einsatzgruppen dans l’URSS occupée, et en décembre que Hitler donna l’ordre de la « Solution finale »’°.
Quant aux bolcheviks, s’ils ont dès leurs premières semaines de pouvoir prétendu que la terreur n’était qu’une action préventive et d’autodéfense contre la réaction bourgeoise, ils n’en avaient pas moins proclamé depuis 1916 la nécessité d’exterminer la bourgeoisie « en tant que classe », ce qu’ils mirent immédiatement en pratique, le terme de « bourgeoisie » étant bientôt étendu à l’ensemble de ceux qui n’accep- , taient pas leur politique.
Venons-en maintenant à l’erreur méthodologique : condamner les crimes abominables des nazis ne dispense pas d’analyser le mécanisme interne qui a amené au crime en fonction des valeurs des bourreaux.
Or, partant d’une philosophie tout aussi matérialiste que les nazis (non pas biologique et raciale, mais socio- historique), les communistes ont agi au nom des mêmes valeurs antidémocratiques, antimorales et antihumaines.
(p.326) C’est cette convergence qui a permis à de très nombreux auteurs, dès les années 1930 – citons en France Elie Halévy, Boris Souvarine ou Jacques Maritain -, d’engager une comparaison entre les deux phénomènes et de les désigner sous le terme de totalitarisme.
Il nous paraît aberrant que Hitler ait pu conclure de la défaite de novembre 1918 et des mouvements révolutionnaires de 1919 que l’Allemagne était victime d’un complot du « judéo-bolchevisme ». Mais la pensée de Staline n’est-elle pas tout aussi aberrante, quand, confronté à l’échec de l’étatisation économique, il y voit d’abord le complot des « koulaks » dont il décrète qu’ils doivent être « exterminés en tant que classe », puis le complot des « bandits hitléro-trotskistes » qui justifie la Grande Terreur ?
Ces deux systèmes de pensée et de pouvoir, nazi et communiste, plaçaient bien au centre de leur vision du monde l’image de « l’ennemi ». Un ennemi qui n’avait rien à voir avec l’adversaire politique traditionnel : un ennemi absolu, irréductible, qu’il faut exterminer pour survivre. C’est, chez Hitler, le « judéo-bolchevik » qui, après la liquidation des communistes en 1933-1934, deviendra le seul Juif ; chez Lénine et ses successeurs, le « capitaliste » ou le « koulak », bref le « bourgeois » dont la haine a été, comme l’a très bien montré François Furet, l’un des moteurs essentiels des mouvements totalitaires11.
Cinquante-cinq ans après la défaite et la disparition de Hitler, les crimes du nazisme continuent de hanter l’Europe et le monde. Neuf ans après la chute du communisme à Moscou, et alors que plus d’un milliard d’hommes continuent de vivre sous ce type de régime, les crimes du communisme semblent être tombés dans quelque poubelle de l’histoire.
Le mouvement communiste qui s’est emparé du pouvoir en novembre 1917 est mort en 1991, (p.327) mais les cornmunistes sont toujours là, reconvertis en socio- démocrates, en socio-libéraux ou en ultra-nationalistes. Aucun processus juridique sérieux n’a été engagé pour condamner les bourreaux. Viachteslav Molotov, bras droit de Staline et personnellement responsable de centaines de milliers d’assassinats, est mort tranquillement dans son lit en 1986, à l’âge de quatre-vingt-seize ans. Nikita Khrouchtchev, présenté comme le dénonciateur de Staline, fut sous les ordres de ce même Staline le bourreau de l’Ukraine – il y fut chargé de la Grande Terreur en 1938 (plus de 100 000 arrestations et exécutions en 1938 et 3 survivants sur les 200 membres du Comité central du parti communiste d’Ukraine) ; il s’attaqua ensuite aux nationalistes ukrainiens dont les dernières guérillas furent exterminées au début des années 1950.
(p.329) Le loyal bourreau de Staline: le commissaire du peuple Nicolaï Iejov
(p.333) En avril 1933, il engagea une vaste épuration des membres du parti communiste – comme cela avait d’ailleurs été fait en 1921, sous Lénine, puis en 1929 – et Iejov en fut l’un des responsables. Lors du XVIIe congrès, surnommé par Staline le « congrès des vainqueurs – les vainqueurs de la collectivisation qui avait présidé à la création du Goulag, à la déportation au travail forcé de millions de paysans et à la mort de faim de 4 à 5 millions d’entre eux dans la grande famine organisée par le pouvoir contre l’Ukraine en 1932-1933 -, Iejov connut la consécration : il fut nommé membre du Comité central, membre de l’Orgburo et chef de la commission autorisant les déplacements à l’étranger. Il était l’étoile montante dans l’entourage de Staline, celui en qui le vojd plaçait toute sa confiance.
En février 1934, Iejov participa à sa première réunion du Bureau politique, où fut décidé de réorganiser tout l’appareil de sécurité et de créer le tristement fameux Commissariat aux Affaires intérieures, le NKVD, ancêtre du KGB. Mais pendant tous ces mois, Iejov s’était surmené, sa santé était défaillante et le Bureau politique décida de l’envoyer se soigner à l’étranger. Il rejoignit donc un sanatorium à Vienne, en Autriche – alors même que le mouvement socialiste autrichien était écrasé militairement par la police du chancelier Dollfuss – et ne rentra à Moscou qu’en octobre, quelques semaines avant le coup de tonnerre qui allait provoquer la Grande Terreur.
Le 1er décembre 1934, l’un des principaux chefs du régime, Serge Kirov, était assassiné, à Leningrad, par un communiste déséquilibré. Staline se saisit immédiatement de cette mort comme prétexte pour lancer une gigantesque purge. Il fit d’abord adopter un décret autorisant une procédure expéditive à l’encontre de toute personne soupçonnée de terrorisme, avec à la clef une mise à mort quasi automatique. Puis il partit pour Leningrad, accompagné de plusieurs des principaux chefs bolcheviques, dont Iejov qui fut chargé de superviser l’enquête sur place et devint une sorte d’œil de Staline au sein du NKVD, au grand dam du chef officiel de celui-ci, Genrikh Iagoda.
En réalité, fidèle à son principe selon lequel ses réseaux personnels doublaient les instances officielles, Staline se servit de Iejov pour imposer au NKVD les conclusions de « son » enquête : le meurtre de Kirov était le fait d’un complot d’oppositionnels partisans de Zinoviev et Kamenev, des leaders depuis longtemps marginalisés. De fait, Iejov était devenu le véritable patron, quoique non officiel, de la police politique.
En récompense des services rendus – et des services espérés -, Iejov devint l’un des cinq secrétaire du (p.335) Comité central, le 1er février 1935, en compagnie de Staline, Kaganovitch, Jdanov et Andreev. Il était alors au cœur du système de pouvoir, dans le cercle très fermé des intimes de Staline, et profitait des plus grasses prébendes du régime (datcha luxueuse, voiture, etc). Peu après, il fut nommé à la tête d’un nouveau département – Staline modifiait en permanence les structures pour mieux les contrôler – chargé de gérer le personnel du parti. On lui confia également le soin de purger le Komsomol – l’organisation des Jeunesses communistes – et de superviser la direction du NKVD.
Le 13 mai 1935, le Bureau politique créa, secrètement et à l’insu du NKVD, une commission spéciale pour la Sécurité d’Etat, dirigée par Staline avec pour adjoint Iejov, dont l’objet était de préparer la liquidation des « ennemis du peuple », en vérifiant la conduite politique de chaque membre du parti. Désormais, tout communiste qui ne s’était pas montré un fidèle stalinien passait de la catégorie de l’opposition interne au parti à celle de contre-révolutionnaire. On commença à « monter » des « affaires » où d’ex-zinoviévistes, trotskistes, droitiers etc. étaient accusés d’avoir voulu assassiner Staline. Toute opposition interne devenait une action criminelle susceptible d’être liée à des activités terroristes visant la direction bolchevique.
Staline ayant besoin de « preuves » pour convaincre ses affidés de la nécessité d’appliquer la terreur non seulement aux « ennemis » extérieurs au parti, mais également aux « ennemis de l’intérieur », Iejov fut chargé de « monter » une affaire contre Enoukidze, qui n’était rien moins que secrétaire du Comité central exécutif de l’URSS. Le 6 juin 1935, Iejov prononça son premier discours devant le Comité central : une charge violente contre les hauts responsables – en premier lieu, Enoukidze – qui, par « myopie politique », avaient laissé faire les « terroristes » zinoviévistes/trotskistes/etc. qui voulaient assassiner Staline. (p.336) Dans la foulée, Enoukidze fut exclu du parti. Un nouveau pas était franchi dans la marche à la Grande Terreur : désormais, même un stalinien bon teint et membre des sommets du pouvoir pouvait être qualifié de contre-révolutionnaire et traité comme tel. Au 1er décembre 1935, la purge avait déjà entraîné l’expulsion du parti de 177 000 personnes – 9,1 % du total des membres -, dont 15 218 avaient été arrêtées.
Parallèlement, Staline avait chargé Iejov de lutter contre les influences étrangères en URSS. A cette fin, il le fit « élire » au Comité exécutif du Komintem, lors du VIE et dernier congrès de l’Internationale communiste, qui regroupait tous les partis communistes. Une photo inédite, publiée par Jansen et Petrov, montre d’ailleurs Iejov en grande et souriante conversation, lors de ce congrès, avec les chefs du Komintem, le Bulgare Georges Dimitrov et le Soviétique Dimitri Manouilski, qui étaient eux- mêmes les chefs directs du communiste français Maurice Thorez. Quelques semaines plus tard, Iejov dénonça à Staline la présence au sein du Komintem de nombreux éléments louches – Polonais, Roumains, Allemands, Tchèques, Finlandais – qui espionnaient sans doute pour leur pays d’origine ! Le 19 janvier 1936, Manouilski, en vieux renard au fait des mœurs du sérail, demanda à être reçu par Iejov et commença à dénoncer ses camarades du Komintem, donnant ainsi le coup d’envoi de la purge au sein de cette organisation, qui aboutit à l’arrestation puis à l’exécution de centaines de communistes et révolutionnaires étrangers, antifascistes réfugiés en URSS.
Au printemps 1936, Staline décida de franchir un pas de plus vers la Grande Terreur et ordonna à Iejov d’organiser le premier des Grands Procès de Moscou, qui se déroula du 19 au 24 août 1936 et aboutit à la condamnation à mort des seize accusés, dont Zinoviev et Kamenev, deux des principaux leaders du Parti bolchevique sous Lénine. (p.337) Le procès était entièrement truqué : les accusés avaient été contraints, sous la torture, « d’avouer » des crimes imaginaires et de « réciter » leur texte lors des audiences publiques. L’idée de Staline était, par la multiplication de ces procès à tous les échelons, de mettre en œuvre ce qu’Annie Kriegel a appelé « une pédagogie infernale2 » destinée à terroriser les élites et à faire croire au peuple que sa situation dramatique était le fait des « traîtres » et des « saboteurs ».
Après ce brillant succès, Staline fit nommer Iejov chef du NKVD et le chargea d’organiser le second grand procès, tenu du 23 au 30 janvier 1937, et de purger le NKVD de l’équipe de Iagoda, puis l’Armée rouge.
Ce processus en apparence insensé, correspondait chez Staline à l’idée que, pour préparer la guerre qui s’annonçait, il lui fallait tenir absolument en main l’URSS grâce à l’épuration et à la terreur. C’est alors que le dictateur se décida à lancer la phase décisive de la Grande Terreur qui allait frapper d’une part les sphères dirigeantes du parti et de l’administration, et d’autre part des catégories spécifiques de la population.
En dehors de toute procédure judiciaire, Iejov fut chargé de « traiter » des populations d’« ennemis du peuple », selon des quotas fixés à l’avance, et des modalités ne comprenant que deux catégories : la lre – fusillé – et la seconde – déporté. Désormais, les ordres opérationnels du NKVD, directement inspirés par Staline, scandèrent les quatorze mois qui courent du 30 juillet 1937 au 1er novembre 1938 :
- ordre opérationnel n° 00447 du 30 juillet 1937 visant les « koulaks » ayant terminé leur peine ou évadés du Goulag, les religieux et croyants, les ex-membres des partis non-communistes, les criminels et en général les « gens du passé », autorisant l’arrestation de 767 397 personnes, dont 386 798 fusillées.
(p.338) ordre opérationnel n° 00486 du 15 août 1937, défini par le Bureau politique le 5 juillet 1937, autorisant l’arrestation de plus de 18 000 femmes d’« ennemis du peuple » et de 25 000 enfants de plus de quinze ans.
- ordre opérationnel n° 00439 du 25 juillet 1937 visant les Allemands travaillant en URSS et les Soviétiques ayant eu des relations avec l’Allemagne, soit au total 68 000 personnes arrêtées dont 42 000 furent exécutées.
- ordre opérationnel n°00485 du 11 août 1937 visant tous les Soviétiques ayant eu des relations avec la Pologne ou des Polonais en URSS, soit au total 144 000 personnes arrêtées dont 110 000 furent exécutées, y compris la plupart des dirigeants et cadres du Parti communiste polonais réfugiés en URSS et dont le parti fut officiellement dissous par le Komintern en août 1938.
- ordre opérationnel n° 00593 du 20 septembre 1937 visant les Soviétiques originaires de Harbin revenus de Mandchourie en URSS après le règlement de la question du chemin de fer de l’Est chinois en 1935 avec le Japon. 25 000 personnes furent arrêtées.
- d’août à octobre 1937, le NKVD déporta des frontières d’Extrême Orient au Kazakhstan plus de 170 000 Coréens.
Le 31 janvier 1938, le Bureau politique autorisa le NKVD à étendre son action aux opérations lettone, estonienne, grecque, iranienne, roumaine, finlandaise, chinoise, bulgare et macédonienne, puis, le 1er août 1938, à l’opération afghane. Le total des victimes de ces « opérations nationales » se monte à 350 000 personnes arrêtées dont 247 157 exécutées.
Le 19 septembre 1937, le Bureau politique autorisa le NKVD à intervenir en Mongolie extérieure, ce qui aboutit en quatre mois à l’arrestation de 10 728 « conspirateurs » dont 7 814 lamas, 322 propriétaires féodaux, (p.339) 300 officiers ministériels, 180 responsables militaires, dont 6 311 étaient déjà fusillés au 31 mars 1938.
Parallèlement, Staline signa personnellement 383 listes que lui avait transmises Iejov, concernant plus de 44 000 membres du Parti communiste et de l’appareil d’Etat, dont 39 000 furent exécutés et les autres déportés.
Au total, du 1er octobre 1936 au 1er novembre 1938, 1 565 000 personnes furent arrêtées – 365 805 pour les « opérations nationales » et 767 397 en vertu de l’ordre n° 00447, dont 668 305 furent exécutées et 668 558 envoyées en camp de concentration. Encore ces chiffres sont-ils sous-estimés et le nombre d’exécutés se monte- t-il à plus de 700 000. C’est ainsi que Staline mit en œuvre la « solution finale » au problème des « éléments antisoviétiques ». Il fut personnellement responsable de la Grande Terreur, trop souvent mise sur le compte du seul Iejov, alors qu’en 1937-1938, le chef du NKVD fut reçu 278 fois par Staline au Kremlin – « en moyenne tous les deux jours et demi ! -, à peine moins que Molo- tov, le bras droit du tyran.
Avec la Grande Terreur, Iejov devint l’homme le plus puissant du monde communiste, après Staline. On imagine le sentiment de mégalomanie qui a pu s’emparer de ce petit homme de 151 centimètres, semi illettré jusqu’à ses vingt ans, ignorant dans tous les domaines, sauf celui de l’extermination. Emporté par cette espèce de folie criminelle qui lui faisait envoyer quotidiennement à la mort ou au Goulag des milliers d’hommes innocents et qui le poussait à participer personnellement à des séances de torture, Iejov devint insomniaque. Il se mit à boire jusqu’à en être régulièrement ivre mort et à avoir un comportement sexuel frénétique, tant avec les hommes qu’avec les femmes.
Sa femme, Evgueniia Solomonovna, ne menait pas une vie moins dissolue. Elle était rédactrice en chef de (p.340) L’URSS en construction, une luxueuse revue de propagande qui chantait les triomphes du régime. Etaient ainsi réunis au sein du même couple deux des ressorts principaux du totalitarisme : propagande et terreur. Solomonovna s’entichait de littérature et avait créé une sorte de salon littéraire où se retrouvaient les écrivains les plus encensés par le régime, parmi lesquels elle choisissait ses amants dont Cholokhov, l’auteur présumé du Don paisible, et surtout Isaac Babel, l’auteur fameux de Cavalerie rouge, qui paiera de sa vie son intimité avec elle.
Pour le lecteur qui souhaiterait approcher le climat très particulier dans lequel vivait le cercle dirigeant du Kremlin, on recommandera la lecture du livre de Simon Sebag Montefiore qui donne une description minutieuse et fort bien informée du comportement de ces grands apparatchiks qui, venus de rien, s’étaient servis de la révolution pour se hisser au pouvoir absolu et devenir des satrapes3. Dans l’euphorie de leur sentiment de toute-puissance et dans l’ivresse de la construction utopique du communisme, ils donnaient libre cours à leurs passions. Beuveries, orgies, tueries, rien ne manque à ce tableau dont la plus noire des pièces de Shakespeare ne rendrait qu’une bien pâle image. Dans ce climat de frénésie révolutionnaire et de totale amoralité, Staline nouait et dénouait les intrigues et les destins, seul maître à bord, fascinant et terrorisant ses plus proches acolytes par ses nerfs d’acier, sa cruauté, son fanatisme radical mais aussi ses exceptionnelles capacités politiques mises au service du renforcement et de l’expansion du régime totalitaire. C’est ainsi que Iejov, soupçonnant la liaison entre sa femme et Cholokhov, fit mettre sur écoute la chambre de l’écrivain à l’hôtel National. L’ayant appris, Cholokhov se plaignit à Staline qui, en pleine réunion du Bureau politique, contraignit Iejov à présenter ses excuses à l’amant de sa femme.
(p.341) Alors que la terreur battait son plein, Staline estima que ses principaux objectifs étaient atteints et décida d’y mettre fin aussi soudainement qu’il l’avait initiée. Ce fut pour Iejov le début d’une rapide descente aux enfers. Le 29 septembre 1938, il se vit soudain flanqué d’un adjoint qui cosignait tous ses décrets, Lavrenti Beria. Le 23 novembre 1938, lors d’une réunion avec Molotov et Vorochilov, Staline accusa Iejov d’en avoir trop fait – il n’avait pas su s’arrêter -, ce que celui-ci admit humblement. Il fut débarqué de la direction du NKVD et nommé responsable des voies navigables, tout en conservant ses fonctions de secrétaire du Comité central et président de la Commission de contrôle du parti. Ce fut la dernière fois qu’il fut autorisé à rencontrer Staline.
Iejov fut remplacé à la tête du NKVD par Beria, un Géorgien – comme Staline – qui avait fait ses preuves en mettant à feu et à sang la Géorgie. Homme encore plus cruel et pervers mais beaucoup plus intelligent que Iejov, Beria s’acharna immédiatement à détruire celui- ci, avec, bien entendu, les encouragements de Staline. Il attaqua d’abord Solomonovna et fit arrêter tout son entourage. Se sentant perdue, la femme de Iejov sombra dans une dépression et fut hospitalisée. C’est alors que son mari, pour se débarrasser d’une relation compromettante et tenter de sauver sa peau, demanda le divorce et la poussa au suicide, après lui avoir discrètement transmis du poison.
Iejov était de plus en plus isolé, tous ses adjoints du NKVD étant arrêtés les uns après les autres. Le 21 janvier 1939, il apparut pour la dernière fois en public, au Bolchoï. Le 29, il assista à sa dernière réunion du Bureau politique. En février, il ne fut pas désigné comme délégué au XVIIIe congrès du parti. Le 6 mars, son nom apparut pour la dernière fois dans la presse soviétique. Le 9 avril, il signa ses derniers ordres et fut arrêté le lendemain.
(p.342) Ne supportant pas la torture – qu’il avait pourtant fait infliger à des centaines de milliers d’autres -, il signa tout ce qu’on voulut lui faire avouer. Il était accusé d’avoir espionné depuis des années au profit de l’Angleterre, de la Pologne et du Japon – rien de moins ! Lors de son procès secret, 2 février 1940, il rejeta toutes les accusations. Il fut condamné à mort mais son adoration pour Staline était telle qu’il demanda, in fine, que soit rapporté au dictateur qu’« il mourrait avec son nom sur les lèvres ». Il n’en fut rien. L’exécution eut lieu le soir même et, face à la mort, Iejov s’effondra ; les gardes durent le traîner sur le sol jusqu’au lieu d’exécution. Ainsi mourut pitoyablement, de la main même de son maître, l’un des principaux bourreaux du système totalitaire communiste. Que son nom soit connu de tout le monde.
Mais comme, décidément, le délire communiste continuera encore longtemps de hanter nos sociétés et notre mémoire, on ne peut pas clore le chapitre Iejov sans rapporter la morale de cette histoire. Iejov et sa femme n’ayant pas eu d’enfant, ils avaient adopté une petite fille, Natacha. En dépit d’un destin tourmenté, elle était restée fidèle à son père adoptif qui avait été particulièrement affectueux avec elle – alors qu’il envoyait des dizaines de milliers d’enfants d’« ennemis du peuple » à la mort. En 1998, Natacha demanda aux nouvelles autorités judiciaires russes que Iejov, qui avait été condamné à tort pour espionnage, soit réhabilité. La requête fut rejetée. Ironie de l’histoire …
(p.243) De Babeuf à Lemkin : génocide et modernité
En tant que spécialiste du communisme, je fréquentais depuis de très longues années les écrits de Gracchus Babeuf, considéré comme le fondateur du communisme moderne à travers sa conjuration des Egaux de 1796. Mais ce n’est que beaucoup plus récemment, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, que j’ai pris connaissance de la brochure de Babeuf sur la guerre de Vendée. Il est vrai que ce texte, iconoclaste du point de vue révolutionnaire communiste, avait été soigneusement occulté par les « babouvologues », pour la plupart communistes ou communisants. Or, avec une acuité remarquable, Babeuf y met en lumière la relation forte entre dictature révolutionnaire et massacres de masse qu’il cherche à nommer – mais le mot « génocide » ne sera inventé qu’en 1944 par le juriste polonais Rafaël Lemkin.
(p.345) / Reynald Secher a inventé le terme ‘mémoricide’. /
(p.345) Babeuf avait inventé les termes « populicide », « plé- béicide » et même « nationicide » pour désigner la politique d’extermination des Vendéens, votée par la Convention le 1er août et le 1er octobre 1793. Mais ce « populicide », soigneusement occulté, est demeuré une affaire franco-française. Il n’en a pas été de même pour le « génocide », inventé par Lemkin « pour désigner une vieille pratique dans sa forme moderne5 », et qui, sur ses instances, a été cité dans l’acte d’accusation du Tribunal militaire international de Nuremberg chargé de juger les principaux chefs nazis. Encore que, il s’en fallut de peu : en effet, la délégation britannique à Nuremberg refusa dans un premier temps l’usage de « génocide » sous prétexte que le mot ne figurait pas dans l’Oxford Dictionary6.
(p.345) Ainsi, d’emblée, Babeuf a été frappé par la volonté d’extermination qui avait caractérisé les événements de Vendée, qu’il s’agisse de la phase de guerre civile active – de mars à décembre 1793 – ou de la phase plus (p.346) spécifiquement génocidaire qui court d’avril 1794 à la chute de Robespierre. Et il ne manque pas d’imagination lexicale pour la désigner : « un si grand amoncelage de crimes », « immolations féroces de milliers de vos frères », « des peuplades entières effacées du nombre des vivants », « l’égorgerie de nos frères », « colosse du crime », « le grand hachis », « tuerie générale », « exécrations nationicides », « massacrerie », « boucherie horrible », « système de destruction », « système pratique L d’égorgement », « extrême barbarie ». i Babeuf ne se contente pas de recenser des massacres de masse dus à quelque hasard ; il conclut, au contraire, que « les crimes de la Vendée […] paraissent tenir à un système d’extermination générale7 » dont il accuse le Comité de salut public qui a décidé de « tourner la faux de la mort sur la totalité de cette race vendéenne8 ». C’est la dimension volontaire et planifiée du massacre par les diverses instances du pouvoir étatique – Comité de salut public, Convention, armée de l’Ouest, etc. – et le fait qu’il vise l’ensemble d’une population civile qui ^ caractérisent l’entreprise génocidaire. à Le futur « tribun du peuple » n’était certes pas le juriste de haut niveau international que fut Lemkin. Il n’en a pas moins saisi la plupart des ressorts qui sous-tendaient la logique génocidaire inaugurée en Vendée. Et bien avant les grands désastres totalitaires du XXe siècle, il a souligné la relation entre les causes et les effets : comment des ambitieux, maniant de « détestables sophismes politiques », s’étaient emparés d’un gouvernement révolutionnaire et avaient fait qu’une révolution « commencée par la sagesse et la vertu du peuple » aboutît à un « système d’où sont sorties les laideurs cadavéreuses qui le caractérisent9 ».
A l’origine de cette dérive révolutionnaire, Babeuf place l’instauration de ce qu’il nomme « les vices-rois départementaux avec leurs pouvoirs sans bornes et (p.347) jusques y compris le droit de vie et de mort10 », allusion à l’adoption par la Convention, le 4 décembre 1793, des propositions de Billaud-Varennes d’envoyer des représentants en mission dans les districts et les communes, de leur permettre d’épurer les autorités civiles et d’obliger les ministères et les administrations à rendre compte au Comité de salut public : « La république devait voir, dès lors, les départements livrés aux caprices de l’arbitraire et à toutes les passions de quelques hommes qui ne manqueraient point de s’enivrer du dépôt de la toute-puissance réunie en entier dans leurs mains. Elle devait voir la royauté travestie et déguisée seulement en costume tricolore, qui, loin des regards du Sénat [la Convention], se permettrait tout ce que peut inspirer le délire éblouissant d’une domination illimitée, qu’on avait jamais dû s’attendre d’être en situation d’exercer11. »
Babeuf qualifie cette « toute-puissance » et cette « domination illimitée » de « parfaite tyrannie, autant parfaite que jamais il en put exister » ; s’il raisonne encore dans les termes de la philosophie politique traditionnelle, il montre néanmoins, en évoquant « la tyrannie la plus parfaite », qu’il a senti qu’émergeait un phénomène nouveau, inédit, ce que Hannah Arendt, un siècle et demi plus tard, nommera « une volonté de domination totale » : le totalitarisme.
Il pressent d’ailleurs fort bien la source de cette tyrannie moderne quand il écrit : « Que l’on cesse donc d’attacher au caractère de mandataire du peuple ce prestige idolâtre, ce fanatisme esclave, cette fausse idée d’infaillibilité ou, tout au moins, de capacité supérieure à celle des autres citoyens12. » Or c’est bien la prétention à la supériorité et à l’infaillibilité de leurs chefs qui a mené les régimes totalitaires, tant communistes que nazi, à mettre en œuvre des logiques génocidaires.
(p.349) Babeuf a saisi d’emblée la dimension extraordinaire- / ment moderne de l’extermination des Vendéens, en soulignant le côté mécanique – sinon déjà industriel – qui sera la marque des génocides du xxe siècle. En écrivant que « dans la démonstration de toute machine, il faut toujours remonter au chef ressort pour bien faire apprécier l’emploi de chaque rouage15 », Babeuf vise le Comité de salut public, qu’il affuble d’autres qualificatifs évocateurs : « aristocratie meurtrière », « Comité d’assassinats publics », « Comité d’égorgerie »16 ou encore « autocratie comitatoriale »17.
Et il insiste sur ce point quand il évoque Carrier :
« On reconnaît déjà que Carrier […] ne fut qu’un instrument, qu’un ressort subordonné et même postérieur à beaucoup d’autres ressorts ; mais on voit déjà […] que ce rouage exterminateur avait vu marcher avant lui une infinité d’autres rouages non moins meurtriers, dont il avait reçu le mouvement d’impulsion, presque autant que de l’action immédiate de la force placée au centre de la machine politique […]18. » Le « rouage exterminateur » : remarquable vision de la politique totalitaire comme une machine, comme une mécanique qui, une fois remontée, ne peut plus être arrêtée et dont les acteurs sont agis par la machinerie ; prémonition des grandes bureaucraties exterminatrices des régimes totalitaires.
Babeuf décrit longuement toutes les atrocités commises en Vendée, que l’on « assassine militairement » ou que l’on « assassine révolutionnairement »19 : arrestations arbitraires, exécutions sommaires des rebelles pris les armes à la main ou blessés, mais aussi de ceux qui se sont rendus, et encore des populations civiles, femmes et enfants compris. Autant de préfigurations des crimes de masse inaugurés par le régime de Lénine (p.350) puis de Staline en Russie, et dupliqués par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale puis par les régimes communistes instaurés après celle-ci.
On retrouve y compris, sous la plume de Babeuf, l’un des moyens de génocide mis en œuvre par Staline contre les paysans ukrainiens lors de la collectivisation en 1932-1933, par les nazis avec l’instauration des ghettos juifs ou par Pol Pot contre la partie « impure » du peuple cambodgien entre 1975 et 1979 : l’arme de la faim. Babeuf cite la lettre de Carrier au général Haxo, du 15 décembre 1793 : « Il entre dans mes projets, et ce sont les ordres de la Convention nationale, d’enlever toutes les subsistances, les denrées, les fourrages, tout en un mot de ce maudit pays, de livrer aux flammes tous les bâtiments […]. Oppose-toi de toutes tes forces à ce que la Vendée prenne ou garde un seul grain. […] En un mot, ne laisse rien dans ce pays de proscription. Que les subsistances, denrées, fourrages, tout, absolument tout, se transporte à Nantes. » Et il conclut : « La famine est aussi un mode d’assassinat. Carrier l’organise20. »
Face à tant d’atrocités, Babeuf reste perplexe. En bon émule des Lumières, il cherche à expliquer rationnellement le fait que la Convention ait non seulement ordonné d’exterminer l’ensemble des Vendéens, y compris les bons républicains, mais encore qu’elle ait laissé massacrer d’innombrables troupes républicaines envoyées sans précautions dans une région en révolte. Il y voit un plan ourdi avec soin dont il croit avoir découvert le secret : la mise en œuvre d’un « système de dépopulation » par Robespierre qui aurait considéré que le territoire français ne pouvait pas nourrir l’ensemble de sa population et qu’il fallait donc, par le biais de la Vendée, se débarrasser de sa part excédentaire. Hypothèse farfelue, mais qui contient sa part de vérité totalitaire : déjà en 1793-1794, un gouvernement (p.351) révolutionnaire estimait que sa population comprenait « des hommes en trop », des hommes « superflus » qu’il était légitime d’exterminer. Logique génocidaire qui, bientôt nourrie d’idéologie scientiste – racialiste ou marxiste-léniniste – et portée par des partis de révolutionnaires professionnels encore dans les limbes sous la Révolution française21, aboutira aux grands désastres du XXe siècle.
En abordant, dans la dernière partie de sa brochure, le procès du Comité révolutionnaire de Nantes puis de Carrier22, Babeuf nous instruit de la manière dont les bourreaux et assassins, responsables d’actes de génocide, inaugurent leurs moyens de défense devant les instances judiciaires mais aussi devant le tribunal de l’Histoire. Moyens qui seront repris avec exactitude par leurs émules du xxe siècle. Il cite le discours de Goullin, l’un des adjoints de Carrier :
« L’homme qui électrisa nos têtes, guida nos mouvements, despotisa nos opinions, dirigea nos démarches, contemple paisiblement nos alarmes […] Il importe à notre cause que Carrier paraisse au tribunal ; les juges, le peuple enfin doivent apprendre que nous ne fûmes que les instruments passifs de ses ordres et de ses fureurs. Qu’on interpelle tout Nantes, tous vous diront que Carrier seul provoqua, prêcha, commanda toutes les mesures révolutionnaires. […] Carrier seul donna enfin cette impulsion terrible, qui jeta hors des bornes des patriotes ardents, mais égarés. Citoyens jurés, vous dont le maintien calme annonce l’impartialité, vous ne prononcerez pas sur le sort de tant de victimes égarées, sans avoir entendu l’auteur de tous nos maux et de toutes nos fautes. Que Carrier paraisse ; qu’il vienne justifier ses malheureux agents ou qu’il ait la grandeur de s’avouer seul coupable23. »
Moyen de défense qui deviendra classique, tant chez les nazis que chez les communistes : les bourreaux n’ont(p.352) fait qu’appliquer les ordres, ils sont eux-mêmes victimes du seul coupable qui est le chef.
Carrier applique la même tactique, arguant de son obéissance aux deux décrets de la Convention qui ordonnaient d’incendier et d’exterminer toute la Vendée : « Il se couvrit de l’égide de ses pouvoirs illimités. Il se mit sous celle de la Convention […] puisqu’elle avait approuvé, commandé par des décrets toutes les mesures prises par les députés en mission24. »
En outre, « il s’efforça d’écarter l’inculpation des noyades et fusillades […] en mettant au défi qu’on puisse lui opposer aucun ordre écrit25 ». Ce fut là encore, un siècle et demi plus tard, une pratique courante des chefs totalitaires que de ne donner qu’orale- ment les ordres d’extermination. Ainsi les historiens n’ont retrouvé aucun papier signé de la main de Hitler ordonnant le génocide des Juifs, pas plus que de la main de Pol Pot dans le cas Cambodgien. Lénine et Staline étaient plus francs – ou plus assurés de leur impunité – qui n’hésitaient pas à coucher ces ordres par écrit, mais en prenant en général la précaution d’y associer les autres membres du Bureau politique.
Le dénouement même du procès Carrier préfigure la stratégie de défense de grands criminels d’Etat du xxe siècle. En effet, le 14 décembre 1794, Carrier et deux autres membres du Comité révolutionnaire de Nantes étaient condamnés à mort tandis que trente autres accusés, tout aussi coupables, étaient acquittés. La Convention tentait ainsi d’échapper à ses responsabilités en désignant à la vindicte publique trois boucs émissaires promptement guillotinés afin de les rendre définitivement muets. Ainsi, le procès de Carrier fut couronné de succès, permettant à de nombreux conventionnels terroristes de poursuivre une carrière politique sous le Consulat et sous l’Empire, à commencer par le fameux (p.353) Fouché, commanditaire intéressé de la brochure de Babeuf26.
Consciemment ou non, cette leçon sera retenue, cent soixante ans plus tard, par les chefs soviétiques dont la manœuvre s’opéra en deux temps. D’abord, peu après la mort de Staline en mars 1953, ils abattirent le bourreau en chef, patron du KGB, Lavrenti Beria, à la fois parce qu’ils le craignaient et parce qu’il savait tout de leurs responsabilités dans les crimes de masse. Puis, le 25 février 1956, Nikita Khrouchtchev présenta devant le XXe congrès du Parti communiste d’Union soviétique son fameux « Rapport secret » où, à l’instar de Goullin, il prétendit que Staline était seul coupable et que tous les autres dirigeants n’avaient fait qu’obéir à ses ordres, sous peine de mort. Le « Rapport secret » permit à l’ensemble de la nomenklatura soviétique, y compris celle du KGB, de poursuivre sa carrière et de jouir de ses privilèges. Les pires assassins – Molotov, Kagano- vitch, Khrouchtchev, Serov – moururent dans leur lit à un âge avancé et couverts de médailles. Ainsi était rééditée une manœuvre éprouvée destinée à assurer l’amnistie à toute une classe politique et à imposer l’amnésie à l’ensemble de la société27.
Bien avant la querelle sur le nombre de Juifs disparus dans la Shoah ou la polémique provoquée par la publication du Livre noir du communisme à propos des victimes du communisme, Babeuf a eu le souci de dénombrer, estimant les victimes vendéennes à « un million peut-être », ce qui n’aurait pas manqué de lui attirer les foudres des censeurs si l’on s’en tient au chiffre de 117 000 avancé récemment par Reynald Secher28. Mais l’ampleur du chiffre annoncé – le million – était destiné à frapper les imaginations et à faire sentir que la Vendée avait été victime d’autre chose que d’un simple massacre. D’ailleurs Babeuf ne manque pas de remarquer que, dans son rapport du 1er avril 1794, le (p.354) représentant Lequinio a utilisé un euphémisme pour qualifier le génocide : « des mesures de rigueur qui ont été employées sans discernement29 ». Le même type d’euphémisme par lequel les assassins totalitaires ont cherché à masquer leurs crimes : « solution finale du problème juif » chez les nazis », « la mesure punitive la plus élevée » chez Staline envoyant à la mort plus de vingt-cinq mille officiers et notables polonais faits pri- l sonniers par l’Armée rouge en septembre 193930.
Par là, Babeuf aborde l’un des points les plus troublants de l’histoire des génocides modernes. A propos des crimes de la Vendée, il écrit : « On n’y croirait pas si nous ne les confirmions par des faits précis et authentiques31 » ; ou encore : « Il est d’autres faits si étrangement atroces que nous avons glissé rapidement à leur égard, parce que l’imagination se refuse presque à les croire, malgré que, par l’analogie, rien ne doive plus paraître incroyable, d’après la certitude des actes forcenés que nous avons été dans la position de décrire32. »
Il soulève ainsi la question fondamentale d’une certaine impossibilité, voire d’un refus, de l’esprit humain à appréhender, à connaître et à comprendre des actes L d’une telle inhumanité. Trouble auquel ont été confron- 1 tés y compris les penseurs les plus fameux du totalitarisme au xxe siècle. Raymond Aron en témoigne dans ses Mémoires : « Le génocide, qu’en savions-nous à Londres ? Au niveau de la conscience claire, ma perception était à peu près la suivante : les camps de concentration étaient cruels, dirigés par des gardes-chiourmes recrutés non parmi les politiques mais parmi les criminels de droit commun ; la mortalité y était forte, mais les chambres à gaz, l’assassinat industriel d’êtres humains, non, je l’avoue, je ne les ai pas imaginés, et parce que je ne pouvais les imaginer, je ne les ai pas sus33. »
(p.355)
Et Hannah Arendt confirme cette difficulté à laquelle se heurte l’esprit. Ayant pris connaissance de la « Déclaration » du 17 décembre 1942 par laquelle onze gouvernements alliés et la France libre dénonçaient le processus d’extermination des Juifs engagé par les nazis, elle témoigne en 1964 de sa réaction d’alors : « Tout d’abord, nous n’y avons pas cru, bien qu’à vrai dire, mon mari et moi-même estimions ces assassins capables de tout. Mais cela, nous n’y avons pas cru, en partie aussi parce que cela allait à l’encontre de toute nécessité, de tout besoin militaire. Mon mari […] m’a dit : Ne prête pas foi à ces racontars, ils ne peuvent aller jusque-là ! Et cependant, nous avons dû y croire six mois plus tard lorsque nous en avons eu la preuve. […] C’était vraiment comme si l’abîme s’ouvrait devant nous34. »
Contemporain des événements, informé de première main grâce aux révélations suscitées par les crimes de Vendée après la chute de Robespierre, Babeuf aurait pu taire ce qui apparaît comme une tache indélébile dans le cours de sa chère Révolution. Au contraire, il a tenu à témoigner et à condamner. Il a analysé avec finesse la tentative révolutionnaire d’exterminer la Vendée, préfiguration des génocides modernes. Lui, homme de la Raison et des Lumières, et à ce titre exempt de tout préjugé, il avoue avec une certaine naïveté : « c’est que je suis encore, sur le chapitre de l’extermination, homme à préjugés35 ». Très ancien préjugé, tout à son honneur, et qui s’énonce simplement : « Tu ne tueras point ».
(p.364) En fait, au début des années 1930, le pouvoir soviétique avait choisi un processus plus complexe : la liquidation ou déportation, dès 1920, des élites intellectuelles
- écrivains, penseurs, artistes, enseignants -, politiques
- nationalistes puis communistes – et religieuses ; puis la planification d’une famine organisée contre la paysannerie qui aboutit en 1932-1933 à la mort de faim de 5 millions d’Ukrainiens ; et enfin le repeuplement de l’Ukraine par des populations non ukrainiennes, en particulier des Russes fidèles au régime soviétique. Lemkin concluait : « Ce n’est pas simplement un cas de crime de masse. C’est un cas de génocide, de destruction non seulement d’individus, mais d’une culture et d’une nation20. »
(p.370) Après avoir visé une classe sociale et après l’échec de la révolution de 1848 en Europe centrale, Marx stigmatisa (p.371) dans son journal, la Nouvelle Gazette rhénane, les petits peuples contre-révolutionnaires, qualifiés de « déchets de peuples » :
« Aux phrases sentimentales qu’on nous offre ici au nom des nations contre-révolutionnaires de l’Europe, nous répondons : la haine des Russes a été et restera la première passion révolutionnaire des Allemands et, depuis la révolution, s’y est ajoutée celle des Croates et des Tchèques ; ensemble avec les Magyars et les Polonais, nous sauvegarderons la révolution par un terrorisme décidé à l’égard de ces peuples slaves. Nous savons maintenant où se trouvent les ennemis de la révolution : en Russie et dans les pays slaves d’Autriche. Nulle phrase, nulle affirmation quant aux avenirs démocratiques de ces pays ne nous empêchera de considérer nos ennemis comme tels. […] Lutte impitoyable, combat à mort avec les Slaves traîtres à la révolution, extermination, terrorisme sans égard, non dans l’intérêt de l’Allemagne mais dans celui de la révolution35. »
Ainsi, avant même que Charles Darwin ne publie son ouvrage sur L’Origine des espèces, qui marqua profondément la pensée de Marx, ce dernier développait déjà un darwinisme social et national qui lui faisait considérer comme normale l’extermination de groupes humains faisant obstacle au processus révolutionnaire tel que lui- même l’avait théoriquement défini comme « sens de l’Histoire ».
(p.373) S’il se situe dans la filiation de ses grands prédécesseurs en révolution, en particulier les jacobins et le Comité de salut public, Lénine apporte deux innovations majeures : d’une part une idéologie scientiste fortement constituée en doctrine et bientôt en orthodoxie ; d’autre part, un nouveau type de parti : le parti de révolutionnaires professionnels, très idéologisé et sous la (p.374) coupe d’un chef d’autant moins discuté qu’il va enregistrer succès sur succès. Et c’est ce mouvement révolutionnaire inédit, fondateur du totalitarisme, qui s’empare du pouvoir le 7 novembre 1917, passe à l’acte et inaugure d’emblée, entre 1917 et 1922, un processus génocidaire fondé sur la terreur utilisée comme moyen de gouvernement.
(p.374) Dans un texte publié seulement en 1929 mais écrit entre le 6 et le 9 janvier 1918, Lénine a couché sur le papier sa pensée profonde, qu’il ne livrait pas au public :
(p.375) […] La diversité est ici gage de vitalité, une promesse de succès dans la poursuite d’un même but unique : débarrasser la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces (les filous), des punaises (les riches) et ainsi de suite. Ici on mettra en prison une dizaine de riches, une douzaine de filous, une demi-douzaine d’ouvriers qui tirent au flanc. […] Là on les enverra nettoyer les latrines. Ailleurs on les munira, au sortir du cachot, d’une carte jaune [la carte des prostituées sous le tsarisme] afin que le peuple entier puisse surveiller ces gens malfaisants jusqu’à ce qu’ils se soient corrigés. Ou encore on fusillera sur place un individu sur dix coupable de parasitisme43. »
(p.376) (…) la spoliation / expropriation qui fut l’un des premiers actes majeurs des bolcheviks au pouvoir, suivant le mot d’ordre de Lénine « Volez les voleurs, pillez les pillards ! ». Dans les mois qui suivirent le 7 novembre 1917, la Russie fut le théâtre d’un fantastique transfert de propriété de ceux qui « avaient du bien » soit vers le parti-Etat – le pouvoir saisit le contenu de 35 000 coffres-forts, d’innombrables immeubles, usines, commerces et propriétés agricoles -, soit vers les voyous et le lumpen-prolétariat qui sévissaient dans les villes, tandis qu’à la campagne les paysans dépouillaient les grandes propriétés de leur matériel agricole et de leur bétail. Or, comme le notait Lemkin dès 1944, la spoliation était un moyen d’affaiblir les groupes visés par le génocide – quand elle n’était pas l’un des moteurs du génocide. Et d’ailleurs, les nazis pratiquèrent et la stigmatisation symbolique et la spoliation des Juifs, avant d’engager leur ségrégation sociale et juridique.
Dès 1918, les bolcheviks ont pratiqué l’exclusion sociale grâce à un moyen très simple et terriblement efficace, en application du fameux slogan de Lénine « Qui ne travaille pas ne mange pas ! ». Si ce slogan peut sembler raisonnable, il devient terrifiant dès que l’on est dans un système où le pouvoir détient le monopole de l’emploi et du salaire – et peut donc le refuser arbitrairement et condamner quiconque à la mort de faim ou à l’illégalité. Le pouvoir a aussi très tôt créé une catégorie de citoyens privés de leurs droits, les lichentsy.
Les bolcheviks ont imposé par la violence une ségrégation spatiale qui s’est inscrite d’abord en creux, à travers des vagues massives d’émigration et d’exil, plus d’un million de membres des classes « condamnées par l’Histoire » s’étant enfuies pour sauver leur vie. Mais très vite, cette ségrégation a pris la forme de l’enfermement dans des prisons puis dans des camps de concentration dont Trotski réclamait l’installation dès le 4 juin
1918, suivi en cela le 26 juin par le Conseil des commissaires du peuple qui exigea que ces camps soient utilisés pour mettre hors d’état de nuire les « ennemis intérieurs ». Et le 8 août, Trotski approuva la création des trois premiers camps, appelés à devenir un véritable système concentrationnaire, dès 1921, dans le complexe des îles Solovki, sur la mer Blanche, bien avant que les nazis n’aient ouvert leur premier camp.
(p.378) Le premier acte de génocide majeur eut lieu en 1919- 1920 quand fut engagée contre les Cosaques du Don et du Kouban la « décosaquisation » sur un ordre du Bureau politique du Parti bolchevique du 24 novembre 1919 spécifiant de « les exterminer jusqu’au dernier » ; en un an, 15 000 Cosaques furent massacrés et leurs ‘vfamilles internées dans des camps que la Tcheka elle-même qualifiait de « camps de la mort » ; au total, entre 300 000 et 500 000 personnes furent massacrées ou déportées sur une population de 3 millions d’habitants46.
Parallèlement, des centaines de milliers de civils des villes et des campagnes, ouvriers en grève ou révoltés, paysans refusant les réquisitions ou fuyant la conscription forcée dans l’Armée rouge, prisonniers « blancs » ou déserteurs « rouges » furent assassinés.
(p.382) On vit même l’un des principaux hommes politiques français, Edouard Herriot, visiter l’Ukraine à l’été 1933 et publier en revenant un livre où il décrivait cette contrée comme « un jardin en plein rendement », démentant tout soupçon de famine ; les rapports du NKVD concernant l’organisation de cette visite diplomatique, aujourd’hui accessibles, nous montrent en détail comment les Soviétiques organisaient avec succès des voyages « à la Potemkine » destinés à masquer leurs crimes de masse50.
La deuxième grande opération génocidaire organisée par Staline est connue sous le nom de Grande Terreur – tout comme est intitulée Grande Terreur la période paroxystique du règne de Robespierre au printemps 1794. A cet effet, il nomma à la tête du NKVD l’un de ses affidés les plus proches, Nikolaï Iejov51, qui, en dehors de toute procédure judiciaire et dans des délais déterminés, fut chargé de « traiter » des populations d’« ennemis du peuple », selon des quotas fixés à l’avance pour chaque région, et des modalités ne comprenant que deux catégories : la lre – fusiller ; la 2e – déporter.
Désormais, les ordres opérationnels du NKVD, directement inspirés par Staline, scandèrent les quatorze mois qui courent du 30 juillet 1937 au 1er novembre 193852. Au total, du 1er octobre 1936 au 1er novembre 1938, 1 565 000 personnes furent arrêtées – 365 805 pour les « opérations nationales » et 767 397 en vertu de l’ordre n° 00447, dont 668 305 furent exécutées et 668 558 envoyées en camp de concentration. Encore ces (p.383) chiffres sont-ils sous-estimés et le nombre d’exécutés se monte-t-il à plus de 700 000. S’y ajoutent l’arrestation de 44 000 membres du Parti communiste et de l’appareil d’Etat, ainsi que celle de dizaines de milliers de militaires – avec à la clef de nombreuses déportations et exécutions. C’est ainsi que Staline mit en œuvre la « solution finale » du problème des « éléments antisoviétiques »53.
Cette Grande Terreur répondait à une réflexion rationnelle et avait trois objectifs principaux : assurer le pouvoir absolu du chef sur le parti et sur l’administration afin qu’il dispose d’un outil parfaitement discipliné ; assurer le pouvoir absolu du parti sur l’ensemble de la population afin d’imposer à celle-ci la politique définie par le chef et qui consiste en permanence à renforcer son pouvoir, celui du parti, celui de l’URSS en liquidant « les gens du passé » et en s’appuyant sur la nouvelle génération formée sur le modèle de « l’homme nouveau » ; se préparer à la guerre en liquidant des catégories de la population ou des élites définies selon des critères sociaux et/ou nationaux et considérés comme de potentielles cinquièmes colonnes.
La troisième vague génocidaire intervint avec la guerre. De septembre 1939 à juin 1941, le pouvoir soviétique déporta et/ou extermina les élites des nations conquises et annexées à l’URSS à la suite de l’alliance germano-soviétique. Dans la partie orientale de la Pologne, 30 000 prisonniers de guerre furent envoyés au Goulag et beaucoup d’autres incorporés de force dans l’Armée rouge comme « nouveaux citoyens soviétiques ». Le 2 mars 1940, Staline donne suite à un rapport de Khrouchtchev et Beria demandant la déportation de 22 000 à 25 000 familles de Polonais internés, soit plus de 60 000 femmes et enfants. Le 5 mars, le Politburo signa l’ordre de fusiller 25 700 Polonais internés, dont 14 587 officiers – parmi lesquels les (p.384) 4 243 fusillés à Katyn. Parallèlement, le NKVD lança quatre grandes opérations de déportation visant en priorité les couches dirigeantes et leurs familles : 140 000 personnes le 10 février 1940, 61 000 personnes le 13 avril 1940, 75 000 personnes le 29 juillet 1940, et enfin plusieurs dizaines de milliers de prisonniers massacrés lors du repli soviétique après le 22 juin 1941. Au total 330 000 personnes dont un tiers d’enfants de moins de 14 ans. Au total, du 17 septembre 1939 au 22 juin 1941, plus de 440 000 victimes – assassinés et déportés – sur une population de 12 millions d’habitants54.
Les Estoniens subirent un sort similaire à partir du 12 juin 1940, quand l’Estonie fut conquise et annexée à l’URSS : plus de 2 200 personnes fusillées – dont 800 officiers, la moitié du corps -, 12 500 soldats et plus de 10 000 civils déportés en URSS entre juin 1940 et juin 1941. Les mêmes méthodes furent employées quand l’Armée rouge réoccupa l’Estonie en 1944 : 75 000 personnes arrêtées dont plus de 25 000 fusillées ou mortes en camp, et 75 000 déportées au Goulag soviétique dont 6 000 tuées en chemin dans l’hiver 1944-1945. Une nouvelle vague de déportation de plus de 22 000 personnes intervint en mars 1949, tandis que plus de 2 000 résistants maquisards étaient tués au combat, 1 500 assassinés et 10 000 arrêtés entre 1944 et 1953. Au total, environ 175 000 Estoniens furent assassinés ou déportés, soit 17,5 % de la population,
sans oublier les innombrables exilés55.
Les Lituaniens, les Lettons et les Bessarabiens, occupés et annexés en juin 1940, subirent un sort analogue même si l’état des travaux historiques est encore assez peu avancé sur ces cas.
La quatrième grande opération génocidaire visa, à partir du 22 juin 1941 et alors que l’URSS était en guerre contre l’Allemagne, des populations intégrées à l’URSS (p.385) avant le 17 septembre 1939. Furent d’abord concernés les Allemands de la Volga, implantés en Russie depuis le xvine siècle : 446 000 déportés du 3 au 20 septembre 1941 – en pleine débâcle militaire soviétique – avec un total de 894 000 personnes au 25 décembre 1941 (soit 82% du total de ces Allemands). Puis Staline s’attaqua à des population décrétées « peuples ennemis », en 1943-1944 : 93 000 Kalmouks déportés en quatre jours, du 27 au 30 décembre 1943 ; 521 000 Tchétchènes et Ingouches déportés en six jours, du 23 au 28 février 1944 ; 180 000 Tatars de Crimée déportés du 18 au 20 mai 1944 ; 41 000 Grecs, Bulgares et Arméniens de Crimée déportés les 27 et 28 juin 1944; enfin, 86 000 Turcs, Kurdes et Khemchines du Caucase du 15 au 25 novembre 194456.
Ces déportations présentent un caractère génocidaire incontestable, entre 40 et 50 % des déportés étant des enfants de moins de seize ans. Et elles se révélèrent extrêmement meurtrières, soit pendant le transport qui durait des semaines, soit à l’arrivée où aucun accueil n’avait été organisé, ou un accueil très sommaire ; ainsi, sur les 608 749 personnes déportées du Caucase, 146 892 étaient mortes au 1er octobre 1948 et seulement 28 120 étaient nées entre-temps. La plupart de ces décès semblent dus à l’incurie ; mais cette prétendue incurie participe du génocide : le gouvernement soviétique a mis lui-même ses propres populations dans une situation d’impossible survie ou de survie très difficile. Enfin, ces déportations participaient d’un plan d’ensemble et avaient été précédées par l’assassinat des élites traditionnelles, opéré lors de la collectivisation et de la Grande Terreur pour les populations soviétiques, ou après l’entrée de l’Armée rouge pour les peuples occupés de septembre 1939 à juin 1941.
Le fait que Staline ait déporté des peuples non Russes situés à la périphérie de l’URSS ajoute à la dimension (p.386) de classe du génocide une dimension ethnique/natio- nale. Il s’est donc bien agi de « l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe social, national ou ethnique » – définition du génocide par le code pénal français -, encore souligné par le fait que ces opérations distrayaient de l’effort de guerre soviétique d’énormes moyens en homme et en matériel – 2 760 wagons pour les Kalmouks ; 12 610 wagons et 119 000 hommes des troupes spéciales du NKVD pour les Tchétchènes !
Au total, de septembre 1939 à mai 1945, ce sont environ 2,5 millions de personnes que Staline fit déporter.
(p.395) Il est important de souligner que les principes et les méthodes d’extermination bolcheviques servirent de modèle aux nazis, comme le démontre un document récemment exhumé, le mémorandum que, le 25 mai 1940, alors que la défaite de la France était déjà acquise, Himmler adressa à Hitler et où il envisageait d’exiler les Juifs est-européens dans la colonie française de Madagascar. Estimant que l’immigration forcée constituerait la solution optimale, il commentait : « Aussi cruel et tragique que puisse être chaque cas individuel, cette méthode est encore la plus douce et la meilleure, si l’on rejette la méthode bolchevique d’extermination physique d’un peuple, parce qu’on est intimement convaincu qu’elle est non germanique et impossible61. »
Reste cependant un point de différenciation en apparence irréductible entre nazisme et communisme : le contenu des idéologies qui président au génocide. L’une est raciste et inégalitaire, alors que l’autre serait liée à la pensée égalitariste et universaliste issue de la Révolution française.
(p.404) (…) on se souvient des violentes campagnes menées par le PCF et tout le camp communiste contre le livre de Victor Kravchenko, J’ai choisi la liberté, en 19493, puis contre David Rousset, ce résistant déporté par les nazis qui dénonçait le système concentrationnaire soviétique.
(p.429) A propos de l’Ukraine, le Premier Secrétaire, qui a été le patron de cette république de 1938 à 1947, déclare : « Les Ukrainiens n’évitèrent ce sort que parce qu’ils étaient trop nombreux et qu’il n’y avait pas d’endroit où les déporter. Sinon ils auraient été déportés eux aussi34. » Déclaration qui, d’après le compte rendu officiel, provoque « Rires et mouvements dans la salle », réactions très symptomatiques de la mentalité qui règne parmi les délégués au congrès : un cynisme absolu.
(p.431) (…) c’est sur son propre cas que le Premier Secrétaire /Krouchtchev / est particulièrement discret, alors qu’il a été un pur produit du mode de promotion stalinien, qu’il a toujours soutenu la terreur et a été responsable de très grandes opérations terroristes. Ainsi, dès 1926, encore simple chef communiste de district dans le sud de l’Ukraine, il réclamait contre un opposant « les mesures les plus répressives » et signait des sentences de mort contre des vaincus de la guerre civile36. En mai 1930, il se prêta à une manoeuvre de Staline destinée à purger l’Académie industrielle de Moscou, ce qui assura définitivement sa promotion vers les sommets. Alors qu’il n’évoque pas une seule fois le Goulag et qu’il ne cite que deux fois les « camps » dans son rapport, une photo le montre, l’air très satisfait, en train de visiter, en 1933, le Bielomorkanal, premier grand chantier du Goulag où périrent plusieurs dizaines de milliers de travailleurs forcés37. Et en 1934-1935, comme chef communiste de la ville de Moscou, il supervisa le chantier du métro qui, conduit dans des conditions techniques déplorables, entraîna la mort de centaines d’ouvriers, mais lui assura… l’Ordre de Lénine, sa promotion au Comité central, sa présence sur le Mausolée de Lénine avec les principaux dirigeants lors des grandes cérémonies et son statut de « chouchou » de Staline38.
Nommé chef de la province de Moscou – 11 millions d’habitants sur un territoire équivalent à l’Angleterre et au Pays de Galles réunis -, Khrouchtchev participa activement à la Grande Terreur. A Moscou d’abord où, avec son aval, 35 des plus hauts responsables de la ville – sur 38 ! – furent exécutés, tandis que 136 des 146 dirigeants des autres villes et districts de la province étaient (p.432) condamnés, la plupart de ses adjoints directs étant assassinés. Le 27 juin 1937, le Bureau politique décida pour la province de Moscou d’un quota de 35 000 « ennemis » à arrêter dont 5 000 à exécuter ; le 10 juillet, Khrouchtchev fit rapport à Staline de ce que 41 305 « criminels » avaient été arrêtés et qu’il en avait affecté de son propre chef 8 500 en « lre catégorie » – fusillés39. A l’époque, le futur Premier Secrétaire était en excellente relation avec le chef de la Grande Terreur, Iejov, qui avait été son responsable auprès du Comité central quand il était chef de la cellule de l’Académie industrielle, et avec qui il figurait – certes au dernier rang – sur une grande affiche de 1938 présentant les onze principaux personnages du régime… ce même Iejov qu’il accusait de tous les crimes vingt ans plus tard40.
C’est cette constance dans la terreur qui valut à Khrouchtchev sa brillante promotion, en janvier 1938, à la tête du Parti communiste en Ukraine, un territoire grand comme la France sur lequel il avait tout pouvoir. Là encore, son arrivée coïncida avec l’accélération de la purge : tous les dirigeants ukrainiens – communistes, gouvernementaux et militaires – furent arrêtés et sur les 86 membres du Comité central ukrainien désignés en juin 1938, seuls 3 étaient encore en fonctions un an plus tard. Cette soumission absolue aux ordres de Staline fut récompensée par de très fortes gratifications matérielles et symboliques – c’est alors que Khrouchtchev développa son propre culte de la personnalité -, marquées par la remise au Kremlin de l’Ordre du Drapeau rouge en 1939. De son aveu même, il baignait alors dans l’euphorie.
A partir de septembre 1939 et jusqu’en juin 1941, le maître de l’Ukraine fut chargé de l’annexion et de la soviétisation d’une partie de la Pologne orientale, occupée par l’Armée rouge après les pactes germano-soviétiques du 23 août et du 28 septembre 1939. Dans ce rôle, il ne se contenta pas d’organiser des élections truquées (p.433) destinées à désigner des assemblées qui votèrent à l’unanimité le rattachement à l’URSS41. Il fut mêlé de très près à la terreur qui s’abattit sur les populations. Le 5 mars 1940, le Bureau politique donna l’ordre d’« appliquer la mesure la plus élevée : l’exécution » à 25 700 prisonniers polonais, principalement des officiers, ce qui aboutit, entre autres, au massacre de Katyn – ordre cosigné de Molotov, Vorochilov et Mikoïan. Or, quelques jours plus tôt, Khrouchtchev avait cosigné avec Beria un rapport qui aboutit, dès le 2 mars, à une résolution du Bureau politique, signée de Staline, qui exigeait de déporter les habitants d’une bande de 800 mètres le long de la nouvelle frontière avec le Reich – incluant 9 villes – et surtout de « déporter au Kazakhstan, pour une période de dix ans, toutes les familles des prisonniers de guerre qui se trouvent dans les camps pour officiers, agents de police, gardiens de prison, gendarmes, agents secrets, ex-propriétaires terriens, entrepreneurs, hauts fonctionnaires, soit un total de 22 000 à 25 000 familles42 » – dont les familles des 4 400 officiers assassinés à Katyn.
Au total, sous l’autorité du futur Premier Secrétaire, cette partie orientale de la Pologne annexée à l’URSS dut subir de septembre 1939 à juin 1941 quatre grandes vagues de déportation d’« ennemis du peuple » et de leurs familles, soit environ 392 000 personnes dont environ 30 000 moururent au cours de transfert en déportation, la mort par fusillade de plus de 25 000 personnes, ainsi que l’assassinat sur place par le NKVD de 10 000 à 20 000 prisonniers lors de l’attaque allemande de juin 194143. Sans plus entrer dans les détails, on aura compris que le sympathique bonhomme accueilli en loyal challenger par les Américains en septembre 1959 et en héros par les communistes français lors de sa visite en France au printemps 1960 était en réalité un apparatchik-assassin de première grandeur.
(p.434) Non seulement il ne fait dans son « Rapport secret » aucune allusion à ses activités criminelles à Moscou puis en Ukraine, mais dans ses mémoires, Khrouchtchev se montre particulièrement fier de sa soviétisation de la Pologne orientale : « J’ai organisé et supervisé la soviétisation de l’Ukraine occidentale. […] Je ne veux pas le cacher, ce fut pour moi une époque heureuse. […] A cette époque, nous menions encore des arrestations. C’était notre opinion que ces arrestations servaient à renforcer l’Etat soviétique et à dégager les voies pour la construction du socialisme sur les principes marxistes léninistes44. » Toute la logique totalitaire communiste est là : l’idéologie – les « principes marxistes-léninistes » vouant les « ennemis de classe » à l’extermination -, le projet utopique et absurde – la « construction du socialisme » – et le moyen – la terreur de masse, présentée de manière euphémisée sous le terme d’« arrestations ».
Les mensonges par omission concernant personnellement le Premier Secrétaire dans le « Rapport secret » ne touchent pas seulement à son rôle dans la terreur, mais aussi à ses responsabilités dans les désastres militaires. Alors qu’il démolit systématiquement l’image du « maréchal » Staline comme chef militaire suprême au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Khrouchtchev prend à témoin le maréchal Bagramian, présent parmi les délégués, et rappelle que sur le front sud-ouest dont il était le commissaire politique, en 1942, il demanda à Staline « d’arrêter une opération dont l’objectif à l’époque aurait pu avoir pour l’armée de fatales suites […]45 », ce que, dans un premier temps, Staline refusa. Or il « omet » de préciser que c’est sur ses instances expresses que Staline avait engagé, le 17 mai 1942, contre l’avis de l’Etat-major, une vaste offensive sur Kharkov qui, violemment contre-attaquée par les Allemands, entraîna, du côté soviétique, un désastre (p.435) – 200 000 prisonniers et 67 000 tués -, et surtout ouvrit à la Wehr macht la route de Stalingrad46.
(p.437) D’autre part, aucun des principaux bourreaux de la période stalinienne ne fut inquiété après 1956. Ainsi Ivan Serov fut le président du KGB de 1954 à 1958 – et aussi le responsable de la répression sanglante de la Révolution hongroise pour laquelle il fut décoré d’un Ordre de Lénine -, alors qu’il avait été le grand organisateur de la déportation des Baltes et des Polonais en 1940-1941 et des peuples du Caucase en 1943-1944. Or, dans le « Rapport secret », Khrouchtchev avait expressément dénoncé la déportation des Tchétchènes, des Ingouches, des Karatchaïs, des Kalmouks, des Ingouches et des Balkars. Sans doute le fait que Serov ait été le chef du KGB en Ukraine en 1939-1941, quand Khrouchtchev y était le patron du Parti communiste, avait créé des liens de… complicité. Il mourut dans son lit en 1990, à l’âge de 85 ans, avec le grade de général et couvert d’honneurs.
Enfin, si le processus de réhabilitation d’un certain nombre de victimes s’accéléra, passant de 7 679 entre 1954 et janvier 1956, à plusieurs centaines de milliers, il concerna en priorité de hauts cadres communistes qui avaient eux-mêmes largement contribué à la terreur contre la société lors de la guerre civile, puis de l’industrialisation accélérée et de la collectivisation forcée ; et les victimes « de la base » ne reçurent aucune réparation, ni morale, ni matérielle.
(p.438) A plus long terme, en découplant spectaculairement Lénine de Staline, le « Rapport secret » établit le mythe du « bon communisme » qui rencontra un immense succès, tant en URSS que dans le mouvement communiste international, mais aussi dans le monde non communiste.
Amnésie et amnistie des crimes communistes
(p.446) Face à la chute du mur de Berlin, la tristement célèbre Securitate – la police politique – et les dirigeants communistes roumains craignaient fort de perdre un pouvoir qu’ils contrôlaient absolument depuis quarante- cinq ans. Ils ont donc fait distribuer des armes dans la rue, histoire de provoquer le chaos et de faire croire à une (p.447) révolution démocratique, avec à la clef plus de 1 500 victimes. Simultanément, ils ont organisé l’abominable mise en scène de Timisoara, dévoilant devant les caméras du monde entier un charnier annoncé comme la face visible d’un massacre de plusieurs milliers de personnes, ordonné par Ceausescu. Beau prétexte pour assassiner le dictateur et sa femme et les désigner comme les boucs émissaires de toutes les horreurs de l’un des pires régimes totalitaires en Europe.
Au moment voulu, les manipulateurs sont sortis de l’ombre et, sous le nom de Front du salut national, ont ramassé le pouvoir sans coup férir, poussant sur le devant de la scène un jeune et fringant Premier Ministre, Petre Roman, fils d’un haut nomenklaturiste étroitement lié aux services soviétiques depuis l’avant- guerre.
Inutile de préciser que, dans ces circonstances, les victimes du régime communiste et les démocrates qui espéraient sortir du cauchemar, n’eurent pas droit à la parole. Et quand ils tentèrent d’élever la voix, Ion Iliescu les fit tabasser et bastonner par des bandes de mineurs – ou de membres de l’ex-Securitate déguisés en mineurs – qui avaient ordre de « casser de l’intello ». C’est les 14 et 15 juin 1990 que se déroulèrent à Bucarest ces scènes de lynchage officiel que les Roumains nommèrent « minériades ».
De son côté, Petre Roman affirmait que les victimes du communisme – emprisonnés compris – n’avait pas dépassé les dix mille, alors que le chiffre réel aurait dû être multiplié par cinquante. Enfin, la plainte déposée par le sénateur Constantin Dumitrescu, président de l’Association des anciens détenus politiques, contre deux cents tortionnaires connus de la Securitate, fut classée sans suite et peu après, le sénateur fut victime d’un grave accident de la route provoqué, opération caractéristique des méthodes de la Securitate.
(p.449) les mariages s’y déroulent encore au son des musiques traditionnelles – violon, flûte, tambour.
(p.451) Le Mémorial
Après 1945, Sighet était à la fois l’un des points les 1 plus éloignés de Bucarest et situé sur la frontière soviétique. Pour cette double raison, le régime communiste y emprisonna, à partir de 1948, et y extermina les principales personnalités roumaines de l’opposition. C’est ici que Iuliu Maniu, le grand leader du Parti national- paysan et ex-Premier Ministre, mourut de manque de soins en 1951, tout comme cet autre ex-Premier Ministre, Constantin Bratianu, le chef du Parti national-libéral. L’un des principaux historiens roumains, Gheorge Bratianu, qui avait soutenu sa thèse à la Sorbonne et était le collègue et l’ami de Marc Bloch, y subit le même sort en 1953, à peine âgé de 54 ans. Tout comme deux autres anciens premiers ministres et neuf évêques de rite catholique et gréco-catholique. Au total, cent quarante personnalités assassinées à petit feu et jetées dans les fosses communes d’un terrain vague, dont, aujourd’hui encore, les dépouilles n’ont pu être identifiées.
(p.452) Plus de soixante cellules y sont aménagées en autant de lieux d’exposition. Ici, une cellule est consacrée aux prisons, là au goulag du canal du Danube où périrent des milliers de forçats dans le creusement d’un chantier sans objet, plus loin aux asiles psychiatriques à caractère politique, puis aux lieux d’exécution, et aux fosses communes.
Une place de choix est réservée aux victimes. Une salle est consacrée à Maniu. Une autre à la famille Bra- tianu. Une autre encore aux populations d’origine allemande ou serbe, installées en Roumanie depuis des siècles et déportées en bloc dans la nuit de la Pentecôte 1951 – 43 899 hommes, femmes et enfants abandonnés au beau milieu de la steppe insalubre du Baragan.
Les bourreaux ne sont pas oubliés : ceux du parti communiste – qui ne comptait que quelques centaines de membres lors de sa prise de pouvoir sous occupation soviétique -, ceux de la Securitate – il y a même la reproduction d’une salle d’interrogatoire -, ceux qui mirent en œuvre la terrible expérience de la prison de Pitesti où, sous peine de mort, des dizaines d’étudiants anticommunistes – ou tout simplement catholiques ou orthodoxes – furent contraints de se torturer les uns les autres, tant physiquement que psychologiquement, jusqu’à ce que leur personnalité soit détruite ou… que mort s’ensuive.
Plus surprenantes, les cellules qui évoquent la résistance opposée par la population à l’oppression communiste. La résistance armée dans les montagnes, dont les derniers combattants furent assassinés en 1962. La résistance passive des paysans à la collectivisation. La résistance massive des ouvriers en grève à Brasov le 15 novembre 1987. (p.453) La résistance isolée des intellectuels et dissidents.
(p.454)/2002/ les jeunes Moldaves, en pleine révolte contre leur gouvernement toujours communiste qui tentait de réimposer le russe obligatoire dans les écoles et les lycées. Grandes leçons de dignité et de résistance à l’oppression.
(p.457) L’honneur perdu
de la gauche européenne
Le 25 janvier 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a examiné une résolution et une recommandation concernant la condamnation des « crimes des régimes communistes totalitaires ». Cette séance a donné lieu à un long travail préparatoire d’un groupe de 28 parlementaires – dont 16 venant de pays ayant connu des régimes communistes et 12 d’Europe occidentale – qui, dès le 10 juillet 2003, avaient signé une motion dans ce sens. Le 14 décembre 2004, se tint à Paris une audition spécialisée du Conseil de l’Europe sur le même thème qui entendit quatre experts – le dissident russe bien connu Vladimir Boukovski, deux universitaires estonien et polonais et moi-même au titre de coauteur du Livre noir du communisme – et qui donna lieu à un débat approfondi avec les députés. Enfin, le rapporteur, le député suédois Gôran Lindblad, se rendit en mission d’information en Bulgarie en mai puis en Estonie et en Russie en juin 2005. Le rapport qu’il a rendu le 15 décembre 2005 était donc le fruit d’un travail sérieux et mûri. M. Lindblad y appelle l’attention sur le fait que « le grand public est très peu conscient des crimes commis par les régimes communistes » et il propose au Conseil de l’Europe d’adopter une déclaration officielle en faveur de la condamnation de ces crimes.
(p.458) Le Conseil ne disposant d’aucun pouvoir législatif et encore moins judiciaire ou exécutif, cette résolution, au demeurant fort modérée, appelait donc à une simple condamnation morale. Elle a pourtant déchaîné la fureur des partis communistes et postcommunistes européens. Tandis que le chef du PC grec – l’un des plus orthodoxes – affirmait : « Le Conseil de l’Europe a déclaré la guerre à la classe ouvrière » [sic], le PCF s’est distingué, dès le 12 janvier 2006, par un communiqué qui montre que, derrière ses belles déclarations, ce parti conserve ses vieux réflexes.
Il y critique d’abord l’affirmation de la résolution selon laquelle « le crime de masse a été, dans les pays de pouvoir communiste, non pas le fruit des circonstances mais le résultat d’une politique longuement préméditée […] ». Or les historiens ont bien montré que si, comme pour tout événement, les circonstances ont joué un rôle dans l’émergence, à partir de 1917, de la dimension criminelle du mouvement communiste, c’est bien la (p.459) volonté et l’idéologie d’un homme – Lénine -, de ses successeurs et de ses émules, qui ont transformé dès 1918 cette terreur conjoncturelle en méthode de gouvernement.
Le communiqué en renvoie la responsabilité au « stalinisme […] perversion terrible d’un idéal communiste qui ne peut pas séparer la liberté, la justice sociale et les droits imprescriptibles de la personne ». Or dans aucun texte de Lénine parvenu au pouvoir on ne trouve la moindre référence à ces valeurs, considérées par les bolcheviks comme « bourgeoises ». Au contraire, ce ne sont qu’appels à la guerre civile, à la « dictature du prolétariat », à l’extermination des ennemis de classe, avec passage à l’acte dans la foulée. Marx lui-même, dans le Manifeste du parti communiste de 1848, fustigeait ces « valeurs étemelles » – liberté, justice – et concluait son texte sans ambages : « Les communistes déclarent ouvertement qu’ils ne peuvent atteindre leurs objectifs qu’en détruisant par la violence [souligné par nous] l’ancien ordre social. » Il y a toujours eu une articulation forte entre la doctrine des bolcheviks – le communisme du xxe siècle – et leur pratique.
Le communiqué du PCF s’enfonce ensuite dans la désinformation pure, affirmant que la résolution « vise à établir officiellement un signe d’égalité entre le communisme et le nazisme », voire « en identifiant le communisme et le nazisme » ; il assure même que « le projet de résolution participe de la négation de l’exceptionnalité du phénomène nazi. Il contribue ainsi à la banalisation du génocide des juifs ». Bien entendu, rien – absolument rien – dans la résolution ne correspond à ces déclarations calomnieuses qui montrent que, depuis 1997 et le débat sur le Livre noir du communisme, le PCF continue de refuser toute approche comparative des régimes totalitaires, pourtant admise et pratiquée (p.460) par la plupart des spécialistes européens des mouvements communiste, nazi et fasciste au XXe siècle.
Qualifier de négationnistes ceux qui s’attachent à établir la réalité des crimes du communisme : voilà le genre d’amalgame qui rappelle les plus belles heures du stalinisme triomphant. Le génocide des Juifs d’Europe n’a pas été plus « exceptionnel » que l’extermination par la famine organisée de millions de paysans ukrainiens par Staline en 1932-1933 ou que l’assassinat de près d’un quart de la population cambodgienne par les Khmers rouges de 1975 à 1979. Tenter d’établir, comme le fait le PCF, un classement dans l’horreur et une concurrence des victimes à seule fin de couvrir sa propre responsabilité n’est tout simplement pas digne d’un parti démocratique.
Plus grave encore, le PCF dénonce la résolution comme « un projet liberticide », qui « veut mettre le communisme au ban de la conscience démocratique universelle », qui, « annonce la possibilité de futures interdictions ou condamnations légales » – imaginaires ! -, qui « se prépare donc [ah, ce “donc” !] à instituer de fait un délit d’opinion » – toujours imaginaire – et enfin qui « ferait peser une grave menace sur la vie publique de notre continent ». Rien de moins. Nous atteignons ici la fameuse « double pensée » décrite par Orwell : plus on dénonce un crime, plus on attente aux libertés. CQFD !
(p.461) M. Einarsson, représentant de la Gauche unie (cornmuniste) suédoise a condamné la résolution, estimant que si des « violations massives des droits de l’homme ont été commises », c’était « par des régimes ou par des partis qui se prétendaient communistes » ou qui s’étaient « autoproclamés communistes ». Il ignore sans doute que c’est Lénine en personne qui, en mars 1918, a changé le nom de son parti social-démocrate pour l’intituler communiste.
Quant au représentant du groupe socialiste, il a exigé que le texte soit renvoyé en commission sous prétexte « qu’en condamnant une idéologie, il condamne des idéalistes qui se sont battus pour les libertés ». Question : Iejov, qui organisa sous Staline la Grande Terreur et envoya à la mort 700 000 personnes en 1937-1938, était-il un idéaliste épris de libertés ? Afin de ne pas chagriner quelques milliers de démocrates fourvoyés (p.462) dans le communisme, faut-il oublier les millions de victimes ?
Mais l’opposant le plus farouche a été le député russe Ziouganov, parlant au nom de 73 partis communistes « qui représentent les travailleurs qui n’ont pas la possibilité de donner leur avis » – sans doute pensait-il aux travailleurs nord-coréens, chinois, vietnamiens, cubains… Or Ziouganov n’est autre que le chef du Parti communiste de Russie, successeur en ligne directe des Lénine, Staline, Brejnev et autres Andropov ! Peut-on j imaginer que dix-sept ans après la fin de la Deuxième v Guerre mondiale, le chef d’un parti néonazi aurait pu, devant le Conseil de l’Europe, vilipender une résolution condamnant les crimes du nazisme ?
La plupart des députés est-européens ont, bien entendu, été scandalisés de ces prises de position. Et même Madame Saks, la socialiste estonienne, a refusé de voter avec son groupe : elle a rappelé que « de nombreux parlementaires ont été témoins directs des faits qui sont dénoncés » et a reconnu que « l’histoire exige la recherche de la vérité même s’il est difficile à certains de l’admettre en raison de leur implication person- i nelle ».
Après un tel débat, le résultat du vote n’a guère été surprenant : 99 pour, 42 contre et 12 abstentions. Qu’un tiers des députés se soit prononcé contre une condamnation simplement morale des crimes des régimes communistes, voilà qui en dit long sur la persistance de l’influence de cette idéologie totalitaire et des réseaux qui la portent.
(p.463) Pour être adoptée, une telle recommandation devait recueillir les deux tiers des voix. Il n’y en eut que 85, contre 50 et 11 « courageuses » abstentions. Dans cette affaire, les socialistes ont clairement rejoint les communistes et « post-communistes » pour aboutir à ce résultat qui déshonore non seulement la gauche européenne, mais l’Europe tout entière. Il est extrêmement inquiétant pour la démocratie européenne que, dix-sept ans après l’effondrement du mur de Berlin, on en soit encore là, preuve, s’il en était besoin, de l’utilité pédagogique de la démarche de M. Lindblat et de ses collègues.
La chose est d’autant plus scandaleuse que, au même moment, le commissaire européen aux droits de l’homme, M. Alvaro Gil-Robles, après avoir déclaré le 16 février 2006 sur Europe 1 que « les Européens doivent être particulièrement exigeants sur le respect des valeurs démocratiques », a dénoncé le camp d’internement de Guantanamo en le comparant… au Goulag ! On croit rêver : Guantanamo, 500 prisonniers, arrêtés en Afghanistan alors qu’ils s’entraînaient à la guérilla dans des camps d’Al-Quaida, nourris, soignés, exempts de travail forcé, un seul décès après trois ans d’internement ; le Goulag soviétique : 15 millions de prisonniers,
(p.464) pour la plupart des civils – y compris des femmes et des enfants -, nourris, soignés, logés et contraints à un travail forcé dans des conditions entraînant souvent la mort, des centaines de milliers de victimes – sans compter les innombrables goulags communistes de Chine, du Vietnam, de Corée du nord etc. On peut certes condamner l’absence de statut légal du camp de Guantanamo, mais on demeure stupéfait que M. Gil-Robles, qui est censé être un spécialiste de la violation des droits de l’homme, en arrive à une telle confusion intellectuelle.
(p.465) Chacun sait que les archives du KGB et de l’Armée rouge demeurent largement fermées – a- t-on retrouvé les dizaines de volumes du dossier de Soljénitsyne ? -, tandis que les archives chinoises, vietnamiennes, cubaines, nord-coréennes sont complètement fermées.
Quant aux archives des régimes communistes d’Europe de l’Est, leur situation est diverse. Relativement ouvertes là où la sortie de communisme s’est effectuée par une révolution anticommuniste – en Allemagne, en Estonie, en République tchèque -, elles sont beaucoup plus fermées dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, l’Albanie, la Moldavie – sans parler de l’ex-Yougoslavie – où les réseaux communistes se sont largement maintenus au pouvoir. Je rappellerai ici quelques exemples récents des pressions exercées sur des historiens pour les empêcher d’accéder à une documentation lourde de secrets longtemps cachés.
Ainsi l’historien roumain Marius Oprea, spécialiste de la Securitate – la sinistre police politique de Ceausescu – a eu les plus grandes difficultés à accéder à des archives et a subi de très fortes pressions et menaces depuis ses publications. Il vient heureusement d’être nommé par le Premier Ministre de son pays à la tête d’un (p.466) nouvel institut chargé de rechercher des preuves contre les hommes du régime communiste coupables de crimes et qui n’ont toujours pas été inquiétés2.
Le directeur général des archives d’Etat albanaises, M. Shaban Sinani, qui a publié en 2005 un ouvrage contenant des documents d’archives sur la répression du régime d’Enver Hodja contre le fameux écrivain Ismaïl Kadaré, a été purement et simplement « viré » de son poste3.
Le journaliste polonais Bronislaw Wildstein, qui a signalé en 2004 qu’il existait dans les archives des listes nominatives avec des dossiers – sans même qu’il indiquât le contenu de ces dossiers – a été lui aussi « viré » de son journal.
Il est donc irresponsable pour des historiens français de laisser croire à l’opinion que les archives du communisme sont parfaitement accessibles dans les ex-« démocraties populaires » et dans l’ex-URSS – sans parler des pays où le communisme est toujours au pouvoir -, et que l’on disposerait désormais des chiffres exacts du bilan des crimes communistes. Un travail de plusieurs décennies sera encore indispensable avant d’avoir sous les yeux un tableau complet et fiable.
(p.469) Vous avez dit négationnisme?
Au printemps dernier, Annie Lacroix-Riz, professeur à l’université Paris VII en Histoire contemporaine, a lancé, un site internet pour appeler ses collègues à la mobilisation contre un innommable mensonge qui courrait le monde depuis soixante-dix ans : non, mesdames et messieurs, il n’y a pas eu de famine en Ukraine en 1932- 1933, et encore moins une famine qui aurait fait plusieurs millions de morts, et surtout pas une famine organisée par le pouvoir soviétique lui-même. Pour preuve : des dizaines de dépêches du Quai d’Orsay des années 1930 confirmant l’absence de famine. A la rigueur une disette.
(p.470) Non seulement Mme Lacroix-Riz ignore les témoignages de base, celui de Miron Dolot (Ramsay, 1986), ou le livre-mémorial élaboré dès 1987 par deux journalistes ukrainiens, Lidia Kovalenko et Volodymyr Maniak, qui ont, pour la première fois en URSS, levé un coin du voile sur ce sujet absolument tabou, en recueillant plus de 6 000 témoignages de survivants et en sélectionnant 450 (voir 1933, l’année noire. Témoignages sur la famine en Ukraine, Albin Michel, 2000), mais elle ne tient aucun compte des règles élémentaires du travail de l’historien. A aucun moment elle ne s’interroge sur les conditions de production de ces fameuses et sacro- saintes dépêches du Quai d’Orsay. La « professeure » Lacroix-Riz a-t-elle jamais lu l’inénarrable chapitre consacré par Sophie Cœuré au voyage d’Edouard Her- riot en URSS à l’été 1933 et dont ce mentor de la diplomatie française tira en 1934 un livre, Orient, où il jurait ses grands dieux (déjà) qu’il n’y avait pas de famine en Ukraine, comme le lui avait confirmé… Kalinine, le président du Soviet suprême ! Or les archives soviétiques démontrent que ce voyage avait été entièrement « fabriqué » – « à la Potemkine » – par le NKVD, la police politique de Staline (La Grande lueur à l’Est, Le Seuil, 1999).
De surcroît, elle ignore tout autant les nombreux tra- ’ vaux tirés des archives soviétiques, synthétisés tant par Nicolas Werth dans le Livre noir du communisme (chap. VIII « La grande famine », Robert Laffont, 1997) que par Françoise Thom (Quand tombe la nuit, chap. XII « La “dékoulakisation” et la famine », L’Age d’homme, 2000). Elle ignore plus encore les innombrables ouvrages en langue anglaise, à commencer par le classique de (p.471) Robert Conquest, Sanglantes moissons (Robert Laffont, 1995).
A propos, Mme Lacroix-Riz est-elle au courant que le fameux journaliste américain Walter Duranty, qui avait reçu le prestigieux Prix Pulitzer précisément pour ses reportages « remarquablement informés » sur l’URSS en 1933, censés démontrer l’absence de famine, est l’objet aux Etats-Unis d’une forte campagne réclamant sa déchéance post mortem de ce prix : les archives soviétiques révèlent qu’il était très grassement payé pour écrire ces contre-vérités notoires.
(p.471) Alain Besançon, dans son remarquable ouvrage sur le Malheur du siècle – le XXe -, s’interrogeait sur les raisons qui, en France, ont présidé à une hypermnésie des crimes du nazisme et à une amnésie des crimes du communisme. Il aura ici un début de réponse : pour des raisons qui semblent de toute évidence politiques et idéologiques, certains enseignants chargés de former les jeunes générations pratiquent une euphémisation et une dénégation qui relèvent du négationnisme.
(p.474) Quand il fut expulsé d’URSS en 1974, Alexandre Soljénitsyne lança un appel resté célèbre et qui était au
cœur de son action de dissident : « Ne pas vivre dans le mensonge ». Il le commentait ainsi : « C’est là justement que se trouve, négligée par nous, mais si simple, si accessible, la clef de notre libération : le refus de participer personnellement au mensonge ! »
Il est vrai que le mensonge était un tropisme du pouvoir tsariste, symbolisé par les trop fameux « villages
Potemkine » – mise en scène d’une paysannerie heureuse sur le trajet de la Grande Catherine. Mais le mensonge est surtout une caractéristique fondamentale des régimes totalitaires qui interprètent l’histoire au filtre puissant de leur idéologie – qu’elle soit de classe ou de race -, et qui surtout, après s’être emparé pouvoir, s’arrogent le monopole de l’expression publique de la pensée. A travers le monopole de la presse, de l’enseignement et des médias audiovisuels, et grâce à de puissants appareils de censure appuyés sur la terreur, ils peuvent à loisir imposer leur récit historique, aussi fantaisiste soit-il au regard de la vérité historique.
(p.477) En 2007, tout comme durant la période soviétique, le maître du Kremlin a estimé que l’histoire était une chose trop sérieuse pour être laissée aux historiens et a décidé de réviser à sa manière les manuels scolaires. Il a fait publier un livre intitulé Une histoire de la Russie moderne, 1945-2006 : un manuel pour les enseignants d’histoire. Ignorant délibérément les années 1917-1941, l’ouvrage s’inspire largement de la vulgate soviétique et surtout réhabilite Staline, décrit comme « l’un des dirigeants les plus efficaces de l’URSS » grâce à qui « à la suite des purges, une nouvelle couche administrative s’est formée, adaptée aux objectifs de modernisation » du pays. In fine, ce manuel de formation des enseignants stigmatise les ennemis de Poutine – en particulier l’ancien P-DG de la société Ioukos, Mikhaïl Kodorkovski, jeté en prison, dépouillé de tous ses biens et condamné à des années de camp de concentration – et glorifie la politique du Président. Bref, un petit air bien connu…
(p.479) (…)en 1992-1993, sur pression russe, les 300 000 Géorgiens d’Abkhasie – région autonome de la Géorgie peuplée alors de 500 000 habitants – ont été spoliés et chassés manu militari.

