
Nazismus / Nazism / Nazisme
Victor Klemperer, LTI*, La Langue du Troisième reich, Carnets d’un philologue, éd. Albin Michel, 1996 / Extraits
*LTI = Lingua tertii imperii
(p.12) (…) épargné par les déportations du fait de son union avec une « aryenne ». Jusqu’au matin du 13 février 1945 où les Juifs protégés par un mariage mixte sont à leur tour convoqués et cela, bien qu’Auschwitz soit déjà aux mains des troupes soviétiques. C’est donc au bombardement anglo-américain de Dresde intervenu le soir même que Klemperer devra la vie.
(p.14) Ce philologue apolitique, qui s’était toujours tenu à l’écart de la respublica, est très tôt conscient que derrière l’hystérie de la langue se profile celle des actes. Ses mots les plus durs, il les réserve à ceux qui auraient dû comme lui le comprendre, à cette bourgeoisie d’origine juive qui se voila la face aussi longtemps que faire se put, à ses collègues, intellectuels « aryens » qui démissionnèrent et s’inclinèrent devant la bêtise. Par lâcheté, par confort et conformisme.
(p.19) Communiste, Klemperer ne le devient vraisemblablement que pour autant que cette identité supplante l’ origine juive décrétée contingente. Il adhère à cette culture communiste dont l’élan assimilateur refoule la différence juive. Il l’adopte au point d’être à son tour frappé de cécité lorsque la vague de procès contre les « cosmopolites » déferle au début des années cinquante dans les autres capitales est-européennes, lorsque est révélé un prétendu complot des « blouses blanches », ces médecins presque tous juifs, pour assassiner Staline à Moscou, lorsque les dirigeants d’origine juive sont écartés du pouvoir à Berlin-Est et qu’émigre la grande majorité de la communauté juive. Certes, le mot « juif » n’est alors jamais prononcé, mais cela pouvait-il berner l’ auteur de LTI ? Dans cette partie-là de l’ Allemagne, et pour longtemps, ce mot est désormais devenu tabou. Jusqu’au génocide qui est dissous dans les autres crimes nazis. En 1953, à l’occasion d’une conférence sur l’ancien et le nouvel humanisme « , le philologue Victor Klemperer cite le nom de Staline, qui vient de mourir, parmi les grands humanistes… En d’autres lieux, rappelle non sans Schadenfreude, le magazine (ouest-)allemand Der Spiegel, il aurait parlé du « génie » de Staline . (…)
Nous devons à Tadeusz Borowski, l’auteur du Monde de pierre, un émouvant témoignage sur Klemperer, d’une tout autre nature. L’écrivain polonais, survivant d’ Auschwitz, fait la connaissance du philologue juif allemand peu de temps après la fin de la guerre, Klemperer parcourt alors la zone d’occupation soviétique pour y tenir des conférences sur la paix. Il ne parle pas de Staline mais des crimes de l’hitlérisme, résistant aux insultes antisémites et aux invectives qui l’accueillent le plus souvent (in : Pages polonaises, Seghers, s.d. [1953], préface d’ André Wormser).
(p.20) L’apport de Klemperer à la formation d’une conscience historique fut souterrain et par là même plus profond, décisif. En RDA, pour échapper à l’emprise angoissante de la « présence pleine » des fantômes, on lisait LTI Et l’on se surprenait, parfois, à la lecture de cette analyse d’une langue pervertie par l’ idéologie, à établir d’inquiétants parallèles…
(p.24) Quand Hitler raconte son ascension, ses premiers grands meetings à succès, il vante, tout autant que ses talents d’orateur, la valeur au combat de son service d’ordre, dont le petit groupe engendrera bientôt la SA. Les braunen Sturmabteilungen, dont la mission ne relève que de la force brutale et qui, au cours des meetings, doivent se ruer sur les adversaires politiques et les expulser de la salle, voilà ses véritables complices dans la lutte pour gagner le coeur du peuple, voilà ses premiers héros qu’ il dépeint comme les vainqueurs inondés du sang d’ adversaires plus nombreux, comme les héros exemplaires de combats historiques dans les lieux de réunion. Et l’ on rencontre des descriptions semblables, les mêmes convictions et le même vocabulaire lorsque Goebbels raconte son combat pour Berlin. Ce n’est pas l’esprit qui est vainqueur, il ne s’agit pas de convaincre. Ce n’est même pas la duperie rhétorique qui décide de la victoire de la nouvelle doctrine, mais l’héroïsme des premiers membres de la SA, des « vieux combattants « . C’est ici, selon moi, que les récits de Hitler et de Goebbels sont complétés par la distinction de connaisseur qu’a faite une de nos amies, alors interne à l’hôpital d’une petite ville industrielle de Saxe. « Quand le soir, après les meetings, on nous amenait les blessés, racontait-elle souvent, je savais tout de suite à quel camp chacun d’eux appartenait, même s’il était au lit et déshabillé : ceux qui avaient été blessés à la tête par une chope de bière ou un barreau de chaise étaient des nazis et ceux qui avaient reçu un coup de stylet dans les poumons étaient des communistes. » En matière de gloire, il en va pour la SA de même que pour la littérature italienne : seuls les débuts sont éblouissants.
(p.38) Non, l’effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux, il ne fut obtenu par rien de ce qu’ on était forcé d’ enregistrer par la pensée ou la perception.
Le nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. On a coutume de prendre ce distique de Schiller, qui parle de la « langue cultivée qui poétise et pense à ta place », dans un sens purement esthétique et, pour ainsi dire, anodin. Un vers réussi, dans une « langue cultivée », ne prouve en rien la force poétique de celui qui l’a trouvé ; il n’est pas si difficile, dans une langue éminemment cultivée, de se donner l’air d’un poète et d’un penseur.
Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral d’ autant plus naturellement que je m’ en remets inconsciemment à elle. Et qu’arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d’éléments toxiques ou si l’on en a fait le vecteur de substances toxiques ? Les mots peuvent etre comme de minuscules doses d’arsenic. on les avale sans y prendre garde, elles semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir. Si quelqu’un, au lieu d' »héroïque et vertueux « , dit pendant assez longtemps » fanatique « , il finira par croire vraiment qu’un fanatique est un héros vertueux et que, sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. Les vocables » fanatique » et » fanatisme » n’ont pas été inventés par le Troisième Reich, il n’a fait qu’en modifier la valeur et les a employés plus fréquemment en un jour que d’autres époques en des années. Le Troisième Reich n’ a forgé, (p.39) de son propre cru, qu’un très petit nombre des mots de sa langue, et peut-être même vraisemblablement aucun. La langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers et, pour le reste, emprunte la plupart du temps aux Allemands d’avant Hitler. Mais elle change la valeur des mots et leur fréquence, elle transforme en bien général ce qui, jadis, appartenait à un seul individu ou à un groupuscule, elle réquisitionne pour le Parti ce qui, jadis, était le bien général et, ce faisant, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison, elle assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret.
(p.41) Au début de sa « carrière » politique, Hitler se faisait appeler « le Tambour ». À la suite du putsch de la brasserie du 9 novembre 1923, il déclara au tribunal : « Ce n’est pas par modestie que je voulais devenir tambour, car c’est ce qu’il y a de plus noble, le reste n’est que bagatelle. »
(p.88) Comme tous les autres penseurs des Lumières qui, en tant que philosophes et encyclopédistes, étaient « ses camarades de parti », avant qu’il fit cavalier seul et commençât à les haïr, Rousseau emploie lui aussi « fanatique » dans un sens péjoratif. Dans La Profession defoi du vicaire savoyard, il est dit de l’ apparition de Jésus parmi les zélateurs juifs : « Du sein du plus furieux fanatisme la plus haute sagesse se fit entendre. » Mais peu après, quand le la vicaire, en porte-parole de Jean-Jacques, s’en prend presque plus violemment à l’intolérance des encyclopédistes qu’à celle de l’Église, on peut lire dans une longue note : « Bayle a très bien prouvé que le fanatisme est plus pernicieux que l’athéisme, et cela est incontestable ; mais ce qu’il n’a eu garde de dire, et qui n’est pas moins vrai, c’est que le fanatisme, quoique sanguinaire et cruel, est pourtant une passion grande et forte, qui élève le cœur de l’homme, qui lui fait mépriser la mort, qui lui donne un coeur et qu’il ne faut que mieux diriger pour en tirer les plus sublimes vertus : au lieu que l’irréligion, et en général l’esprit raisonneur et philosophique, attaché à la vie, efféminé, avilit les âmes, concentre toutes les passions dans la bassesse de l’ intérêt particulier, dans l’abjection du moi humain, et sape ainsi à petit bruit les vrais fondements de toute société. »
Ici, le renversement de valeur qui fait du fanatisme une vertu est déjà un fait acquis. Mais, en dépit de la renommée universelle il est resté sans effet, isolé dans cette note. Dans le romanitmse, la glorification non pas du fanatisme mais de la passion (p.89) sous toutes ses formes et pour toutes les causes relevait de Rousseau. À Paris, près du Louvre, se trouve un ravissant petit monument qui représente un tout jeune tambour qui s’élance. Il bat la générale, il réveille la ferveur avec les roulements de son tambour, il est représentatif de l’enthousiasme de la Révolution française et du siècle qui l’a suivie. Ce n’est qu’en 1932 que la figure caricaturale de ce frère de l’enthousiasme qu’est le fanatisme passa la porte de Brandebourg pour la première fois. Jusque-là, le fanatisme était demeuré, malgré cet éloge discret, une qualité réprouvée, quelque chose qui tenait le milieu entre la maladie et le crime.
(p.90) (…) ; le national-socialisme étant fondé sur le fanatisme et pratiquant par tous les moyens l’éducation au fanatisme, « fanatique » a été durant toute l’ère du Troisième Reich un adjectif marquant, au superlatif, une reconnaissance officielle. Il signifie une surenchère par rapport aux concepts de témérité, de dévouement et d’opiniâtreté, ou, plus exactement, une énonciation globale qui amalgame glorieusement toutes ces vertus. Toute connotation péjorative, même la plus discrète, a disparu dans l’usage courant que la LTI fait de ce mot. Les jours de cérémonie, lors de l’anniversaire de Hitler par exemple ou le jour anniversaire de la prise du pouvoir, il n’y avait pas un article de journal, pas un message de félicitations, pas un
appel à quelque partie de la troupe ou quelque organisation, qui ne comprît un « éloge fanatique » ou une « profession de foi fanatique » (…).
(p.114) La dérision, qui, en ce temps-là, était à l’oeuvre contre la volonté du législateur, a été délibérément employée par le gouvernement nazi ; il ne voulait pas seulement mettre les Juifs à l’écart, il voulait aussi les « diffamer ».
(p.115) (…) la tradition est repoussée sans ménagement lorsqu’elle est hostile au principe national. Ici entre en jeu une caractéristique typiquement allemande (…) (p.116) la manie de faire les choses à fond [Gründlichkeit]. Une grande partie de l’Allemagne a été colonisée par les Slaves, et les noms de lieux rappellent cette donnée de l’histoire. Mais tolérer d’ autres
noms de lieux que des noms germaniques va à l’encontre du principe national du Troisième Reich et de sa « fierté raciale ». Ainsi, la carte géographique est-elle épurée jusque dans les moindres détails. En lisant un article de la Dresdener Zeitung du 15 novembre 1942 . « Noms de lieux allemands à l’Est », j’ai noté ceci : Dans le Mecklembourg, on a supprimé l’annexe « Wendisch » [Sorabe] du nom de nombreux villages, en Poméranie, on a germanisé 120 noms de lieux slaves, environ 175 dans le Brandebourg, et les patelins de la vallée de la Spree ont été germanisés tout spécialement. En Silésie, on est parvenu à 2 700 germanisations, et dans la circonscription de Gumbinnen – où c’étaient surtout les terminaisons lituaniennes « racialement inférieures » [niederrassig] qui choquaient, et où, par exemple, on a rendu
« Berninglauken » plus nordique [aufnorden] en le changeant en « Berningen »-, dans la circonscription de Gumbinnen, donc, sur 1 851 communes, pas moins de 1 146 ont été débaptisées.
(p.117) Le »Gau de la Warta », créé le 26 octobre 1939, s’étendait sur une partie de Pologne occidentale comprise entre Lodz (Litzmannstadt), Poznan (Posen) et Inowroclaw (Hohensalza). Le Gauleiter Arthur Greiser s’y rendit responsable de déportations massives et de l’ extermination de Juifs et de Polonais en vue d’une » dépolonisation » /Entpolonisierung/ et d’une » germanisation » /Eindeutschung/ .
(p.154) Mais le Führer ne peut pas parler tous les jours, il ne le doit pas non plus, la divinité se doit en général de trôner au-dessus des nuages et de s’exprimer plus souvent par la bouche de ses prêtres que par la sienne propre. Ce qui, dans le cas de Hitler, est associé à un autre avantage, à savoir que ses serviteurs et amis peuvent l’élever au rang de Sauveur de manière encore plus péremptoire et plus ingénue, le vénérer en choeur encore plus inlassablement qu’il ne le peut lui-même. De 1933 jusqu’en 1945, jusqu’au coeur de la catastrophe berlinoise, cette élévation du Führer au rang de Dieu, cette assimilation de sa personne et de sa conduite au Sauveur et à la Bible eurent lieu jour après jour et marchèrent toujours « comme sur des roulettes », et jamais on ne put la contredire le moins du monde.
(p.182) L’ Essai sur l’inégalité des races humaines de Gobineau, qui parut en quatre volumes de 1853 à 1855, est le premier à enseigner que la race aryenne est supérieure, que la pure germanité est l’aboutissement de la race humaine et même la seule digne de ce nom, et qu’elle est menacée par le sang sémite qui s’insinue partout, dont on doute fortement du caractère humain. Tout ce dont le Troisième Reich a besoin pour son assise philosophique et pour sa
politique est réuni ici, toute application et tout développement ultérieurs, pré-nazis, de cette doctrine renvoient invariablement à ce Gobineau. Lui seul est ou semble être – je laisse cette question en suspens – l’auteur responsable de l’idéologie sanguinaire.
(…) l’idée originale de Gobineau n’était pas d’avoir divisé l’humanité en races, mais plutôt d’avoir relégué le concept général d’humanité au second rang par rapport aux races devenues autonomes, et d’avoir opposé de manière fantaisiste, au sein des races blanches, une race de seigneurs germanique à une race de parasites sémite. Gobineau avait-il sur ce point de quelconques précurseurs ?
(p.185) Le comte Arthur de Gobineau joue un rôle plus important dans l’histoire de la littérature française que dans les sciences naturelles, mais il est caractéristique que cette influence ait été reconnue plus tôt du côté allemand. Dans toutes les phases de l’histoire de France qu’il a vécues – il est né en 1816, mort en 1882 -, il s’est senti spolié de ce qu’il croyait être le droit seigneurial que lui conférait son ascendance noble, spolié de ses potentialités individuelles, par le règne de l’argent, de la bourgeoisie, de la masse aspirant à l’égalité des droits, par la domination de ce qu’il désignait sous le nom de démocratie, qu’il haïssait et dans laquelle il voyait le déclin de l’humanité. Il était convaincu de descendre, en droite ligne et
de sang non mêlé, de la noblesse féodale française et de la haute noblesse franque.
(p.188) Pour apaiser ma conscience de philologue, j’ai essayé pendant l’ère nazie d’établir cette relation entre Gobineau et le romantisme allemand, et je l’ai aujourd’hui un peu renforcée. J’avais en moi, et j’ai toujours, la certitude que le romantisme allemand est très
étroitement relié au nazisme; je crois qu’il l’aurait forcément engendré, même si Gobineau, ce Français allemand de coeur, n’avait jamais existé, lui dont l’admiration envers les Germains
vaut d’ ailleurs bien plus pour les Scandinaves et pour les Anglais que pour les Allemands. Car tout ce qui fait le nazisme se trouve déjà en germe dans le romantisme : le détrônement de la raison, la bestialisation de l’homme, la glorification de l’idée de puissance, du prédateur, de la bête blonde… Mais n’est-ce pas là une terrible accusation portée contre le mouvement intellectuel, précisément, dont la littérature (au sens le plus large) et l’art allemands tirent des valeurs humaines si extraordinaires ?
Elle est justifiée, en dépit de toutes les valeurs créées par le romantisme. » Nous volons haut et descendons d’autant plus bas. » La caractéristique essentielle du mouvement intellectuel le plus allemand qui soit est l’absence de toutes limites.
(p.218) (…) quel fut le jour le plus difficile pourles Juifs dans ces douze années d’enfer ?
Je me repose aujourd’hui la question que je me suis posée, que j’ai posée aux personnes les plus diverses des centaines de fois déjà : quel fut le jour le plus difficile pour les Juifs dans ces douze années d’ enfer ?
Jamais je n’ai obtenu de moi, jamais non plus des personnes interrogées, une réponse autre que celle-ci : le 19 septembre 1941.
À partir de cette date, il fallut porter l’étoile jaune, l’étoile de David à six branches, le chiffon de couleur jaune qui signifie, aujourd’hui encore, peste et quarantaine et qui, au Moyen Âge, était la couleur distinctive des Juifs, la couleur de la jalousie et du fiel dans le sang, la couleur du mal qu’il faut éviter ; le chiffon jaune avec son impression à l’ encre noire : « Juif », le mot encadré par les lignes des deux triangles encastrés l’un dans l’autre, le mot tracé en grosses capitales qui, de par leur espacement et l’outrance de leurs horizontales, simulent les caractères hébraïques.
(p.265) J’étais si sûr de ma qualité d’Allemand, de ma qualité d’Européen, de ma qualité d’être humain, de mon vingtième siècle. Le sang La haine raciale ? Pas aujourd’hui voyons, pas ici au coeur de l’Europe ! Les guerres non plus n’étaient sans doute plus à craindre, pas au coeur de l’Europe… peut-être quelque part dans la péninsule balkanique, en Asie, en Afrique. Jusqu’en plein mois de juin 1914, j’ai considéré comme fantaisiste tout ce qu’on écrivait au sujet de la possibilité d’un retour à des conditions moyenâgeuses, et je prenais pour conditions moyenâgeuses tout ce qui était incompatible avec la paix et la culture.
Puis vint la Première Guerre mondiale, et ma confiance dans la solidité inébranlable de la culture européenne fut sans doute ébranlée. Et, naturellement, je sentais de jour en jour plus vivement la montée du flux antisémite et nazi – je me trouvais parmi des professeurs et des étudiants, et parfois je crois qu’ils étaient pires que la petite bourgeoisie (ils étaient certainement plus coupables).
(p.280) Ce qu’ il y avait d’ étonnant ici, c’ était l’ impudente grossièreté de ces mensonges, qui transparaissait dans les chiffres; la conviction que la masse ne pense pas et qu’on peut parfaitement l’abrutir est à la base de la doctrine nazie. En septembre 1941, le communiqué de l’armée fit savoir que 200 000 hommes étaient encerclés à Kiev ; quelques jours plus tard, on tira de cette même poche de résistance 6o0 000 prisonniers – sans doute rangeait-on à présent l’ensemble de la population civile au nombre des soldats. Autrefois, on souriait volontiers, en Allemagne, de la débauche de chiffres extrême-orientale; dans les dernières années de guerre, il était saisissant de voir les communiqués japonais et allemands rivaliser dans l’ exagération la plus insensée; on se demandait lequel s’inspirait de l’autre, Goebbels du Japonais ou l’ inverse.
(p.284) » Magnanime » [grosszügig] et « grand-allemand » [grossdeutsch] sont déjà bien trop vieux et usés pour enfler encore notablement la grandiloquence de cette phrase. Pourtant la LTI a d’elle-même engendré une telle prolifération du préfixe gross – Grosskundgebung [grande manifestation], Grossoffensive [grande offensive], Grosskampftag [grand jour de combat] – que sous le régime même des nazis, ce bon national-socialiste qu’était Börries von Münchhausen a protesté.
/Frankreich UNTER alles/
(p.361) Parmi les réfugiés, dans le village, se trouvait une ouvrière berlinoise avec ses deux petites filles. Sans que je sache comment, avant même l’arrivée des Américains, nous avons lié conversation. Soit dit en passant, pendant quelques jours, ce fut un plaisir pour moi de l’entendre parler un berlinois si authentique en pleine campagne de Haute-Bavière. Elle était très affable et perçut tout de suite en nous la parenté de convictions politiques. Elle nous
raconta bientôt qu’ en tant que communiste son mari avait longtemps fait de la prison et qu’à présent il était dans un bataillon punitif Dieu sait où, si seulement il était encore en vie. Et elle- (p.362) même, raconta-t-elle avec fierté, avait aussi passé un an à 1’ombre et serait encore en taule aujourd’hui si les prisons n’avaient pas été surchargées et si l’on n’avait pas eu besoin d’elle comme ouvrière.
« Pourquoi étiez-vous donc en taule ? demandai-je. – Ben, j’ai dit des mots qui ont pas plu. » (Elle avait offensé le Führer, les symboles et les institutions du Troisième Reich.) Ce fut l’illumination pour moi. En entendant sa réponse, je vis clair. « Pour des mots », j’entreprendrai le travail sur mon journal. Je voulais détacher le balancier de la masse de toutes mes notes et esquisser seulement, en même temps, les mains qui le tenaient. C’est ainsi
qu’est né ce livre, moins par vanité, je l’espère, que « pour des mots ».
(p.363) RESISTER DANS LA LANGUE
Modestement désigné par son auteur comme le » carnet de notes d’un philologue », LTI est, dans le sens le plus éminent du terme, un manuel de résistance. Que reste-t-il à l’individu solitaire, séparé de tous les autres par le règlement maniaque de la discrimination raciale, marqué, harcelé, criblé d’interdictions, accablé de misère ? Que reste-t-il à cet abandonné en proie à la peur constante de la déportation, mais aussi des bombardements lorsqu’il a été dépouillé de ce qui, dans une société civilisée, constitue un homme ?
La réponse, toute stoïcienne, mise à l’ épreuve de douze années de nazisme par Victor Klemperer (et sa femme Eva qui, non juive, demeura envers et contre toutes les persécutions à son côté, lui évitant ainsi la déportation) est : la liberté intérieure, cette forme de résistance sans panache exhibé qui prend consistance dans l’ obstination, envers et contre tout, de la vigilance intellectuelle du témoin du désastre. » Observe, étudie, grave dans ta mémoire
ce qui arrive » – tels sont l’ auto-exhortation et le commandement qui, dès le premier jour de la catastrophe, vont régler la conduite du professeur d’université réduit à la condition de paria.
La résistance qui se déploie ici ne prend pas la forme du coup d’éclat, de l’action guerrière, elle donne corps à une stratégie de l’endurance, de la persévérance, face à l’adversité la plus extrême et en dépit du danger de tous les instants. Le résistant muet, en (p.364) apparence soumis et apraxique qu’est Klemperer, lance le défi le plus insensé qui soit : celui de maintenir et d’incarner la continuité de la raison, de la pensée critique, de l’identité civilisée lorsque
tout se défait, lorsque tout « nage dans la même sauce brune ». Il est celui qui mise, au péril de sa vie (découvertes, ses notes le condamneraient à coup sûr au camp, voire à la chambre à gaz), sur l’ininterruption du travail d’élucidation dévolu à l’intellectuel – lors même que le poison des mots et des opinions distordus s’infiltre partout et que 1’« épidémie » n’épargne rien ni personne.
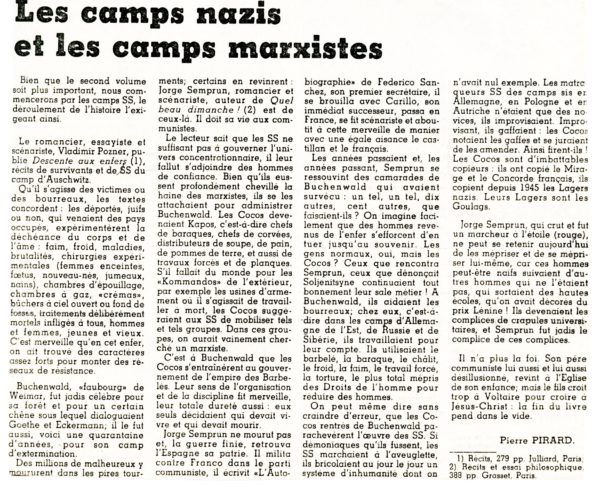
Les camps nazis et les camps marxistes: avec Vladimir Pozner et Jorge Semprun
(Pierre Pirard, in: LB, 28/03/1980)

