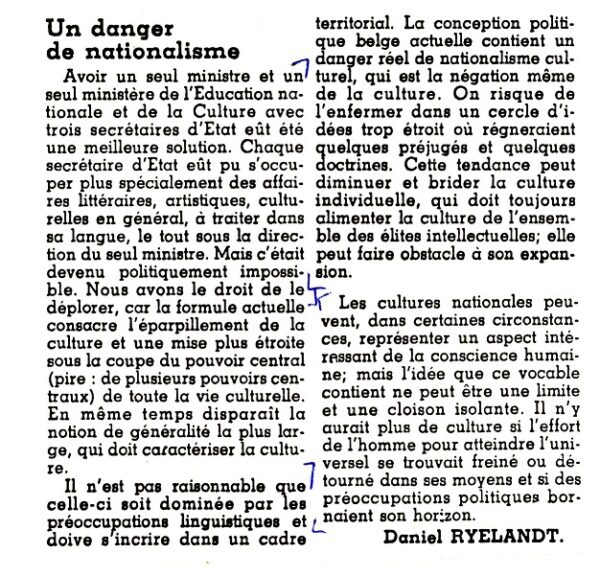PHILOSOPHIE
Platon, in: Magee Bryan, Histoire illustrée de la philosophie, Ed. Le Pré aux Clercs, 2001
(p.29) « Dans sa cité idéale, une classe intermédiaire, qu’il appelle celle des auxiliaires, maintient l’ordre sous la direction d’une classe dominante composée de philosophes. Ainsi présentée, la cité idéale de Platon ressemble aux sociétés communistes du XXe siècle. Il est indéniable que la pensée politique de Platon a exercé une immense influence au fil des siècles, en particulier sur les doctrines totalitaires de droite comme de gauche qui ont caractérisé le XXe siècle.
(p.84) « Dès mes premières années, j’avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. »
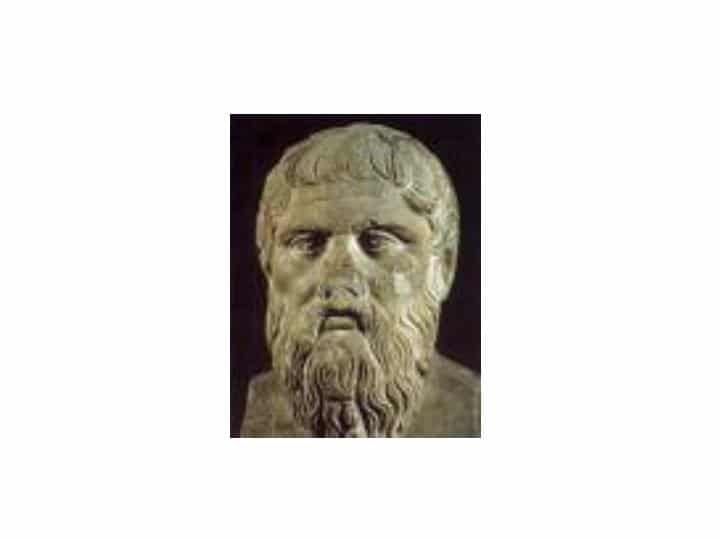
Platon
Aristote, in: Apprendre à philosopher, RBA, 2016
Le fait qu’une grande partie de l’activité philosophique d’Aristote se soit déroulée à Athènes alors qu’il n’était pas Athénien de naissance mais originaire d’une polis périphérique soumise successivement aux empires du Nord et de l’Est, prend ici toute son importance. C’est en effet ce qui l’a empêché de créer sa propre école à Athènes (où les métèques ou étrangers ne jouissaient pas du droit de propriété) et contraint de finir sa vie loin d’Athènes par crainte de représailles des partis les plus anti-macédoniens, qui le considéraient comme allié à l’ennemi. D’une certaine manière, toute la vie et la pensée d’Aristote furent toujours en équilibre instable entre le centre et la périphérie, entre Athènes et la Macédoine, entre l’héritage spirituel de Platon et le développement d’un système philosophique qui lui était propre.
(p.107-108) L’étroite corrélation qu’Aristote établit entre destin individuel et destin collectif pourrait ressembler à une forme précoce de totalitarisme. La pensée politique du Stagirite a été interprétée en ce sens par de nombreux auteurs. Aristote se situe pourtant très loin de Platon (autre philosophe également considéré – peut-être cette fois plus justement – comme totalitaire) et de son gouvernement élitiste aux mains du philosophe-roi. C’est sans méfiance qu’il envisage la participation active de tous les citoyens à la gestion des affaires publiques, aussi active que leurs obligations le leur permettent. Etre citoyen c’est, de fait, gouverner et être gouverné par d’autres citoyens. Ce qui probablement éveille les soupçons sur un possible totalitarisme aristotélicien est sa conception (étrange pour nous) de la liberté. Pour Aristote, la meilleure expression d’une vie libre est celle qui s’inscrit dans une cité bien gouvernée. Donc d’une vie qui se déroule dans une cité dans laquelle l’individu et le groupe tendent vers la même finalité, où il n’y a pas de différences majeures sur le mode idéal de comportement citoyen parce que tous ont grandi au sein d’un projet d’action commun et que les lois de la cité rappellent en permanence quelles sont les bases et l’objectif ultime de ce projet.
Cette conception peut nous sembler aux antipodes de la véritable liberté, parce que les sociétés occidentales d’aujourd’hui, toutes issues dans une plus ou moins grande
mesure du libéralisme moderne, partent du principe qu’être libre signifie faire ce que l’on souhaite, pour autant qu’on ne porte pas préjudice à son voisin. La cité, pour nous aujourd’hui, est celle qui nous permet de développer des projets de vie propres à chacun et où l’on attend que les obligations collectives et les restrictions légales limitent le moins possible le désir de liberté individuelle. L’on peut aisément imaginer à quel point une telle conception aurait paru à un homme tel qu’Aristote aussi éloignée de la liberté « réelle » que nous semble celle qu’il défend. Il s’agit dans les deux cas de notions de la liberté également défendables. La première a été appelée liberté positive (la liberté comprise comme action et participation aux affaires collectives), la seconde, liberté négative (comprise au sens d’obstacle au déroulement sans heurts du projet individuel). Tout débat sur ce que signifie le fait d’être libre doit se situer entre ces deux extrêmes. Et ces deux extrêmes sont aussi éloignés l’un comme l’autre du totalitarisme.
(p.122) L’ONTOLOGIE
L’ontologie est par conséquent l’étude de l’être, pas d’un être particulier, mais de l’être en général. Cependant, en définitive, « être » n’est que l’infinitif d’un verbe. D’un verbe très spécial et très particulier, le seul sémantiquement vide.
C’est-à-dire le seul verbe qui, de fait, ne signifie rien. Coudre, danser, manger, lire et tous les autres verbes qui figurent dans le dictionnaire renvoient à une action sous une forme ou sous une autre. De sorte que si nous disons que quelqu’un coud, danse, mange ou lit, nous pouvons immédiatement nous représenter ce qu’il est en train de faire. Il n’en va pas de même pour le verbe être. Lorsque nous disons que quelqu’un est quelque chose («Jean est grand »), nous ne faisons que connecter le sujet (Jean) à un prédicat (grand). Nous pourrions avoir dit exactement la même chose en écrivant, par exemple « Jean = grand ». Or, il se trouve que même si « être » ne signifie rien en soi, il n’y a rien dont on ne puisse pas dire que « c’est » une chose. Nous ne pouvons imaginer aucun agent au sujet duquel nous ne pourrions pas dire qu’il est quelque chose : la seule manière d’enlever à une chose ou à une personne l’intégralité de ses propriétés est de lui dire qu’elle n’est rien et, dans ce cas, si une chose n’est rien, c’est qu’il n’y a plus ni quoi que ce soit ni rien à qualifier.
(…) Les corps célestes sont encore mobiles. Ils se déplacent selon une trajectoire circulaire qui est la plus parfaite possible parce que c’est celle qui se rapproche le plus de l’immobilité : d’une certaine manière, le mouvement circulaire ne décrit aucun mouvement, puisqu’il s’agit d’un mouvement fermé sur lui- même, un mouvement qui ne vient ni ne va nulle part et pour lequel le point d’origine et le point final seront toujours un seul et même point. C’est pour cette même raison que les astres se déplacent (sans se déplacer) éternellement, parce que seul le mouvement circulaire peut être qualifié d’éternel. Tout autre mouvement qui ne se ferme pas sur lui-même finirait par achopper sur les limites de l’univers. On peut donc dire des sphères célestes que leur substance est (quasiment) un acte pur, parce qu’il ne leur arrive rien et que rien ne vient les modifier puisqu’elles sont emprisonnées dans leur propre dynamique de recommencement éternel. Malgré tout, elles sont encore matière et une étape supplémentaire est nécessaire pour parvenir à l’entité suprême. Ici, Aristote fait faire un pas de plus à son ontologie et se dirige vers la théologie.
(p.125-126) LA THÉOLOGIE
Dieu est celui qui incarne, avec le plus grand degré de perfection, l’idéal d’immobilité et d’immatérialité. Il est immobile parce que se mouvoir signifie changer, être en puissance, c’est-à-dire ne pas être tout à fait, être sans être encore tout à fait. Il est immatériel parce que la matière est synonyme d’indétermination et que l’être suprême est parfaitement et au plus haut degré possible, déterminé. Même dramatiques. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’Aristote l’a dénommée ainsi. Derrière le mot « poétique » se cache le mot poiêsis qui, en grec, désignait toute action tendant vers un but qui lui est extérieur, qu’Aristote distingue de la praxis, qui désigne toute activité qui, au contraire, ne vise que son propre exercice. Le titre du traité, par conséquent, est cohérent avec la division des savoirs proposée par Aristote : les savoirs productifs, pratiques et théoriques.
(p.144) La logique ne nous dit rien au sujet de la « véracité » d’un raisonnement mais nous dit comment nous devons nous y prendre pour que le processus qui mène à la conclusion soit formellement correct. La validité du syllogisme n’est pas pour autant garante de la véracité de ce qu’il affirme.

Aristote
Bryan Magee, Histoire illustrée de la philosophie, Ed. Le Pré aux Clercs, 2001
PENSEURS FRANÇAIS de la REVOLUTION
Rousseau
(p.129) « Avec Rousseau, l’individu n’a absolument pas le droit de dévier de la volonté générale, ce qui rend ce concept de la démocratie compatible avec une absence complète de liberté personnelle. Se trouvaient là formulées pour la première fois, dans la philosophie occidentale certaines des idées fondamentales des grands mouvements totalitaires du XXe siècle, le communisme et le fascisme. Ceux-ci prétendaient de la même manière, représenter le peuple et avoir le soutien des masses, et même être démocratiques, tout en niant les droits individuels ; ils allouaient également un rôle clé aux leaders charismatiques ; et ils livrèrent à la fois une guerre déclarée et une guerre froide aux démocraties anglo-saxonnes qui, elles, se fondaient sur les principes de Locke. »
Voltaire, in: Apprendre à philosopher, RBA, 2016
(p.10) Voltaire rédigea par conséquent une série de volumineux travaux historiques afin de prouver l’absurdité de ces récits. Pour mener cette tâche à bien, il s’appuya sur les nouvelles méthodes scientifiques, qu’il avait découvertes dans les œuvres d’auteurs anglais. Le résultat en fut une nouvelle conception de l’histoire dans laquelle la Providence ne jouait plus aucun rôle. Dans ces écrits apparaît, par ailleurs, le concept de progrès, l’une des idées centrales du siècle des Lumières. Ce concept s’opposait non seulement à l’idée théologique de rédemption, mais également à la philosophie de ceux qui, comme Jean- Jacques Rousseau, un autre grand personnage de l’époque, regrettaient un prétendu « âge d’or » situé dans le passé et prônaient un retour aux coutumes primitives. Les travaux historiques et historiographiques constituent un élément central de la pensée voltairienne. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut comprendre le zèle avec lequel le philosophe défendit chacun de ses travaux lorsqu’ils furent attaqués et le soin qu’il accorda à chacune de leurs rééditions.
(p.12) « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », déclarerait Emmanuel Kant dans la même ligne de pensée, en 1784. Cette attaque contre le monde ankylosé du XVIIe siècle suscita l’intérêt de la nouvelle bourgeoisie, qui tentait de toutes ses forces de se libérer des entraves économiques et sociales qu’il lui imposait encore.
(p.25) Voltaire se dirigea vers l’Angleterre, où il découvrit, à sa plus grande surprise, une sorte de contre-modèle de la société française. Là-bas, les aristocrates cohabitaient avec les commerçants fortunés, les différentes religions étaient tolérées et les sciences, qui progressaient, étaient diffusées. Voltaire, fasciné par cette société, apprit l’anglais, lut Shakespeare, entra en contact avec des personnalités des milieux littéraire et politique, et se familiarisa avec les idées de Locke, de Bacon et de Newton.
(p.29) (…) Ainsi, les Lettres philosophiques, où Voltaire exalte les libertés civiles et politiques qui existent en Angleterre, la tolérance de ses citoyens et les nouvelles méthodes scientifiques suivies par ses savants et ses philosophes, constituent une espèce de manifeste de la philosophie du siècle des Lumières.
(p.41) Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières.
(p.50) Newton introduisit non seulement une nouvelle compréhension du cosmos, mais également une nouvelle méthodologie. A la différence de Descartes, qui acceptait l’existence des idées innées, c’est-à-dire antérieures à l’expérience, et fondait ses recherches sur des principes abstraits, a priori, le scientifique britannique prit l’expérience comme point de départ. Il suivit ainsi une tradition héritée de John Locke, selon laquelle la connaissance commence avec l’expérience. Ces deux positions sont appelées, respectivement, le rationalisme et l’empirisme.
(p.55) (…) la publication de l’œuvre suscita de grandes polémiques et que l‘Encyclopédie fut même mise à l’Index des livres interdits de l’Eglise en 1759. Cette même année, les imprimeurs se virent retirer les permis concédés par l’État pour poursuivre la publication, et D’Alembert abandonna le projet.
(p. 56) L’intention de Voltaire de désacraliser l’histoire était déjà présente dans une série d’ouvrages du XVIIe siècle, comme 1e Dictionnaire historique et critique (1697) de Pierre Bayle, Du peu de certitude qu’il y a dans l’Histoire (1670) de François de La Mothe Le Vayer ou l’Histoire des oracles (1687), de Bernard Le Bovier de Fontenelle. Cependant, ces auteurs tombaient par moments dans un scepticisme historique que Voltaire voulait éviter. Son objectif n’était pas de détruire l’histoire, mais d’en faire une discipline scientifique au même titre que la physique de Newton.
(p.122-123) « Écrasez l’infâme », la phrase avec laquelle il signait ses ouvrages à l’époque, symbolise la devise du siècle. Cette formule est une exhortation à attaquer et anéantir l’intolérance, la superstition et le fanatisme engendrés par les religions révélées. C’est un appel à combattre les passions religieuses, capables de troubler les foules et de les conduire à commettre des actes absolument atroces, comme le massacre de la Saint-Barthélemy, cet assassinat en masse de protestants qui eut lieu en France pendant les guerres de Religion. Cette formule était également une invitation à lutter contre l’intolérance institutionnelle, comme celle dont faisait preuve l’Inquisition en Espagne.
(p.130) Les critiques ne tardèrent pas à condamner ces morales terrestres, y voyant un écart pernicieux du droit chemin de la vertu religieuse et la cause de la décadence de l’époque. Nombre de ces critiques entreprirent de combattre les philosophies « insensées » des philosophes et de récupérer les valeurs chrétiennes. Par exemple, l’abbé Sabatier de Castres, un homme de lettres qui s’arrogea la défense de la religion, déclara que la manie du raisonnement avait provoqué la crise de la pratique de la vertu ; il affirma également que dans son époque frivole et absurde, une philosophie tyrannique étouffait les germes du talent et dégradait la littérature et le goût ; et il exhorta ses lecteurs à réprimer les abus de la « folle raison ». En résumé, de Castres décida de lutter contre les avancées de la philosophie : « Parmi les écrivains contre lesquels nous nous sommes élevés, on distinguera surtout les prétendus philosophes de notre siècle. »
(p.131) Voltaire rejetait le despotisme et la tyrannie. Dans l’article « Tyrannie » du Dictionnaire philosophique, il se demandait, après avoir établi une distinction entre la tyrannie d’un seul et celle de plusieurs, sous laquelle il serait mieux de vivre. Il répondit « sous aucune ». Auparavant, il avait affirmé qu’« on appelle tyran le souverain qui ne connaît de lois que son caprice ». Il soutenait par ailleurs que les hommes étaient par nature égaux, ce qui détonnait avec la structure féodale, c’est-à-dire pyramidale, de la société du XVIIIe siècle:
Les mortels sont égaux ; leur masque est différent.
Nos cinq sens imparfaits, donnés par la nature,
De nos biens, de nos maux, sont la seule mesure.
(p.134) En ce qui concerne l’origine de l’État, Voltaire ne partageait pas l’idée de Jean-Jacques Rousseau, qui affirmait que la société était le produit d’un contrat. Rousseau, qu’il regrettait de ne pas avoir réussi à convaincre de le rejoindre dans sa lutte contre l’« Infâme », estimait que la société est le produit d’un pacte, ou contrat, qui tire les hommes de leur état de nature, ou état présocial. Telle était également la pensée du philosophe anglais John Locke, qui inspira tant Voltaire pour élaborer ses idées philosophiques sur la théorie de la connaissance.
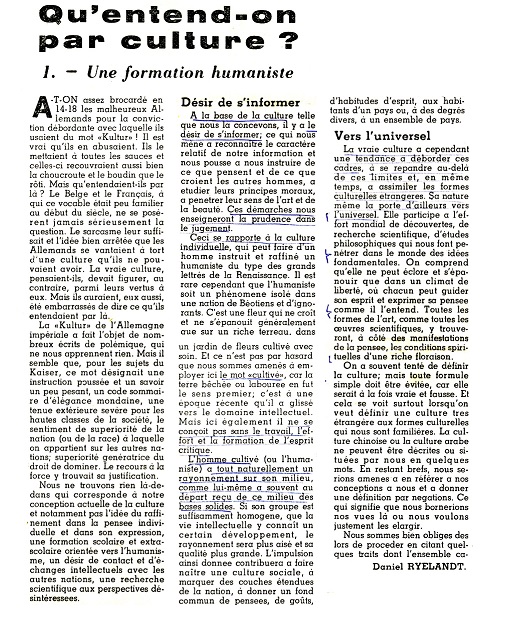
Qu'entend-on par culture? (Daniel Ryelandt)
(LB, 1980s)