
L'Armée belge: histoires / het Belgische leger: verhalen / The BELGIAN ARMY: stories
0 Introduction / 2000 ans d’armée belge

Ambiorix, chef des Gaulois belges
(Tongeren, s.r.)
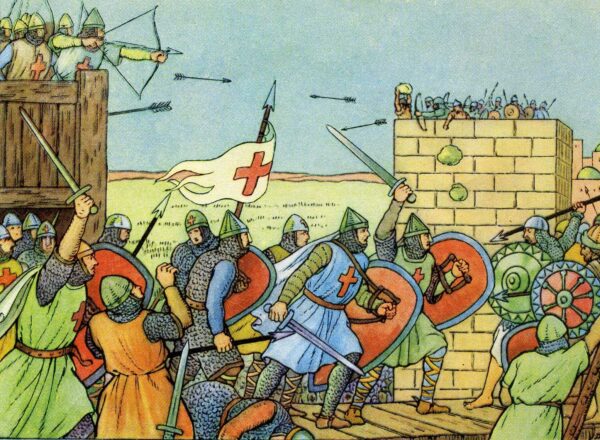
1096- Les Croisés belges

1288 - Jean Ier, duc de Brabant, repousse avec son armée et ses alliés une coalition germanique à la bataille de Woeringen
(Huens)

1302 - de Guldensporenslag (la Bataille des Eperons d'Or) - une armée composée de Flamands (au sens exact du terme: d'habitants grosso modo des provinces de Flandre Occidentale et de Flandre Orientale) et d'alliés namurois, hennuyers, ... écrase l'armée française
Jo Gérard, 2000 ans d’armée belge, LB 22/07/1993
L’armée de métier n’apparaît, chez nous, qu’au XVe siècle et c’est Charles le Téméraire qui systématiquement l’organisera, en développant surtout deux corps : celui des artilleurs et celui du génie.
Plus tard, l’histoire militaire des Belges offrira une autre caractéristique des plus originales : alors que l’ensemble du peuple répugne à porter les armes, on voit à chaque époque quelques milliers de nos ancêtres, les uns lointains, les autres proches, former des régiments qui iront se battre à travers le monde.
Durant la guerre de Trente ans (1618-1648), les bandes wallonnes de t’Serclaes de Tilly ne remportent, outre-Rhin, des victoires en série et Munich élèvera à t’Serclaes une statue colossale.
Au XVIIIe siècle se forme en Belgique un régiment prodigieux, celui des Gardes Wallonnes, au service de Philippe V d’Espagne. Assauts contre Gibraltar, combats à Oran, engagements féroces, retraites parfois dramatiques, les Gardes Wallonnes stupéfient l’Europe par leur gouailleuse vaillance.
Cent ans plus tard, on retrou.ve des Belges sous l’uniforme des zouaves pontificaux, organisés par Mgr de Mérode, qui porte le titre de « Cardinal aux armes »’et à la môme époque, des Belges encore s’engagent dans un corps expéditionnaire qui s’en va protéger, au Mexique, le fragile empire de Charlotte et de Maximilien.
Plus près de nous, on a connu, dans les deux camps de la dernière guerre européenne, la Briciade Piron et les légions levées par Staf De Clercq et par Léon Degrelle. On découvre donc, depuis toujours, dans notre pays, quelques milliers d’hommes prêts à endosser les uniformes les plus variés et à courir la grande aventure de la gloire ou de la mort.
N’a-t-on pas retrouvé, en Libye, le tombeau d’un légionnaire belge au service de l’Empire
romain, deux siècles après J.-C. ?
Après 1830 ?
Quand, le 21 juillet 1831, Léopold Ier prêta serment, devant l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, il avait quelques raisons de dissimuler son inquiétude. Tout permettait decroire, en effet, à un retour offensif des Hollandais après le soulèvement de Bruxelles et la proclamation , d’indépendance du royaume de Belgique. Or, que valait notre armée de 1831 ? Quelques bandes en sarraus bleus, des milices bourgeoises souvent équipées de fu sils de chasse, presque pas d’artillerie, une cavalerie disparate formée de soldats qui, hier encore, appartenaient aux troupes belges de S.M. Guillaume Ier, notre monarque des années 1815-1830.
Les officiers ? Parmi eux, des aventuriers intelligents et actifs comme don Juan van Haelen, des hommes aussi sérieux que l’honnête Pleetinckx, des gail. lards, qui avaient servi sous Napoléon Ier, mais aussi des généraux d’occasion, issus des barricades, hâbleurs, incompétents et incapables d’une stratégie d’envergure. On manquait de tout : balles, poudre, chevaux.
Et ce qui devait arriver, advint. Les Hollandais nous attaquent. C’est la débâcle. Dans une lettre de Léopold Ier, cette phrase : « A Malines, pour garder un pont, j’ai dû m’assoir dessus.» Ce qui nous sauve? L’intervention massive de 50.000 soldats français appelés à la rescousse par le Roi et son remarquable conseiller, Joseph Lebeau.
Le souvenir de la cuisante défaite de l’été 1831 – un mois d’août beaucoup moins glorieux que celui de 1914 – va marquer profondément la politique de Léopold Ier et des hommes d’Etat-de son règne.
Dès 1834, l’Ecole Royale Militaire est fondée et dotée d’un. corps professoral d’élite. Le premier commandant de l’Ecole Militaire est un Français né à Marseille le le 3 octobre 1792. Ce général Chapelié, pendant trente ans, donnerait à l’institution une allure scientifique et une discipline remarquables. L’armée encadrée par les officiers qu’il a formés bénéficie de tout l’appui du Parlement où c’est jusqu’en 1870, la génération des hommes qui firent 1830 qui donne le ton. Un ton très tricolore.
Mais en 1870…
Léopold II qui, en 1865, a succédé à Léopold Ier, est assez. informé de la politique internationale pour savoir que tôt ou tard éclatera un conflit franco-allemand.
Une commission de réforme de l’armée est créée où s’affontent deux thèses. Première these : si on nous déclare la guerre, massons toutes nos troupes à l’abri des forts anversois. Seconde opinion, défendue avec vigueur par le général Renard : « Etendons sur tout notre territoire un puissant réseau de forteresses modernes épaulant les mouvements d’une très mobile armée de campagne, ainsi l’ennemi n’osera pas nous attaquer car il devra non seulement vaincre notre cavalerie, mais, en outre, s’emparer d’Anvers… »
Léopold Ier partage, sans aucun doute, les idées du général Renard, aussi se réjouit-il de voir le Parlement porter 1e contingent annuel des recrues à 12.000 hommes et l’armée adopter l’excellent fusil Albi dont la portée atteint 1.200 mètres et surpasse le « Dreyse » allemand ne tirant que jusqu’à 400 mètres. Nous achetons aussi des canons rayés Wahrendort dont la portée de 4 à 5 kilomètres est remarquable pour l’époque.
Au moment où l’Europe va vivre ces tragiques bouleversements que sont l’écroulement du Second Empire de Napoléon III, et la naissance de l’unité allemande forgée par Bismarck la Belgique selon l’heureuse expression du général Verhaegen est : « Egale à la Prusse par son canon et à la France par son fusil, supérieure par son fusil à la Prusse et par son canon à la France».
Capable d’aligner une armée de 70.000 hommes, notre pays peut faire basculer l’équilibre des forces, car l’Allemagne compte 450.000 soldats et la France 300.000.
Dès l’ouverture des hostilités franco-allemandes, en juillet 1870, Léopold II signé le décret de mobilisation de dix classes en Belgique et notre armée se tient prête à toute éventualité. Notre territoire sera respecté tant par les Allemands que les Français. Evénement heureux, certes, mais qui aura de singulières conséquences pour notre armée. On avait craint sa force qui garantissait. notre neutralité. On oubliera cette force pour ne plus croire qu’à la neutralité.
Fait trop rarement souligné après 1870, s’éteignent les fondateurs de la Belgique indépendante. La génération des Rogier, des Nothomb, des Lebeau meurt, cette génération qui n’avait jamais oublié notre débâcle de 1831.
Avant 1914
En 1886, la Frane adopte le fusil Lebel et l’Allemagne utilise le Mauser. Nous hésitons pendant trois ans entre ces deux armes pour choisir finalement le Mauser; mais notre artillerie, que devient-elle ? Il faut remplacer ses canons Wahrendorf par des pièces modernes. Nous les commanderons chez Krupp et en 1905 seulement, nous achèterons aux usines d’Essen, un « 75 Krupp », qui , ma foi, fera merveille en 1914 contre les troupes du pays qui, nous avait fourni ce redoutable et meurtrier engin !
Notre armée des années 1900 est, aujourd’hui, mal connue. Elle possède, cependant, un remarquable corps d’officiers formés à Beverloo où l’étude du tir est excellente, à Brasschaat dont le polygone d’artillerie apparaît un des meilleurs d’Europe et à Ypres où notre école de cavalerie nous vaut alors de brillants succès internationaux lors des grands concours hippiques.
(…)
1 L’armée belge suivant les époques
1500s – / André Jansen, Les Gardes royales wallonnes, Histoire d’un régiment d’élite, éd. Racines 2003
(p.11) I DE L’INFANTERIE WALLONNE AU RÉGIMENT DES GARDES ROYALES WALLONNES À LA FIN DU RÉGIME ESPAGNOL EN Belgique
L’infanterie wallonne aux Pays-Bas
Depuis Charles Quint jusqu ‘à Ferdinand VII, c ‘est-à-dire depuis le premier tiers du xvie siècle jusqu’au début du XIXe siècle, les Wallons ont servi dans l’armée espagnole. Il convient d’apporter d’emblée une série de précisions à ce sujet, pour éviter toute confusion.
C ‘est Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas espagnols, qui a créé trois régiments d’infanterie wallonne en 1536 et mis à leur tête le comte de Berlaymont, le comte de Rœulx (Jean de Croy) et le comte de Mansfeld. On a recruté ainsi six compagnies ( deux par régiment) de 200 à 500 hommes, compagnies qui portaient le nom d’enseignes. Les enseignes wallonnes comportaient environ 500 hommes et les enseignes flamandes environ 300 hommes.
En 1537, Charles Quint décida de les réunir en un seul régiment sous le nom de Régiment d’infanterie wallonne et en confia le commandement à un colonel. Il comportait des Flamands et des Wallons sous commandement francophone. La plus ancienne patente de colonel strictement wallon remonte à 1556, c’est-à-dire au règne de Philippe II. Elle échut à Charles de Brimeu, comte de Mergen. Par la suite, les grades de colonel échurent aux principales familles nobles des Pays-Bas espagnols : les familles d’Orange, de Croy, de Merode et d’Egmont.
En 1573, au moment du départ du duc d’Albe, nos provinces comptaient jusqu ‘à 20 800 hommes répartis en 104 compagnies où les Wallons étaient majoritaires. À la fin du siècle, on les réduisit à 5 régiments de 10 compagnies seulement qui combattirent en Italie, puis en Allemagne à l’instar des tercios espagnols.
En 1616, Philippe III d’Espagne s’enquiert auprès de l’archiduc Albert des raisons qui font que les compagnies wallonnes comportaient (p.12) jusqu’à 50 mousquetaires alors que les compagnies espagnoles n’en comportaient que 30 et il s’attira cette réponse cinglante: «Parce qu’ils manient le mousquet mieux que tout autre1.»
D’autre part, les compagnies wallonnes comportaient au moins 200 hommes à cette époque, alors que 100 hommes suffisaient à composer une compagnie espagnole.
Au début du XVIIe siècle, il y avait encore dans nos provinces quelque 10 000 hommes d’infanterie composés de Wallons, de Bourguignons, de Luxembourgeois et de Hollandais, outre 30 000 cavaliers. En 1605, le comte de Bergh dirigeait en Flandre un tercio espagnol, deux régiments italiens et quatre régiments wallons, outre des régiments d’infanterie. Il y avait de plus, en Frise, deux tercios espagnols, trois régiments italiens, un régiment wallon et un régiment bourguignon. Le tercio était considéré comme une unité offensive d’élite et son nom provenait du fait qu’à l’origine, seul un tiers de ce régiment était espagnol.
Il serait toutefois faux de croire qu’à cette époque tous les Wallons combattaient dans le même camp. Pendant la guerre de Trente Ans, le comte wallon Bucquoi était le commandant en chef des troupes impériales et avait pour adversaire un autre Wallon, le comte Ernest de Mansfeld. ‘t Serclaes, comte de Tilly, puis Jean de Weert furent deux de ses successeurs belges, alors que le baron de Beck, de Bastogne, était le chef de l’armée espagnole. En d’autres termes, la notion de nationalité n’existait pas et le recrutement des troupes s’effectuait sans distinction d’origine, suivant les besoins stratégiques immédiats. Ainsi, à la fin du xvne siècle, selon le marquis de Merode-Westerloo2, l’armée de nos provinces comprenait 18 régiments d’infanterie et 14 régiments de cavaliers et de dragons.
L’infanterie était composée de quatre corps:
- l’infanterie espagnole, qui comptait 6 régiments de 12 compagnies;
2.l’infanterie italienne, qui comptait 3 régiments de 8 compagnies ;
3.l’infanterie wallonne, qui comptait 6 régiments de 3 compagnies;
- l’infanterie allemande, qui comptait 3 régiments de 10 compagnies.
1 Cte de Clonard, Historia orgânica de las armas de infanteria y caballeria, Madrid, 1851-52.
2 J.Ph.E. de Merode-Westerloo, Mémoires du Feld-Maréchal Comte de Merode-Westerloo, Bruxelles, 1840,1835,1, p. 193.
(p.13) À ces 18 régiments d’infanterie s’ajoutaient 8 compagnies franches (les 5 compagnies de l’empereur Charles Quint, la compagnie d’Anvers, la compagnie de César Morel et celle du château de Gand). Toutes les 8 disposaient d’un statut propre. Les 14 régiments de cavaliers et de dragons comprenaient également 4 corps (espagnol, italo-bour-guignon, wallon et allemand) :
- la cavalerie espagnole, avec 3 régiments de 4 compagnies ;
- la cavalerie italo-bourguignonne, avec un régiment italien de 6 compagnies (de Manuel Fraula) et un régiment bourguignon de 6 compagnies (de Joseph de Toulongeon) ;
- la cavalerie wallonne avec 3 régiments de 4 compagnies;
- la cavalerie allemande avec 3 régiments de 5 compagnies;
5.3 régiments de Gardes, compagnies générales et une compagnie du Prévost-général de l’Armée, François de Castafiaga (ou de Casta-nada) ;
6.3 régiments de Dragons, chaque fois de 9 compagnies soit 27 compagnies.
La totalité de ces troupes ne représentait pas plus de 6 à 8 000 hommes mal payés, mal armés et qui se livraient au pillage ou désertaient même leur corps, en emportant avec eux leurs armes, leurs habits et même de l’argent. Une lettre du maréchal de Puységur, datée de janvier 1701, précise que l’armée espagnole des Pays-Bas aurait dû compter 18 815 hommes, comportant pour un tiers d’officiers dont la moitié était réformée, que le nombre de soldats incluait les invalides et que les cavaliers n’avaient presque plus de chevaux.
Six mille hommes occupaient parallèlement le Milanais, ce qui ne représentait pas plus de 20 000 hommes pour toute l’armée espagnole. Ils contrastaient avec les 300 000 hommes de l’armée française de la même époque.
Il est fréquent de confondre ces régiments wallons avec les Gardes royales wallonnes créées au xvme siècle, en principe pour assurer les protections du souverain espagnol mais utilisées, dès leur création, pour participer aux opérations militaires qui devaient imposer un prince Bourbon sur le trône d’Espagne.
(p.15) Louis XI doit signer la ‘Paix de Rijswijck’ mettant un terme à son impérialisme. /17e s./
(p.20) C ‘est le 17 octobre 1702 que fut créé par ordonnance du roi Philippe V ce régiment d’élite qui allait reprendre le règlement et les ordonnances des Gardes françaises ainsi que leur langue, car jusqu’à la dissolution des Gardes wallonnes, entre 1818 et 1822, les commandements y seront toujours transmis en français, même si les officiers connaissaient l’espagnol et parfois l’italien, comme le montre la correspondance du comte de Gages, commandant général des troupes espagnoles en Italie, de 1742 à 1746.
Selon le premier historien des Gardes wallonnes, le général-baron Guillaume, les fils d’officiers y étaient admis dès l’âge de 16 ans; il ajoute, pour justifier l’enthousiasme de la noblesse belge à s’enrôler dans les premières compagnies wallonnes:
«On haïssait la domination de la France mais les circonstances étaient telles qu’on était réduit à faire des vœux pour qu’un prince français montât sur le trône d’Espagne, cette combinaison paraissant être la seule qui pût empêcher le pays de devenir partie intégrante de la France.» (…)
Les premiers centres de recrutement s’établirent à Lierre, dans la province d’Anvers, en décembre 1703. Ils permirent de recruter plus de 1 300 hommes, soit de quoi fournir 26 compagnies de 50 hommes. On créa tout d’abord deux bataillons de 13 compagnies chacun, dont une de grenadiers et 12 de fusiliers.
- A.GR. Bruxelles, Inventaire n° 10 – Conseil privé de Philippe V, liasse 549, lettre 75.
(p.21) Tous les soldats devaient être originaires des Pays-Bas (…).
(p.27) Le 28 mai 1983, une compagnie de brigadiers participa en Espagne en uniformes du xvme siècle à l’hommage au drapeau qui eut lieu sur la place de la cavalerie de Burgos, à l’occasion de la semaine des Forces armées. Ces grenadiers avaient été complètement vêtus, armés et équipés comme ils l’auraient été en 1783.
D’autre part, la langue de l’aristocratie et de la bourgeoisie a toujours été le français en Flandre mais ce n’était pas la seule raison d’y créer un régiment francophone. Le terme wallon avait été choisi par (p.28) Louis XIV pour désigner un corps belge d’élite qui s’exprimait dans la même langue que la Wallonie, région méridionale de nos provinces. Remarquons qu ‘en Espagne et jusqu ‘à nos jours, le terme flamenco ou flamand désigne les habitants des Pays-Bas du sud, que l’Espagne a toujours appelés Flandes. Par conséquent, les Gardes wallonnes ont recruté indistinctement Flamands et Wallons, c ‘est-à-dire des Belges.
(p.29) Notre décadence était due en grande partie à l’Espagne qui n ‘avait attaché qu ‘une importance stratégique à nos provinces et négligé nos intérêts économiques et politiques. Son administration, imprévoyante pour elle-même comme pour ses vassaux, négligeait les décisions à prendre et maintenait le désarroi dans ses finances. Elle déléguait dans nos provinces des fonctionnaires arrogants au Jieu de chercher sur place des collaborateurs de valeur.
Pour sa défense, nous reconnaîtrons qu’elle avait aussi évité de mécontenter nos populations en respectant toujours ses institutions, ses privilèges et ses corporations. Sous Philippe V, le ministre belge Bergeyck contribua à rétablir l’ordre dans les finances de nos provinces, à réorganiser l’armée, à reprendre certaines de nos villes aux Alliés comme Gand et Bruges en 1708. (…)
La domination française, de 1700 à 1706, allait aussi laisser de pénibles souvenirs dans nos régions. Pourtant, les ordonnances de 1701 et de 1702 avaient favorisé «le progrès de la discipline parmi les troupes du souverain légitime (le jeune Philippe d’Anjou avait été reconnu par l’électeur de Bavière comme notre roi légitime sous le nom de Philippe V) et la réglementation de l’occupation étrangère». Toutefois, «le plat pays en dehors des frais de passage et de repassage des troupes en marche, doit fournir les fourrages, les moyens de transport, (p.30) le bois nécessaire à la construction des palissades et fascines, les pionniers1».
D’une manière générale, les pays occupés étaient obligés de ne servir aux troupes en campagne que le pain de munition et le fourrage. En effet, l’armée française accordait à ses soldats de la viande jusqu’à six fois par semaine. Par contre, le soldat espagnol n ‘en recevait pas car le paysan de son pays n ‘en mangeait qu ‘une ou deux fois par semaine. (…)
Le comte de Bergeyck, nommé surintendant général et ministre de la Guerre, réunit tous les pouvoirs, comme ministre de Louis XTV et de Philippe V dans nos provinces. Il introduisit, rappelons-le, la conscription généralisée par tirage au sort, ce qui provoqua non seulement des protestations mais la fuite des laboureurs et des valets de ferme vers l’étranger ou les bois des campagnes où ils se cachèrent.
En imitation du régime français, Bergeyck centralisa l’administration financière au détriment des provinces et des villes. Il voulut ainsi doubler les revenus des impôts de consommation en réduisant les fraudes. Nommé à Madrid, en août 1711, membre des principaux conseils du gouvernement, Bergeyck proposa une refonte du système espagnol des impôts et de leur perception en supprimant de nombreuses charges et des exemptions de taxes. Pour équiper l’armée du duc de Vendôme, il exigea une contribution d’un doublon par famille2.
1 H. van Houtte, Les occupations étrangères en Belgique sous l’Ancien Régime, Gand, 1930, TI, p. 64.
2 Yves Schmitz, Bergeyck, le Colbert belge, Bruxelles, Les Archers, 1961, pp. 184-188.
(p.60) Le marquis de Bedmar écrivait notamment le 22.IV.1716 à Philippe V : « Les Wallons ont fait tant de prodiges et des actions d’éclat si authentiques dans toutes les occasions, entre autres à Gibraltar, Almansa, Tortosa, Saragosse, Lérida, Villaviciosa et Barcelone, qu’on ne pourrait les oublier. Ils ont donné l’exemple, servi de modèle, inspiré l’émulation du reste de l’infanterie de Votre Majesté. »
(p.64) L’Espagne va connaître de grands généraux :
le marquis de Lede (entre 1714 et 1720), un Flamand ;
le marquis de Montemar (entre 1734 et 1735) qui était espagnol ;
le comte de gages (entre 1742 et 1746) qui était wallon.
(p.68) La conquête de la Sardaigne (1717)
En 1717, l’Espagne décida de reconquérir la Sardaigne. Un Belge, Jean-François Bette, marquis de Lede, fut chargé de diriger l’expédition. Avec 9 000 hommes, 20 navires et une centaine d’embarcations (Alberoni parle même de 300 voiles), il sut arracher l’île à l’Autriche en trois mois. Il s’embarqua à Barcelone en juillet, arriva en Sardaigne le 18 août et prit Cagliari le 13 septembre 1717.
Né au château de Lede, près d’Alost, en 1667, Jean-François-Nico-las Bette, marquis de Lede, grand d’Espagne et chevalier de la Toison d’or, capitaine-général de Sa Majesté Catholique, embrassa rapidement la cause de Philippe d’Anjou et combattit à Ekeren en 1703, avant de rejoindre l’Espagne et de s’y illustrer comme un des meilleurs généraux de Philippe V. En 1720, il dirigea aussi l’expédition d’Afrique (p.69) et après la victoire de Ceuta, fut nommé président du Conseil suprême de la guerre, jusqu’à sa mort, en 1725. Il fut, avec le général Jean Bonaventure-Thierry Dumont de Gages, l’un des trois brillants stratèges au service de l’Espagne au XVIIIe siècle.
La conquête de la Sicile (1718)
En juin 1718, avec tout le régiment des Gardes wallonnes et 30 000 hommes de troupes, le marquis de Lede enleva la Sicile à la Savoie en 6 semaines, après de brillantes victoires à Palerme, Francavilla et Messine. Il avait utilisé à cette fin 40 navires, 340 embarcations, 100 canons de siège et 25 de campagne, 40 mortiers, 100 000 projectiles et 20 000 quintaux de poudre.
(p.73) L’expédition de Ceuta (1720-1721)
Le 22 octobre 1720, le port de Cadix accueillit 57 bâtiments de charge et 32 bateaux plats en provenance de La Corogne ainsi que 5 000 hommes dont 17 compagnies de Gardes wallonnes, sous le commandement du marquis de Lede. Celui-ci fit transporter toutes ces troupes le mois suivant en Afrique pour obtenir la levée du blocus de Ceuta que l’empereur du Maroc assiégeait depuis 20 ans. Selon le comte de Glymes, la traversée maritime fut difficile. Par le comte de Gonricourt, colonel du régiment de cavalerie de Milan, on apprend que le marquis de Lede, informé du désir de revanche des Maures, qui avaient regroupé 60 000 hommes, renforça la défense du camp retranché de Ceuta, avec fossés et artillerie bien que ne disposant que de 12 000 fantassins en 16 bataillons et de 4 000 cavaliers et dragons, répartis en 32 escadrons. Le 21 décembre 1720, les Maures lancent une très grande attaque contre ce camp, soutenue par un feu si terrible que les vieux officiers espagnols déclarent n’en avoir jamais vu de pareil en Europe. Les 60 000 combattants mauresques perdirent de 7 000 à 8 000 hommes, morts ou blessés, alors que Lede limita ses pertes à 500 hommes. Le marquis de Châteaufort, malade, avait pourtant voulu participer à l’action. Le baron d’Ittre, colonel du régiment de Belgique, avait souffert deux contusions et le cheval du marquis de Lede avait essuyé deux coups de fusil. Le 18 février 1721, Lede décide de retourner
- Ozanam, Diplomacia de Fernando VI, Madrid, 1975, p. 422.
(p.74) en Espagne après avoir fait sauter les maisons où les officiers avaient logé ainsi que les principaux ouvrages de défense et il retira toute l’artillerie, sans perdre un seul homme.
Des bateaux plats, dès le 10 janvier 1721, avaient quitté Alicante pour ramener de Ceuta les dragons de l’armée d’Afrique ainsi que les trois bataillons des Gardes wallonnes et les trois bataillons de Gardes espagnoles, au début du mois de mars. On ne laissa à Ceuta que 10 bataillons, ce qui était bien peu pour résister à 24 000 fantassins mauresques et 15 000 chevaux. Le 1er août 1720, le marquis de Lede avait été reçu à la cour pour apprendre sa nomination de vice-roi des deux Andalousies. Et le 25 novembre, le marquis de Fréneau avait montré au roi les drapeaux et les étendards pris par l’armée de Lede aux Maures d’Afrique.
(p.75) La reconquête d’Oran (1732)
Les tribulations de l’Espagne avaient permis aux Maures de prendre Oran à Philippe V dès 1708. Mais, le 15 juin 1732, une flotte espagnole transporta 28 000 hommes – dont 4 bataillons de Gardes wallonnes – sur les côtes africaines, pour reprendre la ville. Le marquis de Châteaufort obtint la capitulation de Mers el-Kébir et d’Oran après avoir mis en fuite Turcs et Maures avec ses Gardes wallons.
(p.77) 1717
Conquête de la Sardaigne par le marquis belge de Lede avec les Gardes wallonnes, 9 000 hommes et 20 navires.
1718-1719
Conquête de la Sicile par le marquis belge de Lede avec les Gardes wallonnes, 30 000 hommes et 40 navires.
Le régiment des Gardes wallonnes est réduit à 2 100 hommes mal nourris, mécontents, malades, tentés de déserter. La flotte anglaise de l’amiral Byng détruit la flotte espagnole devant Messine, ce qui permet aux Autrichiens de débarquer 16 000 hommes en renfort et de contester la Sicile aux Espagnols.
(p.103) A Guerre de Succession de Pologne (…)
1732
L’infant Carlos envahit la Toscane avec 16 000 hommes et les Gardes wallons et se fait proclamer héritier du grand-duc Jean-Gaston de Médicis, sans postérité.
(…)
1734
40 000 Français envahissent le Milanais.
30 000 Espagnols, avec le marquis de Montemar, débarquent en Toscane et descendent vers le sud pour conquérir le royaume des Deux-Siciles par la victoire de Bitonto (rôle important des Wallons). Deux puis cinq bataillons de Gardes wallons passent de Sicile à Grosseto et Livourne pour assister l’armée française du maréchal de Villars aux sièges de Monte Filippo et de la Mirandola, avant de remonter vers la Lombardie.
L’infant Carlos constitue dans son royaume des Deux-Siciles une armée de 30 000 hommes + 4 régiments wallons (Bourgogne, Hainaut, Namur, Anvers) pour repousser une armée sarde de 37 000 hommes et 6 000 cavaliers qui empêchaient sa jonction avec l’armée hispano-
française du nord de l’Italie (en Piémont et en Toscane).
(p.174) En décembre 1802, dans le cadre des officiers, on trouve entre autres le capitaine Philippe de Saint-Marcq qui soutiendra le second siège de Saragosse comme lieutenant-colonel contre les troupes impériales françaises, le capitaine baron de Warsage, qui sera son adjoint, (…).
(p.177) 1794
L’armée française repousse les Espagnols en territoire catalan. Les Gardes wallonnes sont à peu près les seules à pouvoir retenir l’offensive du général français Augereau devant Gerona.
(p.178) Un bataillon des Gardes wallonnes en Amérique du Sud (1798-1800) : Signalé par sa résistance au bombardement anglais de Cadix, le sous-lieutenant Joseph-Marie Potesta fut désigné pour accompagner 600 Gardes wallonnes au Surinam pour y aider les Hollandais à soutenir le blocus anglais.
Grâce à sa correspondance, nous connaissons l’odyssée de ces 600 Gardes qui gagnèrent d’abord Cayenne puis la Nouvelle-Amsterdam, en face de Paramaribo, où ils sont immédiatement saisis de fièvres, d’érysipèle ou d’entérites dues à une alimentation inadéquate et à des conditions climatiques tropicales.
Depuis leur départ d’Espagne (octobre 1798) à la date de leur capitulation (août 1799), un tiers avait péri de maladies. Les survivants, (p.179) qui ne tirèrent pas un coup de fusil, furent transférés en Martinique par la flotte britannique puis tardivement ramenés en Angleterre d’abord, en Espagne ensuite.
(…)
Né à Liège en 1773, le lieutenant des Gardes wallonnes Joseph-Marie Potesta fut réformé, c’est-à-dire pensionné, à l’âge de 41 ans, avec le grade de lieutenant-colonel de Sa Majesté Catholique, et il hérita plus tard du titre de baron accordé à son père par le roi de Hollande. Il mourut en 1851 au château des Waleffes, dans la province de Liège.
(p.181) /1808/
La place de Figueras, tenue par un détachement des Gardes wallonnes, fut également occupée sans surprise. (…) ‘Un bataillon du général français Duhesme lança l’un de ses bataillons à l’assaut de la forteresse de Montjuich à Barcelone et massacra les Gardes wallonnes qui étaient de garde.
(p.185) Les sapeurs français parvinrent à ruiner le couvent de Santa Engracia que tenait le comte belge de Romrée, brigadier général et capitaine des Gardes wallonnes.
(p.186-187) /1809/
Le 18 février, le baron de Warsage, l’un des deux lieutenants belges du général Palafox, fut tué comme capitaine des Gardes wallonnes : Joseph-Marie de l’Hostellerie de la Falloise avait participé à toutes les campagnes contre la République française. (…)
(p.189) On s’étonnera qu’une demi-douzaine d’officiers belges des Gardes wallonnes se soient illustrés à la défense de Saragosse, pendant les années 1808-1809.
(p.190) Tableau synoptique
1807
Selon le traité de Fontainebleau (27 octobre 1807), la France et l’Espagne devaient se partager le Portugal et le 3e bataillon des Gardes wallonnes devait participer à l’opération.
Figueras, tenu par un détachement des Gardes wallonnes, fut occupée par surprise par les troupes françaises à la mi-février. Quelques jours plus tard, les troupes françaises du général Duhesme attaquèrent le fort de Montjuich à Barcelone et y massacrèrent tous les Gardes wallons qui résistèrent.
Devant ces trahisons, le faible Charles IV choisit de se réfugier à Séville, protégé par le premier bataillon des Gardes wallonnes.
1808
L’insurrection populaire du 2 mai 1808 entraîna à sa suite les Gardes wallonnes qui prirent la parti de lutter pour l’indépendance espagnole contre la collaboration avec le roi Joseph, frère de Napoléon. La résistance se cristallisera autour de Saragosse, le 24 mai 1808. Un jeune capitaine espagnol de 32 ans, José de Palafox y Melzi, en reçut le commandement.
Le premier siège de la ville, tenu par 12 000 Français, commencera le 15 juin.
Les assiégés, au nombre de 12 000 également, appelèrent la population à participer à la résistance. Les paysans s’armèrent et fortifièrent les principaux couvents de la ville, jusqu ‘à former 20 000 défenseurs. La chute de Madrid et la défaite de Bailén obligèrent les Français à lever le siège à la mi-août 1808. C ‘est à ce moment que le général belge Philippe Le Clément de Saint-Marcq, réfugié à Valence pour échapper au roi Joseph, y regroupe 5 000 hommes, vole au secours de Saragosse à la demande de la Junte des Insurgés et remplace Palafox, accablé par la maladie, à la tête des défenseurs de Saragosse. 28 000 Français recommencent le siège le 19 décembre 1808 sous les ordres des maréchaux Moncey et Mortier.
Environ 50 000 hommes défendaient la ville avec une volonté de résister jusqu’au dernier mais sans disposer d’un armement pareil aux Français. Il fallut pourtant faire miner chaque centre de résistance et affamer toute la population pour obtenir la capitulation. Celle-ci intervint le 20 février 1809, après un siège infernal au cours duquel les épidémies, le manque d’hygiène, de médicaments et de vivres tuèrent autant que la mitraille.
(p.191) Près de 500 Gardes wallons avaient participé à cette épopée ainsi que le général de Saint-Marcq et les capitaines des Gardes wallonnes, comtes de Romrée et de la Barre et le baron de Warsage. Ce fut le dernier fait des Gardes wallonnes en Espagne. Leur régiment changea d’abord de nom puis fut dissous par Ferdinand VII en 1822.
(p.193-195) VIII LISTE DES COLONELS SUCCESSIFS DU RÉGIMENT DES GARDES ROYALES WALLONNES
1 Charles-Antoine de Croy, duc d’Havre (1702-1710)
Reçut le commandement du régiment à sa création. Né en 1683, il fut tué à la bataille de Saragosse, en 1710. Il fut fait Grand d’Espagne et reçut la Toison d’or en 1707. Son portrait exécuté par le peintre français Rigaud en 1704 figure au château du Rœulx, près de Mons, propriété des princes de Croy.
2 Jean-Baptiste-François de Croy ( 1710-1716)
Reprit le commandement du régiment à la mort de son frère aîné. Né en 1687, il démissionna le 16 octobre 1716, après avoir lutté vainement contre les intrigues de la cour d’Espagne qui tendaient à réduire son régiment, après avoir freiné à plusieurs reprises le paiement de ses soldes. Il mourut en 1727.
3 Charles de Montmorency, prince de Robecque (1716) Nommé colonel le 1er octobre 1716, il mourut le même mois à Madrid.
4 Guillaume de Melun, marquis de Risbourg ou de Richebourg (1716-1734)
Reprit le commandement en novembre 1716 et le garda jusqu’à sa mort en 1734. Il était apparenté aux Croy mais originaire de la région d’Arras.
5 Ignace-François de Brabant, comte de Glymes (1734-1754).
Reprit le commandement du régiment avec le grade de lieutenant-colonel jusqu’en 1746, date à laquelle il fut enfin nommé colonel. Il commandait simultanément le corps expéditionnaire espagnol installé au Dauphiné sous la direction de l’infant Philippe, pour envahir la Savoie et le Piémont. Or, le régiment des Gardes wallonnes combattait en Italie centrale sous la direction de son major, le futur comte de Gages. Le général Guillaume présente dans son Histoire des Gardes wallonnes un portrait du comte de Glymes, datant du xviie siècle et visible au château de La Souveraine près de Jodoigne, appartenant à une autre branche de la famille des Glymes, comme s’il s’agissait du portrait du comte Ignace-François de Glymes de Brabant.
6 Jean-Juste-Ferdinand-Joseph, prince de Croy, comte de Priego (1754-1778).
Neveu du premier colonel et fils du deuxième colonel des Gardes, il reçut son commandement sous Ferdinand VI et l’exerça jusqu’en 1778, participant à la campagne du Portugal de 1762-63, à la répression des insurrections contre Esquilache en 1766 et à l’expédition d’Alger en 1775. Il démissionna en 1778 et son portrait figure au château du Rceulx.
7 Joseph, marquis de Trazegnies-Azuara (1778-1789). Remplaça le comte de Priego, démissionnaire, comme capitaine du régiment et le commandement resta vacant pendant que se multipliaient les demandes de mises à la retraite.
8 Théodore-François, chevalier de Croix (1789-1790).
Nommé colonel du régiment en récompense de son action en Amérique, il mourut à Madrid avant d’avoir pu exercer son commandement, en avril 1791. Son portrait en uniforme de vice-roi du Pérou figure au château de Franc-Waret et à l’hôtel du marquis d’Andigné à Paris.
9 Paolo di Sangro, prince de Castelfranco, marquis de Santo Stefa-«0(1791-1815).
Né à Naples en 1746, fils de Raimondo di Sangro, il s’engagea dans la compagnie flamande des Gardes du corps avant de connaître un avancement fulgurant dû à la protection du comte de Riccia d’abord, de la reine Marie-Amélie d’Espagne ensuite. Capitaine-général de l’armée espagnole pendant la guerre contre la Convention (1793-95), il fut nommé colonel du régiment des Gardes wallonnes en 1791, puis ambassadeur en Autriche de 1802 à 1808, date à laquelle il fut sommé de reprendre son commandement de colonel. Après avoir momentanément servi le roi Joseph, il fut convoqué à Rayonne par Napoléon et incarcéré au château de Portici jusqu ‘au congrès de Vienne. Il mourut en janvier 1815 après avoir retrouvé son commandement.
10 Claude-Anne de Rouvroy, marquis puis duc de Saint-Simon-Montbléru, émigré français, reprit le commandement des Gardes wallonnes de 1815 à sa mort en 1819.
- Le dernier colonel fut le marquis de Castelfranco, Espagnol qui conserva le commandement jusqu’à la dissolution du régiment en 1822.
(p.206) Soulignons que la moralité, l’honorabilité et l’héroïsme des Gardes wallonnes se sont dégradés parallèlement aux difficultés de sélection et de recrutement. Les Archives générales du royaume de Bruxelles révèlent que les Gardes, officiers, sous-officiers et soldats avaient été recrutés à l’origine (1702) parmi les éléments les plus reconnaissables des familles aristocratiques belges et des troupes en service. Cette situation s’est maintenue pendant la première partie du xvme siècle. Par la suite, les difficultés de recrutement dans les Pays-Bas autrichiens et dans la principauté de Liège et les obstacles géographiques forcèrent les recruteurs à se montrer moins exigeants. Dans le dernier tiers du siècle, on accepta même des Français puis surtout des Espagnols parmi les Gardes, sans se préoccuper trop de leur moralité. Le régiment des Gardes wallonnes devint une sorte de Légion étrangère où la soldatesque comprenait souvent des vagabonds, des désœuvrés, tentés par les possibilités de vol et de pillage. Quand ces possibilités manquaient, ils désertaient. Beaucoup déjeunes soldats s’engageaient également pour échapper à l’autorité paternelle, aux poursuites judiciaires, à la misère physique ou morale car de nombreux campagnards isolés en ville, des veufs ou des célibataires sans relations, préféraient la protection de l’armée. L’attrait de l’uniforme, de la vie turbulente, de l’aventure, décidait de plus (p.207) d’une carrière militaire. Des motifs moins avouables existaient également: la recherche du profit, la possibilité de pillage ou de la simple maraude. Tels étaient devenus souvent ceux des Gardes wallonnes à la fin du xviiIe siècle, au niveau des soldats tout au moins.
Conclusions
(…) Les Gardes wallonnes avaient contribué, dès les premières campagnes, au succès des armées bourboniennes. De Philippe V à Ferdinand VII, elles avaient servi d’abord leur souverain, ensuite l’Espagne et jusque dans les derniers combats, la résistance à l’envahisseur napoléonien, puis le parti de l’opprimé. À ce titre, la Garde wallonne a su montrer son courage, son abnégation et son héroïsme, les vertus les plus appréciées du combattant. Il nous a paru souhaitable de rappeler l’histoire aujourd ‘hui bien oubliée de ces jeunes gens qui ont quitté volontairement leur patrie, leur famille et la quiétude de leurs foyers pour aller risquer leur existence dans des conditions matérielles précaires, au service d’un souverain souvent peu connu, avec l’espoir bien ténu d’aventures exceptionnelles, de bénéfices problématiques, à la découverte de nouvelles contrées, de nouvelles coutumes, de nouveaux climats, dans des pays lointains, avec le risque d’y mourir, oubliés de tous, au bord d’un champ de bataille ou dans un hôpital improvisé, des suites de blessures, de maladies ou d’insuffisance alimentaire.

Petite histoire des uniformes de l'armée belge
(Jo Gérard,) in: LB, 13/11/1987


La psychologie des officiers de l'armée belge
(Jo Gérard,) in: LB, 13/11/1987
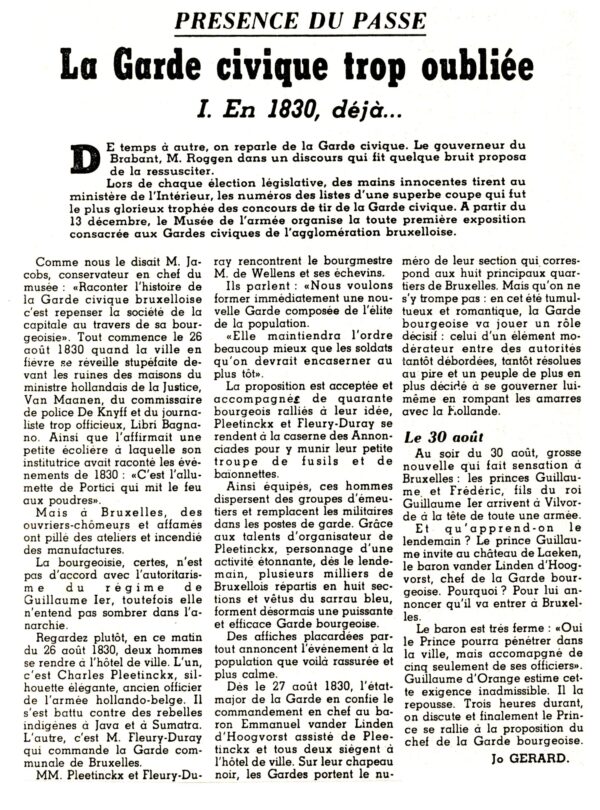
1830-1914 - La Garde civique
(Jo Gérard, La Garde civique trop oubliée…, LB, 18-20-21/12/1988)


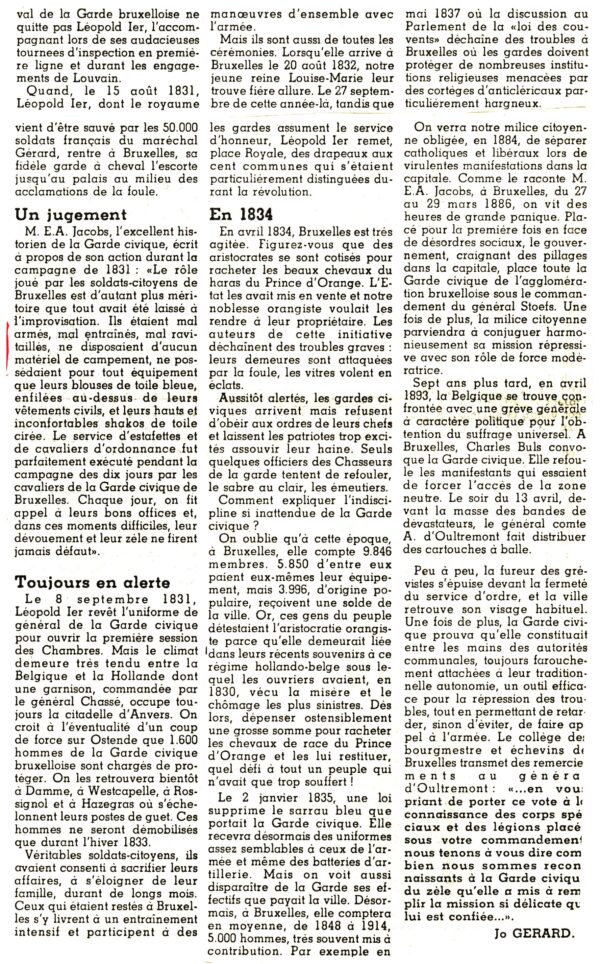

Clio, Les femmes-soldats à travers l’histoire, V Ces cantinières, PP ? 16/08/1979, p.56-60
AVANT 1789, les femmes sont considérées par les généraux comme de redoutables adversaires.
Pourquoi? Parce que, dès qu’une armée se met en marche, elles la suivent, aussi retardent-elles la régression des troupes, tout en transformant les camps en lieux plutôt croquignolets, car ce n’est pas le vent qui, le soir, agite et boursoufle les tentes, mais, selon le mot du prince Eugène de Savoie : « Les appas et les ébats des filles de mauvaise vie ».
Que d’espionnes aussi, parmi ces joyeuses garces.
Afin d’éloigner des troupiers les filles d’Eve, on ne se montrait guère tendre envers elles. Les surprend-on en galante compagnie avec un soldat, on less déshabille et on les fouette. Heureuses sont-elles lorsqu’on ne leur inflige pas un affreux supplice : se tenir à califourchon sur une poutre, tandis qu’on accroche des boulets à leurs chevilles pour accentuer la douleur.
Dans l’armée autrichienne, un officier avait même inventé une pàte noire dont on enduisait le visage les cocottes, et l’auteur de cet onguent prétendait que, malgré les plus vigoureux des nettoyages, il tenait six mois durant.
Vint la Révolution de 1789 et, dans les armées déguenillées, braillardes, buvantes, troussantes et sublimes de la République, des femmes par milliers.
Elles font les campagnes d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, et Bonaparte, furieux, constatera que même en Egypte elles seront un peu là ! De ce temps date la cantinière dont un officier de la 3rande Armée nous dessine ce croquis : – Ces dames commençaient par suivre un soldat lui leur avait inspiré de tendres sentiments. On les voyait d’abord cheminer à pied avec un baril d’eaule-vie en sautoir. Huit jours après elles étaient commodément assises sur un cheval trouvé – A gauche, à droite, par devant, par derrière, les barils et les cervelas, le fromage et les saucissons, Habilement disposés, se tenaient en équilibre.
– Le mois ne finissait jamais sans qu’un fourgon à deux chevaux, rempli de provisions variées, fût là pour prouver la prospérité croissante de leur industrie.
» Il arrivait qu’un parti de cosaques dévalisait ces dames, alors elles recommençaient et bientôt il n’y paraissait plus.
Mais comment sont-elles vêtues ?
L’officier nous le dit : – Il était assez drôle de voir ces dames vêtues de robes de velours ou de satin trouvées par des soldats qui les leur vendaient moyennant quelques verres d’eau-de-vie. Le reste de la toilette n’était pas en harmonie, car les bottes à la hussarde ou le bonnet de police le complétaient d’une manière grotesque.
Supposez à présent quelques luronnes ainsi vêtues à califourchon sur un cheval flanqué de deux énormes paniers, et vous aurez une idée du coup d’oeil bizarre que tout cela représentait.
Les organiser?
Peu à peu, et sur l’insistance de Napoléon, la situation des cantinières se régularise. Leur profession est désormais réservée aux épouses légitimes de caporaux et de soldats. Très populaires, les cantinières font, à l’occasion, le coup de feu, elles soignent les blessés, elles réussissent dans les circonstances les plus difficiles à nourrir les hommes.
Les premiers romanciers à leur consacrer un livre aussi pittoresque qu’émouvant seront Erckmann et Chatrian. Leur « Madame Thérèse » est un petit chef-d’oeuvre.
En 1814, Guillaume Ier, notre nouveau roi hollandais, signe un décret admettant par régiment une cantinière.
Les vainqueurs de 1830 octroient un statut aux cantinières. Ils les désignent curieusement sous le nom de « femmes de compagnie ». Elles doivent être mariées à un militaire d’un grade inférieur à celui de sous-officier. Leur solde est de 35 centimes par jour.
Et leurs attributions?
Elles servent de blanchisseuses, elles peuvent vendre du café dans les casernes et « du bon genièvre absinthé. Toutefois, il leur est interdit de donner à boire les fonds de tonnelet. Si elles s’y risquent, elles subissent deux sanctions : leur mari est mis aux arrêts et on les prive du privilège, combien rentable, de laver le linge de la compagnie.
La première cantinière belge qui entra dans l’histoire, c’est Marie Lombars, affectée au 12e de Ligne. Une robuste fille au vert langage. En 1830, elle accompagne durant la campagne d’Anvers nos volontaires en sarrau bleu.
Mais à Berchem, la bataille fait rage. Et que voit-on ? Marie Lombars se précipiter, le sabre au poing, dans une maison d’où les Hollandais dirigent contre nous un feu d’enfer. La cantinière entre, se rue sur l’ennemi, écrase un soldat contre le mur du corridor, pique le derrière d’un autre de la pointe de son sabre, en culbute un troisième et fraie ainsi, de son importante masse, un chemin victorieux à nos volontaires. Plus tard, elle sera citée à l’ordre du jour du 12e de Ligne, et la première femme à recevoir la croix de l’Ordre de Léopold.
Leur uniforme
Le 27 septembre 1832, « Le Moniteur belge » publie un article assez pittoresque. Il y raconte qu’après la revue de la 3e division d’armée à Alost, notre reine Louise-Marie fut invitée à dîner par les cantinières. Et le Moniteur » de préciser : « Ces dames, au nombre de 30 ou 40, Portaient toutes un uniforme dont l’originalité fait honneur au goût de l’officier général qui l’a exigé.
C’est une redingote de femme, en drap bleu à collet rabattu, boutonnée par trois rangs de boutons, sur laquelle brille la médaille qui atteste leur droit de suivre le régiment.
Elles ont un chapeau de peluche noire noué us le menton, avec des Plumes flottantes de la même couleur, un grand tablier blanc et, sous le bras gauche, l’indispensable tonnelet aux couleurs brabançonnes.
Ainsi habillée, chaque vivandière marchait gravement en serre-file derrière la compagnie au bien de laquelle elle s’était vouée. »
Mais le il septembre 1847, le général Chazal, nouveau ministre de la Guerre, comme on disait alors en Belgique, adresse aux divers chefs de corps cette circulaire : « Pourriez-vous me faire connaître dans le plus bref délai en quoi consiste l’uniforme de vos vivandières ? ».
Le volumineux dossier des réponses est conservé au Musée Royal de l’Armée. Avouerais-je que son contenu, très « couture » mais aussi très insolite, est amusant ?
Par exemple, cette lettre du colonel Lefebvre, commandant du 3e de Ligne: -J’ai trouvé à mon arrivée au régiment, l’habillement des cantinières dans un état qui ne répondait nullement à la commodité et à l’élégance que doivent avoir des femmes accompagnant le régiment, dans les revues et les grandes parades où tout doit être beau, grave et important ..
Le colonel de préciser : « Elles avaient des chapeaux en feutre d’une hauteur extraordinaire et des robes de mérinos très longues qui leur donnaient un air ridicule ».
Parmi les descriptions des uniformes de nos cantinières des régiments de lignards, de chasseurs, de guides et de lanciers, la plus complète et la plus typique est celle d’une vivandière du 4a de Ligne. – Chapeau en cuir bouilli d’une seule pièce, luisant, le no 4 peint dans un écusson doré.
» Robe en mérinos bleu, corsage à jupe pendant à 20 cm de terre.
» Pantalon en mérinos rouge s’arrêtant aux genoux.
« Bas de laine noire, souliers en cuir de veau assez hauts.
» Gants en fil blanc. Baril pouvant contenir 6 litres, le nom de la vivandière se trouvant peint sur le côté, baudrier en cuir indiquant le régiment, le bataillon et la compagnie. «
Au Mexique
Quels souvenirs nous reste-t-il de ces solides petites Belges qui, en 1864, s’embarquèrent pour le Mexique, en bel uniforme à brandebourgs verts ou blancs, en larges jupes, les jambes bien prises dans des bas à rayures noires et rouges, un petit tonnelet de bière en bandoulière et, sur la tête, le chapeau orné d’une touffe de plumes de coq?
Et quelles aventures vécurent-elles dans ce pays lointain, hérissé de cactus et d’embuscades, ces franches gaillardes ?
Nous n’avons retrouvé que deux ou trois de leurs photographies, toutes jaunies par le temps ; M. Duchesne, conservateur au Musée de l’Armée, leur a consacré plusieurs pages. Pages émues, tendrement ironiques, car, on vous le répète, c’étaient des maîtresses femmes au parler fleuri, à la repartie prompte, et qui ne craignaient ni les tempêtes des longues traversées, ni les balles des maquisards de l’Indien Juarez, ni les étés torrides, moites, ces journées où la nature s’alanguit dans une torpeur humide et où les grands papillons mexicains colorés de pourpre, d’émeraude et d’azur se posent, les ailes palpitantes, sur les pierres chaudes des haciendas endormies
Au Mexique, notre Légion Belge fit jusqu’à 1.000 km à pied, le sac au dos, en quarante jours, et les cantinières suivaient trottinantes, sous l’écrasant soleil.
A l’étape, elles versaient la bière blonde ou l’eau fraîche, avec de bons sourires, aux soldats qui tournaient vers elles leur visage tanné, bronzé, sculpté de fatigue.
On écrivit beaucoup d’erreurs à propos de ces cantinières qu’on présenta souvent telles des femmes de mauvaise moeurs.
Certes, elles n’étaient pas des marquises, ni même des bourgeoises bien éduquées par les bonnes soeurs, mais nombre de ces courageuses filles étaient mariées à des soldats ou à des gradés subalternes du corps expéditionnaire.
Elles suivaient donc leur époux, en tout bien tout honneur, dans la rude équipée exotique…
Lorsque l’archiduc Maximilien, frère de l’empereur François-Joseph, eut accepté la couronne du nouvel empire du Mexique, sa femme, Charlotte, ne se tint plus de fierté et de joie. Fille de Léopold Ier, très belle, très ambitieuse, elle rêvait de créer là-bas une monarchie foncièrement chrétienne, de relever le.niveau de vie des Indiens, de forger une puissante nation latine et catholique à côté des Etats-Unis qu’elle qualifiait avec quelque dédain de -nation dangereuse, protestante et trop matérielle..
Léopold ler ne voyait pas d’un trop bon oeil l’aventure où s’engageait sa fille.
Il savait-que Juarez, le leader républicain, recevait de l’or et des fusils du State Department, et que tous les Mexicains étaient loin de se rallier au nouveau régime impérial, appuyé par les baïonnettes des Français que commandait le gros Bazaine (…).
Une garde
Notre Roi estima qu’il fallait lever, en Belgique, une garde de volontaires pour assurer la protection de Charlotte. Et ce fut à Audenaerde qu’on rassembla et qu’on instruisit ces jeunes gens.
Ils étaient si fiers de leurs pimpants uniformes qu’ils en firent une chanson :
Habit de mousquetaire,
Culotte à la zouzou,
Guétres et molletières,
Cravate bleue au cou,
Chapeau muni de plumes.
Baionnette flamboyante,
Voilà tout le costume
De notre armée vaillante
La plupart des volontaires étaient des durs et en faisaient voir de belles à leurs officiers, comme le raconte M. Duchesne, qui nous dit qu’à l’appel du soir, la moitié des volontaires, ou peu s’en faut, restaient invisibles. Rarement les délinquants étaient punis, tant était grande la crainte des organisateurs de la Légion qu’ils ne désertent avec armes et bagages. Les escapades nocturnes devinrent à ce point fréquentes que des réparations durent être effectuées aux murs d’enceinte des divers quartiers.
Plusieurs établissements et cafés d’Audenaerde n’avaient pas tardé à être interdits aux Mexicains .. Cette mesure n’empêcha pas les rixes de se multiplier avec les bourgeois de la ville et les paysans des villages voisins. Un des leurs ayant été blessé à la main par des habitants ivres de Leupegem, non loin du casernement, deux cents légionnaires en tirèrent vengeance, le lendemain. L’arrivée de la gendarmerie prévint la bagarre générale qui s’annonçait. Six autres se rendirent illégalement, un soir, à Renaix, et s’y livrèrent à des exploits tels que, par jugement du 3 décembre 1864, ils furent condamnés pour coups, blessures et bris de clôtures après avoir tous été arrêtés préventivement.
Les casernes, leur ameublement très sommaire et les fournitures de couchage-souffrirent au premier chef de la turbulence et, parfois aussi, de l’état d’ivresse de nombreux légionnaires. Il en coûta plus de 8.000 F à l’administration du corps pour faire face aux réclamations que le collège échevinal d’Audenaerde dut introduire auprès d’elle.
Heureusement que le colonel baron van der Smissen, un homme à poigne, prit en main, et quelles mains, l’entraînement et la discipline de ces turbulants légionnaires dont un premier contingent de 600 hommes quitta Audenaerde sous une pluie battante, le 14 octobre 1864.
Deux jours plus tard, on s’embarqua, à SaintNazaire, à bord du vapeur «La Louisiane» mais, sombre présage, le colonel van der Smissen glissa entre le quai et le pont du navire et fit un magistral plongeon devant ses soldats.
Il fut retiré des eaux par un excellent nageur, le sous-lieutenant Husson.
Quinze cantinières
Le corps expéditionnaire compta quinze cantinières. L’une d’elles deviendra célèbre, à l’époque. Elle s’appelle Catherine et elle a épousé Philippe Opdemessing, lui-mème cantinier du bataillon des Voltigeurs du Mexique. Un pittoresque mariage. L ‘homme est casse-cou, sa femme tout autant.
Ils s’entendent à ravir et ils participent à la terrible bataille de Tacambaro où, des heures durant, les légionnaires belges résistent aux assauts et aux canonnades des Mexicains dix fois plus nombreux.
A Tacambaro, on se bat partout : dans le cimetière, dans les greniers, dans l’église. Les balles sifflent, des hommes tombent en gémissant, (…) notre catherine, « Trientje », (…) verse à boire aux soldat ou panse les blessés.
Mais nos hommes, submergés par leurs assaillants, finissent par se rendre et, huit mois durant, ils seront les prisonniers des Indiens.
L’un d’eux en veut à la vertu de Trientje : elle ‘le repousse d’une bourrade si vigoureuse et d’un potferdomme ! si retentissant que le. don Juan n’insiste pas. En 1867, Catherine Opdemessing fut rapatriée en Belgique, le corsage orné d’une décoration que lui avait value son courage à Tacambaro.
Une autre cantinière, Mariette Moerman, avait un succès fou. Cette futée signa un contrat avec le seul brasseur allemand établi à Mexico et fabriquant une savoureuse bière presque semblable à celle de chez nous.
Le 29 septembre 1865, nos légionnaires organisèrent au profit des pauvres une représentation dramatique à Morelia, la capitale du Michoacan.
On joua « Miche et Christine », un impayable vaudeville d’Eugène Scribe.
C’était Marienne Moerman qui, délaissant son tonnelet de bière, tenait le rôle de l’héroïne aux prises avec mille déboires, les uns comiques, les autres plus tragiques.
La pièce s’acheva par le plus endiablé des cancans dansé par l’infatigable Mariette qu’acclamaient les Mexicains avec d’autant plus d’enthousiasme que jamais ils n’avaient vu pareille danse.
Certaines cantinières, celles qui n’étaient pas mariées, donnaient bien du souci au bon abbé Coenegrachts, l’aumônier du corps expéditionnaire belge. Un aumônier de choc, toujours en première ligne, toujours prêt à arranger les choses quand elles menaçaient de se gâter entre officiers et soldats, un robuste prêtre, pas bigot, au langage dru, direct, cordial.
Il maria les cantinières encore célibataires à des légionnaires et, le 7 mai 1865, un certain caporal Minet ayant insulté une de ces dames qui venait d’épouser un de ses rivaux, l’aumônier Coenegrachts exigea que l’amoureux évincé et discourtois présente des excuses à la cantinière devant toute sa compagnie. Ce qu’il fit, bien contrit, mais non sans recevoir en présence des légionnaires un sonore baiser de paix de la dame qu’il avait si méchamment traitée.
Elles étaient parfois assez coquines, nos cantinières… L’une d’elles, en décembre 1864, débarque à Mexico, toute pimpante dans son uniforme fait au tour, et un galant officier français s’empresse d’inviter cette martiale Vénus à diner. Elle refuse, le rose aux joues et les paupières pudiquement baissées. Le séducteur ne se décourage pas et offre un petit panier garni de bouteilles de vin à notre cantinière. Mais, raconte le capitaine Loiseau, – quand, plus tard, l’officier français se rendit chez elle, il eut le désappointement de trouver la friponne chaperonnée par son frère et quatre sous-officiers sablant gaiement son vin ! ».
Il y avait aussi Juliette Meert aux yeux terribles, bonne fille au demeurant, mais à laquelle le colonel van der Smissen dut ordonner comme à toutes ses collègues de ne plus vendre que de la bière et du café aux soldats, car la liqueur exerçait sur eux des effets néfastes.
Juliette Meert elle-même le reconnaissait Quand ils ont trop bu, ils voient deux Mexicains au’ lieu d’un et alors, ils tirent à côté ».
Délicieuse est l’histoire, enfin, de Jeannette Van Acker, épouse du soldat Pierre-Michel Schepmans. Elle ne s’embarque pour le Mexique que le 11 décembre 1864 car, nous apprend le livre d’ordre de la Légion belge, la femme Schepmans se trouve dans une position intéressante et son état offre des dangers pour la traversée en mer..
Elle aura une petite fille qu’on baptisera Charlotte et dont l’impératrice elle-même sera la marraine, comme des autres enfants de nos cantinières, d’ailleurs.
Un petit bouquet
Il fut un temps, raconte Albert Duchesne, bien avant la guerre de 1940, où le buste de la princesse Charlotte qu’on peut voir au Musée de l’Armée, devant la section consacrée à l’expédition des volontaires belges au Mexique, était fleuri à certaines dates : fête et anniversaire de l’impératrice, Noël et Nouvel An. Le geste était rapide : un modeste bouquet de violettes, parfois une carte illustrée étaient déposés et une vieille dame s’éloignait sans qu’on ait jamais su qui elle était ni pourquoi elle accomplissait ce geste pieux. Qu’il se soit agi là d’une filleule de l’impératrice est suffisamment prouvé par la dédicace écrite d’une main tremblante au verso d’une carte retrouvée au pied du buste : – A ma marraine .. Que l’auteur de cet hommage inlassablement répété jusqu’à sa mort ait été la fille d’une cantinière du régiment de l’impératrice ne fait guère de doute. Le mystère même dont elle a voulu s’entourer jusqu’à la fin nimbe d’une auréole émouvante la figure de Charlotte qui fut impératrice d’un pays à qui son souvenir continue à s’imposer et le visage resté impénétrable de cette autre Charlotte, filleule de souveraine et fille d’une des quinze cantinières qui la servirent, parfois non sans crânerie, tout en vouant leurs meilleurs soins à ceux qui s’intitulaient fièrement : la Garde d’Honneur de l’impératrice !
Peut-on de plus charmante manière que celle de M. Duchesne conclure l’histoire de nos petites cantinières du Mexique où s’établirent plusieurs d’entre elles qui ouvrirent, là-bas, des magasins, des cafés, des ateliers de couture, dont l’histoire ne sera jamais écrite, malgré son pittoresque qui doit être riche en anecdotes.
Une question
Nous avons voulu savoir quand disparurent les cantinières de nos régiments. D’après M. Louis Leconte, c’est probablement vers 1890-92.
En 1890, en effet, elles furent éliminées de l’armée française. Et M. Leconte croit que nous avons suivi cet exemple à vrai dire fâcheux car, en 1914, de solides et courageuses vivandières auraient rendu nombre de services à nos soldats, au cours de leur longue retraite d’Anvers vers l’Yser, par exemple.

De 1942 à nos jours: les prestigieux para-commandos belges
(Roger Rosart, in: LB, 28/04/1992)

The Belgian soldier at the beginning of World War II
(Belgian Army Museum)

