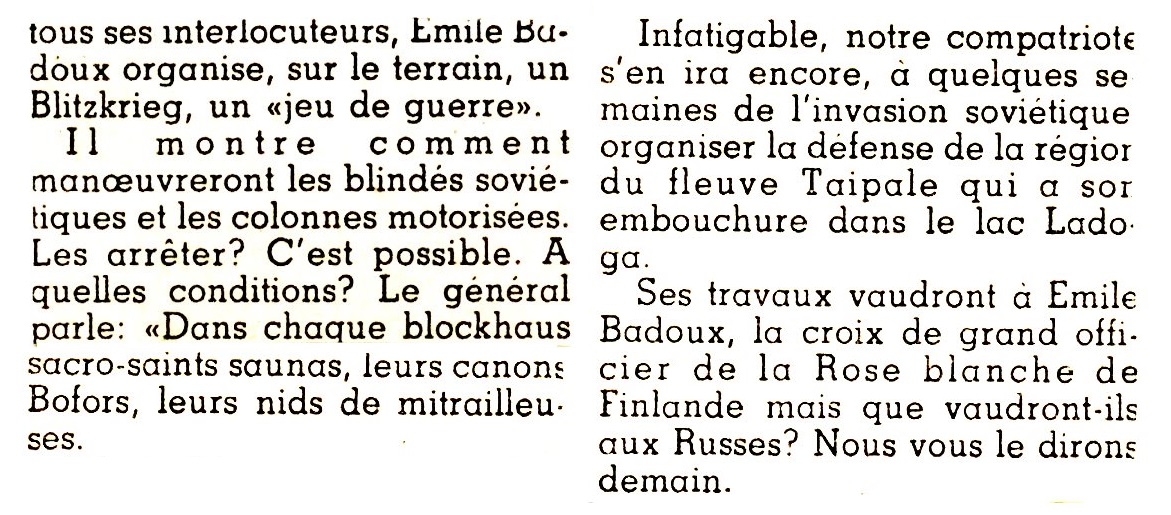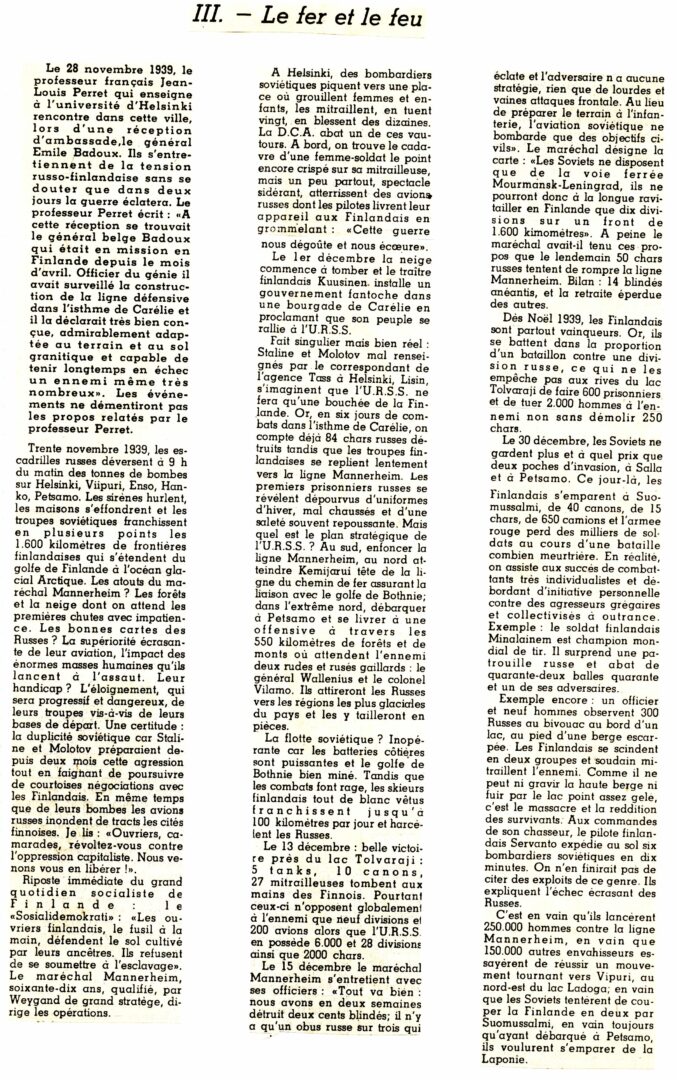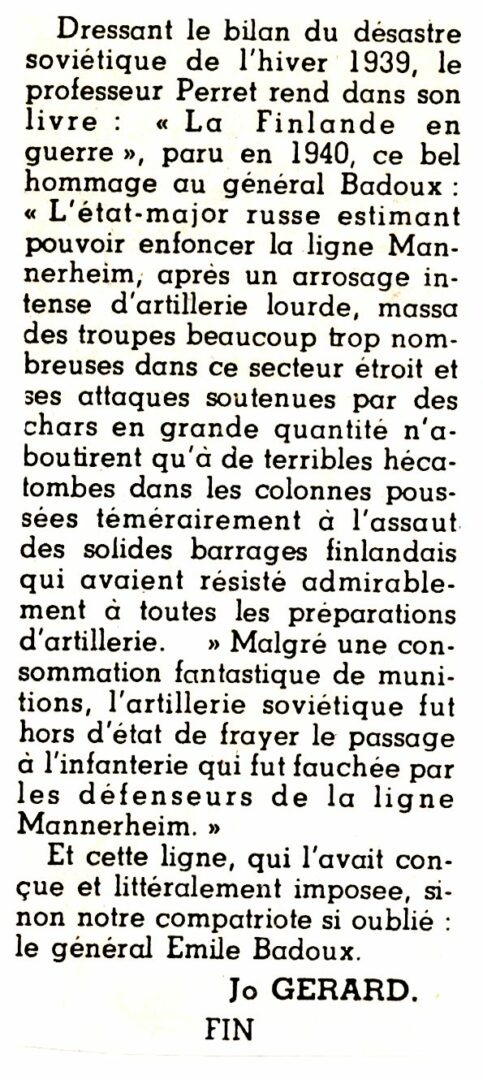1940-1945
PLAN
1 Faits
2 Documents
1 Faits
Jacques Willequet, la Belgique sous la botte, résistances et collaborations 1940-1945, éd. Universitaires, Paris 1986 (extraits)
(professeur d’histoire à l’ULB)
(à la mémoire de Frans van Kalken, professeur de sérénité)
(p.36) Autoritaires et fascisants
Mais nous parlions de mouvements autoritaires. Comme ils allaient se perpétuer sous l’occupation, et cela dans les deux camps, il importe que nous fassions le point à leur égard. Répétons que si le mouvement flamand n’est pas à ranger, en principe, dans cette catégorie, il n’en perdit pas moins au cours des années trente pas mal de ses adhérents modérés, satisfaits des améliorations en cours et qui réintégrèrent leurs anciens partis. D’autres, il est vrai, se durcirent pour évoluer vers des formules de droite. Une des clés de leur sensibilité serait, peut-être, une certaine allergie au jacobinisme imposé sous l’occupation française entre 1794 et 1814. Cette modernisation cartésienne réussit outre-Quiévrain et en Wallonie, alors qu’en Flandre elle fut obscurément ressentie comme la marque d’une domination (p.37) bourgeoise « fransquillonne ». N’est-il pas significatif qu’aujourd’hui encore, le parti qui en région flamande se dénomme « chrétien-populaire » a pris dans le sud du pays l’étiquette « chrétienne-sociale » ? On voit la nuance des connotations : plus vagues et romantiques d’un côté, plus concrètes de l’autre. Grouper ce « peuple » d’une manière « organique », c’était comme une résurgence de l’Ancien Régime qui n’apparut nulle part avec plus de netteté que dans la pensée du plus intéressant — et plus estimable — des hommes politiques flamands. Joris Van Severen était un maurrassien, habité d’une âme fière qui lui fit prendre très tôt en horreur les lamentations misérabilistes de ses anciens compagnons de route, issus comme lui du « mouvement du front ». Tournant le dos au parlementarisme libéral, il fonda en 1931 le Verdinaso, mouvement « national-solidariste » thiois, lui donna comme objectif la réunion des anciens Pays-Bas, Wallonie et Luxembourg y compris à partir de 1934. Il abandonna aussi le nationalisme linguistique, pour se réclamer d’un humanisme chrétien et prôner la formule inspirée des corporatistes français : le roi en ses Conseils, le peuple en ses Etats. Les provinces géographiques et les corps de métiers, ces communautés naturelles, seraient ainsi rassemblés sous la forme d’une sorte de « Grande Belgique ». On conçoit que certains de ses fidèles l’aient quitté, abasourdis, mais il en gagna d’autres. Lui-même fut assassiné dans des circonstances qui lui font honneur, à Abbeville en mai 1940. Le destin futur de ses meilleurs adeptes — dans la résistance, puis dans la vie publique — montre que les germes qu’il avait semés avaient produit quelques fruits non négligeables. Un personnage étonnant, quelque peu visionnaire, dont les 15.000 adhérents prirent sans doute des aspects extérieurs fascistes selon la mode du temps, élitaires en tout cas, alors que l’âme de son mouvement était d’une nature bien différente.
Après ce classique, voici les romantiques : les gens du Vlaams Nationaal Verbond (VNV), plus conformes, eux, à l’image du « flamingant » traditionnel. On serait bien en peine de définir concrètement leur idéal politique : l’éventail s’y déployait depuis l’attachement à la démocratie parlementaire (Elias, Borginon, Romsee…) jusqu’aux crypto-nazis ; depuis l’aspiration à un Etat thiois hollando-flamand (soit Van Severen première manière) jusqu’à une Belgique fédéralisée en passant par une Flandre indépendante. Les meilleures têtes confessaient leur incertitude à cet égard : le tout était d’agir, après quoi on verrait bien. Quant à la réforme interne de cet Etat, en partie sous l’inspiration du sociologue Victor Lee-mans, on la voyait sous l’aspect d’un « solidarisme », soit un corporatisme à la mode autrichienne. En fait, le VNV est toujours resté davantage groupe de pression plutôt que parti très cohérent : son audience électorale s’en trouvait augmentée, mais le discours restait plus négativiste que constructeur, ce qui devait nécessairement oblitérer ses perspectives à plus long terme. En attendant il prenait lui aussi, par contagion, des allures fascistoïdes qui se manifestaient sous la forme de milices, de défilés, ainsi que par un fonctionnement interne des plus autoritaires. A sa tête un instituteur de village, Staf De Clercq, n’avait pas beaucoup d’idées personnelles mais il (p.38) avait l’avantage de représenter une sorte de plus grand commun dénominateur. Tel qu’il était, le VNV revendiquait en 1939 quelque 30.000 membres ; au parlement, ses députés et sénateurs représentaient 12 % des électeurs dans le nord du pays.
On ne parlait encore guère de DeVlag (Communauté culturelle germano-flamande). Sous la houlette de Jef Van de Wiele, un licencié en philologie germanique, cette société groupait un petit nombre d’universitaires et d’étudiants, issus de Flandre et d’outre-Rhin. Et ajoutons-y, pour être complet, des groupuscules franchement nazis tels que le NSVAP, un sigle des plus clairs (Parti national-socialiste des travailleurs flamands). Il se manifesta par des graffiti sur les murs : « Après les Sudètes, la Flandre ». Cela n’avait aucune importance, mais cela en prendrait quelque peu sous l’occupation.
Les chemises bleues de la Légion nationale belge, voilà en revanche un phénomène « ancien combattant » à l’état pur : des anciens de 1914-18, déçus dans leur idéal d’ordre et de patriotisme, totalement dévoués au roi ou à plus exactement parler à l’image qu’ils s’en faisaient, rejoints par les jeunes, écœurés par l’action des forces jugées dissolvantes qui prétendaient affaiblir ou désarmer le pays devant la menace, toujours présente, d’une nouvelle agression : le communisme, le séparatisme, une démocratie parlementaire inefficace. Leur chef, l’avocat liégeois Paul Hoornaert, était un ancien lieutenant patrouilleur qui menait ses troupes (5.000 membres, dont 1.500 jeunes gardes) avec discipline et autorité. L’idéal était national et corporatiste (Hoornaert avait été démocrate-chrétien). Contrairement à ce qu’on a dit, les effectifs étaient implantés sur tout le territoire : on comptait 5 « maisons nationales » permanentes (Bruxelles, Liège, Anvers, Gand, Tournai), plus une dizaine moins importantes dans d’autres localités. A chaque occasion, les troupes étaient « mobilisées », soit pour s’associer à des manifestations patriotiques, soit pour se colleter avec les « ennemis» de l’intérieur: les «traîtres» de 1914-18, les « désarmeurs » et en général toutes les tendances suspectes de germanophilie. L’aspect fascistoïde était évident, mais il évolua. En 1934, Hoornaert revint mécontent d’une rencontre internationale fasciste qui s’était tenue à Montreux. Mussolini baissa dans son estime au fur et à mesure qu’il se rapprochait d’Hitler. Sa campagne anticommuniste redoubla pendant la « drôle de guerre » : par leur action démoralisante, les hommes de Moscou préparaient une « trahison ». L’hebdomadaire Légion nationale n’avait bien entendu qu’un rayonnement restreint. Dans son numéro du 20 avril 1940 — vingt jours avant l’invasion —, Hoornaert publia un article d’une violence extraordinaire, dont chaque ligne mérite d’être pesée. Sous la protection de l’occupant, Quisling venait de prendre le pouvoir en Norvège. Le « chef » explosa : « Judas est, hélas ! de tous les temps. » Si par malheur un tel personnage devait un jour apparaître en Belgique, « quelles que soient les idées qu’il déclarerait promouvoir, espérons que l’on n’hésiterait pas un seul instant à l’abattre comme un chien ! » La dépolitisation de la Légion s’amorçait, sous le signe de l’union sacrée. On conviendra que cet appel à (p.39) la résistance sous sa forme la plus extrême, in tempore non suspecta et avant la lettre, méritait d’autant plus d’être signalé qu’il émanait d’un groupe étiqueté fasciste.
Avec un sûr instinct, la Légion s’était opposée à Rex dès les origines, alors que le mouvement de Léon Degrelle n’en était encore qu’à la première de ses nombreuses variations. Tout avait commencé en 1935 par un élan de jeunes contestataires au sein du parti catholique. On dénonçait le profitariat politicien, l’hypercapitalisme, des scandales financiers pas toujours imaginaires, et l’on brandissait des balais symboliques en désignant des écuries d’Augias. Degrelle était beau garçon, et l’on commença à parler de « rex-appeal ». Il fallait lui reconnaître un talent exceptionnel de tribun. Faire salle comble six jours de suite au Palais des Sports de Bruxelles, cette sorte d’exploit n’était certes pas à la portée du premier venu. Les’ élections de 1936 furent triomphales : 21 rexistes entraient à la Chambre, portés par les voix d’une bourgeoisie en crise mais qui allait bientôt se raviser. Degrelle commit des erreurs tactiques, défia le cardinal qui le « crossa », laissa entrevoir des soutiens suspects aussi bien qu’une ambition forcenée : bref, aux élections de 1939, il ne lui restait que 4 députés. La guerre allait lui donner un second souffle.
Tous ces nationalismes — belges, grand-belges, flamands ou pan-néerlandais — étaient uniformément étiquetés fascistes par une extrême-gauche qui, en dépit de ses prétentions « scientifiques », n’a jamais eu le souci de cerner rigoureusement ses définitions. L’épithète fut appliquée tantôt à des mouvements autoritaires de droite, tantôt à tout ce qui n’était pas communiste (socialistes y compris !) et en général à toutes les tendances qui étaient soupçonnées, parfois à tort, de sympathie pour les régimes mussolinien et nazi. Les intéressés eux-mêmes récusaient cette appellation : ils étaient « nationaux » et ne devaient rien à l’étranger — ce qui n’était pas non plus toujours exact. En attendant, ils clamèrent jusqu’en 1940 le neutralisme le plus scrupuleux. Leur audience électorale, en 1939, atteignait 12,37 % des voix dans tout le pays, rexistes et VNV additionnés. Si on y ajoute les communistes, ces autres adversaires de l’ordre établi, cela faisait 80,26 % d’électeurs restés fidèles aux trois partis « traditionnels ». Que cette grosse majorité, toutefois, ne nous leurre point. Depuis les hautes sphères jusqu’au niveau du simple citoyen, le désenchantement à l’égard du régime était largement répandu, et la volonté de « réforme » s’exprimait sans ambages. Il ne faudra jamais le perdre de vue : le choc de mai 1940 allait frapper une population dont les bases étaient saines mais qui n’avait certes plus, à l’égard du système parlementaire tel qu’il avait évolué, l’attachement qui avait caractérisé les périodes antérieures. Les 20 % de contestataires affichés ne représentaient que la face émergée de l’iceberg.
Pour être complet, il faut dire encore un mot du wallingantisme — une appellation qui à elle seule suggère à quel point ce phénomène récent était avant tout une riposte. Assez sentimental et ambigu, il se caractérisait par les contradictions habituelles en pareil cas : on combattait le flamingantisme, (p.40) mais on se justifiait par lui, on s’en prévalait, au point d’inviter à l’occasion, à sa tribune, un ancien activiste flamand. Haro sur la « belgeoiserie », et en particulier sur les « Brusselaires ». Un romantisme francolâtre et une exaltation de la « race latine » mis à part, les perspectives politiques étaient parfaitement floues, puisque les dirigeants pouvaient tout aussi bien se réclamer de Charles Maurras que de la Grande Révolution — alors qu’outre-Quiévrain, du côté de ces idoles vénérées, l’accueil était aussi aimable, incompréhensif et distrait que celui qui était réservé, aux Pays-Bas, aux « frères de race » flamands. La perte d’une suprématie qui avait été réelle éveillait des inquiétudes wallonnes. Une liturgie délirante, à la gloire de Napoléon s’organisait chaque 18 juin à Waterloo — modeste réplique aux pèlerinages flamands à la tour de l’Yser. Le « danger de l’Est » était redouté, mais tout autant celui du « Nord ». Dans une Belgique unitaire fatalement livrée à une majorité flamande, les intérêts wallons ne seraient-ils pas négligés? Sur ce point, la méconnaissance du problème était totale. On ignorait qu’une union économique franco-belge avait été plusieurs fois envisagée, puis rejetée par les Français eux-mêmes, qui n’eussent consenti ce lourd sacrifice que moyennant une contrepartie impliquant une mise sous tutelle politique : la Belgique, toute la Belgique devait sa prospérité à un libre-échangisme qui lui avait ouvert le monde, et que Paris refusait catégoriquement. Tout aussi énorme, encore que ses bases reposaient sur des illusions couramment répandues, était le désarroi que ces milieux wallons éprouvaient depuis 1936 : on abandonnait « ceux qui nous avaient sauvés en 1914 », on se privait du « dynamisme irrésistible de l’armée française » ? Le ministre des Affaires étrangères était appelé « M. von Spaak » : un Bruxellois, donc déjà presque un Boche. Le salut, on le voyait dans une union douanière et militaire avec la France ; l’avenir, dans le cadre belge si possible, hors de la Belgique si nécessaire. Orateur infatigable et chaleureux, l’abbé Mahieu prêchait de ville en ville ; il finit par se faire interdire par son ordinaire, l’évêque de Tournai. Pendant la « drôle de guerre », la presse wallingante joua un rôle des plus utiles, mais que ses promoteurs n’avaient certainement pas prévu : elle donnait un alibi inespéré au gouvernement qui, en lui imposant des entraves occasionnelles, trouvait de quoi répondre aux démarches de l’ambassadeur d’Allemagne. Après 1940 ses dirigeants, soit fondèrent une sorte de mouvement de résistance dont nous reparlerons — Wallonie libre —, soit cherchèrent des appuis dans l’entourage de Pétain, soit encore militèrent dans la résistance française.
La Belgique constitue une « nationalité » moins cohérente que d’autres, moins faite que d’autres pour un cartésianisme jacobin. D’une part, cet état d’esprit l’a empêchée de verser dans les outrances du nationalisme, cette maladie mentale collective ; en revanche, il ne lui a pas évité l’éclosion de sous-nationalismes contradictoires et irrationnels, toujours minoritaires et le devenant davantage encore en cas d’agression étrangère. L’ensemble de la population était attachée aux biens concrets de la vie quotidienne, paisiblement assurés par des institutions reconnues (…).
Jacques Willequet, la Belgique sous la botte, résistances et collaborations 1940-1945, éd. Universitaires, Paris 1986
(prof. d’histoire à l’ULB)
(A la mémoire de Frans van Kalken, professeur de sérénité)
Les Communistes
Un neutralisme machiavélien
(p.197) Rien n’exprime mieux cette position qu’un article des Iswestia, dévotieusement repris le 14 octobre par Het Vlaamsche Volk : « On peut respecter ou haïr l’hitlérisme, comme tout autre système. C’est une question de goût. Mais commencer une guerre « pour anéantir l’hitlérisme », c’est accepter une politique de sottise criminelle. »
Et il était bien exact que chronologiquement, c’étaient Londres et Paris qui avaient ouvert les hostilités contre l’Allemagne. Leur but était évidemment de promouvoir les intérêts du grand capital et, à terme, de conclure avec le Reich un nouveau traité de Versailles qui jetterait les bases de la véritable explication, celle qui réglerait le sort de l’Union soviétique. Grâce à Dieu et surtout au génial Staline, Hitler n’était pas entré dans ce jeu-là. Son discours de paix du 6 octobre fut chaudement approuvé. On foula aux pieds la Pologne, victime de l’impérialisme occidental, et bientôt aussi la Finlande, patrie des « gardes blancs ». La poli tique des Alliés ne manquait pas d’ambiguïté, c’est vrai, et il n’était pas agréable de lire dans une presse belge unanime que la ligne Mannerheim — c’est-à-dire le front de Finlande — définissait les limites de la civilisation. En avril 1940, la Norvège elle-même fut considérée comme la victime d’un impérialisme qui, apparemment, n’était pas nazi. En novembre et en janvier, des alertes firent craindre le pire : autant d’inventions des services secrets britanniques, tandis que le blocus allié faisait pression sur notre pays pour l’entraîner dans la guerre et, accessoirement, affamer sa classe laborieuse.
Pour tous les Belges sauf les communistes et les nationalistes flamands, le danger potentiel était à la frontière de l’Est. Cette menace terrible impliquait une discipline sociale sur le plan du travail, et un dur effort patriotique de la part des quelque 650 000 soldats mobilisés. Pendant ce temps-là, les communistes parlaient de transformer en révolution prolétarienne la guerre impérialiste voulue par les banquiers de la City ; ils honnissaient Chamberlain et Daladier, et identifiaient la cause de la paix avec celle de l’URSS (laquelle vendait au Reich, à 150 % de ses engagements, tous les produits indispensables à la poursuite de la guerre) ; enfin, dans l’immédiat, ils prenaient en charge les intérêts des travailleurs et des mobilisés: entendons par là une agitation sociale et une propagande de démoralisation qui ne pouvaient pas être interprétées autrement que comme du sabotage et du défaitisme — au profit d’Hitler. Comme dans l’Allemagne de 1932, communistes et nazis se retrouvaient objectivement alliés.
Soucieux de défendre à la fois sa force et sa neutralité, le gouvernement limita la diffusion de journaux trop ouvertement pro-hitlériens et pro-alliés, et il réprima sans hésiter un défaitisme qui se manifestait d’ailleurs bien davantage sous le masque indirect du communisme. Il surveilla son armée ; des cellules nationalistes flamandes et communistes y fonctionnaient, notamment au 15e de Ligne où deux bataillons devaient, en mai (p.198) 1940, se signaler par une conduite honteuse \ Des militants furent arrêtés, et leur presse fut en fin de compte interdite.
Le P.C.B. avait réussi à faire l’unanimité contre lui, les plus impitoyables étant les socialistes ; dans leur indignation, il est du reste permis de penser qu’il entrait autant de tactique que de sincérité. Bref, le moins que l’on puisse dire, avec un historien d’extrême-gauche, c’est que les moscoutaires rejetaient « avec beaucoup plus de force » la responsabilité de ce conflit sur le dos des impérialistes franco-britanniques 2.
Si l’on ajoute à cela le choc brutal du 10 mai 1940, l’étonnant, c’est que les communistes se soient douloureusement étonnés des mesures dont ils avaient été les victimes, et qui se traduisirent par l’arrestation et la déportation de nombre d’entre eux au jour de l’invasion. On sait en effet que deux à trois mille Belges et autant d’étrangers furent mis en détention administrative, puis confiés aux Français qui les internèrent dans les camps de Vernet et de Saint-Cyprien : des nationalistes flamands, des rexistes, des communistes, des étrangers parmi lesquels des réfugiés politiques allemands (donc doublement suspects) — un cortège lamentable de coupables en puissance et de malchanceux innocents. L’épisode le plus douloureux de cette déportation fut l’assassinat, par leurs gardiens français, d’une vingtaine de personnes parmi lesquelles l’honorable leader du Verdinaso, Joris Van Severen. Le kiosque sinistre d’Abbeville entra, le 20 mai 1940, dans l’histoire. Même si cette petite tragédie se perdit dans la grande catastrophe, même si la détention dans les camps du Midi fut loin de prendre des formes très humaines, tout cela fut mal perçu par une population en désarroi et elle-même en bonne partie dispersée sur les routes. Le ressentiment conçu par les intéressés ne doit néanmoins pas être perdu de vue. Il eut son influence, chez les communistes et chez nos fascisants, dans les premiers mois de l’occupation.
L’occupation allemande fut donc accueillie comme une sorte de délivrance et de table rase par les quelques militants qui avaient échappé à la déportation, puis par ceux qui en revinrent avec des rancœurs accentuées. La Voix du Peuple, précédemment interdite, ressuscita au lendemain de la prise de Bruxelles et le 2 juin, Ulenspiegel naquit à Anvers ; le premier de ces journaux serait interdit par la Kommandantur le 23 juin. Quant au second, il ne disparaîtrait que le 1er mars 1941, mais il devenait tellement censuré qu’à partir des derniers mois de 1940, on l’avait graduellement relayé par des clandestins dont nous reparlerons. Des mandataires reprirent ou assumèrent des fonctions publiques, notamment à Liège, et le député Lahaut œuvra au rapatriement et à la remise au travail. Selon le récit d’Henri Bernard, ce même mandataire ne s’était-il pas exclamé, fin juin 1940 à Villeneuve-sur-Lot : «Le national-socialisme réalise toutes
1 R. Van Doorslaer: De Kommunistische Parti] van België en het Soviet-Duits Niet-Aanvalspakt, Bruxelles 1975, p. 115.
2 R. Van Doorslaer : op. cit., p. 117. Pour tout ce qui précède voir passim aux pp. 72-115. Exemples de tracts aux soldats, pp. 237-238.
(p.199) nos aspirations démocratiques » ? 3 La défense des ouvriers passa au premier plan des préoccupations, d’autant plus que l’absence de bien des responsables politiques et syndicaux socialistes ouvrait un créneau qu’il serait profitable d’occuper. Pendant des mois, la politique de présence des communistes allait donc prendre une forme ambiguë, parallèlement publique et clandestine. N’étaient-ils pas protégés, pensaient-ils, par l’amitié germano-soviétique ? Le local gantois du parti resterait ouvert, sans être contrarié le moins du monde, jusqu’en juin 1941.
Fulminer contre les Anglais, apparus et aussitôt disparus, n’était certes pas à l’époque une singularité. La Voix du Peuple s’y emploie (22 mai 1940). Les bourgeois, écrit Ulenspiegel le 7 juin, se sont enfuis avec la caisse en laissant le peuple dans la misère. Voilà où nous ont menés Pierlot et Spaak, ces «laquais de la Cité de Londres et des 200 familles». La capitulation royale est approuvée, et l’on juxtapose d’une manière bien inattendue une condamnation des ministres fuyards et un coup de chapeau à Léopold III : … « ces messieurs de Londres qui se préparent à trahir une fois de plus », après avoir « souillé le blason du roi » (sic)… 4. Bientôt, pour combattre le rexisme et le nationalisme flamand renaissants, le clandestin bruxellois Clarté allait avoir un haut-le-corps : voilà que ces messieurs, eux aussi, pourfendent Pierlot et les limogeards ! La bonne plaisanterie ! Consultons les Annales parlementaires : n’avaient-ils pas soutenu la politique de neutralité avant le 10 mai et n’avaient-ils pas tous, en ce jour historique, voté oui « à la déclaration de guerre à l’Allemagne » (sic) par le même gouvernement? Les seuls à pouvoir revendiquer le mérite de n’avoir jamais suivi Pierlot, c’étaient eux, les communistes (1er novembre 1940). L’argumentation peut paraître étrange : Pierlot n’était-il pas neutre avant le 10 mai, et le P.C. ne continuait-il pas à se réclamer de la même position ? Mais il y avait deux sortes de neutralités, il est vrai. La responsabilité du conflit était imputée aux « ploutocrates fauteurs de guerre de Londres et de Paris » et à leurs valets belges, mais les communistes, eux, seraient véritablement neutres à l’égard de l’Allemagne, contrairement aux socialistes qui avaient été aux genoux de la City (Ulenspiegel, 21 juin 1940). Neutres et corrects : tout sabotage était sévèrement réprouvé (Ulenspiegel, 18 juin 1940). L’entrée en guerre de l’Italie fut saluée avec joie : elle hâterait la débâcle des impérialistes (Ulenspiegel, 16 juin 1940). Et l’offre de paix d’Hitler dans son discours du 19 juillet recueillit tous les applaudissements du même journal le 21 juillet. Plus vite les boutefeux occidentaux seraient battus, mieux cela vaudrait.
3 H. Bernard : Août 1940 avril 1942, p. 4. Ce manuscrit inédit nous a été aimablement communiqué par Francis Balace.
4 R. Van Doorslaer: op. cit., p. 132.
(p.305) LES JUIFS ET, ACCESSOIREMENT, LES FRANCS-MAÇONS
Aux origines du racisme
Racisme et antisémitisme : vastes sujets que ceux-là ! Nous ne tenterons de les clarifier que dans la mesure où il s’agira de comprendre les sentiments des Belges — et des Juifs eux-mêmes — dans l’ouragan de la seconde guerre mondiale.
Certains lecteurs attentifs des récits de voyages antérieurs au XIXe siècle ont remarqué que ces observateurs sagaces des mœurs et coutumes chinoises ou persanes, par exemple, étaient remarquablement dépourvus d’un sentiment de supériorité qui ne commence à transparaître qu’avec notre révolution industrielle : on peut considérer le comte de Gobineau (1816-1882) comme un des « inventeurs » du racisme. Mais, pourquoi cette mutation ? Venus de France, Italie ou Allemagne, pays sous-développés sans que le mot existât, ces anciens explorateurs s’étonnaient souvent, insistaient sur des coutumes religieuses étranges, décrivaient des méthodes artisanales pas très différentes de celles qu’ils connaissaient et parfois même plus ingénieuses. Ils revenaient de là-bas intellectuellement enrichis, mais ni humiliés ni condescendants : dans un univers médiocre ou misérable — la mince couche aristocratique mise à part — tout le monde était à peu près au même niveau. La perspective ne changea qu’au départ d’une modeste machine à vapeur, pour aboutir aux fantastiques développements actuels. Le savoir technique et scientifique, joint aux mécanismes d’une économie libre, creusèrent un abîme entre l’Europe et les Etats-Unis d’une part, et de l’autre le reste du monde qui en était tributaire ou dépendant. Quoi de plus simple et plus convaincant qu’une explication biologique ? Les Blancs étaient de toute évidence plus intelligents, plus réalisateurs que les autres, et l’objection japonaise était balayée : il s’agissait tout au plus de
(p.306) malins imitateurs, incapables d’aller plus loin par eux-mêmes. Ne rions pas de ces préjugés, chaque époque a les siens. On pourrait aligner un étonnant florilège d’opinions émises à cet égard, il y a encore un demi-siècle, et cela par les voix les plus « progressistes ». On « civilisait », mais avec la fausse certitude que cette noble mission finirait, malgré tout, par se heurter à des limites d’ordre biologique. En fait, à de très rares exceptions près, tout le monde était un peu raciste sans le savoir, encore à la veille de 1940, et la meilleure preuve en est que le mot est tout récent : il arrive que des néologismes se créent parce qu’on n’en avait pas besoin auparavant, et cela au moment précis où le bien-fondé du concept commence à être mis en doute. Des journalistes se mirent, vers 1930, à parler de racisme parce qu’il leur fallait traduire, plutôt mal que bien, le « völkisch » prôné par cet inquiétant parti nazi qui se développait outre-Rhin. En fin de compte (« Le Diable porte pierre», dit un proverbe provençal), c’est Hitler qui, en poussant jusqu’à leurs conséquences les plus logiques et les plus horribles des idées communément répandues, a induit par contrecoup les chercheurs à s’interroger, à approfondir leurs investigations, et à conclure que s’il y a des différences entre les hommes, elles sont de nature ethnique ou matérielle (l’alimentation !) et non raciale. Du reste, on pourrait étendre l’examen de ce rôle catalyseur qu’a joué involontairement le maître du nazisme. Cet empire germanique qu’il voulait constituer en Europe, il y œuvrait en usant de méthodes abominables — mais y a-t-il jamais eu des « empires» innocents ? Comment s’était constituée, un demi-siècle plus tôt, la grande démocratie nord-américaine ? Quant à ce racisme diffus d’avant 1940, hâtons-nous de le réduire à des proportions relativement anodines. Personne, et probablement pas encore Hitler lui-même, n’imaginait qu’on puisse éliminer physiquement une catégorie déterminée d’êtres humains. Au-delà du nazisme, c’est la guerre, avec ses phantasmes et ses exacerbations, qui devrait être considérée comme la grande responsable…
L’antisémitisme, c’est à la fois du racisme et à la fois autre chose. Sauf les nazis que personne n’aura l’idée de plaindre dans l’énorme erreur idéologique qu’ils ont commise, on n’a jamais contesté aux Juifs la compétence, voire la supériorité intellectuelle en général attribuée à la race blanche. Au contraire, leur contribution au monde industrialisé a été éclatante. Allons plus loin : c’est leur « racisme » à eux qui leur fut reproché. A la fin du siècle dernier, Bernard Lazare avait publié un livre où il démontrait qu’à l’inverse des autres ethnies, c’étaient les Juifs eux-mêmes qui s’enfermaient dans des ghettos : un argument opportun, dont Charles Maurras s’était emparé pour justifier son antisémitisme d’Etat. Tous s’assimilaient, sauf eux ; il y avait là matière à réflexion. Nationalisme, donc, mais il y avait aussi le reproche de déicide, pas tout à fait disparu en 1940 comme nous le verrons. Quelle que soit l’origine de ces malveillances et persécutions, quel que soit le rôle de ces persécutions elles-mêmes dans l’incontestable, l’incroyable ténacité de ce peuple irréductible et dur, de cette religion si particulière et il faut le dire si cléricale, le fait est là : les Juifs existent, et souvent ils dérangent. Sont-ils malgré tout plus homogènes?
(p.307 Certes non, et nous aurons l’occasion de le souligner ci-après.
Chacun reconnaîtra que si les Belges ont leurs gros défauts, ils sont un des peuples les moins xénophobes du monde. Vivant sur une traditionnelle terre de rencontre et régis par dès institutions libérales, ils comptaient parmi eux, au XIXe siècle, un nombre restreint d’artisans et de boutiquiers juifs. Premiers pays industrialisé du continent, il attira ensuite, par groupes isolés, une immigration de haute qualité. Notamment, financiers, hommes d’affaires s’installaient chez nous, obtenaient bientôt leur naturalisation (sous des gouvernements de gauche… parce qu’ils votaient libéral), et certains même étaient anoblis pour services rendus — ce qui les assimilait théoriquement, sans que cela surprît personne, aux descendants des aristocrates anciens propriétaires du sol. La naturalisation plus un titre de noblesse : il est difficile d’être moins antisémite ! Du reste, ces immigrés ne venaient déjà pas de bien loin : de Rhénanie, des Pays-Bas, au maximum de Bordeaux… Une industrie diamantaire d’importance mondiale se développa à Anvers, comprenant à la fois de grands patrons et une colonie d’artisans, d’ouvriers hautement spécialisés. D’homme à homme, les rapports avec les autochtones étaient bons ; les réticences et les préjugés ne se manifestent qu’au niveau collectif, où interviennent des schémas, des généralisations plus ou moins simplistes ; l’assimilation, elle, ne peut être qu’un phénomène individuel.
A ces petits noyaux primitifs s’ajoutent dans les années vingt des modestes, rescapés des pogromes russes et polonais, occupant des petits commerces et ateliers, surtout dans le secteur de la fourrure et de la maroquinerie, essentiellement à Bruxelles et Anvers. Ils n’avaient qu’un désir, se faire oublier, et ils y parvinrent sans peine. Et pour se faire encore mieux oublier, beaucoup cherchèrent une intégration. Certains militèrent à l’extrême-gauche, mais d’autres aussi dans des associations patriotiques, voire nationalistes. Telle était d’ailleurs, et pour tout le monde, la double grande leçon de 1914-18 : pour ne plus jamais avoir de guerre, pensait-on, il fallait soit s’engager dans l’internationalisme prolétarien, soit renforcer la nation pour dissuader l’agresseur éventuel.
Les années vingt, puis trente, virent donc l’éclosion, plutôt rare chez nous, d’un nationalisme quantitativement significatif, pour cette raison-là et aussi pour d’autres, à caractère social. Les hommes sont ainsi faits que plus ils sont conscients de leurs faiblesses et de leurs précarités, plus ils éprouvent un besoin de compensation, de valorisation. A l’échelle collective, ce processus tourne aisément à la xénophobie. Il y avait toujours eu, en Belgique comme ailleurs, des gens qui n’« aimaient » pas les Juifs (nous hésitons à dire : des antisémites, le mot a changé de sens depuis Hitler) ; il y en avait à gauche comme à droite, et pour des raisons diverses ; le noyau Israélite, si fermé, si « étranger», fournissait le cas échéant un repoussoir idéal. Une identité ne s’affirme jamais qu’aux dépens d’autrui. Toutefois, cette réaction n’allait pas plus loin qu’une malveillance diffuse, s’appuyant sur des archétypes plus ou moins réels, plus ou moins spécieux. Qu’un faux médecin, qu’un commissaire de police prévaricateur défrayassent la chronique, (p.308) aussitôt la presse éprouvait le besoin de préciser qu’ils étaient juifs, alors que les innombrables canailleries commises par des Belges de souche ancienne étaient mentionnées sans étiquette d’origine. Somme toute, cela était encore anodin.
Si Flamands et francophones éprouvaient à l’égard du Reich des allergies et des rancœurs dues aux souvenirs de 1914, si certains nationalistes flamands persisteraient longtemps à chercher outre-Rhin des « grands frères » apparentés, on peut dire que quelques intellectuels mis à part, la généralité des Belges, si repliés sur eux-mêmes, se caractérisèrent par une méconnaissance profonde du grand peuple voisin. Vérité encore difficile à faire comprendre par le public d’aujourd’hui, ce manque d’information et de lucidité s’étendait au nouveau régime lui-même, dans lequel ses adversaires les plus déterminés ne voyaient qu’un fascisme, alors que ses avatars le conduisaient déjà beaucoup plus loin. Parlant de sa famille en 1941, un Marcel Liebman devait écrire beaucoup plus tard : « Nous abhorrions l’Allemagne et le fascisme, mais nous en ignorions totalement la nature» ‘. C’était normal. Oserions-nous dire que cette nature, les hitlériens eux-mêmes ne la connaissaient pas encore ? Le nazisme a été, par excellence, un phénomène évolutif.
Sans doute sera-t-il intéressant, parce que très minoritaire en Flandre, le VNV devait jouer un rôle dans la collaboration, de jeter un coup d’oeil sur ce qu’on y pensait du problème dans les années trente. Disons tout de suite que si Flamands et Wallons éprouvaient à l’égard du Reich des malveillances et des allergies nées des ressentiments de la guerre, la totalité de la Belgique se caractérisait — quelques intellectuels mis à part, — par une ignorance généralisée. La persécution antisémite accrut les antipathies des uns, les plus nombreux, tandis que le groupe nationaliste flamand manifesta des réactions, tantôt de silence gêné, tantôt d’explication essayant de se montrer compréhensive : les Allemands n’étaient-ils pas des « grands frères », qui avaient soutenu l’activisme en 1914-18 ? Cimenté par un romantisme culturel et social qui d’ailleurs s’étendait en se diluant au-delà de son strict électorat, le VNV était des plus disparates, dans tous les domaines mais aussi sur le plan qui nous occupe. Choqué par certaines outrances et soutenu par le maître à penser hollandais du mouvement, le professeur Geyl, le démocrate Borginon menaça de démissionner, parvint à écarter le pro-nazi Van Puymbrouck, mais échoua devant le raciste Ward Hermans qui avait le mérite, capital, de rapporter des voix à Malines et Anvers. Personnellement incolore, le « leider » Staf De Clercq s’efforçait de maintenir la balance égale. Ce Ward Hermans — futur SS — s’était déjà distingué en 1929, quand il avait diffusé un faux pacte militaire franco-belge dont le caractère apocryphe n’avait pu abuser que des faibles d’esprit. Il publia en 1935 une brochure virulente où il justifiait l’Allemagne qui, selon lui, ne faisait que se défendre contre un peuple étranger. Vinrent ensuite quelques articles où se retrouvaient quelques thèmes classiques:
1 M. Liebman: Né Juif, Gembloux 1977, p. 35.
(p.309) effets dissolvants du communisme, de la franc-maçonnerie, de la juiverie, de tout ce qu’on détestait en somme : le marxisme, l’athéisme, le cosmopolitisme, l’immoralité si parfaitement incarnée par le sexologue Magnus Hirschfeld et Léon Blum, auteur d’un livre où il préconisait le mariage à l’essai. Stavisky, le banquier Barmat et le Front populaire apportèrent ensuite de l’eau à son moulin. Il lui paraissait évident que les bellicistes juifs étaient en train d’endoctriner la France pour en faire un instrument de la conquête du monde à leur profit : capitalisme et bolchévisme, les deux visages de la domination juive. Et en Belgique même, ne jetaient-ils pas de l’huile sur le feu dans Le Peuple, sous la signature de ce récent immigré, Joseph Saxe ?
Ces délires trop connus, rappelons-le, restaient marginaux au sein du VNV, et ne trouvaient un certain écho qu’à Anvers. De Schelde, puis Volk en Staat s’en tenaient davantage à des arguments plus concrets et sans doute plus accessibles aux préoccupations de leurs lecteurs, comme cet amalgame qui est fréquemment fait entre Juifs et fransquillons. Ne possèdent-ils pas les grands magasins ? Est-il normal qu’un Henri Buch (futur professeur à l’ULB, résistant et conseiller d’Etat) soit nommé magistrat à Anvers, donc appelé à juger des Flamands? (De Schelde, 13 mars 1936). De quoi se mêlent ces Juifs, qui proposent un boycott des produits allemands? Ils veulent nous attirer des ennuis (De Schelde, 3 mars 1936). La section francophone de l’Athénée d’Anvers regorge d’élèves juifs — donc doublement étrangers au peuple flamand : ce scandale soit cesser. Quiconque prétend appartenir à une autre nation, doit être traité comme une autre nation. En tant que nationaliste, on admire et salue le nationalisme des Juifs, mais ce n’est pas être antisémite que de vouloir protéger ses propres ressortissants (Volk en Staat, 28 août 1937).
Les limites sont floues entre non-xénophilie, xénophobie affirmée, nationalisme et enfin racisme pur et simple. Contre ce dernier l’Eglise catholique, à vocation universaliste, dressait un rempart puissant. Les autres facteurs, on les retrouvait plus ou moins accentués dans des formations telles que le Verdinaso, la Légion nationale et Rex — sans que le problème juif constitue un dogme auquel il fallût adhérer — ou s’en aller. Les excités avaient la parole, mais ce n’était pas parole d’Evangile, et le point n’était pas central. Faut-il rappeler qu’à l’Action française, Charles Maurras développait le thème de l’antisémitisme d’Etat, tandis que son voisin de colonne et co-directeur, Léon Daudet, déclarait ne pas partager son opinion ? Le parti de Léon Degrelle en resta longtemps aux malveillances suscitées par des points occasionnels, tandis que le gros de ses troupes prenaient ses propos pour ce qu’ils étaient au moment même : l’expression d’un nationalisme xénophobe. La plupart des membres en restaient à cette analyse parue dans Rex du 10 janvier 1936, où l’on distinguait les Juifs belges des autres. Les premiers étaient « nos concitoyens, et nous n’admettrions pas qu’il en soit autrement»; Qu’ils soient tous sympathiques, c’est autre chose. Mais s’il y a un problème, c’est à cause des « nouveaux-venus » qui font au commerce une concurrence
(p.310) déloyale. Et puis, riches ou pauvres, ils sont « de gauche ». Cette question devrait être résolue « afin de prévenir le développement d’un antisémitisme aveugle, dont les conséquences pourraient être graves ». Dans ce but, il existait des « moyens pacifiques » de limitation et d’interdiction de séjour. — Un racisme véritable ne devait germer que dans les têtes isolées de futurs nazis, comme au sein de ce groupuscule « Volksverweering — Défense du Peuple », fondé en 1937 par l’avocat anversois René Lambrichts (et financé, on l’apprendra plus tard, par des services d’outre-Rhin). Le VNV lui-même, du moins dans ses expressions officielles, restait soit réticent, soit limité aux arguments nationalistes, soit tout bonnement muet. La brochure-programme du parti, publiée en 1937 par Elias, ignore le sujet. Sous la signature du jeune Théo Luykx (conduite irréprochable pendant la guerre, futur professeur à l’université de Gand), une autre brochure estime que la politique ségrégationniste allemande est « en partie justifiée par les Juifs eux-mêmes, qui ont toujours été volontairement inassimilables ». Le sionisme serait une solution, ce qui n’implique en aucune manière, se hâte-t-il d’ajouter, une quelconque supériorité de la race aryenne 2.
En fait, le problème prit une réelle consistance seulement après les lois de Nuremberg qui, en Allemagne, rendirent aux Juifs la vie toujours plus difficile : interdictions professionnelles et autres les poussaient à émigrer. Apparemment, le nazisme ne voulait pas leur mort, mais il les voulait ailleurs. Est-ce à dire qu’à ce moment là, on put voir aussitôt se creuser un véritable abîme entre les conceptions hitlériennes et celles des Puissances démocratiques? Force nous sera de répondre par un non catégorique. Partout, les pays s’étaient cristallisés sous la forme de l’Etat-Nation, au sens le plus étroit du terme. Pour entrer quelque part, il fallait un passeport et un visa, celui-ci délivré par une autorité consulaire de l’éventuel sol d’accueil ; pour s’y établir, des conditions précises devaient être remplies. Certes, l’opinion mondiale s’émut. Une conférence se réunit en 1937 à Evian, où chacun s’attacha surtout à faire valoir ses propres difficultés en minimisant celles des autres. Les Etats-Unis étaient disposés à accueillir tous les Juifs qu’on voulait – bien entendu dans les limites des quota réservés depuis 1921 à l’immigration allemande. Leur existence physique, après tout, ne semblait pas menacée. L’URSS refusa même de s’associer à l’effort général : elle n’en accueillit pas un seul. Ailleurs, il y eut une certaine bonne volonté, mais au compte-gouttes. Le problème s’aggrava en décembre 1938 avec les représailles qui suivirent l’assassinat d’un diplomate allemand par un Juif polonais. Cette « nuit de cristal » entraîna des dizaines de meurtres, 20 000 arrestations, 7 500 mises à sac et 101 incendies de synagogues. Le danger se précisait, l’exode s’aggrava. Des bateaux de réfugiés sillonnèrent les océans avec des vicissitudes diverses, souvent
2 Ces citations flamandes sont puisées dans M. Depuydt : Sporen van antisémitisme in België tussen de twee wereldoorlogen. De houding van het VNV, mémoire de licence KUL, 1978.
(p.311) dramatiques, toujours angoissantes. Des comités, des groupes de pression s’activèrent, avec des résultats partiels — et signalons en Belgique les efforts de J. Wolf, M. Gottschalk et H. Speyer, bien introduits dans les sphères gouvernementales. Dans nos cantons de l’Est, des amateurs de «petites affaires» — qui n’étaient pas juifs… — vendirent des passages clandestins pour une rénumération de 1000 ou 1500 francs. La soupape officielle s’ouvrit et se referma, au gré des pressions et des possibilités. Un camp de réfugiés s’ouvrit à Merxplas, mais quelque 5 000 fuyards non autorisés et non recensés se fondirent dans l’anonymat, aidés à Bruxelles et Anvers par la solidarité de leurs coreligionnaires. Certes, la pitié était communément partagée, et nous nous en voudrions de ne pas citer, dans la Nation belge du 13 octobre 1938, ce texte où Robert Poulet déclarait compatir « de tout cœur aux infortunes qui sont infligées, dans presque toute l’Europe centrale, à des êtres faibles et innocents, … au nom d’un racisme dont les bases philosophiques, scientifiques, psychologiques sont absolument inexistantes ». Mais la petite Belgique pouvait-elle absorber les centaines de milliers de Juifs allemands qui, sans doute, allaient bientôt demander un asile ailleurs?
Les catholiques étaient émus dans leurs sentiments de charité, les libéraux étaient choqués, et les socialistes indignés — mais aucun d’entre eux n’oubliait les intérêts nationaux. A la Chambre, une rare unanimité se fit à la séance du 22 novembre 1938, dont le niveau mérite d’être souligné. Après une chaleureuse interpellation de la socialiste Isabelle Blume qui fut saluée par des « applaudissements prolongés sur tous les bancs », le ministre de la Justice Pholien la félicita de son « très beau discours ». Il se trouvait, dit-il, devant la nécessité contradictoire de défendre l’ordre public et de se soumettre aux règles d’une « saine humanité ». Les visas légitimes étaient toujours accordés. On avait fermé les yeux sur les premiers 850 réfugiés. Il en était venus 1250 en août, 870 en septembre… Aujourd’hui, ils étaient « des dizaines de milliers » dont se précisait la perspective. Des camps avaient été ouverts, 250 enfants venaient d’être accueillis. Que faisait-on ailleurs ? Beaucoup moins. Seule une conférence internationale pourrait résoudre le problème ; la Belgique s’y associerait « du plus profond du cœur ». — Le catholique Du Bus de Warnaffe abonda dans le même sens, mais en appuyant sur le point de vue économique. Le 8 avril dernier, 800 travailleurs gantiers, à Bruxelles, s’étaient mis en grève pour protester contre la concurrence juive. Nous avions accordé « une facile hospitalité à quelque 50 000 Juifs » lesquels, trop souvent, trouvaient « dans l’inobservation des lois sociales des facilités de concurrence déshonnête qui, si l’on n’y (prenait) garde, (pourrait) par contagion mettre en péril l’économie même de ces lois ». L’antisémitisme nous menaçait, il était urgent de l’éviter. « Si nous ne sommes pas très vigilants, j’ai la conviction personnelle qu’un problème juif pourrait se poser en Belgique avant cinq ans. » Nous étions une terre de refuge, mais pas une terre d’exploitation. Il fallait être humains, mais pas dupes. La limite de nos capacités d’absorption était atteinte. — Le communiste Relecom concéda que les refoulements (p.312) avaient été suspendus jusqu’au 22 novembre ; mais que ferait-on ensuite ? Il y avait aussi des patrons belges qui ne respectaient pas les lois sociales. A quand une initiative internationale ? Et de reprocher aux rexistes le ton antisémite du Pays Réel. — A quoi le rexiste Horward répondit que quand on était un admirateur inconditionnel de l’Union soviétique, cette championne toutes catégories de la persécution, il était préférable de se taire. En attendant, dit-il, la saturation était atteinte avec 90 000 Juifs, il convenait de recenser, planifier, réglementer, et de faire appel à la solidarité internationale. — Gérard Romsée, porte-parole du VNV, tint à stigmatiser dès la première phrase les méthodes d’outre-Rhin. Ce qui était préoccupant, c’est que d’aucuns cherchaient à utiliser ces malheureux réfugiés pour exciter l’opinion contre l’Allemagne — une manœuvre qui était sans utilité pour les Juifs, et dangereux pour nous. Une immigration massive était-elle imaginable ? La communauté nationale devait être protégée sur le plan économique, et aussi dans son intégrité culturelle. Avec 280 000 chômeurs, notre marché du travail ne pouvait plus accueillir personne, et le commerce lui aussi était saturé. Par ailleurs, il y avait les lois de l’humanité : et de proposer un choix sévère, en fonction de la gravité des situations individuelles ; des permis de séjour temporaires, mais aussi des interdictions de travail. Dieu merci il n’y avait pas d’antisémitisme en Belgique ; il y en aurait, si on se laissait envahir. Humanité oui. Hospitalité oui. Mais aussi protection des intérêts de la communauté nationale. — Le socialiste Eekeleers stigmatisa le groupuscule. « Volksverweering » et Vandervelde, « patron » du Parti Ouvrier Belge, après avoir souligné que les Juifs avaient, comme les autres, à respecter les lois sociales, reconnut la « bonne volonté évidente » du gouvernement et se réjouit de l’unanimité qui allait se faire sur un ordre du jour traduisant l’émotion générale, le souci de concilier ordre public et sentiments d’humanité, et faisant confiance aux autorités à la fois sur le plan intérieur et dans la perspective d’actions internationales. — Cet ordre du jour, présenté par les trois partis traditionnels, fut voté à l’unanimité le 24 octobre 1938 ; seul s’abstint le communiste Relecom ; c’était le maximum de ce que pouvait faire un parti dont tous les votes, sur tous les sujets, étaient toujours systématiquement négatifs.
L’exode des Juifs. Pour eux, quel statut?
Fondamentalement, la Belgique était donc saine, même si son ethno-centrisme national semble, aujourd’hui, quelque peu dépassé. Toutefois, la situation générale se faisait toujours plus préoccupante, et il était difficile d’enrayer une immigration clandestine qui obligeait un nombre croissant de malheureux à s’entasser dans des taudis et y subsister (qu’eussent-ils pu faire d’autre?) en se livrant à des travaux aussi peu contrôlés qu’ils l’étaient eux-mêmes. On aura remarqué, plus haut, l’argument de la concurrence économique. Les socialistes ne pouvaient manquer d’y être sensibles, (p.313) et davantage encore les syndicats. A Anvers, le bourgmestre socialiste Camille Huysmans, connu pour son esprit d’indépendance, allait plus loin que son parti et protégeait de son mieux ses immigrés : rien de très étonnant à ce qu’aux élections communales d’octobre 1938, le respectable parti catholique, qui menait campagne contre lui, se soit présenté comme un rempart contre « plus de cinq mille étrangers, pour la plupart des Juifs allemands », dans lesquels on voyait déjà «un corps d’élite pour la prochaine révolution » 3. L’électoralisme a ses exigences… La mobilisation de l’armée en août 1939 devait, elle aussi, jouer son rôle : graduellement jusqu’à 650 000 hommes sous les armes, et parmi eux beaucoup d’indépendants et de travailleurs en situation précaire, tandis que leurs familles connaissaient des moments difficiles. Et pendant ce temps-là que faisaient les « étrangers », eux aussi protégés après tout par le sacrifice des nationaux ? Ils prenaient leur place et raflaient leur clientèle !
Répétons-le : un journal de droite comme la Libre Belgique repoussait de toutes ses forces le racisme et stigmatisait les « cruautés révoltantes » qui se déroulaient outre-Rhin (voir, entre cent exemples, les 15, 17 et 19 novembre 1938). L’antisémitisme à l’hitlérienne était refusé, aussi parce qu’il était essentiellement anti-chrétien (11 avril 1938). — C’était la foi catholique qui avait empêché Dollfuss, Salazar et Franco de tomber, « malgré les sollicitations de la politique, dans les erreurs du racisme et du nationalisme exagéré » (6 août 1938). — Le racisme était une hérésie qui menaçait « les assises surnaturelles de l’Eglise », déniait à l’humanité «toute valeur spirituelle» et constituait «un danger international aussi grave que le bolchevisme » (18 novembre 1938). — A la mort de Pie XI, on le glorifia d’avoir combattu « avec une inlassable intrépidité, jusqu’à son dernier souffle, le racisme et le communisme, ces deux fléaux contemporains» (11 février 1939).
Mais il y avait, tout de même, cet afflux inquiétant d’étrangers tout à fait incompatibles et inassimilables, avec des caractéristiques qui mettaient mal à l’aise les Juifs belges eux-mêmes. Entendons-nous bien : la proverbiale générosité juive intervint sans compter, mais est-ce à dire que la communauté israélite formait un bloc sans faille? Sait-on suffisamment que le culte hébraïque est le seul dont tous les offices se terminent, selon le rituel, par l’exécution de la Brabançonne et des prières pour le Roi? Emouvant témoignage d’une volonté d’intégration, en dépit de quelques différences enrichissantes et pas plus fortes, d’ailleurs, que celles qui distinguent les Belges de souche entre eux. En fait, on ignore à quel point le monde juif est divisé par ses origines géographiques et les vicissitudes historiques variées qui en résultèrent, et dont même les sensibilités religieuses conservent l’empreinte, par les progrès de la laïcité et, bien entendu, par des opinions politiques aussi contrastées qu’ailleurs; par les attitudes à l’égard du grand rêve qui se précisait à la faveur des persécutions : le sionisme.
3 M. Steinberg: La solution finale en Belgique, dans la Revue Nouvelle, octobre 1983, p. 298.
(p.316) Après 1940. Toujours le « statut »
Les remous de l’Apocalypse n’étaient pas encore apaisés lorsque, le 19 juin 1940, le président du Parti ouvrier H. De Man rédigea un programme de gouvernement où il alignait onze mesures qui lui paraissaient devoir s’imposer dans l’immédiat, pensait-il, puisque la fin de la guerre était proche, et avec elle, la libération du Roi. Y figurait la « protection de la race, en respectant les commandements de l’humanité ». Il est clair qu’à cette date, dans l’esprit de l’ancien ministre, il ne s’agissait pas d’un quelconque alignement sur des idées ou des législations allemandes. Falkenhausen venait de lui dire qu’il se désintéresserait de nos affaires intérieures ; au surplus, après la brève et foudroyante parenthèse des opérations militaires où notre sol n’avait servi que de voie de passage, on pouvait considérer que la Belgique allait bientôt recouvrer son indépendance4.
Peu après, une opinion plus surprenante nous est fournie par un homme des plus honorables. Résistant de la toute première heure, puisqu’il avait été écroué à Saint-Gilles après son refus de reprendre ses fonctions à la radio contrôlée par l’occupant, Paul Lévy — converti au catholicisme — rédigea en septembre 1940 un mémoire de 33 pages qui était le fruit de ses réflexions sur le problème. Il affirmait la nécessité d’un «statut» qui serait résolument «a-sémite et antiraciste». Les premiers racistes étaient à ses yeux les Juifs, puisqu’ils refusaient de s’adapter à leur entourage (comme il l’avait fait lui-même). La solution allemande devait être repoussée sans hésitation parce que raciste et donc, en un certain sens, confirmant les désirs des Juifs eux-mêmes. La judéité n’était que la conséquence d’une religion, mais quel engrenage ! Enfermer ces gens dans un ghetto, c’était les renforcer, donc alimenter un fâcheux antisémitisme, donc ne plus pouvoir sortir d’un cercle vicieux. Les solutions française et belge (c’est-à-dire l’assimilation) avaient été d’abord des plus satisfaisantes, mais
4 CREHSGM. Papiers De Man, n° 142.
(p.317) tout avait changé avec « l’afflux brutal » de masses tout à fait étrangères, parce que leur racisme était opposé à notre « morale ethnique». Et de proposer une autre solution belge :
« 1. Ne font partie de la communauté nationale belge, et ne peuvent donc être citoyens belges que les individus nés en Belgique, dont un des parents est lui-même né en Belgique et qui, par son attitude, sa vie et ses actes a prouvé qu’il se considérait comme Belge et uniquement comme tel…
« 2. L’exercice de la religion juive un an après la mise en vigueur (du statut). Les subsides officiels seront supprimés. La possibilité d’émigrer sera donnée aux Israélites désirant continuer à exercer leur religion… » (Suit l’interdiction des abattages rituels, des cercles d’études, des associations culturelles…)
« 3. Les mariages des conjoints ayant chacun plus de deux grands-parents de religion juive sont, en principe, prohibés. Le fait, pour une personne d’origine israélite, de choisir son conjoint parmi des individus de même origine sera considéré comme un acte prouvant qu’elle s’exclut de la communauté nationale au sens du paragraphe 1 » 5.
Ce texte, rédigé en prison répétons-le, n’a lui non plus rien à voir avec les Allemands, puisque la première ordonnance de l’administration militaire ne date que du 23 octobre. Lévy allait subir ensuite une année horrible à Breendonck, être libéré en novembre 1941 (sur intervention, paraît-il, de De Man et du Roi), passer en Angleterre et devenir après la libération fonctionnaire européen, puis professeur à l’université de Lou-vain. Interdire une religion ? Restreindre le libre choix d’une compagne de vie et des liens sentimentaux? Par la suite, l’auteur a affirmé qu’il ne s’agissait que d’une boutade. A chacun d’apprécier… Au minimum, c’était pourtant l’extrapolation d’un cas personnel ; ce mémoire d’un homme intelligent et courageux, nous aurions d’ailleurs préféré l’oublier, si l’honnêteté ne nous avait pas imposé d’en faire mention. En tout état de cause, Paul Lévy s’inscrivait, lui aussi, dans «l’air du temps»… Signalons en passant que la fausse nouvelle de sa mort avait été diffusée par le clandestin La Liberté avec ce commentaire : « Ce grand Belge a détruit par son exemple toutes les affirmations tendant à faire croire que les Juifs étaient apatrides » (nos 38-39).
La même idée de « statut » se retrouve chez Robert Poulet, tout aussi détaché de l’influence allemande que les deux autres. Est-ce à dire qu’il avait changé d’avis, cet écrivain dont nous reproduisions plus haut les commentaires apitoyés ? Certainement pas, mais dans l’intervalle, lui qui aurait tant voulu empêcher une guerre (« évitable, bête et mal engagée », estimait P.H. Spaak), il s’était irrité de certaines propos belliqueux tenus par des voix Israélites ; surtout, se méprenant sur les pouvoirs que la loi du 10 mai 1940 avait conférés aux secrétaires généraux, il eût souhaité les voir prendre des initiatives prévenant et limitant celles de l’ennemi. Dans le
‘ CREHSGM. Ibid., n°s 224-234.
(p.319) L’indifférence, constatée par tous les observateurs, ne sera guère troublée lorsqu’apparaîtront les affichettes signalant les maisons de commerce non-aryennes. L’expectative ricanante du collaborationniste Journal de Namur est logique : on allait savoir à quoi s’en tenir. « Nous sommes curieux de compter combien il y a de magasins juifs chez nous » (5 décembre 1940). — En revanche, les commentaires de résistants sont sobres et rarissimes. N’achetez pas dans les magasins juifs, recommande la Nation libre dans son numéro 12 de 1940. Ils sont sous séquestre allemand, et votre argent irait aux Boches. — Un autre écho, indirect celui-là, nous vient de la collaboration. La pancarte « Entreprise juive », écrit Volk en Staat, a inspiré à certains commerçants l’idée d’arborer les couleurs nationales avec l’inscription « Entreprise belge ». Et de conclure avec aigreur : « Ce n’est nullement obligatoire» (12 septembre 1941).
Au début de 1941 circula dans divers clandestins (entre autres Churchill Gazette de février) l’excellente plaisanterie (fondée ou non) selon laquelle le chef du rexisme descendrait en droite ligne d’un Isaac Moskovski installé à Reims en 1760 — mais à la généalogie, on ajoute ce commentaire : dès lors, comment ose-t-il parler au nom des Belges, lui qui n’en est pas un ? — Un peu plus tard, le socialiste Monde du Travail ne cachait pas son aversion pour ces trois catégories dont les nazis venaient de découvrir la nuisance, Juifs, bolchévistes et francs-maçons : « Nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres… Les Juifs capitalistes sont encore plus avares et rapaces que les autres ». Mais en attendant, ce ne sont pas eux qui nous ont attaqués (n° 31, après juin 1941). — Pour en finir avec la notion de « statut », telle qu’elle s’exprimait dans l’opinion de résistants, il faut encore en signaler un écho bien tardif dans un autre organe de gauche, L’Idée socialiste de septembre 1942 — soit après la grande vague des déportations. Après avoir, cela va de soi, affirmé son idéal d’« émancipation humaine », le journal faisait encore la distinction entre deux sortes de Juifs : les assimiliés qui ne posent aucun problème, et les autres, immigrés dans un pays « qui n’est pas le leur, provoquent des réactions de rejet et aspirent à un statut (retour en Palestine, ou organismes propres au sein de leur pays de résidence) »…
Avant même la publication des décrets de l’occupant, la collaboration s’était montrée sensible aux mesures prises à l’étranger. Dans le Pays Réel du 22 octobre 1940, Serge Doring commente le statut qui se prépare à Vichy, celui d’un antisémitisme d’Etat. La Révolution française avait accordé la citoyenneté à un peuple étranger, il en était résulté une infiltration, puis une domination. Pour la Belgique, cet auteur rexiste souhaiterait une solution semblable, faute de quoi on aboutirait à des manifestations individuelles où le sentiment, les désirs de vengeance, les représailles, les mesures arbitraires supplanteraient la raison. — Tout naturellement, son confrère Volk en Staat regardait, lui, vers le nord. Il signalait les décisions
(p.320) qui venaient d’être prises aux Pays-Bas, « sans que cela veuille dire que nous les approuvions toutes des deux mains». Il était vrai, aussi, que l’influence juive y avait pris une ampleur disproportionnée. Cela étant dit, il fallait reconnaître que les plus philosémites refuseraient de traiter en concitoyens les habitants de certains quartiers anversois. Ces gens n’avaient « ni honneur ni moralité » dans leurs relations d’affaires. Pour ces apatrides, les chrétiens n’étaient que des objets d’exploitation. Ils étaient tout prêts àa trahir leur terre d’accueil ; l’Allemagne l’avait appris à ses dépens (10 octobre 1940). — Est-ce déjà du racisme? Nous hésitons à aller aussi loin. — Le 23 novembre 1940, le journal donne des exemples de cette « avidité », de cette «moralité commerciale dénaturée» ; le 1er décembre, il va jusqu’à titrer : « Comment les Juifs s’enrichissent dans leur ghetto ». — Mais voilà, les 8-9 décembre, le même Jan Brans obligé de se défendre. Ses articles précédents lui ont valu des protestations. Des lecteurs lui ont écrit ; ils sont sans nul doute bien intentionnés, mais ils ont le tort de raisonner avec leur cœur. Lui-même voit mieux tous les aspects de la question à travers les siècles, invoque Sénèque et Tacite, Mahomet et Luther, Franklin et Frédéric II, Kant, Goethe, Napoléon, Schiller et Fichte. De tout quoi il ressort clairement que les Juifs ont toujours triché, retourné contre nous nos nobles principes humanitaires. Ce nationaliste flamand cite même Bernard Lazare, ce qui montre qu’il ne dédaignait pas de lire Maurras. Et de conclure : « ce n’est pas nous qui avons refusé l’intégration… La solution est entre les mains des Juifs eux-mêmes». Remarquons cependant qu’après cette mise au point, Jan Brans devait se taire pendant des mois. Quant à son chef et ami Staf De Clercq, il s’en tenait aux brèves déclarations qu’il avait faites dans son discours du 10 novembre 1940: «Les Juifs ne sont pas nos compatriotes».
Dans le Pays Réel, la hargne est permanente, au cours de ces premiers mois. — Le rappel de l’exode de Moïse, une preuve que bien avant l’incarnation du Christ, les Juifs étaient incapables de s’assimiler aux peuples qu’ils « envahissent » (21 septembre 1940). — Une allusion au livre « pornographique » publié jadis par Léon Blum (4 octobre 1940). — Un dessin montrant, sous le titre « Le statut des Juifs », un personnage au nez crochu en discussion avec son percepteur : « Ça peut peut-être s’arranger, avez-vous rendu un service quelconque à l’Etat? » — « Oui… Ch’ai bayé mes contributions! » (1er décembre 1940), etc. — Mais aussi (surprise… José Streel ?) ces lignes : « On sait que dans ce journal nous n’avons jamais professé cette phobie de la franc-maçonnerie et des Juifs qui, chez certains esprits faibles, atteint à l’hystérie. Expliquer tous les malheurs qui se produisent par l’action ténébreuse des francs maçons et des Juifs est un enfantillage indigne d’un esprit politique quelque peu formé et informé » (22 septembre 1940).
Si le rexisme n’est pas encore bien significatif, il est surprenant de constater que le Soir (volé) adopta d’emblée des thèses carrément racistes. Le peuple hébreu se caractérisait par de « lourdes tares » ; ses métissages avec le nôtre n’avaient jamais donné qu’« un pourcentage énorme d’inadaptés (p.321) sociaux, d’éléments instables, de délinquants, de débiles mentaux, voire même de criminels ». La France leur devait son déclin mais heureusement, une race plus forte et plus pure allait prendre la relève ; les mesures législatives qui venaient d’être prises indiquaient que la Belgique allait s’aligner, et s’engager dans le sens d’un « avenir régénéré » (7 novembre 1940). — Le 13 novembre, un reportage hargneux sur le ghetto d’Anvers s’illustrait d’un dessin représentant « la plus extraordinaire collection de têtes que cauchemar puisse évoquer». — En décembre, on republiait, puisée dans la collection du Peuple d’avant 1914, une série d’articles fumeux, rédigés en plus dans un style suranné, qui n’étaient certainement pas ce que l’éminent jurisconsulte socialiste Edmond Picard avait produit de meilleur. On passait ensuite à la Maçonnerie, tout aussi maltraitée, puis un collaborateur du journal se rendait à Francfort pour y assister à l’inauguration d’un Institut « scientifique » voué à l’étude de ce problème « fondamental ». Pour la première fois dans l’histoire du monde, l’Allemagne y apportait la solution définitive. Le Juif était un étranger absolu, biologiquement inassimilable, même s’il quittait la synagogue, même s’il embrassait le christianisme, même s’il adoptait, fût-ce sincèrement, la nationalité du pays d’accueil. Tous devaient donc être traités de la même manière, tous auraient à quitter le continent (9 avril 1941). — Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, que l’on soit en guerre ou en paix, les Bruxellois moyens achètent le Soir à la fin de la journée, en quittant leur travail. Ce qu’ils pensaient du contenu, c’est autre chose, mais on doute qu’il y en ait eu beaucoup pour entériner un tel extrémisme. Alors, pourquoi ces outrances, exceptionnelles dans la presse censurée ? L’administration militaire n’en exigeait pas tant : elle distribuait son matériel de propagande, mais n’en imposait pas la publication. Ses ordonnances étaient reproduites ou résumées, avec la mention « Belgapress ». Les journaux étaient libres d’y ajouter des commentaires — favorables bien sûr —, libres aussi de ne pas souffler mot. Dans le cas du Soir, risquons une tentative d’explication. Etait-ce pour faire accepter les nombreux articles où s’affirmait la foi dans l’union nationale et l’indépendance de la patrie ? Ou bien parce que son directeur Raymond De Becker, selon la rumeur publique, avait lui-même une bonne dose de sang juif? Les motivations des hommes sont rarement univoques…
En effet, dans la Cité Ardente, la Légia se montrait beaucoup moins intéressée. Pendant les premières années de l’occupation, on n’y découvre que deux articles, l’un sur l’influence des Juifs dans le monde du cinéma, l’autre sur les anciennes campagnes bellicistes qui leur étaient attribuées — et cela sous la plume d’un correspondant parisien. Quant à la presse d’information flamande, elle se borna de loin en loin à des poncifs connus, mais sous le double éclairage de l’amalgame Israël-Maçonnerie-bolchévisme-athéisme et dépravation des mœurs. Plutôt rares au début, ces thèmes ne se multiplièrent que dans les douze derniers mois, avec la progression de l’Armée rouge… et à un moment où, hélas !, clandestins mis à part, il ne restait plus beaucoup d’Israélites dans le pays… Comme aussi (p.322) en région francophone, la question allait évoluer en fonction de la lutte entre Reeder et Himmler, par agents respectifs interposés : soit le VNV d’une part, la SS flamande et DeVlag de l’autre. Soucieuse par ailleurs d’exécuter les ordres mais sans heurter trop brutalement l’opinion belge, l’autorité allemande se contentait d’un antisémitisme modéré. Un véritable racisme, en tout cas au début, était principalement incarné par le groupuscule « Volksverweering » de l’avocat Lambrichts : un ramassis d’indicateurs et d’hommes de main qui s’illustrent, en avril 1941, par la mise à sac du quartier juif anversois ; il est significatif que, prudente, l’administration militaire soit intervenue auprès de la censure pour qu’aucune publicité ne soit faite à l’événement. Les deux hebdomadaires étaient intégralement financés par la SS. S’y étalent des caricatures suant la haine et le mépris, des statistiques (incommensurablement gonflées) du pourcentage d’Israélites dans les diverses professions, des exigences précédant de peu les mesures qui allaient être prises — preuve qu’on était bien informé —, des appels indulgents à la fraternisation générale (francs-maçons compris !) contre l’unique adversaire, des noms et adresses de Juifs et notamment, suprême abjection, ceux qui ne s’étaient pas fait enregistrer. Signalons au hasard, dans l’Ami du Peuple du 14 novembre 1942 (après la grande vague des déportations…) ce dessin montrant deux amis dans un bar de luxe : « Tiens, Chaïm, tu ne portes pas l’étoile ?» — « Penses-tu, ils m’enverraient travailler en Pologne…» — Inutile de dire que cette fange servait surtout à décorer les kiosques à journaux ; rares étaient les acheteurs.
Il n’en reste pas moins, on l’a vu, qu’un léger antisémitisme à base de repli national était encore latent, et cela dans tous les bords. « L’opinion ne s’émouvait guère parce que les cas les plus tragiques étaient peu connus du public », avouerait le Peuple de juillet-août 1942. Mais quittons un instant cette approche historique pour évoquer le bon dépouillement fait naguère par une jeune licenciée en journalisme selon la méthode propre à cette discipline : l’analyse de contenu. Après avoir examiné 600 feuilles clandestines, Ariette Ciga conclut que 15 % d’entre elles ont mentionné le problème, soit pour le commenter, soit pour fournir de simples informations. Soit 85 % d’ignorance ou d’indifférence surtout, il est vrai, dans des localités où il n’y avait pas de Juifs. Leur regroupement dans 4 villes du pays, la faible proportion d’Israélites de nationalité belge (3 764 sur 46 642 enregistrés /), ces compatriotes n’étant d’ailleurs gravement impliqués qu’en septembre 1943, le sentiment général, du moins jusqu’en 1942, que les restrictions qui leur étaient imposées n’étaient pas beaucoup plus pénibles que celles dont souffrait l’ensemble de la population — mieux, ou pire, qu’après tout elles étaient logiques, tout cela explique un réel manque d’intérêt. Ce n’est pas tout. Notre auteur a relevé dans ces journaux résistants 37 articles ou entrefilets déplaisants: 12 parlent sur un ton pas très amène d’« habiles commerçants», 9 appuyent lourdement sur des particularités physiques, 7 leur attribuent des « caractères rusés», et 4 ne les « aiment pas». Le déicide apparaît dans 3 articles, 2 les soupçonnent d’accointances avec la Gestapo ou de « s’arranger avec l’occupant » — ce (p.323) qui n’est d’ailleurs pas exclu du tout: il y eut hélas! parmi eux des dénonciateurs appointés6.
Et puis et surtout, il y avait un autre phénomène plus diffus, dont tous les Belges « occupés » ressentirent les effets. Après tout, l’armée allemande de 1940 avait combattu correctement, à un épisode près, vite oublié. Des informations avaient filtré sur les massacres pratiqués en Pologne et en URSS par les « Einsatzgruppen » SS, mais ils paraissaient s’inscrire dans la tradition des pogroms antérieurs. Au pire, il n’y avait guère d’SS en Belgique, et « cela ne se passerait pas ainsi chez nous ». Enfin, les « bourrages de crâne s» de 1914-18 avaient laissé des souvenirs négatifs. Un mensonge peut être efficace, dans l’immédiat ; à terme, il se retourne contre son auteur. Que n’avait-on pas dit, et accepté dur comme fer la fois précédente ? Bien sûr, les massacres de Dinant, les incendies de Louvain n’avaient pas été imaginaires, mais au-delà de ces « bavures », la propagande alliée n’avait reculé devant aucune outrance. Harold Nicolson en avait fait l’aveu à la Chambre des Communes en février 1938: « Nous avons menti honteusement. » Nos pères avaient été crédules ; plus « adultes » qu’eux, nous ne nous laisserions plus prendre. Quiconque, en 1942, aurait avancé dans une conversation de Belges moyens l’hypothèse que les Allemands pourraient bien déporter les Juifs pour les tuer, se serait heurté à un scepticisme général : « Suffit. En 1914, on nous avait fait croire qu’ils coupaient les mains des petits enfants… »
Renvoyons au livre, remarquable et approfondi, de Maxime Steinberg pour tout ce qui concerne l’exposé chronologique des faits 7. Les premières ordonnances de l’occupant définirent la notion de Juif, imposèrent à tous leur inscription dans un registre communal et leur regroupement à Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi. La chose passa, soit inaperçue (ils y étaient déjà pour la plupart), soit pour logique et explicable : n’est-il pas d’usage, en temps de guerre, de mettre sous surveillance spéciale les suspects ou les ressortissants d’un Etat ennemi ? Suivirent des interdictions professionnelles (frappant très peu de monde : avocats, fonctionnaires, journalistes, professeurs), la confiscation des récepteurs de radio, un couvre-feu plus strict… Même l’« aryanisation » des entreprises ne paraît pas avoir indigné beaucoup de personnes…
Nul ne pouvait prévoir, selon la formule de Steinberg, que l’enregistrement « créait cette réalité nouvelle » (le Juif), mais qu’il la créait « pour l’anéantir ». Un nombre indéterminé (et pour cause…) d’Israélites ne se rendirent pas à leur bureau d’état-civil pour se faire connaître. Ce fut de leur part le tout premier acte de résistance, inspiré par un instinct obscur ou par le refus de se faire coller une étiquette par un occupant usurpateur. Sans trop s’en douter, ils choisissaient la longue et dangereuse voie d’une angoissante clandestinité. La grande masse des autres se mettaient « en règle»,
6 A. Ciga : Le Juif dans la presse clandestine belge de 1940 à 1944, mémoire de licence ULB, 1973, particulièrement aux pp. 40, 42 et 85.
7 M. Steinberg: L’Etoile et le Fusil, 2 premiers vol., Bruxelles 1983-1984.
(p.324) donc entraient sous la protection de la loi. On peut considérer comme infiniment vraisemblable la réponse ingénue du bourgmestre intérimaire de Bruxelles, en juin 1942, quand on lui demanda pourquoi il refusait de distribuer les étoiles de David, alors que deux ans plus tôt son administration s’était soumise à l’ouverture des registres : « C’est qu’à ce moment, nous n’étions pas aussi certains de la victoire anglaise…»
Une manœuvre diabolique : le « retournement »
Mais voyons l’étape suivante, qui elle aussi verra s’ouvrir une sorte de carrefour. Fallait-il s’incliner devant ce qui pouvait être la continuation logique de la ligne antérieure — ou qui d’un autre côté risquait d’être l’amorce d’une action plus menaçante ? Le 25 novembre 1941, l’autorité occupante constitua une Association des Juifs en Belgique (AJB, et notons le caractère flou du « en ») qui aurait pour objectifs d’« activer l’émigration » (soit, mais quelle émigration ?) et de prendre en charge les écoles et institutions de bienfaisance de leur communauté, sans préjudice d’« autres devoirs » ; en effet, tous les enfants juifs, soumis à la loi belge sur l’obligation scolaire, auraient à quitter leurs établissements pour être regroupés dans des écoles gardiennes et primaires entretenues par l’AJB (1er décembre 1941). Nouvelle ambiguïté : on parlait d’émigration, mais en même temps on institutionnalisait une ségrégation qui, toute déplaisante qu’elle fût, paraissait inaugurer une ère stable et, tout compte fait, rassurante. En quelque sorte, les Juifs recevaient un « gouvernement » distinct, sous la forme d’une « association sans but lucratif » apparemment contrôlée par le ministère belge de l’Intérieur.
La manœuvre était diabolique : les effectifs nazis en Belgique étaient infiniment trop faibles pour s’atteler à la tâche énorme qui se préparait. Le seul moyen, c’était de s’assurer la coopération des futures victimes elles-mêmes, de pratiquer ce que les services d’espionnage appellent le « retournement » et l’« intoxication » 8. Corollaire et condition indispensable du succès : les Juifs qui se prêteraient à l’opération, il fallait qu’ils fussent de bonne foi, qu’ils puissent répercuter sur leurs administrés la confiance qu’ils éprouvaient eux-mêmes, donc leur apporter un soutien cordial dans ce qui devait apparaître comme une œuvre culturelle, philantropique et sociale. « Bis auf weiteres », jusqu’à nouvel ordre, une formule classique dans les instructions reçues par le SD, chargé de la mise en œuvre pratique. Est-ce à dire que dans les bureaux de l’avenue Louise, on était déjà au courant de ce qui se préparait? Certainement pas. Seuls, une douzaine
8 Cette ingénieuse comparaison a été faite par Lucien Steinberg : Le Comité de Défense des Juifs en Belgique 1942-1944, Bruxelles 1973, pp. 57 et suiv. A noter le prénom de cet auteur ; il ne doit pas être confondu avec son homonyme précité.
(p.325) d’hommes connurent, en un premier temps du moins, ce qui fut décidé à Wannsee le 22 janvier 1942. A Bruxelles, les agents d’exécution nazis entreprirent donc une campagne de. séduction cauteleuse qui réussit à convaincre un certain nombre de notables juifs qu’une politique « de présence et de moindre mal » leur faisait un devoir de siéger dans le comité directeur de cette nouvelle institution. Sollicité d’en assumer la présidence, le grand-rabbin Ullmann hésita, recourut au conseil des autorités morales les plus éminentes : le cardinal Van Roey, le ministre d’Etat Carton de Wiart, le président de la Croix-Rouge, l’avocat-général Cornil… N’était-il pas aumônier militaire, n’avait-il pas prêté serment de fidélité à la Constitution ? Tous l’engagèrent à accepter en faisant valoir l’argument classique : nul mieux que lui ne pourrait protéger les siens, limiter des dégâts éventuels, et puis, s’il devait refuser, quelle personnalité suspecte ne risquait-on pas de désigner à sa place ? Il céda (pour démissionner en septembre 1942 après les déportations, être emprisonné puis relâché, et enfin se cacher jusqu’à la Libération dans la résidence de l’évêque de Liège).
A considérer les choses avec le recul, on voit donc se dessiner une nouvelle charnière. L’article 118 bis du Code pénal prévoyait la détention extraordinaire pour quiconque transformerait les institutions ou servirait méchamment les desseins de l’ennemi. Ce texte fut interprété ou plus exactement modifié à Londres en décembre 1942 : désormais, ce serait la peine de mort, et il suffirait d’une collaboration fournie « sciemment », ce qui dispenserait la Justice d’avoir à apporter la preuve d’une intention perverse. Tranchante, Justice Libre, organe du Front de l’Indépendance, donna son opinion : les statuts de l’AJB n’existaient pas aux yeux de notre droit, et les ordonnances allemandes non plus ; y collaborer tomberait sous le coup de l’article 118bis (N° d’avril 1942). Hâtons-nous de dire qu’il eût été monstrueux de poursuivre après la Libération les rescapés du génocide. Ils avaient été aveuglés — comme aussi certains non-Juifs inspirés par d’aussi bonnes intentions. Plus lucides se révélèrent — et c’est pour cela que nous parlons d’un deuxième carrefour — les résistants du Comité de Défense des Juifs (CDJ) qui au même moment se constitua dans le cadre du FI, au domicile du professeur à l’Université de Bruxelles Chaïm Perelman. Son œuvre admirable, nous en parlerons plus loin mais en bonne justice, mention doit être faite d’un précurseur : le petit périodique clandestin Unzer Won, en langue yiddisch, qui dès décembre 1941 avait prescrit d’ignorer les ordonnances contraires à « la loi belge » et, après la création de l’AJB, de refuser cette « communauté obligatoire » (mars 1942). A ce moment toutefois, ces mises en garde n’avaient guère impressionné.
Ce résumé des faits étant établi, voyons ce que pensaient ou faisaient les acteurs ou spectateurs d’une tragédie dissimulée derrière de savants trompe-l’œil. Du côté rexiste, on vit apparaître, chose révélatrice, une curieuse suite de discours à la cantonade. Le feu fut ouvert par les racistes de l’Ami du Peuple, qui reprochèrent aux mouvements d’Ordre nouveau d’être vraiment trop peu intéressés par ce qui constituait tout de même le (p.326) problème fondamental de l’heure. Aussitôt, dans le Pays Réel, José Streel répond à « certains frénétiques actuels », sans les citer nommément. La présence et l’influence des Juifs étaient négligeables avant 1935, à part le bellicisme d’un Joseph Saxe, cet immigré tchèque. Avec l’afflux des réfugiés d’Europe centrale, c’est un problème social qui se posa, et certainement pas sous la forme d’une « hostilité foncière entre deux races hétérogènes ». Ce problème social, il incombe à la société nationale de le régler, donc par une « judicieuse intervention de l’Etat ou du Pouvoir qui, provisoirement, en tient lieu ». Un « antisémitisme d’Etat » par conséquent, sans haine, sans passions populaires, sans violences, sous la forme d’un statut « humain et équitable », exempt de persécutions. « L’antisémitisme d’Etat remet seulement les Juifs à leur place d’étrangers » ; il les laisse organiser leur vie sociale « dans les limites très larges du cadre qui leur est assigné », et qui les protégera « contre les violences individuelles que leur présence aurait pu provoquer par réaction ». C’est là un point de vue « conforme à la tradition des sociétés chrétiennes du Moyen-Age », et qui du reste est provisoire : il pourra dans un sens être amélioré (après le départ des Allemands ? note de l’auteur) « au profit de cas individuels malheureux » (convertis, anciens combattants, etc), et dans l’autre être le prélude d’un retour dans l’Europe orientale d’où ils viennent (P.R. 5 décembre 1941).
— Pauvre angélique Streel, qui en effet devait se sentir toujours plus mal à l’aise au sein de son parti… Car voyons la suite. Dès le lendemain, le chef a.i. de Rex Victor Matthys se désolidarise de son voisin de colonne, catégoriquement mais toujours de manière indirecte. Certaines « âmes sensibles », dit-il, pensent devoir faire des distinctions. Or, la nouvelle législation est encore trop libérale, puisqu’elle ignore les « demi-Juifs qui n’en possèdent pas moins, à 100 %, les stigmates et les tares de leur race ». Même s’ils résident chez nous depuis plusieurs générations, ce ne sont que des « prétendus assimilés ». Ne font-ils pas la preuve de leur « nationalisme raciste » en n’épousant que des leurs ? Partout dans le monde, leur attitude était claire avant 1940. Par leurs excitations, ce sont eux qui nous ont plongés dans un bain de sang. « Un bain de sang aryen, bien entendu ». Les voilà remis à leur place: celle d’« étrangers dangereux»… « Les y outres (hélas ! le mot y est) regretteront un jour d’avoir voulu cette guerre qui les anéantira». Tout cela sous le titre « Les Juifs seront matés» (P.R. 6 décembre 1941).
Les propos — sincères — de José Streel auraient pu être écrits, à peu de chose près, dans la Libre Belgique d’avant la guerre. Ceux de Matthys – qui l’étaient tout autant, laissons-leur ce triste bénéfice — marquent une étape dans la politique de collaboration. Cette dernière a déjà perdu pas mal de sympathisants. Elle n’en devient que plus offensive : les deux phénomènes se tiennent. Toutefois, il importe de ne pas oublier qu’à ce stade de l’évolution, le public reste encore bien distrait: la création de l’AJB, le regroupement de quelques élèves dans des écoles spéciales n’alertent que peu de personnes. En témoignant les réactions, très éparses, que ces événements suscitèrent dans la presse résistante. Eparses, mais (p.327) aussi nuancées. Si Le Peuple d’avril 1942 fait appel à la solidarité à l’égard d’une communauté placée dans un «ghetto moral», c’est aussi «d’autant plus que ces mesures frappent aussi bien les Belges que les étrangers ». — « Manœuvres de diversion !» s’exclame België Vrij (FI anversois). On voudrait nous faire croire que les Juifs sont la cause de tous nos malheurs. Personne ne marchera ! (septembre 1941). — Dans son n° 12, Belgique indépendante se borne à suggérer que tous les magasins, indistinctement, arborent l’affiche « Entreprise juive ». — A Liège, La Victoire (modérée) en reste à une affirmation de solidarité : « Un Juif, un franc-maçon est un homme comme vous et nous. Du moment qu’il soit honnête et qu’il fasse son devoir de Belge, respectez-le, et quand vous pouvez aider à le tirer des pattes des Tudesques d’outre-Rhin, n’hésitez pas un seul instant » (septembre 1941) ; son confrère La Meuse s’indigne, mais sur le seul plan de la ségrégation scolaire : des écoles spéciales pour les Juifs ? Quelle abjection! » (février 1942). — Quant à la Voix des Belges (MNB), elle se contentera de publier en mars 1942 un très bon article contre le racisme ; cet organe, il est vrai, s’était spécialisé dans une réflexion politique d’un ordre plus général.
La préoccupation des prosémites n’était donc que très circonstantielle et marginale. Pour l’interpeller directement, il fallut qu’en juin 1942 (ordonnance du 27 mai), les étoiles jaunes apparussent sur les poitrines de rares passants. Cette rareté frappa au premier abord : on avait tellement entendu dire que les Juifs étaient partout !
Le commentaire du Pays Réel reste, disons, civilisé. Il approuve la « rigueur » de cette mesure « prophylactique », mais il se nuance aussitôt : « Nous ne devons pas nous abaisser à traiter les Juifs de manière barbare ou inhumaine » (23 juin 1942). — Son confrère Volk en Staat, un peu gêné tout de même, nous montre une fois de plus à quel point les hommes se réfugient, d’instinct, dans les leçons du passé, bien ou mal interprétées. Certaines personnes s’indignent, dit-il. Particulièrement les catholiques devraient se rappeler St. Thomas d’Aquin, le 3e concile de Latran et les prescriptions de Paul IV selon lesquelles les Israélites devaient certes être traités avec humanité ; mais n’avaient-ils pas l’obligation de revêtir une tunique jaune et de se coiffer d’un chapeau bleu lorsqu’ils pénétraient dans les quartiers chrétiens? Ceux qui, aujourd’hui, se déclareraient choqués seraient donc, soit de « mauvais catholiques » soit, plus simplement, des « anglophiles larvés » (2 juin 1942). — Le Moyen-Age ! C’est aussi le mot qui revient dans la presse clandestine, avec toutefois un peu plus de lucidité : on se réfère à ce qui est appelé la « barbarie » des siècles d’obscurantisme mais on discerne, cela va de soi, l’intention malveillante. En témoignent België Vrij juillet 1942), Le Monde du Travail (« moyenâgeuse mesure », juin 1942), etc. — Ce n’est pas que les anciennes distinctions soient tout à fait mortes, loin de là. « Que l’on soit pour ou contre l’antisémitisme, écrit La Légion Noire, il est une chose qui révolte : on ne met pas ainsi un tas de gens, toute une race au ban de la société. Uniquement (sic) parce que cette mesure est prise par nos protecteurs, nous devons être contre. (…)
(p.330) /Wannsee, 20/01/1942/
Les exécutions massives, baptisées « traitement spécial » (« Sonderbehandlung », ou mieux encore, « SB ») se dissimuleraient derrière l’intimité des camps. D’ordre écrit, on n’en a jamais retrouvé, et il n’y en eut sans doute pas. Six millions d’êtres humains allaient disparaître en fumée ou autrement, sans qu’on en eût, jusqu’en 1945, la connaissance formelle et indiscutable. — « S’il est exact, devait écrire W. Laqueur, que seule une poignée d’Allemands savaient tout sur la solution finale, très peu nombreux étaient ceux qui ne savaient rien » 9. En terre libre, la première information faisant état d’une « extermination totale » semble être parvenue au Congrès mondial juif de Genève en août 1942, mais elle laissa bien des sceptiques (des esprits normaux peuvent-ils penser l’impensable ?), et le rabbin Jacob Kaplan lui-même devait confesser par la suite que ses derniers doutes ne cessèrent qu’au début de 1944 10.
Comment cette « déportation » fut-elle perçue en Belgique ? Quels commentaires souleva-t-elle ? C’est ce que nous allons voir — mais avant cela, particulièrement nos compatriotes eurent à franchir un énorme et ultime camouflage : celui de la mise au travail. Premier point tout à fait spécifique : la mémoire collective des Belges avait gardé le souvenir des cruelles, stupides et inefficaces déportations de chômeurs pratiquées par von Bissing (contre son gré) en 1916. On s’attendait à une mesure semblable, en la redoutant. Et n’était-il pas logique de commencer par les Juifs, déjà limités dans leur activité ? Précisément, deux ordonnances (11 mars et 8 mai 1942) avaient réglementé leur emploi, qui se ferait sur réquisition et uniquement par groupe. Ces mesures avaient été aussitôt mises en application. On avait vu partir des convois, pour travailler aux fortifications côtières dans le nord de la France. Surtout, on les avait vu revenir, leur besogne terminée. L’opération « anesthésie » avait été tellement vicieuse qu’après coup, on peut se demander si elle avait été vraiment calculée. Quoi qu’il en soit, elle ne manqua certainement pas son effet. — Second point : chacun savait que depuis le début le IIP Reich en guerre avait un intarissable besoin de main-d’œuvre ; l’ordonnance de mars 1942, visant tous les Belges disponibles l’avait confirmé, et une autre viendrait encore la durcir en octobre. Gardons nos deux pieds sur terre : était-il logique, était-il raisonnable, était-il seulement concevable d’imaginer que les Allemands allaient déporter cette précieuse réserve de bras… pour aussitôt l’anéantir ? Nous reviendrons sur la mise en œuvre de la déportation juive, appliquée en juillet 1942 avec l’indispensable coopération de l’AJB, mais voyons tout de suite quelques extraits de la presse clandestine illustrant l’analyse que nous venons de faire. Déjà au début du second semestre de 1941, le n° 35 du Monde du Travail avait manifesté son appréhension globale, héritière des mauvais souvenirs de 1916 : « Verrons-nous une déportation des travailleurs ? » — Ensuite vint la réaction, très explicable, ne voulant et ne
9 W. Laqueur: Le terrifiant secret. La «solution finale» et l’information étouffée, Paris 1981, p. 25.
10 M. Marrus et R. Paxton : Vichy et les Juifs, Paris 1981, pp. 316 et suiv.
(p.331) pouvant voir, dans le sort réservé aux Juifs, qu’une préfiguration de ce qui attendait ensuite les autres catégories de la population : On vient de concentrer les Israélites à Malines pour les diriger, « on a tout lieu de le croire », vers la Pologne. Belges, voilà votre sort, si les Allemands gagnaient cette guerre ! (Monde du Travail, août 1942). — Le même organe socialiste ne s’émouvra vraiment qu’après l’ordonnance d’octobre, laquelle visait cette fois les Belges : « Les bandits à l’œuvre. A bas la déportation ! » (ibid., novembre 1942). — L’analyse est identique dans L’Espoir, socialiste. Parlant des Juifs, il consacre un petit entrefilet à ces « mesures ignobles », à ces «mœurs barbares» (septembre 1942), mais dans son numéro de novembre, la déportation d’ouvriers belges occupe toute la première page. — Même réaction encore au FI d’Anvers. België Vrij avait attribué 20 lignes à la déportation des Juifs, en annonçant que ce n’était qu’un début (juillet 1942), mais dans son numéro suivant, les travailleurs belges en mériteront 140. — « Boucs émissaires! » s’exclame Libération. Les Juifs sont « déportés dans des camps de travail, à l’étranger ». Après eux viendra le tour des officiers et des soldats, puis des jeunes classes, puis des organisations patriotiques (juillet 1942). —Pourquoi pas nous ? (Verviers) partage l’erreur : ces « ignobles persécutions » ne constituent qu’« un aspect du problème de la main-d’œuvre qui se pose pour les nazis d’une façon particulièrement aiguë » (août 1941). — Bref, et l’on pourrait avancer d’autres citations du même genre, le trompe l’œil a été efficace, le sort des Juifs est assurément déplorable, mais on n’y insiste pas trop : ils semblent représenter l’avant-garde d’une misère plus générale, qui pend comme une épée de Damoclès sur la tête de tout un chacun. — Enfin, si en ce second semestre de 1942 les clandestins communistes découvraient une raison supplémentaire de stigmatiser le nazisme, leur analyse globale n’était pas différente. Voici les directives de leur Service de presse : « Aux Bourses du Travail, la mention selon laquelle les Juifs n’entrent pas en ligne de compte pour les offres de travail en Allemagne est retirée ». Voilà qui démontre que les Allemands ont besoin de main-d’œuvre. D’ailleurs, les mesures contre les artisans et petits commerçants juifs n’ont pas d’autre raison : il s’agit de les prolétariser pour les encourager au travail outre-Rhin (avril 1942). — « En recourant officiellement à la déportation de travailleurs des pays occupés, Hitler avoue la terrible pénurie de main-d’œuvre du IIIe Reich… Prélude aux déportations massives d’autres couches de la population, des rafles de Juifs furent organisées… Refuser de travailler pour Hitler, c’est hâter la victoire! (octobre 1942).
Il va de soi qu’à l’AJB elle-même, la chose avait été présentée exactement de cette façon-là. Elle aussi se croyait astreinte à la dure nécessité de la guerre, qu’elle ne serait pas seule à subir. Et puis après tout, les victimes étaient des étrangers… Ce « Judenrat », dirigé par des notables belges sans aucun doute de très bonne foi, assuma pleinement l’organisation des départs vers la caserne Dossin, à Malines, lieu de concentration qui préludait aux embarquements en direction de l’Allemagne. Elle n’est hélas ! que trop vraisemblable, cette phrase attribuée à l’un de ses dirigeants : « Et si vous (p.332) partiez pour l’Europe de l’Est, où serait le malheur?… Vous veniez de Pologne, et vous y retournez, voilà tout ! » Le texte de la convocation parlait d’une «prestation de travail», et il précisait que les réfractaires seraient internés dans un camp de concentration (!). L’affreuse duplicité ne se dévoila que plus tard, trop tard mais en attendant, que de malheureux brimés, trompés, espérant un sort peut-être meilleur en fin de compte que celui qu’ils avaient fini par connaître dans leur éphémère refuge belge ! Ou encore cette réaction du jeune Marcel Liebman (Belge, donc pas concerné dans l’immédiat), refusant la fuite, acceptant avec crânerie n’importe quel sort parce qu’il ne voulait être ni un lâche, ni un déserteur n. Inutile de rappeler que pour la plupart de ces martyrs, l’espérance de vie n’était plus que très, très faible : à peine arrivés à destination, c’était en général le massacre, sans autre examen. Avec, parfois, un petit raffinement de camouflage supplémentaire : on leur faisait signer au préalable des cartes postales annonçant à des amis qu’ils étaient en bonne santé… et l’on n’acheminait ces messages que de longs mois plus tard. La démence raciste avait atteint son aboutissement logique. Il arrive qu’aujourd’hui l’on rencontre un ancien « collaborateur », resté ferme sur ses opinions et toujours aussi convaincu d’avoir agi en fonction d’un bien supérieur. Pas un seul toutefois, nous disons pas un seul qui n’ait gardé sur la conscience le remords d’avoir, à son insu, entériné le génocide. Quelques rarissimes le nient ou le minimisent, ce qui est encore une façon de s’en désolidariser. Au moment même, ces « collabos » n’allaient pas plus loin, n’imaginaient pas aller plus loin que ne le voulait cette sobre information du Pays Réel : La moitié des Juifs de nationalité étrangère ont « maintenant quitté le pays pour un endroit où ils gagneront leur pain à la sueur de leur front, conformément à la loi divine» (25 octobre 1942).
La protection s’organise, mais dans l’aveuglement général
Nous avons vu qu’à cette tragique croisée des chemins, quelques esprits lucides et courageux s’étaient ressaisis : mieux valait se rebiffer, éclairer les résignés, protéger les victimes et, dans la pire des éventualités, avoir au moins la satisfaction de mourir en combattant. Dans le cadre du Front de l’Indépendance, le Comité de Défense des Juifs accomplit une œuvre fantastique dont le tableau, encore incomplet paraît-il, a été dressé par Lucien Steinberg 12. Grâce à une presse clandestine active (Perelman, Roger Van Praag dans le Flambeau, Léopold Flam dans De Vrije Ge-dachte) le pourcentage des réfractaires, faible au début, augmenta sensiblement. Les plus hautes autorités belges furent alertées : la Reine Elisabeth, le cardinal Van Roey et les évêques, le président de la Croix-Rouge Dronsart, la directrice de l’Œuvre nationale de l’Enfance Yvonne Nève-
- Liebman: op. cit., p. 53. : L. Steinberg: op. cit., passim.
(p.333) Jean, Mgr Cardijn et la Jeunesse ouvrière chrétienne, le haut fonctionnaire au Ministère de la Justice Platteau, de nombreux banquiers parmi lesquels le gouverneur de la Société Générale Galopin… (soit dit en passant, voilà qui rend quelque peu incompréhensible l’affirmation de Marcel Liebman, selon laquelle l’antisémitisme aurait été une création de la bourgeoisie et du capitalisme). Ces inspirateurs s’appuyaient sur une pyramide d’incalculables dévouements individuels, d’autant plus nombreux que beaucoup négligèrent, mission accomplie, de se faire recenser après la Libération. Pendant ce temps-là, des dizaines de milliers d’individus adressaient des lettres de dénonciation à la Kommandantur, souvent pour régler de vulgaires comptes personnels : ainsi, dans la hideuse et magnifique histoire des hommes, on voit sans cesse se côtoyer le meilleur et \e pire… Quelque 4 000 enfants furent sauvés, bien des adultes, pourvus de logements et de timbres d’alimentation, purent disparaître dans la clandestinité. Pour des raisons évidentes, des chiffres exacts ne pourront jamais être établis. A la conférence de Wannsee, les Juifs de Belgique, présents à cette date, avaient été estimés à 43 000. 25 559 personnes passèrent par Malines, 1 244 rentrèrent de captivité en 1945… La proportion des sauvetages a donc été remarquable ; les trois quarts d’entre eux peuvent être attribués à l’action du CDJ.
En outre, cette organisation comprenait un groupe d’action directe, composé de Partisans armés (pas tous juifs, d’ailleurs). Lui revient la responsabilité du meurtre d’Holzinger, un dirigeant de l’AJB plus naïf encore que les autres, donc particulièrement nuisible (29 juillet 1942). Deux jours plus tard, ces résistants attaquaient et mettaient à sac le local bruxellois de l’AJB, afin d’en détruire les fichiers. Cet épisode devait être commenté par la Libre Belgique (Liège) de septembre 1942, mais en des termes qui nous montrent une fois de plus à quel point le camouflage nazi avait été efficace. Méconnaissant tout à fait le caractère allemand de l’AJB, ne croyant voir en elle qu’une œuvre de protection des Juifs, cette feuille résistante ne put que s’interroger. D’où venait cette agression ? De toute évidence, de la police allemande, qui avait voulu mettre la main sur les fichiers, enrichir sa liste de travailleurs potentiels. Et non sans résultats : ne voyait-on pas les Juifs partir à la cadence de mille par jour « vers les mines de sel de Pologne, vers les tissages de Silésie et les fortifications du nord de la France». — Outre quelques autres actions moins spectaculaires mais protectrices, cette unité de PA (à laquelle s’allièrent des membres du Groupe G) s’illustra, pendant la nuit du 19 au 20 avril 1943, par l’attaque d’un train de déportés près de Tirlemont. Cette action se solda par 108 évasions définitives, 75 échecs (c’est-à-dire des évadés repris) et, sans doute, 21 tués sur place.
La presse du CDJ, disions-nous, se caractérisa par la relative exactitude de ses informations, donc par son influence bénéfique. C’est elle qui publia, en 1943, le rapport d’un « espion » qui, sous la couverture d’un voyage scientifique, interrogea en Allemagne des travailleurs étrangers dont les propos ne pouvaient plus guère laisser de doute sur le sort des déportés
(p.334) raciques. Le Flambeau avait un premier mérite : il refusait de tomber dans une sorte de contre-racisme, de se montrer exclusivement philosémite. Les pratiques dénoncées menaçaient d’autres catégories sociales encore, de telle sorte qu’en aidant les Juifs, on servait l’ensemble de la population. Dans la misère générale, les Juifs ne sont qu’une avant-garde (mars et mai 1943). — On parle de cet « Est » mystérieux dont personne ne revient : « la déportation, c’est la mort » (mars 1943). — « Le plus souvent, ce sont des nouvelles tragiques : des fusillades en masse, des empoisonnements par les gaz, des attaques armées contre les ghettos en Pologne ». Mais le refrain subsiste : solidarité pour tous. Il y en a d’autres qui se cachent. « Les réfractaires au travail obligatoire en Allemagne sont dans le même cas » (novembre 1943). — Et d’en revenir à la question essentielle : il ne s’agirait que de déportation dans des camps de travail ? Alors, pourquoi des vieillards, pourquoi des enfants ? (janvier 1944). — Corollaire de ce que nous remarquions plus haut, le plus significatif, dans l’esprit de ce clandestin, c’est une réelle modération à l’égard du peuple allemand en soi. On pourfend « la bête hitlérienne, le fascisme, les sadiques nazis». Alors que la presque totalité des résistants étroitement « belges » mettent volontiers IIIe Reich et « Bo-chie » dans le même sac, les Juifs du CDJ (plus cosmopolites, ayant franchi davantage de frontières?) font mieux certaines distinctions.
A mentionner encore, dans cette œuvre protectrice, l’intervention personnelle de la Reine Elisabeth, qui obtint la promesse que les déportés seraient traités humainement (?) et qu’en tout état de cause les Belges (pas beaucoup plus de 3 000) seraient préservés — ce qu’ils furent jusqu’en septembre 1943. Submergés comme ils l’étaient en août 1942, les nazis pouvaient s’engager à titre provisoire. En outre, sans vouloir minimiser l’effet de cette intervention royale, il faut noter ce commentaire de Lucien Steinberg : accessibles à l’argent, bien des gestapistes ont pu saisir ce prétexte, qui ajoutait une couverture respectable à des motivations qui l’étaient beaucoup moins.
Il est temps, pour nous, d’en revenir à notre tentative d’analyse de l’opinion à travers la presse résistante. Toutefois, au risque de se répéter, une remarque s’impose, impérativement. Les trois quarts des clandestins ignorent complètement le problème, le dernier quart n’en fait que des mentions sporadiques : c’est presque comme s’il n’avait jamais existé, alors que de nos jours, il est devenu central. De plus, ces clandestins eux-mêmes, quel était leur rayonnement ? Nous en avons fait la surprenante expérience personnelle : on peut avoir vécu toute l’occupation dans un chef-lieu de province de 12 000 habitants, échangé les propos les plus ouverts dans un Athénée intégralement patriotique, n’avoir jamais eu sous les yeux le moindre pamphlet résistant… et apprendre une génération plus tard que cette ville avait vu naître une demi-douzaine de titres. Un certain nombre de personnes jouaient un rôle actif, le secret était bien observé, mais il avait ses inconvénients… A Bruxelles, Gand, Liège et Charleroi, en revanche, les « grands » clandestins étaient bien diffusés, mais que savaient-ils, que disaient-ils ?
(p.335) Paul Struye, cet observateur sagace, nous heurte un peu lorsqu’il date du 1er décembre 1942 des observations sans aucun doute pertinentes, mais qui paraissent avoir été écrites quelques mois plus tôt : « Certes, on les tenait (ces mesures anti-juives) pour injustes. Mais dans l’ensemble, on y demeurait assez indifférent. Le Belge moyen n’admet assurément pas qu’on persécute une catégorie de citoyens pour des raisons d’ordre racique ou religieux. Mais il est hors de doute qu’il « n’aime pas les Juifs » et qu’il existe, tout au moins à Bruxelles et plus encore à Anvers, ce qu’on pourrait appeler un antisémitisme modéré. Personne — ou à peu près — ne croit que les Juifs sont à la source de tous les maux dont souffre l’Europe, mais assez nombreux sont ceux qui estiment qu’il s’était créé en Belgique un problème juif et que des mesures étaient — ou seront — nécessaires pour éviter qu’il ne prenne un caractère aigu ». — Plus proches de l’événement puisqu’ils écrivent au jour le jour, Ooms et Delantsheere restent très évasifs et confondent les déportés avec les « autres Belges dont certains reviennent d’Allemagne, tuberculeux ou dans un état lamentable ». A la date du 2 août 1942, leur indignation grandit: on les persécute, «on les contraints à émigrer, on les enfourne comme des esclaves dans des wagons à bestiaux » qui les transportent « vers des destinations inconnues où ils perdront sinon la vie du moins la santé… » Ils sont emportés par groupes « vers la résidence qu’on leur a assignée », vers une «misère morale», particulièrement en ce qui concerne « les jeunes filles »… — Les jeunes filles ! Nous allons les retrouver, ces malheureuses, dans le texte qui suit, et les gorges ne pourront que se serrer devant l’abîme d’incompréhension qui se creusait entre un niveau de civilisation considéré comme acquis, et l’ensauvagement des mœurs nouvelles. La Libre Belgique du 15 septembre 1942 commente la déportation. Après en avoir montré le caractère illégal (elle viole la Constitution, le Droit international et les promesses de l’occupant lui-même), l’auteur en condamne les modalités : « II est difficile à tout homme ayant gardé un tant soit peu le sens de sa dignité humaine de ne pas avoir un haut-le-cœur de dégoût devant ce retour à la barbarie… Comment juger ceux qui entassent, pêle-mêle, jeunes gens et jeunes filles dans des wagons à bestiaux, sans aucun souci de moralité élémentaire ? Quelle appréciation porter sur ceux qui arrachent une mère à ses enfants en bas âge, sans se préoccuper du sort de ces derniers, et cela uniquement parce qu’ils ont les cheveux noirs et le nez crochu ? » Et ces criminels « ont le culot de réclamer des colonies ! » Ils devraient être rééduqués « avant de pouvoir s’entretenir sur un pied d’égalité avec le reste de l’humanité ». Mais pourquoi ces persécutions, se demande le journal ? Encore que partiellement juste, sa réponse ne va pas très loin. Un régime totalitaire se doit de détruire tout mouvement qui reconnaisse, « au-delà de l’Etat, une solidarité internationale quelconque ». Le sort des Juifs guette, par conséquent, les francs-rrTaçons demain, et les chrétiens ensuite. Que de prêtres déjà arrêtés ou molestés ! Les Israélites ne forment que le premier maillon d’une chaîne, et voilà « pourquoi le problème juif doit être aujourd’hui à l’avant-plan de nos préoccupations». (Sans doute mais, remarquons-le, ce (p.336) clandestin n’y reviendra plus. Dans un tourbillon comme celui-là, une préoccupation chasse l’autre…).
Mêmes sursauts de dégoût, mais aussi d’ignorance et d’inadéquation, dans la presse clandestine bourgeoise de Liège. Déjà en avril 1942, Churchill Gazette s’était étonnée. C’est une «race forte», les Allemands devraient donc l’admirer. D’accord, leurs ancêtres sont responsables de la Crucifixion, mais Jésus ne leur a-t-il pas pardonné depuis longtemps ? Cette étoile jaune serait un signe d’opprobre ? Retournons l’argument : saluons, plaignons et aidons ces victimes. — Viennent, en juillet, les déportations. « Respect aux persécutés ! » s’exclame le même auteur (août 1942). Ensuite, il essaie de réfléchir : Ces mesures « touchent coupables et innocents… S’il existe des coupables… qu’on les cite devant les tribunaux belges, qu’on les juge et qu’on les condamne ! Pas de châtiments collectifs ! Saluons-les, parce que nous avons des ennemis communs : l’Allemand et le collaborateur ». — « Ce sont nos frères dans le malheur» (septembre 1942) — une appréciation qui sera confirmée, le mois suivant, par l’ordonnance sur le travail obligatoire en Allemagne. Confirmée, certes, mais du même coup les Juifs sembleront, davantage encore, se diluer dans une persécution générale. — En parallèle, le Coq Victorieux réagit de la même façon. Déjà le titre de son article est significatif : « Les tribulations d’Israël ». La fuite en Egypte, remarque-t-il, débouchait sur la liberté; aujourd’hui, c’est un «départ pour l’esclavage». Les Allemands s’attaquent-ils aux « représentants de cette finance internationale » qu’ils vilipendent ? Mais non : leurs victimes sont des modestes, des artisans, des petits commerçants. On viendra nous dire : ce sont des étrangers. Mais on ne les renvoie pas chez eux ! « On pourrait admettre, jusqu’à un certain point», qu’on expulse des étrangers. Encore faudrait-il que, « tout au moins », on les laisse libres d’emporter leurs biens, ou qu’on leur laisse le temps de les réaliser. En plus, de la part de nos « protecteurs », c’est imprudent, puisque cela provoque des réactions en faveur des persécutés. C’est inhumain et ce n’est pas juste : on sépare des familles et on prive des gens de leur légitime propriété. Un officier allemand aurait dit que ce serait « une mort sans blessure… vers des climats rigoureux de Pologne et d’Ukraine ». Ces crimes inspirent un « profond dégoût ». Hitler n’aurait-il pas eu de mère? (août 1942). — Quant au bon Van de Kerckhove, rédacteur de Chut !, on a vu plus haut qu’en retard de deux guerres, il en était encore aux voleurs de pendules et peu au fait des « progrès » réalisés depuis 1870. Il ne parle des Juifs qu’une seule fois, le 1er septembre 1942. La civilisation est « couverte de honte, écrit-il. Il ne s’agit pas de prendre parti pour l’antisémitisme ou contre le sémitisme, de peser les arguments en faveur ou en défaveur (de ce) peuple », mais de répondre à la question : « Le Juif est-il un homme comme vous et moi ? Oui ou non ? La réponse est, ne peut être que positive… On peut aimer les Juifs ou les détester, c’est affaire de sentiment. Le sentiment n’a pas de prise sur un principe. » Et l’objectif de cette déportation, comment l’imagine-t-il ? Les hommes au travail forcé, les femmes dans des camps ou des mines de sel, les filles pour
(p.337) le plaisir des soldats… — Encore un, parmi d’autres innombrables, qui attendra 1945 pour y voir plus clair…
Les déportations de l’été 1942 ont assurément suscité un intérêt indigné. Il se traduira par une pointe aiguë dans la courbe des mentions à découvrir dans la presse clandestine — ce qui ne veut pas dire, très loin de là et répétons-le, que tout le monde en parle. Il y a ceux qui ne voient rien du tout, et il y a ceux qui se contentent de signaler un fait épisodique : Le Bon Sens du 20 août 1942 relève l’arrestation d’une fillette rue de Flandre, à Bruxelles. Soit, sur la totalité de sa collection, 8 lignes sur 13,000. — Ou encore, comme le faisait déjà Bric à Brac en février 1942, on continue de joindre les Juifs aux autres persécutés. — L’allusion au déicide — pour réfuter l’argument, bien sûr — reparaît en novembre 1942 dans la Légion Noire : ceux qui font de l’antisémitisme à caractère religieux devraient se rappeler que tout ce que les textes liturgiques ont jamais demandé contre les Israélites, c’est « des prières ». — Aussi faiblement informé que les autres, Demany n’en parle qu’en octobre 1942, mais à travers la déportation des travailleurs belges : « On s’y attendait un peu. Les Boches s’étaient fait la main sur les Juifs. Les pogroms dans les quartiers Israélites, c’était la répétition générale. Car, quand Hitler fait de l’antisémitisme, c’est signe que quelque chose ne va pas dans le grand Reich. Et c’est pourquoi l’occupant vient de publier ses ordonnances sur le travail obligatoire. » Plus loin, il reproche à une dame juive de s’être suicidée : « Le geste de Mme Hirsch est tragique, mais il est inutile. Ce qui importe en ce moment, c’est de vivre, de vivre pour l’écrasement d’Hitler, le châtiment des traîtres, de vivre pour hâter notre libération » (Résistance, octobre 1942). — Le Patriote, de Forest, retourne l’argument : « Je n’ai rien ni pour ni contre les Juifs, et je ne crois pas me tromper si j’estime que la grosse majorité des Belges se trouvent dans les mêmes dispositions. Je suis le premier à reconnaître que les sémites possèdent quelques échantillons d’individus peu recommandables, mais… Notre pauvre Belgique a vu depuis le 10 mai 1940 le développement remarquable d’une faune immonde de reptiles baveux, plus connus sous les vocables de rexistes et de VNV. Ne devons-nous donc conclure que tous les Belges ne sont que d’affreuses canailles ? » Conclusion: aidons-les (2 novembre 1942). — « Boucs émissaires! » s’écrie Libération (FI). Les Juifs « sont déportés dans des camps de travail, à l’étranger ». Après eux viendra le tour des officiers et des soldats, puis des jeunes classes, puis des organisations catholiques (juillet 1942). — La Meuse, elle aussi, se méfie de ce qu’elle considère comme une manœuvre de diversion : « II faut aider les Juifs. Il faut lutter contre l’occupant. — Le peuple de chez nous sait que les artisans de notre misère ne sont pas les Juifs, mais l’occupant et ses valets. Accordons notre soutien à toutes les victimes de l’oppresseur nazi mais sans distinction de catégories. Ne tombons pas dans le piège tendu » (août 1942). — Bec et Ongles consacre aux déportations vingt lignes sur douze pages, parle avec fureur de la « grande misère des Juifs… expédiés, c’est le mot, vers une destination inconnue… Une fois de plus, l’Allemand prouve qu’il ne respecte rien… Haine et (p.338) vengeance! Telle est, MM. les nazis, la moisson qui vous est promise » (août 1942).
Assez généralement, on fait surtout appel aux lois de l’humanité. « On déporte, on sépare les familles, écrit la Voix des Belges du 15 août 1942, et « tout fait prévoir que les souffrances des déportés seront bien plus grandes encore quand ils seront dans les lieux de travail forcé qui leur sont destinés ». — « On peut penser ce qu’on veut du rôle des Juifs, estime le Coup de Queue (Mons), les considérer comme dangereux pour la sécurité de l’Etat ou parfaitement inoffensifs, mais quel que soit le sentiment que l’on éprouve à leur endroit, il ne peut leur être infligé des traitements barbares, inhumains, qui en fassent des esclaves ou du vil bétail. Ce sont des hommes, faits comme les autres pour aimer, être heureux, vivre librement à la face de Dieu. » Hélas ! la morale nazie n’a que faire de ces évidences. Certains collabos, tel le quotidien Mons-Tournai du 1er août, poussent des cris de cannibales. Et ces Aryens « se prétendent seuls dignes du nom d’hommes. Ah ! les barbares ! » (août 1942). — Constatons que, depuis les communistes et trotskistes jusqu’à la droite bourgeoise, ce n’est qu’un cri de colère et d’indignation (du moins dans les feuilles qui en parlent), et cela dans les termes les plus durs. Toutefois, si le mot « extermination » apparaît dans le Monde du Travail de février 1943, il est souvent associé à des rumeurs fausses ou douteuses, un peu comme si, pressentant la vérité, on cherchait des arguments pour l’établir avec certitude. — Une centaine de femmes et d’enfants auraient été gazés à Dusseldorf, nous apprend Churchill Gazette de janvier 1943. — Et le Monde du Travail assure que 200 cadavres auraient été brûlés au crématorium d’Uccle (février 1943). — Le Coq Victorieux croit savoir que des « milliers de Juifs, sans masques protecteurs…, crèveraient en trois jours dans des mines de sel » (janvier 1943). — Libération (FI) attendra décembre 1943 pour affirmer l’existence d’une « campagne d’extermination des Juifs par les hitlériens, que des centaines de milliers sont tués par fusillades, asphyxie, injections mortelles, etc. », tandis que le même mois, son homonyme brabançon utilise le même mot, mais il le voit sous la forme d’« épuisants travaux forcés, nutrition insuffisante et bastonnades jusqu’à la mort». — En juillet-août 1943, le Coq Victorieux entame — avec quel retard ! — un reportage sur la caserne Dossin, tandis que Churchill Gazette, humour oblige, se livre au petit jeu des définitions : « Juifs. Race responsable de toutes les guerres et de tous les malheurs. Exemple : la Belgique a été envahie par les Juifs le 4 août 1914 et le 10 mai 1940 » (mai 1943).
L’intérêt commençait à fléchir. Pour le ranimer temporairement, il fallut les rafles de Juifs belges, cette fois, en septembre 1943. Le Peuple signale : « Les Allemands ont repris la chasse aux Juifs. De nombreux Juifs belges ont été arrêtés ces dernières semaines (octobre 1943). — Fernand Demany se réveille : « Les persécutions contre les Juifs recommencent. A Bruxelles, les nazis ont arrêté une série de personnalités juives (Résistance du même mois). Les persécutions « recommençaient » ? Elles avaient donc cessé, une fois franchie la frontière belgo-allemande ? — Et à cette occasion, (p.339) la Légion Noire publie des commentaires comme toujours assez fortement « déphasés » : elle parle de mauvais traitements, de gardiens lâches qui, en plus, font signer à leurs victimes des attestations comme quoi elles n’ont subi aucun sévice et qu’elles se tairont sur les circonstances de leur internement (octobre 1943). — A rapprocher d’un article de L’Alouette, qui évoque l’« inconfort » et la « saleté » de la caserne Dossin, la discipline « prussienne » qui y règne (le mot est significatif !), la nourriture « insuffisante », les gardes-chiourmes qui volent les aliments apportés de l’extérieur (1er août 1943). On a parfois l’impression que cette presse patriote « imagine » des situations, mais qu’elle les imagine selon ses catégories à elle, qui sont loin de correspondre à celles de l’ennemi — d’où, nécessairement, une inadaptation. Sans être tout à fait adéquat, le Monde du Travail se rapproche davantage de la réalité lorsqu’il parle, « sans doute… de camps d’atrocité, antichambres pour d’épouvantables agonies… » (décembre 1943).
Chose étonnante, Front (FI) reprendra encore en mars 1944 une analyse pas bien différente de celle qu’on pouvait faire quatre ans plus tôt : la distinction entre assimilés de longue date, «Belges comme les autres», et les immigrés, « persécutés partout et depuis l’invasion aussi chez nous. Ils rêvent d’un foyer national en Palestine ou ailleurs et, en attendant, ils se cachent et combattent. » — De fait, en cette période ultime qui était devenue celle des rafles, des traques et des contrôles, trois sortes de Juifs subsistaient dans notre pays : les rescapés de l’AJB, tolérés parce qu’ils pourraient éventuellement servir, des dénonciateurs à la solde de la Gestapo et, Dieu merci, un nombre malgré tout appréciable de clandestins. Après octobre 1943, le thème redevient rarissime dans la presse patriotique. Le destin d’une toute petite minorité de la population a disparu dans les brumes de l’Est, chacun a d’autres soucis, plus personnels ou plus immédiatement contraignants. Loin des yeux…
Les frénétiques de la collaboration
Mais qu’en pensait-on, pendant ce temps-là, chez les tenants d’une politique de présence puis, dans l’autre bord, celui de la collaboration et du collaborationnisme ? Chose remarquable, une politique de présence, représentée par des quotidiens d’information, neutres et prudents, se maintint jusqu’au bout en pays flamand. L’exemple le plus caractéristique nous est donné par L’Algemeen Nieuws, version camouflée du catholique Sta-daard que l’épiscopat encourageait pour ne pas laisser le champ libre aux séparatistes et aux païens — et qu’après la Libération le même épiscopat réussirait à sauver des poursuites de la justice militaire. Ce journal se contenta, sobrement, de remarquer le 31 mai 1942 qu’un Juif «sera toujours un Juif», qu’il porte une étoile ou non. — Het Vlaamsche Land, assez accessible aux thèmes « officiels », attendra jusqu’en août 1942 pour publier une série d’articles sur « La question juive sous l’angle catholique », (p.340) concluant que la religion ne pourrait que trouver profit (?) à l’exclusion des Israélites. — De bonne foi ou non, ce même organe écrira encore : « Le national-socialisme recherche à tous égards une solution humaine, qui devrait servir de leçon à nous-mêmes et au monde entier » (20 juillet 1944). — Côté francophone Le Soir, si prolixe et hargneux à l’époque de ses débuts, devenait à ce point de vue presque inexistant, de même que la Légia, où l’on ne retrouve plus que l’une ou l’autre petite remarque déplaisante. — Davantage encore que d’autres néerlandophones sous l’influence de DeVlag et sous la plume du frénétique Ward Hermans, Gazet estimera dans un de ses ultimes numéros que Juifs ploutocrates et Juifs bolchévistes étant tous par vocation fauteurs de guerre, que l’Amérique ou la Russie l’emporte, en tout état de cause le malin Juif serait toujours du bon côté (2 juin et 21 août 1944). — Dans l’ensemble toutefois, le thème s’était dilué dans celui, plus vaste, d’une civilisation chrétienne menacée par le capitalisme et le marxisme, paradoxalement unis (Volk en Staat, 16-17 janvier 1944).
Ce qui nous mène au VNV, enfermé dans l’impasse d’un nationalisme flamand qu’il espère (ou que, de plus en plus, il feint d’espérer) réaliser dans le cadre de bonnes relations avec l’occupant. Volk en Staat se tient sur une réserve qu’un rapport de la Propaganda-Abteilung, daté de juin 1943, semble à la fois comprendre et regretter. La collaboration « modérée » était submergée de matériel de propagande, mais rien ne l’obligeait à l’utiliser, et elle l’utilisa peu : pour des raisons peut-être en partie honorables, l’administration militaire considérait sans doute que ce silence pouvait avoir des côtés positifs — c’est-à-dire favorables à la paix intérieure et au camouflage qu’il importait de préserver.
Mais — refrain — il y avait la Militärverwaltung, et d’autre part la SS. Bien que désormais totalement inféodé à celle-ci, le Pays Réel essayait de toucher (sans y arriver le moins du monde) un plus large public, et il maintenait donc, parfois, une certaine couleur d’humanité. En témoigne par exemple (toutes proportions gardées !) son numéro du 9 avril 1943, où il s’indigne en apprenant que certaines commissions d’Assistance publique continuent de verser des secours à des Juifs, même étrangers. Certes, « la misère n’a pas de patrie», et nous-mêmes avons toujours fait preuve de solidarité humaine. Nous avons d’ailleurs été payés de retour, puisque l’Allemagne accueille nos enfants pour des vacances de grand air. Mais : « Les épreuves qui frappent aujourd’hui les Juifs sont méritées parce que ce peuple, par son action néfaste dans le domaine international comme dans la vie interne des peuples, a fait tout pour précipiter l’humanité dans la guerre et dans les misères morales et matérielles. Le Juif a voulu la guerre… et aujourd’hui encore, veille à ce que cette guerre perdure (sic) le plus longtemps possible. Que lui importent les souffrances des hommes, les détresses des foyers… Ce n’est pas le sang juif qui coule… Le Juif profite de la guerre (dans les pays alliés et, chez nous, en faisant du marché noir)… Qu’il y ait des Juifs malheureux, des Juifs éprouvés par la maladie, par la misère, nous voulons le croire, et nous ne serons jamais de ceux qui (p.341) s’opposeront à ce que remède soit apporté à ces cas exceptionnels. » Mais n’ont-ils pas, depuis le texte paru au Moniteur belge du 21 mars 1942 leur propre Association, expressément chargée de leur assistance ? Ils mangeraient donc à deux râteliers ? Le Christ l’a dit : on ne jette pas le pain des enfants aux chiens… « A l’heure où notre peuple souffre et où les efforts de tous les Belges sont nécessaires pour le sauver de la misère, on ne jette pas le pain des enfants belges aux chiens, ni aux Juifs ! »
Dans le rapport de la Propagande Abteilung évoqué plus haut 13, Rex, Algemeene SS (devenue Germaansche SS) et DeVlag étaient chaudement félicités. De fait, — encore un certain ésotérisme, que l’on peut opposer aux relatives prudences de la presse quotidienne — c’est dans leurs hebdomadaires ou mensuels réservés à un noyau central de militants que l’antisémitisme se manifeste dans toute sa pureté. National-Socialisme, organe intérieur du mouvement rexiste était-il précisé, publie dans chacun de ses numéros une rubrique « Race » où l’accent est surtout porté sur la nécessaire harmonie qui règne entre un corps et une âme nordiques: le corps reflète l’âme et vice-versa, et voilà expliquée l’antipathie instinctive que nous éprouvons à l’égard des juifs, dont l’aspect extérieur trahit une mentalité qui nous est totalement étrangère. Le Juif est un taré, et les tares biologiques empêchent l’épanouissement des valeurs spirituelles (novembre et mai 1943). — D’ailleurs, « le racisme est par soi-même essentiellement socialiste », puisque le mélange des races affaiblit la souche et empêche l’éclosion des qualités morales (avril 1944). — Et d’appeler à la rescousse une citation de l’incontestable Henri Pirenne : « En dépit de la langue latine qu’ils ont conservée, les Wallons nous apparaissent dès le 5e siècle comme un peuple germanique » (février 1944). — Dans le dernier numéro (15 août 1944), la fureur antisoviétique se traduit par des chiffres attribuant à l’URSS 1,77 % de population juive, mais un cadre de dirigeants où cette infime minorité monopoliserait les postes à concurrence de 76 à 100 %…
Si, dans le parti rexiste, Léon Degrelle semblait plutôt se désintéresser de la question — il se réservait l’image héroïque du guerrier européen —, son bras droit Victor Matthys ne mâchait pas ses mots. Voici, d’après National-Socialisme de janvier 1943, des extraits du discours qu’il avait prononcé au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 25 octobre 1942 : « La révolution se fera, faut-il le dire, contre les Juifs à galette et contre ceux qui n’en ont pas. Lorsque nous agirons ce sera radical. Après huit jours il n’y aura plus de question juive dans le pays, parce qu’il n’y aura plus un Juif. — Cette question doit être envisagée d’une manière réaliste, sans l’ombre d’une sensiblerie ». — Que de souffrances ils nous ont infligées: les banquiers Franck et Barmat, l’« ersatz » de Juif Van Zeeland, Imianitoff qui voulait bolchéviser la médecine belge (note de l’auteur : il s’agit d’un faux
13 Rapport « Das Judentum in Belgien » (juin 1943), conservé à l’Instituut voor Oorlog-sdocumentatie d’Amsterdam et cité par E. De Bens : De Belgische dagbladpers onder duitse censuur, Kapellen 1973, pp. 468-469.
(p.342) médecin, attaché au cabinet de la Santé publique, condamné à la prison en 1939), les professions envahies… C’est bien tard qu’on leur a imposé l’étoile, « ces étoiles qui sont d’ailleurs devenues des étoiles filantes » … Ces deux guerres qu’ils ont voulues… Leur « littérature perverse » … Mais leur plus grand crime est sans doute d’avoir corrompu le socialisme, sain à l’époque de ses fondateurs aryens, ensuite réduit par eux à « un internationalisme sans fondement dans le réel, vidé de sa véritable substance révolutionnaire… » — « Pas de pitié pour eux aujourd’hui malgré leur habileté à la susciter par leur pleurnicheries hypocrites chez les âmes émotives… Les mesures prises à leur égard sont extrêmement libérales. On leur a fait porter l’étoile, on les renvoie là d’où ils sont venus et on les fait travailler : quoi de plus logique et de plus humain ! » II ne reste qu’à les expulser jusqu’au dernier, y compris les officiers d’état-civil qui favorisent des accouplements monstrueux » (allusion à des mariages judéo-aryens de complaisance) : valets des Juifs, ils partiront avec les Juifs. »
On reste pantois devant cette logique paranoïaque, on en cherche les prémisses, et on trouve. Il est vrai que dans les années trente, d’assez nombreuses voix juives s’étaient élevées pour dénoncer les dangers qui menaçaient leur communauté en Allemagne, et il n’est que trop vrai que ces appels rendaient un son belliqueux très mal reçu par une opinion à peine sortie de l’affreuse guerre précédente, où chacun espéra, jusqu’à la dernière minute, voir sauver la paix. Les extraordinaires délires d’un L.F. Céline n’ont pas d’autre explication : cet homme d’extrême-gauche, pacifiste absolu, croyait dur comme fer à l’existence d’un complot juif international : tuer des millions d’Aryens s’il le fallait, mais sauver 150000 Israélites allemands…
Le germanique flamand De SS Mon, lui, porte davantage l’accent sur deux thèmes : la nécessaire pureté de la race, et les dangers d’un métissage juif. Métissage voulu, d’ailleurs, et c’est une des armes que ce peuple a utilisées pour gagner « sa » guerre et nous dénaturer, affaiblir, pervertir et en fin de compte bolchéviser (6 février 1942). — L’iconographie est appelée à la rescousse. On met en regard deux portraits : le leader judéo-bolchevik dont le mufle respire la haine sauvage, l’ambition satanique, la volonté de domination hystériquement exacerbée, tandis que le visage aryen reflète l’esprit d’entreprise bâtisseur, l’intrépidité tranquille, la solidité des racines: une âme loyale et pure (11 avril 1942). — Les œuvres d’art en témoignent : un couple à la Arno Breker exprime « la plus noble grandeur » ; vu par un cubiste judéo-bolchevik, on n’y voit plus que « dégénérescence » et « insulte à la grandeur humaine » (23 mai 1943). — Pouvons-nous livrer à ces germes de mort ce « sang nordique, héritage sacré » ? (8 août 1942). — La France l’a fait, pour son malheur. Grâce à ses origines franques, elle s’était placée à l’avant-garde de la civilisation : la voilà sur le déclin, irréversiblement métissée (13 septembre 1943). — D’ailleurs nous ne sommes pas antisémites, mais antijuifs. Les Arabes sont des sémites purs, donc respectables, ils se sont bien gardés, eux, de se mêler à un ramassis de bâtards dont la seule mission consiste à pourrir les autres (3 (p.343) avril 1943). — Une photo représente la cathédrale de Cologne bombardée : un « attentat juif » (18 septembre 1943). — Le dernier numéro, celui du 2 septembre 1944, publie un article sur la «Joyeuse entrée des Juifs à Paris ». Il traite du cours, favorable aux Américains, imposé par la monnaie d’occupation. Les autres arguments ne valaient pas l’encre d’un commentaire, celui-ci mérite quelques mots, parce que le fait est peu connu ou oublié. Le gouvernement belge installé à Londres était resté pleinement dépositaire de la souveraineté nationale ; il fut traité de Puissance à Puissance par les Anglo-Américains. Bien différente était la position du général De Gaulle, puisqu’il n’était pas encore juridiquement reconnu. Les libérateurs débarquèrent donc dans un pays en principe du moins « occupé », avec 80 milliards de faux francs que la Banque de France eut à racheter par la suite…
Enfin Balming, périodique de DeVlag se voulant culturel, nous montre le beffroi de Bruges tendant les bras à celui de Dantzig et exalte le passé grand-germanique dans des articles qui sont loin d’être tous mauvais. Les mêmes poncifs antisémites sont ressassés d’un bout à l’autre ; l’inévitable Ward Hermans et un certain Emiel Francken s’y partagent la besogne.
Que penser de cet article de Cassandre, dû à la plume d’un fasciste italien, Massimo Rocca ? « Mais on ne martyrise pas les Israélites, on ne les prive pas de leur qualité d’hommes quand on les oblige à s’avouer et quand on les considère — sauf quelques exceptions individuelles — comme étrangers à l’Europe, à son histoire et à son esprit ; quand on leur interdit une influence excessive sur la pensée, hors de proportion avec leur valeur et leur nombre ; quand on empêche leur mainmise sur l’économie et l’éducation du pays, ainsi que toute participation à son gouvernement» (16 janvier 1944). Camouflage plus ou moins volontaire, sincérité relative, qui nous le dira ? Seule certitude : l’homme est sur la défensive. — Comme l’avait été De SS Man du 3 octobre 1942, rapportant que le curé d’un village flamand avait demandé « des prières pour nos frères juifs persécutés » : ce singulier prêtre « regretterait-il que le peuple élu de Dieu soit enfin obligé de travailler ?».
On comprend qu’à partir de 1943, la SS ait tout misé sur Rex, la Germaansche SS et DeVlag : les deux premiers très peu nombreux et le troisième en apparence plus étoffé — mais que penser de ses chiffres énormément gonflés par l’adhésion obligatoire des travailleurs en Allemagne, dont les cotisations étaient retenues d’office sur leurs salaires ? Les précurseurs tel que René Lambrichts et le Dr. Ouwerx — nous parlerons de ce dernier plus loin — avaient été utiles, mais ils avaient fait leur temps. Pour mieux les contrôler, on fit pression sur Lambrichts pour qu’il intègre son groupe dans DeVlag, ce qu’il refusa ; Ouwerx se montra plus docile et se rapprocha de Rex. Mais ceci devient de la très petite histoire…
Pour la grande histoire en revanche, il reste l’exemple hallucinant d’un génocide bureaucratique, tel qu’ont pu le concevoir des cerveaux déshumanisés par un raisonnement idéologique, et l’exécuter des hommes de main dans la discrétion d’un régime totalitaire. Le silence ne fut vraiment (p.344) brisé qu’en 1945. Au cours des années antérieures, ce silence du nazisme est bien compréhensible, mais on ne fréquente pas impunément un tel système — fût-ce pour le combattre. Le totalitarisme pourrit tout ce qui l’entoure, parce qu’il ne joue qu’en application de ses règles à lui. Resterait à expliquer un autre silence : celui du monde libre, de ses autorités politiques et morales, de ses mass média. 11 y a moyen d’ailleurs, et d’une manière très convaincante. Mais ce n’est plus ici notre propos.
Un mot peut-être encore, qui nous fera redescendre dans un terre à terre immédiat et quotidien, d’autant plus significatif sans doute. Il n’est pas tout à fait exact de dire que les ondes londoniennes n’ont jamais mentionné le sujet. Titulaire d’une émission religieuse à la Radiodiffusion nationale belge (sous contrôle du gouvernement Pierlot), le Père Dantinne y consacra son émission du 13 février 1944 — nous disons bien : 1944. En termes que voici résumés. Les Juifs doivent être considérés par nous comme des frères et toutes les raisons de droit naturel, longuement développées, nous imposent ce devoir. Tout de même, il faut bien qu’on se pose la question, pourquoi leur histoire est-elle parsemée de malheurs ? La seule explication qui puisse venir à l’esprit, c’est qu’ils se sont rebellés contre le vrai Dieu. Et de conclure : la solution de leurs problèmes serait donc qu’avec le soutien de notre « charité compatissante », ils en arrivent à entrer dans la foi chrétienne 14. — Est-il monstrueux de supposer qu’en 1944, il devait encore y avoir infiniment plus de Belges pour approuver les analyses du Père Dantinne plutôt que celles de Rex ou DeVlag ?
14 CREHSGM. Fonds Inbel, n° 530.
(p.348) Les périodes troublées ne manquant jamais de faire voler en miettes la mince couche de raison qui recouvre, dans le cerveau humain, un univers d’instincts et de superstitions. Dès qu’on ne comprend pas, on rationalise de travers à la façon des idéologues, ou on se met carrément à délirer : combien de personnes n’y a-t-il pas eu, aussi bien en 1914 qu’en 1940, pour croire dur comme fer à certaines prophéties de Sainte-Odile qui annonçaient la victoire pour une date déterminée? Dès qu’une guerre éclate, les églises deviennent trop petites pour accueillir les fidèles (qu’on veuille bien ne pas mal interpréter cette remarque : disons simplement que ces fidèles-là ne sont pas de la meilleure qualité). Déjà le général Ludendorff, dans les années vingt, voyait le destin du monde réglé par un obscur conclave, réuni Dieu sait où et paradoxalement composé de Juifs, de Jésuites et de francs-maçons. D’autres imaginent, d’une manière caricaturale, une conspiration de capitalistes ou des « deux cents familles». Bouc émissaire, puis victime, le monde juif est aussitôt retourné comme un gant pour incarner toutes les abominations agressives et oppressives qui désolent la planète. D’ennemis de la chrétienté, les maçons deviennent, dans un contexte modifié, d’excellents patriotes puis, une génération plus tard, d’honorables spiritualistes dont il convient de se rapprocher pour combattre un matérialisme envahissant.
(p.355) « Fascisme » ?
Ce phénomène fasciste — et ce mot tant galvaudé — méritent d’être examinés d’un peu plus près : cela nous permettra peut-être de mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvèrent des Belges, responsables (p.356) et conscients à des titres et des degrés divers, entre 1940 et 1944. On le sait, maintenant, qu’un système totalitaire s’était peu à peu établi en Allemagne ; mais que savait-on du mot, que connaissait-on de la chose ? En général, on disait plutôt « dictature », ou « régime autoritaire ». D’autres parlaient de « fascisme », un vocable susceptible des interprétations les plus vagues. A l’extrême-gauche, on y voyait à la limite à peu près l’équivalent de non-communisme, ce qui dispensait de creuser plus à fond, et surtout, détournait le bon peuple de comparaisons gênantes avec le totalitarisme soviétique. Fascistes, Hitler et Franco, Pinochet et les colonels grecs, mais bien entendu, ni Staline ni le général Jaruselski. « Je l’ai constaté depuis longtemps, avait dit Henri Rochefort, ce sont les mots dont je ne connais pas le sens qui rendent le mieux ma pensée. » La pensée d’un pamphlétaire, certes ; mais celle de certains professeurs d’université, et dans des facultés de science politique encore bien ? Or, entre une dictature, un fascisme et un totalitarisme, il y a des convergences et des zones floues qui se chevauchent, mais les lignes de force fondamentales restent distinctes.
Depuis la Rome antique, la dictature, en général militaire, est un expédient dont on imagine qu’il permettra de sortir d’une situation inextricable, voire désespérée. Une telle usurpation n’était pas à la mode dans la partie évoluée de l’Europe des années trente et, ô paradoxe, on pourrait rétrospectivement le regretter. Pur jeu de l’esprit, un général von Schleicher (assassiné en 1934) ou un général von Blomberg (écarté par des méthodes honteuses en 1938) eussent saisi le Reich dans une poigne ferme, gelé la situation politique, profité d’une conjoncture économique en voie d’amélioration et de la perte de vitesse qui déjà, était manifeste au sein des partis extrémistes. Schleicher avait d’ailleurs quelque chose de semblable dans l’esprit : il ne fut pas soutenu par les masses syndicales, et il recula devant la perspective d’un assaut conjugué des milices nazies et communistes. Cessons de rêver pour en venir à une constatation qui nous paraît solide. L’ordre ainsi restauré n’aurait certes rien eu de démocratique ; du moins aurait-il eu cet avantage de n’être appuyé ni sur une doctrine ni sur un parti — donc d’être et de ne se vouloir qu’essentiellement transitoire. Les pires abominations qui allaient suivre nous eussent été épargnées.
Une dictature de « droite » est pleinement autoritaire. Elle se fonde sur un système d’une grande simplicité. Sous les ordres du chef se répartissent, à tous les niveaux hiérarchiques, les doses variables d’obéissance et de responsabilité. Aucun parti unique n’est porteur d’un quelconque message idéologique : on se contente de maintenir, de figer par la contrainte les valeurs établies et les cadres socio-économiques préexistants (donc éventuellement de « gauche » : voir la Pologne actuelle). Dans les rares cas où un tel parti est créé ou toléré, il ne joue qu’un rôle d’encadrement et de mobilisation de la masse populaire. En bref — et ceci est fondamental —, bien que confisquée au profit d’un seul homme, la souveraineté de l’Etat reste intacte ; mieux, elle est accrue. Par la force des choses, le régime
(p.357) devient policier. Tel fut entre beaucoup d’autres le franquisme, exemple d’autant plus significatif que l’Espagne possédait un mouvement fasciste — peut-être le plus exemplaire de tous — mais cette Phalange, justement, fut démantelée et réduite par le dictateur à une fonction symbolique dès 1937. Franco fut un Salazar encore plus musclé, chacun est libre de lui attribuer les qualificatifs les plus malsonnants, sauf celui de fasciste. Plusieurs causes peuvent expliquer que son régime ait duré si longtemps ; la principale pourrait se trouver dans les structures encore archaïques du pays. Il y remédia du reste, et à moyen terme creusa sa propre tombe en développant une classe moyenne qui, en 1936, n’existait qu’à l’état embryonnaire.
Avec le fascisme en général, nous entrons dans un domaine d’autant plus complexe qu’il emmagasine à des doses variées les éléments doctrinaux et les phantasmes les plus disparates. Même s’il incorpora certains thèmes remontant à la plus haute Antiquité, et qui devaient lentement refaire surface après son décès officiel, la réunion de ces composantes offre quelque chose de tellement unique et original qu’on est bien obligé de le considérer comme un phénomène particulier, inscrit entre deux dates précises (la fin de chacune des guerres mondiales) et dont toute la difficulté consiste à lui donner une définition. Contrairement à la dictature banale que nous venons d’évoquer, ce fut en tout cas une manifestation se voulant révolutionnaire, et le produit d’une société industrialisée. Une conséquence, au premier chef, de l’épouvantable traumatisme politique, économique, social et psychologique causé par la Grande Guerre. On ne passe pas quatre années de souffrances et de sacrifices dans les tranchées sans en sortir d’autant plus marqué qu’une fois la paix revenue, la vanité, l’inutilité de ces combats se révèlent avec évidence. Les problèmes n’ont pas été résolus, ils se sont aggravés. L’« ennemi » intérieur a donc remplacé l’« ennemi » extérieur ; il faudra continuer la lutte dans un même esprit nationaliste, par les mêmes méthodes militaires, dans un même coude à coude fraternel et viril. Tous les leaders fascistes ont été des anciens combattants — même Degrelle qui, trop jeune en 1914, fit l’évolution inverse et termina sa carrière sous l’uniforme du soldat. Autre choc : le coup d’Etat léninien et la révolution bolcheviste commencée en 1917. Cette révolution s’accompagna d’un long et cruel bain de sang qui s’échelonna sur des années (avant de resurgir de plus belle, en 1930), et qui engendra l’image bien connue de l’« homme au couteau entre les dents» : ce fut l’origine d’une réaction de peur chez les uns, de loin les plus nombreux, et d’un fallacieux espoir au sein de la classe ouvrière. L’idéal d’un socialisme à visage humain subsista bien dans le Labour et dans les partis belge, français et allemand, mais n’oublions pas que si maintenant, le socialisme sous des formes variées (et souvent inconciliables) a conquis l’Europe et une grande partie de la planète, il n’y eut jamais, entre 1917 et 1945, qu’un seul modèle de socialisme appliqué : le stalinisme. On conviendra généralement que s’il put aveugler une partie de l’opinion, il revêtit aux yeux de tous les autres un aspect fort peu séduisant. Pour s’en préserver, — autre racine importante du fascisme — une démocratie parlementaire en crise, dépassée (p.358) par des problèmes économiques, monétaires et techniques nouveaux, apparut à beaucoup comme de moins en moins fiable et crédible. Non seulement elle ne maîtrisait guère le chaos engendré par le terrible conflit, mais bien des gens commencèrent à se dire que les libéraux tolérant les socialistes et les socialistes tolérant le communisme, tout le système risquait de glisser vers Staline comme le plus mince ruisseau finit par aboutir à l’océan. Ne serait-on pas obligé, pour le vaincre, d’adopter les nouvelles méthodes de combat qu’il avait lui-même inaugurées (violence, pragmatisme cynique, encadrement de la nation par un parti unique, etc.) ? La guerre n’avait pas tué que des hommes, par millions ; elle avait brutalement ruiné les valeurs bourgeoises de scientisme, de rationalisme, d’individualisme et de foi dans un progrès sans limites qui avaient eu cours jusqu’en 1914. Quelle valeur pouvait avoir un arbre qui avait porté de si tristes fruits ? L’irrationnel resurgissait. Ce désarroi général fut quelque peu masqué par l’ivresse de la victoire dans des pays de tradition démocratique plus ancienne. Il toucha davantage l’Italie victorieuse mais frustrée, et surtout l’Allemagne, où la défaite fut considérée comme injuste et inexplicable autrement que par la trahison. Toutefois, ces angoisses et ces rancœurs se seraient résorbées si une autre conséquence de la guerre n’était venue jouer avec une force déterminante : la déséquilibration du corps social au détriment de couches qui, en plus, avaient été davantage saignées par le conflit : la petite et moyenne bourgeoisie. L’immense gaspillage d’or se paya, rétrospectivement, par une inflation qui fit tomber le franc au septième de sa valeur, et le mark à zéro. Incompréhensifs et indignés, ceux qui ne possédaient que du papier ou des revenus bloqués en monnaie fondante furent profondément touchés. Leur colère se porta sur le « Boche » qui refusait de payer — ou ailleurs sur les anciens Alliés qui non seulement avaient vaincu par tricherie, mais abusaient maintenant de leur force pour dévaliser la grande blessée, et aller extraire de ses poches les dernières pièces d’or qui pouvaient encore s’y trouver. « Deutschland erwache ! » Un révolutionnarisme confus se développa dans une classe moyenne d’autant plus angoissée qu’elle voyait, à sa droite, un grand capital qui se débrouillait plutôt bien, et à sa gauche une classe ouvrière psychologiquement et matériellement moins touchée parce que défendue, elle, par ses organisations syndicales.
1925 apporta un apaisement passager ; les blessures subsistèrent, mais le redressement économique les camoufla, en partie au profit de bénéficiaires nouveaux. Le répit fut de courte durée. Pendant un bref laps de temps, l’Europe se crut revenue à la « normale », s’imagina avoir retrouvé sa place prépondérante dans le monde, alors qu’en réalité elle vivait au centre d’une chaîne financière dont elle ne possédait plus la maîtrise : les Etats-Unis déversaient leurs milliards sur l’Allemagne laborieuse, qui pouvait ainsi payer les intérêts de ces emprunts et les Réparations dues aux anciens Alliés, lesquels redevenaient en mesure de régler les annuités des dettes contractées en Amérique pendant la guerre. Une chaîne se casse à son maillon le plus faible : c’est ce qui se produisit à Wall Street en octobre 1929.
(p.359) Cette fois, la grande crise eut des effets radicaux. Le monde entier fut frappé, et par ricochet l’Allemagne dépendante au plus haut degré. La classe paysanne y fut agressée par une chute verticale des prix, le chômage y atteignit les six millions (un chômage au contenu très différent de celui que recouvre, aujourd’hui, le même mot), et d’innombrables faillites touchèrent une fois de plus, non point tant les grosses firmes (plus solides ou aidées par l’Etat), mais essentiellement les petites et moyennes entreprises qui, jusque-là, avaient pu modestement dépasser les limites de la rentabilité. Les classes moyennes, commerçantes et artisanales, entrèrent dans un processus de prolétarisation « en cols blancs ». En théorie, on aurait pu les imaginer tendant la main à la classe ouvrière, elle aussi en détresse (c’est ce qu’un Spaak et un De Man, dans la Belgique démocratique, allaient faire avec un certain succès). Outre-Rhin, cela se produisit sous la forme la plus fâcheuse, en coopération avec la partie non politisée et non encadrée de la classe ouvrière : longtemps plus que marginal, le nazisme séduisit à la fois la fierté nationaliste (mépris pour les «criminels de novembre 1918», camouflage d’attachement aux valeurs «respectables») et l’espoir d’une révolution sociale guère définie, mais dont on attendait au moins qu’elle résoudrait la crise et réaliserait un ordre plus juste en coupant l’herbe sous le pied d’un communisme qui faisait horreur.
Staline, du reste, joua dans les années trente un double rôle dont les conséquences catastrophiques ne sauraient être surestimées. D’abord l’allié objectif du nazisme dont sa presse allemande reproduisait les thèmes nationalistes, revanchards et anti-ploutocratiques, il contribua à le porter au pouvoir. Ensuite, il fit sensation en 1935 en opérant un virage à 180 degrés qui renversa tous les mots d’ordre classiques de sa propagande et déconcerta en France, en Belgique et ailleurs bien des esprits qui lui avaient fait jusque-là une confiance religieuse. Non seulement l’U.R.S.S. commençait à se faire ouvertement nationaliste, mais ses antennes extérieures rejetaient le pacifisme si profondément implanté à l’extrême-gauche de l’éventail politique, glorifiaient l’armée et la défense nationale en régime capitaliste, cessaient de considérer les socialistes comme des frères jumeaux du fascisme, tendaient «la main aux curés», ressuscitaient les thèmes du vieux jacobinisme bourgeois et prônaient une alliance qui pourrait s’étendre, contre le fascisme, jusqu’aux milieux les plus réactionnaires. On mesurera difficilement le trouble qui en résulta dans les milieux les plus traditionnels de l’extrême-gauche : si les démocrates idéalistes tinrent bon, nombreux furent les esprits et, surtout, les tempéraments qu’aujourd’hui on appelle gauchistes qui s’en allèrent grossir les rangs de ceux qui, au sein du fascisme, aspiraient sincèrement à une révolution sociale. En France, Jacques Doriot représenta spectaculairement cette tendance mais partout, jusque sous l’occupation nazie, bien des hommes, happés par une évolution logique, se laissèrent engager dans une courbe qui les mena de l’extrême-gauche vers — le serpent qui se mord la queue — ce qu’on a coutume de considérer un peu vite comme une extrême-droite.
(p.360) Dans la vieille Allemagne dont les couches aristocratiques et grand-bourgeoises avaient donné à notre civilisation ses valeurs les plus élevées, mais à un moindre degré dans les pays de plus ancienne démocratie, certaines classes populaires et petites-bourgeoises se laissèrent hypnotiser par ces mouvements. Le besoin le plus élémentaire de l’homme le porte à faire ses trois repas par jour, et moins la démocratie représentative est implantée dans les masses, plus on y trouvera les nombreux desperados prêts à confier leur sort et leur salut aux « terribles simplificateurs » qui désigneront du doigt un ennemi, un responsable d’autant plus abhorré que son action est souterraine, impalpable ou même carrément mythique.
Le fascisme, ou le national-socialisme première manière est donc un mouvement (plutôt qu’un parti, le mot tendait à se déprécier) dont les racines doivent être cherchées, directement ou indirectement, dans tous les maux, les déstabilisations ou les phantasmes engendrés ou réactivés par la Grande Guerre. Sans elle, il est incompréhensible, de même qu’il prépare et explique la seconde catastrophe — en cherchant, car tout cela est complexe, dans certains cas à l’éviter. Cette fonction est claire dans certaines catégories belges et françaises, où il n’est pas du tout évident que le soudain pacifisme de ces milieux, à partir de 1936, soit dû à de quelconques affinités idéologiques. Une certaine aristocratie tendait alors à rejoindre le prolétariat pacifiste: en septembre 1939, Léopold 111 le grand seigneur idéaliste, Robert Poulet le maurrassien et De Man le socialiste envisageaient le phénomène guerre, sous l’angle éthique et esthétique, à peu près de la même façon. L’avenir de l’Europe en général, lui aussi, les angoissait, on ne saurait dire à tort.
Loin d’être une extrême-droite pure, le fascisme prétendait synthétiser, syncrétiser à la fois les valeurs traditionnelles et la justice sociale. La Phalange espagnole, par exemple, avait mis à son programme, sous l’impulsion de José-Antonio Primo de Riveira, parallèlement une tranche de droite (autorité, religion, grandeur et unité de l’Espagne) et un volet de gauche (nationalisation des banques, pouvoirs étendus aux syndicats et, ô merveille, réforme agraire). Sa sincérité était hors de doute, comme celle de bien des nazis, doriotistes et autres, et qu’il n’en soit rien sorti ne doit pas trop nous surprendre : en histoire contemporaine, les déraillements sont plus nombreux que les réussites, les meilleures intentions peuvent tourner au cauchemar, et nous aurons la charité de ne pas aligner les exemples (de « gauche ») qui se pressent sous la plume. En plus, on ne se rendait pas compte que le système passerait par un Etat policier, pour aboutir à peu près inéluctablement au totalitarisme.
En Italie, Mussolini créa des services qui furent aussitôt ressentis par la classe ouvrière comme de grands progrès auxquels le régime bourgeois antérieur n’avait pas songé : Dopolavoro, crèches, consultations de nourrissons, tandis que le corporatisme et les tribunaux du travail furent loin de trancher systématiquement au profit des patrons. Quant à Hitler, il eut le trait de génie, avant tout le monde sauf l’Union soviétique, de décréter le 1er mai fête légale ; son Arbeitsfront, supplantant les syndicats, offrit aux (p.361) travailleurs une gamme d’institutions sociales qui leur donnèrent le sentiment de devenir des membres à part entière de la « Volksgemeinschaft ». Pour la première fois dans l’histoire de l’Allemagne, les maîtresses de maison en vinrent à se lamenter : « Je n’ose plus rien dire à ma bonne, elle irait aussitôt me dénoncer au Parti». Ces faits, du moins au cours des premières années, expliquent l’adhésion résignée ou enthousiaste de la classe ouvrière au régime, en Italie et en Allemagne. Ils sont en général passés sous silence. Un tel paternalisme d’Etat répondait fort peu, cela va de soi, aux normes actuelles. Il n’en fut pas moins efficace, et si la guerre n’avait pas éclaté, rien ne permet de deviner où l’aurait conduit son destin.
La critique marxiste, cette autre terrible simplificatrice, affirme que les fascismes ont été délibérément portés au pouvoir par les puissances économiques et financières qui redoutaient de perdre le poids énorme dont elles jouissaient dans un Etat libéral. Si la chose était exacte, ces forces occultes devraient être rangées parmi toutes les autres dupes que le régime allait bientôt faire. En réalité, il est bien vrai que la grande bourgeoisie (qui votait nationaliste ou libéral, mais certainement pas nazi) a financé Hitler, mais elle a financé davantage pas mal d’autres partis et organismes, du centre gauche à la droite, qui ne sont pas arrivés pour autant au pouvoir. Son seul but était d’acheter la « paix sociale», c’est-à-dire une classe ouvrière docile et un climat politique où l’on pût gagner son argent et travailler à l’aise. Le fascisme n’avait guère d’autre doctrine en matière économique qu’un souci d’efficacité. Par la force des choses, la grande bourgeoisie fut enserrée dans le même carcan que toutes les autres classes. Elle dut passer par le dirigisme et la planification, pour aboutir à une économie de guerre qui lui fit perdre tous ses pouvoirs de décision. Le IIIe Reich peut se prévaloir rétrospectivement d’un seul et unique succès. Alors que la république de Weimar avait laissé intacte une prépondérance bourgeoise si bien symbolisée par le chapeau haut-de-forme et le col raide à coins cassés du Dr. Schacht, les douze années de nazisme entraînèrent délibérément un brassage dont la démocratie parlementaire du chancelier Adenauer allait abondamment profiter. L’Allemagne devenue égalitaire grâce à la croix gammée, voilà qui était plutôt inattendu.
Dans notre souci de clarté, ces généralités sur le fascisme vont nous conduire vers une remarque absolument fondamentale. Ce qui différencie radicalement ce fascisme d’une simple dictature de droite, c’est l’existence préalable et permanente d’un parti unique, agent moteur de tout le système et véritable contre-Etat. Les structures de l’ancien Etat subsistent, mais elles sont systématiquement doublées par les structures du Parti, qui graduellement les absorbent et s’y substituent. La dictature militaire figeait ; le fascisme, qui est mouvement, part pour une conquête qui ne laissera aucune institution en repos. Le Parti et l’Etat ont chacun leur armée, leurs Affaires étrangères, leur Justice, leurs Affaires économiques, leurs organisations sociales et culturelles, leur police et même, dans un cas, leurs religions concurrentes. Et la vocation des unes est, autant que possible, de prendre le contrôle des autres. Ce schéma existe en partie dans l’Italie
(p.362) fasciste ; en Allemagne, il va prendre une allure vertigineuse. Au départ, le régime fait modeste figure : il n’y a rien de changé, si ce n’est qu’enfin, l’« opposition nationale » s’est emparée de la barre pour rendre au pays sa dignité. Les mises au pas successives obéiront toujours, en apparence, à un souci d’efficacité et à la plus rigoureuse des logiques. Le Front du Travail est créé en mai 1933, et l’Eglise «chrétienne-allemande» en septembre. Himmler devient chef de la police en avril 1934 et en juin, la « nuit des longs couteaux» liquide la S.A., armée du Parti, au profit de la Reich-swehr. Surprenante concession : on comprendra bientôt que c’était le prix payé pour obtenir, à la mort d’Hindenburg, la fusion des titres de Führer et Chancelier (le second vocable ne disparaîtra que vers- 1943). A cette tactique léninienne du pas en arrière vont succéder, en 1938, deux grands pas en avant : Hitler « coiffe » l’armée en prenant le portefeuille de la Guerre et en nommant le docile Keitel à la tête de la Wehrmacht ; le serment de fidélité des troupes ne s’adressera plus à l’Etat et à sa législation, mais au Führer et chancelier en personne. Au même moment Ribben-trop (« la Voix de son Maître »), qui avait primitivement dirigé le bureau des Affaires étrangères du Parti, est placé à la tête de l’Auswärtiges Amt. Depuis septembre 1937, les services de Goering se sont emparés de la planification.
On sait que dans les premiers mois du régime, la Cour de Justice de Leipzig lui avait infligé un camouflet en acquittant les communistes accusés d’avoir incendié le Reichstag. On invoqua l’« urgence» pour expliquer la brève apparition d’une justice partisane au lendemain du 30 juin 1934, et puis tout rentra provisoirement dans l’ordre, sauf bien entendu en ce qui concerne les détenus concentrationnaires ; il est vrai que leur cas relevait d’une fiction admirable : loin d’être une punition, c’était une Schutzhaft, une mesure provisoire qui devait les protéger contre la colère de la foule. La justice parallèle n’apparut qu’en avril 1942 lorsque fut constitué le Tribunal du Peuple du redoutable Roland Freisler. Mais déjà s’était précisée la prolifération des services relevant d’Himmler et de son SS-Hauptamt. Il doubla l’Abwehr militaire (pour s’y infiltrer plus tard) en prenant le contrôle de la police (Sipo-Gestapo) et du renseignement (S.D., Siche-rheitsdienst) sous le chapeau du R.S.H.A. (Reichssicherheitshauptamt) de Heydrich, puis Kaltenbrunner. En même temps, le Reichsfùhrer SS se mit à grignoter, et à vider de leur importance de vieilles administrations telles que les Affaires économiques et les Affaires étrangères : création du Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, attribution en 1941 de tout ce qui relevait, à l’étranger, de la « Volkstumspolitik » c’est-à-dire des rapports avec les populations de souche germanique à l’extérieur du Reich. Enfin, jusqu’au 20 juillet 1944, l’appareil militaire d’Etat était resté un monde où « d’être honnête homme on pût avoir la liberté » ; après ce coup manqué, la SS coiffa également l’armée, où les soldats durent désormais saluer leurs supérieurs en levant le bras à l’hitlérienne. Ce pouvoir croissant d’Himmler allait bientôt, en Allemagne et à l’étranger, faire naître des spéculations sur une rivalité potentielle entre Hitler et lui. C’était complètement faux :
(p.363) jusqu’à l’avant-dernière minute du régime, le slogan à usage interne resta justifié : Himmlerpolitik ist Fùhrerpolitik. Le Reichsfùhrer SS lui-même était aux ordres. Pendant ce temps-là, dopés par les succès militaires (patriotisme !) ces Allemands constataient des exactions qu’il était difficile de ne pas voir, mais les considéraient comme des « bavures » auxquelles Hitler, quand il en aurait le loisir, mettrait bon ordre. « Wenn der Führer dass wüsste », disaient-ils, lointain écho du célèbre : « Si le Roy savait… ».
En « hommage » à Mussolini, nous préférerons baptiser fasciste ce stade au cours duquel commencent à s’interpénétrer pouvoir et contre-pouvoir, encore qu’en Italie, la monarchie et l’Eglise aient eu pour effet de freiner cette intégration à mi-chemin. Il est étrange que même dans les milieux scientifiques, où l’on est si féru de typologie et de schémas, on tolère l’usage d’un terme purement passionnel pour désigner trois sortes de systèmes qui ne sont recouverts que par de simples analogies superficielles. Le fascisme doit donc être considéré comme un régime évolutif et transitoire, non seulement transitoire parce qu’il est mort avec la seconde Guerre mondiale, mais parce que son implacable logique interne devait nécessairement le faire aboutir à quelque chose de différent : le totalitarisme.
Le fascisme avait encore une certaine chaleur enthousiaste qui pouvait donner l’apparence d’un patriotisme exacerbé. Désormais, nous entrerons dans l’univers secret et glacé des Eichmann et des Vychinski, idéologues implacables, des assassins bureaucratiques et des doctrinaires désincarnés. On pouvait encore traiter avec une certaine humanité des ennemis de l’Etat (en Italie, on se contenta en général de les exiler ou de les assigner à résidence aux îles Lipari, tandis que le nazisme première manière laissait volontiers partir des Juifs) ; les ennemis de l’idéologie devinrent des non-hommes, cessèrent d’être justiciables d’un traitement normal.
Le racisme nazi contre l’Etat, contre la Nation
Avec une certaine condescendance, les nazis eux-mêmes se défendaient d’être fascistes, et ils décernaient cette étiquette aux juristes qui, n’ayant pas encore tout à fait compris, cherchaient à introduire le « Führerprinzip » dans le fonctionnement de l’Etat. En effet, c’est au seul Parti que devait revenir, maintenant, le pouvoir discrétionnaire de décision. Le Parti donne des ordres, l’Etat en assure l’exécution bureaucratique, ce qui en allemand s’exprime sous la forme d’un bon jeu de mots : aux uns la « Führung », aux autres la « Durchführung ». Pendant la période fasciste, le Parti avait encadré, par mille racines et courroies de transmission, tous les aspects de la vie concrète des hommes, des femmes et des enfants. Et parallèlement, il avait envahi l’Etat, non point pour le renforcer, mais pour le réduire et l’étioler. Le but se dessinait avec clarté : une « Entstaatlichung des ôffentlichen Lebens», une désétatisation de la vie publique.
Suprême forme de mépris, cet Etat, on préfère l’ignorer. Hitler ne prit (p.364) jamais la peine d’abolir officiellement la Constitution de Weimar (nous éviterons bien sûr les frappantes comparaisons avec le totalitarisme soviétique, si bien relevées par Hannah Arendt ; rappelons simplement que Staline, lui, promulgua en 1936 une Constitution des plus rassurantes, mais complètement fictive). Le Reichstag continua d’exister, ses membres gardèrent leurs indemnités et autres avantages, mais on ne les réunit plus qu’une fois par an pour écouter un discours d’Hitler et chanter les hymnes nationaux *. On maintint, certes, l’Auswärtiges Amt, mais ces diplomates traditionnels n’eurent plus à jouer que le rôle — utile — d’une vitrine respectable. Il y a gros à parier que leurs rapports n’étaient pas lus : ceux de 1939 étaient pourtant d’une lucidité parfaite, de même qu’à Moscou l’ambassadeur von der Schulenburg, digne réplique de Caulaincourt en 1812, allait déployer des efforts pathétiques pour éviter la guerre. Dans ce type de régime, les diplomates ont intérêt à se taire, ce qui parfois vaut mieux pour leur sécurité personnelle, ou bien à abonder dans le sens de la vérité officielle.
Les ministres perdirent toute prise sur la réalité. Recevoir un portefeuille devint synonyme de rétrogradation, ou d’insignifiance. Mis à part Schacht qui démissionna, Ribbentrop et Goebbels sont les seuls dont l’histoire conserva le souvenir. En 1941, le vieux lutteur (« alter Kämpfer ») Rosenberg quitta le Bureau des Affaires étrangères du Parti pour assumer un nouveau portefeuille : celui des territoires de l’Est. Ses idées fausses mises à part, sa qualité de Balte lui donnait une certaine compétence et il se mit à élaborer, dans le vide, une réorganisation étatique du monde slave qui, somme toute, eût réservé à ces populations un sort moins affreux. Pur camouflage : pendant ce temps-là, les « Einsatztruppen SS » commençaient à les déporter, ou à les massacrer allègrement. On entre en plein délire avec la reconstitution, en 1940, d’un ministère des Colonies. Sur la base d’un organigramme impressionnant, où ne manquaient ni la politique indigène ni la lutte contre les maladies tropicales, quelques 250 fonctionnaires se mirent à gérer avec une conscience professionnelle toute germanique un empire colonial inexistant. Personne ne se souciait d’eux et c’est au bout de trois ans, à l’époque des grandes défaites, qu’on s’aperçut de leur présence et qu’en un coup de colère compréhensible, on mit fin à leur activité.
Rien n’étant aboli et tout foisonnant, on vit croître la plus extraordinaire prolifération de services dont les attributions et les compétences se dédoublaient et détriplaient, se chevauchaient et, chose plus grave encore, devaient rendre leurs comptes à des hiérarchies concurrentes, voire antagonistes. Un édifice peut avoir une structure, pas un mouvement. A première vue et avec nos conceptions démocratiques, on pourrait croire que le régime voulait caser ses créatures. Une étude plus approfondie montre que si cette préoccupation joua, ce ne fut qu’à titre très, très secondaire. A
- La gouaille berlinoise les désignera comme « das teuerste Männerchor der Welt », la chorale masculine la plus coûteuse du monde.
(p.365) l’atomisation de la masse devait correspondre une atomisation de la bureaucratie. Il fallait empêcher qu’une hiérarchie permanente et juridiquement établie puisse éventuellement, grâce à des prérogatives reconnues, gêner ou menacer le seul pouvoir légitime, celui d’Hitler. Un désordre délibéré y pourvoirait. De judicieuses mutations (ou la création d’organismes supplémentaires !) animaient ou réanimaient un mouvement perpétuel d’où n’émergeaient, seuls pivots, que des rois fainéants gavés ou des inconditionnels SS.
Les rois fainéants gavés ? Ce furent les vieux camarades du parti que l’on mit à la tête de l’administration civile à l’intérieur, puis au Pays-Bas, au Gouvernement général en Pologne, au Commissariat du Reich en Ukraine et dans d’autres pays occupés. Quant aux inconditionnels SS, voilà qui autoriserait des développements considérables ; nous n’en retiendrons que ce qui sera utile à la compréhension de notre sujet. Himmler, nous l’avons vu, avait au départ des attributions de police. Dès novembre 1937, le Führer précisa que la police allait devenir « une sorte de pouvoir exécutif de l’autorité suprême», sa mission secondaire (et, si l’on veut plus normale) consistant à « protéger le peuple contre les forces de destruction et de désintégration ». Le meilleur connaisseur belge du IIIe Reich, le Dr. A. De Jonghe, un historien flamand que nous avons suivi avec gratitude, a dépeint en une minutieuse série d’articles un aspect de cette lutte de la SS contre l’Etat. En Allemagne, cet Etat-façade agonisait. En Belgique, une administration militaire se maintint, et il est maintenant démontré que cette situation résulta pour l’essentiel de la présence, au pays, du roi Léopold. Quand on le déporta en 1944, une administration civile (donc nazie et SS) fut introduite, mais par bonheur elle n’eut guère le temps d’exercer des ravages plus affreux encore.
L’armée, c’est un truisme, est par excellence un organe de l’Etat. En 1914, elle incarna ce qu’il y avait de plus dur dans un Reich dominé par son influence ; par comparaison, elle apparut en 1940 comme le vestige de ce qui avait été le grand souci de l’Allemagne prussienne et wilhelmienne : un Rechtsstaat, un Etat de droit. Certes, les convictions démocratiques ne la caractérisaient que fort peu. Aristocrate, le général von Falkenhausen abhorrait la « racaille » nazie et se sentait au fond plus éloigné de ses propres compatriotes que de Léopold III, de la Reine Elisabeth et des membres de la noblesse belge qui demandaient, et obtenaient des mesures de grâce pour des résistants condamnés à mort *. Il laissait toute l’« intendance » au chef de son administration militaire, Reeder. Jusqu’en juin 1944, cette administration militaire eut le souci d’une bonne gestion et d’une image de marque acceptable en haut lieu. Cela impliquait aussi, dans une certaine mesure, une « modulation » des ordres reçus, des Tätigkeitsberichte (rapports d’activité)
‘ Voici une petite anecdote ; nous ne voudrions pas qu’elle se perde. Le vicomte Jacques Davignon, un homme peu communicatif, nous déclara un jour : « Sous l’occupation, j’ai sauvé une centaine de personnes ». Et nous voyons toujours cet ancien ambassadeur à Berlin, avec sa haute taille et son index levé : « Savez-vous combien d’entre elles sont venues me remercier après? Une».
(p.366) comportant des parties impeccables mais dont d’autres doivent être prises cum grano salis (l’« ennemi » n’était pas qu’en Belgique, il était aussi à Berlin). Sa politique, qui était aussi inspirée par l’auto-défense, prétendait nourrir et préserver une population qui pourrait ainsi mieux travailler sur place — pour l’effort de guerre du Reich bien entendu. Jusqu’à un certain point, et ce ne fut pas le moindre des paradoxes, ses intérêts recouvraient ceux de la population occupée. Une situation analogue à celle de 1914-1918 se reproduisait. Avec sa belle franchise militaire, von Bissing, gouverneur général de l’époque, avait coutume de dire : « Je suis d’avis qu’une vache crevée ne donne plus de lait. » Mais Falkenhausen et Reeder avaient affaire, à Berlin, à un groupe de pression qui, dans son délire, méprisait en fin de compte aussi bien les intérêts allemands que les intérêts belges. Une « Volkstumspolitik », une politique raciale s’amorçait, à laquelle l’administration militaire dut collaborer : elle fait partie intégrante et essentielle du totalitarisme nazi… et elle nous éloigne encore davantage d’un simple fascisme.
Disons pour l’instant qu’inconcevable et incompréhensible pour presque tous les Belges et la plupart des Allemands, mais d’une cohérence parfaite pour qui veut bien en accepter les prémisses, elle faisait de la notion de race la base de toute l’organisation sociale future. Les non-peuples (Juifs, Tsiganes) devaient être exterminés comme des parasites. Ensuite venaient les primitifs, les « Untermenschen » (sous-hommes), c’est-à-dire les Slaves ; une fois leurs élites liquidées, ils feraient de bons valets de ferme et pousseurs de brouettes. Des races latines, on s’en souciait peu ; il n’y avait qu’à les abandonner à leur décadence. La race aryenne ou germanique, elle, était seule dépositaire des qualités les plus éminentes. Mais n’allons pas croire, loin de là, que tous les Allemands fussent dignes d’accéder à l’élite suprême. Des Germains, il y en avait jusqu’en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Flandre puis, en doses qui allaient diminuant, en Wallonie et jusqu’à la Somme. Le grand Reich germanique se constituerait sur cet espace. On le pressent, après le concept d’Etat, c’est celui de Nation qui, dans le rêve hitlérien, commençait à se dissoudre. Bismarck avait construit au siècle dernier un IIe Reich, unifiant de force des populations qui, à part la race, avaient au fond peu de choses en commun. Et il est bien vrai que nos grands voisins se divisent, aujourd’hui encore, en particularismes profonds et variés : les Rhénans diffèrent des autres, les Badois sont presque des Alsaciens, il y a un abîme entre les Souabes et les Bavarois, et tous se réconcilient contre les Prussiens, porteurs néanmoins de traditions qui ne sont pas sans mérites. Au XIXe siècle, la langue allemande écrite s’était imposée par l’école et le service militaire, refoulant à la cuisine et aux champs des patois dont les utilisateurs eussent été incapables de se comprendre d’un « Land » à l’autre. Ce processus, ne pourrait-on pas le continuer à l’époque actuelle, au-delà des frontières « reichsdeutsch » ? Complétant cette entreprise grandiose, Hitler rassemblerait la totalité de la race germanique. Même l’Allemagne, comme jadis les « Länder» , aurait à s’y intégrer, et à se soumettre. Le rêve
(p.366) hitlérien, après tout, n’était pas absurde à 100 % — si ce n’est qu’il arrivait simplement plusieurs siècles trop tard ! Alors, dernière étape de cette évolution fondée sur l’obsession d’une race pure, l’élite SS, produit d’une distillation émanant du monde germanique dans son entier, régnerait sur le tout *. Mais cela, c’était la doctrine secrète, le dernier stade ésotérique de l’initiation SS. On n’en découvrit toute l’ampleur qu’après la guerre, en lisant les propos de table d’Hitler, son deuxième livre posthume, et les conférences faites à huit-clos par Himmler aux hauts dignitaires SS. Nous voilà loin d’un fascisme. Mais de tout cela, la généralité des Belges — et des Allemands — n’avait aucune idée. Ces Allemands, auraient-ils voté pour Hitler en 1932, si ce dernier était venu leur promettre qu’une fois au pouvoir, il entreprendrait l’anéantissement de leur Etat et de leur Nation ?
Pendant quatre années donc, l’administration militaire lutta pied à pied pour rester maîtresse de ses prérogatives et de ses responsabilités. Longtemps, elle parvint à limiter le partage et le chevauchement des compétences qui étaient siennes. Elle dut admettre un délégué du Front du Travail pour les questions ouvrières, la SD-Sipo alors qu’elle avait ses propres services (Feldgendarmerie et Abwehr), la Propagandastaffel qui relevait à la fois de Reeder et de Goebbels, voire l’embryon d’un SS-Amt que toute l’obstination d’Himmler tendrait à coiffer d’un HSSPF.
L’institution de ces Höherer SS und Polizeiführer remonte à 1937 ; ils représentent le signe le plus net de cette dégénérescence délibérée de l’Etat. Dès le départ, ce furent des sous-Himmler chargés, comme lui, de coordonner police, renseignement et organisation SS non point même dans le ressort du « Gau » (anciennement, « Land »), mais dans celui du district militaire (« Wehrkreis ») qui ne coïncidait pas avec les frontières du premier : le système nazi dépasse toutes les bornes de la complication, et on aura déjà compris dans quel but. Après qu’ils eurent sapé le pouvoir administratif à l’intérieur, on les envoya poursuivre la même besogne dans les territoires conquis ou occupés. Les Pays-Bas en furent dotés dès le début ; à Paris, le général von Stulpnagel dut cohabiter avec le redoutable Oberg en 1942. Les instructions qu’ils reçurent leur attribuaient « les pouvoirs de police, les problèmes raciaux et toutes les questions politiques »(!). Chacun comprendra les sentiments de notre administration militaire, la souplesse tenace qu’elle mit à s’en défendre, jusqu’à sa défaite finale en juin 1944.
Le pouvoir totalitaire touchait au point de perfection. La tache d’huile fanatique, raciste et subversive gagnait une Europe conquise, où l’« Eindeutschung » eût été aussi fatale que la francisation des couches supérieures belges aux XVIIIe et XIXe siècles ; (…).
- Le leader flamand Van de Wiele, chef de l’organisation SS DeVlag, fut un des rares à avoir compris. Alors que presque tous les résistants et même, d’une autre façon, la plupart des collaborateurs s’étaient défendus contre une mainmise nationale allemande, cet inconditionnel déclara à son procès : « Vous me reprochez d’avoir prêté serment d’allégeance à Hitler ? Mais c’était tout naturel. Son successeur aurait pu tout aussi bien s’appeler Piet Janssens ! » (Janssens, en Belgique, est à peu près l’équivalent de Dupont en France).
(p.368) La généralité de notre population avait ressenti le choc comme si Guillaume II l’avait agressée une seconde fois. Les militaires allemands firent leur devoir le moins inhumainement possible (certains, dont Falkenhausen, se révoltèrent en juillet 1944 et en subirent les conséquences), les fascistes francophones et les nationalistes flamands se laissèrent duper par une variété de décors en trompe l’œil ; ils n’évitèrent ni les geôles américaines dans le cas des premiers, ni les rigueurs de l’épuration en ce qui concerne les seconds, même ceux dont les yeux s’ouvrirent au bout de deux ans. L’« occupant », ou « les Allemands », n’étaient à coup sûr pas ce que tout le monde s’était figuré.
La maladie avait progressé, chronologiquement et idéologiquement, entre 1920 et 1945. Avec une ruse diaboliquement géniale elle avait, soit usé d’une « langue de bois » des plus séduisantes (dont le Dr. Goebbels était le maître d’œuvre et aussi, hélas ! le précurseur), soit carrément tu certains thèmes inopportuns (peu de chose sur les Juifs dans les discours d’Hitler en 1932 !) pour les faire resurgir, chaque fois au moment voulu. Chaque catégorie sociale à l’intérieur, chaque pays à l’étranger avaient entendu, quand il le fallait, le discours propre à l’anesthésier. L’imaginaire s’en était abondamment nourri, tandis que la réalité se dissimulait derrière une série de décors astucieux. L’ésotérisme de cette sorte d’église initiatique était soigneusement camouflé. Beaucoup d’Allemands s’y trompèrent,. .. et même pas mal de nazis.
Quant aux peuples vaincus et occupés, on a pu voir au cours de cette étude, dans le cas belge, le temps qu’il leur a fallu pour déchirer un voile, puis un autre, et enfin un troisième après 1945. Mais la leçon profonde, a-t-elle vraiment porté ses fruits? A voir certaines critiques qui ont été adressées au récent petit livre de Georges Goriely — si remarquable pourtant —, on viendrait à en douter. L’imaginaire reste toujours présent, dans les tripes et dans les illusions.
Au Yad Vashem pour ne pas oublier, AL 02/05/2008
Nonante élèves des deux écoles rochoises se sont rendus au mémorial Yad Vashem, à Jérusalem. Une semaine de séminaire pour se pencher sur la Shoah.
- Jean-Michel BODELET
Shoah. Cinq lettres qui renvoient à la page la plus noire de notre histoire. Celle du génocide des Juifs par les nazis. Six millions de victimes. Chiffre qui est inconcevable. Six millions d’hommes, de femmes, d’enfants, de vieillards tués au nom d’une idéologie. C’était il y a soixante ans. Les survivants qui sont devenus témoins se font de plus en plus rares. Cependant, il n’est pas permis, il n’est pas autorisé d’oublier. Par simple respect pour les victimes. Mais également pour que cela ne se reproduise plus. Pour ne pas oublier, pour ce devoir de mémoire, il est impératif de sensibiliser les jeunes générations. Pour ce faire, depuis presque dix ans, la commune de La Roche-en-Ardenne s’est investie dans ce sens. Elle organise, avec les classes de cinquièmes humanités de l’athé roya et de l’institut du Sacré-Cœur un voyage éducatif.
Allée des justes
Auschwitz, Mauthausen, Dachau ont ainsi été l’objet d’un voyage. Cette année vers Israël que le groupe s’est envolé. Groupe composé d’une nonantaine de personnes. Destination Jérusalem. Et plus particulièrement le Yad Vashem. Véritable centre de la mémoire de la Shoah. Au programme : un séminaire d’une semaine sur ce thème. Une analyse très profonde allant des racines de l’antisémitisme à la mise en place de l’extermination en passant par la vie dans les ghettos. Outre les conférences, tous ont visité le nouveau musée dédié à la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La découverte de l’allée des Justes parmi les nations où il est rendu hommage aux hommes qui, non Juifs, ont sauvé ces derniers de la mort. Plus que poignant. «Nous apprenons énormément de choses sur cette période que nous ne connaissons que par les livres ou les films» notera un élève.
|
1940s |
Ce que Himmler pensait … de Léopold III, LB 14/02/1996
Jean Vanwelkenhuyzen traite dans un numéro de la “revue Générale” de documents inédits, découverts par le professeur Léon Masset, de l’université d’Amsterdam, où Heinrich Himmler, le maître des basses oeuvres du Reich nazi, donne son avis sur Léopold III. Ces notes furent rédigées pendant la guerre par le docteur Félix karsten, masseur d’ origine estonienne fixé aux Pays-Bas. Kersten soignait Himmler, à Berlin, et en recevait des confidences que, rentré chez lui, il mettait par écrit.” Ainsi lit-on qu’en avril 1943, l’homme le plus puissant d’ Allemagne après Hitler dit du roi des Belges: c’est un ”traître minable à l’égard de la grande mission germanique, ayant combattu son propre sang, et, de ce fait, perdu tout droit à la pitié ou à la considération.” “La théorie nazie est que le Roi des Belges aurait dû se soumettre, avec son armée, au service de l’Allemagne. Des avances lui furent faites dans ce sens; au lieu de quoi “il demeura entêté et capricieux et refusa toutes nos propositions magnanimes.”
|
|
1940 |
Christian Laporte, Les espions belges jouèrent un rôle décisif en 40-45, LB 16/05/2008
Etude d’Emmanuel Debruyne (La guerre secrète des espions belges, 1940-1944, éd. Racine) 21 000 agents recensés ¼ fut incarcéré, 1570 d’entre eux fut incarcéré.
|
|
1940s |
DE STANDAARD / MAANDAG 15 OKTOBER 2007
POSTUUM ANDREE DE JONGH, verzetsstrijdster Dédée redde ruim 700 piloten
BRUSSEL (BELGA, DS) | De legendarische verzetsstrijdster Andrée De Jongh (91) is zaterdag in Brussel overleden. Het konings-huis beloonde haar voor haar gro-te inzet met de titel van gravin. De Jongh was 25 toen ze in de Tweede Wereldoorlog een ont-snappingslijn oprichtte voor Brit-se piloten. Ze deed dat samen met haar vader, schooldirecteur in Schaarbeek, en met een vriend, Arnold Deppé. Die was van opleiding radiotechnicus en had voor de oorlog tien jaar in het Zuid-Franse Bayonne gewoond. De lijn was actief vanaf 1941 tôt het einde van de oorlog. Wegens haar snelheid — men legde de af-stand tôt in Spanje soms in twee of drie dagen af — kreeg ze de naam Komeet. Financiële hulp kwam uit Londen. Omdat De Jongh bang was dat ze niet seri-eus genomen zou worden aïs vrouw, communiceerde ze met Londen onder de codenaam ‘Post-man’. Ze gebruikte ook net pseu-doniem ‘Dédeé’. In tegenstelling tôt ‘René’ uit de komische série ‘Allô Allô’, was zij wel succesvol: haar netwerk repa-trieerde 704 piloten en 64 sluikreizigers. Over de voile vier jaar werkten ongeveer 2.000 mensen mee: Belgen, Fransen en Basken. De Jongh zou zelf een zware toi betalen, want in de winter van 1942-’43 Hep het mis. De overtocht door de Pyreneeën was al een paar keer mislukt door het barslechte weer. Op 15 januari 1943 viel de Gestapo de boerderij binnen waar Dédée samen met een groepje medewerkers en onderduikers op beter weer zat te wachten. Op dat moment hadden al 118 mensen veilig de oversteek gemaakt, onder wie tachtig piloten. En ook nadien zou het netwerk actief blijven. De Jongh verbleef in verscheidene gevangenissen, voor ze op 1 augustus naar Duitsland gedeporteerd werd en in de concentratie-kampen van Ravensbrück en Mauthausen belandde. Maar ze overleefde. Haar vader was op 7 juni 1943 door de Duitse bezetters aangehouden en opgesloten in Fresnes. Hij werd gefusilleerd op 28 maart 1944. Meer dan 800 leden van het netwerk Komeet werden gearresteerd en 216 van hen overleefden de oorlog niet. De Jongh werd meermaals gehul-digd in het buitenland, onder meer in de VS en in Groot-Brittannië. Na de oorlog verhuisde ze naar Congo, en later naar Ethiopie, waar ze in een melaatsenziekenhuis ging werken. Ze was van opleiding verpleegster. (vbr)
|
|
1940s |
Dirk Vanoverbeke, Le grand-père de Laurette Onkelinx accusé de collaboration
Maurice Onkelinx a été privé de ses droits civiques après la Seconde Guerre mondiale. Pour la leader socialiste, la collaboration est « inexcusable ». Maurice Onkelinx, père de Gaston et grand-père de Laurette, fut-il collaborateur pendant la guerre ? C’est la question posée par des journalistes de la VRT qui ont enquêté sur le passé d’un homme qui, comme son fils et sa petite-fille, a lui aussi embrassé une carrière politique. On apprend ainsi qu’il a été privé de ses droits civiques après la Seconde Guerre mondiale. Les faits Maurice Onkelinx fut, entre mai 1943 et août 1944, bourgmestre faisant fonction de la petite commune limbourgeoise de Jeuk, près de Gingelom. En 1941, il avait déjà été nommé échevin par l’occupant allemand. Arrêté à la Libération, il est emprisonné en novembre 1944 pendant quelques mois. En 1945, la Députation permanente du Limbourg le sanctionne pour avoir été membre du VNV – le Vlaams Nationaal Verbond – le parti nationaliste flamand qui collabora politiquement avec l’occupant nazi. Déchu de ses droits civiques et politiques, le grand-père de Laurette Onkelinx est réhabilité dans tous ses droits par le Tribunal en 1950. Laurette Onkelinx : « La collaboration est inexcusable » Voici la réaction de sa petite-fille Laurette Onkelinx (PS) : « Toutes les histoires de famille contiennent toutes leur lot de secrets. Une vie éteinte depuis des dizaines d’années révèle parfois de bonnes ou de mauvaises surprises. Je ne sais pas si ce qu’on raconte sur mon grand-père paternel est vrai ou pas. A-t-il collaboré avec l’occupant pendant la guerre ? En tout cas, mon père le dément avec fougue. Ce que je sais, quelle que soit la vérité, c’est que cela ne change en rien mes convictions et mes valeurs. La collaboration avec l’ennemi est inexcusable et j’ai une admiration sans borne pour celles et ceux qui ont résisté. Et il y en a aussi dans ma famille qui ont eu ce courage. À toutes celles et ceux qui trouvent des excuses à la collaboration pour justifier les choix de leurs ascendants, je leur dis ceci : nous sommes bien sur les héritiers d’une histoire mais nous sommes surtout ce que nous décidons d’être. Nos valeurs, nos combats, sont ceux que nous choisissons. C’est ça aussi la liberté : choisir son camp en toute indépendance. Moi, j’ai choisi le mien : celui de la démocratie, de la tolérance, de l’ouverture aux autres et de la justice sociale. »
|
|
1940s |
Exécution de 27 rexistes, LB 14/12/1999
Le 10 novembre 1947, dans la citadelle de Dinant, sont exécutés 27 membres du mouvement fasciste “Rex”, dont le chef Léon Degrelle, a trouvé asile en Espagne. Ils ont été condamnés à mort et fusillés pour avoir porté les armes contre leur pays pendant la guerre. Le ministre de la Justice, Paul Struye, n’a accordé grâce à aucun des condamnés.
|
|
1940 |
Georgette Eloy, juste parmi les nations, VA 22/10/1998
Ce 21 octobre, une Cinacienne a été honorée par l’Etat d’Israël. Georgette Eloy vient d’être déclarée “juste parmi les nations”, distinction suprême décernée à des non-juifs par l’Etat d’Israël. Travaillant, à Linden, près de Louvain, dans une école privée, elle permit à des enfants juifs arrivés en 1942 d’être hébergés en Condroz dans des familles.
|
|
1940s |
Martine Dubuisson, José Gotovitch, Historien, dir. du Centre d’Etudes et de documentation Guerre et sociétés contemporainies, LS 12/06/1998
Sur le décret visant à indemniser les “victimes de la répression” voté par le parlement flamand: “Il y a eu des collaborateurs wallons tout aussi forcenés que les Flamands, voire plus agressifs puisque dans un milieu hostile; ils étaient cependant isolés dans une population qui les vomissait. En Flandre, on ne peut pas dire qu’ils aient été isolés. Ils ont bénéficié, à tort ou à raison, d’une relative compréhension de la population – sans dire pour autant que toute la Flandre a été collaboratrice.
|
|
1940s |
Omer Marchal, Un jésuite dans la Résistance, le père Josef Hatier 1990, p.126
NOTRE CONGO SE BAT. NOS TROUPES COLONIALES VICTORIEUSES EN ETHIOPIE COMME AU TEMPS DE NYANGWE ET DE KASONGO, DE TABORA ET DE MAHENGE : GAMBELA ET SAJO.
A 1 CONTRE 3. Traversant tout le massif continent africain, bravant le climat tropical, la dysenterie, la soif, des soldats belges ont pris leur première revanche contre les troupes de l’Axe, au printemps de l’année 1941. Il était d’une importance vitale pour la stratégie alliée de s’emparer des hauts plateaux éthiopiens qui alimentent le Nil blanc dont dépend finalement la fertilité et la sécurité de l’Egypte. Face à une armée très supérieure en nombre, les Belges réussirent, à force d’audace et d’endurance, à accomplir cette tâche .spéciale, a écrit George Weller, reporter du Chicago Daily News. On aura une ides de la disproportion des forces lorsqu’on saura que dans tcus les engagements les Belges eurent à lutter au moins à l contre 3. Et alors que l’adversaire était près de ses bases, les Belges furent parfois coupés pendant soixante jours de tout ravitaillement.
PRISE D’ASSOSA. Les Belges durent d’abord franchir plus de 2.000 km. de pays presque inhabité où il fallait porter vivres et munitions à dos d’homme. Parti de Watsa, au nord-est du Congo, le Ier bataillon gagna le Nil blanc, prit vers le nord, inclina à l’est. Des journées très pénibles dans la brousse, puis une ascension non moins pénible le conduisit devant Assosa où un bataillon britannique l’attendait pour passer à l’attaque Pris au dépourvu, les Italiens battirent en retraite vers le sud jusqu’à leur garnison la plus proche, Gidami (prononcez : Guidami), à environ 180 km. Pendant que le bataillon britannique effectuait la poursuite, le l »r bataillon retourna au Nil, le remonta, puis reprit vers l’est, le long du Sobat, afin d’aller feraer le piège tendu aux Italiens.
PRISE DE GAMBELA. Mais le bataillon britannique se trouva bientôt arrêté. Il devint évident que le général Gazzera avait intérêt, étant donné la supériorité de ses forces, à prendre lui-même l’offensive vers le Soudan. I1 fallait donc lui couper la route, c’est-à-dire aller s’emparer de Gambela (prononcez : Gambéla). Le i »r bataillon (700 soldats, 400 porteurs) se porta dans cette direction. En onze jours, sous une température de près de 40°, il abattit ses 1.300 km. Il arriva épuisé. Il passa néanmoins à l’attaque, se heurta aux nids de mitrailleuses qui défendaient résolument les voies d’accès, s’en rendit maître et força les défendeurs à se retirer vers Sajo (prononcez : Saïo), abandonnant leurs morts. Après ce succès, le r’r bataillon resta à Gambela pour se refaire. Les hommes n’en pouvaient plus et la plupart souffraient de dysenterie. Mais la position, sans artillerie, était périlleuse entre le rempart de l’Ethiopie et la phinc du Soudan.
LE FRONT DE BORTAI La radio ne tarda pas à apporter des nouvelles réconfortante^. Un II* bataillon était en route et un III* en formation. Peu après, les Belges se portèrent de nouveau en avant sur la route longue de 60 km. allant à Sajo. La première ligne de défense était constituée par un torrent, le Bortai (prononcez : Bortaï), qui coupe la route à angle droit. Un premier accrochage y eut lieu le 15 avril. Neuf jours plus tard, les Italiens, après une vive préparation d’artillerie, contre-attaquèrent en force. Eprouvés, les Belges durent reculer; cependant, ils parvinrent à se-maintenir sur ce qui devint le front de Bortai. Le mois clé mai fut dur. L’aérodrome de Gambela était trop petit pour que des avions de Ravitaillement y pussent atterrir. Les porteurs tombaient d’inanition entre Gambela et le front (5o km.). Le béribéri s’ajouta a la dysenterie.
INVESTISSEMENT DE SAJO Enfin, dans les prrmiers jours de juin, des renforts arrivèrent. On résolut de couper les 8.000 Italiens de Sajo de leur base de ravitaillement. Pour cette opération, ne furent employés que 250 Belges qui redescendirent vers Gambela et, de là, avec des difficultés inouïes, se hissèrent, par des sentiers de chèvres, jusqu’aux positions adverses. Le 9 juin, la défense s’avérant vigoureuse, les assaillants s’installèrent autour de la place et sî mirent à opérer des raids incessants contre les ravitaillements; ils firent preuve d’une activité considérable pour donner à penser qu’ils étaient en nombre. Entretemps, sous la poussée des Britanniques, des troupes italiennes de plus en plus nombreuses, refluant d’Addis-Ababa et du Djimma, cherchaient refuge à Sajo. Le l°r juillet, les Anglais annoncèrent qu’ils avaient coupé la ligne de retraite. Le général belge, récemment arrivé du Congo, ordonna de prendre Sajo.
PRISE DE SAJO. A l’aube du 3 juillet, le 1cr bataillon s’empara des collines flanquant la route, le IIe se glissa sur la gauche du Ier, le IIP exécuta un long mouvement tournant sur la droite à travers de hautes herbes et en suivant des sentiers soigneusement repérés. La manœuvre réussit. Les Italiens, après avoir abandonné les deux collines, se trouvèrent pris sur leur flanc gauche; ils s’enfoncèrent à droite, vers la plaine, n’osant s’aventurer sur la route balayée par l’artillerie. A 13 h. 40, le bataillon d’encerclement s’apprêtait à donner l’assaut final lorsque deux automobiles, battant pavillon blanc, se présentèrent. La petite armée belge eut fort à faire rien que pour ramasser les 15.000 prisonniers qui se rendirent dans la province de Galla Sidamo. A Sajo même, 9 généraux, 370 officiers, 2.575 soldats italiens et 3.500 soldats indigènes se rendirent aux 3.000 soldats et 2.000 porteurs des troupes coloniales belges.
|
|
1940 |
Paul Struye, Guillaume Jacquemyns, La Belgique sous l’Occupation allemande (1940-1944), éd. Complexe, 2002
(p.44) La plupart des réfugiés revenaient d’ailleurs, les Wallons plus encore que les autres, pleins de rancoeur et d’amertume à l’égard de la France, de son régime, de son armée, de ses autorités civiles et de sa population. La déception profonde et – le terme n’est pas excessif – le dégoût qu’avait inspiré à beaucoup d’entre eux le spectacle de la décomposition française et de la veulerie d’un grand nombre de Français devant l’occupant, contribua par réaction à renforcer en Belgique le sentiment de la cohésion et de l’unité nationale. On sentit confusément que, dans notre pays, on « n’était pas tombé aussi bas ». .
(p.45) Si cependant, le courant « collaborationniste » ne réussit pas à prévaloir, il faut, semble-t-il, attribuer son échec, tout d’abord à l’extrême réserve gardée par le Roi, dont, bientôt, chacun sut qu’il entendait se confiner dans son rôle de prisonnier de guerre et dont l’opinion belge, dans sa majorité, admira la dignité, qui formait un saisissant contraste avec le « retoumement » brutal dont les dirigeants français donnaient à ce moment l’étonnant exemple. Mais l’échec doit être imputé aussi, pour une très large part, à l’ attitude de l’ occupant lui-même.
(p.55) D’autres croient à la nécessité d’un Bloc militaire avec la Hollande, l’Angleterre et la France. Mais, depuis le rapprochement franco-allemand, ces projets ont perdu de leur consistance et il règne beaucoup de désarroi et d’incertitude dans les esprits. Sur ce terrain, on n’arrive pas à se « raccrocher » à une réalité. Ce n’est guère que dans l’hypothèse d’une « paix de compromis » que certains envisagent le retour pur et simple à notre position de « neutralité de fait « .
(p.58) Question linguistique Sur le plan linguistique, il faut noter avant tout que les divergences idéologiques actuelles entre Belges ne se calquent nullement sur la différence de « race » ou de langue. Alors qu’en 1914-1918 c’est à peu près exclusivement en pays flamand que certaines fractions de la population collaboraient avec l’occupant, aujourd’hui, au contraire, les plus notoires des «activistes » nouvelle manière sont des publicistes d’ expression française, tandis que plusieurs des leaders flamands les plus en vue sont à la tête de la politique de « guerre jusqu’au bout » contre l’Allemagne. L’opinion paraît très divisée chez les flamingants même avancés. Certains nationalistes flamands ont ouvertement opté pour la constitution d’un État thiois appuyé sur le Reich. D’autres font profession de loyalisme belge. Il est difficile de doser l’importance de ces différents courants. Mais il paraît certain que, dans l’ensemble, la masse du peuple flamand est, à peu de chose près, aussi hostile à l’occupant que la population wallonne.
(p.70) On établit parfois (à tort ou à raison) un contraste, flatteur pour les Allemands, entre leur attitude vis-à-vis de la population et les excès des troupes françaises et surtout britanniques qui ont souvent laissé de fâcheux souvenirs de leur passage en mai 1940. Il n’est même pas rare d’entendre reconnaître qu’aucune armée au monde n’aurait pu occuper (p.71) notre pays avec autant d’ordre, de discipline et de correction, et avec aussi peu d’incidents que les troupes du Troisième Reich.
Il faut donc chercher ailleurs les raisons de l’évolution de l’opinion. De toute évidence, le sentiment d’hostilité qui anime les Belges n’est pas dirigé contre les Allemands, à titre individuel, mais contre l’Allemagne en tant que régime et « système « . Les journaux paraissant avec l’ agrément du pouvoir occupant attribuent à cette hostilité trois causes dont la troisième se confond, dans une large mesure, avec les précédentes. D’une part, la propagande anglaise, d’autre part, l’action des « politiciens » et enfin, les difficultés de ravitaillement qui seraient, assurent-ils, exploitées habilement tant par cette propagande que par ces politiciens.
(p.84) Seuls, certains milieux, assez fermés de dirigeants pouvaient être qualifiés d’anglophiles, en ce sens qu’ils considéraient que l’Angleterre est le garant naturel de la Belgique contre les ambitions françaises et allemandes, et qu’il y a une communauté permanente d’intérêts entre les deux pays, tout au moins sur le Continent. C’est ce qui explique que depuis Léopold 1er jusqu’à M. Paul Hymans, M. Henri Jaspar, M. Spaak et… M. Joris Van Severen, la politique extérieure de la Belgique, dans le cadre qui fut abandonné seulement de 1918 à 1936 – de la neutralité, fut immuablement axée sur l’ amitié britannique. Aujourd’hui, l’on entend dans certaines fractions de l’opinion l’écho de ressentiments persistants à l’égard de l’Angleterre. Le passage des troupes britanniques en mai 1940, et les destructions qu’elles ont opérées, ont laissé de mauvais souvenirs. Les bombardements aériens de la côte continuent à indisposer une partie de la population locale.
(p.86) LA FRANCE
La désaffection des Belges pour la France est l’un des phénomènes les plus frappants de ces derniers mois. Elle se manifeste partout, dans toutes les couches de la population, et, plus encore qu’ailleurs, dans les milieux wallons les plus traditionnellement « francolâtres ». Le spectacle de la débâcle et de la décomposition françaises en mai-juin 1940 a laissé chez les centaines de milliers d’entre nos concitoyens qui furent témoins ocu1aires de ces faits, l’impression la plus pénible et la plus déprimante. La désillusion fut totale. Les mauvais procédés dont beaucoup de Belges furent victimes en France après la reddition de l’armée belge et, davantage encore, le discours insultant de M. Paul Reynaud au matin du 28 mai, ont provoqué une indignation et une véritable colère que le temps n’a pas réussi à dissiper. On peut affirmer que des millions de Belges ne pardonnent pas à l’homme d’État français d’avoir « sali leur Roi ».
La politique suivie par la France de Vichy depuis l’armistice n’a fait qu’accentuer l’extrême sévérité du jugement que la grande majorité de l’ opinion porte sur nos voisins du Midi. M. Laval et l’amiral Darlan ont hérité une large part de l’impopularité qui s’attachait – et s’attache encore – au nom de M. Paul Reynaud. On leur reproche, souvent avec passion, de jouer un rôle de « Saxons ». On avait admis unanimement la nécessité de la reddition de l’armée française de terre en juin 1940. On était beaucoup moins unanime à approuver la décision (p.87) de ne pas continuer la guerre sur mer et dans les colonies. Mais on trouve peu de Belges qui comprennent une politique de « collaboration » allant jusqu’à donner une aide active au Reich dans sa lutte contre l’Angleterre. La figure du maréchal Pétain était jusqu’ à ces derniers temps demeurée à l’abri des critiques. Bien que beaucoup de Belges eussent été péniblement émus de certains de ses commentaires sur la capitulation de notre armée, l’auréole du « vainqueur de Verdun » restait à peu près intacte et beaucoup lui attribuaient un rôle « à la Hindenburg », avec l’arrière-pensée de revenir à l’ alliance britannique dès que les circonstances le permettraient.
Les récents événements de Syrie ont mis fin à cette illusion et le prestige du vieux soldat s’en est trouvé sensiblement atteint, aux yeux d’un grand nombre de Belges dont les sympathies yont, de plus en plus, au général de Gaulle et au mouvement de la « France libre », et qui n’arrivent pas à comprendre pourquoi les forces armées françaises auxquelles le gouvernement avait fait mettre bas les armes devant les Allemands sont contraints par ce même gouvernement de lutter contre les Anglais. Quant à ceux qui gardent intacte leur vénération pour le maréchal beaucoup d’entre eux considèrent que le fait que la France « nouvelle » n’ait trouvé comme « chef » et comme « drapeau » qu’un vieillard de 83 ans est une preuve de plus de la décadence profonde de la France. Le sentiment dominant du Belge moyen à l’endroit de nos voisins du Midi ne pourrait mieux se comparer qu’à la déception douloureuse qu’on éprouve devant un ami qui nous est très cher et qu’on voit dévoyé’ diminué, ravalé, qu’on sent irrémédiablement perdu – et perdu par sa faute. Quelle que soit l’issue des hostilités, il paraît raisonnable de prévoir que le rayonnement de la France en Belgique et sa « force d’attraction » seront compromis pour longtemps.
(p.90) LA HOLLANDE
L’ opinion est manifestement très sympathique à l’ endroit de la Hollande et des Hollandais. Le fait que leur pays a été envahi en même temps que le nôtre, les horreurs du bombardement de Rotterdam20, la continuation de la guerre par ce qui reste de forces armées néerlandaises, les discours radiodiffusés de la reine de Hollande, que des Flamands écoutent les larmes aux yeux, enfin et surtout, ce qu’ on sait – ou croit savoir – de 1″‘ admirable résistance de la population hollandaise à l’occupant », tout a contribué à donner à la Hollande « la cote d’amour ». On entend couramment répéter que » les Hollandais résistent mieux que nous ». On fait l’ éloge de leur ténacité, de leur dignité dans l’épreuve. On a de plus en plus – dans tout le pays, Wallonie comprise – le sentiment que Belges et Hollandais sont très proches les uns des autres et qu’ il y a intérêt commun à resserrer les liens entre les deux peuples. Il est permis de croire que si, après la guerre, les deux pays recouvrent leur indépendance, il existera un puissant courant en faveur d’une étroite entente belgo-hollandaise.
(p.98) D’une part, on considère comme acquis que l’armée belge s’est, dans l’ensemble, comportée aussi honorablement que n’importe quelle armée qui a eu à faire face à l’envahisseur allemand – et beaucoup plus honorablement que les Français – certains ajoutent : « et que les Hollandais ». On considère comme une injustice qui froisse la susceptibilité nationale les appréciations sévères qu’on a souvent portées, en France, au sujet des prestations de l’armée belge. On éprouve une fierté patriotique à exalter l’ héroïsme de certains régiments. Les Chasseurs ardennais en particulier sont dès à présent entrés dans la légende.
(p.99) Mais on est de plus en plus inquiet de l’appui qu’il donne aux mouvements séparatistes flamands. Le fait qu’il a organisé une milice flamande intégrée dans le cadre du nazisme et qui prête serment de fidélité au Führer apparaît comme de fâcheux augure. D’une façon générale, beaucoup considèrent que « l’Allemagne nous divise, à toutes fins utiles » – se ménageant ainsi, suivant les circonstances, diverses solutions possibles. Dans les provinces wallonnes et spécialement dans les régions frontières, on n’ est pas rassuré sur ses intentions et on redoute des annexions ou des « transplantations ». Enfin, certains craignent que la réconciliation franco-allemande se traduise un jour par un partage de la Belgique.
(p.105) Il est difficile de se rendre compte exactement de l’état d’esprit des anciens dirigeants du mouvement flamand qui ont refusé d’adhérer au VNV Il semble pourtant que beaucoup d’entre eux sont décidés, dès que les circonstances le permettront, à lutter contre les extrémistes avec la dernière énergie. La guerre et l’Occupation ont ravivé ou créé chez eux un sentiment patriotique belge qui leur était parfois étranger.
(p.109) Il n’est pas douteux que depuis la guerre et l’Occupation, la très grosse majorité des Belges sent plus profondément que la Belgique est une réalité, une entité distincte des pays qui l’entourent. Leurs contacts avec les Allemands et avec les Français leur ont donné ou ont affermi en eux la conviction que « nous sommes autres » que les peuples voisins, que nous avons d’autres conceptions, d’autres aspirations, d’autres habitudes de vie, d’autres réactions, d’autres états d’esprit – que nous sommes « nous-mêmes » – peut-être pourrait-on dire que « nous sommes meilleurs et plus sains « . . Cette « découverte » sinon d’ une « âme belge » tout au moins d’un « sens belge « , d’une « mentalité belge « , d’un « climat belge « , a été, sans doute, le fait des Flamands qui n’ont pas trouvé chez les Allemands beaucoup de traits communs – mais davantage encore le fait des Wallons qui se sont sentis tout à coup très différents de la France et très heureux d’en être si différents. Le séparatisme wallingant, qui était une grave menace pour l’unité nationale, paraît déjà appartenir au passé.
Les divisions actuelles entre Belges pro- et antinazis sont cruelles, mais il est important de noter qu’elles n’opposent ni les Flamands aux Wallons – (les plus connus des activistes, nouvelle manière, sont des publicistes wallons ou bruxellois), – ni les jeunes générations aux anciennes, ni une classe sociale à une autre, ni même l’ancienne droite à l’ancienne gauche (le plus notoire des ralliés est un homme de gauche, M. De Man et les milieux catholiques et conservateurs sont, dans l’ ensemble, très hostiles à l’ « Ordre nouveau »). Si l’on sait que les réactions présentes du paysan flamand sont exactement celles du paysan wallon, et qu’on pourrait parcourir le pays d’ Arlon à Ostende, en rencontrant chez la majorité des habitants de chaque ville et de chaque village la même hostilité à l’occupant, la même fidélité au Roi et la même aspiration à un régime traditionnel de liberté, on doit retirer l’impression finale que, dans l’ensemble et en dépit des ombres (p.110) signalées ci-dessus, la cohésion nationale est plus forte qu’avant le 10 mai 1940.
(p.111) 1942. Auguste Borms, figure emblématique du mouvement nationaliste flamand, activiste en 1914-1918, dirigeant du Conseil de Flandre. Condamné à mort après 1914, élu en 1928 à Anvers alors qu’il est en prison (élection invalidée), il est arrêté en mai 1940, puis déporté en France. Il est nommé à la tête de la Commission des réparations instaurée par l’occupant en faveur des activistes condamnés. Il sera condamné une nouvelle fois à mort et exécuté.
(p.195) Au sein des universités de Louvain et de Gand des professeurs se prononcèrent clairement pour la collaboration. La répression et l’ épuration d’après guerre permirent de mesurer leur force qui atteignit, mais ne dépassa pas, 10% du personnel enseignant.
(p.220) M. Degrelle avait proclamé le caractère germanique des Wallons et assigné à la Belgique de demain un rôle de marche occidentale du Reich, rompant avec son statut territorial et son régime monarchique de 1830-1940. Mais l’opinion dominante fut que M. Poulet avait été heureux de trouver un prétexte pour se retirer à temps d’une entreprise dont la vanité et le danger lui étaient apparus à la suite des premiers échecs de l’Axe.
(p.233) Les troupes françaises de Tunisie jouent un jeu contradictoire entre l’obéissance à Vichy et la collaboration avec les Alliés, facilitant la résistance allemande. Ce sera finalement le 7 mai que les Anglais entrent dans Tunis et les Américains dans Bizerte.
(p.234) À plusieurs reprises, des magistrats furent pris comme otages, enfermés à la citadelle de Huy et relâchés après quelques semaines ou quelques mois d’enfermement. En France, on connaît les juridictions spéciales françaises créées pour juger les résistants et qui prononcèrent de nombreuses condamnations à mort.
(p.265) Le Limbourg est un cas de violence paroxystique. De la fin du mois de mai à novembre 1943, 19 collaborateurs dont 12 membres du VNV furent abattus et 14 blessés. En décembre : 14 morts. Le dirigeant du VNV du Limbourg et la direction nationale demandèrent, sans grand succès, à l’autorité allemande des moyens renforcés de défense et la possibilité pour le VNV de participer à la répression par le biais de la Hilfsgendarmerie. La SIPO-SD intervint début 1944 et réalisa une véritable battue, arrêtant 80 partisans limbourgeois dont 24 furent exécutés le 11 avril 1944. Cela n’arrêta pas la vague d’assassinats. L’ occupant donna « enfin » au VNV l’ autorisation de mener des actions de représailles : du 7 au 20 août 1944, diverses actions furent conduites simultanément qui entraînèrent 59 arrestations et 8 morts.
(p.270) C’est une véritable guerre civile qui s’est engagée entre certains éléments des adhérents à l »‘ Ordre nouveau » et certains éléments des mouvements dits » de résistance ». De nombreux collaborateurs de l’occupant ont été abattus chez eux, en rue ou en pleine campagne. Des femmes figurent en assez grand nombre parmi eux. Il s’agit toujours, dit-on, de dénonciatrices qui auraient livré des réfractaires à l’occupant. Un » traître » a été trouvé dans un bois près d’ Houffalize, pendu à l’ aide de crochets de boucher plantés dans la gorge. Il semble acquis que, dans certains cas, c’est uniquement à raison de leur parenté avec des » collaborateurs » que plusieurs personnes ont été tuées.
|
|
1940 |
Reflector, nr 10, 1971, p.203
« Men mag niet uit het oog verliezen dat na de oorlog meer Waalse dan Vlaamse incivieken ter dood werden gebracht (122 tegen 105). » (p.204) « Hoe dan ook, na de repressielawinie scheen de Vlaamse Beweging grondig onthoofd. Het grafmonument van de Vlaamse frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog, de sedertdien heropgebouwde IJzertoren, werd straffeloos gedynamiteerd. »
|
|
1940s |
Rik Coolsaet, De atoombom was ook van ons, Knack, 21/05/1986, p.33-36
Uit archieven en dossiers blijkt dat Belgen een grote rol hebben gespeeld in de produktie van de atoombommen van Hiroshima en Nagasaki. België heeft vanuit Kongo uranium aan de V.S. verkocht.
|
|
1940 |
Robert Close, général e.r., Léopold III au Xxe, LB 27/01/2000
Restitution des faits. Léopold III, en sauvant de l’élimination le corps expéditionnaire britannique de Lord Gort grâce aux combats sur la Lys, a exercé une influence décisive sur l’évolution ultérieure vers la victoire finale. Témoignages.
Le XXe siècle finissant a vu le voile de l’oubli tomber lentement sur celui de son père, le roi Léopold III. Il est grand temps de renverser cette tendance que l’on pourrait croire délibérée et de restituer les faits dans leur perspective historique. C’est dans ce contexte que je voudrais évoquer un épisode crucial de la guerre de 1940, dont on célébrera en l’an 2000 le 60e anniversaire : la bataille de la Lys et son impact capital sur le sort des combats. Je ne crois pas m’avancer outre mesure en affirmant qu’au même titre que le roi Albert Ier a largement contribué à la victoire de la Marne en septembre1914 par sa résistance sur l’Yser, son fils LéopoldIII, en sauvant de l’élimination totale le corps expéditionnaire britannique (BEF) de Lord Gort grâce aux combats acharnés sur la Lys du 24 au 28 mai 1940 a sans aucun doute exercé sur les événements et sur l’évolution ultérieure vers la victoire finale une influence décisive. Je m’appuierai sur deux témoignages irrécusables. Le premier est celui du général Alexandre von Falkenhausen qui s’exprime comme suit dans ses déclarations du 15 août 1945 (1) . «L’armée belge a combattu bravement sous le commandement personnel de S.M. le Roi, son commandant en chef. L’armée britannique ne doit d’avoir réussi à au fait que l’armée s’échapper de Dunkerque qu’au fait que l’armée belge a combattu jusqu’au 28 mai. Sa résistance n’aurait pas été aussi effective et n’aurait pas duré aussi longtemps si S.M. le Roi avait quitté ses troupes prématurément. Seule, sa présence a rendu possible la résistance. »Le deuxième est celui du grand critique militaire anglais sir Basil Liddell Hart (2). Le « Times » du 9 novembre 1960 sous le titre « British Army saved by King Léopold « claim by Captain Lidell Hart » rapporte en effet dans son résumé d’une conférence donnée à l’Université de Londres, que Lidell Hart émit l’opinion que «si le Roi Léopold avait quitté la Belgique le 25 mai 1940, comme l’y poussaient ses ministres et M. Churchill, l’armée belge aurait probablement capitulé immédiatement, au lieu de continuer à combattre jusque tard le 27 mai. Dans ces conditions, les Britanniques n’auraient eu que très peu de chance d’échapper à l’encerclement. Il peut dès lors être dit avec raison qu’ils furent sauvés par le roi Léopold, dont il fut alors abondamment médit en Grande-Bretagne et en France » A-t-on mesuré les conséquences incalculables d’un départ précipité le 25 mai que la plupart des combattants auraient considéré comme une fuite ou même une désertion au coeur de la bataille, laissant le corps expéditionnaire britannique voué à une destruction certaine ? Il n’y avait pratiquement pas de réserves terrestres en Grande-Bretagne. L’ élimination des divisions anglaises aurait entraîné l’impossibilité d’encadrer les troupes qui débarqueront en juin1944 sur les plages de Normandie pour la reconquête de l’Europe et la victoire finale. Dans l’immédiat, comment aurait réagi Churchill alors même que lord Halifax avait, dès le 26 mai, envisagé de traiter avec l’Allemagne et que Reynaud considérait la guerre comme définitivement perdue ?
Ces considérations définitives nous permettent de faire bonne justice des reproches si souvent entendus par des critiques peu ou pas avertis et selon lesquels le Roi, à l’instar de la reine Wilhelmine des Pays-Bas aurait dû, sans coup férir, gagner immédiatement l’Angleterre. Or, comme le démontre lumineusement Sarah Bradford dans sa passionnante biographie de GeorgesVI, c’est contre son gré que la reine Wilhelmine a dû chercher refuge en Angleterre. Voici comment les faits se sont passés. «Le 13 mai, le Roi reçut une communication télêphonique de la reine Wilhelmine, en provenance de Harwich où elle était arrivée à bord d’un destroyer britannique. Wilhelmine demanda avec insistance d’etre rapatriée en Hollande et réclama une aide militaire britannique immédiate. Embarrassé, le Roi lui expliqua que dans les circonstances présentes aucun de ses souhaits n’était réalisable et à 5heures de l’ après-midi il l’accueillit en personne à la gare de Liverpool. » Elle lui dit qu’après son départ de La Haye, elle n’avait pas la moindre intention de quitter la Hollande, mais qu’elle était arrivée en Angleterre par tout un concours de circonstances imprévues. Elle était bouleversée et n’avait pris aucun vêtement avec elle. La reine sexagénaire s’était rendue au Hook of Holland pour trouver un bateau qui puisse la conduire vers le Sud où ses troupes résistaient encore à la pression allemande. Imperturbable en dépit des bombardements allemands, elle embarqua à bord d’un vieux destroyer britannique « HMS Hereward » qui se trouvait à quai et demanda à être conduite à Flessingue. Peu après, l’amirauté ordonna au « Hereward » de regagner l’Angleterre compte tenu du fait que les approches de Flessingue étaient minées. C’est ainsi que la brave Reine se retrouva réfugiée malgré elle à Londres. Lejour suivant, l’armée hollandaise capitulait (3). Il n’était pas inutile de rétablir une vérité historique trop souvent tronquée par le discours ignominieux de Paul Reynaud le 28 mai et par les scandaleuses déclarations de Limoges le31mai1940. Il suffira de se souvenir de l’émouvant appel du Roi, A la veille de la bataille de la Lys : «Soldats, la grande bataille qui nous attendait, a commencé. Elle sera rude. Nous la conduirons de toutes nos forces avec une suprême énergie. Elle se livre sur le terrain où en 1914 nous avons tenu victorieusement tête à l’envahisseur. Soldats, la Belgique attend que vous fassiez honneur à son drapeau. Officiers, soldats, quoiqu’il arrive, mon sort sera le vôtre. Je demande à ,tous de la fermeté, de la discipline, de la confiance. Notre cause est juste et pure. La providence nous aidera. Vive la Belgique !
Léopold. En campagne, le 25 mai 1940 (4)
Nul doute que c’est par sa détermination sans faille et sa vibrante proclamation que le Roi a galvanisé les énergies et permis la résistance désespérée de l’armée belge contre des forces infiniment supérieures, sauvant ainsi les Britanniques de l’ anéantissement. Le roi Léopold III a bien mérité de la Patrie et de l’Histoire… .
Paragraphe 1. page 1. « The capitulation of 28may1940 ». (2) Cité dans la préface de Sir Roger Keyes dans « Témoignage britannique » du général Cecil Aspinall Oglander, page9. (3) Sarah Bradford. Georges Vl. Weidenfeld and Nicholson-London 1989, page315. (4) Cité par Georges H. Dumont. « Léopold lll, roi des Belges » -Charles Dessart-1944.
|
|
1940 |
Triangle rouge – Territoires de la mémoire – expo (sur un panneau)
« Dès 1931-1932, le Verdinaso a les allures d’un parti fasciste avec salut nazi, uniformes et milices paramilitaires. Joris Van Severen, son Président, veut créer un « Empire Thiois », avec le pays flamand, la Wallonie, la Flandre française et les Pays-Bas. Arrêté par la Sûreté belge, il est fusillé par les soldats français en mai 1940. La tendance pronazie des dirigeants et des militants du Verdinaso rejoint alors le VNV. (…) »
|
|
1940 |
Un pilote belge honoré à Norwich, LB 05/10/2006
Norwich donnera à l’une de ses rues le nom d’un aviateur belge, Maurice Herman Marceau Raes, originaire de la région montoise, pilote au sein de la 350e escadrille, décédé aux commandes de son Spitfire de la RAF, le 13 juin 1942.
|
|
1944 |
Michel, Daniel Polet, L’homme qui voulut enlever Degrelle, in : Le Vif 28/02/1985, p.137-140
Gand, 15 juillet 1944. La voiture file en direction du siège de la Gfp (Geheime Feld Polizei). A l’arrière Albert Mélot, arrêté un mois plus tôt pour sabotage, est encadré par deux Ss flamands. Soudain, tout bascule. Des coups de feu claquent. Un des Ss s’écroule. L’autre hurle. L’Armée secrète (As) fait irruption. Albert Mélot est libre. L’ordre était venu de Londres: il fallait tout tenter pour sauver ce témoin privilégié… Namur, octobre 1984. Le baron Albert Mélot, vice-président émérite du tribunal de première instance de Namur, capitaine-commandant de réserve honoraire du régiment paracommando, rompt 30 ans de silence. «Mon premier jour de liberté a été mon premier jour de deuil – explique-t-il. Mon frère avait été tué à Hasselt. Mon père, ma mère et mes trois sœurs étaient otages en Allemagne. Mon père et ma mère y sont restés. Après la victoire, j’ai su ce qu’elle m’avait coûté. J’ai visité les camps. J’ai vu des choses abominables. Je suis resté plus de 25 ans sans rien faire…» Attachant personnage, Albert Mélot! Une courtoisie légendaire, une intelligence subtile, un humoqr très «british» et une modestie à toute épreuve, malgré le caractère exceptionnel de son témoignage, marqué par deux faits généralement peu connus : – Degrelle a bien failli être enlevé en Espagne ; – le roi Léopold accepta en principe de prendre le commandement de l’As. Le premier, à caractère anecdotique, se révèle d’une étonnante actualité, alors que certains souhaitent profiter de la visite du Pape en Belgique pour relancer la question de l’amnistie. Le second jette un éclairage singulier sur l’attitude du «roi fWludit» qui reste au centre de passionsVet de rancœurs que le temps vient à peine atténuer. Et l’on mesure, à travers ce témoignage, à quel point la vérité sur «l’affaire royale» demeure fragmentaire. Les discours abrupts de Léopold III ont déclenché le bruit et la fureur. Albert Mélot, en choisissant de parler des silences du roi, restitue aux choses leur complexité originelle. Entre l’excès d’ombre et l’excès de lumière, l’Histoire finira bien par trancher. Réseau comète – Comment jugez-vous les Belges dans le conflit 40-45 ? – Pour comprendre l’attitude des Belges, il faut se mettre exactement dans notre position en 1940. C’est le tort tout naturel des jeunes de ne pas comprendre que, jusqu’au 28 mai 40, la Belgique était très anti-allemande. Elle avait rompu, en 36, les alliances avec la France et l’Angleterre. Pas par manque de sympathie, mais parce qu’on se méfiait de leurs velléités guerrières. Alors il y a eu le grand rush en dehors de Belgique pour échapper aux Allemands, ces vampires, ces Teutons de la guerre 14. Puis ça s’est terminé à toute vitesse. Et quand on a capitulé (surtout quand la France a eu capitulé), qu’on est revenu en Belgique, on s’est aperçu que les Allemands étaient aimables, qu’ils donnaient du chocolat aux gamins, etc… En d’autres termes, on était tout retourné. Ce n’était plus du tout les Teutons de 14-18. Et puis, ils étaient les alliés des Russes. Les Etats-Unis n’étaient pas en guerre. Il n’y avait plus d’armée française, pratiquement plus d’armée anglaise, plus d’armée belge.
Pour tout le monde, les Allemands étaient vainqueurs. – Comment expliquer votre attitude de résistance ? – Mon attitude, pendant la guerre, a varié comme celle de tous les Belges. J’avais l’avantage d’avoir un père très au courant de tout. Il était directeur de «La Revue Générale» et, contrairement à la plupart, il était resté très optimiste. J’étais dans un contexte favorable. Et puis, il y a eu, très vite après la capitulation, la création de la «Légion belge», qui est devenue l’Abr (Armée belge reconstituée). II y a d’ailleurs eu différents petits mouvements comme ça, qui se sont fondus pour devenir l’ Armée secrète (nom donné en mai 1944). La Légion belge a eu comme membre fondateur, un moine de Maredsous, qui avait été mon professeur et qui était devenu un ami. J’ai très vite été embrigadé par lui. J’avais alors 25 ans. A ce moment-là, on souhaitait négocier avec les Allemands. Il y a eu une première période d’euphorie complète jusque fin septembre 40. C’est ce qui explique que le roi Léopold ait déclaré le 25 mai: «Moi. je ne vous suis pas en France, je reste en Belgique et je partage le sort de mon peuple.» II avait fait ses paquets pour partir comme prisonnier de guerre. Et s’il n’est pas parti en Allemagne, c’est grâce à Pierlot. Car Hitler avait très bien entendu le Premier ministre belge, le Premier ministre français et tous les parlementaires belges faisant chorus à Limoges (sauf un) que le roi Léopold était un traître, qu’il était l’ami d’Hitler, qu’il avait tout combiné pour que les Allemands gagnent la guerre, etc… Et Hitler s’était dit que ce n’était certes pas un tel homme qu’il fallait emmener comme prisonnier » que c »était exactement ce qu’il fallait (…).
|
|
1944 |
MONUMENTS A LA GLOIRE DES BELGES
France Stèle à Brucourt, village de Normandie libéré par des soldats belges en 1944. Le drapeau belge flotte sur chacun des sites du débarquement de 1944 dans la région d’ Arromanches.
|
|
1945 |
in : Marylène Foguenne, Fils d’Ardenne, Souvenirs d’une vie au Pays de Bastogne, 1930-1950, éd. Eole, 2003
Le gouvernement belge s’exilait alors en Angleterre afin de continuer la guerre aux côtés des Alliés et défendre les intérêts des Belges. Pourtant, des phénomènes étranges s’observaient au sein de la population belge. Beaucoup de gens s’appauvrissaient, se ruinaient pour acheter de quoi se nourrir, de quoi vivre. Ils vendaient tout ce qu’ils avaient, jusqu’à leurs beaux vêtements, leurs beaux couverts. Par contre, les trafiquants du marché noir (producteurs et autres fraudeurs) se sont bien enrichis. Ils achetaient des produits disponibles (alimentaires et autres : tabac, café, savon…) et les revendaient quelquefois à des prix exorbitants, jusqu’à dix fois plus élevé que les prix d’avant-guerre. Certains de ces profiteurs ont acheté des maisons, terrains, bois. En investissant, ils blanchissaient leur argent et espéraient que ces transactions n’auraient pas de conséquences à la fin de la guerre. De plus, la Banque Nationale, sous l’ordre de l’occupant, fabriquait de l’argent sans garantie de sa valeur, vu que tout l’or était parti à l’étranger.
Inévitablement, l’inflation est apparue. Ceci signifie qu’il y a trop d’argent en circulation et trop peu de produits à acheter ; il en résulte une hausse des prix. À la Libération, Camille Gutt, ministre des finances de l’époque, décida de lutter contre ce fléau, d’empêcher cette masse monétaire excessive d’avoir des conséquences nuisibles, empêcher les prix du marché noir de devenir des prix réels. Puisqu’il y avait trop d’argent, il fallait en retirer une bonne partie de la circulation. Le plan que Gutt mit sur pied en octobre 44 était composé de trois étapes : 1) les billets qui perdaient leur cours légal, devaient être rentrés et comptabilisés, à l’exception des billets de 50 fb et moins, destinés à assurer un minimum de circulation. La personne qui rentrait ses billets anciens, recevait en échange 2000 fb de nouveaux billets. Les comptes d’épargne ou de dépôt étaient bloqués temporairement, sauf le montant inscrit au 9 mai 1940. 2) un mois plus tard, le ministre devait encore libérer 3000 fb des comptes bloqués de chaque titulaire. 3) puis la somme comptabilisée sur les comptes était divisée en deux tranches, respectivement de 40 % et de 60 %. La première tranche était bloquée de manière temporaire, la deuxième définitivement. Les 40 % seraient libérés à mesure que l’économie du pays reprendrait, quand les marchandises reviendraient normalement sur le marché ; ce qui empêcherait définitivement des hausses de prix. Chacun devait également prouver l’origine de son argent. Les autres 60 % seraient transformés plus tard en titres d’emprunt à 3 %. Beaucoup de gens trouvaient le plan injuste, mais il faut admettre que Gutt devait remettre de l’ordre dans notre système monétaire et il avait trouvé la bonne méthode.
Au point 1, il était dit que les comptes d’épargne étaient bloqués sauf le montant inscrit au 9 mai 1940. Ceci signifiait que le montant inscrit sur les comptes avant la guerre restait propre. Mais si la personne avait d’autres biens (terrains, maisons), elle devait prouver par des actes notariaux ou papiers officiels que l’acquisition datait d’avant-guerre. Si on ne pouvait le prouver, le bien était considéré comme bénéfice de guerre et fortement taxé. C’était injuste, car celui qui n’avait pas ses papiers en ordre était pénalisé. Mon père en a gardé un mauvais souvenir. Avant la guerre, il avait prêté une certaine somme d’argent à un cultivateur qui avait des dettes (il avait prêté comme il disait « du bon argent »). Le cultivateur dont les affaires se sont améliorées, lui a remboursé mais avec de l’argent « du temps de guerre ». Quand la loi est sortie, papa n’a pas pu prouver que ce prêt datait d’avant-guerre. Il n’avait pas fait de papier officiel, car en ce temps-là, donner sa parole était sacré et papa avait fait confiance. Il est allé trouver le cultivateur pour qu’il affirme au fisc que l’argent lui avait été prêté avant la guerre. Ainsi papa n’aurait pas été taxé sur cette somme, la taxe serait revenue au cultivateur. Celui-ci n’a jamais voulu reconnaître les faits, lui fournir le document et papa en a subi les conséquences.
La loi Gutt voulait, en vérifiant l’origine de l’argent, retirer du circuit celui du marché noir. Malgré les mesures prises, certains en ont profité pour mettre sur pied des « magouilles » incroyables. Certains trafiquants avaient réalisé de gros bénéfices pendant la guerre. Quand la loi Gutt est apparue, ceux-ci, au lieu de rentrer leurs billets, ont essayé de ne pas perdre tous ces gains « anormaux », de blanchir leur argent. Ils se rendaient ainsi dans des communautés religieuses (couvents, monastères) ou autres communautés vivant de charité, de donations, dont il était difficile de vérifier tous les comptes. Ils leur faisaient soit-disant don d’une grosse somme, mais recevaient une compensation en nouveaux billets. Plutôt que de tout perdre, ils retrouvaient une partie de leurs gains, mais en « bon argent ». En guise de conclusion, nous pourrions parler du climat de vie où se trouvaient les gens quand les mesures de la loi Gutt sont apparues. À la fin de la guerre, le plan Gutt a apporté des mesures très strictes, d’une grande rigueur. Le nouvel argent (billets et monnaie) est arrivé d’Angleterre et a été mis en circulation du jour au lendemain, en remplacement de l’argent de guerre. Bien sûr, la valeur était identique, mais une partie de l’argent restait bloquée sur les comptes. Imaginons l’état d’esprit dans lequel se trouvaient les gens. Ils devaient rentrer tout leur argent sans garantie de le revoir un jour. Quelle insécurité ont-ils dû ressentir ! Ils ont vécu dans la peur de perdre ce qu’ils avaient s’ils ne pouvaient prouver qu’ils le possédaient déjà avant la guerre. Les 60 % bloqués définitivement représentait une taxation énorme sur l’argent dit « de guerre ».
Les gens ont vécu une période transitoire très difficile, mais c’était le prix à payer pour revenir à une vie économique normale.
|
2 Documents

1939 - Le général Emile Badoux, ce Belge qui sauva la Finlande
(Jo Gérard, in: LB, 1980s)