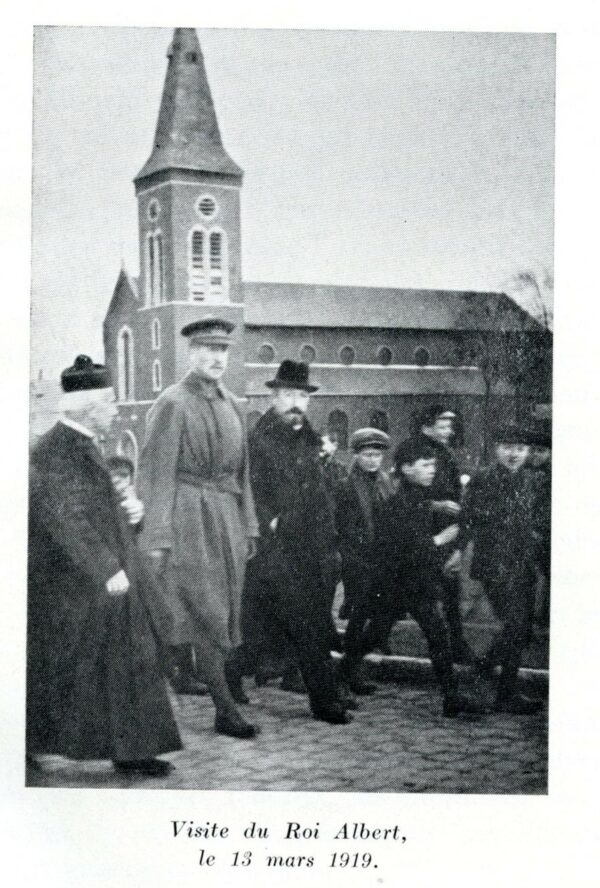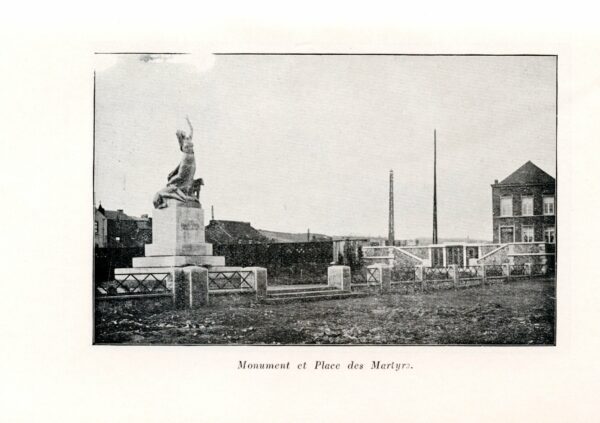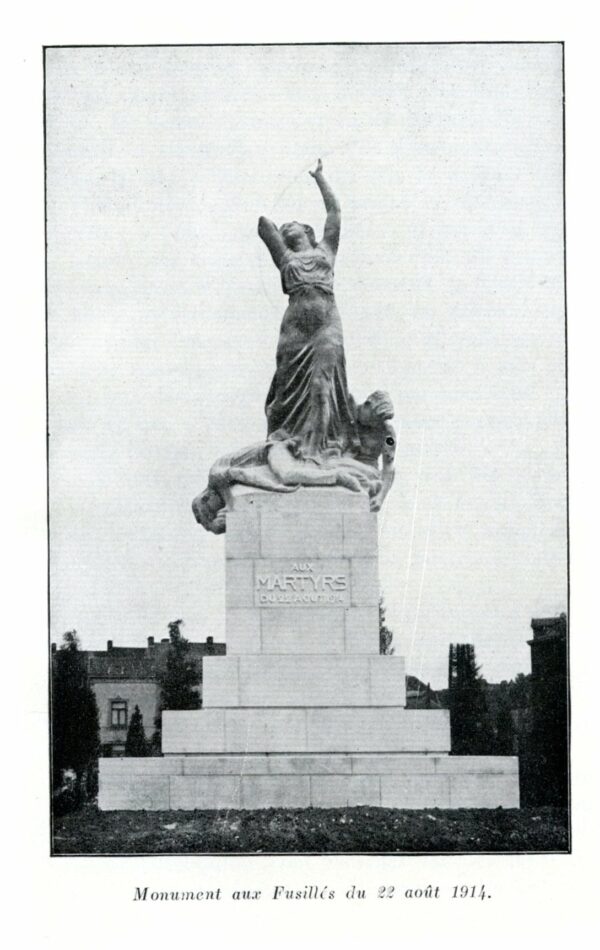La guerre 1914-18 en Belgique: faits méconnus


het Fort van Kessel
(in Belgisch Leger 1914-1918, p.52)
|
|
Centre de docum. histor. des forces armées, Histoire de l’armée belge, T1, éd. Grisard 1982
(p.385) L’Afrique en guerre INTRODUCTION Le conflit qui éclata en Europe en août 1914 allait toucher très rapidement l’ensemble de l’Afrique centrale et opposer les Allemands installés dans l’Est africain allemand (Tanzanie, Ruanda et Burundi), le Sud-Ouest africain allemand (Namibie), le Cameroun et le Togo et les autres Européens : Britanniques, Français, Italiens et Portugais. Si les colonies allemandes de la côte atlantique furent rapidement conquises, les opérations militaires dans l’Est se poursuivirent jusqu’en 1918. La Force publique participa aux opérations qui se déroulèrent au Cameroun et dans l’Est africain allemand. Ce sont ces dernières que nous évoquerons brièvement en distinguant, du point de vue belge, les trois phases essentielles : la phase défensive, Tabora et Mahengé. Mais rappelons d’abord ce qu’était la FP en 1914.
/Le Général major Tombeur en 1917. Musée royal de l’armée. Bruxelles./
LA FORCE PUBLIQUE EN 1914 Les effectifs A la veille du conflit mondial, la FP comptait un effectif budgétaire de 17.833 hommes répartis comme suit : — Etat-major : 50 hommes; — 21 compagnies d’activé aux effectifs très variables (de 225 à 950) : 12.143; — 6 camps d’instruction : 2.400; — 1 compagnie de réserve dans l’Uélé : 225; — 1 corps de réserve à Lisaka : 150; — Troupes du Katanga : 2.875. Les compagnies actives étaient réparties surtout le territoire et placées aux ordres des commissaires de district. La constitution de quatre états-majors de bataillon (un par province) était prévue mais seuls ceux de l’Est existaient.
Armement II restait très sommaire : fusil Albini (Mauser au Katanga), quelques mitrailleuses et quelques canons. Valeur Constituée essentiellement pour jouer un rôle de police, la FP n’était pas en mesure, en 1914, d’entrer en campagne et de mener des opérations militaires, car elle ne disposait ni d’organes de commandement, ni de services logistiques, ni de plans de mobilisation, ni de plans d’opération; de plus, les hommes n’avaient pas été entraînés à des tâches militaires. Face à la menace allemande, il faudrait donc se défendre et préparer un outil militaire capable d’entrer en opérations.
SUR LA DEFENSIVE (1914-1916) La Rhodésie En dépit de la neutralité du Congo, les Allemands entreprirent à partir du 15 août une série de raids sur la rive ouest du lac Tanganika. Pour y faire face, les vice-gouverneurs des deux provinces de l’Est assurèrent la responsabilité de la défense de leur province et firent occuper les postes de la frontière.
(p.396) /Le lieutenant-colonel Olsen en 1917. Musée royal de l’armée. Bruxelles./
Dès septembre 1914, des unités du Katanga pénétrèrent en Rhodésie et y combattirent jusqu’en novembre 1915.
1915 Les premières mesures prises, l’Etat-major de la FP s’employa à transformer celle-ci en armée tout en assurant la protection du territoire contre toute percée; il faudra une bonne année pour y parvenir.
Avril 1916 Placées aux ordres du général Tombeur, les troupes de l’Est étaient articulées de la manière suivante : — un quartier-général; — une brigade nord à deux régiments de trois bataillons, chacun avec deux batteries d’artillerie, une compagnie de pionniers-pontonniers, une compagnie de télégraphistes, aux ordres du colonel Molitor; — une brigade sud à deux régiments de trois bataillons, chacun avec une batterie d’artillerie, une compagnie de pionniers-pontonniers, une unité de télégraphistes, aux ordres du lieutenant-colonel Olsen; — les troupes de défense du Tanganika, la flottille du lac Kivu, quatre bataillons non enrégimentés et des services.
TABORA(1916) Introduction Les opérations dans l’Est africain allemand qui permettront à la FP d’atteindre finalement Tabora ne peuvent être dissociées de celles qui furent menées par les Britanniques, les Portugais et les Rhodésiens. Nous ne rappellerons toutefois que les péripéties essentielles de la campagne belge qui peut se subdiviser en quatre phases : la conquête du Ruanda, celle de l’Urundi et de l’Ussuwi, celle des bases de Kigoma et Mwanza, et la prise de Tabora. Ruanda (avril-mai 1916) Précédée d’une attaque britannique qui démarra en mars, la FP passa à l’offensive le 20 avril et lança sa brigade nord en direction de Kigali et la /Le colonel A. E. M. Molitor en 1918. Musée royal de l’armée. Bruxelles./
(p.387) brigade sud vers Nyanga. Les objectifs furent atteints de la manière suivante : — Kigali le 6 mai par le 3e régiment et le 20 mai par le 4e; — Nyanza le 19 mai par le 1er régiment.
Urundi-Ussuwi En dépit de graves problèmes d’intendance, des difficultés géographiques et des attaques incessantes des troupes allemandes, les troupes du général Tombeur atteignirent leur second objectif : — le sud du lac Victoria le 24 juin, — Kitega le 17 juin, — Usumbura le 6 juin. Le 1er juillet, un violent combat opposa à Kato une partie des troupes du 4e régiment à plusieurs détachements ennemis en provenance du Nord, qui tentaient de rompre l’encerclement.
Kigoma-Mwanza (juillet 1916) Troisième phase de la campagne : l’occupation des bases de départ pour l’attaque finale vers Tabora. Quittant la région de Kitega le 8 juillet, la brigade sud descendit le long de la côte est du lac Tanganika et atteignit le chemin de fer sur une longueur de 120 km, de Kigoma (28 juillet) à Got-torp (31 juillet). La brigade nord fut moins heureuse et progressa peu, en raison du harcèlement allemand et de problèmes de porteurs; bientôt, elle dut s’arrêter et se reposer jusqu’au début d’août. Pendant ce temps, Rhodésiens et Britanniques poursuivirent leur progression.
Tabora (septembre 1916) Au début d’août, les deux brigades entamèrent leur marche convergente, guère coordonnée il est vrai, vers Tabora. Le 10 septembre, la brigade sud entama l’attaque finale; la brigade nord entra dans la danse le 13. Le 19, les autorités civiles remirent la ville aux troupes de la FP : c’était la victoire!
MAHENGE(1917) Introduction La victoire de Tabora avait provoqué le repli des Allemands tandis que Belges, Britanniques, Rhodésiens et Portugais entamaient la poursuite, bientôt stoppée par la saison des pluies. En janvier 1917, le gouvernement belge ordonna la rentrée au Congo de la grande majorité de la FP. Le 25 février 1917, les Belges remettaient Tabora aux Anglais. Les réactions allemandes allaient à nouveau modifier le cours des événements. Pris à la gorge, les Allemands se refusaient en effet à capituler, et ils allaient se battre jusqu’au 12 novembre 1918. On peut scinder cette dernière période de la guerre en trois phases : le raid de Wintgens et Naumann, l’attaque de Mahenge, et les ultimes réactions de von Lettow auxquelles ne sont pas mêlées les troupes belges.
Le raid de Wintgens et Naumann Tandis que les Alliés occupaient les territoires conquis et démobilisaient une partie de leurs effectifs, 500 à 600 hommes, sous le commandement de Wintgens d’abord, de Naumann ensuite, allaient parcourir de février à octobre 1917 l’Est africain allemand y jetant le désarroi, parfois même l’affolement dans les états-majors, les unités et les populations. En dépit de ses succès incontestables, ce raid ne parvint qu’à retarder l’échéance et provoqua chez les Alliés la décision d’en finir une fois pour toute avec les troupes allemandes en Afrique. A bout de souffle, le raid de Naumann se termina par sa reddition le 1er octobre 1917.
Mahenge A partir du mois de mars 1917, une série de réunions entre Alliés aboutirent donc à la décision d’en finir avec les troupes de von Lettow. Les mois suivants se passèrent dans les deux camps en préparatifs fébriles et en réorganisations. Le 25 juillet, à l’issue de la conférence de Dar-es-Salam, les troupes FP furent organisées comme suit : — quartier-général à Dodoma, — brigade sud dans la région de Dodoma-Kilosa, — brigade nord à Iringa, sauf les troupes à la poursuite de Naumann. L’approche de Mahenge se déroula pendant les mois d’août et septembre; l’assaut final démarra le 5 octobre pour se terminer le 9. Les jours suivants, la poursuite fut entamée; elle sera bientôt stoppée par la pluie, le manque de ravitaillement et les réactions allemandes.
La fin de la guerre Les combats de l’année 1918 mirent aux prises les Alliés et les Allemands; les Belges n’y participèrent pas. Ils furent regroupés le long du chemin de fer et se préparèrent à rentrer définitivement au (p.388) Congo. Ils assistèrent ainsi de loin aux dernières opérations de von Lettow qui allait se battre et sillonner toute la région jusqu’au 12 novembre, date à laquelle la nouvelle de l’armistice toucha les belligérants sur le sol africain. Force de police, la FP s’était peu à peu transformée afin de pouvoir mener des opérations militaires dont les deux faits majeurs sont Tabora et Mahenge. A la fin du conflit, les pertes étaient lourdes : 9.077 tués, dont 58 Européens.
(p.391) L’odyssée des autos-canons-mitrailleuses belges en Russie FORMATION Les premières voitures blindées de la guerre 1914-1918 virent le jour en Belgique. En août 1914, on fixa des plaques d’acier sur un châssis Minerva, on arma le véhicule d’une mitrailleuse et on lui donna un équipage de quatre hommes; ainsi naquit la première auto blindée. Les premiers véhicules, destinés à exécuter la reconnaissance éloignée, furent mis en œuvre dans les provinces d’Anvers et du Limbourg pour renseigner le GQG sur le déplacement et la progression des unités allemandes dans ces régions. Au cours d’une de ces missions, le 6 septembre 1914, les deux voitures du lieutenant Henkart tombèrent dans une embuscade à Sammel, près de Westerloo; les occupants succombèrent tous après une farouche résistance. Les blindés continuèrent leurs raids tant que l’armée demeura en mouvement; leur utilité diminua avec la stabilisation sur le front de l’Yser. Néanmoins, le Commandement décida, en novembre 1914, de créer un corps d’autos-canons-mitrailleuses (ACM), qui fut formé à Paris par voie d’appel à des volontaires; on y réunit très rapidement un contingent de 350 hommes. L’unité comportait 22 véhicules (6 autos canons, 4 autos mitrailleuses, 3 autos chefs, 4 autos caissons, 3 camions de ravitaillement, 1 voiture ambulance et 1 voiture de livraison) auxquels s’ajoutaient 8 motos et 90 vélos. Le Major AEM Colson, attaché militaire à Paris, en reçut le commandement. Le 21 avril 1915, le corps dont l’instruction était terminée quitta Paris pour le front belge. Il fut cantonné sur les arrières de l’armée dans un village appelé Les Moëres.
(p.392) MISE A LA DISPOSITION DE LA RUSSIE Sur proposition du capitaine Brejbiano, attaché militaire russe auprès du GQG belge, le corps des blindés belge, avec son personnel et tous « ses accessoires sont mis gracieusement à la disposition de la Russie » (1). Le corps quitta Les Moëres le 17 septembre 1915 et embarqua à Brest le 21 sur le Wray Castle. L’effectif s’élevait à quatre officiers, un médecin, un aumônier et 355 sous-officiers, brigadiers et soldats. A cet effectif s’ajoutaient 2 officiers ingénieurs et 275 sous-officiers, soldats techniciens et ouvriers destinés à servir dans les usines à munitions russes. Le navire arriva le 13 octobre à Potgoritza, l’avant-port d’Arkhangelsk, d’où les ACM furent dirigées sur Peterhof près de Petro-grad (actuellement Leningrad). Le corps blindé fut passé en revue par le tsar à Tsarskoe-Selo le 6 décembre 1915. Le 14 janvier 1916 les ACM furent envoyées derrière le front russe en Galicie, à Zbaraz. L’unité avait à ce moment l’organisation ci-contre. (1) Lettre du ministre de Broqueville au capitaine Brejbiano.
Organisation du 30 octobre 3915 Etat-major Deux batteries, comportant chacune une section de combat à 3 autos mi (dont une auto chef), une section de combat à 3 autos canons, une section de ravitaillement avec voiture ambulance, voiture de liaison et camion Une batterie de ravitaillement avec une section de ravitaillement en munitions, une section atelier, une section vivres, équipement et essence. Une batterie de motocyclistes (side-cars) et cyclistes. Une batterie de transport composée de soldats russes. Une auto blindée belge du Corps des A.C.M., en Russie. L’habillement du personnel, notamment, posa quelques problèmes, la tenue de campagne belge se révéla insuffisante pour affronter les — 20° et — 30° de l’hiver russe; il y fut rapidement remédié par l’adoption de l’uniforme russe avec insignes belges. Le major Colson, à qui l’on devait la mise en condition des ACM, fut rappelé en Belgique le 12 février 1916 et remplacé par le commandant Semet.
PARTICIPATION DES ACM AUX OPÉRATIONS EN RUSSIE Le 19 mai 1916, le corps quitta Zbaraz pour rejoindre le front et fut incorporé au VIe Corps du général Goutor; la lre Batterie fut mise à la disposition de la 16e Division à Zagrobiela, la 2e rejoignit la 4e Division à Igrouitza. Toutes deux participèrent à l’attaque du VIe Corps le 4 juin 1916 dans le cadre de l’offensive Broussiloff. Les autos blindées et les cyclistes continuèrent à se distinguer à maintes reprises dans le courant des mois de juin, juillet et août. Les ACM passèrent ensuite à la 7eArmée en septembre 1916. Réparties par petites fractions dans les unités russes, elles prirent part à de nombreux combats. Les autorités ne tarissaient pas d’éloges pour leur combativité et leur courage au feu. Le corps quitta la 7e Armée en octobre et rejoignit le VIe Corps avec lequel les contacts, nés d’une habitude déjà longue étaient meilleurs. L’usure du matériel, les pluies continuelles et l’hiver russe interrompirent les activités des ACM sur le front de Galicie pendant les derniers mois de l’année 1916. Le corps passa l’hiver à Jezerna, où il (p.393) reçut en renfort un contingent d’une centaine d’hommes. En mars et avril 1917 apparurent au sein de l’armée russe les premières manifestations de solidarité envers le nouveau régime né de la révolution russe. Elles allèrent en s’accentuant et posèrent quelques problèmes aux autorités russes du front. Néanmoins, les opérations militaires ne furent pas abandonnées pour autant. Le corps blindé participa à l’offensive du 2 juillet 1917, où les Belges se distinguèrent à nouveau, mais subirent de lourdes pertes; à Koniouki, deux voitures blindées de la 4e Batterie furent mises hors de combat par de gros obus : sur douze hommes d’équipage, deux furent tués et huit furent blessés. A la fin du mois d’août 1917, le major Semet fut rappelé en Belgique et remit le commandement des autos blindées au capitaine-commandant Roze. La désintégration de l’armée russe se poursuivant à une cadence accélérée, le rôle du corps blindé prit fin dans ces pénibles circonstances. Vers la fin du mois d’octobre, un ordre du Roi prescrivit le rapatriement du corps des blindés belges. Il se rassembla initialement à Kiev, où il arriva, non sans peine, à la fin du mois de décembre. Après des difficultés sans nombre au milieu de l’anarchie bolchevique, le personnel (le matériel avait été détruit) quitta Kiev le 20 février 1918 pour Moscou. L’évacuation par Arkhangelsk étant (p.394) rendue impossible par la présence d’une armée russe blanche, on se résolut à emprunter le transsibérien. Le long voyage s’effectua par à-coups car il fallait obtenir au fur et à mesure de l’avance l’autorisation successive de nombreux soviets locaux : ce fut notamment le cas à Omsk, à Krasnoiarsk et à Tchita. Après avoir surmonté toutes ces difficultés, parfois par l’intimidation, le corps belge atteignit la frontière chinoise, d’où il fut conduit jusqu’à Vladivostok, il s’y embarqua pour San Francisco sur le Sheridan. L’accueil que les Belges reçurent aux Etats-Unis fut triomphant et inoubliable, mais ils ne s’y attardèrent guère; ils débarquèrent à Bordeaux en juillet 1918 après avoir fait un tour du monde. Le drapeau de l’unité fut cravaté aux couleurs de l’ordre de St-Georges; trois citations : Zborov, Koniouki, Vordbiefka furent inscrites sur la soie de l’étendard. Le corps expéditionnaire belge en Russie avait bien mérité de la patrie.
(p.395) La résistance 1914-1918
La résistance se manifesta dès les premiers jours du mois d’août 1914 : — par des vendeurs de journaux prohibés et par les porteurs de lettres qui traversaient les lignes allemandes, — par le recueil des soldats français, anglais et belges demeurés dans le pays occupé ainsi que par la création de lignes d’évasion pour des milliers de jeunes gens qui tentèrent de rejoindre l’Armée belge derrière l’Yser en traversant les fils électri-fiés que l’ennemi avait tendus tout le long de la frontière hollandaise. Incroyable bravoure tant du côté des passagers descendus dans les lignes que du pilote qui les y conduisait. Et aussi par la lutte menée dans l’ombre, une lutte féroce et meurtrière, par ces hommes merveilleux qui sont les agents des services de renseignement et qu’on a appelés à juste titre « les yeux de l’armée ». Une importante série de procédés secrets ont exercé une énorme influence sur les cours des événements militaires, et bien des catastrophes se seraient produites sans l’activité incessante de ces hommes et femmes. * * * Trois exemples entre mille évoqueront les filières d’évasion. Lorsque la guerre éclata, Edith Cavell, une jeune Anglaise devenue en 1906 la directrice de la première école belge d’infirmières diplômées, fondée par le Docteur Depage,- improvisa un institut médico-chirurgical au sein de cette école. Des soldats anglais et alliés blessés, réchappes des combats, vinrent y demander asile. Elle les soigna, puis, après leur guérison, elle et ses amis les aidèrent à fuir par la Hollande. Dénoncée, elle fut arrêtée et incarcérée à la prison de Saint-Gilles. Le procès s’était déroulé le premier jour dans la salle des séances du Sénat et le second à la Chambre des représentants. Trente-cinq personnes étaient impliquées dans cette affaire. Le tribunal condamna à la peine de mort Edith Cavell, l’architecte Philippe Baucq, une Française, Louise Thu-liez, institutrice à Lille, la Comtesse Jeanne de Bel-leville et le pharmacien Séverin. Vingt-deux autres furent condamnés à des peines allant de deux ans d’emprisonnement à quinze ans de travaux forcés; huit prévenus furent acquittés. La sentence prononcée contre Edith Cavell et notre compatriote Philippe Baucq fut exécutée le lendemain 12 octobre 1915 à six heures du matin au Tir National à Bruxelles. D’après le compte-rendu des débats, la police allemande avait été mise durant l’été 1915, sur la trace d’une filière d’évasions. Il s’agissait d’un réseau de recueil de soldats blessés organisé dans le Hainaut et dont le chef était le Prince Reginald de Croy. Ces soldats étaient clandestinement dirigés et guidés sur Bruxelles et Mons par la Comtesse de Belle ville et par des ouvriers mineurs. A Bruxelles, ils étaient accueillis par Edith Cavell et ses amis. Ensuite, on les acheminait vers Anvers et Turnhout pour les faire passer finalement en Hollande. Le Ministère public déclara que les agissements des prévenus avaient eu une part incontestable dans le succès des opérations de la Marne qui provoquèrent la retraite de l’Armée allemande jusqu’à l’Aisne. Deux autres exploits d’évasion héroïques méritent d’être mentionnés. Le 5 décembre 1917, l’Alsacien Joseph Zilliox, soldat de l’armée allemande, batelier en garnison à Liège, emmena sur le remorqueur Anna, de Visé au Limbourg hollandais, 42 personnes désireuses de rejoindre l’armée. Zilliox fut arrêté après deux autres missions et fusillé à la Chartreuse, à Liège, le 13 juillet 1917. Le 13 janvier 1917, à Liège, Jules Hentjens embarqua 103 jeunes gens à bord du remorqueur Atlas V. Il franchit plusieurs barrages sur la Meuse, entre autres le pont de Visé renforcé d’obstacles et de fils électrifiés soumis à une tension de 6.000 volts et, à une heure du matin, il parvint avec ses passagers à Eysden, premier village hollandais. L’existence des Belges dans leur pays était devenue pénible après quelques mois d’occupation. Les arrestations arbitraires se multipliaient. On se réunissait en cachette dans les arrière-boutiques pour lire des feuilles clandestines. (p.397) Dans les trams, c’était à voix basse qu’on échangeait ses impressions, de peur d’être entendu et dénoncé par un mouchard. Il était interdit de passer devant les casernes et sur les trottoirs des gares. Seules les autorités et les troupes allemandes pouvaient faire voler des pigeons. Le droit de posséder et d’utiliser des installations de télégraphie sans fil appartenait exclusivement à l’armée d’occupation. Les installations du téléphone et du télégraphe étaient désormais réservées à l’usage des autorités allemandes. Les violations de domicile, les expulsions, les perquisitions, les arrestations, les déportations en Allemagne de personnes jugées « indésirables » ne se comptaient plus. Il fallait obligatoirement correspondre par lettres ouvertes, par la poste allemande, et ce pour certaines parties du pays seulement. Le simple fait de transporter une lettre d’une localité à une autre constituait un délit pour un particulier. Une nuée d’espions et de délateurs prêtaient l’oreille aux conversations, tout en affectant l’indifférence. On estimait à 6.000 le nombre d’espions allemands dans les grandes villes, parmi lesquels 2.000 femmes. Ce fut dans ce climat que d’importants services de renseignement allaient voir le jour. Le précurseur du renseignement clandestin fut Dieudonné Lambrecht, un industriel liégeois. Lambrecht s’évada vers la Hollande en octobre 1914, où il entra en contact avec un représentant de la Section Intelligence du Grand Quartier Général britannique. Il accepta de rentrer en Belgique et de signaler les mouvements ennemis par voie ferrée, dans les deux sens. Il s’assura du concours de plusieurs personnes dans différents secteurs, notamment des cheminots et des employés des P.T.T. Un réseau de postes de surveillance fut établi. Ceux de Liège, Namur et Jemelle furent les premiers à fonctionner. Tout mouvement de troupes entre l’est et l’ouest était repéré et signalé. Les préparatifs de l’offensive allemande contre Verdun qui débuta le 26 février 1916 avaient été décèles par ces services plusieurs semaines auparavant. Le 25 février 1916, Lambrecht était arrêté à Liège et, le 18 avril suivant, il fut fusillé. Ses amis, Walthère Dewé, un brillant ingénieur et cousin de Lambrecht, Herman Chauvin, ingénieur électricien et le père jésuite Desonay poursuivirent son oeuvre. Le 22 juin 1916, ils fondaient un service qui s’appellera successivement, Michelin, B 149, la Dame Blanche et le Corps d’observation anglais (COA). En juillet 1917, des boîtes aux lettres furent installées non loin de la frontière hollandaise. Le Secret Service y remettait ses directives et Dewé son courrier. Ainsi, la liaison permanente était réalisée. La Belgique était divisée en quatre secteurs, chacun sous un chef responsable. Le réseau Jemelle, Namur, Liège était remis en train. Charle-roi, Arlon, Dinant et Tongres avaient leur poste de surveillance des voies ferrées. Le début de l’année 1917 vit la réorganisation des services secrets alliés. Le capitaine Landau du Secret Service britannique promit, le 5 juillet 1917, à l’ingénieur Gustave Lemaire, envoyé en Hollande par La Dame Blanche, que les combattants de l’intérieur seraient reconnus comme soldats, mais après la guerre seulement. Dewé donna à son service une véritable organisation militaire. Trois bataillons furent créés à Liège, Namur et Charleroi. Chaque bataillon était divisé en compagnies, chaque compagnie en pelotons. Dans toutes les compagnies, un quatrième peloton avait pour mission de collecter les documents provenant des 3 autres et de les déposer dans la boîte aux lettres de compagnie. Une unité spéciale du bataillon était chargée de transporter le courrier des boîtes aux lettres de compagnie jusqu’à celles du bataillon. Un agent par bataillon portait à son tour les courriers de ces dernières à la boîte du Quartier Général de la Dame Blanche à Liège.
Les documents étaient examinés, contrôlés, classés par Dewé et Chauvin, reproduits et acheminés vers l’une des boîtes aux lettres terminales créées par le Secret Service. Les membres du service de renseignements avaient un grade militaire : Chef de Bataillon, Commandant de Compagnie, Lieutenant, Sous-Lieutenant, Adjudant, Sergent, Caporal, Soldats. Tous devaient prêter serment en tant que soldat dans le Corps militaire d’observation allié. A la fin de l’été 1917, la Dame Blanche s’était implantée sur toutes les voies ferrées belges d’importance stratégique. Elle fut en mesure de répondre à toutes les demandes britanniques. Au cours de l’été 1918, son réseau couvrait la Belgique et le nord de la France comme une toile d’araignée (voir croquis). Le 21 juillet 1918, le capitaine Henry Landau transmettait à Dewé un message du War Office britannique : « Le travail de votre organisation représente 70 % de la somme totale des renseignements (p.398) obtenus par toutes les armées alliées, non seulement par les Pays-Bas, mais aussi par les autres pays neutres. Ceci vous fera comprendre le rôle unique et merveilleux que vous remplissez et en même temps vous donnera une idée de la grande responsabilité qui pèse sur vous, car c’est sur vous seuls que comptent les Alliés pour l’obtention des renseignements concernant les mouvements ennemis dans les régions près du front …. Les renseignements obtenus par vous valent des milliers de vies aux armées alliées. » Trois jours avant l’armistice, le maréchal Douglas Haig, par sa Dispatch du 8 novembre, citait à l’ordre du jour de l’armée britannique tous les membres de la Dame Blanche.
Au total, 904 agents (626 hommes et 278 femmes) et 180 auxiliaires firent partie de la Dame Blanche. 45 membres furent arrêtés, 5 condamnés à mort, 2 exécutés et 1 membre décéda en service actif. Ce chiffre de 3 morts est très bas en comparaison du nombre de personnes exécutées en 1914-1918 pour fait d’action clandestine. Le nombre de combattants clandestins belges tués est estimé à un millier. Les dossiers de personnes exécutées en 1914-1918 ont été détruits en mai 1940, par crainte des représailles de l’occupant. En avril 1916 furent passés par les armes pour espionnage : — Gabrielle Petit, vendeuse à Molenbeek, — Edgard Van de Woestyne, conducteur à Eeklo, — Aloï’s Vermeersch, facteur à Tielt, — Alphonse Matthijs, manœuvre à Tielt, — Oscar Hernalsteens, dessinateur à Bruxelles, — Jules Mohr, inspecteur d’assurances à Valen-ciennes, — Emile Gressier, inspecteur des ponts et chaussées à Saint-Amand. Leur crime, déclarait l’autorité allemande, était d’avoir « longtemps observé nos troupes, mouvements de troupes, transports par chemin de fer, autos, etc … et transmis, ou fait transmettre, les renseignements ainsi obtenus au service d’information de l’ennemi. » Et le procureur allemand Stoeber déclarait à propos de Gabrielle Petit, modeste employée de 22 ans : « Cette femme nous a fait plus de mal que plusieurs corps d’armée. » Elle voulut mourir en beauté et le 1er avril 1916, elle marcha à la mort parée d’une robe blanche et des rubans rosés dans les cheveux. Au pied du poteau, elle refusa de se laisser bander les yeux et déclara : « Vous allez voir comment meurt une femme belge!. »
|
|
|
in : L’Illustration, 24/02/2007, p.162-166
LA CONQUÊTE DE LA DERNIÈRE COLONIE ALLEMANDE LE RÔLE DES TROUPES BELGES EN AFRIQUE ORIENTALE
(p.162) En 1880, l’Allemagne ne détenait pas un pouce de terrain outre-mer. En 1914, l’Allemagne s’était assuré un empire colonial immense. Des contrées du plus grand avenir en faisaient partie. Et l’Afrique et l’Asie semblaient promises à ses ambitieuses visées. Aujourd’hui, de tout cela l’Allemagne ne possède plus rien. Son labeur trentenaire est anéanti. S’il existe à Berlin un service de la « carte de guerre », après y avoir mis au point les derniers progrès germaniques dans les terres moldaves, sans doute jette-t-on un regard par delà les mers. Il y a là un graphique éloquent à tracer ! Parti de rien, il y a trois décades, il avait suivi, depuis, une courbe toujours ascendante. En août 1914, avec la perte du Togo, voici une première chute. Puis, la descente s’accentue à la prise de Kiao-Tchéou et des archipels du Pacifique, ces bases importantes aux carrefours du monde. Et la ligne s’abaisse encore : tout l’Ouest africain est’ conquis par Botha, le Cameroun passe aux mains des troupes britanniques, françaises et belges. Enfin, le graphique tombé et s’écrase, car, désormais, l’Afrique Orientale allemande est aux Alliés! L’Allemagne nous a porté de rudes coups, mais nous les lui rendons et elle en ressent peu autant que celui-là. Ses hommes d’Etat, sa presse et son opinion publique en témoignent. « Sans colonies, pas de situation mondiale possible pour l’Allemagne », déclarait, hier encore, un de ses ministres devant un groupe de personnalités considérables.
La conquête de l’Afrique Orientale allemande, deux fois grande comme l’empire des Hohenzollern, a demandé trente mois de combats. Jusqu’en février 1916, loin d’être battus, les Allemands nous infligèrent plusieurs défaites. Au Nord le protectorat anglais, au Sud-Ouest la Ehodesia sentirent, dans une mesure inégale mais constante, la morsure de l’invasion; à l’Ouest, sur une frontière qui, de l’Ouganda à la pointe méridionale du Tanganyika, mesure plusieurs centaines de kilomètres, les Belges durent aussi subir -de furieux assauts. Aux premiers jours des hostilités, la Belgique disposait sur le grand lac africain d’une seule canonnière, l’Alexandre-Delcomune. L’ennemi, depuis longtemps préparé, s’adjugeait la maîtrise des eaux grâce à ses quatre navires armés. Ce fut pour le détachement Moulaert l’obligation de se disséminer sur toute la rive Ouest, afin de garder nos installations, objet de continuels bombardements. Mais, à la fin de 1915, grâce au concours anglais, ou put mettre à l’eau deux canonnières amenées du Cap à travers toute la Rhodesia. Ce fut une performance dont la Grande-Bretagne est fière à juste titre. Dès lors, la situation changea et, bientôt, le Wissmann était coulé, puis le Kingavi capturé. Le lieutenant-colonel Moulaert pouvait désormais porter ses hommes vers l’Est, surtout quand sa présence aux confins de la Rhodesia ne fut plus indispensable aux Anglais pour la garde de leur frontière. En Afrique autant que sur nos champs de bataille, l’Allemagne avait profité ainsi, dès les premiers jours, d’une préparation longue, savante et méthodique. 40.000 soldats indigènes encadrés par 3.000 Européens, artillerie puissante et variée, ballons captifs, autos-mitrailleuses, telle fut la mise de l’ennemi dans cette terrible partie. Quant au territoire, but de la campagne anglo-belge, pris dans son ensemble il était trop vaste. Aussi, fallut-il en déterminer la partie vitale, puis la proposer à l’effort commun des Alliés. Ce fut le grand chemin de fer central ‘qui déroule ses 1.250 kilomètres, inestimable trait d’union, entre l’océan Indien et le Tanganyika. Le Tanganyikabahn, colonne vertébrale du protectorat allemand, est le soutien de toute sa charpente. De l’Océan il monte à travers une dépression profonde, puis pénètre dans les larges plateaux de l’Ounyamouézi, le « pays de la lune ». Contrée charmante, elle est toute en molles collines aux contours gracieux, bois et prairies immenses semées de villages, et partout des troupeaux qui paissent les pentes. Nous allions suivre en partie, et dans un sens inverse, les routes qu’immortalisèrent Burton et Speke, Livingstone et Stanley, et d’autres encore, pionniers de la plus belle des sciences, celle des terres lointaines et mystérieuses. Sur ces chemins, où périrent tant de porteurs, les misérables pagazi, victimes des Arabes, ces pirates de terre, les nôtres allaient refouler dans leur dernier repaire ceux-là mêmes qui du monde veulent se faire un domaine d’esclavage. Depuis 1914 seulement, le voyageur pouvait de Dar-es-Salam traverser ainsi l’Afrique porté par le rail d’acier, véritable conquérant. Pour construire cette voie, la firme Holzmann de Berlin, rivalisant avec les meilleurs pionniers anglais, réalisa des prodiges, posant jusqu’à 1.000 mètres de rail par vingt-quatre heures. Surprise au début — et sa colonie de l’Est en souffrit beaucoup — l’Angleterre se ressaisit. Finalement elle aligna 42.000 hommes, inégalement répartis dans le Nord, sur les lacs et aux confins de la Rhodesia. L’Inde contribua à cette campagne. Un corps expéditionnaire quitta un jour Bombay pour Tanga sous les ordres du major général A.-E. Aitken. Mais l’Afrique du Sud fournit le principal effort, et elle nous donna un chef, Jannie Smuts, celui-là même qui provoquait, un jour, à la Chambre des Communes, cette réflexion piquante : « Dans cette longue guerre, la Grande-Bretagne n’a eu encore que deux généraux victorieux et, chose étonnante, ce sont deux hommes politiques : Botha et Smuts! » Retracer l’ensemble d’une campagne aussi longue et intéressant un pareil territoire dépasserait le cadre de cet article. Mais, parce que leur intervention fut décisive, il convient de dire quel » rôle les Belges, mes compatriotes, y ont joué. La dernière colonie allemande tombe devant une quintuple attaque. Au Nord, les colonnes britanniques, sous le commandement en chef du lieutenant-général Smuts dont les brigadiers sont, dans leur ordre de bataille de l’Ouest à l’Est: Sir C. Crewe, qui, par le Victoria Nyanza, rejoint les colonnes belges à Tabora; Van Dcventer, dont la division, après de brillants succès à Moschi, demeure quelques semaines dans Kondoa Iraûgi, puis coupe le Tanganyikabahn et approche de Mahenge; Hoskins, Brits ‘ et Hannington qui, an lendemain de la prise de Tanga, se séparent, l’un gagnant Dar-es-Salam et les deux autres le Rufigi. A l’Est, une escadre anglaise bloque la côte; l’île Pemba et Zanzibar servent de base à l’action navale; en outre, des corps de débarquement occup’ent les ports de Kilwa-Kiwindje, Lindi et Mikendani, coupant ainsi les dernières communications allemandes avec la mer. Au Sud, les Portugais, depuis ces derniers mois, ont engagé deux colonnes sons les ordres du général Gil; il leur appartient, non de conquérir la terre allemande — ce qui est fait — mais d’arrêter les contingents ennemis qui accélèrent leur retraite (p.163) vers le Sud, avec l’espoir d’opposer une dernière résistance dans le maquis du Mozambique. Au Sud-Ouest encore, les Anglais ont envoyé de Rhodesia deux colonnes: parties du Nyassaland avec le colonel Hawf borne et son ehsf, le général Northey, elles se dirigent vers Mpanga et Iringa. Enfin, à l’Ouest, et sur une ligne de plusieurs centaines de kilomètres, le gouvernement du roi Albert met en ligne 20.000 hommes répartis en trois colonnes sons le commandement en chef du général major Tombeur, assisté de ses seconds, le lieutenant-colonel Moulaert et les colonels Olsen et Molitor; leur objectif stratégique est Tabora; par une action convergente ils parviendront à saisir l’ennemi dans les mâchoires d’une énorme tenaille et, ce jour-là, avec la chute de Tabora, capitale de guerre, la campagne sera pratiquement achevée. Au point de vue militaire, l’originalité de toutes ces opérations est la parfaite convergence d’efforts qui s’exercent à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Cette note caractéristique, exacte .pour l’ensemble, le demeure dans la cohésion plus localisée, quoique encore sur un espace immense, de chacune des colonnes dont le lecteur connaît, maintenant, la constitution et la nationalité, le commandement, la direction et le but.
Il va sans dire que la nécessité d’entreprendre sous les tropiques une campagne de conquête prit un peu au dépourvu le gouvernement belge, par ailleurs dépouillé de ses indispensables moyens d’action. Sauf un lambeau, plus de territoire national; plus d’impôt; plus de peuple, puisque les quatre cinquièmes en sont prisonniers de l’Allemagne. Cependant, il fallut créer, armer, munir, expédier, entretenu*, alimenter une armée coloniale de 20.000 hommes et lui fournir des cadres. Et dans quelles conditions ! Traverser l’Océan, parcourir une grande partie du continent noir avec 66.000 charges dont les porteurs durent, pour la dernière partie du trajet, marcher quarante jours durant sut la route des caravanes.. Il fallut suffire aux exigences d’un armement mis au point des derniers progrès et d’une campagne conduite avec une technique merveilleuse. Voilà ce qui fait honneur à ceux qui, l’ayant entreprise, terminent victorieusement cette guerre lointaine. Le général en chef dut organiser sur place et ses hommes et la répartition du matériel. Autour d’un noyau de forces depuis longtemps en service, on groupa les nouveaux effectifs. Au Congo belge, le service indigène comprend sept années de présence sous les armes. Chaque soldat reçoit une solde quotidienne. Au terme de son engagement, il touche une allocation de retraite. Les nègres choisis pour l’armée sont de beaux types, à la charpente solide. Fiers de servir, il leur arrivait presque toujours, après un premier septennat, de contracter un nouvel engagement. Leur fidélité au drapeau fut maintes fois prouvée.
La liaison entre forces britanniques et belges est assurée, d’abord, par un officier anglais, le major Grogan, placé auprès du général Tombeur.’ Grogan est célèbre par sa traversée de l’Afrique, du Cap au Caire. Grand voyageur sympathique, possédant une immense fortune et cependant d’une modestie charmante, il a comme adjoint le capitaine Nugent. D’autre part, aux côtés du lieutenant-général Smuts se trouve un officier belge, le commandant Van Overstraeten, officier d’artillerie qui appartint à l’état-major de la lre division de cavalerie. Une ligne télégraphique spéciale relie le commandement belge à la ligne de l’Ouganda (Port-Florence — Mombasa) et de là, par Nairobi, communique avec les Anglais. Elle fut souvent détruite par les animaux sauvages. Ainsi arrivait-il, un jour, au docteur Rodhain, professeur à l’Université de Louvain, qui accompagnait nos colonnes en mission d’étude, de trouver une girafe étranglée par les fils télégraphiques. Les colonnes comprennent chacune un état-major monté à dos de mule La remonte est ; surtout venue d’Abyssinie et des réserves de cavalerie en garnison à Djibouti et dans Aden. Les batteries d’artillerie sont aussi attelées de ces mules pour la plupart d’une forte race et capable d’une bonne allonge. Le climat et l’épuisante difficulté des communications devaient placer au premier plan le rôle du service médical. Son importance était capitale. Rien ne fut laissé au hasard. A chaque bataillon, son médecin avec un infirmier blanc. A chaque régiment, son hôpital volant avec un chirurgien, deux médecins et un infirmier européen. Derrière chaque colonne et à la base d’étape, un hôpital secondaire volant. Malades et blessés, après examen, sont dirigés, si c’est utile, vers la base sanitaire générale et commune à toute l’expédition. De là, les convalescents, par les ports maritimes, regagneront l’Europe ou seront laissés au repos dans les missions. Voilà comment il arriva que pas une seule maladie épidémique ne vint affaiblir les troupes Les hommes dans un corps sain gardèrent intact un cœur généreux.
Et ce qui surprend encore, tout au moins à première vue, c’est de voir à travers la brousse au milieu d’un pays peuplé de fauves, en pleine nature tropicale, sur des routes excellentes — dont le mérite, d’ailleurs, appartient en partie à l’ennemi — bicyclettes, motocyclettes précipitant leur allure. Le service des estafettes s’opère avec régularité et à une vitesse endiablée. Quelques semaines avant l’offensive générale le 26 novembre 1915, une affaire d’avant-garde nous coûtait du monde. Le capitaine Defoin et le sous-officier Dupuis s’engageaient avec leurs hommes dans les monts Tshavdjaru-Bulele. Leur but était de reconnaître les sommets, en vue d’une occupation ultérieure. Une mitrailleuse, servie par les sous-officiers Loriaux e’t Devolder, suivait en renfort. Soudain, avant l’aube, le 27, ce petit détachement est surpris dans son camp. Plusieurs compagnies avec 4 mitrailleuses et un canon, assaillent les nôtres. Plutôt que de se retirer, le capitaine Defoin fait face à l’agression. Ses soldats s’accrochent au terrain. L’unique mitrailleuse belge fauche les Allemands. Un de ses pointeurs, Loriaux, est blessé. On l’évacué. Devolder continue seul à servir la pièce. La situation devient intenable. Les Allemands progressent. Ils sont à 100 mètres, à 50 mètres… La mitrailleuse belge se cale. Le capitaine Defoin crie alors à Devolder: « Filez avec la pièce!… » Mais le fils du ministre d’Etat belge, qui a ramassé un fusil, répond : « Jamais! » Fatalité, le chef du détachement est atteint. Devolder s’élance et le reçoit dans ses bras. Alors, ces deux soldats, unis par le devoir, sont ensemble criblés de balles tirées qui ont conqu’t’ à bout portant… Ils reposent, désormais, côte à côte, au milieu de tant d’autres braves, dans le (p.164) cimetière de Kibati, près du lac Kivu. — Simple épisode, pris au hasard, ce combat livre un des côtés admirablement héroïques de toute la campagne. * ** La fin du mois d’avril coïncide avec un changement complet dans la situation militaire. De toutes parts, à la défensive succède une suite ininterrompue d’attaques décidées, énergiques, toutes parfaitement coordonnées. De la périphérie, l’ennemi est refoulé vers le centre de son territoire. Pour sa part, le général major Tombeur fait avancer successivement ses trois brigades. Le 3 mai, la plus riche province ennemie, le Rouanda, est envahie par le colonel Molitor qui, ancien lieutenant-colonel du régiment des carabiniers, commande en second toute la campagne jusqu’en avril 1916. De ses deux régiments, l’un quitte l’Ouganda, l’autre longe la rive septentrionale du lac Kivu. Ils avancent entre les deux mers intérieures, le Victoria Nyanza et le Tanganyika. Les Allemands occupent de redoutables positions dans la zone montagneuse qui dessine la frontière. Dès le premier contact, les Belges révèlent la tactique qui, désormais, leur sera commune avec les Anglais. Il s’agit d’aborder des obstacles, égaux en faveur défensive naturelle à ceux qu’affrontent Français et Serbes en Macédoine, Italiens en Garnie, avec parfois, en plus, des altitudes supérieures. Attaquer de front coûterait trop cher’et un bon chef sait épargner la vie de ses hommes. Aussi, chaque fois, par une démonstration violente, l’ennemi est-il fixé sur ses retranchements, tandis qu’un fort parti, faisant un grand détour, le prend de flanc ou même à revers. Il ne lui reste plus alors qu’à céder la place ou se faire prendre. Et c’est ainsi que. pendant des mois entiers, on le refoulera pied à pied. En Afrique Orientale, la guerre a fait revivre la devise napoléonienne: les soldats gagnent la bataille avec leurs jambes.
La brigade Nord traverse toute la grande plaine de lave qui s’étend de Rutshuru à Kibati. La route serpente au milieu d’un admirable décor. A droite, à gauche, ce ne sont que pyramides volcaniques éteintes dont les sommets blanchâtres semblent, au couchant, couronnés d’un dernier jet de feu. Les flancs de ces collines tapissés de verdure ondulent sous le vent qui caresse au passage les forêts de bambou et les bananeries. Non loin de là, Burunga réserve aux Européens d’inappréciables ressources. De grands potagers y sont pleins de légumes — friandises délicieuses sous les tropiques — salades, poireaux, choux-fleurs… et aussi des fraises exquises du Kivu. La vallée du Grabeu est proche. Les Pères Blancs possèdent là plusieurs missions prospères. Le paysage est dominé par un bruit lointain de canonnade, que produisent les cataractes des rivières. Après avoir occupé Kissenji, le 16 mai, Rubengero, le 24, le colonel Molitor entre à Kigali, chef-lieu du Rouanda. C’est une agglomération vaste et peuplée de 100.000 habitants; c’est aussi le nœud essentiel de toutes les communications du pays. Successivement, toute la partie septentrionale du Rouanda est conquise, jusqu’à la grande route qui réunit à la rive Sud-Ouest du Victoria la pointe Nord du Tanganyika. L’armée belge traversa ce riche pays sans commettre la moindre déprédation. Pas une charge de bois, pas une douzaine d’œufs qui n’ait été payée rubis sur l’ongle. Et se révélant une fois de plus habiles colonisateurs, les nôtres se firent des auxiliaires de ces populations belliqueuses qu’on espérait leur opposer. L’une après l’autre, Nsasa et Biaromulo tombent à leur tour. * ** A cette même époque, une nouvelle heureuse vient réjouir nos soldats. Les Allemands doivent abandonner l’île Kivijiji qu’au mois d’août 1914 ils avaient occupée par surprise. Située au milieu du lac Kivu, elle couvre une superficie de 300 kilomètres carrés environ. Remarquablement peuplée pour une terre africaine, elle ne contient pas moins de 20.000 âmes. Canonnières, vapeurs et chaloupes armées avaient eu raison d’une résistance pourtant décidée et qu’appuyaient de solides positions établies sur le pourtour de l’île. Celle-ci domine une vaste nappe d’eau sulfureuse où il ne se rencontre pas un seul crocodile, pas un hippopotame, mais par contre remplie d’un excellent poisson de la grosseur d’une brème. Quelques cartouches de tonite suffisaient à assurer à nos troupes d’abondantes provisions. Et ces pêches miraculeuses s’entouraient d’un décor digne du pays des fées. Les rives sont creusées de fjords tapissés de verdure que séparent de hautes murailles rocheuses. Sous leur vêture grise elles forment un étrange contraste avec le ciel bleu et profond que répète en bas l’immense glace mouvante du lac. Au loin, résonnent les échos multipliés à l’envi de cascades dont les eaux emportées tombent avec fracas, bondissant dans une lumière limpide, puis s’écrasant, auréolées d’arc-en-ciel. Sur ces entrefaites, notre progression s’affirme. Après avoir appuyé sa gauche à la rivière Kagera, Molitor, avec le gros de ses forces, franchit l’Akanjuru, affluent droit de la Kagera, et sa droite approche d’Ousumbura, chef-lieu de la province d’Ourundi, sur la rive septentrionale du Tanganyika. Depuis son départ, aux premières heures de l’offensive générale, la brigade Nord avait ainsi parcouru 200 kilomètres en combattant sans cesse.
Le colonel Molitor avance toujours vers l’Est, dans le but d’occuper la rive- Sud-Ouest du Victoria. Réussir, c’est couper la retraite aux contingents adverses qui tiennent encore au Nord. Et c’est ce qui arrive. L’artillerie, allemande fait, alors, un effort désespère pour percer les lignes belges. C’est un combat (p.165) sauvage pendant sept heures consécutives. Le major Rouling, grièvement blessé à la tête de son bataillon, maintient ses hommes dans une attitude superbe et les Allemands, taillés eu pièces, sont ou tués ou pris avec leur chef. En même temps, beaucoup plus au Sud-Ouest, dans la région du Tanganyika, la brigade Olsen presse l’ennemi qui refuse le combat et bat en retraite vers l’intérieur. C’est à ce moment qu’intervient efficacement une escadrille d’hydravions qui était arrivée à Borna, le 2 février, après un voyage mouvementé: un incendie avait éclaté en mer et 70.000 litres d’essence avaient pris feu. Au début de juin, malgré toutes les difficultés de transport et de montage, deux appareils étaient prêts. En juin, les aviateurs belges firent de nombreux essais sur le Tanganyika. En juillet enfin, un bombardement de la côte allemande est décidé. Malgré les canons et les mitrailleuses, le port de Kigoma-Ujiji est reconnu, bombardé et photographié. Le puissant vapeur Graf von Goetzen est attaqué et fortement endommagé. Au cours d’une croisière, en liaison avec le service aérien de Kigoma-Ujiji, la canonnière Netta (lieutenant Lenaërts) surprend le navire Wami débarquant des troupes et, en quelques coups, règle définitivement son sort.
L’effet produit sur l’ennemi est noté dans les documents officiels saisis à Kigoma. Après le premier bombardement, on ordonne l’évacuation immédiate des femmes et des enfants, on envisage l’abandon prochain des forts et on prépare la destruction des ouvrages importants et du matériel de chemin de fer. Le colonel Olsen a ainsi défini l’effet énorme produit par l’intervention des avions: « Après chaque bombardement, j’ai senti fondre la résistance de l’ennemi ; vos derniers raids l’ont réduite complètement. Vous pouvez dire que vous avez forcé l’évacuation de la place de Kigoma, nous y sommes entrés sans tirer un seul coup de fusil. » C’est un honneur pour les Belges d’avoir pu réaliser, les premiers, l’aviation au centre de l’Afrique Equatoriale. A ce magnifique résultat ont attaché leurs noms : le commandant de Bueger, le capitaine Russchaert, les lieutenants Collignon, Orta, Behaeghe et Castiau, tous faits chevaliers de l’Ordre de l’Etoile Africaine. * ** Après la chute de Kigoma-Ujiji, survenue le 29 juillet, le terminus intérieur du chemin de fer central est perdu pour l’adversaire et les événements vont se précipiter. Les Allemands se replient vers Tabora sous l’attaque concentrique de trois colonnes belges et d’un corps britannique du général Sir C. Crewe. La brigade anglaise descend du Nord; le colonel Molitor arrive du Nord-Ouest; les deux régiments (1″ et 2e) du colonel Olsen progressent de l’Ouest vers l’Est; le lieutenant-colonel Moulaert, enfin, se joint à la manœuvre commune. Il avait rassemblé ses troupes, devenues inutiles sur le Tanganyika depuis que le pavillon allemand en avait disparu. Traversant alors le lac, il passe de la rive belge sur le rivage allemand et vient donner à la brigade Olsen un inestimable appui en couvrant sa droite.
Moulaert, major du génie belge, était avant les hostilités commissaire général du Congo. Ingénieur de grand mérite, il se consacrait à l’étude des questions fluviales et se révéla l’homme d’action dans toute la force du terme. Ainsi, malgré l’espace immense, malgré la nature souvent hostile, malgré la liaison contrariée par le terrain et la brousse qui le ronge, toutes nos colonnes d’attaque, au moment voulu, tendent à leur but comme les rayons d’une roue vont au moyeu qui les rassemble. A l’heure fixée, ils sont tous là pour sonner l’hallali et porter bas l’Allemand. Et voici ce qui arrive. Du Nord à l’Ouest et de là vers le Sud, l’envahisseur dessine presque un demi-cercle complet. Crewe et Molitor se retrouvent, le 12 août, après que ce dernier vient d’enlever les redoutables positions des monts Kahama et de bousculer l’ennemi à Saint-Michaël, sur la grande route Muanza-Tabora. Anglais (p.166) et Belges se rejoignent ainsi à 120 kilomètres au Nord de Tabora. La brigade Molitor avait en ;tout parcouru 500 kilomètres. Plus bas, le colonel Olsen s’engage sur le Tanganyikabahn et, le 14 août, occupe la station d’Ugaga. Quelques jours après il parvint à 40 kilomètres du but. , • ‘ . Danois d’origine, Olsen est depuis plusieurs années au service de la Belgique, tout en conservant sa nationalité. Sa carrière coloniale le place hors de pair. Chef des troupes de Katanga, au début de la guerre, il fut d’abord envoyé avec ses hommes pour soutenir les Anglais sur les confins de la Ehodesia. Il y remporta des succès, et, au moment de l’offensive générale, on le trouva à la tête de la brigade Sud. Le voilà donc en possession d’un important tronçon du rail allemand, qu’il lui faut utiliser. Point de matériel, car l’ennemi a tout emmené ou détruit. Et l’on vit, à travers le majestueux Tanganyika, passer des chalands qui, de Lukaga, amènent sur la rive opposée tout le matériel désirable qu’on pose sur les voies à Ujiji-Kigoma. Puis on remet la ligne en état et notre matériel roule sur les premiers 100 kilomètres de rail conquis par les Belges sur l’Allemagne. Ils atteignent la station de Rutchugi. Les. événements décisifs approchent. Toutes les forces adverses sont désormais réunies en deux masses, sans liaison entre elles. L’une recule devant le lieutenant-général Smuts, qui la refoule vers Mahenge, mais connaîtra bien des déboires dans les marais du Rufigi, l’autre cède, pressée par les troupes du major général Tombeur. Le général prussien Wahle regroupe alors ses hommes pour une dernière résistance dans Tabora. Il s’agissait de défendre la principale ville intérieure de l’Afrique équatoriale. Depuis que Dar-es-Salam, le grand port de la côte océanique, se trouvait sous les canons de l’escadre britannique, on avait transporté ici tous les services de la colonie. Tabora était devenu cœur et cerveau de la résistance.
Pendant dix-neuf longues journées, on se bat avec rage et septembre 1916 comptera dans les annales des guerres exotiques. Malgré tout, il faut bien que les Allemands cèdent. Le 19 septembre, le général Tombeur entre dans la capitale. Il y délivre 189 Européens prisonniers, ressortissants des nations alliées, et capture 215 Allemands de tous grades, plusieurs centaines de soldats indigènes, des .canons, dont du 105, des mitrailleuses en quantité et surtout, butin précieux quand on se trouve au bout d’aussi longues lignes du ravitaillement, des provisions variées et en masse. Au centre du continent noir, que ne représente pas la valeur d’une charge amenée de Borna! Le général Wahle s’enfuyait avec à peine 1.300 fusils, cherchant à gagner le Sud. Le graphique de notre carte indique assez combien périlleuse était sa situation. Le lecteur voit comment l’ennemi va devoir se glisser entre Van Deventer (p.166) qui vient du Nord et la colonne du Nyassaland qui monte du Sud. Derrière lui, Tombeur ne lui laisse aucun répit et, sur la ligne de retraite, les Portugais ont le privilège de pouvoir achever la bête sur ses fins ! Les troupes battues à Tabora ont été, quelques semaines après, complètement défaites dans la région de Mahenge. En mêîne temps, à Impeude, puis près de Ilemboule, deux autres partis allemands sont détruits. Une colonne de 500 hommes dut se rendre avec armes et bagages. Le général Wahle perd ainsi la majeure partie de ses derniers effectifs dont le sort est, dès maintenant, réglé, car il ne leur reste qu’à se faire prendre ou à périr dans la brousse. Parmi les tués se trouvait le député national-libéral Gruson, le propriétaire des grandes aciéries de Magdebourg.
Ainsi, la campagne est virtuellement terminée. Les soldats du roi Albert de Belgique, en attendant mieux encore, ont conquis 200 kilomètres carrés que peuplent 6 millions d’habitants. La population totale de la colonie s’élève à 10 millions. Les Belges tiennent donc la plus riche partie du pays. Et si vous regardez la carte, en constatant que le territoire gagné par leurs armes commande toutes les communications entre les grands lacs africains, l’importance politique du gain n’échappera à la réflexion de personne, car enfin, on se bat en Europe pour décider du sort, non seulement de nos provinces, mais aussi de l’avenir de tout le monde et des jeunes continents aux possibilités incalculables. Au cours de ces sanglants épisodes, les Allemands paraissent avoir généralement observé les lois de la guerre. Toutefois, on a surpris sur leurs soldats des balles dum-dum. Les chefs expliquèrent que, le ravitaillement comptant parfois sur le produit des chasses, ces projectiles n’avaient d’autre destination que le tir du gibier. Quant aux Belges, ils mirent une certaine coquetterie à respecter scrupuleusement les lois de la guerre et traitèrent bien les prisonniers allemands. Dans ces jours tragiques, beaucoup d’entre nous prêtèrent peu d’attention à cette campagne, où cependant 100.000 hommes étaient engagés. Elle permit à la guerre de mouvement de survivre aux tranchées, et sans doute ces centaines de kilomètres, parcourues victorieusement par les Anglais et les Belges durant trente mois d’un rude et cruel labeur, feront-elles soupirer les braves que l’immobilité parfois exaspère. Il leur est, cependant, moins que jamais interdit d’espérer que le jour approche où ils pourront, eux aussi, connaître et savourer l’ivresse des grandes étapes victorieuses.
Charles STIÉNON
|
|
|
PIOTTE, PIOT, JASS, JAS OU …POILU BELGE !, in : AO 31/10/2007
Voici quelques compléments d’information initialement destinés à M. Jean d’Olnë, de Sendrogne, à propos du surnom des soldats belges de 1914-1918. Cependant, l’intérêt de cette documentation m’a poussé à vous la proposer à tous. Tous ces renseignements ont été rassemblés et transmis par M. Alain Canneel, de Lesterny. «Consultons les dictionnaires non pas français mais néerlandais. Je n’ai sous la main que le Frans Woordenboek de C.R.C. Herckenrath, J.B. Wolters, Groningen, mais il m’apprend déjà que een piot signifie un pioupiou, un troupier. Vous aurez d’ailleurs noté que le seul ouvrage en langue néerlandaise cité la semaine dernière use dans son titre du terme piot (pluriel: piotten), à la différence des ouvrages en langue française qui utilisent un piotte et des piottes. Pour être correct, il aurait sans doute fallu écrire sur la couverture du numéro 52 d’InterNos «een Belgischepiot»… Il vous reste à lancer votre moteur de recherche favori sur l’Internet avec comme mots clés soit een piot, soit piotten associé à 1914, pour trouver une abondance de textes en néerlandais à propos des troupiers de 1914. Si vous associez piot ou piotten à 1940, par exemple, vous aurez la confirmation de ce que suggère la mention ci-dessus à propos de l’ouvrage en langue néerlandaise concernant la guerre de 1940-1945, à savoir que les appellations piot ou piotten ne sont pas plus spécifiques de la «Grande Guerre» que jass A la différence de poilu ? Enfin, mon Frans Woordenboek ignore le(s) jass. Quant au poilu belge, je peux aussi mentionner une carte postale qui, selon sa légende, représente «Le 14 juillet à Paris en 1916- Les Poilus Belges devant le Grand Palais». Et une autre, qui montre, selon sa légende, «La Grande Guerre 1914-1916- En Belgique – La Reine des Belges accompagnée du Général de Conninck écoutant dans les tranchées un poilu mélomane» (jouant du violon).
JASS ou JAS Last but not least, Jules-Marie Cannée! signait ses illustrations de couverture pour la revue InterNosdu camp d’internement de Harderwijk en faisant parfois suivre son nom par une qualification de son état de soldat belge interné. Ainsi, signa-t-il la couverture du numéro 40 (1er janvier 1918) j.m. canneel soldat belge, celle du numéro 49 (15 mai 1918) qui est un autoportrait y.m. canneel Belgian soldier by himselfvu celle du numéro 61 (novembre 1918) j.m. canneel soldat interné belge. Mais ce sont ses signatures des couvertures des numéros 45 (15 mars 1918) et 59 (15 octobre 1918) qui doivent intéresser les lecteurs de la Petite Gazette -soit respectivement j.m.canneel piotte et j.m. canneeljas. Voyez les reproductions ci-après. Toutefois, l’élément le plus éclairant à propos de jass et jas provient d’un monument situé devant l’hôtel de ville d’Arlon. Voyez la reproduction de cette carte postale. (…) Cette statue en bronze de 2,30 mètres de haut, œuvre de Jean-Marie Gaspar (1861 -1931 ) inaugurée le 3 octobre 1920 suite à une souscription publique, a pour nom «Le Jass». Elle représente un soldat de la Grande Guerre et a été érigée à la mémoire des combattants et des déportés belges, ainsi que des fusillés arlonais morts au cours de la guerre 1914-1918. J’ai puisé ces informations sur \’Internet, à l’adresse htfp://www.arlon-is-on.be/fr/autres.html où sont détaillés les monuments de la ville d’Arlon. On y lit de surcroît cette précision: le nom Jass vient du mot flamand jas qui désigne la capote portée par les soldats en hiver (een jas, dans son sens courant, c’est une veste, un veston). Ainsi, quand piotte vient du mot flamand piot, jass vient du mot flamand jas (qui.se prononce ‘yass’’ comme dans yeux et tasse). Nous sommes bien en Belgique! Aussi, pour faire bonne mesure, vous trouverez ci-joint une carte postale de Bruxelles montrant «Manneken-pis en costume de Jass – Manneken-pis in Jass»…
|
|
|
AU-DELA DES PIOTTES ET DES POILUS, AO 03/01/2008
Grâce à vos diverses interventions, dans les derniers mois de l’année 2007, nous avons eu un large aperçu des différents sobriquets dont étaient affublés (ou que se donnaient eux-mêmes) les soldats de la Grande Guerre. Monsieur José Marquet, de Sprimont, a eu l’excellente idée de fouiller les mémoires de volontaire de guerre (1914 – 1918 évidemment) de Maurice Flagothier, de Lincé-Sprimont, à la recherche de termes de l’argot militaire alors utilisé. L’auteur de ces mémoires en donnait aussi la définition : « Flotte ou Lignard, : soldat belge d’infanterie de ligne. Poilu : soldat français. Jampot : soldat anglais. Plouk : simple soldat. Piottepak : gendarme Plakpotte : soldat malpropre et débraillé. Ménapien : Flamand. Cabot : caporal. Premier bidon : 1er sergent-major. Adjupette, capiston et colon : adjudant, capitaine et colonel. Carapate : carabinier., Flingot : fusil. Rabat de col : mauvais morceau de viande. Chapeau boule ou pot de chambre : casque. Vîspaletots : soldats non armés des vieilles classes qui avaient gardé leurs anciennes tenues sombres datant de l’avant-guerre et ce jusqu’en 1917. Ils étaient affectés à certains travaux. Compagnie sans floche : compagnie de réhabilitation formée de soldats condamnés par les conseils de guerre et dont le bonnet de police était dépourvu de gland. » Merci à M. Marquet pour cette recherche.
|
|
|
Les « Hèyeûs d’ Sovenis » de l’A.R. D’Aywaille, Histoire et traditions de nos vallées, TIII, éd. Dricot, 2006
TOPONYMIE POPULAIRE Lu vîje Bèljike
Dans les années 20 et 30, dans la région de Ligneu-ville, qui avant la guerre 14-18 faisait encore partie de l’Allemagne, les gens, lorsqu’ils parlaient de leur nouvelle patrie, l’appelaient toujours « lu vîje Bèljike » par opposition aux pays rédimés, nouvellement rattachés, qu’ils nommaient « lu novèle Bèljike ».
(Propos d’Anna Lising recueillis par Marc Lamboray)
|
|
1914 |
Pawly R., Lierneux P., Courcelle P., The Belgian Army in World War I, Osprey Publishing, 2009
(p.9) The defence of Liège, August 1914
A few hours after the delivery of the reply to the German ultimatum the forces that had been massed on the frontier entered Belgium. During the morning of 4 August two cavalry divisions outflanked the fortified position of Liège on the north and arrived at Visé on the Meuse, but, finding the bridge broken and the passage guarded they withdrew towards their principal force, which was already standing before the advanced defences of the fortified city. General von Emmich had about 130,000 men and plentiful artillery; he expected that, faced with such a disproportionate force, Gen Leman would capitulate rather than make a useless attempt to defend Liège. When a German demand that Leman give passage to the Germans was rejected Emmich immediately proceeded to attack the forts of Chaudfontaine, Fleron, Evegnée, Barchon and Pontisse. Nine brigades stormed across the fields in between the different forts, but were everywhere repulsed with such heavy losses that several divisions were withdrawn into Germany; this spread such a panic that at Aachen (Aix-la-Chapelle) librarians started removing archives for safety. (p.10) German reinforcements were brought up in large numbers, and started an outflanking movement that threatened with encirclement the Belgian troops holding the intervals between the forts. These field units were compelled to withdraw; however, the forts themselves held on, the last only capitulating on 16 and 17 August after Forts Chaudfontaine and de Loncin had been destroyed with heavy loss of life by monstrous explosions when German shells penetrated the magazines. The German casualties outside Liège have been estimated at 42,712 men, but much more serions was the loss of precious time. The unexpected check suffered by the vanguard held up the invading army in enormous traffic jams; the overcrowding of roads and railways caused such confusion inside Germany that the whole army had to mark time for several days, which enabled the French Army to carry out itls mobilization and concentration. Even though their garrisons were doomed, the time it was costing the invaders to put the outdated fortresses out of action would hâve a real influence on the outcome of the 1914 campaign.
(p.18) /Diksmuide/ Germans scattered over the neighbouring meadows, and threatened their prisoners with death if they did not direct them towards the artillery batteries; no one spoke, and the Germans shot them down, Cdr Jeanniot of the fusiliers-marins dying at the hand of the German major. At break of day the Germans who were left were surrounded in batches; several fell under the bayonets of the infuriated soldiers, and four were convicted of murder and executed by the French admirals orders.
(p.19) Opening the sluices
Deliberate flooding was a classic defensive tactic in Flanders. These lowlands were reclaimed from the sea and the marshes, and are managed by a System of drainage and irrigation that dates back to the Middle Ages. To flood the ground covered by the German front lines it would be sufficient to open the sluices in Nieuport that gave access to the Beverdijk, and to close them again before the ebb tide. The System of canals and manually-operated sluice gates was complex, and the exact results depended upon the tides and winds. However, under the direction of one Louis Kogge, who had been in charge of the Beverdijk sluices for many years, ail necessary measures were taken, and from 27 October seawater began to mix with that of the canals. The flood oozed up on ail sides to suck down German guns, fill the trenches, and imprison in their strongpoints those defenders imprudently left in them by the German command (these isolated garrisons either surrendered one by one, or were drowned while trying to escape). Gradually the whole front between Nieuport and Dixmuide was covered, from the Yser westwards to the railway embankment.
|
|
1915 |
in : L’Illustration, n°3762, 10 avril 1915, p.363
Pierre Loti, Au grand quartier général belge
Me rendant au grand quartier général belge, où j’ai à m’acquitter d’une mission du président de la République française à Sa Majesté le roi Albert, je traverse aujourd’hui Furnes, autre ville inutilement sauvagement bombardée, où, à cette heure, le vent glace, la neige, la pluie, la grêle, font rage sous le ciel noir. Ici comme à Ypres, les barbares se sont acharnes surtout contre la partie historique, contre le vieil Hôtel de Ville charmant et ses entours; c’est qu’aussi le roi Albert, chasse de son palais, s’y était d’abord installé; alors les Allemands, avec cette délicatesse que le monde entier à présent ne leur conteste plus, avaient aussitôt repéré ce point-là pour y lancer leurs « marmites » féroces. Dans les rues (où je ralentis beaucoup l’allure de mon auto afin de mieux apprécier au passage « l’œuvre civilisatrice » du kaiser), presque personne, il va sans dire ; seulement des groupes de soldats de toutes armes qui, le col relevé, d’autres le capuchon rabattu, se hâtent sous les rafales, courent, comme des enfants, avec de bons rires, comme si c’était très drôle, cet arrosage, qui pour le moment n’est pas du feu. Comment se fait-il qu’aucune tristesse, cette fois, ne se dégage de cette ville à moitie déserte ? On dirait que la, gaieté de ces soldats, malgré le temps sinistre, se communique aux choses devastées. Et comme ils semblent tous de belle santé et de belle humeur! Je n’aperçois plus de ces mines un peu effarées, hagardes, du commencement de la guerre. La vie tout le temps dehors, jointe à la bonne nourriture, leur a dore les joues, à ces épargnes par la mitraille ; mais ce qui surtout les soutient, c’est la confiance entière, la certitude d’avoir dejà pris le dessus, et de marcher à la victoire. Il en va de l’invasion boche comme de cet affreux temps, qui n’est en somme qu’une dernière giboulée de mars: tout cela va finir! A un tournant, pendant une accalmie, un petit groupe de matelots français surgit, bien imprévu, devant moi. Je ne puis me tenir de leur faire signe, comme on ferait à des enfants que l’on retrouverait tout à coup, dans quelque lointaine brousse, et ils accourent à ma portière, tout contents eux aussi de voir un uniforme de notre marine. C’est à croire qu’on les a choisis, tant ils ont de braves et jolies figures. avec de bons yeux vifs. D’autres, qui passaient plus loin et que je n’avais pas appelés, viennent aussi m’entourer, comme si c’était tout naturel, mais avec une familiarité si respectueuse: à l’etranger, n’est-ce pas, et en temps de guerre !… C’est hier, me disent-ils, qu’ils sont arrives, tout un bataillon, avec des officiers, pour camper dans un village voisin, en attendant de foncer sur les Boches. Et j’aimerais tant faire un détour pour aller en visite chez eux, si je n’étais pressé par l’heure de l’audience royale! Certes j’ai du plaisir à me trouver avec nos soldats, mais bien plus encore avec nos matelots, au milieu desquels j’ai passe quarante années de ma vie. Avant même de les voir, ceux-là, rien qu’à les entendre parler, tout de suite je les devinerais. Plus d’une fois, sur nos routes militarisées du Nord, en pleine nuit noire, quand c’était un de leurs détachements qui m’arrêtait pour me demander le mot d’ordre, je les ai reconnus rien qu’au son de leur voix. Un de nos généraux, commandant d’armées sur le front Nord, m’en parlait hier, de cette gentille familiarité de bon aloi, qui règne à présent du haut en bas de l’échelle militaire, et qui est nouvelle, qui est une caractéristique de cette guerre profondément nationale, où tout le monde marche la main dans la main. « Aux tranchées, me disait-il, si je m’arrête à causer avec un soldat, d’autres m’entourent, pour que je cause aussi avec eux. Et ils sont de plus en plus admirables d’entrain et de fraternité! Si l’on pouvait nous rendre nos milliers de morts, quel bien les Allemands nous auraient fait, en nous rapprochant ainsi tous, jusqu’à n’avoir qu’un même cœur! » Longue route pour aller à ce grand quartier général. En rase campagne, il fait un temps épouvantable, il n’y a pas à dire. Chemins défonces, champs inondés qui ressemblent à des marécages, et parfois des tranchées, des chevaux de frise, rappelant que les barbares sont encore tout proches. Eh bien, quand même, tout cela, qui devrait être lugubre n’y parvient plus. Chaque rencontre de soldats — et on en fait à toute minute — suffirait du reste à vous rassérener: figures épanouie: toujours, qui respirent le courage et la gaieté. Même les pauvres sapeurs, dans l’eau jusqu’aux genoux, travaillant à réparer des trous d’abri ou des barrages, ont l’expression gaie, (…)… Que de soldats dans les moindres villages, belges et francais très fraternellement mêles! Par quels prodiges de l’intendance tous ces hommes sont-ils abrités et nourris?
Mais les soldats belges, qui donc prétendait qu’il n’en restait plus ! J’en croise au contraire des détachements considérables, marchant vers le front, bien en ordre, bien équipés et de belle allure, avec des convois d’une artillerie excellente et très moderne. On ne dira jamais assez l’heroïsme de ce peuple, qui aurait eu raison de ne pas se préparer aux batailles, puisque des traites solennels auraient dû l’en préserver à tout jamais, et qui au contraire vient de subir et d’arrêter le plus formidable attentat de la Grande Barbarie. Désemparé d’abord et presque anéanti, il se reprend, il se groupe autour de son roi, au courage sublime… Il pleut, il pleut, on est transi de froid. Nous voici enfin arrivés et dans un instant je vais le voir, ce roi qui est sans reproche comme sans peur. N’étaient ces troupes et tant d’autos militaires, on n’imaginerait jamais que ce village perdu puisse être le grand quartier général. Il faut descendre de voiture, car le chemin qui mène à la résidence royale n’est plus qu’un sentier. Parmi les rudes autos qui stationnent là, toutes maculées de la boue des campagnes, il en est une élégante, mais sans armoirie d’aucune sorte, seulement deux lettres tracées à la craie sur la portière noire: S. M. (Sa Majesté), — et c’est la sienne. Un coin charmant de vieille Flandre, une antique abbaye, entourée d’arbres et de tombes, — c’est là. Sous la pluie, dans le sentier qui borde le religieux petit cimetière, un aide de camp vient à ma rencontre, aimable et simple comme sans doute ne peut manquer d’être son souverain. A l’entrée de la demeure, pas de gardes, aucun cérémonial ; un modeste corridor, où j’ai juste le temps de jeter mon manteau, et, dans l’embrasure d’une porte qui s’ouvre, le roi m’apparaît, debout, grand, svelte, le visage régulier, l’air étonnamment jeune, les yeux francs, doux et nobles, la main tendue pour le bon accueil. Au cours de ma vie, d’autres rois ou empereurs ont bien voulu me recevoir, mais malgré l’apparat, malgré les palais parfois splendides, jamais encore comme au seuil de cette maisonnette, je n’avais éprouvé le respect de la majesté souveraine, — si infiniment agrandie ici par le malheur et le sacrifice… Et quand j’exprime ce sentiment au roi Albert, il me répond en souriant : « Oh ! mon palais à moi… » et il achève sa phrase par un geste détaché, designant le pauvre décor. Bien modeste, en effet, la salle où je viens d’entrer, mais, par l’absence de toute vulgarité, gardant de la distinction quand même; une bibliothèque bondée de livres occupe entièrement l’une des parois; au fond il y a un piano ouvert, avec un cahier de musique sur le pupitre; au milieu, une grande table est chargée de cartes, de plans stratégiques; et la fenêtre, ouverte malgré le froid, donne sur une sorte de vieux petit jardin de cure, presque enclos, effeuille, triste, qui semble pleurer de la pluie d’hiver. Après que je me suis acquitté de la facile mission dont m’avait chargé le président de la République, le roi veut bien me garder longtemps à causer. Mais, si je me suis déjà senti hésitant pour écrire le commencement de ces notes, je le suis tellement davantage pour toucher, si discrètement que ce soit, à cet entretien ; et alors, combien va sembler pâle ce que j’oserai en dire ! C ‘est qu’en effet je sais qu’il ne cesse de recommander à ceux qui l’entourent: « Surtout, tâchez que l’on ne parle pas de moi », et je connais, je comprends si bien l’horreur qu’il professe pour tout ce qui ressemble à une interview. J’étais donc d’abord décidé à me taire; — et cependant, lorsqu’on a quelque chance d’être entendu, comment ne pas vouloir, dans la faible mesure de ce que l’on peut, contribuer à répandre la gloire d’un tel nom! Ce qui frappe d’abord chez Lui, c’est tant de sincère et exquise modestie dans l’héroïsme, c’est cette presque inconscience d’avoir été admirable. La vénération que les Français lui ont vouée, sa popularité chez nous, il juge ne pas les mériter autant que le moindre de ses soldats tue pour notre commune défense. Quand je lui conte que j’ai vu, même au fond des campagnes chez des paysans, l’image du roi et de la reine des Belges à une place d’honneur, avec des petits drapeaux, noir, jaune et rouge, pieusement épinglés autour, il a l’air d’à peine y croire, son sourire et son silence semblent me répondre : c’est pourtant si naturel, ce que j’ai fait; est-ce qu’un roi digne de ce nom aurait pu agir d’une autre manière? Maintenant nous causons des Dardanelles, où se joue à cette heure une partie grave ; il veut bien me questionner sur les embûches de ces parages que j’ai longtemps fréquentés et qui n’ont cesse de m’être si chers. Mais tout à coup une plus froide rafale entre par cette fenêtre, toujours ouverte sur le petit jardin triste; avec quelle gentille sollicitude alors il se lève, comme eût pu faire un simple officier, pour fermer lui-même ces vitres près desquelles je suis assis. Et puis nous causons de guerre, de fusils, d’artillerie; Sa Majesté est au courant de tout, comme un général dejà rompu au métier… Etrange destinee de ce prince, qui, au début, ne semblait pas désigné pour le trône et qui peut-être eût préférécontinuer sa vie un peu retirée de jadis, auprès de la princesse qu’il aimait! Quand ensuite la couronne inattendue fut posée sur son jeune front, il pouvait se croire en droit d’espérer une ère de profonde paix, au milieu du plus paisible des peuples, et au contraire, il aura connu le plus épouvantablement tragique de tous les règnes. Du jour au lendemain, sans une défaillance, sans même une hésitation, dédaigneux des compromis qui, pour un temps au moins, auraient pu, au préjudice de la civilisation mondiale, préserver un peu ses villes et ses palais, il s’est dressé, devant la ruée du Monstre, comme un grand roi guerrier, au milieu d’une armée de heros.
Aujourd’hui, visiblement, Il ne doute plus de la victoire, et sa loyauté lui donne confiance entière en la loyauté des Alliés, qui certes voudront rendre la vie à sa Belgique ; cependant il tient à ce que ses soldats coopèrent, de toutes leurs dernières forces, à la délivrance, et qu’ils restent jusqu’à la fin au danger et à l’honneur. Saluons-le bien bas! Un moins noble que lui se fût dit peut-être: « J’ai largement payé ma dette à la cause universelle ; ce sont mes troupes qui ont élevé le premier rempart contre la barbarie ; mon pays, piétiné le premier par les brutes allemandes, n’est plus qu’un champ de ruines ; cela suffit! » — Mais non, il veut que la Belgique ait son nom inscrit, à une page encore plus belle, à côte de la Serbie, sur le livre d’or de l’histoire. Et voilà pourquoi j’ai rencontré, en venant, ces précieuses troupes, alertes et fraîches, renouvelées à miracle, qui s’en allaient au front, continuer la sainte lutte. Devant Lui, inclinons-nous donc jusqu’à terre! La nuit tombe quand l’audience est close et que je me retrouve dans le sentier de l’abbaye. Pendant le trajet de retour, à travers ces routes défoncées par la pluie, défoncées par les charrois militaires, je reste sous le charme de l’accueil. Et je compare ces deux souverains situés pour ainsi dire aux deux pôles de l’humanité, celui d’ici au pôle lumineux, l’autre au pôle noir; — l’autre, là-bas, le bouffi d’hypocrisie et de morgue, monstre parmi les montres, qui a du sang plein les mains. de la chair dechirée plein les ongles, et qui ose encore s’entourer d’une pompe insolente; — celui d’ici, relégué sans murmure dans une maisonnette de village, sur un dernier lambeau de son royaume martyr, mais vers qui monte, de toute la Terre civilisée, le concert des sympathies, des enthousiasmes, des glorifications magnifiques, et qu’attendent les plus pures et immortelles couronnes.
pierre loti. (Copyright in United States of America by the New-York American.)
|
|
1917 |
Pawly R., Lierneux P., Courcelle P., The Belgian Army in World War I, Osprey Publishing, 2009
THE BELGIAN AIR FORCE
(p.39) On 4 May 1917 a daring mission was flown by Henri Crombez and Louis Robin from 6th Sqn, who flew deep behind enemy lines to drop a Belgian flag over occupied Brussels. Another famous flight was made by Ring Albert, who on 6 July 1917 was taken over the front in a Sopwith-Strutter in order to observe the situation for himself – thus becoming almost certainly the only reigning monarch in the world ever to fly a military combat mission. That month the small Aviation Militaire was putting up an average of 120 sorties each day.
|
1918 |
Adrien Herman, Wellin jadis 1795-1950, 2001
(p.143-144) Les Allemands partis sans autre retard, le village se croyait libéré. Il l’était, mais de ses ennemis seulement. Il ne l’était pas de ses amis. Dès le 25 novembre, il se remplit d’Italiens. Le hasard voulut que les localités du canton fussent occupées par la 89eme division d’infanterie du général Albricci, venant du front de France où elle avait été envoyée symboliquement. Laissons la plume à un témoin. «On aurait pu dire d’eux; qu’en qualité d’amis, ils étaient polis, propres, peu gênants. Ce fut tout le contraire: salir, abîmer, détruire furent leur principale occupation, de sorte qu’ils causèrent réellement plus de dégâts que leurs devanciers » (2). Ces alliés encombrants demeurèrent une dizaine de semaines à Wellin et environs. Les gradés jouaient leur solde au baccara ou à la canasta et ne se préoccupaient guère de discipline. Tous s’en allèrent vers le 15 février 1919, non sans avoir élevé à leur propre gloire un petit monument fait de vieilles pierres, portant une plaque commémorative de leur passage, rue du Tribois, près de la voie du tram. |
|
1918 |
Pawly R., Lierneux P., Courcelle P., The Belgian Army in World War I, Osprey Publishing, 2009
LIBERATION / 1918
(p.35) On 17 April, after the kind of short but violent artillery preparation that they employed throughout the spring offensive, three German infantry divisions attacked near Merkem down the axis of a road towards Poperinghe; three more waited in the second line close to the Houthulst Forest, while a seventh was in rear reserve. The front-line units advanced quickly, with an apparent contempt for any dangers that might threaten their right wing. The first Belgian outposts near the road were swept away or submerged, but stubborn hand-to-hand fighting then delayed the enemy’s march. By noon the Germans had reached the Belgian support line, but there they were stopped by the Belgian artillery playing on both their assault elements and their reserves. The decisive moment came when Belgian infantry advanced from their support trenches, and began to recapture lost ground behind a moving barrage. Caught between barrages in front and behind, the German units wavered – the formations assigned to Operation ‘Georgette’ were not storm troops but tired ‘trench divisions’. Battalions broke, and the fighting degenerated into a number of smaller local battles. By 8pm the Belgians had recovered ail the lost ground and taken more than 800 prisoners; the Belgian Army had shown that it could play its part in offensive operations as well as holding trenches. (Marshal Foch, the generalissimo of the western Allies, visited Belgian GHQ on 23 May, and in King Albert’s presence conferred decorations on officers and men who had distinguished themselves in this battle of Merkem.)
|
|
1914 |
Deux soldats wallons sous la tour de l’ Yser, AL 16/05/1986
(dans le bulletin trimestriel d’ information des « Amis du Musée international de la guerre 1939-1945, de la Resistance et des camps de concentration) « C’est le général Georges De Bruyn qui a raconte qu’ il avait connu intimement ces deux Wallons au Boyau de la Mort, en 1917 et 18. Il les a d’ ailleurs vu mourir à ses pieds. »
|
|
1914 |
Christian Laporte, Le Roi-Chevalier, LB 16/07/2005
L’armée belge résista vaillament, dans la mesure de ses possibilités, encouragée en permanence par la présence à ses côtes du roi Albert. Celui-ci refusa obstinément d’abandonner ses soldats. Et pourtant les alliés français et ang1ais n’avaient pas manqué de le lui suggérer dès le mois d’octobre 1914, Mais Albert leur fit répondre qu’il resterait avec les siens et conserverait « le commandement de l’armée belge, quel que soit son effectif. (…) chef de l’armée be1ge, il resta avec ses troupes sur le dernier lambeau de terre nationale encore libre derrière l’Yser mais veilla surtout en permanence aux interêts de ses hommes. A plusieurs reprises, il parvint à éviter des pertes mutiles en refusant l’engagement des soldats belges dans certaines opérations de l’etat-major français. (…) Le Roi profita de cette solidarité belgo-belge pour demander aussi une meilleure égalité entre les deux principales langues nationales. Il était temps que les Flamands puissent être administrés totalement dans leur langue. Et cela devait se traduire aussi dans l’enseignement, jusques et y compris au niveau universitaire. Il s’engagerait ainsi pour la flamandisation de l’Université de Gand en 1930.
Toujours, à l’époque romaine, on recrute en Wallonie les soldats de la légion l’Alouette dont j’ai vu 1es tombes en Lybie où ils veillaient sur les frontières africaines de l’Empire. (…) Notre manteau de laine à capuchon sera adopté dans tout l’Empire romain, et en Wallonie, un agriculteur inconnu mettra au point une extraordinaire moissonneuse mécanique.
II Des énergies neuves
Les Templiers libèrent les serfs et les transforment en travailleurs libres dans leur neuf mille commanderies, ces vastes domaines ruraux. (…) La commune engendre une bourgeoisie politique dont Jacques van Artevelde est un des représentants les plus typiques. Homme du carrefour belge, il en renforce la cohésion par les accords qu’il conclut avec le Hainaut et le Brabant pour faciliter la circulation des marchands et améliorer le rythme des affaires. Le carrefour belge s’ouvre aussi largement sur ce Marché commun du Moyen Age qu’est la Hanse teutonique où Bruges et bientôt Anvers jouent un rôle important. (…) Deux dates capitales dans l’histoire du carrefour belge : 1288 et 1302. En 1288, dans la plaine de Worringen, Jean Ier, duc de Brabant, repousse la minamise des seigneurs germaniques sur les accès de notre pays vers le Rhin et il fera ainsi la prospérité de Bruxelles si bien située su la chaussée reliant l’Allemagne aux ports de la me du Nord et donc au trafic vers l’Angleterre. En 1302, devant Courtrai les milices commuales ecartent l’emprise française sur les issues de notre carrefour s’ouvrant sur l’Ouest et le Sud. (…) La bataille des Eperons d’Or a des aspects sociaux incontestables : elle affirme la puissance de la bourgeoisie au détriment de celle de la noblesse. Aussitôt connue à Bruxelles et à Liège la victoire de Courtrai, on voit les artisans, les représentants des métiers exiger une plus importante participation à la gestion de leur cité.» (…) « … : l’art belge du Moyen Age se compose d’influences innombrables que capte ce carrefour qu’est notre pays. » « Les sept rues aboutissant à la Grand-Place mènent aux sept portes de la ville et elles s’ouvrent sur des routes conduisant à tous les pays d’Europe. » « Un sentiment national se forge dans le creuset d’une nouvelle institution créée en 1465 : les Etats Généraux. » « La trame du tissu national qui se noue ainsi se révélera solide et combien résistante quand, après la mort du Téméraire, Louis XI lancera ses troupes à la curée d’une Belgique qu’il avait tente de diviser politiquement au préalable, car il n’y a rien de neuf … »
Les pétrodollars
« Luther lance la Réforme. En spoliant l’Eglise de ses biens, elle enrichit les féodaux allemands au moment où l’or affluant d’Amérique crée de nouvelles richesses mobilières qui risquent de submerger la puissance que comtes et barons devaient à leur revenus immobiliers. Grâce à Luther, ils pourront, en raliant la réforme et en dépouillant l’Eglise de ses terres, de ses villages, de ses fermes, accroître leur patrimoine menace par les « pétrodollars » en version du 16e siècle. L’opération séduit plus d’un aristocrate belge. Elle explique leur politique hostile à Philippe II. L’attitude du Taciturne, d’Egmont, de Hornes est celle de féodaux jaloux d’une nouvelle bourgeoisie d’affaires brassant l’or américain qui stimule et alimente tant d’entreprises en Belgique et fait la prospérité des remuants et dynamiques parvenus d’Anvers. »
III Les temps modernes
« De 1794 à 1814, nous voilà Français -non sans liguer contre nos occupants républicains les paysans de Flandre, du Brabant et de Wallonie qui leur livrèrent une guerre comparable à celle de Vendée. La chouannerie belge eut ses moments de gloire et ses rudes héros. »
Ce que les Belges firent ensemble (Jo Gérard) – Résister à Jules César. – Participer à l’essor de l’empire de Charlemagne. – Participer aux croisades. – Conclure, au XlVe siècle, des ententes entre la Flandre, le Brabant, le Hainaut. – Participer à la Ligue Hanséatique. – Créer au XIVE siècle, l’admirable Chartreuse de Champmol. – Créer l’Ecole de peinture belge du XVIe et au XVIIe siècles. – Fonder New York au XVIIe siècle. – Faire la révolution de 1789 contre Joseph Il et fonder la République des Etats-Belgiques Unis. – Faire la guerre des paysans en 1797-1798 contre les républicains français. – Faire ensemble 1830. – Créer ensemble la médecine tropicale au Congo dès 1883. – Construire des chemins de fer en Chine, la ville d’Héliopolis en Egypte, électrifier la Russie, créer des usines en Bulgarie, ouvrir des mines en Floride, équiper quinze pays de tramways. – Défendre la Belgique en 1914-18 et en 1940. – Développer et civiliser le Congo. – Mais encore : des artistes wallons, flamande et bruxellois embellirent Versailles au temps de Louis XIV et travaillèrent ensemble pour Napoléon. – Flamands, Wallons, Bruxellois luttèrent pour Pie IX sous l’uniforme des Zouaves pontificaux et pour Charlotte, impératrice du Mexique dans la Légion belge. – Deux millions de Belges ont des ascendants wallons et flamands. – C’est, parmi d’autres, le cas du celèbre Juriste Edmond Picard et du grand romancier Camille Lemonnier.
|
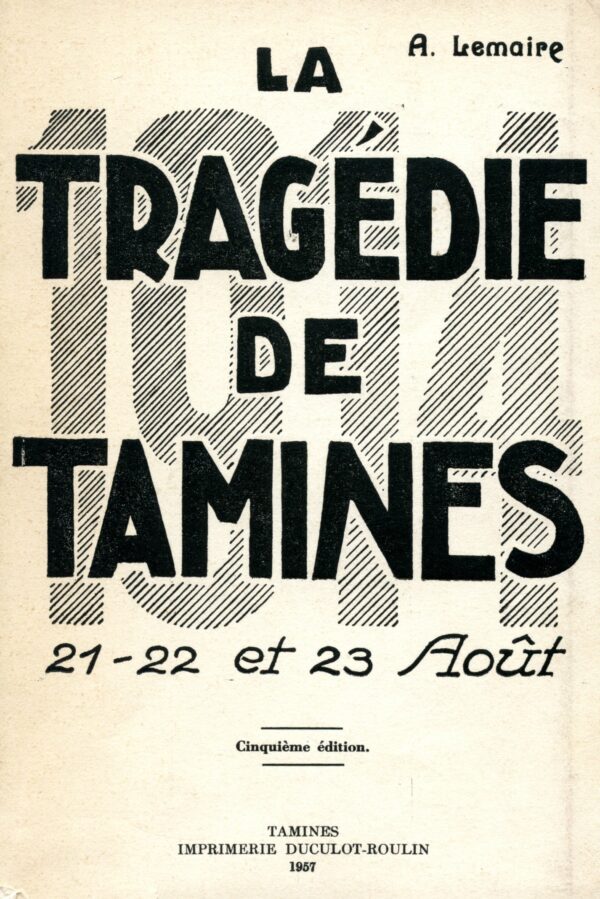
12-23 août / La Tragédie de Tamines: la barbarie à son sommet
(A. Lemaire, Impr. Duculot, Tamines, 1957)
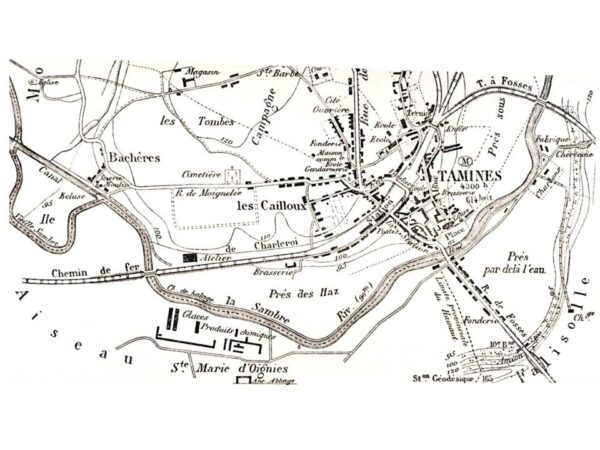

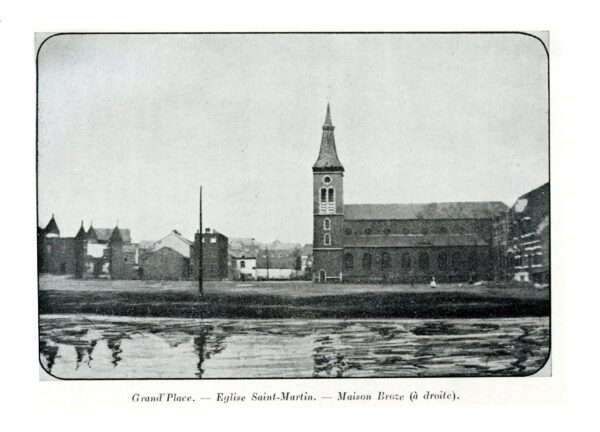

A. Lemaire, La tragédie de Tamines, 21-22 et 23 août, Tamines, Impr. Duculot-Roulin, 1957
TABLE DES MATIERES
avant-propos
PREMIERE PARTIE
- — L’arrivée des Allemands …… 9
- — Bataille de la Sambre…………………………………. 13
III Tamines en feu. Le sort do la population .. 18
IV _ A l’église des Alloux……………………………. . 32
- — Le cortège……………………………………………………. 38
- — La fusillade……………………………………………. 43
VIL — L’achèvement des blessés …. 50
VIII. — La nuit du 22 et la matinée du 23…….. 73
- — Les civils réfugiés chez les Frères………… 83
- — L’enterrement des fusillés et le départ pour Velaine 92
- — Au lendemain de la tragédie. L’exhumation des morts 99
XII. — Les responsabilités …….. 108
DEUXIEME PARTIE: Les témoignages.
- — Déposition de M. Franz Steinier …. 123
IL — » M. Adolphe Seron………………… 130
III — » M. Emile Leroy………………. 140
IV — » M. Louis Lardinois…………….. 143
- — » M. Franz Van Heuckeloom 146
- — » M. François Lavis ….. 150
VIL — » M. Lucien Lardinois………………………. 152
VIII. — » M. Henri Joret…………………………… 158
- — » M. Louis Lorette …………………………….. 160
- — » M. le chanoine Crousse …. 166
XL — » R. Frère Victor Frippiat …. 172
XII. t— Extrait de la relation de M. l’avocat Goffin 176
XIII — Déposition de l’autrichien Graf . . . 181
XIV— Réponse de M. Fcrnand Gillieaux………. 185
- — Lettre du Feldwebel-Leutnant Weber………. 187
Les victimes 189
(p.9) PREMIERE PARTIE
LA TRAGEDIE
CHAPITRE PREMIER L’arrivée des Allemands
Tamines est une importante agglomération de 5,800 habitants (1), située sur la Sambre, à mi-chemin entre Namur et Charleroi. La pente de la colline sur laquelle elle est bâtie l’incline doucement vers la rivière qui l’encercle. L’activité de sa population, industrielle, commerciale et agricole, la régularité de ses rues et l’élégance de ses maisons lui donnent l’aspect d’une petite ville.
Les habitants distinguent trois quartiers principaux; La Praile et Les Alloux au nord, Saint-Martin dans la vallée (2). Ces deux dernières divisions ont donné naissance aux paroisses du même nom.
Une grande route, allant de Ligny, au nord, vers Fali-solle, au sud, traverse l’agglomération de part en part et prend successivement les noms de rue de Velaine, rue de l’Hôtel de Ville (actuellement Avenue Roosevelt), rue Centrale (actuellement rue Roi Albert), rue de la Station et, rue de Falisolle (actuellement Avenue des Français). Le pont de la Sambre, dont la possession fut disputée avec
- En 1957, 8050 habitants.
- Un quatrième quartier a été créé aux Bachères en 1948; il compte, en 1957, environ l000 habitants.
(p.10) tant d’acharnement, relie la rue de la Station à la rue de Palisolle et domine la place Saint-Martin, où la tragédie devait se dérouler.
Les Allemands arrivèrent à Tamines le vendredi 21 août 1914. Dès six heures du matin, une patrouille de quelques cavaliers descendait de Velaine-sur-Sambre par la route de Ligny, et s’avançait jusqu’à proximité de l’Hôtel de Ville. Là, elle fut reçue à coups de fusil par les soldats français, qui, au nombre de trente-cinq, constituaient avec vingt artilleurs de la Garde Civique de Charleroi, les avant-postes de l’armée de défense. Dans cette escarmouche du début, un cavalier allemand fut abattu, blessé légèrement à la jambe, et fait prisonnier par la garde civique de Charleroi. Les autres tournèrent bride et s’enfuirent dans la direction de Velaine.
Vers sept heures du matin, une nouvelle reconnaissance, comptant une vingtaine d’hommes, cavaliers et cyclistes, s’avança de nouveau par la route de Ligny, et fut arrêtée près de l’Hôtel de Ville par le feu des Français. Un cycliste fut blessé grièvement au ventre et ne put s’enfuir avec les autres.
Dans l’entretemps, des détachements de fantassins et de cavaliers allemands étaient arrivés au quartier de la Praile. Là, ils font prisonniers une cinquantaine de civils, hommes, femmes et enfants, et les entassent dans la maison de M. Mouffe, conseiller communal suppléant, chez qui ils installent aussi un poste de Croix-Rouge. Déjà alors, ils menaçaient les hommes de les fusiller, sous prétexte que leurs concitoyens tiraient sur les soldats.
Vers huit heures, ils désignent quelques civils, pour aller recueillir le cycliste blessé. Les hommes se mettent en route, précédant un détachement d’une trentaine de soldats. Arrivés près du charbonnage Sainte-Barbe, ils trouvent (p.11) le blessé dans une briqueterie voisine et l’emportent à bras. Mais, auparavant, les Allemands leur font tenir le milieu du chemin, pendant qu’ils échangent des coups de feu avec les soldats français.
Tout en regagnant leur point de départ, ils tirent au hasard à travers les rues, dans les portes et dans les fenêtres. Parvenus près de l’église des Alloux, ils pénètrent dans une maison, s’emparent d’un sommier de lit et y étendent le blessé que les civils transportent chez M. Mouffe.
A l’intersection du Baty Sainte-Barbe et de la rue de Velaine, le détachement prend en enfilade la rue à droite et à gauche, tuant une fillette de huit ans (Céline Huybrecht) et blessant un homme (Alphonse Van Griecken) ainsi qu’une jeune fille de dix-sept ans (Louise Hubeau).
En outre, dans la matinée, ils incendièrent six ou sept maisons de la Praile et trois maisons de la rue de Velaine. Ils en saccagèrent en même temps plusieurs autres.
Les habitants de la section de la Praile étaient toujours retenus prisonniers chez M. Mouffe ; le commandant allemand, sous menace de fusiller les hommes, exigea la présence du bourgmestre et d’un médecin. Il délégua plusieurs personnes chez le premier magistrat de la commune. M. Guiot, faisant fonctions de bourgmestre, avait pris la fuite dès le matin. A son défaut, la responsabilité incombait au premier échevin, M. Lalieu, docteur en médecine, qui, pressenti par M. Emile Duculot, conseiller communal, accepta d’abord, puis pratiquement refusa de se rendre au devant des Allemands.
Alors, M. Duculot, accompagné du docteur Defosse, de M. Ferauge, président de la Croix-Rouge, et de quelques brancardiers prit sur lui d’affronter le danger. A la Praile, M. Duculot et M. le Dr Defosse s’arrêtèrent devant l’officier ; il tenait le milieu de la route et était porteur d’une (p.12) carte de l’Etat-major et de jumelles de campagne. Il posa la question: « Qui est le bourgmestre? ». M. Duculot répondit que le bourgmestre étant parti, il se présentait à sa place. « Les civils ont tiré sur nous », déclara l’officier. M. Duculot protesta avec énergie, soutenant que l’autorité communale avait fait placarder des affiches pour obliger les habitants à déposer leurs armes à la Maison communale, que le public était averti qu’on ne pouvait poser aucun acte d’hostilité contre les belligérants, et que l’affirmation de l’officier était invraisemblable. Celui-ci dit alors que les soldats avaient déjà pris trois revolvers, mais il ne les montra pas.
L’officier pria M. le D1‘ Defosse de soigner le blessé qui se trouvait chez M. Mouffe. M. Duculot accompagna le médecin. Tandis qu’on pansait le blessé, le commandant fit appeler « le conseiller » et lui demanda jusqu’où les soldats pouvaient s’avancer sans danger. M. Duculot répondit qu’il lui était impossible de satisfaire à cette question, car les Français pouvaient se déplacer à tout moment (1). Devant l’insistance du chef allemand, M. Duculot, d’un geste montrant la route, dit: « Voyez vous-même: la route est libre aussi loin qu’on peut voir, jusqu’à l’église des Alloux ».
Au clocher flottait encore le drapeau belge. Ordre est donné aussitôt au Conseiller de conduire à la tour un peloton d’une quinzaine de soldats, qui reçoit mission de faire disparaître notre emblème national. « Si les civils, dit l’officier, tirent sur les soldats, les soldats tireront sur vous ».
(1) Il est à remarquer que les Allemands savaient que les Français étaient près de l’Hôtel de Ville, puisqu’il y avait eu combat entre eux et les deux « reconnaissances ». M. Duculot ne révélait donc pas aux ennemis la présence des Français. La question était, de savoir s’il était possible aux soldats de procéder à l’enlèvement du drapeau belge qui flottait au clocher de l’église des Alloux.
(p.13) Aux Alloux, M. le Curé vint lui-même ouvrir la porte de l’église ; un soldat monta au clocher et ne parvint pas à détacher le drapeau. De retour près de l’officier, le sergent qui était à la tête du peloton, rendit compte de l’insuccès de sa mission, et M. Duculot fut chargé de faire retirer du clocher l’emblème national, car, ajouta le commandant, « par ordre supérieur, les couleurs doivent disparaître ; sinon la lourde artillerie détruira le clocher ». Sur cette menace, les otages furent remis en liberté et, en signe d’adieu, le chef serra la main au Conseiller.
Celui-ci, en descendant la rue pour regagner sa demeure, recommanda une fois encore à la population de rester calme et de rentrer chez elle ; il avertit M. le Curé du danger que courait le clocher de son église et promit de lui envoyer un ardoisier pour enlever le drapeau ; en passant devant la Maison communale, il mit l’adjudant français au courant de l’emplacement et du nombre des Allemands: il pouvait y avoir à cet endroit une cinquantaine de cavaliers, et une centaine de fantassins.
CHAPITRE II La Bataille de la Sambre
A ce moment du récit, il n’est pas inutile de rappeler que les Français, qui avaient fait leur apparition dans le pays de Charleroi le dimanche 16 août, n’avaient traversé la Sambre que le 17, en route vers le Nord. A cette date, en effet, plusieurs régiments de cavalerie avaient passé la rivière, et, poussant leur pointe, avaient laissé derrière eux
(p.14) Farciennes, Tamines, Auvelais. A partir de ce moment, la gare de Tamines fut affectée au ravitaillement de ces troupes. Environ 70 camions-automobiles venaient y prendre des vivres pour les distribuer aux hommes qui opéraient dans la région. Un poste de télégraphie sans fil avait été installé sur la place Saint-Martin. D’autre part, un détachement de la garde-civique de Charleroi, appartenant au corps spécial de l’artillerie et commandé par M. Fernand Gillieaux, occupait la commune depuis le début des hostilités (1).
Dès le jeudi matin, il devint évident que les Français, renseignés sans doute sur les masses énormes qui allaient s’abattre en avalanche sur eux, avaient décidé leur mouvement de retraite, et que leur objectif était, en sacrifiant le moins d’hommes possible, de retarder la marche de Fennemi. En effet, ce même jour au matin, le poste de télégraphie sans fil était démonté, les camions-automobiles quittaient Tamines, prenant la route du Sud, par Aiseau. Le personnel affecté aux divers services et les soldats de garde s’éloignaient dans la même direction. Dans la journée, quelques détachements d’infanterie, de concert avec les gardes civiques de Charleroi, occupaient différents points de la localité, notamment le pont de la Sambre et les abords de la Maison communale.
On a vu plus haut que, le lendemain vendredi, des rencontres partielles, comme des tâtonnemsnts, avaient eu lieu déjà: le moment n’était pas éloigné, où les armées devaient en venir aux mains pour la possession du passage de la Sambre.
Vers une heure de l’après-midi, un groupe de cavaliers allemands qui battait la campagne, fut accueilli à coups de
(1) Lire dans la deuxième partie le rapport intéressant de M. l’avocat Goffin.
(p.15) Farciennes, Tamines, Auvelais. A partir de ce moment, la gare de Tamines fut affectée au ravitaillement de ces troupes. Environ 70 camions-automobiles venaient y prendre des vivres pour les distribuer aux hommes qui opéraient dans la région. Un poste de télégraphie sans fil avait été installé sur la place Saint-Martin. D’autre part, un détachement de la garde-civique de Charleroi, appartenant au corps spécial de l’artillerie et commandé par M. Fernand Gillieaux, occupait la commune depuis le début des hostilités (1).
Dès le jeudi matin, il devint évident que les Français, renseignés sans doute sur les masses énormes qui allaient s’abattre en avalanche sur eux, avaient décidé leur mouvement de retraite, et que leur objectif était, en sacrifiant le moins d’hommes possible, de retarder la marche de Fennemi. En effet, ce même jour au matin, le poste de télégraphie sans fil était démonté, les camions-automobiles quittaient Tamines, prenant la route du Sud, par Aiseau. Le personnel affecté aux divers services et les soldats de garde s’éloignaient dans la même direction. Dans la journée, quelques détachements d’infanterie, de concert avec les gardes civiques de Charleroi, occupaient différents points de la localité, notamment le pont de la Sambre et les abords de la Maison communale.
On a vu plus haut que, le lendemain vendredi, des rencontres partielles, comme des tâtonnemsnts, avaient eu lieu déjà: le moment n’était pas éloigné, où les armées devaient en venir aux mains pour la possession du passage de la Sambre.
Vers une heure de l’après-midi, un groupe de cavaliers allemands qui battait la campagne, fut accueilli à coups de
(1) Lire dans la deuxième partie le rapport intéressant de M. l’avocat Goffin.
(p.16) velle établie sur Amion, ils pouvaient surveiller à la fois les rivages du charbonnage de Falisolle par où les Allemands affluaient, et la rive de la Sambre. Le pont dégagé, les Allemands le franchirent rapidement et envahirent, au delà, toutes les maisons de la rue de Falisolle. Ils forcèrent les hommes habitant cette rue à marcher devant eux pour leur servir de bouclier. Dès qu’ils furent arrivés à une centaine de mètres au delà du pont, en face de la fonderie Gilot, les Français ouvrirent le feu. Cinq civils furent blessés: l’un d’eux, Georges Devillez, mourut dans la nuit. La bataille continua avec acharnement pendant l’après-midi ; mais, le soir tombant, les Allemands rétrogradèrent et repassèrent la Sambre en emportant leurs blessés.
Sans discontinuer, ils affluaient dans la commune: les maisons étaient bondées de soldats prêts à marcher à l’assaut définitif du passage de la Sambre.
Vers deux heures du matin, le signal fut donné et les Allemands, en rangs serrés, traversaient à nouveau le pont. Les Français les laissèrent s’avancer assez loin dans la rue de Falisolle, puis, estimant que le moment favorable était venu, ils déchargèrent avec une fougue toute française fusils et mitrailleuses et infligèrent à leurs ennemis des pertes assez sensibles. Le combat se déroula sans doute avec des alternatives d’avance et de recul, car un séminariste soldat, M. Maxime Bourrée, blessé sur la route de Falisolle et soigné à Charleroi, raconta que les Français prononcèrent une attaque à la baïonnette et refoulèrent momentanément les Allemands au delà du pont. La lutte fut acharnée et longue: après la furie de la reprise, elle se ralentit pour recommencer de plus belle puis se relâcher encore; mais on peut dire qu’elle se prolongea jusqu’à 2 heures de l’après-midi, quand les Français, vaincus, se replièrent vers le Sud, et ne s’arrêtèrent plus qu’à de rares (p.17) intervalles, pour faire face à l’Allemand et plus tard lui porter le coup décisif de la Marne.
A Tamines, les Français, comme partout sur la Sambre, étaient notablement inférieurs en nombre et en armement. Débordés de tous côtés par les Allemands qui avaient franchi la rivière en aval et en amont de Tamines et se concentraient pour les enfermer dans un cercle de fer, ils opposèrent à l’ennemi une résistance opiniâtre, d’autant plus héroïque que leur infériorité numérique les obligeait à reculer plus tôt. Néanmoins ils tinrent tête à l’adversaire depuis le vendredi matin jusqu’au samedi après-midi, ralentissant d’autant sa marche foudroyante vers la France.
Les pertes des Allemands, sur la route de Falisolle, doivent avoir été considérables: l’imagination populaire, il convient de le constater, s’est plu à en exagérer le chiffre. En supposant qu’ils aient, comme on le prétend, fait mystérieusement disparaître leurs morts, il reste que l’ambulance de la Croix-Rouge, établie chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, occupée jusqu’au dernier lit, hébergeait, dès le samedi à 8 h. du soir, environ 150 soldats blessés, et que l’église Saint-Martin, transformée en hôpital, en contenait un très grand nombre. De là, à conclure que les Allemands, sur le pont de la Sambre et la route de Falisolle, ont perdu 2.000 à 3.000 hommes, il y a de la marge. Le chiffre de leurs hommes mis hors de combat ne dépasse pas 600. Au témoignage d’un officier, le 77e a été très éprouvé.
On conserve pieusement à Tamines le souvenir du soldat français Pierre Lefèvre qui, sur la route de Falisolle, un peu en dessous de la villa Herpin, a fait preuve d’une héroïque bravoure et a brûlé sa dernière cartouche, avant d’être blessé à mort.
(p.18)
CHAPITRE III
Tamines en feu. Le sort de la population
Pendant que se déroulaient ces événements, qu’était devenue la population taminoise?
On a vu plus haut qu’à leur apparition dans le village, le premier soin des Allemands avait été de s’emparer d’une partie de la population civile, et, en la retenant prisonnière, de s’en faire à la fois un gage et un bouclier. Au cours de leurs opérations, ils avaient placé devant leurs troupes, comme un rideau, un certain nombre de civils, et les avaient obligés à leur servir de guides et à déblayer les passages encombrés.
A cette vue, au spectacle surtout des incendies que les Allemands allumaient sans raison, des hommes et des femmes, des familles entières, traînant par la main de petits enfants, emportant des hardes prises au hasard, avaient, dans une course folle, commencé à s’enfuir du quartier des Alloux dans la direction de Falisolle et d’Aiseau. C’est vers dix heures du matin, le vendredi, que l’incendie des maisons Thibaut avait donné le signal du départ. Les fuyards qui, à cette heure-là, descendirent vers la Sambre furent arrêtés par les patrouilles françaises. Quelques-uns, malgré tout, réussirent à forcer la consigne, et franchirent le pont. Les autres se répandirent dans le bas du village, dans les maisons hospitalières d’amis et de connaissances.
Vers cinq heures de l’après-midi, les Allemands arrivent en masse près du café Hennion, situé au coin de la Place Saint-Martin, et, hurlant comme des sauvages, obligent, sous la menace, les habitants à leur ouvrir la porte. Brandissant (p.19) le fusil ou le revolver, ils réquisitionnent en deux fois tout le pétrole, afin de mettre le feu aux maisons d’alentour. M. Hennion, ayant demandé qu’on rapporte sa cruche, est mis en joue par les incendiaires. Quelque temps après, ils reviennent en grand nombre et exigent que l’on prépare des lits pour leurs blessés: vite, ils organisent dans toute l’habitation une rigoureuse perquisition, puis s’emparent des couches et les placent dans le café qu’ils transforment ainsi en ambulance de combat. Tandis que les uns sont occupés à ce travail — la nuit était déjà bien avancée — les autres s’approchent de M. Hennion et l’obligent à les conduire chez le Bourgmestre. Le cafetier fait observer qu’il est malade: il n’importe; ils le chassent devant eux avec brutalité et, le poussant dehors avec M. Léchât, chef de gare de Mazy, ils forcent ces deux hommes à les précéder chez M. Guiot.
Cependant, au fort de la bataille, les Allemands estimant sans doute que leurs blessés, exposés, dans l’estaminet, aux projectiles dirigés vers le pont, n’étaient plus en sûreté, évacuent cette ambulance provisoire ; ils amènent dans la salle du café cinq femmes, cinq enfants et dix hommes qu’ils ont recueillis deci-delà et qu’ils retiennent prisonniers. Ces pauvres gens assistèrent, jusque tard dans la nuit, aux effrayantes péripéties de la bataille et, au milieu du fracas des obus qui éclataient et des balles qui ricochaient ou s’écrasaient contre les murs, ils attendaient dans une angoisse inexprimable le moment suprême de la mort.
Mais voici qu’une accalmie se produit: les Allemands en profitent pour faire sortir les civils et, soi-disant, les éloigner du danger. Il pouvait être deux heures du matin. Les dix hommes doivent partir les premiers: un à un, ils sont forcés de quitter le café. A peine apparaissent-ils dehors que des soldats les abattent à coups de fusil: ils (p.20) s’affalent dès le seuil et tombent les uns sur les autres, morts. Huit hommes ont déjà été fusillés, lorsqu’arrive le tour du sieur Ducoffre de franchir le seuil de la maison. Une balle l’atteint à la cuisse, alors qu’il est encore dans le tambour de l’entrée. Il tombe. Le traînant dehors avec l’intention de l’achever, son meurtrier lui enfonce à quatre reprises la baïonnette dans le dos, et le laisse pour mort. Mais tout à coup, une alerte éclate: les soldats s’enfuient ou se dissimulent contre les murs. Ducoffre, qui n’a pas perdu sa présence d’esprit, profite de cette alarme pour se soustraire à la rage de ses bourreaux et, au prix de peines inouïes, parvient à se traîner jusqu’à l’ambulance des Frères (1). Restait Lechat.
L’infortuné, on ne sait trop comment, était rentré seul de la corvée chez le Bourgmestre et avait laissé Hennion à la merci des Allemands. Tandis que les neuf hommes qui le précédaient subissaient leur triste sort, il s’était blotti derrière les femmes et les enfants, espérant ainsi échapper au massacre. Malheureusement, lorsque les Allemands vidèrent la maison pour y mettre le feu, le dernier qui fermait le cortège s’aperçut de la présence de Léchât parmi les femmes et le fusilla à bout portant. Les femmes et les enfants, remis en liberté, se dirigèrent affolés vers le Tienne Devillez.
Les Allemands incendièrent le café Hennion: des débris enflammés tombèrent sur les cadavres et les carbonisèrent.
Quant à Hennion, on ignore le supplice que les Allemands lui réservèrent. Que firent-ils de lui, lorsque, arrivés chez le Bourgmestre, ils constatèrent que ce dernier s’était enfui? A quelles tortures fut-il soumis et pendant combien de temps? Ce que l’on sait, c’est qu’il ne revint plus chez
(1) Ducoffre est mort en janvier 1917.
(p.21) lui et qu’on le retrouva mort entre l’ancien cimetière et la maison Loriaux, les mains liées d’un fil de fer: il avait été fusillé.
Au moment de leur tentative nouvelle pour passer le pont — tentative qui leur coûta beaucoup d’hommes — les Allemands mirent le feu systématiquement à la plupart des maisons situées dans le fond de la vallée: c’est ainsi que la rue Centrale, la rue de la Station, la Place Saint-Martin, la rue de Falisolle furent livrées aux flammes dans la seconde partie de la nuit du vendredi. Les habitants, chassés par le feu, suffoqués par la fumée, poussés brutalement hors de chez eux, tombèrent dans les mains des Allemands qui les attendaient dans la rue.
Il est impossible de narrer toutes les scènes d’horreur qui se déroulèrent dans les maisons et dans les caves à l’occasion des incendies allumés par les Allemands: chaque famille subit un martyre épouvantable, que la plume se refuse à décrire. Le drame le plus affreux est sans contredit celui qui se passa dans la cave du « bazar Mombeek », rue de la Station, à droite en descendant.
Là, pour se mettre à l’abri des projectiles, s’étaient réfugiées douze personnes, appartenant aux familles Mombeek, Jaumain et Seghin. Dans la nuit du vendredi, les maisons avoisinantes avaient déjà pris feu et l’immeuble Mombeek ne devait pas tarder à devenir la proie des flammes: les Allemands ayant répandu, dans les appartements, du pétrole en abondance, une étincelle avait suffi pour transformer le « bazar » en un immense brasier. Dès lors, la cave où se cachaient les douze réfugiés n’offrait plus qu’un asile incertain.
Plusieurs, sur la demande de M. L. Jaumain, s’ils avaient l’intention de s’enfuir ou de mourir dans cet abri, répondirent (p.22) qu’ils préféraient attendre la mort là que d’aller la trouver ailleurs.
Le danger menaçait de plus en plus. M. Jaumain, alors, proposa de se retirer dans la cave à charbon, située à l’angle de la rue de la Station et- du sentier Trimosy. C’est là, dans ce réduit de quatre mètres carrés à peine, à moitié rempli de charbon gras, que les douze personnes attendirent la mort. Madame Jaumain pria sa mère, Madame Mombeek, qui parlait leur langue, de venir avec elle implorer la pitié des Allemands. « Ça, jamais de la vie, dit-elle, tu ne connais pas les Prussiens ; je te plains, toi et tes enfants, si tu dois un jour les supporter. » En présence de cette obstination, il fallut se résigner à subir le danger jusqu’au bout. Serrés les uns contre les autres, ils ne pouvaient presque pas se remuer et à peine respirer. Pour comble de malheur, le soupirail était fermé par une tôle perforée, à travers laquelle on apercevait bien ce qui se passait au dehors, mais que l’on ne pouvait pas ouvrir, cadenassée qu’elle était à l’extérieur. Que faire? Pas d’issue: le feu, d’une part, et le soupirail hermétiquement fermé, d’autre part, empêchaient toute évasion de cette horrible prison.
A quelques mètres de là, on distinguait dans le sentier, debout près d’une bicyclette, un soldat allemand qui faisait le guet. L’appeler au secours? M. Jaumain recommande à tous d’observer un grand silence et de respirer le plus possible par le nez. Malgré le soin qu’il avait pris de boucher l3s fissures qui communiquaient avec l’intérieur de la maison, la fumée de l’incendie envahissait peu à peu le réduit et augmentait de minute en minute la difficulté de respirer ; de plus la chaleur devenait intense.
Tout à coup la servante de M. Jaumain, Augusta Bauwin, lance cet effroyable cri: « Je brûle !» — « Mais comment? » demande M. Jaumain. — « Il tombe des gouttes sur ma (p.23) tête ! » Ayant tâté le plafond qui n’avait rien de chaud ni d’humide, M. Jaumain répondit: «C’est impossible! » — Le plafond était formé d’une taque triangulaire en fonte qui, en rejoignant la voûte, laissait un espace libre par où le liquide bouillant — probablement de l’eau — avait pu couler. Soudain Elmire Lefèvre, servante de Madame Se-ghin, profère la même épouvantable plainte, puis immédiatement après, Camille Seghin se tord en hurlant de douleur, sous l’impression d’atroces brûlures. En même temps, on sentait comme une odeur d’acide carbonique: le liquide bouillant, en tombant sur le charbon gras, développait peut-être déjà le gaz terrible qui devait asphyxier cinq victimes. Dans cette situation, c’était pour tous la mort immédiate. M. Jaumain prépare à l’affreuse réalité ses compagnons d’infortune: « Nous devons tous mourir, faisons donc vite notre acte de contrition ».
« Des adieux touchants et des embrassements intimes et affectueux qu’on ne connaît qu’alors et qu’on ne saurait traduire, ainsi continue M. Jaumain, s’échangent entre nous tous. Voulant étreindre pour la dernière fois mon fils » Marcel, qui se trouvait sous moi, j’éprouve soudain une atroce sensation de brûlure à la main droite, puis à la jambe droite, au contact du charbon qui se gazéifiait. En » proie aux plus vives douleurs et voulant y mettre un terme, je crie à tous de se jeter à la renverse avec la bouche ouverte, pour être asphyxiés instantanément. Entretemps, que de cris de douleur, que de plaintes déchirantes dans ces angoissantes tortures ! Nous attendions donc la mort dans cette position, mais, comme elle n’arrivait pas assez vite, je me redressai violemment » comme un fou et passai sur les corps de ma courageuse belle-mère et de notre servante pour m’élancer au-dehors y par l’escalier, afin de faire sauter le cadenas qui nous (p.24) retenait prisonniers. Hélas ! je ne pus atteindre ce but. Me sentant réellement cuire à la figure et aux pieds, dans » la fournaise de cet incendie où je ne pouvais plus res-» pirer, je rebroussai chemin en courant vers la cave à charbon. Mais en franchissant de nouveau le seuil de ce » réduit que je croyais devoir être notre tombe commune, » j’eus l’heureuse inspiration de dire à ma femme: Anna, crie au secours en allemand! ». Tout de suite, elle se ren-» dit à ma demande, en spécifiant qu’elle était d’Aix-la-Chapelle. Le soldat qui stationnait en face du soupirail, répondit que nous étions bien là, que nous n’avions qu’à y rester et que nous n’en avions pas encore assez. Malgré » toutes les supplications, le vaurien disparut sans nous » prêter secours. Le feu avait alors gagné la porte, et les » vêtements de ma regrettée belle-mère flambaient déjà sous les regards de ma femme, impuissante à fléchir le bourreau.
Un autre soldat, moins inhumain, survint en entendant les appels désespérés de ma femme. A l’aide de sa baïonnette et d’un outil qu’il prit dans la pochette du vélo, il fit sauter la serrure, et la porte du soupirail s’ouvrit. » Georges Seghin sortit le premier, et exprima au soldat sa gratitude: celui-ci s’en allait sans rien dire quand ma femme, libérée à son tour, courut le remercier. Il n’eut •a pour toute réponse que ces mots: « Pauvres gens ! ».
Je passai immédiatement ma petite Marguerite, puis après mes fils Marcel et Maurice. Le contact de l’air libre fut pour eux comme une résurrection, car ils ne bougeaient plus et aussitôt dehors ils remuèrent et revinrent à la vie. A mon tour, je sortis et, me retournant, je vis des bras tendus au milieu de l’épaisse fumée qui fuyait » par le soupirail: je reconnus mon beau-père. Dans la rue, ce n’étaient plus qu’obus et balles qui éclataient et (p.25) sifflaient de tous côtés. Ma femme m’appelait en disant: « Viens vite, Léon, tu vas te faire tuer ». Je répondis: « II faut que je retire ton père. Dis à Georges » (Seghin) de venir m’aider ». A grand’peine nous le tirâmes » dehors, mais force nous fut de le laisser étendu sur le pavé. Les autres personnes ne donnaient plus signe de vie. »
Abandonnant dans le réduit les cinq victimes qui étaient déjà mortes et dont l’incendie devait carboniser les corps, les rescapés s’enfuirent comme ils purent. M. Léon Jaumain souffrait atrocement de ses brûlures et son fils Maurice était devenu aveugle. Depuis il a recouvré la vue. M. Mombeek, qu’il avait fallu laisser étendu dans la rue de la Station, eut malgré tout la force de se traîner à l’écart; il fut recueilli quelque temps après, puis transporté à Moignelée où il mourut le mardi suivant des suites de ses brûlures.
Le calvaire de la famille Jaumain, qui fut, avec des péripéties variées, celui de beaucoup de Taminois, dépasse, en souffrances physiques et morales, tout ce que l’on peut imaginer.
Séparé de sa femme et de ses enfants qui prirent la fuite de leur côté, M. Jaumain fut d’abord dirigé vers l’ambulance des Frères où il fut soigné tant bien que mal et où il fut l’objet des soupçons et des menaces des soldats furieux. Incapable de marcher, tout couvert de brûlures, à la figure, aux mains, aux jambes et aux pieds, il fut conduit sur une brouette jusqu’à la Place Saint-Martin, où se déroulaient les derniers mais effrayants épisodes de la tragédie et où il pensa être passé par les armes ; puis enfin, on le transporta en voiture à Fleurus: il n’eut la certitude d’échapper à la mort que lorsqu’il fut arrivé chez M. le Vicaire de cette localité, où il fut accueilli à (p.26) bras ouverts et reçut les soins que réclamait son état. Sa famille avait réussi à atteindre Moignelée.
Dans la rue de la Station, quatre jeunes gens de moins de vingt ans furent aussi carbonisés dans la maison de Madame veuve Fernémont. Il plane sur ce drame un mystère qu’il n’a pas été possible d’éclaircir. Ces quatre jeunes gens: Rousselle Hubert, Glime Alidor, Laviolette Sylvain, Demeffe Octave, furent faits prisonniers avec Léon Bodart, boucher ; on les vit encore descendre sous escorte la rue de la Station, où ils furent maltraités et battus. On les retrouva ensuite: Léon Bodard blessé à mort dans la rue de la Station, par une balle dans le ventre, les quatre autres carbonisés, dans la cave de Madame Fernémont. Que s’est-il passé? Les jeunes gens sont-ils parvenus à s’échapper des griffes de leurs bourreaux et à se réfugier dans la cave où, malgré tout, une mort terrible les attendait? Ou bien, hypothèse assez peu vraisemblable, les Allemands les ont-ils massacrés dans la rue et de là, pour laisser passage libre à leurs troupes, jetés dans la cave où on les retrouva? On ne le saura jamais. Le mardi suivant, leurs corps carbonisés, presque entièrement recouverts de briques et de décombres, furent retirés de la cave. Ils étaient méconnaissables. Ils gisaient les uns sur les autres: on aurait dit que ces jeunes gens s’étaient embrassés dans la mort.
C’est le moment de raconter ici l’épouvantable malheur qui s’abattit sur la famille Devillez, habitant rue de Falisolle.
Le vendredi, entre 4 et 5 h. de l’après-midi, les Allemands, qui venaient de passer le pont, s’emparèrent de M. Hubert Devillez et de son fils Georges, âgé de 17 ans. Ils les placèrent devant leurs rangs, avec d’autres habitants de la même rue, et se cachèrent derrière eux — bouclier humain — pour faire le coup de feu contre les Français.
(p.27) Ceux-ci attendirent la troisième salve avant de riposter. M. Hubert Devillez fut alors atteint légèrement, tandis que Georges recevait à la jambe une grave blessure qui, faute de soins, devint rapidement mortelle. Transporté d’abord chez des voisins, puis chez lui, il fut étendu sur un matelas dans une chambre du rez-de-chaussée: la perte ininterrompue du sang précipita le dénouement. Vers 3 heures du matin il rendait le dernier soupir, tandis que les Allemands, armés de haches et munis de petites boîtes incendiaires, ayant brisé portes et fenêtres, faisaient irruption dans la maison et allumaient l’incendie dans les appartements. Une à une, systématiquement, les chambres sont livrées aux flammes. Ils pénètrent dans celle où le jeune homme agonisait et constatent que la mort est sur le point d’accomplir son œuvre: que leur importe? Ils rassemblent, au centre de la pièce, les meubles auxquels ils mettent le feu, puis montent à l’étage: là, était étendue sur son lit, impotente et demi-morte de frayeur, la vieille Madame Thiry âgée de 89 ans. Rien n’arrête les incendiaires ; ils déposent leurs boîtes à essence sous les meubles qu’ils ont entassés au milieu de la chambre, mettent le feu et s’en vont.
L’incendie dévora la maison et carbonisa la grand’mère et le petit-fils: Madame Devillez ne retrouva plus de sa mère et de son fils que des restes qui n’avaient plus forme humaine.
Elle devait souffrir davantage encore.
Dans l’après-midi de ce samedi, les survivants de la famille, y compris M. Hubert Devillez qui avait été blessé la veille devant les troupes allemandes, furent conduits en face de l’église Saint-Martin et forcés de prendre part, spectateurs ou victimes, à l’assassinat de la fusillade: M. Hubert Devillez et son fils Robert, âgé de treize ans, furent (p.28)
joints aux hommes qui venaient des Alloux et tous deux trouvèrent la mort dans le massacre.
Quant à Madame Devillez, qui venait d’être témoin déjà de l’incendie de sa maison, de la mort de son fils Georges et de celle de sa propre mère, elle dut encore assister, impuissante, à l’épouvantable tragédie, où périrent son mari et le plus jeune de ses fils.
Parmi les habitants que l’incendie ou la perquisition brutale chassait de leurs maisons, une partie furent capturés dans la rue par les Allemands.
Lorsqu’ils arrivaient dans la rue, les gardes, l’arme au poing, la figure congestionnée, les yeux sortants des orbites, vociféraient des injures et des menaces: plus morts que vifs, bousculés et impuissants, les malheureux se laissaient mener au gré de la soldatesque.
D’autres eurent la chance en s’échappant par leur jardin, de n’être pas aperçus ; ils s’enfuirent affolés dans les campagnes et gagnèrent les villages voisins: hommes, femmes, enfants couraient à travers champs ou par les chemins détournés, se couchant pour offrir moins de prise aux balles qui pleuvaient autour d’eux.
Firmin Glime, que l’incendie avait chassé de son abri, rue de la Station, vers 3 heures du matin, s’en allait par la rue de l’Industrie chercher un autre refuge. Il portait dans ses bras sa petite nièce, âgée de quatre ans: il se trouvait ainsi dans l’impossibilité matérielle de faire le moindre mal aux Allemands. Survient de la gare un soldat qui lui tire un coup de fusil et l’atteint. Le projectile lui fracasse la mâchoire, brise deux doigts de sa main droite et, à la façon d’une balle dum-dum, blesse par ses éclats l’enfant au bras gauche et à la jambe.
Vers 5 heures du matin, treize personnes, quittant Ta-mines, s’enfuyaient vers Moignelée par la rue de Fleurus.
(p.29) Il y avait, dans ce groupe, deux femmes et deux enfants ; Joseph Ledoux conduisait dans une brouette J.-B. Cobut, son beau-père impotent, âgé de 83 ans. Des soldats, postés le long de la même rue et disséminés dans les champs, s’aperçurent de l’exode des fuyards et, sport ou chasse au gibier d’un nouveau genre, s’amusèrent à faire feu dans le tas. Sur treize, douze furent atteints: il y eut sept tués et cinq blessés. Une famille étrangère, composée du père autrichien, de la mère allemande et de deux enfants, ne fut pas plus épargnée que les autres: tous les quatre furent touchés. Etaient-ce des francs-tireurs? Reconnaissant qu’ils avaient blessé des amis, les Allemands recueillirent ces quatre personnes et les soignèrent dans leur ambulance. Cinq heures après ce massacre, Sébastien Ledoux, étendu sur la route et perdant son sang, implorait encore du secours. De loin, on entendait ses gémissements et ses appels; mais comment se risquer à sortir? Si l’on faisait mine de paraître au dehors, les soldats épaulaient leur fusil et recommençaient à tirer. L’infortuné Ledoux, abandonné sans soins, ne tarda pas à agoniser et à mourir.
Ces cas ne sont pas isolés: dans des circonstances identiques, quatorze Taminois furent tués et cinq blessés, sans compter les enfants. Cinq femmes se trouvent parmi ces dix-neuf victimes. Un grand nombre d’autres fuyards entendirent siffler à leurs oreilles les balles que les soldats leur destinaient, mais, par bonheur, ne furent pas atteints.
Il est possible que l’un ou l’autre fugitif ait été blessé par un projectile perdu, la bataille faisant rage, mais il est hors de doute que les Allemands tiraient sans pitié sur tous ceux qu’ils voyaient fuir, et qu’ils ont ainsi volontairement tué ces Taminois dans les campagnes (1).
(1) Voir dans la liste des victimes les noms des tués et blessés dans les campagnes.
(p.30) Dans quelques circonstances particulières, ils poussèrent la sauvagerie jusqu’à l’extrême: ce fut surtout le cas pour Félicien Istasse, Alphonse Couvreur et Jean Claes qu’ils fusillèrent dans leur propre maison.
Entre 9 et 10 h. du matin de ce fatal samedi, plusieurs soldats, hurlant comme des forcenés, vinrent frapper à coups de crosse de fusil à la porte de Félicien Istasse, ardoisier, rue de Velaine. Il était avec sa famille, dans sa cave, attendant que la tempête de fer et de feu se fût apaisée. Il avait pris sur lui tout l’argent et toutes les valeurs qu’il possédait. Au bruit infernal des coups qui ébranlaient la porte, Istasse remonta seul pour ouvrir aux soldats. Il dit: «Entrez!». Mais à peine a-t-il prononcé cette parole, que deux coups de revolver éclatent et le corps de l’ardoisier, les bras en croix, la tête percée de deux balles, s’effondre sur le seuil. Les brutes dépouillent le cadavre, pénètrent dans la maison et la mettent à sac: les vitres volent en éclats, les meubles du rez-de-chaussée et de l’étage sont jetés par les fenêtres ; les armoires sont vidées; les pillards s’emparent de bouteilles de liqueurs dont ils avalent le contenu avec avidité. Le revolver au poing, ils descendent à la cave et y trouvent demi-morte de frayeur, la famille de leur victime. Ils invectivent Madame Istasse, qu’ils s’apprêtaient peut-être à fusiller aussi, lorsque la vue des enfants parut les adoucir. Après ce bel exploit, ils quittèrent la maison. Dans le cours de cette journée, d’autres soldats revinrent avec l’intention de piller à nouveau la maison. Ils assouvirent leur rage sur le cadavre, car, en l’inhumant, on trouva qu’il avait le ventre et les jambes percés d’une dizaine de coups de baïonnette.
(p.31) Mais il est temps de revenir aux prisonniers.
Disons d’abord que toute la population de la section des Cailloux fut massée près du Calvaire et, par bonheur, dirigée sur Moignelée par le chemin des Tombes; pour la plupart, ces fugitifs restèrent à Moignelée où ils ne furent pas molestés.
Quant aux premiers captifs que les Allemands avaient recueillis dans le bas du village au moment des incendies, ils furent rassemblés à la Maison communale, puis conduits au quartier de la Praile pour être relégués dans un champ de betteraves.
Là, se trouvaient déjà réunis depuis le matin quelques civils et aussi des femmes que les Allemands avaient prises à l’église des Alloux tandis qu’elles priaient.
De nouveaux prisonniers venaient sans cesse s’ajouter aux premiers, si bien que le champ de betteraves finit par ressembler à un vaste campement.
Quel était le but des Allemands en massant là cette foule, si tôt dans la matinée et pendant toute la journée? Ils avaient installé à la Praile une ambulance militaire et, derrière cette ambulance, était établie leur artillerie. Etait-ce pour se protéger par ce rideau de civils contre les projectiles? Beaucoup de Taminois le pensent.
- l’abbé Hottlet, curé des Alloux, M. l’abbé Donnet, son vicaire, les Religieuses des Alloux furent aussi conduits là et restèrent exposés au tir des Français. M. le curé portait avec lui les Saintes Espèces: il donna aux paroissiens de Tamines, en pleine campagne, la bénédiction du Saint-Sacrement et l’absolution générale.
Tous ces incidents se déroulaient dans le cadre effrayant des incendies et de la bataille: les projectiles éclataient de toutes parts, brisant vitres et toits, enfonçant des pans de murs ; le feu réduisait en cendres les habitations de ces (p.32) malheureux. Qu’on imagine l’angoisse des hommes, les pleurs des femmes, la terreur des enfants: ces procédés d’arrestation et de brutalité devaient durer depuis deux heures et demie du matin jusqu’à sept heures du soir!
Plus tard, au commencement de l’après-midi, toute cette foule fut conduite dans une prairie située à l’intersection de la rue de Velaine et du Baty Saint-Pierre. Pendant ce temps, l’artillerie et l’infanterie déniaient sans interruption.
Au fur et à mesure qu’ils arrivaient, les civils étaient fouillés et parfois même volés, puis versés dans le groupe qui grossissait toujours. Afin de rassurer la population et de la rassembler sans difficulté, les Allemands donnèrent pour prétexte de ces arrestations la nécessité de mettre les civils à l’abri des projectiles.
CHAPITRE IV A l’église des Alloux
Vers 4 heures, on dirigea cette multitude vers l’église des Alloux. Près du Baty Saint-Pierre, les gardes firent arrêter le groupe, et l’autrichien Graf, qui s’était fait l’interprète des Allemands, adressa la parole aux prisonniers. Il leur demanda s’ils promettaient de ne plus tirer sur les soldats. Les Taminois répondirent qu’ils n’avaient pas tiré et ajoutèrent qu’ils faisaient volontiers la promesse de ne pas poser d’acte contraire aux coutumes de la guerre. Graf leur dit alors qu’ils allaient être conduits à l’église, qu’ils y seraient (p.33) en sûreté sous la sauvegarde des Allemands et que, vers six ou sept heures, ils seraient remis en liberté: cette nouvelle les rassura.
Cependant, de toutes parts, on voyait arriver les familles que l’incendie avait chassées de leurs maisons et que les soldats avaient contraintes à suivre le chemin de l’église.
Ces pauvres gens, à moitié vêtus, les cheveux en désordre, la terreur peinte sur leur visage, obéissaient, la mort dans l’âme, aux injonctions des gardiens.
Les rues qui convergent vers l’église étaient grouillantes d’une foule en mouvement, cortège désordonné à la merci de ses bourreaux.
Aveuglément, sans soupçonner l’horrible tragédie dont ils allaient être victimes, hommes, femmes et enfants s’acheminaient vers l’édifice et y entraient confiants. Plusieurs même y vinrent de leur plein gré ; gagnés par cette contagion qui prend les foules moutonnières, il couraient à l’église comme au refuge assuré qui les tiendrait à couvert du danger; il leur semblait, puisque la rumeur en circulait, que, là du moins, ils échapperaient au malheur suprême qui, cependant, à leur insu les guettait, impitoyable.
Quelques Allemands entretenaient ce sentiment de sécurité: peut-être les simples soldats ignoraient-ils les intentions de leurs chefs ; sinon, n’auraient-ils pas favorisé l’évasion de leurs prisonniers? On aimerait à le croire, mais les faits qui se sont déroulés ne permettent pas de leur faire ce crédit. Interrogés sur le but de ces rassemblements, les soldats donnaient les réponses les plus contradictoires: les uns insinuaient qu’il fallait protéger la population contre le bombardement « français » ; d’autres déclaraient qu’on allait anéantir la ville par l’artillerie ; enfin quelques cyniques plaisants assuraient qu’on allait chanter un salut pour obtenir la paix.
(p.34) Le bruit courait aussi que les hommes étaient convoqués pour enterrer les soldats tués. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, un Allemand fit irruption chez Firmin Sevrin, le sommant d’avoir à se joindre à ses concitoyens, afin de creuser des tranchées ; manchot, il ne pouvait aider efficacement à ce travail. Son beau-père, J.-B. Gilbert, chez qui il habitait et qui, à ce moment, se reposait sur son lit, fut invité par sa femme à remplacer son gendre et se dirigea, pour son malheur, vers l’église des Alloux. Il arriva au moment de la formation du cortège dans lequel il fut forcé de prendre rang: la mort l’attendait sur la Place Saint-Martin.
Pour un motif ou pour un autre, les Taminois, de plus en plus nombreux, arrivaient de confiance.
En entrant dans l’église, on regardait autour de soi pour reconnaître les visages amis et chacun se dirigeait vers le groupe qui avait ses sympathies. Les uns étaient assis et mangeaient à leur aise, les autres causaient sans contrainte; on se communiquait ses impressions qui ne laissaient pas d’être lugubres, on donnait libre cours à ses regrets sur les dégâts des incendies, on se perdait en conjonctures sur les mobiles de ce rassemblement; et, bien qu’on fût sous le coup d’un sentiment d’effroi, car à deux pas de l’église deux maisons brûlaient encore, on ne soupçonnait pas le sort épouvantable qui attendait les hommes.
Toutefois, un vague pressentiment semble s’être emparé de plusieurs qui se confessèrent même à cette occasion: ne fallait-il pas se préparer à toute éventualité ?
Pendant ce temps, la foule affluait toujours ; on entendait les cris des enfants qui avaient faim et soif; et plusieurs grandes personnes, arrêtées à l’improviste, n’avaient eu ni le temps de manger ni la présence d’esprit d’apporter des provisions. Les soldats, pris de pitié sans doute, arrivèrent (p.35) avec des liqueurs, des caisses de raisins secs, des bonbons, des biscuits, qu’ils avaient dérobés dans les magasins de Tamines, et qu’ils distribuaient à tous et surtout aux petits. Débordé par les enfants qui saisissaient eux-mêmes des biscuits dans la caisse, un soldat jeta celle-ci par terre et piétina les biscuits ; en même temps, il tirait un coup de revolver pour effrayer les gens.
Cependant M. le Curé, accompagné d’un Allemand, parcourait les nefs, ouvrait les confessionnaux et montrait ainsi qu’aucune personne suspecte ne se tenait cachée.
Vers six heures, l’édifice étant décidément trop petit pour contenir cette foule qui ne cessait de croître, M. le Vicaire Donnet transmit aux femmes et aux enfants l’ordre de sortir et de se rendre à l’école des Sœurs en face de l’église. Seules, les femmes qui étaient venues les dernières et occupaient la moitié du lieu saint, du côté du portail, obéirent.
A six heures et demie, l’église est tellement bondée que les hommes eux-mêmes sont de force dirigés vers l’école. Quelques-uns y vont spontanément. Ici, l’anxiété est à son comble: l’affluence et le désordre de cette cohue mettent dans les esprits plus que de l’incertitude; on n’est pas loin de soupçonner un malheur.
Celui qui aurait noué bout à bout les indices provenant des paroles équivoques de certains gradés et de leurs procédés à l’égard de la population, aurait certainement deviné que les Allemands ne méditaient rien de bon.
Mais quel Belge eût jamais pensé que des hommes fussent capables des actes de cruauté dont le prélude s’achevait?
- Henri Joret raconte, dans sa déclaration écrite, cet incident caractéristique:
« Un fait qui avait retenu mon attention s’était produit (p.36) vers dix heures du matin — M. Joret avait été conduit i la Praile, près de la briqueterie de M. Mouffe, dès quatre heures et demie du matin —: « Le service de la Croix-Rouge » étant revenu avec bon nombre de blessés allemands, je fis remarquer à M. Franz Denys que le chef paraissait » bien fâché. Nous en eûmes bientôt l’explication. Sitôt le » dernier blessé rentré, l’officier revint vers nous et, nous apostrophant, nous dit — en jouant de son revolver —: » Ce sont les civils qui ont tiré sur nos soldats ! » Nous nous récriâmes: « Non, non! » et, faisant signe de la main pour faire taire ces cris, il nous dit: « Si, si, si, je connais » ça. C’était notre arrêt de mort qu’il venait de prononcer » et qui, transmis à l’état-major, allait être exécuté dans la soirée. »
Pendant la seconde partie de la détention dans l’église, un sergent étant entré en discussion avec un prisonnier qui connaissait la langue allemande, affirmait: Die Zivilisten haben geschossen. (Les civils ont tiré.) A quoi M. Louis Lardinois, qui passait, répondit: Das ist nicht möglich; alle Flinten waren auf dem Stadthaus. (Ce n’est pas possible ; tous les fusils étaient à l’Hôtel de Ville.)
Après avoir été blessé, comme on l’a vu plus haut, Fir-min Glime fut, pour la seconde fois, chassé de la cave où il s’était réfugié et forcé, avec sa mère et sa petite nièce, de prendre le chemin de l’église. Au moment d’entrer, Mme Glime pria les soldats qui surveillaient la rue, d’autoriser Firmin à se rendre à la Croix-Rouge. Mais, l’un d’eux, s’aidant du geste pour se faire comprendre, prétendit qu’il avait reçu sa blessure en tirant sur les soldats et qu’il était franc-tireur. Pour toute réponse, on lui montra la petite blessée qui, elle, n’avait certes pas fait le coup de feu; (p.37) mais l’Allemand, furieux, poussa les malheureux à l’église en les menaçant de sa baïonnette.
En outre, lorsque les soldats présents à l’église étaient appelés à s’exprimer sur le compte des prêtres, ils ne pouvaient le faire sans entrer dans une violente colère ; ils les exécraient, les accablaient de quolibets insultants, juraient qu’ils les pendraient ; il les qualifiaient de Erzspitzbuben (coquins fieffés). Ils les considéraient comme les organisateurs de la guerre de francs-tireurs et les chefs de la « population révoltée ».
Ce devaient être là les sentiments de ce sous-officier qui pénétra dans l’église, quelque temps avant la formation du cortège. Hors de lui, la face congestionnée, écumant de rage, il hurlait des menaces, dont, à défaut de comprendre le sens, les Taminois devinaient la portée, à la fureur des gestes qui les accompagnaient. Apostrophant M. le Curé, il redoublait d’invectives. Deux compagnies de soldats avaient été tuées par les civils, et c’était lui, le Curé, qui était responsable, criait-il. Terrifié et impuissant, M. le Curé, qui n’entendait pas l’allemand, appela alors par son prénom quelqu’un qui connaissait la langue. Son appel resta sans réponse.
Si l’on avait connu les intentions des Allemands, on eût pu recourir à une médiation. Mais une médiation, à laquelle personne ne songea, eût-elle réussi à prévenir l’épouvantable catastrophe?
(p.38) CHAPITRE V Le cortège
Entre sept heures et sept heures et demie du soir, un cri retentit dans l’église et dans l’école: « Tous les hommes dehors ! ».
Alors commença, dans une indescriptible confusion, la séparation des hommes d’avec les femmes et les enfants. Ce fut une scène navrante. Dans une étreinte suprême, pères, mères et enfants se faisaient des recommandations et, dans les larmes, pour la dernière fois peut-être, s’embrassaient.
« Tous les hommes dehors ! » Où donc allait-on les conduire, les hommes ? L’ordre était donné, il était exécuté cruellement. Et, comme pressés d’en finir, les soldats les arrachent de leurs enfants et de leurs femmes, et les poussent dehors. Plusieurs furent chassés loin des bras qui, suppliants, se tendaient vers eux. Un suprême regard, profond comme un adieu sans espoir, fut pour beaucoup l’unique marque de tendresse qu’ils purent échanger en se quittant.
Bien qu’on fût loin de deviner la vérité, le cadre effrayant des incendies et de la bataille dans lequel ces malheureux avaient passé la nuit du vendredi et la journée du samedi, la brutalité des soldats dont presque tous, déjà, avaient été victimes, la chasse à l’homme à laquelle ils avaient assisté dans les campagnes et les jardins, tout cela faisait naître dans leur âme un sinistre pressentiment.
Deux ou trois vieillards exceptés, qui eurent la chance de passer inaperçus parmi les femmes, tous sortirent de l’église et de l’école: le vieux J.-B. Clément, malade, incapable de marcher, pria M. le Curé d’intercéder pour lui près des (p.39) soldats allemands. L’un d’eux se laissa fléchir et permit au vieillard de rester.
On les rangea par quatre le long de l’église jusque dans la rue de Velaine. Ils pouvaient être au nombre de cinq cents.
Parmi eux se trouvaient plusieurs adolescents de treize et de quinze ans, ainsi que des vieillards de plus de quatre-vingts ans: avaient-ils, ceux-là aussi, commis quelques méfaits contre l’armée allemande?
Un jeune officier, revolver au poing, donna le signal du départ ; à ce moment, le château de M. Liesens, sur la route de Moignelée, commençait à flamber.
Le lugubre cortège se dirigea par la rue de Velaine, la rue de l’Hôtel de Ville, la rue Centrale et la rue de la Station, vers la place Saint-Martin. Les Taminois étaient flanqués de deux cordons de fantassins échelonnés de cinq en cinq mètres, armés de fusils, baïonnette au canon, et de quelques cyclistes allant et venant, tels des chiens de berger le long d’un troupeau.
Durant la marche, quelques hommes se risquèrent à demander aux soldats le but de tout ceci: « C’est pour vous faire prendre l’air, on suffoque dans l’église. » D’autres se croyaient réquisitionnés pour relever les soldats dans le creusement des tranchées. Certains encore ont cru qu’ils allaient préparer des fosses pour les victimes du combat. Uans un autre groupe, M. Fernand Michaux et ses compagnons se voyaient déjà placés en rideau devant les troupes en marche contre les Français. Mais la bataille était terminée. Personne ne soupçonnait que c’était une longue procession de condamnés à mort qui défilait: condamnés sans délit, sans interrogatoire, sans justice. On y pensait si peu que M. Franz Steinier, resté chez lui avec quelques (p.40) soldats qui s’étaient fait servir copieusement à boire, courut pour rejoindre le cortège, alors qu’il aurait pu se cacher dans sa maison ou s’enfuir vers Moignelée.
En face de la maison de M. Moreau, un officier qui marchait le long de la colonne aperçut deux jeunes gens mêlés aux hommes, Jules et Lucien Lardinois, âgés respectivement de treize et de quinze ans, et il leur dit; « Les enfants hors des rangs! ». Ils obéirent, et se disposaient à retourner à l’église, lorsqu’un peu plus haut un soldat les fit rentrer en ligne. Ils reprirent cette fois la queue du cortège, la route qui menait au théâtre du drame.
A quelques centaines de mètres de l’église, stationnaient des soldats isolés qui semblaient appartenir à l’artillerie, et, de fait, formaient l’arrière-garde d’un convoi de cette arme: à partir de l’Hôtel de Ville, on s’en rendit clairement compte. Ce train d’artillerie se tenait à droite en descendant, de sorte que les soldats, à pieds, à cheval, ou hissés sur les affûts, contemplaient la morne procession. Ils n’y assistèrent pas en simples spectateurs: au fur et à mesure que les victimes déniaient devant eux, surtout à partir du pont du chemin de fer, ils les accablèrent d’injures et de brutalités, leur crachant au visage, les poussant à coups de crosse de fusil, les cinglant à coups de fouet.
Avant de pénétrer dans la rue de la Station, un vieillard avait peine à marcher: ses jambes ne suffisaient plus à le porter aussi vite que ses compagnons d’infortune.
C’était M. Leroy. Deux hommes: M. Achille Leroy, son fils, et M. F. Michaux, se mirent en devoir de le soutenir; mais, sous la menace et les coups des forcenés qui gardaient le cortège, il fallut l’abandonner. Ce fut heureux pour lui, car, laissé en arrière, il survécut à l’horrible drame. Non loin de l’endroit où cette scène avait lieu, M. Justin (p.41) Sevrin, épuisé par la maladie, fatigué par la marche, abattu par l’émotion, s’affaissa sur le chemin: il était mort.
Les prêtres présents dans le groupe, MM. le Curé et le Vicaire des Alloux, et M. l’abbé Docq, furent l’objet des plus ignobles traitements. M. le Vicaire des Alloux raconte que ce passage à travers la soldatesque déchaînée fut l’étape la plus douloureuse de son calvaire. Pas un soldat qui ne voulût son tour à lancer au prêtre des propos insultants. Les uns, grinçant des dents, lui adressaient en allemand des apostrophes violentes où le mot de « Pastor » intervenait à tout instant avec un accent de colère. Les autres le menaçaient du poing ou braquaient vers lui leur fusil. Un officier même, s’approchant furieux, et lui plaçant le revolver sous le nez, lui faisait entendre que sa dernière heure était venue. Tandis qu’il gravissait, rue de la Station, les décombres des maisons incendiées, un formidable coup de poing dans la nuque le fit trébucher et tomber dans les ruines.
Tous ces hommes s’avançaient, sombres, la tête basse, silencieux. Outre la douleur qu’ils éprouvaient d’avoir si brusquement quitté leurs proches et de voir leur village natal incendié, ils ressentaient un indicible déchirement à traverser, comme un troupeau d’esclaves, les rangs de cette vile soldatesque ; et l’humiliation se compliquait encore des insultes grossières dont on les abreuvait, des vociférations sauvages qui résonnaient à leurs oreilles, des coups de cravache qui sifflaient dans l’air et s’abattaient sur eux. Ces brutes n’avaient d’égards pour personne ; ils frappaient au hasard ceux qui avaient le malheur de passer à leur portée: M. Hubert Demoulin, qui était boiteux, ne marchait pas assez vite à leur gré ; ils lui assénèrent dans les reins des coups de crosse de fusil.
(p.42) Après avoir parcouru la rue Centrale incendiée, ils durent marcher sur les débris fumants de la rue de la Station. Ce qui restait libre de la route, c’est-à-dire le côté droit, était occupé par le convoi d’artillerie qui s’échelonnait à perte de vue jusque sur la route de Falisolle ; l’autre côté était encombré par les éboulis des façades: fils électriques, pierres, briques, le tout formant des tas inégaux et élevés que les Taminois n’escaladaient qu’avec peine. Et les artilleurs, assis sur leurs caissons, prenaient plaisir à ce manège; si parfois l’un des civils, après avoir péniblement franchi un monceau de décombres, ralentissait son allure, afin de reprendre haleine, un violent coup de fouet lui cinglait le visage ou les reins, tandis que des lèvres des artilleurs s’échappaient ces injures, accompagnées d’un rire épais: Schneller, Schweinhunde! (Plus vite, cochons!).
Vers le bas de la rue de la Station, quelques maisons, et en particulier la maison d’Achille Chaltin, étaient encore en feu. On avait déjà marché bon pas jusque là ; mais, à cet endroit, il fallut encore redoubler de vitesse: la fumée prenait à la gorge et la chaleur devenait intolérable. Comme cette marche précipitée provoquait des vides dans la queue du cortège, les gardes poussaient les hommes et les excitaient en criant: Los.’ Los.’ (Vite! vite!)
On atteignit enfin la Place Saint-Martin.
Là, étaient massées de nombreuses troupes d’infanterie qui, a n’en pas douter, avaient pris part à l’action contre les Français, ou qui, nouvellement arrivées, allaient faire leurs premières armes en assistant à la plus horrible tragédie de cette terrible guerre. Voyant la tête du cortège qui débouchait de la rue de la Station, ces soldats ouvrirent leurs rangs et laissèrent passer les civils. Ceux-ci, obliquant légèrement vers la gauche, abandonnèrent le chemin du pont de Sambre et prirent la direction de la (p.43) rivière, en traversant la place. Là était rassemblé depuis l’après-midi un second groupe de Belges, composé d’habitants de la rue de Falisolle, de quelques autres du village de Falisolle et d’étrangers rencontrés dans les environs du pont de la Sambre. Les hommes furent adjoints aux prisonniers qui descendaient de l’église des Alloux.
Quelques femmes se trouvaient aussi parmi eux. Les Allemands les laissèrent près de l’église: elles allaient assister au massacre inhumain de leurs maris et de leurs fils.
CHAPITRE VI La fusillade
Parvenus à trois ou quatre mètres de la Sambre, les civils furent poussés sans ordre tout le long du cours d’eau, par rangées de sept ou huit hommes en profondeur, face à la rivière d’abord, puis face à l’église Saint-Martin: la ligne s’étendait depuis le mur du jardin qui borde la Sambre — et devait, le lendemain, être transformé en cimetière, — jusqu’à quelques mètres du pont.
Les Taminois étaient ainsi enfermés comme dans une souricière: derrière, la Sambre, que la plupart, faute de savoir nager, ne pouvaient pas franchir ; devant, la masse compacte des soldats qui, l’arme au poing, surveillaient leurs mouvements; à droite, le mur du jardin; à gauche, le remblai du pont, garni d’un autre rideau de troupes: impossible de fuir.
Ils ignoraient toujours quel était le but de cette manœuvre. (p.44) Dans le tumulte qui régnait nécessairement pendant la mise en ligne, plusieurs d’entr’eux, soupçonnant peut-être l’horrible vérité, se jetèrent à l’eau et réussirent à gagner la rive opposée ou les enclos qui bordent en aval la rive gauche de la Sambre. Des soldats armés accoururent le long de la rivière pour contenir les fuyards.
A peine ces cinq cents hommes avaient-ils pris place dans l’alignement, car ils affluaient toujours, qu’un officier à cheval leur adressa la parole à peu près en ces termes: « De nombreux et braves soldats allemands sont tombés à Tamines, non pas sous les balles des Français, mais des civils. Vous êtes des lâches, sales Belges. Vous avez mérité une peine exemplaire : vous allez être fusillés ! »
A une quinzaine de mètres des premiers rangs, les soldats disposés en « gradins », l’arme prête, attendaient l’ordre de faire feu. En observant leur mine furieuse, en voyant les fusils qu’ils brandissaient, en entendant le cliquetis des chargeurs qui glissaient dans les magasins ou le bruit du mouvement qui armait les fusils, les pauvres gens, du moins bon nombre d’entre eux, se rendirent compte de l’intention des Allemands. Plusieurs, à cent lieues de penser que, dans leur innocence, on voulait les tuer, restèrent jusqu’au bout dans l’ignorance du sort qui allait les frapper.
Au moment où la réalité se fit jour dans l’esprit de ces hommes, ce fut, dans leur cœur, un inexprimable tumulte de sentiments: la stupeur, l’affolement, la colère, la crainte extrême. Etre ainsi placé, sans avertissement ni motif, en face de la mort… Alors, du fond même de leur âme, jaillit spontanément, du moins chez beaucoup, l’explosion affolée des convictions chrétiennes: les uns se cramponnaient instinctivement aux prêtres, comme si ceux-ci pouvaient les protéger contre l’inexorable fatalité des balles; les autres se pendaient à leur cou, les suppliant d’entendre (p.45) leur confession suprême ; d’autres enfin récitaient à haute voix leur acte de contrition. Dans cette épouvantable confusion, les prêtres, tout à leur ministère sacerdotal, les consolaient de leur mieux et ne prenaient point garde à ce qui se passait: cette circonstance explique comment ils tombèrent morts ou blessés sans songer à préserver leur vie. Ils prononcèrent sur tous leurs paroissiens les paroles de pardon. L’abbé Docq, lui, dit à très haute voix à ceux, qui l’entouraient: « Mes amis, cette fois-ci, je crois que ça va « chauffer » ; je vais vous donner l’absolution générale ».
C’est peut-être à ce moment-ci qu’il faut placer chronologiquement la manœuvre des Allemands qui consista à couper en deux le groupe des Taminois. Ce sectionnement, tous les témoins l’affirment, mais ils sont en désaccord et sur le temps et sur le but. Il eut lieu à peu près en face du tamis du jeu de balle, non loin du poteau télégraphique. La version la plus vraisemblable est que les Allemands, voulant répartir également les civils, trop nombreux vers le centre, les firent avancer vers le mur et formèrent ainsi deux groupes, afin de mieux diriger le tir. De fait, selon le témoignage de beaucoup de témoins, au premier coup de sifflet, ils firent feu d’abord sur la section du côté du jardin, puis, au second coup de sifflet, sur la section du côté du pont.
Mais n’anticipons pas.
Aux paroles menaçantes de l’officier, à la vue des préparatifs des soldats qui se disposaient évidemment à les fusiller en masse, ces malheureux lancèrent vers le ciel un cri formidable, une clameur immense: « Grâce ! grâce ! Pitié pour nos enfants ! Vive l’Empereur ! Vive l’Allemagne ! Notre Reine est bavaroise! ». Les supplications de (p.46) ces pauvres victimes étaient tellement énergiques et poignantes, qu’on les entendit dans les villages voisins.
Quelques audacieux lancèrent un résolu « Vive la France!», en signe de protestation contre l’exclamation qui leur était imposée, tandis que d’autres, à Parrière-plan, exprimaient en langage approprié leur indignation contre les intentions criminelles de ces tortionnaires: leurs voix furent couvertes par les clameurs de leurs compatriotes.
Après les cris répétés de « Vive l’Allemagne! », il y eut comme une seconde de répit, je ne sais quelle accalmie: on aurait dit que ces malheureux attendaient un instant pour voir l’effet de leurs supplications.
Beaucoup de survivants affirment sans réserve que les exclamations de «Vive l’Empereur! Vive l’Allemagne!» furent commandées par l’officier qui prit la parole et donna l’ordre du feu. M. H. Joret atteste même que les soldats employaient la violence pour forcer les victimes à répéter ces cris.
Il ne semble donc pas que l’histoire doive hésiter à enregistrer ces témoignages: l’invraisemblance de pareil raffinement de cruauté pourrait seule la faire tergiverser.
D’ailleurs, dans le drame de Tamines, tout n’est-il pas invraisemblable, mais douloureusement vrai?
Et si d’autres témoins gardent le silence à ce sujet, n’est-ce pas que, se trouvant aux derniers rangs et préoccupés d’autres pensées, ils ne se sont point rendu compte d’où partait l’initiative de ces exclamations?
Elles ne se sont pas répétées après la première décharge. C’est là, remarque M. Seron, une preuve nouvelle qu’elles furent commandées par les Allemands. Car, si les Taminois les avaient lancées spontanément, dans le seul but de s’épargner la vie, ils les auraient renouvelées avec d’autant (p.47) plus d’insistance après la première salve. Ces clameurs faisaient donc partie de la mise en scène du drame.
Ainsi, au moment d’accomplir leur exécrable forfait, les massacreurs poussent l’excès de la férocité jusqu’à contraindre leurs victimes à acclamer l’Allemagne et son Empereur. Peut-on trouver, dans les annales de l’humanité, exemple aussi horrible de cruauté réfléchie? N’auraient-ils pas dû voir dans l’inconsciente docilité des Taminois une marque évidente de leur innocence?
Inconscients, beaucoup l’étaient; démoralisés par les émotions et les fatigues de cette journée fatale et de la nuit précédente, abattus par les traitements brutaux que vient de leur infliger une soldatesque impitoyable, ils sont brusquement jetés dans l’effrayant décor d’une épouvantable tragédie où tout est prêt pour les massacrer sans merci. Tout naturellement, perdant le sentiment de la situation, ils subissent, sans réagir, les impulsions du dehors ; ils exécutent machinalement les ordres des soldats: ils avancent, prennent rang, reculent, s’alignent ; ils obéissent d’instinct, ils répètent même le cri des Allemands, sans qu’ils aient eu ni le temps ni l’idée d’en préciser la portée, sans qu’ait pu s’établir en leur esprit un marchandage quelconque entre l’instinct de la conservation et des pensées d’un autre ordre.
Semi-conscients, d’autres tentent en vain de fléchir leurs bourreaux, en invoquant la nationalité de leur Reine.
Enfin, ceux qui pouvaient avoir conservé entière leur présence d’esprit, ne savaient-ils pas que leurs femmes et leurs enfants étaient emprisonnés à l’église et à l’école des Alloux ? Ne savaient-ils pas que toute attitude hostile, défensive même, de leur part, aurait attiré sur ces autres innocents de terribles représailles? Ce souci de sauver l’existence de leurs proches, n’avait-il pas, d’ailleurs, été (p.48) constant, et n’avait-il pas suffi, à défaut d’autres motifs, à leur interdire tout acte contraire aux coutumes de la guerre ?
Telle est bien aussi la raison pour laquelle, au lieu de se jeter sur leurs exécuteurs et de vendre chèrement leur vie, les Taminois, véritables martyrs du devoir, se résignèrent à mourir sans résistance (1).
- l’abbé Docq venait donc de prononcer les suprêmes paroles d’avertissement qui devaient terminer sa carrière ici-bas: soudain, un coup de sifflet déchira l’air: c’était le signal de la fusillade. Une salve, et tous tombèrent… Un certain nombre étaient tués, d’autres blessés; mais la plupart avaient esquivé la décharge en se jetant à terre.
On avait tiré d’abord une série de coups de fusil plus ou moins espacés, dont l’ensemble ne formait pas une décharge bien réglée ; puis ce fut le crépitement serré d’un feu à volonté qui dura l’espace d’une demi-minute.
Chacun, suivant son inspiration, avait d’instinct trouvé un moyen de protection: les uns se cachaient derrière un voisin qui ainsi fermait écran ; d’autres, pour offrir moindre cible aux balles, se plaçaient de biais ; d’autres encore, le corps plié en deux, l’avant-bras sur les yeux, se tenaient en arrêt, pour se laisser tomber dès le commandement du feu ; beaucoup aussi se jetèrent par terre, s’efforçant de ne rien voir ni de rien entendre.
Alors les Allemands crièrent : « Debout, tous debout ! » Les uns, fascinés par l’énergie du commandement, se relevèrent;
(1) A propos de ces exclamations invraisemblables, l’auteur a été dans la presse l’objet de violentes attaques: plusieurs auraient voulu qu’il les passât sous silence. Après avoir à nouveau contrôlé les nombreuses déclarations, il n’a pas cru, au nom de la vérité, pouvoir se soustraire à la conclusion qui s’impose : c’est un fait historique. Il faut en chercher l’explication, bien naturelle d’ailleurs, dans l’état de délire où se trouvaient les Taminois, au moment de mourir.
(p.49) les autres, sentant qu’il y allait de leur vie, se cramponnèrent au sol. Les soldats s’approchèrent et les forcèrent à se tenir debout: à coups de baïonnette et de crosse de fusil, ils groupaient les indemnes et préparaient une nouvelle cible pour une seconde décharge. On entendait les cris de douleur des blessés et les lamentations des hommes qu’on brutalisait pour les remettre sur pied.
Un second coup de sifflet et une nouvelle salve des fusils: tous tombèrent à nouveau, tués, blessés ou faisant le mort.
Tout cela se passa en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire. Il est certain qu’il y eut, entre les deux salves, un arrêt d’assez courte durée et que la seconde fusillade donna l’impression d’être plus longue que la première.
Rien n’égale en horreur ce massacre où soldats et officiers rivalisent de férocité, mettant à mort sans jugement, à froid, délibérément, après les avoir acculés à une rivière où toute fuite est impossible, des centaines de civils innocents et désarmés. Cette cruauté s’aggrave d’une lâcheté sans nom, et l’histoire la jugera avec toute la sévérité que mérite un pareil forfait.
Il importe, cependant, de relater toute la vérité: tandis que les hommes de Tamines étaient alignés le long de la Sambre, attendant la balle qui devait les coucher sur le sol, et que leurs clameurs lamentables, implorant la compassion de leurs bourreaux, se croisaient, montaient jusqu’au ciel, plusieurs soldats allemands laissèrent la pitié s’élever jusqu’à leur cœur et, au témoignage des victimes elles-mêmes, tirèrent ou trop haut ou trop bas, afin d’épargner les civils.
Quelques témoins prétendent avoir vu fonctionner une mitrailleuse et beaucoup affirment en avoir entendu, pendant la seconde salve, le tac-tac régulier. Sans nous arrêter à cette affirmation, qui peut aussi bien avoir pour origine (p.50) une illusion des sens, il convient, pour être complet, de la mentionner ici. Aux yeux de l’histoire, l’instrument du massacre importe peu: les Taminois ont été tués à bout portant, et leur assassinat restera pour l’Allemagne une éternelle flétrissure (1).
Et pourtant, ce ne fut pas hélas ! la fin des scènes d’horreur qui se déroulèrent sur la place de Tamines.
CHAPITRE VII L’achèvement des blessés
La double fusillade venait d’étendre, morts ou blessés, plusieurs centaines de Belges innocents. Les derniers coups de fusil crépitaient encore, poursuivant les fuyards dans la Sambre, que les criminels quittaient leur poste, se ruaient sur les victimes et s’apprêtaient à achever les blessés. Ils circulèrent autour du groupe à la recherche des survivants, pour leur donner le coup de grâce.
Ce fut une effroyable boucherie. De la pointe de leurs
(1) Les Allemands attachent sans doute une importance particulière à l’usage d’une mitrailleuse dans le massacre des martyrs, car, lors de la visite à Tamines de quelques officiers, huit jours avant l’enquête officielle d’un magistrat (cf Chapitre XII), M. Seron fut menacé de châtiment pour avoir affirmé qu’une mitrailleuse avait fonctionné.
D’autre part, M. René Fournier, qui fut déporté en Allemagne en novembre 191(> et forcé de travailler chez le fermier Hermann Gerling (Lintel par Veidenbrück, Post 13, en Westphalie) rapporte, au sujet de l’emploi de la mitrailleuse, un dire intéressant: Gcrling racontait qu’appartenant à l’armée allemande, il avait traversé Tamines au moment de l’exécution et que, les soldats tirant trop haut ou trop bas, un officier avait saisi une mitrailleuse et l’avait actionnée.
(p.51) baïonnettes, ils fouillaient les monceaux de corps affalés les uns sur les autres, plongeaient dans le tas et enfilaient ceux qui respiraient encore ; ou, de la crosse de leurs fusils qu’ils abattaient après de violents moulinets, ils martelaient avec rage les crânes à en faire jaillir la cervelle. Et, plus haut que la sourde plainte des agonisants, montaient les cris sauvages et gutturaux de ces manouvriers de carnage. Et leurs rauques « ahans », comme ceux des bûcherons qui cognent, scandaient la chute lourde, sur les crânes, de leurs fusils déshonorés. Ils allaient ainsi, enjambant les corps, battant comme au fléau ces gerbes humaines. Et telle fut la violence des coups qu’ils assenaient que, lorsqu’on déblaya la place le lendemain, on retrouva un canon de fusil brisé, et M. le Vicaire des Alloux affirme qu’en se levant à l’aube, il vit à ses côtés un homme dont la tête était plate « comme une figue ».
A ce sujet encore, voici ce que raconte M. Louis Lardinois:
« Je fus blessé au cours de la seconde salve: je sentis deux douleurs cuisantes dans le dos et à la tête: c’étaient deux balles qui m’avaient éraflé. Puis, j’eus l’impression de recevoir un violent coup de poing dans le dos, du côté droit: c’était la balle qui m’avait frappé, m’ouvrant une large blessure entre l’omoplate droite et la colonne vertébrale. C’est un peu après, que la seconde salve a cessé. Immédiatement les soldats, ceux-là même qui avaient tiré, se précipitèrent sur le tas de morts et de blessés. Ils se servaient de la baïonnette et des crosses de leur fusil pour achever les victimes ; ils frappaient réellement comme des forcenés, en aveugles, sans voir le but ; ils s’avançaient même dans le tas, escaladant les monceaux de cadavres: c’est ainsi qu’un soldat, après avoir transpercé plusieurs corps qui gisaient à ma gauche, les a (p.52) enjambés et est monté sur mon dos — j’étais tout juste au sommet d’un monceau — pour pouvoir lancer ses coups plus loin. La semelle de sa bottine était exactement à la place où la balle m’avait fendu le dos. J’eus malgré tout la force de ne pas crier: c’est ce que je ne comprends plus. Je sentais fort bien chaque coup de baïonnette qu’il donnait, au mouvement du corps qui pesait plus lourd » sur moi; à certain coup, j’entendis mon père crier: il » était à côté de moi. Il avait reçu deux coups de baïonnette, un dans la figure et l’autre dans le flanc, après avoir été blessé de deux balles, à l’épaule et au côté droit.
» Le soldat s’est alors avancé plus loin.
» Après cela, j’entendis un autre soldat lancer à ceux » étendus à ma droite, des coups furieux de baïonnette, en poussant des hurlements qui n’avaient rien d’humain. J’entendis alors un soldat lui adresser ces paroles: Genug, genug, sie sind alle kaput. (Assez, assez, ils sont tous » morts). »
- Arthur Brichard, tué par les balles, MM. Georges Steinier et Joseph Warnier, ceux-ci sains et saufs, étaient tombés les uns sur les autres et formaient un monticule que les meurtriers escaladèrent et d’où ils distribuèrent, à droite et à gauche, des coups de baïonnette.
- Fernand Massart, âgé de 18 ans et son père, M. Joseph Massart, tous deux blessés par les balles, se faisaient leurs adieux, attendant la mort. Tout-à-coup surviennent ces assassins qui les lardent de leurs baïonnettes.
Ils n’eurent pas le temps, apparemment, d’achever leur besogne: car, tandis qu’ils perçaient les corps et fracassaient les crânes, voici que tout-à-coup retentirent, lugubres, trois notes d’un clairon. D’après le son, cet appel devait partir de la direction du café Hennion. Aussitôt, (p.53) les soldats quittèrent le lieu d’exécution et rejoignirent leur colonne qui s’ébranla par la route de Falisolle.
C’est du moins la version que l’on peut établir sur les dires des témoins et qui paraît vraisemblable. Car la besogne d’achèvement était loin d’être terminée.
En effet, sitôt ces bourreaux disparus, d’autres viennent continuer le massacre. Il en est, parmi ces nouveaux exécuteurs, qui portent le brassard de la Croix-Rouge. Ils s’approchent à la lueur de torches et de lanternes de poche — car l’obscurité s’épaissit — et, armés de fusils et aussi de chevrons ou de madriers, qu’ils ont sans doute trouvés dans les décombres des maisons incendiées, ils veulent avoir leur part au carnage. Ils vont, promenant les rayons de leurs lampes sur les figures inertes ou mutilées, et, dès qu’ils aperçoivent un mouvement, un frisson, un spasme de douleur, ou qu’ils entendent une plainte, ils s’approchent, constatent la présence de la vie en disant: Er lebt noch (il vit encore) ; s’acharnant sur le malheureux avec une rage infernale, ils le retirent du tas, lui font souffrir les tortures les plus atroces et l’assomment à grands coups de massue.
Par groupes de deux ou trois, ils parcourent le champ du carnage. Dans le doute s’ils ont à faire à un mort ou à un vivant, ils le transpercent de leur baïonnette pour voir s’il réagit: malheur à celui qui n’a pas l’énergie de rester immobile !
Au premier abord, en voyant arriver ces soldats, quelques blessés murmurèrent avec un accent de satisfaction: « Voilà la Croix-Rouge, nous allons être soignés ». Il fut bien question de cela.
Un soldat, s’adressant à un survivant, lui demanda s’il était blessé. — « A l’épaule gauche », répondit celui-ci qui, (p.54) en même temps, le pria de lui donner à boire. Le soldat lui promit de le satisfaire. A ces mots, d’autres blessés sortent du prudent silence qu’ils avaient observé jusqu’alors et demandent aussi de l’eau. Pour les désaltérer, les soldats s’approchent des blessés, les prennent par les épaules et par les jambes et les précipitent dans la Sambre.
- Jules Mary, dont les Allemands s’étaient servi la veille, rue de Falisolle, comme d’un bouclier et qu’ils avaient ensuite placé dans le groupe des fusillés, raconte ce drame poignant: « J’étais blessé dans le dos. Après la » fusillade, les Allemands, comme des lions, cherchaient » dans le tas ceux qui vivaient encore pour les achever; ils » en saisirent plusieurs qu’ils jetèrent dans la Sambre.
» Le blessé qui était près de moi — Franz Moussiaux d’Auvelais — se plaignait beaucoup: il suppliait qu’on » vînt à son secours et qu’on lui donnât à boire. Je lui dis: « Ne te plains pas comme cela, tu vas les attirer par ici et ils t’achèveront comme ils achèvent les autres. Le malheureux répondit qu’il souffrait trop et qu’il ne pou-» vait réprimer l’expression de sa douleur. Il continua à se lamenter et à demander grâce. Sur ce, arriva un Allemand qui l’interrogea sur son état et les causes de sa souffrance. Moussiaux lui dit qu’il avait l’épaule fracassée. Le soldat appela ses camarades. Ceux-ci apportent une civière et, avant d’y étendre le blessé, exigent encore une fois qu’il dise ce qu’il a. Il répond, et supplie qu’on ait pitié de lui. Alors, ils le tirent avec violence par l’épaule: j’entends encore les hurlements de douleur de l’infortuné martyr. Ils le jettent ensuite sur la civière et lui donnent, pour l’achever, quelques coups de baïonnette; j’ai entendu le râle de la mort; alors, ils le précipitent dans la Sambre. »
(p.55) Le récit de M. Fernand Michaux n’est pas moins expressif:
« J’étais couché sur le sol, le buste libre mais les jambes recouvertes d’un tas de cinq ou six cadavres. Revenu au sentiment de la réalité, je me hasardai à regarder autour de moi, sans cependant me risquer trop; j’aperçus » devant moi la tête bouclée et si caractéristique de mon » beau-frère, Victor Barbier. Il émergeait d’un amas de cadavres, couché sur le dos, la tête reposant sur le bras gauche. Je l’appelai doucement et, ne recevant pas de » réponse, je touchai l’extrémité de son petit doigt. Hélas ! la mort avait fait son œuvre. Les Barbares l’avaient tué, faisant du coup une veuve et deux petits orphelins.
Je me recouchai alors, tenant le plus possible ma tête éloignée du sol, à cause du sang qui détrempait la terre et dont l’odeur tout à fait particulière m’incommodait. Je ne sais combien de temps je restai dans cette position, » mais, à certain moment mon attention fut attirée par les cris de souffrance arrachés aux rescapés, que les soldats frappaient avec violence. J’en vis, à côté de moi, labou-» rer littéralement les corps à coups de baïonnette.
Ces bandits escaladaient même les corps pour arriver au milieu des tas de cadavres ; c’est ainsi que, par deux fois, un de ces hommes féroces revint près de moi. Je » sentis parfaitement le poids du fusil pesant sur la baïon-» nette posée sur moi, un peu en dessous de la nuque. J’attendais anxieux, ayant fait, dès lors, le sacrifice de ma vie, mais il ne frappa point, et n’appuya même pas.
Quelques instants après, pris de remords sans doute, il revint à la charge et usa du même procédé, en appuyant, cette fois, mais sans frapper. Je reçus de ce fait une légère blessure qui ne me fit aucunement souffrir physiquement. Mais, qui dira les tortures morales endurées (p.56) pendant ces quelques secondes, longues comme plusieurs siècles, où je sentis planer sur moi l’aile de la mort ! où je revis si nettement l’image d’êtres chers! Toutefois, le danger n’était pas passé. Devant moi, j’entendais frapper à coups redoublés; je me rendis compte peu à peu que l’on traînait des cadavres ou des blessés à la Sambre et je prévoyais le moment où bientôt mon tour arriverait. J’étais, je l’ai dit, décidé à faire le mort jusqu’au bout et je me serais laissé traîner à l’eau sans mot dire, espérant bien que le peu de profondeur de la rivière à cet endroit me laisserait la chance » de sortir vivant. »
- Joseph Biot était étendu sur M. Nicolas Warnier ; les tortionnaires l’aperçoivent, le tirent par les jambes jusqu’au bord de la Sambre, et là, lui demandent s’il est blessé. Le malheureux répond affirmativement. Alors, ils l’empoignent par les épaules et par les jambes et le lancent dans la rivière.
Ils en jetèrent à l’eau, vivants ou morts, une bonne trentaine, car, quelques jours après la fusillade, on retira 43 cadavres de la Sambre et il paraît raisonnable de supposer qu’un certain nombre de fuyards se noyèrent ou furent atteints d’une balle en voulant s’échapper. Ils semblent avoir eu l’intention d’en jeter davantage; découragés sans doute par la longueur et la difficulté de l’opération, car la déclivité de la rive est peu accentuée et les cadavres restaient à fleur d’eau, ils renoncèrent à leur projet.
Citons encore M. Louis Lardinois:
« Peu après que les premiers soldats furent partis, j’en » vis d’autres qui paraissaient inspecter le tas de morts et » de mourants à côté de moi, et je vis parfaitement que » ces soldats étaient armés de fusils et portaient au bras (p.57) le brassard de la Croix Rouge: ils étaient coiffés de casques; d’autres qui n’étaient pas armés de fusil, se servaient de morceaux de chevrons ; et la scène de carnage continua comme précédemment.
» A certain moment, j’entendis une victime demander à boire. L’un des soldats lui répondit en français, avec un » accent allemand très prononcé: « Vous avez tiré sur nos soldats ». Le malheureux répondit: « Ce n’est pas vrai, » c’est le prétexte que vous invoquez pour nous massacrer » tous ». A ces mots, il fut empoigné par les épaules et par les jambes: il devait être blessé à la jambe, car lorsqu’il fut saisi, il se plaignit et lança des cris de dou-» leur. On le remit à terre et, peu après, il fut repris malgré » ses cris et porté jusqu’au bord de la Sambre où il fut précipité. Les soldats qui le jetèrent prirent leur élan » en comptant: « Eins, zwei! ». (Un, deux!) J’ai entendu la chute du corps dans l’eau.
Puis les Allemands, se retirant, allèrent d’un autre côté. L’endroit où je me trouvais resta un instant sans » soldats.
Je vis alors près de moi un homme se lever et, courant, prendre la direction du pont. Il fut suivi de quelques autres. Je me suis approché de mon père pour m’assurer s’il était encore en vie: je constatai que sa figure » était froide ; il devait être évanoui. Mais le croyant mort, je rampai jusqu’au pont et me glissai dans le fossé, le long du chemin de halage… »
Dès l’instant où les civils avaient été rangés le long de la Sambre, plusieurs d’entre eux avaient profité d’un moment d’accalmie ou de distraction des soldats pour sauter dans la rivière, se sauver à la nage et gagner les enclos de la rive gauche. Pendant et après la tuerie qui suivit la fusillade, un certain nombre d’entre les épargnés conçurent (p.58)
la même idée et se jetèrent à l’eau. Les soldats qui se trouvaient sur le pont et ceux qui étaient en face du café Remy tiraient sur les fuyards.
- F. Lavis fait à ce propos le récit suivant:
En entendant les cris des blessés qu’on achevait, mon fils (1) me demanda: « Voulons-nous nous jeter à l’eau » pour nous noyer et ainsi ne pas souffrir? ». J’embrassai » alors mon fils et lui dis au revoir. Nous nous relevâmes, courant vers l’eau. En arrivant à la Sambre, tandis que mon fils avait les deux pieds dans l’eau, une balle vint broyer ma montre, dans mon gousset; — je conserve précieusement ce souvenir. Le briquet avec lequel j’allu-» mais mes cigares et qui se trouvait également dans la poche de mon gilet, est aussi tout tordu.
Sans plus chercher mon fils, car je ne savais ce qu’il » était devenu, je me couchai dans l’eau malgré tout; là, j’ai encore reçu trois balles de fusil dans mon pardessus. Je sortis de la rivière vingt-cinq mètres en aval et me dirigeai vers la Glacerie Saint-Roch à Auvelais, où nous nous sommes retrouvés huit, et nous nous sommes cachés dans un canal de four à plâtre, plein de suie. »
- Van Heuckeloom raconte comme suit cet épisode du carnage:
« Je me suis laissé tomber par terre; c’est seulement lorsque je fus tombé que j’entendis les balles siffler à mes » oreilles. A terre, en regardant autour de moi, je voyais les flocons de laine des vêtements qui volaient sous l’action des balles. Je ne me souviens plus de rien, sauf qu’on est venu achever à coups de crosse et de baïonnette ceux qui bougeaient encore. J’entendais bien ce
(1) M. C. Lavis était aussi à la fusillade et, comme son père, n’avait pas été blessé.
(p.59) qu’ils disaient: Er lebt noch (il vit encore). J’ai compris alors ce qu’il fallait faire et je fis le mort. J’étais couché » à plat ventre ayant sur les pieds deux jeunes gens: Camille Lambotte et Fernand Sevrin. Ceux-ci reçurent des coups de baïonnette, mais ne furent pas tués. En lançant » leurs coups de crosse ou de baïonnette, les Allemands fai-» salent entendre des « ahans » formidables. L’un d’eux » était armé d’un madrier: le lendemain, j’ai vu près de » moi la pièce de bois. Dans leur sauvage besogne, ils s’éclairaient de leurs lampes électriques. J’étais en proie à une frayeur atroce, craignant d’être jeté à la Sambre. » — J’entendis ensuite des coups de feu dans la direction d’Arsimont, puis tous les Allemands qui, à la lueur de leurs lampes, rôdaient autour de nous se sauvèrent à l’église. Ne se sentant plus épiés, deux ou trois civils se levèrent, et s’échappèrent en se jetant à l’eau, près de » l’enclos voisin. J’en ai vu un qui nageait. A ce moment, » les Allemands sont revenus et l’un d’eux voulut tirer; » mais un autre cria: Nicht schiessen; lass ihn schwimmen, er schwimmt gut. (Ne pas tirer ; laisse-le nager, il nage bien). C’était, en effet, un excellent nageur. Les soldats, sans avoir tiré, se sont de nouveau retirés à l’église ».
Un certain nombre de ces infortunés réussirent donc à se soustraire aux balles et aux coups de massue de la soldatesque: les uns s’échappèrent à la nage ; les autres, pataugeant dans la boue et marchant dans le lit de la rivière avec de l’eau jusqu’au cou, glissèrent vers l’aval hors de portée des coups et des balles ; d’autres encore, passant en dessous du pont, s’enfuirent par le chemin de halage ; enfin, plusieurs, séjournant dans l’eau jusqu’au matin, la tête dissimulée dans les ajoncs ou les buissons de la rive, se dérobèrent à la vue de leurs bourreaux. La plupart étaient dans un tel état d’affolement que plus d’un se blottit dans (p.60) les fossés et dans les champs; d’autres cherchèrent asile dans les maisons abandonnées, d’où ils ne sortirent que plusieurs jours après ces événements.
- Lucien Lardinois, qui était couché sous les cadavres, raconte ainsi ce qu’il a constaté:
« Ce que je sais très bien, c’est que le civil qui se trouvait au-dessus de moi eut la tête fracassée d’un coup de crosse de fusil: c’est Georges Mouyard. Je ne saurais dire s’il était mort: le coup de crosse l’acheva certainement s’il était encore en vie.
Dans la nuit, quelqu’un qui était à côté de moi me demanda si j’étais blessé; lui ayant répondu négativement, je lui posai la même question. Il me dit être blessé à l’épaule, et ajouta qu’il voulait absolument s’enfuir, car, le lendemain matin, les Allemands viendraient certainement encore, avec leurs baïonnettes, achever tout le monde. J’ai préféré rester, et il partit avec un rescapé » quelque temps après. Je n’ai pas demandé son nom.
J’étais couché à plat ventre. Georges Mouyard se trouvait donc au-dessus de moi, les deux jambes sur mon dos, et j’avais la tête en dessous de son ventre ; deux autres étaient sur mes jambes, de sorte que j’étais complètement caché ».
- le Curé des Alloux et M. l’abbé Docq furent tués sur le coup par les balles ; M. le Vicaire des Alloux fut grièvement blessé par deux projectiles dans le dos. Dans leurs recherches, les soldats reconnurent un prêtre à sa soutane: ils se le montrèrent et tinrent à son sujet des propos inquiétants, car, dans leur langage de forcenés, le mot de Pastor résonnait comme une menace à la fois et un cri de triomphe. C’était M. l’abbé Docq. Il est probable qu’ils trouvèrent son cadavre sous un tas d’autres victimes et que, l’ayant dégagé, ils le placèrent au sommet, car, au (p.61) dire de témoins oculaires, il semblait que son buste avait été retiré d’en dessous et placé sur le haut du monceau. Leur rage contre les prêtres trouva l’occasion de s’assouvir sur le cadavre: ils lui donnèrent dans la gorge un formidable coup de baïonnette. C’est ce que purent constater le lendemain les survivants. Le Dr Defosse, son cousin, qui recueillit le corps au moment de l’inhumation, l’après-midi du dimanche, déclara que la blessure du cou avait été portée après la mort.
En voyant cette scène qui ne présageait rien de bon pour lui, M. le Vicaire des Alloux, qui était étendu non loin de là, la face contre terre, se dit qu’il importait de ne pas donner le moindre signe de vie: profitant d’un moment de distraction des soldats, il releva sa soutane sur la tête pour cacher sa tonsure et fit le mort jusqu’au lendemain matin. Cela n’empêcha pas qu’un soldat vint lui soulever la tête, lui tirer les jambes et lui donner des coups de pied pour s’assurer s’il vivait encore, et qu’il fut surveillé cinq heures durant: comme il se tenait immobile, on le laissa tranquille.
- Félix Servais avait été arrêté à l’improviste et versé dans le cortège ; au moment de la fusillade, il tenait encore en main sa valise de voyage et se trouvait près du poteau télégraphique dressé au bord de la Sambre. Au signal de l’exécution, il se laissa tomber dans la rigole et, d’instinct, pour se protéger, plaça la valise sur sa poitrine. Pendant la boucherie de l’achèvement, un soldat marcha sur lui et lui mit le talon de la botte sur le cou, qui en garda la marque pendant huit jours. De là, le bourreau piquait, labourait, enfilait les blessés et les cadavres tout autour. M. Servais avait sur lui M. Lecaille et M. Léon Bodart, chef-garde, tous deux tués sur le coup par les balles. L’Allemand frappa plusieurs fois de son arme le cadavre de Bodart avec tant de violence qu’il en fut transpercé et (p.62) que la pointe atteignit la valise à trois endroits: les livres que celle-ci contenait protégèrent M. Servais.
- le pharmacien Delsauvenière blessé par les balles, était tombé sur le dos au sommet des cadavres: voyant les soldats qui sortaient de l’église et s’approchaient de lui, il leur demande à boire: ce fut en vain. Comme il insistait: «De l’eau? disent-ils; vous avez tiré sur nos soldats». Il proteste avec énergie: « Je suis pharmacien ; on a brûlé ma pharmacie. Si vous voulez me soigner, je vous promets, dit-il, croyant les apitoyer, de me dévouer pour vos blessés ». A ces mots, ils se mettent à lui taillader les jambes à grands coups de baïonnette. Ils le laissent pour mort. Les blessures étaient profondes: il fallut amputer les deux jambes et, malgré tous les soins, M. Delsauvenière mourut quelques jours plus tard.
- Joseph Mollet, étendu près du poteau télégraphique, n’était pas blessé. Voyant qu’on achevait un à un les survivants et craignant peut-être que son tour ne vînt bientôt, il se dégage des corps qui le couvraient, se met à genoux devant les assassins et, appuyant les mains sur les cadavres, implore sa grâce: un soldat survient par derrière et l’étend raide mort d’un formidable coup de baïonnette dans la nuque.
- Fernand Sevrin raconte comme suit son martyre:
« Je n’ai pas été blessé par les balles. J’ai fait le mort « en me laissant tomber sur MM. Van Heuckeloom et Camille Lambotte (1). Après la fusillade, des soldats portant un brassard sont venus vers nous et se sont mis à achever les blessés. Ils avaient donné le coup de grâce à un grand nombre de victimes, lorsqu’ils s’approchèrent
(1) Camille Lambotte passa la frontière en 1915, s’enrôla dans l’armée belge et tomba au champ d’honneur dans la dernière offensive.
(p.62) » de moi et m’enfoncèrent leur baïonnette dans le dos: l’arme sortit par le côté et me perça le bras. Camille Lambotte, lui, avait reçu un coup terrible de la même arme en plein visage. Nous croyions que nous allions mourir et nous nous faisions nos adieux. Constatant que nos assassins dépouillaient les cadavres, je jetai mon porte-monnaie dans la Sambre. Je voulais également y jeter » ma montre ; mais, voyant revenir les égorgeurs, je n’en eus pas le temps et fis le mort. La nuit, je dormis et j’eus la fièvre. M. E. Labarre alla me chercher de l’eau à la rivière ».
- Florent Moussiaux, qui avait échappé aux balles, n’y tenant plus, se dresse et invective les meurtriers en criant: «Lâches! je vis encore, assassins!». Un soldat s’élance et l’assomme d’un coup de crosse sur la tête: il s affaisse ; deux tortionnaires se précipitent à leur tour et achèvent le malheureux à la baïonnette.
- Arthur Collin s’était jeté à terre au signal de la fusillade:
« J’étais tombé à plat ventre, la figure contre terre. Un » homme était couché en travers de mes jambes. J’entendais, tout autour de moi, les plaintes de ceux qui (p.63) imploraient grâce et de ceux aussi qui suppliaient les soldats de les achever. Chaque fois que des bottes résonnaient près de moi, je sentais mon cœur se glacer d’effroi et j’attendais le coup mortel. Lorsque les soldats s’éloignaient, je me disais: « Ce n’est pas encore pour cette fois ». Tout à coup, j’entendis le bruit lourd de pas et vis des bottes s’arrêter près de moi: au même instant, » je me sentis piquer à la jambe. Hélas ! les bandits s’acharnaient sur le malheureux couché sur moi. Cet homme était déjà mort probablement, car, il ne se plaignit ni ne cria. Ils le transpercèrent de quatre coups de baïonnette (p.64) et, chaque fois, ils frappèrent si fort que l’arme, passant à travers le corps, me trouait la jambe. Un peu » plus tard, ils revinrent me piquer sous l’épaule gauche et à l’épine dorsale. La blessure sous l’épaule était assez » profonde, car le poumon fut légèrement atteint. Je souffrais en silence, sans oser proférer un cri. Je n’étais pas encore au bout de mon tourment, car, un peu après, les lâches me lancèrent de nouveau un coup de leur arme » dans le côté gauche et ainsi m’endommagèrent une côte. » Mes douleurs alors devinrent insupportables. Je perdais du sang en abondance et, à chaque respiration, j’avais » la sensation que l’air entrait dans mon corps par la blessure du côté et celle de dessous l’épaule. Cette fois, je me suis dit que c’en était fait de moi. Tandis que je souffrais ainsi, attendant la mort à tout moment, les victimes qui se plaignaient trop haut étaient achevées et celles qui demandaient à. boire, précipitées dans la Sambre… »
- Emile Leroy raconte en ces termes les traitements qu’il eut à subir:
« Je suis dans le peloton de gauche: j’assiste, terrifié et impuissant, à ce qui vient de se passer et j’attends mon » tour. Je suis donc placé au premier rang du peloton de gauche ; le commandant est à quelques mètres de moi, et, quand je vois qu’il porte le sifflet aux lèvres, je me laisse tomber ; je suis piétiné, je roule, pour enfin m’arrêter couché sur le ventre, faisant le mort…
J’entends distinctement le fracas des armes, le sifflement de la mitraille dans un bruit confus de cris féroces set de vociférations sauvages, puis plus rien… Si! les » gémissements, les cris de souffrance, les râles de ceux » qui sont atteints.
Quant à moi, je n’ai pas une égratignure; les balles et la mitraille m’ont épargné. Toujours couché, faisant (p.65) le mort, je me rends bien compte que ces barbares évacuent la place; je m’estime heureux, croyant être sauvé; mais hélas ! je ne suis pas encore au bout de mes peines. Les soldats de la Croix-Rouge restent derrière et, quand les autres sont partis, ils se ruent comme des bêtes fauves sur tous ces hommes sans défense, couchés, la plupart blessés ou morts, et, à grands coups de baïonnette, frappent à tort et à travers. Les cris, les gémissements des blessés se font de plus en plus entendre ; certains deman-» dent grâce, pitié ; mais, sans écouter ces plaintes, les soldats sanguinaires frappent toujours, frappent encore. Et moi, pendant ce temps, j’attends, me demandant: » que vais-je devenir? Est-ce bientôt mon tour?
Tout-à-coup, un soldat s’approche de moi et me retournant sur le dos, me frappe rageusement de sa baïonnette. Oh! je n’oublierai jamais les traits de cette face bestiale qui se penche sur moi. Du premier coup, il me transperce le bras gauche de part en part ; le second, plus violent, m’est porté en dessous du mamelon gauche, et c’est grâce à un calepin que j’avais en poche et qui est transpercé d’outre en outre, que le cœur ne fut pas atteint. Je reçois un troisième coup dans le flanc droit; » après quoi, craignant que les coups ne m’atteignent au visage, d’un effort surhumain, je me retourne ; exaspéré sans doute, mon bourreau me lance un terrible coup de son arme ; celle-ci pénètre dans le côté gauche du cou, au-dessous de l’artère carotide, traverse une partie de » la gorge et ressort en dessous du menton. J’ai très bien » senti le fer remuer dans la plaie, je l’ai même touché de » la main. Ayant retiré son arme, la brute m’assène le « coup de grâce » en me donnant un formidable coup de crosse dans la nuque; puis il m’abandonne, croyant évidemment m’avoir achevé.
(p.66) Mais il se trompait; j’avais même gardé ma présence d’esprit.
Cependant, je perdais le sang ; craignant d’attirer à nouveau l’attention, je n’osais faire aucun mouvement. Par un effort suprême de ma volonté, je réussis toutefois, en usant de précautions, à nouer mon mouchoir de poche autour du cou pour essayer d’arrêter l’hémorragie, me rendant parfaitement compte que cette blessure est la plus grave.
Je viens à peine d’achever que j’entends tout-à-coup cette bande de sauvages qui revient à la charge ; la nuit est venue et pourtant je vois très bien qu’ils sont armés de pièces de bois: à tour de bras, ils frappent à nouveau dans la masse, j’entends les coups qui martèlent, les crânes.
Au moyen de petites lampes électriques, ils inspectent leurs victimes, et celles qui se plaignent — elles sont nombreuses — sont achevées, ou prises à bras le corps et jetées à la Sambre.
C’est alors que, soudain, je sens la botte d’un de ces massacreurs qui touche ma figure. Il est là, debout près de moi. Que fait-il? Est-ce pour s’assurer que je suis bien mort? En tous cas, je retiens ma respiration; je ne fais aucun mouvement, j’invoque la Providence, craignant à tout moment d’être achevé et flanqué à l’eau comme une bête malfaisante. Dans ce dernier cas, je suis perdu, car je ne sais pas nager et, de plus, je suis sérieusement blessé. Quelques minutes d’attente qui me paraissent un siècle… et il s’en va.
Quel soupir de soulagement je pousse ! Je suis tout transformé, je ne souffre plus, je ne pense plus à mes blessures et je voudrais, me semble-t-il, secourir mes (p.67) amis. Mais comment ? Et les sentinelles allemandes qui sont toujours là…
Et la nuit arrive. Ah ! quelle nuit, mon Dieu, quelle «nuit! D’un côté, les plaintes et les gémissements des blessés, les râles des mourants; de l’autre, le froid qui commence à me gagner. J’ai perdu mon chapeau dans la mêlée: je ramasse la casquette d’un camarade tué à mes côtés et je l’enfonce sur ma tête. Je cherche à me glisser en dessous de son paletot pour me réchauffer, car je tremble de froid. Et puis, la soif qui commence à me tenailler, si bien que n’y tenant plus, je me traîne sur les genoux, jusqu’au bord de la Sambre, où je me désaltère à longs traits. Je rampe à ma place primitive et j’attends le jour… »
La déclaration de M. Philémon Vanderwaeren n’est pas moins tragique:
« Au coup de sifflet .qui commandait la fusillade, d’instinct, je fis demi-tour à gauche, et me protégeai la tête du bras droit. Je tombai, blessé à l’épaule droite. La balle était venue s’aplatir sur l’omoplate, après avoir labouré les chairs et fait une horrible blessure, large comme la main.
Une seconde salve succède presque sans interruption à la première. Elle abat tous ceux qui n’étaient point encore touchés et les malheureux qui, sur l’injonction: « debout », s’étaient relevés.
De toute cette masse humaine montent des cris, des lamentations, de pitoyables gémissements, des sanglots qui s’étouffent en râles d’agonie.
Et voilà que, sur toute cette lugubre mélopée de souffrance, éclate soudain, comme un rire satanique, la saccade crépitante d’une mitrailleuse. Mise en batterie à (p.68) quelques dizaines de mètres, elle nous prenait en enfilade et semait ses balles sur les monceaux de victimes.
Une douleur nouvelle me mord au côté gauche: j’avais le flanc ouvert, deux côtes brisées, le poumon gauche » perforé. Je perdis connaissance.
Quand je revins à moi, je souffrais horriblement.
J’étais incapable du moindre mouvement: sur mes » jambes, pesait de tout son poids un corps inerte. J’essayai cependant de me dégager: je n’y réussis pas d’abord ; mais, à force d’énergie, je parvins à retirer une jambe. Enfin, d’un suprême effort, je repoussai le corps » qui immobilisait l’autre jambe.
Les soldats qui rôdaient autour des tas, en quête d’une victime à égorger, s’aperçurent de ces mouvements. Deux hommes portant brassard de la Croix-Rouge, bondirent sur moi, le fusil en arrêt, la baïonnette au canon.
Une seconde fois, je pus croire que ma dernière heure était arrivée. Ces hommes se ruèrent sur moi et me lardèrent de coups de baïonnette dans le dos jusqu’au cou. Le sang m’inondait le visage.
N’en pouvant plus de douleur, je criai à ces brutes, en flamand: « Achevez-moi donc, tas de lâches! ». Alors, l’un d’eux promène la pointe de sa baïonnette sur mon cou, comme pour chercher l’artère carotide. Il m’en pique déjà, lorsque, d’instinct, je saisis l’arme par le tranchant et l’écarté violemment. Mon geste fut si brusque que j’en eus le médius et l’annulaire de la main droite tranchés jusqu’à l’os.
Cette résistance les met hors d’eux-mêmes et, jetant à terre leur fusil, mes bourreaux me saisissent chacun par un pied et me tirent hors du charnier. Ils riaient en m’entendant gémir, les barbares. Et, pour prolonger mon martyre, ils me traînent autour des cadavres amoncelés.
(p.69) Et moi, avec tout ce qui me restait de force, je m’accrochais à tout ce qui pouvait offrir quelque résistance. Me retournant sur le côté, pour retomber bientôt plus lourdement sur le dos, ils me traînaient toujours ; et ma pauvre tête, cahotée de droite et de gauche, rebondit sur le sol en des sursauts douloureux, tandis que mes vêtements balayant les cailloux et les cendres, soulèvent une épaisse poussière qui retombe sur mon visage ensanglanté et se coagule avec le sang dans mes plaies du dos et du cou. Et dans les blessures de mes mains, les cendres en » lave sanglante s’accumulent ; elles s’incrustent dans la peau de mon visage et dans mes cheveux et y forment une épaisse couche rugueuse.
Je ne croyais pas que l’on pût tant souffrir. Durant ce supplice, pas une seconde, je ne perdis conscience; j’ai tout senti et, à ces souffrances physiques, la pensée de ma chère femme et de mon petit enfant ajoutait encore les plus mortelles angoisses.
Quand ils m’eurent ramené au point de départ, je crus un instant qu’il allaient me laisser expirer tranquille. Mais non ! Ils me traînent jusque sur les bords de la Sam-» bre, et, comme si leur tâche à eux était accomplie, ils laissent lourdement retomber mes jambes. Quatre de ces » forcenés, alors, s’emparent de moi. Par les bras et par les jambes, ils me balancent et… eins, zwei.., comme une masse inerte, me jettent dans la rivière.
Cette dernière cruauté devait me sauver. Je coulai à fond, d’abord, mais l’eau, en entrant dans la bouche, calma la soif qui me dévorait. L’hémorragie de mes quatorze plaies fut arrêtée, et le froid me ranima quelque peu. Non sans peine, je parvins à me redresser et, touchant le fond, je tins ma tête hors de l’eau.
(p.70) Je ne pouvais demeurer longtemps ainsi. Déjà, mes membres s’engourdissaient; alors, pour gagner la rive hors de portée de mes bourreaux, je remontai le courant. Accroupi dans l’eau, marchant à quatre pattes, la tête émergeant, je me glissai péniblement sur une longueur » de vingt-cinq mètres en amont du pont. Il y avait là un » escalier en pierre pratiqué dans la berge. Je le gravis et, à bout de forces, je roulai évanoui sur le chemin de halage…
Combien de temps je restai là, je n’en sais rien ; mais, quand je revins à moi, je me remis à fuir droit devant moi, n’importe où. Je rampai une centaine de mètres plus loin ; mais je n’en puis plus et, épuisé, je m’affaisse et je tombe ; je me remets en mouvement une fois encore, je veux vivre assez pour ne plus retomber dans leurs mains. Un chantier de construction s’offre à mes pas. Là, peut-être, là, pourrai-je me cacher. Je passe à travers l’encombrement des matériaux et j’arrive à des fils de clôture qui me barrent la route: je pèse sur eux et je roule » dans un jardin. Je me relève encore. Il fait nuit noire ici. Je ne sais où je suis ni où je vais, je trébuche, je tombe, je me relève. Je n’ai qu’une idée: fuir!
Et voilà qu’un treillis métallique me barre de nouveau le passage. Retourner, par où? Je n’en ai plus la force. Mes jambes se dérobent sous moi ; je reste immobile un instant. Je grelotte, mes dents claquent, mes yeux se » voilent, et je tombe là, raidi dans la gaine de mes vêtements trempés.
Il était onze heures. J’ai su plus tard que j’avais mis trois heures à parcourir trois cents mètres.
Oh! l’effroyable nuit que j’ai passée là, à la lueur que faisait dans le ciel le rougeoiement des incendies qui finis-» saient!
(p.71) Vers trois heures du matin, mes gémissements attirèrent l’attention de M. Sylvain Detry. Lui aussi avait fui. Aidé de sa femme, il avait emporté son beau-père impotent, âgé de 82 ans, pour le soustraire aux flammes qui » dévoraient sa maison. Et tous trois, pour échapper aux Allemands, s’étaient tassés là, immobiles, dans le jardin Decocq.
Comme j’appelais au secours, M. Detry s’approcha » avec prudence et, à mi-voix, nous échangeâmes quelques mots: « Etes-vous blessé? — Oui. — Soldat français? — Non. — Belge? — Oui. » Un silence et bientôt après M. Detry, se laissant couler au-dessous de la clôture, se » trouva en face de moi. Il ne fut pas long à prendre une décision.
Rentrer dans son hangar, en rapporter une échelle, me la faire gravir en me soutenant et puis m’emporter à l’abri, fut l’affaire de quelques instants. On me coucha dans une couverture de fortune, sur un lit de briques. Je restai là cinq jours en compagnie de la famille Detry, n’ayant pour me désaltérer que de l’eau de pluie recueillie quelques semaines auparavant.
Le calme étant revenu, le 26 août, M. Detry, aidé de la Sœur Supérieure de l’Hospice de Tamines, me transporta à l’ambulance de l’école des Sœurs.
Le dévouement sans limite de M. le Dr Defosse et les soins d’un ambulancier volontaire et des bonnes Sœurs » qui m’hospitalisaient, m’aidèrent à guérir… »
Il faudrait un volume pour raconter dans le détail ces scènes atroces qui, d’ailleurs, défient toute description.
L’achèvement de chaque blessé constitue tout un drame qui restera pour jamais inconnu. Les égorgeurs étaient toujours à leur horrible besogne lorsque, soudain, retentirent des coups de feu au delà de la Sambre, dans la direction (p.72) de Falisolle ; c’étaient sans doute les décharges de sentinelles allemandes à l’adresse de quelques soldats français qui, chassés de leur abri par l’incendie, s’échappaient en traversant la rue.
Au même instant, un blessé cria: « A moi, Français ! »
Cette alerte dérangea les bourreaux dans leurs opérations. Laissant là le charnier, ils s’enfuirent à toutes jambes vers l’église où ils abritèrent leur lâcheté.
Est-ce alors que la scène prit fin?
Il semble qu’ils n’y revinrent plus qu’individuellement ou en sentinelles et que l’alarme provoquée par les coups de feu leur enleva l’envie d’assouvir plus longtemps leur soif de sang.
Combien de temps dura le massacre? Une demi-heure, d’après certains rescapés ; une heure, au dire des autres. Les soldats donnèrent ainsi le coup de grâce à tous les blessés qu’à la lueur de leurs lampes ou de leurs torches, ils parvinrent à découvrir. Dès que les victimes se rendirent compte que, pour sauver leur vie, il s’agissait de rester coi, et, malgré la douleur, de ne proférer aucun gémissement, les soldats eurent plus de difficulté à trouver les survivants.
Il est impossible de supputer le nombre des achevés. Certains témoins estiment que si le massacre de l’achèvement n’avait pas eu lieu, il y aurait eu la moitié moins de tués.
Bien que cette appréciation paraisse exagérée, il n’en est pas moins vrai que le nombre des victimes mises à mort par cette atroce boucherie doit atteindre un chiffre très élevé.
(p.73) CHAPITRE VIII
La nuit du 22 et la matinée du 23
En se retirant, les Allemands laissèrent sur la place quelques sentinelles.
Outre les blessés qu’ils n’avaient point achevés, il y avait là, couchés sous les cadavres et retenant leur haleine de peur de trahir leur présence, une bonne soixantaine d’hommes indemnes. Ils devaient leur salut au fait qu’ils occupaient surtout le centre du groupe, et à l’accumulation des cadavres sur eux. L’angoisse leur étreignait le cœur. Plusieurs, on l’a dit, prirent la fuite après la scène de l’achèvement. Parmi ceux qui restèrent, il en est, tel M. Franz Steinier, qui sentirent pendant une partie de la nuit couler sur leur figure, dans les oreilles et même dans la bouche, le sang de leurs concitoyens.
- Fernand Michaux rend bien l’impression de ces moments terribles: « Peu à peu, le calme se rétablit et je commençai à entendre du bruit derrière moi. Plusieurs même complotaient, à voix basse, de se sauver ; je tâchai de les en dissuader, de crainte que le bruit de la fuite n’attirât de nouveau les soldats et que le carnage ne recommençât.
De temps en temps, je tournais la figure pour respirer un peu plus librement, mais de peur qu’un soldat, venant à passer, ne me remarquât parmi les tués, je m’étais barbouillé la face du sang répandu à mes côtés. J’avais aussi par mesure de prudence, enlevé les bagues que je portais aux doigts, car, à plusieurs reprises, j’avais aperçu des mains frôlant les corps étendus, dans le but évident (p.74) de les dévaliser. Je craignais surtout d’avoir les doigts coupés.
Un de mes compagnons d’infortune me demanda si son fils n’était pas là, devant moi, et un dialogue s’engagea:
— Qui est-ce votre fils? demandai-je.
— Roger Kaise.
— Je ne le connais pas.
— II a un foulard blanc, là-bas, passez-le moi, s’il vous plaît.
Je tâchai alors, en évitant le plus possible de me montrer, de dénouer le foulard et de le rendre au père. Je n’eus pas besoin de poursuivre le dialogue: les sanglots du père m’apprirent le triste sort du fils. Quelques jours après, le père lui-même était amputé d’un bras.
A côté de moi, Louis Thibaut me suppliait de dégager sa jambe pour lui permettre de fuir. J’eus beau lui dire qu’elle était libre, le malheureux ne me croyait pas. Sa jambe brisée lui donnait l’impression qu’un lourd poids la tenait immobile. Il est mort peu après, des suites de l’amputation.
Derrière encore, M. Goffin père, dans la fièvre, suppliait sa fille Madeleine de lui donner à boire. A deux pas, son fils Louis gisait, mort. Devant moi, M. Descamps appelait son gendre et, ne recevant pas de réponse, s’en prenait à ses voisins. Dans sa fièvre, — il se croyait sans doute au charbonnage, où il était directeur des travaux — il offrait des journées de salaire à qui délivrerait son pied. Cet incident m’apprit la présence, sur le lieu du massacre, de mon ami Adolphe Seron, que je n’avais pas aperçu à l’église et, ne l’entendant pas répondre, je » me figurais que lui aussi était tué… »
(p.75) Pendant longtemps, après le départ des bourreaux, des blessés excédés par la souffrance, suppliaient qu’on les achevât. L’infortuné Hippolyte Robert, dont trois fils et un beau-fils furent tués et un quatrième fils blessé dans la fusillade, avait le corps et le côté tout abîmés par les balles. Ne pouvant supporter plus longtemps la douleur, il demandait qu’on lui donnât le coup de grâce: il ne devait pas tarder à succomber à ses blessures.
Quelques-uns, enfin, se faisaient leurs adieux dans l’attente de la mort. En dehors de ces plaintes, quelques coups de fusils — dernières escarmouches entre Allemands et Français — furent seuls, avec les cris sauvages que les Allemands poussaient sur la route de Falisolle, à troubler le lugubre silence qui planait sur Taniines.
Cependant, quelques survivants plus hardis, se hasardèrent peu à peu à lever la tête et à scruter l’horizon. Ecrasés sous les cadavres qui pesaient sur eux et les empêchaient de respirer, plusieurs devaient d’ailleurs se soulever pour humer un peu d’air. Dès qu’une pique de casque apparaissait, ils se couchaient à plat ventre ; puis, une fois le soldat disparu, ils se risquaient à redresser le buste, ils allaient même jusqu’à se tenir presque debout…
Pendant la seconde partie de la nuit, les supplications des blessés qui, altérés par la perte du sang, demandaient à boire, devinrent si pressantes qu’un brave se traîna par deux fois à la Sambre et y puisa, au moyen d’une bouteille, de l’eau qu’il tendit à ses compagnons d’infortune: c’était M. Ernest Labarre qui, lui-même, avait reçu dans les reins un coup de crosse de fusil.
Encouragés par tant d’audace, MM. Seron, Lucien Lar-dinois, Jules Lardinois — ce dernier blessé au genou — et quelques autres s’enhardirent à se relever ; ils se mirent au service des blessés et, qui avec un chapeau ou une bottine, (p.76) qui avec une bouteille, portèrent de l’eau de la Sam-bre aux malheureux martyrs: pour atteindre la rivière, il fallait, à certains endroits, enjamber les cadavres que les Allemands y avaient jetés.
Dans l’entretemps, le jour commençait à poindre. Au fur et à mesure que les lueurs de l’aube dissipaient les ténèbres, un effrayant spectacle apparaissait; c’est alors seulement que les survivants se rendirent compte des proportions et de toute l’horreur du drame.
Un immense charnier, d’une quarantaine de mètres de longueur sur cinq de large, les entourait: les cadavres amoncelés se confondaient dans un inextricable enchevêtrement, tordus par la souffrance. Des crânes versaient leur cervelle, des têtes étaient écrasées, des jambes broyées, des poitrines défoncées, des corps sans tête ; partout des débris de cervelle et de chair ; ça et là des entrailles saignantes ; de tous côtés des éclaboussures de sang…
C’est près du poteau télégraphique que l’entassement des cadavres était le plus compact. Sur la déclivité du lit de la Sambre, on voyait surnager plusieurs têtes; on aurait dit que ces infortunés n’avaient renoncé à la vie qu’après avoir déployé une suprême énergie pour revenir vers le bord et tenter de se sauver.
Au commencement de cette matinée, se produisit le pénible accident qui coûta la vie à M. Descamps. Lors de la mise en rangs des civils, le samedi soir, M. Seron, qui est bon nageur, avait supplié M. Descamps, son beau-père, de se jeter à la Sambre avec lui. Il avait obstinément refusé. Au commencement de la fusillade, le vieillard avait été épargné, grâce à l’énergique rapidité avec laquelle M. Seron l’avait soustrait aux balles en le précipitant à terre. Malheureusement, ces émotions violentes avaient ébranlé sa raison. A la pointe du jour, il s’était relevé et ne (p.77) donnait aucun signe apparent de folie, lorsqu’un peu plus tard, pris d’un accès de fièvre chaude, il profita d’un moment où son beau-fils donnait les premiers soins aux blessés pour se jeter à l’eau. Les efforts pour le sauver furent vains.
Cependant, quelques blessés, sentant la mort venir, réclamaient le ministère d’un prêtre. M. Seron se mit en devoir d’en trouver un: M. l’abbé Docq et M. le Curé des Alloux étaient tous deux morts à quelques mètres de distance. Plus loin, il aperçut le bord de la soutane d’un prêtre qui gisait apparemment inanimé, la face contre terre. Il s’approche et constate que M. le vicaire Donnet, bien que grièvement blessé par deux balles dans les reins, est cependant capable, pourvu qu’on le soutienne, de porter aux mourants le dernier apaisement. M. Seron le dégage, le relève et l’accompagne près de ceux qui désiraient son aide. A la vue du prêtre qui se dresse, intrigués de le voir aller avec mystère de groupe en groupe et se pencher vers les mourants, les soldats de garde, l’arme au poing, s’approchent soupçonneux et suivent d’un œil méchant son geste de pardon. Ils laissent faire cependant.
Il pouvait être six heures ou six heures et demie du matin.
A la prière de quelques rescapés, M. Seron se décide à se mettre en rapport avec les Allemands, pour obtenir des éclaircissements sur leurs intentions ultérieures. Dans ce but, il avise le corps de garde qui se tenait près de l’église, et, agitant son mouchoir tout teinté de sang, il essaye d’entrer en pourparlers avec lui. En même temps, il se met en devoir de s’avancer. Mais, à peine a-t-il franchi quelques-mètres, qu’il est couché en joue par les soldats. Il parvient néanmoins à faire comprendre l’objet de sa démarche et on lui dit: « Le commandant va venir ». Quelques temps après, on vit en effet, paraître un grand et bel homme, qui (p.78) semblait être un officier. A son approche, la plupart des survivants crient: « Grâce ! » et plusieurs veulent parler en même temps. « Vous étiez ici hier soir? » demande-t-il. Sur les réponses affirmatives, il ajoute: « Je ne vous crois pas, vous êtes venus ici pendant la nuit: montrez-moi vos blessures ». Il dut se rendre à l’évidence. — « Vous avez tiré sur nos soldats», affirme-t-il. — «Non, non! nous jurons le contraire! », répliquent les malheureux. — « Vous jurez tous mal! » dit-il en terminant, « restez là ». M. Se-ron s’approche alors et lui demande la permission d’aller chercher de l’eau propre pour soigner les blessés. « II n’y a pas de blessés ici », répondit-il, et il disparut, s’en retournant comme il était venu (1).
Cet homme devait être moins méchant que ses paroles ne le donnaient à penser, car, au cours de la matinée, on apprit qu’il avait envoyé — du moins le lui attribue-t-on •— un rapport favorable sur la décision à prendre au sujet des survivants.
La visite de cet officier avait produit sur ces pauvres gens une impression de découragement: ses paroles n’avaient rien que de cassant et ne laissaient percer aucune lueur d’espoir. Ils les prirent pour un nouvel arrêt de mort. A partir de ce moment, ceux chez qui l’excès de la douleur morale n’avait pas complètement émoussé la faculté de souffrir, s’abandonnèrent à l’angoisse et même au désespoir. Ils croyaient n’avoir échappé au massacre de la veille que pour subir, en pleine conscience et après expérience, le
(1) Pendant la première partie de cette matinée, un officier vint devant les fusillés et accusa les survivants d’avoir fait usage d’armes à feu contre les troupes allemandes. Les Tann’nois affirmèrent le contraire. Il indiqua alors du geste, en disant « là-bas », la route de Falisolle où auraient eu lieu ces violations des lois de la guerre. Les victimes répliquèrent que ce n’était plus Tamines. Il répondit simplement; «Ah! ce n’est plus ‘Famines ! », et il partit. Est-ce le même officier que celui dont il vient d’être question? L’identification n’a pas été possible.
(p.79) sort des compagnons d’infortune étendus à leurs pieds. Pendant cette scène, l’interminable migration d’un peuple en armes, marchant à la conquête de la France, défilait à côté d’eux. Des détachements venaient camper en face et terrorisaient encore ces malheureux qui, demi-morts déjà de frayeur, se répétaient entre eux: « Le moment fatal est arrivé ! ». Des groupes nouveaux de soldats, des automobiles, du charroi passaient sans cesse et s’engageaient sur le pont, vers Falisolle. Des bataillons menaçants s’arrêtaient devant eux et se livraient à des simulacres qui n’étaient que trop bien compris des victimes. Dans leur affolement, celles-ci leur adressaient des supplications en grâce et des saluts inconscients. Toutes ces manœuvres prolongeaient leur supplice et leur faisaient regretter de vivre encore: « Puisque nous devons mourir, se disaient-ils, pourquoi nous faire attendre si longtemps! ». Cette torture morale se prolongea jusque dans l’après-midi, plus douloureuse que les souffrances endurées la veille pendant la fusillade et l’achèvement.
Quoi d’étonnant, dès lors, si plus d’un survivant, complètement démoralisé par cette incertitude, excédé par le cauchemar d’une fin qu’il croyait prochaine, n’y tenant plus, voulut mettre un terme à ses souffrances en se jetant à l’eau ? Malgré l’état de faiblesse où le réduisaient ses blessures, M. le Vicaire des Alloux dut plus d’une fois intervenir, pour rappeler ces pauvres désespérés au sentiment du devoir.
Quelques autres, tels MM. Félix Servais, Auguste Fournier, Georges Steinier, épiaient les gestes des Allemands: se promenant de long en large ou s’asseyant près de la berge, ils s’étaient donné le mot pour sauter à la rivière, au moindre mouvement qui eût trahi, chez les soldats, l’intention sérieuse de recommencer la fusillade.
(p.80) Durant ces heures cruelles, de malheureux blessés, privés de tout secours efficace, souffrant une agonie insupportable, étaient en proie aux affres de la mort. Leur vie s’écoulait goutte à goutte avec le sang: dépourvus de moyens pour arrêter l’hémorragie, se tordant les bras de désespoir, les indemnes assistaient impuissants à leurs derniers moments.
Entre huit et neuf heures, un médecin allemand, accompagné d’un jeune soldat qui parlait le français, arrive vers le tas de victimes et demande à s’entretenir avec un homme sachant l’allemand. M. Van Heuckeloom se présente et le médecin explique qu’une estafette a été envoyée à l’état-major du régiment, afin de savoir ce qu’il faut faire des survivants. Il ajoute que, dans deux heures, on sera fixé sur leur sort. En attendant la réponse, il permet aux hommes valides de fumer, de rester debout, mais leur défend de circuler. En même temps, il donne à M, Franz Steinier l’autorisation d’aller chercher de l’eau pure à la borne-fontaine située à l’autre extrémité de la place, près de l’église. Escorté d’un soldat et muni d’un seau, M. Steinier, pourvoit au désir des victimes.
Pendant ce temps, plusieurs soldats parcourent le champ du carnage. Parmi eux se signale surtout un jeune Allemand que les uns prennent pour un sous-officier, les autres pour un simple soldat. Il a l’air plus humain. Il considère longuement le spectacle affreux qui s’offre à sa vue. En contemplation devant le monceau de cadavres, il se déplace pour se rendre compte de l’étendue du massacre ; les bras croisés, les yeux pleins de larmes, il branle la tête comme pour marquer une réprobation. Il demande aux blessés qui pouvaient encore parler, s’ils souffrent beaucoup. Il interroge M. Lardinois père, sur la nature de la blessure qu’il a reçue. Celui-ci répondit qu’il avait été percé d’un coup (p.81) de baïonnette dans le flanc. Le soldat dit alors en son langage élémentaire: « Baïonnette, baïonnette, pas possible ! » Et il se dirige vers un autre groupe en branlant à nouveau la tête. Le voyant s’attendrir et témoigner aux victimes une réelle sympathie, M. Seron essaye de lier conversation avec lui. L’Allemand déclare qu’un rapport a été adressé à l’Etat-major, concluant à la pitié et demandant d’épargner les survivants. La réponse arrivera vers midi. Il promet à M. Seron, sous le sceau du secret, de lui communiquer la réponse, et, pour fournir une garantie de sa sincérité, il exhibe son chapelet. Dans l’esprit des soldats, les Belges étaient des fanatiques, aveuglément soumis à l’autorité des prêtres et capables de tout pour défendre leur religion. Ce préjugé explique comment le soldat compatissant sortit son chapelet pour inspirer confiance. Il prend sa gourde et, leur soulevant la tête, il offre à boire à plusieurs blessés. Il tire de sa giberne des galettes qu’il leur donne et, comme M. Seron lui manifeste le désir de fumer, il va chercher des cigares et les distribue. C’est lui, probablement, qui apporta dans une corbeille du pain et des miettes de biscuits. Ces témoignages de pitié provoquent chez les autres soldats des marques de désapprobation. Au moment où il donne à boire aux blessés, un sous-officier se dirige vers lui, en lui adressant des reproches et lorsqu’il retourne vers l’église, ses camarades le reçoivent avec des gestes et des mots pleins de menace. Cette hostilité ne l’empêche toutefois pas de revenir, vers midi, annoncer à M. Seron que les survivants ne seraient plus fusillés, mais qu’ils seraient dirigés vers Fleurus, pour être ensuite remis en liberté (1).
(1) L’un ou l’autre témoin prétend qu’il faut ici dédoubler le personnage : les marques de pitié, la scène du chapelet et la distribution des biscuits doivent être attribués non à un, mais à deux ou même trois individus.
(p.82) M. Félix Bodart, brancardier, avait, pendant toute la journée du samedi, soigné les blessés allemands à l’école de la rue des Alloux. Le soir, il sort de l’ambulance pour s’enquérir de sa famille. Malgré le brassard de la Croix-Rouge, qu’il porte ostensiblement, malgré sa carte officielle de brancardier de la Croix-Rouge, qu’il exhibe à plusieurs reprises, les Allemands le forcent à se rendre à l’église des Alloux et à prendre place dans le cortège. Il ne fut pas blessé dans la fusillade. Dans le cours de la matinée, il insista plusieurs fois, en montrant son insigne et sa carte, pour être remis en liberté: toujours même refus. A la fin, à force de démarches, on lui permit d’aller à l’église Saint-Martin porter ses soins aux soldats blessés.
Parmi les événements principaux qui caractérisent cette matinée, il faut encore signaler l’incident qui se passa à propos du vieux Laporte. Il était sans blessure, mais la commotion de cette tragédie et les souffrances physiques qu’il avait endurées, avaient sans doute fini par ébranler sa raison. Dans son délire, sans tenir compte des défenses allemandes, il s’obstinait à vouloir s’enfuir ou se jeter à l’eau. On eut toutes les peines imaginables à le retenir. A cette vue, les sentinelles s’approchent et déclarent que, si le vieux quittait la rive, tous les autres seraient fusillés. C’est peut-être à l’occasion de cet incident qu’on intima aux hommes valides l’ordre, qui d’ailleurs ne fut pas respecté jusqu’au bout, de se tenir dans l’espace libre entre les cadavres et la Sambre.
Après dix heures, l’une des deux sentinelles qui montaient la garde sur le pont, s’aperçut, en voyant Lucien Lardinois porter à boire aux blessés, qu’il y avait des enfants dans le groupe des fusillés. Il appela le jeune homme, lui demanda son âge et s’il était blessé ; il répondit qu’il était indemne mais que son frère Jules, âgé de 13 (p.83) ans, se trouvait parmi les victimes et qu’il avait été atteint d’une balle au-dessous du genou. Le soldat lui demanda encore si d’autres adolescents avaient été touchés, ajoutant que les jeunes gens de 15 à 19 ans étaient immédiatement pansés par les Allemands. Défense lui fut faite de s’enfuir, sous menace d’être fusillé. L’Allemand le renvoya ensuite et lui promit de le rappeler. En effet, vingt minutes après, le voici qui fait signe à Lucien Lardinois de venir lui parler. Il donna l’ordre à ce dernier ainsi qu’à trois autres jeunes gens (Jules Lardinois, Marcellin Dullier et Ernest Thomas) de rejoindre le groupe des femmes et des enfants, qui, déjà arrivés de chez les Frères, se trouvaient à l’extrémité de la place en face de l’église.
Pendant toute la matinée, les Allemands arrêtaient les civils, Taminois et étrangers, qui circulaient dans les rues, et ceux qu’ils découvraient dans les caves: ils les parquèrent à proximité de l’église, en attendant de statuer sur le sort de la population tout entière.
7
CHAPITRE IX Les civils réfugiés chez les Frères
L’Institut Saint-Jean-Baptiste, desservi par les Frères des Ecoles Chrétiennes, avait été, dès avant l’arrivée des Allemands, aménagé en ambulance de la Croix-Rouge. C’est là, qu’instinctivement, lors de la bataille et des incendies, beaucoup de Taminois, surtout ceux du bas du village, cherchèrent un refuge. Ils commencèrent à affluer pendant la seconde partie de la nuit du vendredi au samedi. Blottis (p.84) dans les caves, ou abrités dans les locaux de l’établissement, car les Allemands ne vinrent occuper la Croix-Rouge que dans la soirée du samedi, ils attendaient l’issue du combat et la fin des incendies. Les lueurs du feu qui consumait Tamines étaient la seule lumière qui éclairât leur retraite. Ils étaient là, pêle-mêle, à l’abri du danger. S’ils ne furent pas, jusqu’à quatre heures de l’après-midi, molestés par les Allemands, leurs appréhensions et leurs anxiétés n’en furent pas moins aiguës. Pendant la journée du samedi, on circulait dans la maison, on devisait librement, tandis que d’autres civils, expulsés de leurs maisons par les flammes, affluaient de plus en plus nombreux. Dans la soirée, les Allemands firent la visite de l’Institut: ils le parcoururent de la cave au grenier, ouvrant portes, armoires et chambres. Ils voulaient s’assurer qu’on n’y recelait ni gens suspects, ni munitions de guerre. La perquisition terminée, les réfugiés furent partagés en deux groupes: les hommes passèrent la nuit debout, entassés dans le réfectoire de la communauté ; les femmes et les enfants furent envoyés dans les caves.
Les hommes reçurent la défense de sortir ou de bouger, et deux sentinelles furent postées devant la porte de la salle. Alors, on les fit venir un à un, pour les fouiller, puis, en attendant la fin de l’opération, on les rangea dans le corridor. Les Allemands trouvèrent sur un ouvrier, étranger à la commune, un reste de cartouche •— douille ou balle — qu’il avait ramassé sur le chemin. Aussitôt, ils se mirent à insulter, à bousculer, à maltraiter le pauvre homme, et, le poussant dans la salle d’étude des Frères, ils s’apprêtaient à lui faire un mauvais parti, peut-être à le fusiller, lorsque M. le chanoine Crousse et M. le pharmacien Crousse, s’interposant, se portèrent garants de l’innocence et de l’honnêteté du brave ouvrier.
(p.85) Après la visite, durant laquelle les Allemands ne découvrirent ni armes ni cartouches, les hommes rentrèrent dans le réfectoire et les soldats descendirent dans les caves pour fouiller à leur tour les femmes et les enfants.
Le dimanche matin, M. le Curé de Saint-Martin célébra la messe dans la chapelle des Frères: le petit Célestin Du-culot la lui servit. La chapelle étant trop petite pour les contenir, les réfugiés suivirent l’office au son de la clochette. M. le Chanoine Crousse avait au préalable consommé les Saintes Espèces.
Après la messe — entre neuf et dix heures, — on fit sortir les hommes de la maison et on les aligna dans la cour par rangs de quatre. En même temps, on leur annonça qu’on allait les conduire à Fleurus. Les femmes furent aussi amenées dans la cour. A la vue des hommes prêts à partir, les femmes et les enfants sanglotaient et se lamentaient: « Les femmes reverraient-elles leurs maris, et les enfants, leurs pères? Où les conduisait-on? ».
Encadré de soldats en armes, le cortège sortit de l’établissement des Frères et, au lieu de prendre la rue de Fleurus, enfila la rue du Collège par la brasserie Cochet, puis descendit la rue Saint-Martin qui mène à la Grand’Place. On groupa ces hommes à côté de l’église, en face des maisons incendiées de M. Loriaux et de M. le vétérinaire Broze.
Il leur fallut un certain temps pour se reconnaître au milieu de l’enchevêtrement des soldats, des civils qui attendaient là depuis le matin, des fusils en faisceaux, de l’entassement des cadavres.
Leurs impressions furent différentes et ne se précisèrent que lorsque les preuves du massacre firent éclater l’évidence.
(p.86) M. Emile Duculot raconte ainsi les siennes: « Lorsque nous arrivâmes sur la place, tout était confus pour moi. Les premiers concitoyens que je vis, furent Franz Steinier et Seron. Il y avait là, le long de la rive, un immense tas, un énorme matelas que je pris d’abord » pour des loques, du linge, des vêtements. C’était une masse informe. Ce qui me frappait dans ce mélange de choses et de gens que je ne distinguais pas, c’était de voir au milieu du tas, Léon Kaise soutenant son bras, comme s’il eût été blessé; et j’apercevais de temps en temps un bras qui émergeait, une tête qui se soulevait, et nous nous faisions remarquer les uns aux autres ces incompréhensibles mouvements. Mais cela se précisa dans » mon esprit: ce sont les soldats allemands, pensais-je, qui ont été tués au passage du pont. Peu à peu cependant, » nous nous rendîmes compte de la réalité en reconnaissant nos concitoyens ; nous comprîmes que c’était bien des civils qui se mouvaient; je voyais aussi le Vicaire qui allait d’un homme à l’autre pour les confesser ». M. le Chanoine Crousse s’exprime comme suit: « En arrivant sur la place, ce qui m’a le plus frappé, c’est de voir émerger des vivants et je me demandais ce qu’ils faisaient là: j’avais reconnu M. Seron et un prêtre: c’était M. le Vicaire des Alloux que je ne connaissais pas encore. Je croyais que les cadavres étaient des soldats morts.
Nous contemplons le tas de cadavres le long de la Sambre, nous nous voyons entourés de soldats en armes qui remplissent toute la place. Je demande à mes voisins: » Que va-t-on faire de nous? ». On me répond: « Nous fusiller comme les gens de Tamines qu’on a massacrés hier. Voyez-vous, là-bas, étendus et tués, l’abbé Docq et le Curé des Alloux?». Je n’y comprenais rien…; probablement (p.87) que des survivants de la fusillade s’étaient rapprochés de nous. »
Et ce fut, pour ces hommes qui venaient d’arriver, le commencement d’un atroce supplice. Depuis dix heures du matin, jusque vers une heure de l’après-midi, ils restèrent là dans une complète inaction, en proie à toutes les angoisses, à toutes les menaces, à la frayeur surtout d’être passés par les armes, comme leurs concitoyens étendus tout près d’eux.
Les soldats faisaient l’exercice: à chaque pose, ils brandissaient leur fusil comme pour faire feu sur les civils ; leurs paroles étaient menaçantes, leurs figures respiraient la vengeance. Ceux qui savaient un peu de français accusaient les hommes d’avoir tiré sur eux et traduisaient le langage furieux de leurs camarades. Ici encore, les quatre prêtres présents — MM. le Chanoine Crousse, le curé de Saint-Martin et son vicaire, le curé de Brie, de passage à Tamines — étaient l’objet de violentes invectives.
Au milieu de la place, se promenait à grands pas, provocateur et arrogant, l’officier que certains regardèrent comme celui qui, la veille, avait donné l’ordre de la fusillade. L’impression qu’ils en ont conservée est que sa face ne reflétait plus rien d’humain. Ses ordres cassants, ses cris de fureur, ses gestes effrayants affolaient les prisonniers. Ils croyaient que leur tour allait venir.
Les émotions de la veille avaient été trop violentes pour qu’ils conservassent le calme de l’esprit, et se rendissent compte, de sang-froid, que toutes ces menaces n’étaient que simagrées: le monceau de cadavres à leurs côtés ne leur montrait-il point que les Allemands ne badinent pas?
Au reste, un sous-officier qui, pendant cette matinée, accompagna M. Emile Duculot à l’établissement des Frères, (p.88) pour y reprendre un objet, affirma qu’on allait fusiller d’abord les hommes, puis les femmes et les enfants.
Convaincus que sous peu une balle allait les étendre à côté de leurs concitoyens, tous, sauf deux ou trois, eurent à cœur de chercher dans la Religion une suprême consolation. Les prêtres accomplirent avec un dévouement parfait un devoir à la fois patriotique et religieux en préparant ces malheureux à accepter courageusement la mort. Avec une belle résignation, tous ces hommes offrirent à Dieu leur vie pour le bonheur de leurs familles et le salut de la Patrie.
Ils étaient beaux à voir et sublimes dans leur foi, ces courageux martyrs qui, sans fausse honte, tous ensemble, ployaient le genou sous l’absolution des prêtres, chaque fois que les commandements sauvages des instructeurs, le cliquetis des armes et les gestes menaçants des soldats leur donnaient l’illusion que la fusillade allait recommencer. Beaucoup portaient ostensiblement autour du cou le scapulaire ou le chapelet.
Pendant tout le temps que dura ce long martyre, les prêtres entendirent les confessions: les soldats protestants étaient très intrigués de ces colloques mystérieux, ils n’y comprenaient rien. L’un ou l’autre camarade catholique dut leur en expliquer la signification.
Au cours de la matinée, les Allemands poussèrent, dans le groupe, Louis Lorette qui s’était trouvé la veille dans la foule des victimes. Il s’était jeté à l’eau pendant la fusillade et glissé le long de la Sambre jusqu’à l’endroit où elle côtoyé les prairies. De là, il gagna la maison de M. Sohier où, s’étant caché, il se croyait en sûreté. Le lendemain il fut repris par les Allemands et reconduit sur la place: il pensa cette fois subir le sort auquel il avait, la veille, échappé par miracle, (p.89) Dans l’entretemps, les femmes réfugiées chez les Frères avaient été escortées sur la place et massées en face du portail de l’église, près de la borne-fontaine où l’on venait puiser l’eau pour les blessés de la fusillade.
Il se passa alors parmi les femmes des scènes à fendre Tâme.
Comme elles croyaient aussi que les hommes allaient être fusillés, elles s’abandonnaient à la sentimentalité naturelle à leur sexe: c’étaient des explosions de larmes et de lamentations. Après l’agitation de la veille et l’insomnie de la nuit, elles avaient perdu tout contrôle sur leurs nerfs. Quelques-unes demandèrent à leurs gardiens la permission d’aller dire un dernier adieu à leurs maris: les Allemands, bons enfants pour une fois, se laissèrent attendrir. Constatant qu’on accordait facilement cette permission, beaucoup d’entre elles se précipitèrent, pour l’obtenir; les soldats, débordés, refusèrent. D’autres femmes étaient allées chercher des chaises dans la maison voisine que les flammes n’avaient pas complètement anéantie, et montaient dessus pour se montrer à leurs maris, et leur envoyer de la main des adieux désespérés. Au fur et à mesure que le groupe des hommes grossissait de l’affluence de ceux que les Allemands ne cessaient d’arrêter, les inquiétudes de ces infortunées grandissaient: elles étaient persuadées que les hommes, et elles-mêmes à leur tour, allaient être fusillés. Plusieurs s’évanouirent.
Cependant, les hommes, de leur côté, répondaient aux femmes et aux enfants: ils échangeaient avec eux des gestes de suprême adieu. Ils écrivaient sur de petits morceaux de papier leurs dernières volontés, leurs suprêmes recommandations et assuraient leurs proches de leur courage en face de la mort: « Nous mourons pour Dieu et pour la Patrie».
(p.90) Les enfants prisonniers se faisaient les messagers de ces billets.
Les Allemands avaient joint tous les enfants au groupe des femmes: au moment où ils prirent cette décision, Cé-lestin Duculot, âgé de onze ans, qui était parmi les hommes, déclara qu’il ne quitterait pas son père, qu’il voulait mourir avec lui. Il fallut le forcer à rejoindre les femmes.
Vers midi, un officier fit savoir aux femmes qu’on ne fusillerait plus. Cette nouvelle, que beaucoup ne voulaient point croire et à laquelle la vue du monceau de cadavres ne permettait plus d’ajouter foi, n’eut pas le don de les calmer. Les hommes, d’ailleurs, l’ignoraient, ou du moins ne l’apprirent pas en bloc, ou encore, ne la voulurent pas croire. Les signes d’adieu se prolongèrent donc jusqu’au moment où le groupe des hommes, comme on le verra bientôt, fut dissout sur l’ordre des Allemands. Quelques femmes, qui s’étaient laissées persuader par cette promesse, demandèrent et obtinrent la permission d’aller, sous escorte, chercher dans leurs maisons quelques objets indispensables, car on leur avait appris en même temps que les civils allaient être conduits à quelques kilomètres de Tamines.
Tandis que les Taminois se livrent à ces manifestations d’adieu, et s’arment de courage pour affronter la mort, voici paraître quelques officiers qui font dresser une table au milieu de la place. Ils mangent copieusement et sablent le Champagne dans de grands verres à bière.
Un officier s’approche alors de l’église, dégaine son épée et en donne de grands coups contre le soubassement en pierre de l’édifice, à l’endroit biseauté où la pierre rejoint la maçonnerie. Il semble être en proie à une violente colère. On dirait qu’il veut briser la lame, tant il frappe avec énergie. On en voit encore aujourd’hui les traces dans la pierre. Il remet l’arme au fourreau et se tourne vers les soldats (p.91). Il leur parle en un langage qui respire à la fois la force et la fureur. Les Taminois qui assistèrent à cette scène croyaient que leur heure suprême était venue et que l’officier excitait les soldats à se rassasier du sang des survivants.
Ce fut ensuite le tour des soldats à prendre leur repas: ils vident leur bouteille de Champagne et fument rageusement leur cigare. Ils lancent en l’air, dans la direction des malheureux captifs, les bouteilles vides qui retombent à leurs pieds. « On enivre les soldats pour leur donner plus de rage à nous tuer », disent les uns ; « on les anime au carnage, nous allons y passer », répètent les autres.
Heureusement, leurs suppositions étaient fausses: la sinistre comédie allait bientôt prendre fin. Après le repas, en effet, quatre cavaliers arrivent au milieu d’eux: ce sont, semble-t-il, des officiers, porteurs d’un message. Ils échangent quelques mots avec leurs collègues, puis, leur mission terminée, sans même prendre la peine de descendre de cheval, ils tournent bride et rebroussent chemin.
On conjecture que ces cavaliers ont, en réponse à la requête du commandant, apporté la nouvelle que le reste de la population taminoise serait épargné mais qu’il fallait enterrer les cadavres. (1)
De fait, l’un de ceux qui venaient de dîner si joyeusement s’approche et demande aux Taminois si quelqu’un comprend l’allemand. M. Gustave Moriamé s’avance.
(1) Le souci de l’exactitude nous oblige à ajouter que cette opinion n’est pas générale parmi les survivants : un officier, venu en automobile de la direction de Falisolle, aurait été le messager de cette nouvelle et de cet ordre.
(p.92)
CHAPITRE X
L’enterrement des fusillés et le départ pour Velaine
- Moriamé transmet les ordres des chefs allemands. « Que ceux qui peuvent travailler s’avancent! » Une quarantaine de civils, faisant partie du groupe des hommes qui stationnent devant la maison Broze, se portent en avant. Il s’agit de creuser une grande fosse dans le jardin Steinier attenant à la place et longeant la Sambre, à gauche: c’est là qu’on enterrera les morts. Quant aux blessés, on les soignera après, s’ils sont « bien sages » ! Chacun reçoit donc Tordre de prendre un outil, pelle, pioche ou bêche, et de se mettre à la besogne. Conduits par un soldat, les terrassiers improvisés entrent dans le jardin et creusent un énorme trou de dix mètres de long et cinq mètres de large.
La fosse achevée, les soldats apportent tout un matériel de transport: des échelles, des brouettes, des planches, des panneaux de chariots, qu’ils avaient été chercher dans le village; des portes et des volets qu’ils arrachent sous les yeux des Taminois aux maisons incomplètement brûlées à côté de l’église. Ce fut ensuite le tour des hommes qui n’avaient pas travaillé au creusement de la fosse, à prendre ce matériel de fortune et à transporter les cadavres à la tombe commune.
Alors, se révéla dans toute sa laideur le spectacle de la tragédie. Au fur et à mesure qu’on enlevait les cadavres, on se rendait compte de la blessure qui avait déterminé la mort; par suite de l’enchevêtrement qui reliait tous ces corps, tombés pêle-mêle, il fallait les tirer par les bras, par les jambes, par le buste, comme on pouvait. On les chargeait (p.93) ensuite sur les civières improvisées. Les planches qui servaient au transport ne pouvant être saisies qu’aux deux extrémités et s’infléchissant sous la charge, il se produisait, pendant le trajet de la place à la fosse, un balancement sinistre qui, en semblant rendre au cadavre je ne sais quelle apparence de vie et en se combinant avec la laideur de la blessure, ajoutait encore à l’horreur du tableau.
Rien n’était douloureux comme le spectacle d’un père qui retirait son fils mort, d’un fils qui découvrait le cadavre de son père: Joseph Warnier cherchait et retrouva son fils Albert, âgé de dix-neuf ans, qui venait de remporter, au mois de juillet, son diplôme d’instituteur. Aidé de son fils Léon, il transporta sur une planche la chère dépouille.
Joseph Dogot, étudiant à Floreffe, s’approchait du monceau de victimes, pour les transporter à son tour et allait se diriger, sur l’invitation de M. E. Duculot, vers le cadavre de Charles Decocq, lorsque tout-à-coup, son œil épouvanté rencontre le corps inerte de son père. Il pousse une douloureuse exclamation en le reconnaissant: « Mon papa, mon papa ! » En effet, son père était sur les genoux, la face contre terre, tué. Puis, s’adressant à M. le chanoine Crousse, il reprend: « Est-ce malheureux! le premier cadavre que j’ai rencontré, c’est celui de mon père! — « Acceptez le sacrifice au nom de votre père, dit M. le chanoine ; et, comme vous avez l’intention de devenir prêtre, offrez-le d’abord à Dieu avant de vous offrir vous-même. »
Les prêtres eux aussi, sauf le vénérable chanoine Crousse que les Allemands avaient désigné pour la bénédiction de la fosse, furent obligés de transporter les morts. Le vieux curé de Saint-Martin, dont une raideur dans la jambe rend la marche difficile, fut forcé de transporter un corps sur une brouette: c’était celui d’Alidor Hannoulle. Le père accompagnait la dépouille mortelle à la fosse: il essuyait, de son (p.94) mouchoir de poche, le visage de son fils et l’embrassait avec douleur.
Cent autres exemples enlaidiraient le tableau.
Au fond de la fosse, quelques civils recevaient les fusillés et les couchaient en ordre: on les laissait glisser sur les planches jusqu’en bas, puis on les rangeait par tas plus ou moins réguliers, pour ménager la place. Au sommet, on les déposa pêle-mêle, les uns sur les autres. Au fur et à mesure qu’on les apportait et qu’on les étendait dans la fosse, on les reconnaissait et l’on disait, avec des exclamations de douleur contenue: « Un tel ! c’est bien lui… Et cet autre!… Pauvres parents! Pauvres orphelins! »
Comme l’enterrement procédait trop lentement, les civils qui avaient creusé la fosse, puis les survivants du massacre eux-mêmes reçurent l’ordre d’aider au transport. M. le vicaire des Alloux ne pouvait, vu ses blessures, obéir à cet ordre: un officier, ignorant probablement la gravité de son état, lui dépêcha un soldat qui parlait français, afin de l’obliger à porter les cadavres ; le prêtre s’excusa, disant qu’il était incapable de fournir cette besogne, et, comme preuve, il montra les blessures qu’il avait reçues dans le dos. L’Allemand n’insista pas.
Bien qu’au témoignage des assistants, un médecin allemand ait examiné les corps pour constater les décès, plusieurs rapportent que des blessés respirant encore furent descendus dans la fosse: le fils Lambotte dut supplier en pleurant qu’on n’y jetât pas son père, qui vivait encore et qui ne mourut que le lendemain. L’examen des morts par le médecin allemand ne pouvait être que sommaire, car leur nombre était trop grand et trop rapide l’opération de l’enterrement.
Une escouade de civils fut détachée pour chercher les Taminois carbonisés dans les immeubles incendiés, entre (p.95) autres, chez Hennion et Mombeeck. Leurs restes calcinés furent aussi déposés dans la tranchée.
Alors les prêtres furent chargés de bénir la fosse ; M. le curé de Saint-Martin récita l’absoute. Après les prières, les Allemands obligèrent les hommes valides à faire le tour de la tombe. Le but de ce défilé, dans l’esprit des Allemands, était évidemment, en laissant aux civils une dernière impression de terreur, de leur ôter l’envie de tirer sur les troupes. Enfin, le trou fut comblé par une couche de terre de trente centimètres d’épaisseur. Le nombre des cadavres qui y furent enterrés dépasse le chiffre de trois cents.
Les blessés restaient toujours sur place et sans autre soulagement qu’un peu d’eau pour se désaltérer. Ceux qui pouvaient encore marcher rejoignirent le groupe des hommes devant la maison Broze. Quelques autres pénétrèrent dans la ferme Couvreur ou se rendirent à l’église, qui, transformée en ambulance, était bondée de soldats blessés. Quant aux impotents, dont on peut affirmer qu’un grand nombre, faute de soins, ont été victimes de l’infection, ils furent recueillis pendant et après l’inhumation, et alors seulement transportés à l’église. Beaucoup moururent des suites d’une exposition prolongée au froid de la nuit et à la chaleur du jour, n’ayant reçu aucun soin de huit heures du soir au lendemain à trois heures de l’après-midi. M. J.-B. Demou-lin, blessé à mort par la mousqueterie de la fusillade, souffrait tellement qu’au moment de l’inhumation il supplia M. Emile Chaltin de le prendre lui aussi et de l’enterrer vivant. On le transporta à l’église, où il ne tarda pas à expirer.
L’enterrement terminé, les prisonniers s’imaginaient toujours qu’on allait les fusiller. Les rares privilégiés à qui on avait assuré le contraire, gardaient jalousement leur secret, (p.96)
de peur de provoquer chez leurs concitoyens de compromettantes explosions de joie.
Il s’était établi, entre M. le pharmacien Crousse et le médecin allemand, une espèce de confraternité professionnelle. Au moment où les hommes, hallucinés par l’idée fixe de la mort, croyaient qu’on allait les tuer, M. le Chanoine Crousse s’approche de son frère, qui venait de soigner les blessés, et lui dit: « Embrassons-nous, il faut mourir ». A cette vue, le médecin allemand se rend compte que les deux hommes sont frères. Il appelle le Chanoine au milieu de la place, avec l’intention manifeste de lui annoncer que les civils auraient désormais la vie sauve ; mais il n’a pas le temps de placer une parole ; le Chanoine, rendu verbeux par la perspective de la mort, proteste de l’innocence des Taminois et offre sa vie pour épargner la leur. A la fin, le médecin lui fait comprendre que ni lui ni les autres ne seront fusillés et qu’ils vont être envoyés à Fleurus. « Vous, ajoute-t-il en cherchant dans son dictionnaire le mot approprié, vous serez leur guide vers cette localité ». En rentrant dans le groupe, les hommes demandèrent au Chanoine ce que le médecin lui avait dit. « Soyez calmes et confiants », répondit-il sans trahir son secret. Il craignait d’exciter les esprits.
Au cours de son entretien avec le médecin, le prêtre avait eu la bonne idée de lui insinuer que tous ces hommes mouraient de faim et de soif. A l’instant, l’Allemand leur procura du pain et de l’eau. Un officier, accompagné de trois ou quatre soldats qui apportaient des vivres, leur rompit maladroitement de petits morceaux de pain. Par une touchante adaptation, le Chanoine, au moment où ses concitoyens s’apprêtaient à manger, leur conseilla, puisqu’ils ne pouvaient pas recevoir le Viatique, de reporter leur pensée vers le pain eucharistique.
(p.97) Soudain, un coup de sifflet retentit et les soldats se rangent en deux liles. « Nous y sommes, c’est notre tour d’être fusillés », clame-t-on parmi la foule. Aussitôt les Allemands font signe aux hommes de s’avancer entre les deux haies de soldats. Les civils se groupent au milieu de la place et les femmes reçoivent l’ordre de venir les rejoindre. Ce fut une explosion de joie mêlée de larmes: les événements qu’ils venaient de traverser et ceux qui les attendaient peut-être, rendaient ce revoir infiniment poignant. C’est à peine si quelques-uns, parmi ceux qui n’étaient pas avertis, laissaient poindre dans leur âme l’espérance du salut.
Par rangs de quatre ou cinq, les Taminois qui avaient survécu au massacre remontèrent la rue de la Station, encadrés de soldats, baïonnette au canon, comme les victimes de la tragédie l’avaient descendue la veille. Il pouvait être cinq heures de l’après-midi. Comme les victimes de la veille, ils rencontrèrent un grand convoi de munitions, qu’ils côtoyèrent et dont la présence dans la rue de la Station les obligea à escalader les décombres des maisons brûlées. Comme la veille encore, les soldats leur lancèrent au passage des quolibets et des sarcasmes. Pour leur faire tenir les rangs, les gardes leur disaient: « Celui qui restera en arrière sera fusillé ».
Derrière l’église des AIloux, un nouveau coup de sifflet arrêta le cortège. Sous la menace du revolver, on fit sortir du lieu saint les femmes, les enfants et les quelques hommes qui s’y étaient réfugiés depuis la veille au soir, et ils allèrent grossir la caravane.
Les femmes qui, le soir du samedi, étaient restées à l’église, passèrent la nuit dans une angoisse extrême, au milieu des ténèbres; les lueurs d’un vaste incendie qui se développait derrière l’église et dont les reflets fantastiques jouaient dans les vitraux et animaient des ombres multiples (p.98), augmentaient leur frayeur. Les enfants criaient et pleuraient, les femmes se demandaient avec anxiété ce qu’étaient devenus leurs maris et leurs fils.
Pendant cette nuit lugubre, longue comme un siècle, plusieurs s’évanouirent ou eurent des crises nerveuses. Les soldats qui les surveillaient étaient brutaux et méchants : ils tiraient des coups de fusil près de l’église, pour frapper de terreur ces pauvres femmes, si effrayées déjà. Vers six heures du matin, cinq ou six furent remises en liberté, et partirent pour Velaine avec les Sœurs des Alloux. Dans le courant de la matinée, la rumeur du massacre, vague encore, avait pénétré jusqu’à l’église.
En rejoignant le défilé qui remontait de Saint-Martin, les femmes et les enfants cherchèrent d’abord à retrouver leurs proches: ne les voyant pas, ils s’informèrent dans le détail de ce qu’ils étaient devenus: « Et mon fils? et mon mari? et mon papa? ». On s’ingéniait à leur cacher leur malheur. Mais c’étaient des scènes de larmes, lorsque, à travers la réticence ou le silence des amis, ils entrevoyaient, une partie de la vérité.
La lugubre procession, presque toute la population de Tamines, se remit en marche. Dans le bois de Velaine, des coups de feu retentirent. Les Allemands s’amusaient ou simulaient une attaque. Effrayés, les civils levèrent les bras et l’alerte se calma.
A Velaine, le cortège s’arrêta devant l’école St-Joseph et un Allemand qui se trouvait en tête déclara que tous étaient libres, mais qu’il leur était défendu de rentrer à Tamines.
L’annonce de la délivrance fit passer comme un frisson de soulageante surprise dans toute la multitude et provoqua une immense explosion de joie aux manifestations les
(p.99) plus diverses: plusieurs même, comme fous, crièrent: « Vive l’Allemagne! » et remercièrent les soldats avec effusion. Les habitants de Velaine firent aux Taminois un accueil sympathique et généreux. On leur procura dans les maisons du village un logement confortable et, bien que les Allemands eussent déjà réquisitionné une bonne partie des vivres, on les réconforta copieusement. Beaucoup n’avaient plus mangé depuis la veille à midi. Il pouvait être sept heures du soir.
Il y en eut qui, ne pouvant croire à leur délivrance, affolés, continuaient de fuir, faisant irruption dans les maisons ; et, tant était grande leur crainte de retomber dans les mains des Allemands, ils cherchaient, pour se dérober à leurs poursuites, les pièces les plus reculées. On eût dit qu’ils voyaient planer sur eux, prête à les frapper, la mort qu’ils ne parvenaient pas à éviter.
CHAPITRE XI
Tamines au lendemain de la tragédie. L’exhumation des morts
Tamines n’était plus qu’un tombeau, sur lequel, froid et morne, le silence de la mort pesait. Et, à travers les ruines, le personnel de la Croix Rouge circulait, et passaient aussi, chargés de leur butin, les pillards affairés. Car à peine la population avait-elle disparu, que les troupes laissées dans la commune et celles attachées au service des ambulances organisaient le sac des habitations: le pillage, comme toute œuvre entreprise par les Allemands, y fut systématique.
(p.100) Ils pénétraient jusque dans les coins les plus reculés, enfonçaient les portes, brisaient les fenêtres, mettaient en pièces les meubles, pour en enlever le contenu ou par simple vandalisme, emportaient les objets qui leur convenaient. Ils avaient une prédilection de goujats pour les vins et les confitures. Ils rentraient aux ambulances, leurs camions chargés de paniers de vin et de provisions de bouche; faisaient main basse sur toutes les valeurs, emportaient les objets les plus précieux, les ustensiles et les meubles les plus divers ; le linge de corps et de table était de même enlevé. Ils pillèrent de la sorte environ six cents maisons. Deux cent vingt immeubles, abritant deux cent quarante-six ménages, ont été incendiés. Les dégâts des incendies et du pillage s’élèvent à six millions de francs.
Pendant les premiers jours qui suivirent l’expulsion des habitants, les ambulances furent à Tamines les seuls foyers de vie. Les Allemands avaient installé chez les Frères sous le nom de Lazarett n° 4, un hôpital militaire qui hébergea quelques civils et environ cent cinquante blessés allemands. Cet hôpital fonctionna pendant douze jours, puis le personnel partit pour Maubeuge. Les Allemands furent corrects pendant ce temps et délivrèrent à l’établissement ainsi qu’aux Sœurs hospitalières un élogieux certificat.
Le D’ Defosse avait, lui aussi, établi une ambulance chez lui dans l’intention de soustraire à l’animosité des soldats le plus de civils possible. Chez les Sœurs de Saint-Martin, et à l’école communale des filles, étaient de même organisées des ambulances provisoires. Cette dernière hébergea environ quatre-vingt-dix soldats.
Dès le mardi, tous les blessés de la fusillade étaient défi-litivement recueillis chez M. le Dr Defosse et chez les sœurs de la rue Sainte-Catherine. Ils venaient, en grande najorité, de l’église Saint-Martin et des écuries de la ferme (p.101) Couvreur où, depuis dimanche, ils étaient restés sans nourriture et sans soins. Une trentaine furent hébergés chez le Docteur et quarante-sept chez les Sœurs.
Les médecins et les infirmiers allemands, en général, se sont montrés inhumains et brutaux envers ces innocents. Ils ne les soignaient pas, ne les pansaient qu’avec répugnance ou même les maltraitaient.
Un lourd major laissa, dans la mémoire des blessés transportés à l’église, le plus sinistre souvenir: il était, comme ils disent, brutal à la façon d’un « tigre ».
Le samedi, vers six heures du soir, les Sœurs de Charité, de l’Hospice de Tamines, avaient ramassé, rue de la Station, le boucher Léon Bodart, grièvement atteint au ventre et déjà presque mourant. Elles le portèrent à l’ambulance des Frères. Là, un médecin allemand s’empare du blessé, le brutalise et le fait déposer sur un lit. Il ne permet plus aux Sœurs de s’en approcher. Il prend alors un bassin rempli d’eau froide et frotte violemment la plaie avec un torchon, en employant tellement d’eau que le lit en est inondé. Bodart mourut quelque temps après.
- Alphonse Charlier avait eu la cuisse perforée d’une balle et avait été laissé sur le champ du massacre durant vingt-quatre heures. Enfin, un soldat allemand vint le relever le dimanche soir et le transporta sur une brouette à l’église. On le laissa sans soins sur la brouette jusqu’au mercredi et, malgré son impuissance à se mouvoir seul, pas un Allemand ne vint à son secours. L’infection fit de rapides progrès et, pour sauver le malheureux, il fallut lui amputer la jambe.
Les blessés qui durent être amputés eurent beaucoup à se plaindre des procédés inhumains de la Croix-Rouge allemande.
(p.102) Le Dr Defosse était donc seul à assurer le service médical au milieu des civils: la tâche était rude, les moyens limités et la gangrène n’avait pas tardé à se développer. Il s’acquitta de sa mission avec le dévouement et la discrétion qui le caractérisent et mérita bien de ses compatriotes.
Le mardi 25 août, le Frère Directeur de l’Institut Saint-Jean-Baptiste accompagné de quelques civils, auxquels le chef du Lazarett lui avait permis de faire appel, se mit en devoir de visiter les maisons incendiées, à la recherche des cadavres ensevelis sous les décombres. Il s’agissait de préserver les ambulances du danger d’infection provenant de la décomposition des cadavres.
« Dans la cave de la maison habitée par Madame Veuve » Fernémont — ainsi s’exprime le Frère Directeur, — nous » avons trouvé quatre cadavres de jeunes gens; ils étaient » tombés les uns sur les autres: on aurait dit qu’ils s’étaient » embrassés dans la mort. De là, nous sommes descendus » à la maison Mombeek (bazar) et dans la cave étaient cal-» cinées cinq victimes: Mme Seghin, son fils Camille et la » servante, Mme Mombeek et sa servante. La cave dans la-» quelle ils furent carbonisés était exiguë et remplie de » charbon. Celui-ci s’était allumé par contact, l’acide car-» bonique s’était dégagé du combustible et avait asphyxié » ces cinq personnes.
» La troisième maison que nous avons visitée fut celle de » M. Guiot, en face de la gare: on disait que le corps de sa » belle-mère était resté dans les flammes, mais nous n’a-» vons rien retrouvé. Sur les briques encore toutes chau-» des, gisaient les cadavres de quelques animaux que nous » avons enfouis dans le jardin.
» Pour terminer cette journée, nous sommes allés dans » un jardin où l’on m’avait signalé la présence d’un cadavre. Nous l’avons de fait trouvé, l’avons enterré, mais
(p.103) n’avons découvert sur luii aucun indice qui nous permit » de l’identifier.
» Le lendemain mercredi, le chef de l’ambulance mit à » ma disposition des soldats, avec lesquel j’ai continué l’enfouissement des cadavres d’animaux. »
Cependant, les Taminois expulsés se hasardèrent peu à peu à rentrer dans leurs maisons. Un à un, ils venaient soigner leur bétail ou mettre en sûreté leurs objets de valeur. Ce furent d’abord les femmes, que les Allemands n’avaient guère inquiétées jusque-là: espérant contre toute espérance que leurs maris et leurs fils n’avaient pas été tués à la fusillade et n’étaient que blessés, elles couraient d’une ambulance à l’autre, suppliant, les larmes dans les yeux, qu’on les renseignât sur le sort de leurs proches; et, lorsqu’il fallait confirmer la terrible réalité et dissiper la dernière illusion, c’était une explosion de pleurs et de lamentations que la plume se refuse à décrire.
Les hommes enfin se risquèrent à reparaître.
Au début, les soldats occupants les internèrent et leur témoignèrent une hostilité rancunière.
Le 29 août, le commandant de place fit appeler M. Emile Duculot, le chargea des fonctions de bourgmestre et le tint pour garant de la sécurité des troupes (1).
Le manque de respect témoigné aux victimes en les jetant, pêle-mêle, les unes sur les autres dans une fosse commune révoltait la conscience de la population: il importait de leur donner une sépulture convenable.
Une dizaine de jours après la fusillade, M. Duculot, accompagné de M. P. Goffin, obtint du commandant la permission de déterrer les morts et de les inhumer en terre bénite. On organisa tout un service d’exhumation ; on fit
(1) Le 6 novembre 1914, M. Duculot était appelé, par le Gouvernement belge aux fonctions de bourgmestre.
(p.104) fabriquer des brancards pour porter les cadavres et, pour la désinfection, on se procura cinq mille kilos de chlore à Jemeppe-sur-Sambre.
Tout autour de l’église Saint-Martin, court une bande de terrain qui fut, il y a de longues années, le cimetière du village: c’est là qu’on se disposa à inhumer les martyrs. On ouvrit deux larges tranchées, de part et d’autre de l’église, parallèlement à la nef. Le fond et les parois de ces vastes fosses furent entièrement garnis de planches.
La tombe provisoire fut ouverte en présence du docteur Defosse, et le premier cadavre qui apparut, fut celui de l’horloger Nalinne, puis celui de M. l’abbé Hottlet, curé des Alloux.
Au fur et à mesure qu’on déterrait les victimes, on les étendait sur un brancard, on répandait du chlore sur elles et un homme les fouillait pour rassembler les objets qui pouvaient servir à les identifier. Après avoir nettoyé ces objets, on en dressait une liste, sous un numéro, correspondant à celui assigné au cadavre du fusillé, puis on les empaquetait et sur l’emballage était inscrit le même numéro.
L’ouvrier qui enlevait les objets et celui qui les nettoyait portaient un masque protecteur contre l’infection.
La décomposition avait été tellement rapide et complète, qu’une identification à vue ne fut pas possible; les vêtements étaient à ce point dégradés qu’ils ne purent fournir aucun indice. Seuls, les objets trouvés sur les victimes servirent à établir leur identité. Beaucoup portaient des laissez-passer de l’autorité belge, leurs livrets de travail ou de caisse d’épargne, des objets de piété, etc., qui aidèrent à reconnaître presque tous les cadavres. On interdit aux femmes d’assister à l’exhumation: le spectacle était par trop affreux. Les objets numérotés des corps non identifiés (p.105) furent remis à l’Hôtel de Ville, où les intéressés venaient vérifier s’ils avaient pu appartenir à leurs parents. Cette opération dura près de quinze jours.
Les cadavres furent étendus en long dans les tranchées, en ordre, les uns à côté des autres, sans cercueil. Sur la première rangée fut placée une seconde, et même à certains endroits une troisième. Quelques familles apportèrent des cercueils grossiers en planches non rabotées, dans lesquels furent déposés les restes de leurs proches. Contre l’église, à gauche, reposent plusieurs martyrs dans des cercueils en zinc et en chêne, procurés aussi par les parents qui ont creusé ou fait creuser la fosse.
On n’a pas retrouvé dans les habits tout l’argent qu’avaient sur eux les fusillés au moment du massacre: ont-ils été dévalisés par les soldats allemands ? Plusieurs témoins l’affirment et l’on cite, entre autres, le cas de Fernand Sevrin qui, s’apercevant qu’on fouillait les blessés et les morts, jeta son porte-monnaie dans la Sambre.
En exhumant les’ fusillés, on a trouvé deux cadavres d’hommes complètement nus. D’où venaient-ils? Ils ne se trouvaient pas sur la Place après la fusillade: ils ont été apportés sans doute pendant la première inhumation.
La fosse commune une fois vide, on s’occupa des cadavres enterrés ailleurs et on les déposa à leur tour en terre sainte.
Quelques jours après la fusillade, on avait retiré quarante-trois cadavres de la Sambre ; ils avaient été enterrés dans une tombe commune à proximité du pont du chemin de fer de la ligne Tamines-Mettet ; on les exhuma et identifia de la même manière: la décomposition était beaucoup plus avancée. On les enterra comme les autres au cimetière .près de l’église.
(p.106) Dans les Tiennes d’Amion, on exhuma un civil et cinq soldats français; tous étaient méconnaissables: c’était six semaines après la bataille. Deux des soldats français ne portaient sur eux aucune pièce permettant d’établir leui identité. Mais on enleva les gourdes, les ceinturons, les fourreaux de baïonnettes ; on coupa même le numéro qui se trouvait à leur caleçon; tous ces objets furent déposés à l’Hôtel de Ville, en vue d’une identification possible. Ces soldats ont été inhumés dans une fosse spéciale, à gauche de l’église.
Enfin, le soldat Pierre Lefèvre, enterré provisoirement dans le jardin de la dernière maison en allant vers Falisolle, a été exhumé. Après avoir été blessé à mort, ce brave, qui a abattu tant d’Allemands, avait été recueilli dans cette maison: il mourut le lendemain de la bataille. Il fut mis dans un cercueil et déposé dans une fosse particulière à proximité de la grande croix de pierre qui se dresse au fond du cimetière.
Le nombre des victimes qui dorment côte à côte est de trois cent soixante-sept.
On surmonta les tombes de petites croix faites de deux morceaux de bois et portant le numéro du mort. Sur le bras de chaque croix était peint en grandes lettres noires le nom du défunt. Depuis lors, les familles ont remplacé ces croix grossières par d’autres plus belles et plus dignes des martyrs.
En entrant dans le cimetière, une impression d’infinie tristesse saisit le visiteur: à voir de part et d’autre de l’église, surtout à gauche, cette forêt de croix, aussi touffues que les arbustes d’un taillis, il est impossible de réprimer son émotion; un sentiment d’horreur et de pitié s’empare du plus indifférent. En approchant, on lit sur les croix ces simples inscriptions: « Ici repose… tombé martyr sur la (p.107) place de Tamines, le 22 août 1914 » ; « Ci-gît… mort martyr pour la Patrie » ; le mot « martyr » figure sur une bonne douzaine de croix.
Aux jours anniversaires, les tombes et les croix sont couvertes de gerbes de fleurs, et les Taminois vont, en procession, prier sur les restes de leurs chers martyrs. Ces cérémonies patriotiques et religieuses, ces manifestations, ces inscriptions sur les croix ne plaisaient pas beaucoup aux Allemands qui occupaient la commune ; ces morts, n’étaient-ce pas des « franc-tireurs » ?
Telle était bien, en effet, sur les victimes de la tragédie du 22 août, l’opinion courante chez les soldats allemands. A l’occasion des premiers retours de la Toussaint et de l’anniversaire du massacre, quelques soldats en armes étaient venus, provocateurs et menaçants, arpenter le cimetière de long en large, afin de prévenir toute manifestation germanophobe. Ces veuves inoffensives et ces pauvres orphelins étaient pourtant loin de penser à comploter contre l’empire allemand.
Le 20 mai 1916, M. le bourgmestre Duculot, reçut une communication du sergent-major Weber, représentant de l’autorité allemande à Tamines: faute de mieux, il faut rendre à ce sergent la justice d’avoir fait preuve de bonne volonté en rédigeant sa missive en français. Elle avait pour objet d’informer le bourgmestre, par ordre du Kaiserliches Gouvernement, Namur, d’avoir à supprimer le mot « martyr », inscrit sur une douzaine de croix, comme offensant pour l’amour-propre allemand, ou à le remplacer par un autre terme, tel que « victime ».
C’est ainsi qu’aujourd’hui, les inscriptions de ces croix sont mutilées, elles aussi, et que, pour le profane qui ignore, elles sont à peu près inintelligibles.
(p.108)
CHAPITRE XII Les responsabilités
En présence d’un fait monstrueux comme celui dont Phistoire vient d’être retracée, et qui, par l’excès même de sa monstruosité, s’impose à l’attention de l’humanité tout entière, il importe d’établir les responsabilités.
La population taminoise, inhumainement châtiée, a-t-elle mérité, par des actes d’hostilité contraires aux lois de la guerre, la punition dont, inexorablement, elle a été frappée ? Et, en particulier, les hommes que les Allemands ont fusillés sans merci comme sans jugement, ont-ils pris part illégalement à la guerre?
Les faits vont fournir une réponse à ces questions.
Il est certain d’abord que les armes à feu, avec leurs munitions, ont été déposées à l’Hôtel de Ville avant l’arrivée des Allemands. A Tamines, comme partout en Belgique, les autorités communales, obéissant aux ordres supérieurs, ont obligé la population à se défaire de ses armes, et l’ont avertie, par des affiches nombreuses qui tapissaient les murs des bâtiments publics et des habitations privées, du danger qu’il y avait pour la localité à commettre un acte quelconque opposé aux lois de la guerre. Du haut de la chaire, le clergé, et tout spécialement M. le curé des Alloux qui paya de sa vie son dévouement et son patriotisme, mit, à plusieurs reprises, la population en garde contre toute action contraire aux coutumes de la guerre.
La garde civique locale avait été licenciée dès le jeudi 20 août par une affiche qui était encore placardée à la porte de l’Hôtel de Ville, lors de l’arrivée des Allemands.
(p.109) Les armes étaient déposées dans la grande salle de la Maison communale. Les Allemands les y ont saisies, brisées et brûlées.
Il est indéniable que l’idée d’un complot, d’une embuscade, d’une guerre concertée de partisans, n’a germé dans l’esprit de personne à Tamines et qu’il n’y a pas eu de bandes, organisées ou non, de francs-tireurs. Ni la partie intellectuelle de la population, ni la classe ouvrière, n’ont songé à s’opposer par la force à la marche des Allemands, ni ne l’ont fait en réalité.
A moins d’admettre la théorie que les innocents doivent payer pour les coupables, cette première constatation marque du sceau de la suprême injustice le massacre global de la population taminoise.
S’il n’y a pas eu de plan d’ensemble dressé par les hommes de Tamines, et sournoisement exécuté sous la conduite de chefs, n’y a-t-il pas eu des cas individuels où, au mépris des lois de la guerre, les Allemands ont été traîtreusement attaqués? Il est hors de doute que la masse des fusillés n’a pas fait la guerre de francs-tireurs ; mais est-il impossible que des individus, livrés à leur propre initiative et poussés peut-être par je ne sais quel fanatisme, aient fait le coup de feu contre l’envahisseur?
Un examen superficiel permettrait, semble-t-il, d’admettre que des attentats isolés aient pu être commis contre les troupes par des habitants de Tamines.
En effet, immédiatement après la bataille, l’école des Sœurs des Alloux fut l’objet d’une perquisition minutieuse: c’était entre trois et quatre heures du matin ; on cherchait: armes, soldats français, munitions, francs-tireurs ; on ne découvrit rien. L’officier, qui présidait à cette opération, était hors de lui ; il menaçait Tamines d’une destruction (p.110)
complète ; il avait vraiment, comme disent les Sœurs, une « figure de démon ». Au milieu de ses invectives, il affirma que deux mille soldats avaient été mis hors de combat par les civils.
La matin du dimanche, au témoignage de M. Van Heuc-keloom et de M. le vicaire Donnet, un officier qui est entré en pourparlers avec les blessés de la fusillade, désigna l’endroit d’où les civils avaient déchargé des coups de feu.
Le blessé recueilli d’abord chez Mouffe puis soigné dans l’ambulance des Frères où il mourut quelques jours plus tard, a déclaré à un Frère, de nationalité allemande, que c’étaient les civils qui avaient tiré sur lui.
A l’ambulance de la rue des Alloux, se trouvait un sous-lieutenant blessé à l’avant-bras gauche. Il affirmait que cette blessure avait été causée par une décharge de fusil de chasse. Il proférait les pires injures à l’adresse des civils et s’écriait à tout moment: Schlechte Zivilisten! Il avait été blessé, dans la nuit du vendredi au samedi, à l’une des attaques du pont.
La brochure La Belgique coupable, qui s’arroge, avec plus de prétention que de raison, le sous-titre de « Réponse à M. le professeur Waxweiler » (Berlin 1915, Georg Rei-mer, imprimeur-éditeur) rapporte, page 39, de l’édition française, une déposition de l’Autrichien Graf, relative à Tamines. Cet autrichien habitait la localité au moment de l’entrée des Allemands. Il fit même partie de l’escouade de civils qui furent forcés par les Allemands de recueillir près de l’Hôtel de Ville le cycliste blessé. Il affirma que, au cours de cette expédition, des coups de feu éclataient de quatre côtés. Sans oser prétendre que les civils tiraient, il l’insinue toutefois, en disant qu’il n’a pas vu de soldats français ou autres en uniforme, mais seulement des civils. En outre, les jours suivants, il a entendu des habitants se (p.111) vanter de leur habileté à tirer sur les Allemands sans être
vus. De plus, dans une maison située près du pont de la Sambre, à gauche, une mitrailleuse française pour balles dum-dum aurait\été dissimulée et installée de façon à pouvoir balayer le pont de la Sambre. Lorsque les Allemands voulurent franchir le pont, on avait tiré sur eux de cette maison.
Les officiers et les simples soldats furent unanimes à prétendre que les civils Avaient tiré sur eux.
Telles sont les allégations qui, apparemment, démontreraient la culpabilité d’\me partie de la population.
Pour remettre ces allégations dans le cadre historique, il importe de se souvenir que, lors des premières rencontres qui eurent lien entre Allemands et Français, la population, malgré le danger, continuait à circuler dans les rues, gênant le tir des Français, et permettant aux Allemands de supposer que des civils prenaient part à l’action. Mais il n’est nullement prouvé que les hommes de Tamines, même individuellement, aient fait usage d’armes à feu. Non seulement il est certain que pas un, à l’intérieur de la commune, ne s’est enhardi à tirer sur les Allemands, mais il n’est pas même prouvé qu’ils étaient porteurs d’armes à feu. Dans toute cette foule de civils arrêtés par les Allemands, en a-t-on trouvé un seul qui fût armé?
Il faut, pour comprendre la raison de cette affirmation qui, d’ailleurs, s’appuiera sur des faits, se rendre compte de l’état d’esprit des habitants de Tamines, au moment où la guerre se déchaîna sur la localité par une bataille acharnée: c’était la terreur. Pas un homme qui ne fût sous l’empire d’une frayeur instinctive: crainte pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour leurs biens. Avertis par les recommandations de l’autorité civile et religieuse, apeurés (p.112) par les récits d’atrocités qui déjà précédaient les Allemands, les habitants de Tamines n’avaient/ nulle envie, même s’ils en avaient eu le pouvoir, de prendre part aux hostilités. Une preuve déjà, c’est l’exode de la population qui s’ébranle, le vendredi, jusqu’à dix heures du matin et qui malheureusement, est enrayée au pont de Sambre par les soldats français. Celui qui envisagerait autrement l’état d’âme des Taminois au moment où Français et Allemands se disputaient avec acharnement le passage de la rivière, commettrait une erreur psychologique des plus grossières ; la guerre de francs-tireurs, chez la masse comme chez l’individu, était à cent lieues de la pensée des Taminois. Ils n’avaient qu’un seul souci: se protéger contre les projectiles, laisser les ennemis héréditaires vider entre eux leur querelle, et, dans ce but, s’enfuir ou se terrer profondément dans les caves ou les souterrains, en attendant la fin.
Les événements confirment donc à l’évidence cette assertion, puisque pus un Taminois n’a été pris les armes à la main ou en flagrant délit de violation des lois de la guerre. Tous les hommes tués ou carbonisés dans leur maison étaient inoffensifs et ne portaient point d’armes. Ceux qui fuyaient dans les campagnes et que les Allemands ont abattus comme du gibier, n’avaient d’autre souci que d’éviter les flammes et de mettre leur vie en sûreté. Etaient-ce les femmes et les petits enfants tués ou brutalisés par les Allemands, qui étaient francs-tireurs ?
C’est donc un fait acquis à l’histoire, que tous les Taminois fusillés étaient innocents. Et si même un civil isolé avait déchargé sur les Allemands une arme quelconque, ce n’était pas une raison pour massacrer cinq cents hommes. Il fallait, au préalable, même dans le cas de culpabilité (p.113) certaine, établir un tribunal et prononcer un jugement, quelque sommaire qu’il fût.
Or, pas un\civil n’a passé devant un tribunal militaire, pas un n’a été ^entendu pour sa défense ; mais, au contraire, tous, ainsi que\du bétail conduit à la boucherie, ont été parqués, sans savoir ce qu’on leur voulait, sur la rive de la Sambre, et fusillés à bout portant.
C’est un crime monstrueux que l’histoire se chargera de juger.
Restent les témoignages allemands affirmant la participation des civils à 1^ guerre. Pas n’est besoin de prendre ces témoignages pour ‘des mensonges ; il y a une explication toute simple qui s’impose pour le cas de Tamines, comme pour le reste de la Belgique: c’est que les soldats allemands, lors de leur entrée dans le pays, étaient tellement imbus de l’idée que les civils faisaient la guerre de partisans, qu’au premier coup de feu, ils criaient au « franc-tireur » ; ils ne s’arrêtaient pas même à la pensée que ce pussent être des soldats qui tiraient. Il suffisait qu’ils essuyassent un feu de mousqueterie pour déclarer qu’ils avaient affaire à un diabolique complot ourdi par les civils. C’est ainsi que l’on peut suivre les atrocités allemandes, puisqu’il les faut appeler par leur nom, à la trace des combats que les Allemands engagèrent avec les Français ou les Belges.
Ce fait présupposé, il est facile de se rendre compte de la portée des affirmations allemandes sur la part que les Taminois auraient prise à la bataille de la Sambre.
L’officier qui affirmait que deux mille sodats avaient été mis hors de combat par des francs-tireurs, ignorait sans doute que les Français étaient à Tamines et défendaient le passage de la Sambre. Si la population avait été coupable de ce crime, les Allemands auraient pris ces milliers d’hommes les armes à la main ; ils auraient capturé leurs munitions: (p.114) or, il n’en fut rien. Cette considération détruit déjà l’affirmation de l’officier. Si, au contraire, ces/milliers de francs-tireurs — car il en fallait des milliers pour mettre à mal deux mille soldats allemands — se sont enfuis vers la France à temps pour ne pas tomber aux mains de leurs terribles justiciers, les civils fusillés sont dés victimes innocentes. Au reste, quelle valeur attribuer à cette accusation, alors que, selon toute vraisemblance, le chiffre des Allemands tués ou blessés à Tamines, loin crêtre deux mille ne
dépasse pas six cents?
L’officier qui montrait l’endroit de /la route de Falisolle d’où tiraient les civils, en supposant /qu’il ait vraiment vu ce qu’il affirme, a sans doute aperçu ‘une ou plusieurs maisons d’où partaient des coups de feu ;• mais d’une part, il est bien difficile, à distance, de distinguer un franc-tireur d’un soldat dissimulé dans une maison, et, d’autre part, il est certain que les soldats français, en face du pont et sur la route de Falisolle, ont occupé les maisons après en avoir fait partir les habitants, et, que là, ils ont tiré sur les Allemands.
L’Allemand blessé qui a déclaré à un Frère de sa nationalité que sa blessure avait été faite par une balle de franc-tireur, a pu être de bonne foi: en s’approchant du poste français qui a tiré sur lui et l’a atteint, il a vu des habitants qui circulaient ou se groupaient en curieux ; mais il s’est trompé en prétendant que les civils avaient tiré sur lui. En effet, le Dr Defosse qui lui a donné les premiers soins chez Mouffe, a constaté que la blessure avait été causée par une balle de fusil de guerre: le petit trou pratiqué dans l’abdomen par l’entrée du projectile est concluant. Il n’y a donc pas lieu d’accuser un Taminois. Le Dr Defosse déclare en outre que les soldats allemands auxquels il a donné ses (p.115) soins étaient, sans exception, blessés par des éclats d’obus ou des ballfts de fusil de guerre.
Le camarade du soldat en question, touché dans la première reconnaissance et fait prisonnier par les Français, a été soigné par\e Dr Scohy qui a extrait de la blessure une balle française.
Le sous-lieutenant blessé à l’avant-bras gauche pendant l’attaque du pont,\le soir du vendredi, s’est emporté contre les « vilains civils à qui l’avaient si mal arrangé: sa blessure était large. Mais outre que, psychologiquement parlant, il est infiniment peu probable qu’un civil, non rompu au maniement des armes et non habitué au fracas des batailles, ait eu assez de sang-froid pour tirer sur l’armée allemande au milieu des incendies, du bruit du canon et de la mous-queterie, il serait intéressant de savoir comment ce sous-lieutenant allemand aurait pu distinguer, la nuit, dans la lumière incertaine des flammes, un civil qui tirait, d’un sodat français qui accomplissait son devoir. Comment, d’ailleurs, un fusil de chasse, déchargé au moins à la distance d’une rive à l’autre de la Sambre, aurait-il pu causer une blessure unique et si profonde, alors que la chevrotine s’éparpille à trente mètres? Les balles françaises, en effet, que les Allemands appellent avec expression des Querschlii-ger, en pénétrant de biais dans les chairs, produisent de larges blessures, semblables à celle du sous-lieutenant.
Quant à l’autrichien Graf, il n’affirme pas avoir vu les civils tirer, mais il affirme n’avoir pas vu les soldats français. Cette double assertion réduit à néant sa déposition tout entière. Qu’au début les civils aient continuer à circuler dans les rues de façon à pouvoir induire en erreur, sur leur intervention au combat, un observateur lointain, nous ne faisons aucune difficulté à l’admettre. Mais il n’en est pas moins vrai que les Français’ et les gardes-civiques en uniforme (p.116) étaient là et faisaient feu. Le témoignage /ae M. Fer-nand Gillieaux, capitaine-commandant, est catégorique sur ce point (1). Les artilleurs de Charleroi, au norpbre de vingt, à la tête desquels il se trouvait, s’étaient Avancés, disséminés dans la rue, jusqu’à quelques centair/es de mètres de l’église des Alloux ; les Français, à leur tour, étaient dispersés aux environs de l’Hôtel-de-ville et attendaient les Allemands de pied ferme. A leur apparition/, tous ces hommes se mirent à tirer avec entrain. Si donc u est vrai que Graf ait constaté qu’on a tiré de quatre côtés à la fois, chose au reste bien difficile à vérifier dans sa situation, c’étaient les Français et les gardes-civiques de Charleroi qui, postés à différents endroits, faisaient le coup de feu sur l’ennemi.
Graf a d’ailleurs donné lui-même un démenti formel à sa déposition. Car, pendant le séjour prolongé qu’il fit à Ta-mines après le début des hostilités, il affirma, devant M. Seron entre autres, à plusieurs reprises, qu’il n’avait point vu de civils tirer.
Quant à sa déclaration au sujet des habitants qui se vantaient de leur habileté à tirer sur les Allemands, et au sujet de la mitrailleuse française pour balles dum-dum, l’histoire ne la prendra pas au sérieux, tant que Graf ne citera pas les noms pour permettre de vérifier ses dires. De plus, comme il parlait difficilement le français, il a pu mal saisir, ou prendre au sérieux ce qui n’était qu’une folle vantardise ou une simple plaisanterie.
Au reste, un autre document, émanant officiellement du ministère des Affaires étrangères, le Livre Blanc, publié le 10 mai 1915 (Die völkerrechtswidrige Führung des belgischen Volkskriegs, 328 pp., Berlin) fait justice de l’accusation
(1) Voir dans la IIe partie le détail de cette importante déclaration.
(p.117) indirecte de Graf et de l’inculpation directe des soldats allemands.
Le Livre Blanc, composé de dépositions faites sous serment par les soldats allemands devant une commission impériale a pour objet de démontrer la culpabilité du peuple belge dans la guerre imaginaire des partisans. La première partie traite des violations commises par les communes isolées de Belgique (p. 1-87). La deuxième s’occupe uniquement d’Aerschot (p. 89-103) ; la troisième, d’Andenne (p. 105-114) ; la quatrième, de Binant (p. 116-229) et la cinquième, de Louvain (p. 231-328). Le massacre de Tamines étant aussi abominable que les horreurs commises dans ces localités et ayant besoin aussi d’être justifié, on devait s’attendre à ce que le Livre Blanc y attachât une importance au moins pareille et s’évertuât, à titre égal, à prouver la responsabilité de la population taminoise.
Or, qu’est-il arrivé?
Au commencement de l’année 1915, le gouvernement allemand organisa à Tamines une enquête officielle: un magistrat, aidé d’un interprète et d’un secrétaire, fit comparaître devant lui, à l’hôtel de ville, un certain nombre d’habitants et acter leurs déclarations. M. Emile Duculot, bourgmestre, raconta dans le détail, devant cette commission les phases de la tragédie: sa déposition dura trois heures. Les résultats de cette enquête, chose curieuse, sont restés dans les archives du ministère des Affaires Etrangères ; pas un mot n’en a transpiré. Le Livre Blanc n’en parle pas et ne cite le nom de Tamines que pour rapporter, au sujet de Vignées près de Tamines, (1) (p. 56, Anlage 41), un incident militaire, d’ailleurs totalement erroné.
Voilà donc un document officiel dont l’unique objectif est
(1) Vignées n’existe pas : il s’agit évidemment d’Oignies.
(p.118) d’accabler la population belge sous la honte d’accusations infamantes, et qui, à propos du fait le plus saillant de la « guerre des francs-tireurs » — l’exécution sommaire de cinq cents hommes — ne trouve pas un mot pour blâmer les Taminois et justifier les procédés allemands.
Le Livre Blanc n’a pas jugé bon non plus d’insérer le témoignage de Graf: cette omission démontre le peu de valeur qu’il attribue aux affirmations de l’Autrichien.
Le silence évidemment voulu du Livre Blanc, est à la fois le certificat d’innocence le plus éloquent que le Gouvernement allemand pouvait décerner aux Taminois et Pacte d’accusation le plus écrasant contre les officiers responsables.
Enfin, qu’officiers et soldats, présents à Tamines au moment de la tragédie, aient unanimement accusé les habitants d’avoir tiré sur eux, alors qu’il n’en était rien, cela dénote la mentalité de ces hommes, qui entrèrent dans la commune avec la conviction, reposant uniquement sur des calomnies, que les civils belges étaient organisés pour la guerre des francs-tireurs. Ce préjugé qualifie les témoignages qui précèdent et leur enlève toute valeur objective.
Avant leur départ pour la Belgique, les soldats allemands, en effet, avaient lu dans leurs journaux qu’ils allaient se trouver aux prises avec des bandes organisées de francs-tireurs ; on le leur avait répété à satiété et inculqué comme un axiome. Arrivés à Tamines, ils sont reçus à coups de feu et subissent des pertes importantes ; ils ne voient pas les soldats français, qui, bien abrités et dissimulés, tirent sur eux, et ils concluent que ce sont les civils.
Telle est la psychologie simpliste du soldat: si elle diminue la culpabilité du sous-ordre, il ne paraît pas qu’elle disculpe l’officier et surtout l’Etat-Major.
En étudiant les événements, on arrive à la conclusion (p.119) vraisemblable que la Direction de l’armée allemande opérant à Tamines avait, avant son arrivée dans le village, méditer d’infliger aux habitants un châtiment exemplaire.
En effet, dès l’heure de midi du vendredi 21 août, M. le Curé et M. le Bourgmestre de Velaine avaient été requis chez eux et conduits sur la plaine en qualité d’otages.
Ils furent bousculés par les soldats qui les gardaient, et, vers le soir, ils se trouvaient sur les hauteurs qui dominent la Sambre vers Auvelais, entourés de milliers de soldats et serrés contre une vingtaine d’officiers à cheval. Ces officiers semblaient appartenir à l’Etat-Major commandant toutes les troupes en lutte en ce moment avec les Français le long de la Sambre.
Coup sur coup, des estafettes survenaient, apportant des nouvelles qui ne paraissaient pas réjouir les officiers et en particulier le général.
Soudain, ce dernier se tourne vers le prêtre et crie: « Rossarts de Belges, vous avez poussé vos compatriotes à tirer sur les troupes allemandes, marchant ainsi à la remorque du Cardinal de Malines, du petit roi Albert et de la petite diplomatie belge. Les Belges ont trahi l’Allemagne, la seule puissance capable de maintenir l’ordre en Europe, l’Empereur, le seul protecteur de la Religion et de la paix universelle » !
Alors, il y eut entre les officiers des colloques animés. On ne percevait pas distinctement le détail de leur conversation ; mais ils affirmaient que la population civile prenait part à la guerre et qu’il fallait faire un exemple.
Quelques heures plus tard, Tamines était occupé par ces mêmes troupes.
Ce qui fut décidé dans ce conciliabule, nul ne pourrait le dire avec certitude ; mais la suite des événements nous permet de supposer que ce fut là, à Velaine, que, sur les rapports (p.120) non contrôlés de patrouilles de reconnaissance, la résolution fut prise d’infliger à Tamines l’horrible peine de l’incendie et du massacre.
Quoi qu’il en soit, l’ordre fut donné de cet abominable forfait.
En admettant chez les chefs responsables une erreur involontaire, on ne les excuse point encore d’une impardonnable précipitation à tirer vengeance d’un délit qui n’était point suffisamment établi. Si, sur le rapport de leurs hommes, il leur était permis d’accueillir l’accusation, ils avaient le devoir, avant d’agir, d’instruire la cause. Tout au plus pourrait-on concéder que, si les officiers ont cru de bonne foi à l’organisation d’une « guerre de francs-tireurs » en Belgique et qu’ils étaient à Tamines en présence d’un épisode de cette guérilla, leur responsabilité en fût légèrement atténuée. Mais alors, elle pèse, entière et accablante, sur l’Etat-Major allemand et sur les publicistes qui, à la légère, ont répandu cette monstrueuse calomnie.
Par contre, toute la question de la culpabilité des officiers renaît du fait d’avoir ordonné le massacre sans avoir ni interrogé les accusés ni entendu leur défense. Et qu’on veuille bien le remarquer: il n’y eu pas ici de flagrant délit, puisque pas un des fusillés ne fut pris les armes à la main. Depuis quand, même en temps de guerre où les exécutions sommaires sont légitimes, n’admet-on pas l’inculpé à se justifier et le condamne-t-on sans l’avoir entendu? C’est là le point sur lequel s’appuiera l’histoire pour flétrir à jamais la mémoire de ceux qui ordonnèrent le massacre de Tamines.
Quant à l’achèvement des blessés, la question se pose ici encore: a-t-il été commandé par les officiers, ou a-t-il été perpétré spontanément par les soldats?
Dans l’un comme dans l’autre cas, le jugement à porter (p.121) ne peut varier: ce fut un acte de sauvagerie inouïe qu’aucune circonstance n’excuse.
Il est admis, dans l’exécution d’un coupable par les armes, que l’officier qui commande le peloton s’approche de la victime et lui tire dans l’oreille un coup de revolver pour l’achever. Mais la boucherie qui coûta la vie à tant de Taminois, blessés déjà ou encore indemnes, n’offre rien de comparable avec l’opération du coup de grâce. Les soldats qui se livrèrent aux brutalités dont on a essayé de donner une idée, n’ont pas eu l’intention de porter ce dernier coup, ou, s’ils l’ont eue, ils se sont comportés comme des bêtes féroces. Si donc l’achèvement a été commandé, il fut un acte d’impardonnable brutalité ; s’il n’a pas été commandé, il n’existe pas de termes dans le langage humain pour le stigmatiser.
Ainsi donc, ces deux journées des 22 et 23 août pourraient se résumer dans ce seul mot de « barbarie », mot devenu banal, à force, hélas ! d’avoir trouvé son emploi dans la littérature de ces quatre années de guerre.
Barbarie et lâcheté que des troupes, baptisées « héroïques » par des communiqués officiels, contraignent des civils à déblayer un pont exposé au feu de l’ennemi et les fassent marcher devant elles pour leur servir de bouclier.
Barbarie doublée de brigandage que ces incendies allumés sans raison et systématiquement, forçant femmes et enfants à fuir dans une course folle sans rien emporter, ou à périr dans leurs propres demeures.
Barbarie et férocité, que l’assassinat de ces dix hommes fusillés à bout portant chez Hennion.
Barbarie et brutalité, que ces coups de fouets, accompagnés d’insultes, à l’adresse de retardataires trébuchant parmi les décombres d’une ville en ruines, et incapables de suivre l’allure du cortège.
(p.122) Barbarie et monstruosité, que l’exécution de plusieurs centaines d’innocents, condamnés en bloc et sans jugement.
Barbarie et infamie, que cet achèvement des blessés à la baïonnette, accompli sauvagement par des soldats au brassard de la Croix Rouge.
Barbarie et cruauté, raffinée, que cette vision, imposée aux survivants, d’une mort proche et atroce, et que l’entretien de cet affreux cauchemar, par menaces et simulacres, durant une interminable matinée.
Barbarie chez les chefs responsables ; barbarie dans l’exécution par la soldatesque prussienne.
Le massacre de Tamines reste une honte pour le 77e régiment d’infanterie; il déshonore à jamais l’armée allemande.
(p.123)
DEUXIEME PARTIE LES TEMOIGNAGES
Les témoignages reproduits ci-dessous ne constituent qu’une partie des documents utilisés par l’auteur. Il a pris soin, par de multiples conversations avec beaucoup de témoins dont les dépositions ne paraissent pas ici, de mettre au point les caractères d’ensemble de la Tragédie. Pour éviter les redites, on n’a cité, de certaines déclarations, que des extraits typiques et omis les passages déjà publiés dans la première partie.
Déposition de M. Franz Steinier.
Le jeudi 20 août, nous avions appris que les Allemands se trouvaient dans la région au nord de Tamines, qu’ils étaient passés à Boignée et même qu’une patrouille avait pénétré dans Fleurus. C’est ainsi que ce soir-là, vers huit heures, quelques fugitifs venant de Boignée et de Velaine, ont traversé Tamines. Le lendemain, vendredi 21, de bon matin, vers six heures et demie, la première patrouille allemande descendait dans la rue de Velaine. Elle fut arrêtée par des soldats français qui se trouvaient près de l’Hôtel de Ville de Tamines. Après cette patrouille il en passa successivement deux autres : la famille Billy, au moment où elle prenait le chemin de l’église, essuya le feu de l’une de ces patrouilles. Aussitôt après, on commença à entendre (p.124) une fusillade dans toutes les directions, surtout du côté d’Au-velais. Des fenêtres de mon habitation, je pus voir une pièce allemande en batterie le long de la Sambre, à Auvelais, au lieu dit Laronerie ; et je voyais les obus français éclater dans le bois qui borde la Sambre. A mesure que le temps s’écoulait, le combat se généralisait. Vers dix heures, on aperçut de la fumée s’échapper d’un groupe de maisons situées au-delà du passage à niveau, rue de Velaine. C’étaient les Allemands qui avaient mis le feu. La vue de l’incendie effraya les habitants, et ce fut la fuite qui commença. Je descendis dans le quartier de la Gare avec l’intention de fuir aussi; mais près de la gare j’appris que les soldats qui gardaient le pont de la Sambre ne permettaient pas aux civils de le franchir, et j’attendis.
Au commencement de l’après-midi, je suis allé à la rencontre de M. Emile Duculot, à ce moment conseiller communal, qui, avec le docteur Defosse et quelques brancardiers de la Croix-Rouge, s’était rendu près d’un officier allemand à la Praile, à la demande de celui-ci. Dès que je vis M. Duculot, je lui demandai quelle contenance avaient les Allemands ; il me répondit que l’officier l’avait prié de faire disparaître le drapeau belge flottant au clocher de l’église des Alloux; M. Duculot me dit, en outre, que lui-même avait recommandé à la population de rester calme, de ne pas poser d’actes d’hostilité envers l’armée et qu’ainsi la localité serait en sécurité. Rassuré par ces paroles, je perdis toute envie de pousser plus loin et j’entrai chez Dautre-bande, rue du Collège. Vers quatre heures le premier obus passa au-dessus de la maison Dautrebande et un bombardement s’ensuivit. En ce moment-là, la bataille s’engageait pour la possession du pont de la Sambre, à Tamines. Les Français, exposés au bombardement venant de Tamines et, d’un autre côté, menacés de flanc par les Allemands qui venaient d’Auvelais, se replièrent vers Falisolle. Le combat dura jusqu’à la nuit. Le soir, du côté est et sud-ouest, le ciel, au loin, était tout illuminé par les incendies. Pendant la nuit, ce fut une circulation continuelle de troupes allemandes ; nous les entendions très bien marquer le pas sur le pavé de la rue. A un moment (p.125) donné, nous entendîmes le roulement d’une pièce d’artillerie ou d’un camion.
A l’aube, tout au point du jour (nous étions donc le samedi), une fusillade terrible s’engage, des projectiles viennent s’abattre contre tous les murs, ce sont des bruits de portes qu’on enfonce, des vitres qui volent en éclats, des cris, des appels, des sonneries de clairon, et du feu partout.
Au moment de la mousqueterie, nous nous réfugiâmes dans la cave, pour éviter d’être touchés par les balles, et ce ne fut qu’au moment où la fumée nous suffoqua que nous nous décidâmes à sortir. Les flammes de la maison voisine léchaient déjà le trottoir de celle qui nous abritait; et, accompagnés de tous ceux qui se trouvaient dans la maison, c’est-à-dire de la famille Dautrebande, de la femme et du fils Jadoul, d’une famille d’E-mines, de mes deux beaux-frères Joseph Philippart et Fernand Bruyère, ainsi que de ma famille, nous nous mîmes à fuir par la rue du Collège ; chacun se réfugia où il put, tandis que moi, je continuai mon chemin jusqu’au pont du Terniat, où je traversai la ligne du chemin de fer, et je me dirigeai vers les Tiennes où je savais qu’il existait une caverne appelée « Trou Mahy ». C’est là que je trouvai asile. D’autres personnes y étaient déjà réunies. Après moi arriva, entre autres, la famille Legrand. Pendant que nous étions dans cette caverne, qui se trouve sur la rive gauche de la Sambre, des soldats allemands passèrent plusieurs fois sur la rive opposée. Ils venaient de Grogneaux où ils avaient établi un pont sur la Sambre et se dirigeaient vers Auvelais en longeant les bassins de la glacerie Saint-Roch.
Le bombardement reprit de plus belle. Je trouvai quelques personnes charitables qui donnèrent à boire à mes petits enfants, dont l’un était âgé de cinq mois (il est mort un mois après, par suite de la guerre), l’autre âgé de deux ans à peine et le troisième de trois ans et demi. Nous restâmes là une bonne partie de la journée, jusque vers trois heures de l’après-midi ; pressé par mes enfants qui seraient morts d’inanition, et croyant tout danger écarté, je me décidai à sortir. La plupart de (p.126) ceux qui étaient dans la caverne se résolurent aussi à partir. J’avais fait à peu près deux cents mètres et je ne me trouvais pas bien loin du Trou Machot, lorsque je fus arrêté par un sodat allemand portant lunettes, qui nous ordonna brutalement de nous rendre à l’école aux Alloux. Chemin faisant, un obus éclata pas bien loin de nous, et sous la garde des soldats allemands, nous arrivâmes près de l’école. Là, on nous fouilla et on nous dirigea ensuite vers une prairie sise à la rue de Velaine, à l’endroit où le Baty St-Pierre rejoint la rue de Velaine.
Là étaient rassemblées déjà d’autres personnes, hommes, femmes et enfants. Peu après notre arrivée, une auto conduisant un militaire, officier pour le moins, s’arrêta en face de nous et repartit presque aussitôt. De cette prairie, on nous fit monter le Baty Saint-Pierre et, à travers un champ de betteraves, nous gagnâmes un champ d’avoine. Là, nouvelle halte. Une heure environ après notre arrivée, on nous dirigea tous vers l’église des Alloux.
En y voyant toute cette foule réunie déjà, je m’enquis autour de moi du but de ce rassemblement, mais personne ne put me fournir la moindre précision. Je résolus donc de m’adresser aux Allemands et j’abordai deux soldats qui se trouvaient sous le porche. Dans l’intention de leur soutirer quelques indications, je leur fit comprendre, par les quelques mots d’allemand qui me revenaient à la mémoire, que j’avais du vin de Champagne chez moi et que je leur en offrais. Ils acceptèrent et vinrent chez moi, à deux pas de là. Je leur servis donc mon Champagne et nous commençâmes chacun de notre mieux, une petite conversation, rendue pénible par le fait que je parlais difficilement l’allemand. Au moyen de mon atlas de géographie, je parvins à comprendre que leur régiment venait de Celle, dans le Hanovre. Ils me montrèrent eux-mêmes cette ville sur la carte. L’un s’appelait Meldau et l’autre Lauffert, du 77e. Ils me donnèrent même chacun une carte portant leur adresse. L’un d’eux était Bäcker (boulanger) ; ils chantèrent leurs hymnes nationaux, me firent voir combien la lame de leur baïonnette était aiguisée — j’y passai même le pouce. Quelques instants après, arrivèrent (p.127) cinq ou six autres soldats. Tous ensemble, nous bûmes à nouveau et, à un moment donné, tous les soldats se levèrent et partirent.
Alors, saisi de crainte d’être trouvé seul dans une habitation, tandis que je savais tous les autres à l’église, je pris le parti d’aller rejoindre mes compagnons. J’emportai même mon pardessus pour couvrir mes enfants pendant la nuit.
En sortant de chez moi, je vis un groupe de soldats près de la maison d’Olivier Dambremont qu’on venait d’incendier. Je reçus un coup de cravache qui fit tomber mon chapeau. Je voulais retourner à l’église, croyant que tout le monde s’y trouvait encore et j’expliquai aux soldats que j’avais reçu des Allemands à qui j’avais donné à boire; mais au lieu de me diriger vers l’église, ils m’envoyèrent en avant, c’est-à-dire vers l’Hôtel de Ville en me disant: lauf (cours). Je descendis ainsi toute la rue de Velaine, en passant en face de la maison Descamps où je vis les derniers soldats allemands. De là jusqu’à l’Hôtel de Ville, je ne rencontrai plus personne. A cet endroit, où je rejoignis l’artillerie en marche, un soldat me prit à ses côtés, et c’est ainsi qu’après avoir reçu force coups de pied, coups de poing, coups de fouet, j’arrivai sur la place Saint-Martin. Là étaient rangés déjà, le long de la Sambre tous les hommes que l’on avait fait sortir de l’église, pendant que j’étais chez moi avec les soldats allemands. Il devait être alors huit heures du soir, car il faisait obscur, sauf que les quelques lueurs de l’incendie qui achevait de consumer les maisons avoisinantes envoyaient sur le groupe une lumière rouge et dansante. Je pénétrai dans les rangs, cherchant les amis que j’avais vus à l’église, entre autres mes deux beaux-frères; au moment où j’arrivai sur la Place, des civils criaient déjà: «Grâce, grâce!», d’autres: «Vive l’Allemagne!». Puisqu’il fallait crier quelque chose, et sans réfléchir, je me mis à dire: Deutschland ûber allés! la devise des Allemands ; mais déjà, j’entendais les cartouches s’engager dans les chargeurs des fusils ; et puis, les soldats qui se trouvaient à huit ou dix mètres tiraient.
(p.128) Les premiers rangs s’écroulèrent ; je me retrouvai tout contre terre, et je sentis immédiatement du sang couler sur ma figure, et emplissant mon oreille droite.
On cria : « Debout ! », une nouvelle décharge et de nouveaux martyrs tombèrent.
Je secouai la tête du malheureux qui se trouvait au-dessus de moi, il ne répondit plus : il avait été frappé à mort du premier coup. C’est seulement quand je sentis le sang m’inonder que je me rendis à l’évidence : alors, plus moyen de douter, on nous massacrait…
Après avoir tiré, ces soldats sauvages, avec une rage et une férocité inouïes, armés de leur baïonnette, faisant usage de leur crosse de fusil et d’autres instruments encore, se précipitèrent sur le tas de victimes et se mirent en devoir de les achever, J’entendis bien distinctement, à plusieurs reprises, le bruit que fait un corps lourd qui tombe à l’eau : c’étaient des blessés ou bien des cadavres que les soldats allemands jetaient à la Sambre.
Au bout d’un certain temps, ces soldats partirent et l’on n’entendit plus que les cris des malheureux dont les souffrances étaient indicibles. Chaque fois que j’entendais le pas d’un soldat, je tirais à moi le cadavre qui m’avait jusqu’alors protégé et j’appliquais sa figure froide et sanglante sur ma propre figure. A certain moment, brisé par les fatigues et l’émotion, je m’endormis. On ne saurait rendre les souffrances endurées pendant cette nuit. De pauvres blessés se tramant péniblement parvinrent les uns dans un champ, les autres dans une grange, là où on les retrouva du reste après : ils n’étaient pas morts, cependant. D’autres, pendant de très longs moments, suppliaient qu’on les achevât; plus tard, ceux qui étaient valides encore, puisèrent, au moyen de bouteilles, de l’eau à la Sambre pour donner à boire aux blessés, torturés par la soif.
Peu à peu, le jour vint ; nous vîmes alors, à contempler cet amas de cadavres et de blessés, combien tragique avait été la scène qui s’était déroulée la veille : ici un crâne vidant sa cervelle, plus loin une tête aplatie complètement; là une jambe (p.129) broyée, des débris de cervelles et de chair humaine ; partout, des entrailles et du sang.
Nous étions donc le dimanche matin. Nous demandâmes au soldat qui nous gardait à parlementer avec l’officier qui était à l’église. M. Seron s’avança et on lui dit que, dès que l’officier le pourrait, il viendrait à nous. Peu d’instants après, en effet, il arriva. Il dit: « Vous avez tiré sur les soldats allemands ». Nous répondîmes : « Non ! nous jurons le contraire ! » A cela, il répondit: «Vous jurez tous mal». Il retourna à l’église et nous crûmes que cette dernière parole était un nouvel arrêt de mort contre nous. A partir de ce moment, je perdis tout espoir. C’est alors que commença pour moi un affreux supplice. Je croyais n’avoir échappé au massacre de la veille que pour subir le sort des compagnons d’infortune étendus à mes côtés. Chaque fois que des groupes de soldats passaient sur la route de Falisolle ou que d’autres groupes venaient camper sur la place, nous nous disions : « Le moment est arrivé ! »
II se fit ainsi que, par deux ou trois fois, des groupes de soldats s’arrêtèrent vis-à-vis de nous, mais chaque fois ils s’en allèrent. Cette incertitude prolongeait notre supplice, et nous nous disions : « Puisqu’il faut mourir, pourquoi nous faire tant attendre? »
Dans la matinée, j’avais obtenu l’autorisation d’aller chercher de l’eau au moyen d’un seau, à une borne-fontaine qui se trouve dans le haut de la Place, près de l’église et je demandai au soldat qui nous gardait, quel sort on nous réservait : il me répondit que nous devions être « bien sages », que nous ne devions pas essayer de fuir, que nous irions à Fleurus.
C’est ainsi que la matinée se passa dans des alternatives d’espoir et de désespoir. Vers 10 heures, d’après ce que je pus juger, nous vîmes arriver sur la Place, amenés par des soldats, des groupes de civils qu’on avait cherchés dans les caves et partout où l’on pouvait se cacher. Les femmes et les enfants étaient gardés tout près de l’église, tandis que les hommes et les jeunes gens étaient amenés près du tas de cadavres et devant le groupe de maisons qui bornent la Place, à l’est. A chaque instant, de (p.130) nouveaux groupes venaient grossir le nombre des prisonniers. Ceux-ci faisaient des signes d’adieux à leurs femmes et à leurs enfants, gardés en face de l’église.
A certain moment, les soldats firent creuser, par les civils qui venaient d’arriver, une grande fosse dans le jardin situé le long de la Sambre. Alors, au moyen de planches, on porta dans cette grande fosse les cadavres que l’on arrangea par lits.
Cette besogne terminée, les hommes furent de nouveau maintenus sur la Place jusqu’au moment où, placés en rangs, hommes, femmes et enfants, sous bonne escorte, se mirent en route par la rue de la Station, la rue Centrale, en passant par l’Hôtel de Ville, jusqu’à l’église des Alloux.
Là, au cortège, se joignirent les femmes et les enfants qui y étaient depuis la veille et, tous ensemble, toujours sous la garde des soldats allemands, on nous conduisit jusqu’à Velaine. Près de l’église de ce village, les soldats firent comprendre qu’il était interdit de rentrer à Tamines avant la fin de la guerre.
II
Déposition de M. Adolphe Seron
Pendant la nuit du vendredi, j’avais reçu chez moi un nombre considérable de soldats et leur avais procuré ce qu’ils désiraient. Parmi eux se trouvait un officier, soi-disant lorrain, qui parlait parfaitement le français. Pour me remercier de mon accueil, ce dernier me dit : « Monsieur, ramassez toutes les valeurs que vous possédez et sauvez-vous. Foutez le camp » (sic). Tout-à-coup, retentit la sonnerie d’alarme. J’insistai pour avoir un sauf-conduit qui me fut refusé, et comme je ne faisais pas mine de vouloir partir sans passeport, l’officier commandant me dit : « Adieu, vous l’avez voulu ». Il pouvait être une heure et demie de la nuit.
Ma maison, située près de la gare, a été incendiée dans la matinée du samedi ; elle a brûlé par contact et a reçu deux obus.
(p.131) Je m’étais, réfugié chez Mage, maison proche, et j’y étais encore vers trois heures de l’après-midi, le samedi. Cependant je constatai que je serais plus en sûreté dans ma maison brûlée, dont les caves sont très grandes, et je rentrai chez moi. A ce moment-là, des troupes passaient dans Tamines sans discontinuer. Vers trois heures et demie des soldats sont encore entrés chez moi.
Ma famille était prisonnière dans la cave de la maison Mage. Je me demandais ce que j’allais faire pour la délivrer, lorsque je vis passer l’officier lorrain que j’avais hébergé la veille. Je sifflai pour l’appeler. 11 se retourna et me pria de le rejoindre. « Tiens, vous êtes encore là, vous », dit-il. — « Oui, Monsieur, votre commandant ne m’a pas fait de passeport ; c’est pourquoi je ne suis pas parti. Dites-moi, je vous prie, où je puis me rendre pour être en sûreté. » — « Allez, Monsieur, à l’église des Alloux ; là vous serez en sûreté. » II m’autorisa à aller reprendre ma famille et à emporter mes bagages.
Madame Durez, et ma femme qui l’accompagnait, ont demandé à l’officier où elles devaient se rendre pour être à l’abri. « Allez à l’église des Alloux », répondit-il. Nous sommes partis et nous avons marché sans encombre jusqu’au charbonnage Sainte-Barbe ; les Allemands que nous rencontrions nous laissaient passer sans nous molester. Au charbonnage, un groupe de soldats nous ont demandé ce que nous avions dans nos paquets : « Du linge », avons-nous répondu. Ils étaient toujours très polis, corrects même, si l’on peut dire. Ils n’ont pas poursuivi la visite.
Je suis arrivé près de la maison de mon beau-père où j’ai essayé d’entrer. J’en ai été empêché par les soldats qui nous ont intimé l’ordre d’aller à l’église des Alloux. Il pouvait être cinq heures et demie du soir. Là, j’ai retrouvé une grande partie de la population, hommes, femmes et enfants, qui remplissaient l’église. Ne trouvant plus place dans le vaisseau, je me suis installé dans le chœur : on servait à la population de l’eau, des biscuits et du pain, mais en très petite quantité. J’ai appris que certaines personnes se trouvaient là depuis le matin.
J’étais à peine entré dans l’église qu’un Allemand, officier (p.132) apparemment, s’est approché du curé des Alloux, près du chœur. Il paraissait tout en colère. Il lui expliquait que les Allemands avaient perdu beaucoup d’hommes à Tamines, et faisait des gestes de menace.
Vers sept heures, on a crié : « Tous les hommes dehors ! » On nous a rangés quatre par quatre depuis la rue de Ligny jusque vis-à-vis de l’église, et un tout jeune officier, revolver au poing, a donné l’ordre du départ. Les soldats nous entouraient, baïonnette au canon; il y en avait tous les six ou sept mètres; j’ai demandé alors où l’on nous conduisait. Un soldat m’a répondu : « Beaucoup de gens dans l’église, prendre l’air. »
Arrivés aux Quatre-chemins, près de la maison Delattre, un convoi d’artillerie passait, s’étendant depuis cet endroit jusqu’à perte de vue ; dans la rue de la Station, les prisonniers durent marcher sur les débris et à la file indienne. Là, plusieurs reçurent des coups de fouets donnés par les canonniers sur leurs sièges.
Tandis que nous passions près de chez Chaltin, la maison brûlait encore. Le convoi d’artillerie s’étendait toujours dans la direction de Falisolle.
Arrivé près de chez Hennion, je remarquai que des troupes nombreuses d’infanterie étaient massées sur la place ; elles ouvrirent leurs rangs pour nous laisser passer dans la direction de la Sambre. On nous rangea : les premiers rangs étaient à environ trois ou quatre mètres de la Sambre.
J’insiste près de mon beau-père, que j’avais protégé jusqu’ici, pour nous jeter à l’eau ; car je sais nager, et je ne pensais pas qu’on allait nous fusiller : je croyais seulement que nous étions prisonniers des Allemands et que nous allions probablement leur servir de paraballe. Mon beau-père, craignant l’eau, ne voulut pas se rendre à mes raisons. J’étais absolument étranger à tout ce qui se passait autour de moi. Tout à coup, j’entends une clameur formidable, et je distingue parmi les cris : « Assassins, fainéants, cochons, vive l’Allemagne, vive l’Empereur ! » et je vois que plusieurs civils sautent dans la Sambre. Des soldats, remarquant cela, accoururent, baïonnette au canon, le (p.133) long de la Sambre pour maintenir les fuyards. A ce moment, pas un coup de fusil n’avait été tiré. Le jour tombait, il allait faire noir. Les soldats allemands se retirèrent ; à un coup de sifflet, j’entendis une décharge composée de très nombreux coups de fusil. Je n’ai pas entendu une balle siffler et n’ai pas vu un homme tomber.
Les cris et les clameurs de la foule s’élevèrent de nouveau avec une force toujours croissante. Les Allemands, revenus le long de la Sambre, rendaient la fuite difficile, sinon impossible. Beaucoup de civils se jetèrent par terre ; les soldats les contraignirent, à coups de baïonnette, à se relever, puis rangèrent les hommes face au mur du jardin voisin.
J’insistai de nouveau auprès de mon beau-père pour l’entraîner dans la Sambre ; je me trouvais alors à peu près au centre des civils. Je remarquai que les soldats se retiraient à reculons, l’arme au poing, sur ma droite. A gauche, un peloton composé d’une vingtaine d’hommes s’avançait vers la tête du groupe des civils en face de la maison du vétérinaire Broze. Je vis en même temps quelques femmes.
Les soldats épaulèrent. Je saisis alors mon beau-père à bras le corps et voulus le précipiter dans la Sambre. Or, mon beau-père était très lourd. Il se débattit et, ce faisant, me fit faire demi-tour à droite, de sorte que j’étais à peu près face au pont. J’aperçus alors un intrument monté, m’a-t-il semblé, sur trépied. Je le pris pour un appareil photographique et je me fis la réflexion ; « Tiens, les brigands photographient les Belges au moment où ils demandent grâce », et tout de suite après, je me suis dit : « C’est une mitrailleuse ». Tout ceci a duré l’espace de, quelques secondes.
« Jetons-nous à terre ! » dis-je à mon beau-père, en l’y précipitant. Au même instant, les fusils partaient et les hommes tombaient, au milieu de toutes les clameurs imaginables. Au coup de sifflet, les soldats en face de la maison Broze tirèrent d’abord, et tout de suite après, la mitrailleuse. Celle-ci fonctionna pendant un certain temps qui s’a semblé plusieurs minutes. On en entendait distinctement le «tac-tac ».
(p.134) La plupart des civils, au signal, s’étaient jetés par terre. M. Arthur Fauvelle, qui se trouvait à mes côtés, tomba sur moi : il avait la tête traversée d’une balle, qui est sortie par l’oreille gauche.
J’étais donc par terre, les jambes couvertes de morts ; mon corps se trouvait entre les jambes d’Eugène Ledoux, mort. Je me suis caché au moyen de Fauvelle le mieux que j’ai pu, en faisant le moins de mouvements possible ; c’est dans cette position que j’ai pu entendre et voir à différentes reprises les soldats allemands parcourir le champ du carnage et s’acharner sur les malheureux civils, mourants ou blessés.
Il pouvait être huit heures et demie.
Le calme régnait et n’était troublé que par les lamentations et les cris des blessés. J’entendis alors, surpris, qu’il restait des survivants au massacre, entre autres, mon beau-père. Une demi-heure après, je distinguai à la lueur des incendies un groupe de soldats se trouvant près de l’écurie de M. Broze. Est arrivé, sur ces entrefaites, un autre groupe de soldats et j’entendis murmurer autour de moi avec un accent de soulagement : «Tiens, voilà la Croix-Rouge; nous allons être soignés». A ce moment, je relevai légèrement la tête et il me parut, en effet, remarquer que ces soldats étaient sans armes et tenaient en main des instruments autres que des fusils. Les voyant approcher, je m’enfonçai la tête vers le sol. L’un d’eux s’approche d’un blessé et lui demande s’il est grièvement atteint. Celui-ci répond: «A l’épaule gauche», et lui demande de l’eau. Le soldat lui en promet, ce qu’entendant, d’autres blessés s’empressent de faire la même demande. Les soldats s’approchent alors et, pour leur donner à boire, précipitent les malheureux dans la Sambre. C’est ainsi qu’une vingtaine d’hommes furent jetés dans la rivière. Ces soldats étaient armés de barres de fer, de pièces de bois, etc.
D’autres soldats, venant de la direction du pont, explorèrent le champ de carnage et achevèrent tous ceux qui leur paraissaient être encore en vie. C’est à ce moment que le malheureux Fauvelle, mort déjà, eut la tête fendue.
(p.135) Soudain, quelques coups de fusil, précédés d’un coup de canon, se firent entendre. Un blessé cria : « A moi, Français ! » Les soldats se précipitèrent vers le pont et tout rentra dans le calme. Il pouvait être neuf heures du soir.
Au bout d’un certain temps, je relevai la tête pour m’assurer qu’aucun soldat ne montait la garde parmi nous. Je constatai que pas un n’était visible aux environs. Le silence n’était troublé que par les cris sauvages que poussaient les Allemands sur la route de Falisolle. Je pus alors causer avec mon beau-père et je constatai malheureusement qu’il avait perdu la raison. Je fis des efforts surhumains pour me dégager les jambes et je ne pus y parvenir. Au bout d’un laps de temps qui me parut être long, j’entendis des blessés demander à boire. Je reconnus, à sa voix, M. Labarre qui leur donnait de l’eau.
Epuisé de fatigue, d’émotions, de faim, de soif, ayant presque perdu la notion de moi-même, je m’endormis.
Le jour paraissait à peine, lorsque je m’éveillai. Je promenai ma main derrière moi : je touchai une tête toute chaude, brûlante. Je demandai qui c’était ; une voix répondit : « Pierre Gouthière ». Je m’informai s’il était blessé. « Oui, me répondît-il, à la jambe ». Son voisin, Arsène Malonne, qui était couché sur moi, était aussi vivant. Dans l’entretemps, mon beau-père prétendit qu’il avait le pied coupé et me demanda de le dégager. Je demandai à Pierre Gouthière s’il ne pourrait pas se soulever un peu et, en même temps, soulever le cadavre qui reposait sur mes jambes. Après m’avoir supplié de ne pas bouger, Pierre se rendit à mon désir. Je pus avec son aide dégager la jambe droite, puis la jambe gauche. Aussitôt redressé, j’inspectai l’horizon : j’aperçus quelques soldats près du porche de l’église et une sentinelle faisant les cent pas sur le pont.
Me voilà debout au milieu des cadavres ! Le jour se levait, et je regardais ce qui se passait. Ne remarquant plus aucune attitude hostile, je m’empressai de dégager mon beau-père. Je constatai avec plaisir qu’il ne portait aucune blessure grave. Je lui conseillai de se frictionner un peu les jambes et de se promener (p.136) pour rétablir la circulation du sang et, à ce moment-là il paraissait avoir recouvré la raison.
Entendant des conversations et du bruit, des blessés demandèrent à boire, entre autre, mon ami Charles Decocq. J’allai puiser dans mon chapeau de l’eau à la Sambre, parmi les cadavres des noyés, et c’est les mains teintes de sang que je leur présentai à boire. En renouvelant une seconde fois la même manœuvre, je remarquai des bouteilles vides et m’en servis au lieu du chapeau. Plusieurs blessés étaient mourants et me demandèrent de leur amener un prêtre.
Je me mis en devoir de satisfaire à leur demande et trouvai M. l’abbé Docq, mais il était mort. Il avait la bouche ouverte, et je constatai qu’il avait une blessure à la gorge; il devait être mort avant d’avoir reçu cette blessure, car il n’y avait pas de sang sur sa soutane.
Quelques pas plus loin, je remarquai le cadavre de M. le curé des Alloux. En même temps j’apercevais le bord de la soutane d’un autre prêtre : ayant remué quelques corps, je reconnus M. le vicaire des Alloux. Je lui demandai s’il était blessé et s’il était en état de se lever, car des mourants réclamaient son ministère. « Je crois que oui, me répondit-il, mais avec votre aide, car je suis blessé ! »
Pour l’aider à se lever, je dus déplacer quelques cadavres. Je rencontrai un corps chaud, face contre terre, qui tenait par le bras l’abbé Donnet. Je l’interrogeai : « Tiens, c’est toi, là, Félicien (j’avais reconnu le bossu Sadone) que fais-tu là? ». « Je suis mort ! » dit-il en wallon. Je dus employer la force pour dégager M. le Vicaire ; je le conduisis près des mourants qui avaient réclamé ses soins, puis le ramenai à sa place.
Je retournai près de mon ami Charles Decocq et constatai que la vie l’abandonnait. Je le pris dans mes bras et pendant ce temps j’entendis comme le bruit de la chute d’un corps dans l’eau : ne voyant plus mon beau-père sur la rive, je courus vers la Sambre, mais trop tard ! Il avait disparu dans les flots, pris d’un accès de fièvre chaude; on l’en a retiré quelques jours plus tard.
(p.137) Je revins à mes blessés.
Nous voilà arrivés entre six et six heures et demie du matin. A la demande de quelques compagnons, je me décidai à m’adresser au corps de garde qui se tenait près de l’église. Je pris en main mon mouchoir tout teinté de sang et je l’agitai pour indiquer mon intention au poste. Arrivé à quelque distance, je fus couché en joue, et on me dit : « Le commandant va venir. » II s’écoula un certain temps, puis je vis un grand et bel homme, me paraissant être un officier, s’avancer vers nous. La plupart des survivants, à son approche, crièrent « grâce » et voulurent tous parler à la fois. S’adressant à ces malheureux : « Vous étiez ici, hier soir? » Sur la réponse affirmative, il dit: « Je ne vous crois pas, montrez-moi vos blessures ». Il dut se rendre à l’évidence. Pour toute réponse : « Vous avez tiré sur nos soldats, dit-il, vous resterez tous ici ». Je me suis ensuite approché de lui et lui ai demandé de l’eau pour soigner les blessés. Il me répondit: « II n’y a pas de blessés, ici » et il disparut, s’en retournant comme il était venu.
Alors, vers sept heures et demie, est arrivé un médecin allemand de la Croix-Rouge qui m’accorda de l’eau propre pour les blessés et chargea M. Steinier, accompagné d’un soldat, d’aller en chercher à la pompe, près de l’église. Tous les valides, alors, se mêlèrent de soulager les blessés.
Depuis le matin, les Allemands amenaient tous les civils qu’ils trouvaient encore, hommes, femmes et enfants et les parquaient près du café Steinier en face de l’église. On amena, pour tenir compagnie à ces malheureux, environ deux cents femmes et enfants, qui pouvaient contempler le monceau de cadavres.
Vers dix heures, des hommes, au nombre de cent cinquante à deux cents, furent amenés, et on les massa en face des ruines de la maison Loriaux. Le spectacle qui s’offrait à la vue de ces pauvres gens qui ne savaient pas ce qui s’était passé la veille, était affreux. Sur une longueur d’environ cinquante mètres, une largeur de cinq à six mètres, étaient étendus le long de la Sam-bre plus de quatre cents cadavres et blessés, gisant dans toutes les positions, les uns le crâne ouvert laissant échapper la cervelle (p.138), les autres défigurés; d’autres encore dont le ventre ouvert laissait échapper les entrailles ; et au milieu de ce tas de cadavres, des hommes, des amis, circulant parmi ces débris humains.
J’avais vu arriver sur la place, vers huit heures, un soldat que je pris pour un sous-officier ; il me paraissait plus humain, ayant les yeux pleins de larmes. Tandis que je circulais parmi les blessés, j’essayai d’entrer avec lui en conversation. C’est ainsi qu’il m’apprit qu’un rapport avait été adressé à l’Etat-Major demandant de ne plus fusiller les survivants de ce massacre, et que la réponse arriverait vers midi. Il me promit, sous le sceau du secret, de me communiquer la réponse ; et, comme je paraissais en douter, il me montra son chapelet. Dans l’esprit des Allemands, nous étions des fanatiques, et cette idée explique comment il me montra son chapelet, pour m’inspirer confiance. Il prit sa gourde et en donna à boire à plusieurs blessés, puis tira de sa giberne des galettes qu’il distribua; comme je lui demandais si l’on pouvait fumer, il alla chercher des cigares et nous les offrit. Furieux de la compassion qu’il témoignait aux blessés, les soldats qui se trouvaient près de l’église, le reçurent avec des gestes et des cris que nous prîmes pour des menaces. Ce qui ne l’empêcha pas de venir me dire vers midi que nous ne serions plus fusillés et que nous serions dirigés vers Fleurus où nous serions libres.
Vers onze heures, plusieurs officiers allemands vinrent sur la place et, s’adressant à M. Gustave Moriamé qui comprenait l’allemand, lui expliquèrent que les civils qui se trouvaient près de chez Loriaux devaient creuser une fosse dans le jardin Steinier, situé près de la Sambre, pour y enterrer les morts, ajoutant que l’on soignerait ensuite les blessés légèrement, s’ils étaient sages et que l’on devait emmener les autres près de l’église où était creusée une petite tranchée. Dans cette tranchée, se tenaient en ce moment quelques soldats allemands armés de fusils dont les canons étaient dirigés sur les civils près de chez Loriaux, faisant toujours mine de les fusiller.
On creuse une grande fosse. Celle-ci achevée, les morts furent transportés par les civils valides sur des planches de deux à trois (p.139) mètres de longueur, ce qui produisait un balancement sinistre et augmentait la difficulté du transport. Le vieux curé de St-Martin fut contraint de conduire un cadavre sur une brouette.
On jetait, on culbutait, on faisait rouler les cadavres dans la fosse où ils étaient rangés par un civil qui était au fond. Comme ce civil se plaignait de la tâche inhumaine qu’on lui imposait, de manipuler des cadavres pleins de sang, défigurés, un médecin qui se trouvait sur le bord de la fosse a tapé sur sa montre en disant : « C’est la guerre, heure de Monsieur a. sonné, heure de Madame aussi. »
Cette sinistre besogne dura jusque environ une heure. Pendant ce temps, une table dressée au milieu de la place était entourée d’officiers et de médecins sablant le Champagne.
Depuis huit heures du matin, plusieurs pelotons de soldats, dont certains de la Croix-Rouge, venaient faire l’exercice sur la place.
Aussi presque tous les civils, ignorant la confidence qui m’avait été faite le matin par le sergent, ou refusant d’y croire, pensaient à tout moment que leur dernière heure était arrivée. C’est ainsi qu’en prévision de leur exécution, beaucoup se sont confessés aux prêtres.
La triste besogne était terminée. Les femmes et les enfants remplis d’effroi avaient assisté à cette lugubre opération.
Une escouade de civils fut ensuite détachée pour aller rechercher les cadavres carbonisés dans les immeubles Hennion et Mombeek.
Vers quatre ou cinq heures, les hommes furent confondus avec les femmes et encadrés de soldats baïonnette au canon. Le cortège s’ébranla à travers les débris fumants des maisons, par la route de Velaine, dans la direction de Fleurus. Il grossissait, chemin faisant, de tous les autres civils arrêtés et parqués en différents endroits. En passant près de l’église des Alloux, i! s’augmenta de la multitude des femmes et des enfants qui y étaient enfermés. Toute la population de Tamines fut ainsi conduite à Velaine sous une escorte de baïonnettes. Traversant le bois, on fit lever les mains aux prisonniers, tandis qu’on
(p.140)
tirait deci-delà des coups de feu. Les malheureux croyaient toujours qu’on allait les tuer dans le bois.
Cette foule d’environ trois mille personnes fut libérée à Ve-laine, localité de deux mille cinq cents âmes, où elle dût chercher abri et nourriture, beaucoup étant restés sans boire ni manger depuis vingt-quatre heures. L’effroi, la démoralisation de ces malheureux avait atteint un tel degré qu’à l’annonce de leur libération, plusieurs se mirent à crier encore « Vive l’Allemagne ! »
III. Déposition de M. Emile Leroy
C’est le samedi 22 août 1914, jour néfaste, à jamais inoubliable.
Vers trois heures et demie du matin, je suis obligé avec ma famille, de fuir précipitamment de chez moi en présence des incendies qui dévorent les maisons voisines. Tout le quartier de la rue de la Station et celui de la rue de Falisolle sont en feu ; les soldats allemands des 76e et 77e régiments, mettent le feu aux quatre coins de la localité.
Je me réfugie dans la cave d’une maison située aux Alloux. Vers six heures et demie du soir, je suis forcé par les soldats allemands de quitter mon abri et de me rendre à l’église des Alloux. L’église et les écoles y attenant sont déjà bondées de monde : hommes, femmes, enfants se lamentent et se demandent anxieusement ce qu’il va advenir de nous tous.
Nous sommes bientôt fixés ; soudain, un commandement bref retentit : « Tous les hommes à la porte ! » et, dans la confusion générale, malgré les cris, les plaintes, les pleurs des enfants, des mères et des épouses, on nous pousse dehors.
Par rang de quatre hommes, on se met en route; c’est ainsi, qu’escortés par les soldats allemands, revolver au poing, on nous dirige vers le bas du village. Tout le long du chemin, l’artillerie allemande est arrêtée, et, à notre passage, les soldats (p.141) nous lancent les épithètes les plus grossières, nous crachent à la figure et nous frappent de nombreux coups de fouet et de crosse de fusil. En passant dans la rue de la Station, nous sommes obligés d’escalader des tas de débiis fumants ; plusieurs se brûlent sérieusement aux jambes.
Enfin, nous arrivons sur la place Saint-Martin, située près de la Sambre ; il est alors sept heures et demie environ. Là, un fort contingent de soldats arrangés en « gradins » ; il y en a partout, même sur le chemin qui conduit au pont de Sambre, où plusieurs mitrailleuses sont installées.
Notre groupe qu’on peut évaluer à près de six cents hommes, sans défense, et parmi lesquels des vieillards de quatre-vingt-quatre ans et des adultes de quatorze à quinze ans, est partagé en deux pelotons ; on nous injurie à nouveau ; on nous fait crier : <; vive l’Allemagne! vive l’Empereur! », et tout à coup le commandant donne des ordres ; un coup de sifflet retentit et une pétarade bien nourrie déchire l’air; les soldats viennent de décharger leurs armes sur le groupe de droite ; la mort a déjà fait des victimes. (Voir page 6£.)
Quand l’aube paraît, que les premières lueurs du jour me permettent de voir, je suis épouvanté devant le spectacle terrifiant que s’offre à mes yeux. Ce que je vois, oh ! pourrai-je jamais le décrire? Des cadavres et toujours des cadavres couchés pêle-mêle ; des corps sans tête et des têtes à moitié emportées ; des crânes ouverts d’où s’échappe la cervelle ; des membres brisés, déchiquetés et emportés, des plaies béantes. Horreur, horreur !…
Voilà le tableau qu’il m’est donné de contempler pendant des heures ; plus encore, car le dimanche matin, plusieurs blessés expirent sous mes yeux. Je tiens ici à reconnaître et à signaler le dévouement de M. l’abbé Donnet, vicaire des Alloux, qui, malgré ses graves blessures, nous encouragea tous, prodigua des paroles consolantes aux blessés et donna l’absolution in extremis aux mourants.
Le matin, un officier allemand vint contempler avec un sourire (p.142) narquois la belle besogne faite par ces hordes barbares; il nous reprocha d’avoir tiré sur les soldats (ce qui est archifaux, je le proclame hautement). Après lui avoir juré que pareille chose ne s’était pas produite, il nous répondit; «Vous jurez tous mal ; restez-la ! »
Comme vous voyez, nous n’étions pas encore fixés sur notre sort. Bon nombre de civils, hommes, femmes, enfants sont amenés sur la place ; on parle encore de les fusiller.
Enfin, vers trois heures les Allemands font enlever les cadavres par les civils qui vont les « enfouir » pêle-mêle dans un jardin avoisinant la place, où une grande fosse a été creusée, toujours par les civils.
Vers quatre heures du soir (donc vingt-et-une heures après le massacre), on commence à transporter les blessés qui, pour la plupart sont déposés dans l’église de St-Martin, transformée en Croix-Rouge.
Quant à moi, je suis obligé de marcher seul et de me rendre par ordre des soldats à la ferme Couvreur, à moitié incendiée, qui se trouve près de l’église. Je reste deux jours couché sur le plancher sans manger et sans recevoir aucun soin. Nous n’avons plus alors qu’un médecin à Tamines, M. le docteur Léonard Defosse, qui est forcé de soigner les blessés allemands avant nous.
Finalement, M. le Docteur Defosse peut me recevoir chez lui, où il me soigne très bien: j’atteste bien haut son dévouement pour tous les blessés.
C’est bien par miracle, avouons-le, que j’échappe à cette véritable destruction humaine, où plus de trois cents hommes sont tués. Mon regretté beau-père, Benoni Culot, âgé de soixante-huit ans, moins heureux que moi, tomba frappé à mort sous les coups de ces véritables assassins.
Et vous qui lirez ce récit, vous vous demanderez peut-être comment il se fait qu’après avoir vécu ces heures terribles, je l’ai pas perdu la raison.
(p.143)
IV
Déposition de M. Louis Lardinois
Nous étions restés dans nos caves toute la journée du samedi 22 août ; vers quatre heures, des coups de crosse de fusil furent donnés dans la porte de la maison et firent voler les vitres en éclats. Des amis, qui s’étaient réfugiés chez nous, M. Bur-niat à son fils, — tués tous deux quelques heures après à la fusillade, — se précipitèrent vers la porte du fond et s’enfuirent dans le jardin. Nous suivîmes, entraînés par l’exemple. Entre notre maison et la maison voisine, il y a un espace libre : des soldats, nous ayant aperçus, se mirent à tirer sur nous quatre ou cinq coups de feu. Un officier s’avance sur le terrain, à cheval, revolver au poing et nous force de nous joindre au groupe de civils captifs qui attendaient devant la maison. Nous partîmes ainsi vers l’église en compagnie de ces Taminois dont le nombre pouvait s’élever à une centaine, tous du voisinage.
A l’église, où nous arrivâmes parmi les premiers, l’afflux des civils commençait. Nous nous assîmes ; on parla, ne soupçonnant pas ce qui allait arriver; un soldat me disait que la raison de ce rassemblement était la crainte du bombardement français.
A certain moment, mon oncle Baudry qui est fermier (mort ensuite dans la fusillade), me dit qu’il désirait aller donner un peu de fourrage à ses bêtes, et je m’adressai à un officier, lui demandant l’autorisation de sortir : il consentit et nous fit escorter par deux soldats. En sortant de l’église, un monsieur qui s’exprimait en allemand, discutait, près du porche, avec une espèce de sergent, et j’entendis distinctement celui-ci qui disait : « Die Zivilisten haben geschossen ». A quoi, l’interlocuteur et moi, nous répondîmes : « Das ist nicht moglich, alle Flinten waren auf dem Stadthaus ». De fait, tous les fusils avaient été remis à l’Hôtel de Ville contre récépissé. Ce bout de conversation me fit supposer qu’on allait punir la population de Tamines.
Lorsque nous arrivâmes chez mon oncle, l’un des soldats me (p.144) fit arrêter, avant de mettre le pied sur le seuil de la/maison, et me dit: « Si des Français sont ici cachés, ou si un seul coup de fusil part de la maison, en quelques minutes, je mets tout en flammes », et il tapa sur sa cartouchière pour indiquer qu’elle était fournie. Après que nous eûmes soigné les bêtes, mon oncle et moi revînmes à l’église toujours escortés des dieux soldats. Les civils arrivaient toujours.
Vingt minutes après le cortège se formait.
L’ordre retentit : « Tous les hommes dehors ! » Quatre par quatre, mornes, la tête basse, silencieux, nous sortîmes enfilant la rue de Velaine, flanqués de deux cordons de fantassins et de quelques cyclistes allant et venant tout le long du cortège.
Près de l’Hôtel de Ville, un charroi d’artillerie se déroulait, comme un ruban sans fin jusqu’à la route de Falisolle. Notre cortège prit la rue Centrale, incendiée, et arriva dans les débris fumants de la rue de la Station. Ce qui restait libre de la route, c’est-à-dire la partie à droite, était occupé par le convoi d’artillerie, le reste était encombré par les façades écroulées, fils électriques, ferrailles, pierres, briques; le tout formant des tas inégaux et surélevés que les malheureux escortés n’escaladaient qu’avec peine. Et les artilleurs, assis sur leurs caissons, prenaient plaisir à ce manège ; si parfois l’un des civils, après avoir péniblement franchi un monceau de ruines, ralentissait son allure afin de reprendre un peu haleine, un violent coup de fouet lui cinglait la figure ou lui ceinturait les reins, tandis que de la bouche de ces monstres s’échappaient ces mots, accompagnés du rire épais de la brute satisfaite : Schneller, Schweinhunde! (Plus vite, cochons!). Plusieurs reçurent aussi des coups de crosses de fusil. Pour ma part, je reçus un coup de fouet dans la nuque.
Je dois ajouter que, devant la maison Moreau, un officier avait dit à Lucien et à Jules : « Les gamins ne viennent pas, sortez des rangs ! » et mes deux frères étaient sortis, rebroussant chemin par la rue de Velaine, dans l’intention de retourner à l’église ; plus loin, un soldat les a fait rentrer dans le groupe : c’est ainsi que, sur la Place, nous étions séparés.
(p.145) Lorsque j’arrivai, on criait déjà : « Vive l’Empereur ! » et «Vive l’Allemagne ! ». J’entendis aussi; « Deutschland über alles! ». Je me rappelle que des commandements ont été donnés alors à voix brève et que les soldats ont commencé à armer leurs fusils : en remarquant cela, je me souviens aussi que les clameurs se sont changées en une immense supplication : « Grâce, grâce ! » et ce cri a cessé brusquement quand le coup de sifflet a retenti. Pendant qu’on criait « grâce » et que les soldats armaient les fusils, les civils étant placés le long de la Sambre, des soldats ont divisé le groupe en deux. A mon avis, cette section en deux pelotons avait pour but de mieux diriger le tir des soldats, car je pense qu’ils tirèrent d’abord sur le groupe extrême le long du mur au premier coup de sifflet. Je n’ai pas entendu crier : « Debout ! » et si on l’a crié, ce doit être entre la première et la seconde fusillade.
Pendant qu’on armait les fusils, j’ai distinctement entendu l’abbé Docq dire à ses voisins à très haute voix ; « Mes amis, cette fois-ci, je crois que ça va chauffer : je vais vous donner l’absolution générale ». Tout de suite après, le premier coup de sifflet a été donné. (Voir page 51.)
Ces deux soldats se retirèrent immédiatement et quelques instants après, un clairon qui devait se trouver près de chez Hennion lança trois notes comme un rappel, et les soldats qui avaient tiré et achevé les blessés se retirèrent se dirigeant, par le pont, vers Falisolle.
Il y eut un moment de répit pendant lequel je n’ai rien pu voir. (Voir page 56.)
J’ai continué ainsi à ramper à travers les prés des Haz jusqu’au talus du chemin de fer que je réussis à escalader sur le ventre, la pente étant très douce. Je traversai le chemin de fer en face de la remise des locomotives. Je m’engageai dans le raccordement de la fonderie Mathy et gagnai par là la campagne. Je me dirigeai de là vers le château Liesens, qui achevait de brûler, en passant à gauche du cimetière. J’entrai dans la (p.146) maison du cocher de M. Liesens, où je me reposai : la maison était déserte. Vers la fin de la nuit, je me dirigea/vers Moigne-lée où je réussis à atteindre l’école des Sœurs, et ou je fus pansé. Le lendemain, je fus transporté sur brancard à Tamines, à la Croix-Rouge de la rue des Alloux où ne se trouvaient que des Allemands.
A l’hôpital de la rue des Alloux, était sojgné un lieutenant allemand qui était blessé à l’avant-bras gauche et qui affirmait que cette blessure avait été produite par une décharge de fusil de chasse. Il était furieux contre les civils et disait à tout moment : Schlechte Zivilisten! Je n’ai pas vu le plomb de chasse, mais sa blessure était large. Il avait été blessé à l’attaque du pont, le soir; il avait été impossible de voir le civil…
Pendant la seconde salve de la fusillade, j’ai entendu distinctement le tac-tac d’une mitrailleuse qui tirait sur nous.
- Déposition de M. Franz Van Heuckeloom
Le vendredi 21 août, j’étais parti Vers huit heures pour me rendre à mon bureau. Les gens croyaient que les Allemands arrivaient : je suis retourné chez moi. Dans la matinée, nous sommes partis avec la famille Fondu par la rue des Alloux et nous nous sommes arrêtés au café Chaltin, près du pont du chemin de fer, gardé par les artilleurs de la Garde civique de Charleroi. Au loin, à Auvelais, on voyait les obus éclater et les maisons brûler.
De là, nous sommes retournés chez nous par le même chemin et nous nous sommes couchés dans la prairie, d’où nous voyions les obus éclater dans l’eau de la Sambre. Nous sommes descendus à la cave de chez Fondu losrqu’on a dit que les Allemands approchaient et enlevaient le drapeau de l’église des Alloux. Un quart d’heure après les Allemands descendaient la rue.
(p.147) Nous nous sommes alors réfugiés dans la cave de Madame veuve Labarre où nçus sommes restés toute la nuit.
Le samedi, nous avons vu, par les soupiraux, des civils qui passaient accompagnés de soldats, remontant vers l’église. Vers quatre heures un\ Allemand est entré dans la maison et s’est mis à boire et à funier. Une heure après, un autre Allemand est venu dire qu’il fallait tous remonter pour se mettre en sécurité dans l’église des AÎloux : avant de nous y rendre, je suis rentré chez moi, accompagné d’un soldat, pour prendre des vivres, du lait et du pain pour les petits enfants.
A l’église, les Allemands, parlant des prêtres, disaient qu’ils les pendraient : ils les appelaient : Erzspitzbuben. Comme je les défendais, en affirmant qu’ils étaient bons, ils ont dit que moi aussi j’appartenais à leur catégorie.
Je ne quittai pas l’église ; les Allemands entraient portant des bouteilles de liqueur, des caisses de biscuits qu’ils avaient dérobées dans les magasins et qu’ils distribuaient à la population : à un moment donné, débordé par les petits enfants qui prenaient eux-mêmes des raisins, un soldat a jeté la caisse à terre et l’a piétinée; en même temps, il tirait un coup de revolver dans l’église pour effrayer les gens.
Pendant ce temps, M. le Curé faisait le tour de l’église avec un Allemand, ouvrant les confessionnaux, montrant que personne n’y était caché. A certain moment, les Allemands ont fait sortir les petites filles qui pouvaient se passer des soins maternels, pour aller à l’école des Sœurs. Le bruit courait que les hommes avaient reçu l’ordre de sortir de l’église pour se rendre à l’école des Frères, parce qu’on était trop nombreux à l’église.
Je me rangeai donc dans le cortège pour descendre vers la place.
Au moment où nous sortions de l’église, la maison d’Olivier Dambremont brûlait en plein. Les Allemands, munis de bidons à pétrole, essayaient de mettre le feu à une table chez Delattre : ce doit avoir été en vain, car la maison n’a pas brûlé.
Sur le parcours, je n’ai pas été maltraité; mais j’ai constaté qu’on frappait les civils et qu’on les injuriait.
(p.148) Rue de la Station, les maisons du fond flambaient encore. Nous avons dû marcher sur les débris. Sur la Place, on nous a alignés par quatre de profondeur, plus ou moins’régulièrement.
A ce moment, j’ai entendu un officier qui nous accusait d’avoir tiré sur les soldats, il nous traitait de lâches, et il disait que nous méritions une peine exemplaire. On était arrivé là depuis quelques minutes qu’on n’avait pas encore tiré. Des civils criaient : « Grâce pour les petits enfants ! Si vous avez pitié de nous, vous remporterez la victoire, etc. ».
C’est alors probablement qu’on a tiré. Je ne sais plus ce qui se passa alors. (Voir page 58.)
Chaque fois que les Allemands venaient, on se couchait à plat, puis, une fois qu’ils étaient partis, on relevait la tête. On devenait un peu plus hardi ; on se redressait tout doucement.
Les Allemands ne sont plus revenus vers nous de la nuit.
Pendant la seconde partie de la nuit les blessés qui étaient torturés par la soif, imploraient leurs compagnons valides, demandant à boire. A ce moment, un blessé se traîna jusqu’à la Sambre et remplit une bouteille dont il donna à boire aux blessés: j’en ai bu une petite gorgée. Ce blessé a été puiser de l’eau une seconde fois.
Au matin, j’ai vu MM. Seron et Labarre qui soutenaient M. le vicaire des Alloux pour aider à confesser ceux qui le désiraient. Quelqu’un est allé chercher de l’eau à la borne-fontaine près de l’église. L»es Allemands ont apporté un demi pain et des biscuits.
Un jeune soldat s’est approché d’un blessé, lui souleva doucement la tête et le fit boire ; il lui donna ensuite une galette. Le soldat branlait la tête de pitié. Un officier s’est alors avancé vers lui et l’a grondé de s’être approché du blessé.
Vers neuf heures, un médecin allemand est arrivé, accompagné d’un jeune soldat qui parlait français, et demanda quelqu’un qui sût l’allemand. Je me présentai. Il expliqua qu’une estafette était partie à l’Etat-major, afin de savoir ce qu’on allait faire de nous. Dans deux heures, ajoutait-il, nous connaîtrions la réponse, nous serions fixés sur notre sort, à savoir si (p.149) nous serions fusillés ou remis en liberté. Je lui demandai alors ce qu’il fallait faire en attendant la réponse ; il donna la permission de fumer, de rester debout, mais défendit de circuler de droite et de gauche et de faire du bruit.
Pendant ce temps, un groupe de soldats s’était arrêté à une dizaine de mètres de nous : quelques-uns employèrent leur temps à nettoyer leurs fusils et leurs baïonnettes avec du sable, et nous les montraient en ricanant.
Un officier, passant, nous interpella et, comme nous affirmions que personne n’avait tiré, il nous dit avoir vu la maison d’où les coups partaient.
Lorsque nos deux heures d’attente furent passées, j’essayai de m’approcher de l’officier ; mais chaque fois, il fit signe de la main que je ne pouvais pas avancer.
Les civils arrivaient, dans l’entretemps, de chez les Frères. On obligea les hommes à creuser la fosse dans le jardin près de la Sambre.
J’ai vu des soldats qui arrachaient les portes et les fenêtres aux maisons du côté de l’église, pour en faire des civières. Le deuxième groupe de civils devaient transporter les morts à la fosse. Comme l’opération était lente, on prit, pour aider au transport, les civils qui avaient creusé la fosse, puis les survivants du massacre.
Tandis qu’ensuite on transportait les blessés, un sous-officier cherchant un civil à qui pouvoir parler en allemand, je l’abordai. La conversation m’ayant amené à lui montrer la photographie de ma femme, il me dit que lui aussi était marié, depuis un an. Je lui expliquai combien c’était malheureux d’être ainsi arrangé, mais lui, il prétendait que c’était un châtiment mérité parce que nous avions tiré sur les Allemands. Je lui affirmai ?; plusieurs reprises que nous n’avions pas tiré. — Je suis resté tout le temps avec lui, jusqu’au moment où nous sommes arrivés à Velaine. — C’est ainsi que je visitai l’ambulance établie à l’église Saint-Martin où se trouvait une femme blessée et des soldats allemands et français, rangés les uns à côté des autres. Mon sous-officier faisait des passeports pour les femmes (p.150) qui n’étaient pas de Tamines, afin de leur permettre de retourner chez elles. Il disait qu’on allait évacuer Tamines, parce que la population était mauvaise et qu’il allait passer beaucoup de troupes : de la sorte, les civils ne pourraient plus tirer sur les soldats. C’est alors que nous avons appris qu’on nous conduirait à Fleurus.
Lorsque le travail d’inhumation fut terminé et les blessés enlevés, on permit aux hommes de se mêler au groupe des femmes et des enfants, retenus près de l’église. Je compris alors qu’on ne nous fusillerait plus, parce qu’il était impossible, me disais-je, que l’on fusillât des femmes.
Dans le bois de Velaine, les Allemands tiraient à droite et à gauche, faisant croire que c’étaient les civils, mais il était impossible qu’il y eût des civils dans le bois.
A Velaine, on apprit que nous étions libres, que nous pouvions aller jusqu’à Gembloux, mais pas rentrer à Tamines. L’Allemand qui m’accompagnait m’a dit que nous pourrions retourner à Tamines dans quatre ou cinq jours, mais non pas ensemble, par petits groupes.
- Déposition de M. François Lavis
J’ai été fait prisonnier vers deux heures et demie dt l’après-midi, le samedi 22 ao:il, rue de l’Ile; on nous a (vuduits à l’église des Alloux et avant d’y arriver, vers le terril du Vieux Hasard, — il était environ quatre heures, — on nous a fait prêter serment que nous ne tirerions plus sur les Allemands ; nous avons déclaré que nous n’avions jamais tiré et que ne us ne tirerions pas encore.
Arrivés à l’église des Alloux, nous avons reçu à manger et on a distribué des bonbons aux enfants. Vers six heures et demi, on a fait sortir les femmes et les enfants pour les mettre à (p.151) l’école des Sœurs, et, vers sept heures, on nous a fait évacuer l’édifice sans nous faire savoir où nous allions,
Le long du chemin, les soldats braquaient toujours leurs uvolvers et leurs fusils sur nous. Arrivés place de la Gare, on nous a fait serrer les rangs pour passer sur les débris des bâtiments écroulés. En face de la pharmacie Croussc, mon fils, âgé dt- quinze ans, a reçu à la figure, un coup de cravache — dont ii a porté la marque six mois — et il me dit ; « Papa, j’ai attrapé un coup de cravache ». Je lui ai dit de prendre ] atieiice.
Sur la place, on nous a fait mettre en rangs de quatre et on nous a fait crier; « Vive l’Empereur, Vive l’Allemagne! ». Ces cris nous ont été commandés par un officier. Alors, on nous a fait retourner vers la Sambre, puis on nous a fait faire derpi-tour pour être face à l’église. On nous a partagés en deux groupes pour former deux pelotons de fusillés; la section a eu lieu à peu près en face du tamis du jeu de balle. Le commandant a sifflé alors et la fusillade a commencé.
J’ai vu tomber les hommes et je pensais que c’était une parade… On nous a fait avancer près des premiers cadavres. Là, j’ai fait coucher mon fils et je me suis blotti près de lui. Cela a duré l’espace d’une minute. Le coup de sifflet retentit encore : les coups de fusil recommencent et les hommes tombent à nouveau.
Nous entendons les soldats crier : « Debout ! » On nous relevait à coups de baïonnette et de crosse de fusil : on entendait les cris de douleur des blessés et des hommes qu’on remettait sur pied.
J’ai demandé à mon fils s’il n’était pas blessé : il m’a répondu que non et me posa la même question. (Voir page 58.)
Le dimanche matin, je sortis du canal et me promenai dans la cour de la Glacerie. De temps en temps, on venait nous dire qu’il fallait se sauver parce qu’on recherchait les rescapés de la fusillade. Le soir, on me fit coucher sur la chaufferie de la Glacerie où je fis sécher mes habits, et, vers trois heures du (p.152) matin, on est venu me dire que mon fils était sauvé ; c’était pour me réconforter, car j’avais pleuré toute la nuit.
Le lundi matin, je me rendis au charbonnage Saint-Roch et on me demanda de travailler. J’ai fait sept jours sur quatre, travaillant donc nuit et jour, et, le jeudi, je suis retourné chez moi, où j’ai retrouvé ma femme qui rentrait de sa captivité à Velaine. Le lendemain, je suis allé revoir mes enfants à Ve-laine et ne les ai plus quittés. Mon fils était rentré à Velaine, après avoir échappé à la fusillade en se jetant à l’eau avec moi.
VII. Déposition de M. Lucien Lardinois
Vers quatre heures de l’après-midi du samedi 22 août, les Allemands sont venus frapper chez nous ; on est allé voir par le soupirail de la cave et nous avons constaté qu’il y avait déjà sur l’autre accotement de la rue un rassemblement d’une centaine de personnes sous escorte. Nous avons essayé de nous échapper par une issue de la cave donnant sur le jardin ; un soldat a tiré sur nous et un officier à cheval nous a coupé la retraite par le passage voisin. A cette vue, nous avons dû nous rendre et nous ranger avec les autres. Nous fûmes les derniers qui furent pris de cette bande. Mon frère Louis parlementa en allemand au sujet de maman et de grand’mère qui reçurent la permission de retourner dans la cave.
Nous partîmes à l’église où se trouvaient déjà des civils qui avaient été pris depuis le matin et qui avaient été placés devant les canons à Grogneaux. Alors ce fut un afflux continuel de civils dans l’église. A certain moment, l’édifice était comble. Les enfants pleurant, car ils avaient faim et soif, les Allemands apportèrent, des magasins qu’ils pillaient aux environs de l’église, des caisses de raisin sec, des bonbons, des biscuits, qu’ils distribuèrent à tout le monde. Comme la multitude ne faisait que croître, les femmes et les enfants durent se rendre à l’école (p.153) des Sœurs. Sur l’autel se trouvait la sacoche contenant le Saint Sacrement, que M. le Curé avait déposée là après l’avoir portée avec lui pendant toute la matinée ; plusieurs se confessèrent. A ceux qui avaient demandé à un soldat allemand ce qu’on allait faire de nous, celui-ci répondit qu’on allait bombarder Tamines, excepté l’église; alors Louis demanda, vu le danger, la permission de retourner à la maison pour ramener à l’église ma mère et marraine. Louis partit avec un soldat et ‘revint à l’église avec elles. Mon oncle Baudry, qui était avec nous et dont le bétail avait besoin d’être soigné, demanda s’il ne pourrait pas aller lui donner du fourrage. Louis l’accompagna, escorté encore de deux soldats.
Pendant tout le temps que nous étions à l’église, nous sommes restés assis, nous avons mangé des provisions que maman avait apportées. On parlait tout haut, on causait librement; on ne savait et ne soupçonnait rien de ce qui allait arriver, on était effrayé de la situation, d’autant plus que près de l’église, deux maisons étaient en train de brûler.
Immédiatement avant de partir, arriva un officier qui entra furieux dans l’église, gesticulant comme un fou ; il s’adressa à M. le Curé en allemand et cria très fort : je ne sais pas ce qu’il lui dit. M. le Curé avait l’air terrifié. Il appela dans l’église, par son prénom, quelqu’un qui savait l’allemand. Celui-ci ne devait pas y être, car personne ne répondit.
Peu après, l’ordre fut donné que tous les hommes sortent de l’église. Le bruit courait que les soldats, auxquels on demandait pourquoi on faisait sortir les civils, répondaient que c’était simplement pour faire des tranchées, qu’eux étaient fatigués et qu’ils devaient se reposer : les civils feraient les tranchées à leur place.
On nous fit mettre en rangs, au fur et à mesure que nous sortions de l’église : nous fûmes rangés par quatre et le cortège se dirigea par la rue de Velaine vers le centre du village. Au moment où nous sortions de l’église, le château Liesens commençait à brûler ; l’incendie ne battait pas encore son plein.
Presqu’en face de chez Moreau, un officier nous vit tous deux,
(p.154) Jules et moi (mon frère Jules avait treize ans et moi j’en avais quinze) et nous dit: « Les enfants hors des rangs! ». Nous sortîmes des rangs, et nous allions retourner à l’église rejoindre maman, lorsqu’un peu plus loin un soldat nous fit reprendre place dans le cortège : c’est ainsi que nous nous trouvâmes séparés de père et de Louis.
Aux environs de chez Moreau encore, traînait la queue d’un convoi d’artillerie avec des sentinelles. C’est à partir de là que notre colonne fut tout à fait formée, ayant, à gauche, un cordon de troupes dont les hommes s’espaçaient de cinq en cinq mètres, et à droite, des véhicules de plus en plus nombreux. Près de l’Hôtel de Ville, nous nous rendîmes compte que c’était vraiment de l’artillerie.
Dès que le cortège fut arrivé près du convoi d’artillerie, les soldats injurièrent les civils et les frappèrent à coups de fouet et de crosse de fusil. Plus on avançait, plus on nous obligeait à marcher vite : « Los, los ! » disaient les soldats.
Avant d’arriver dans la rue de la Station, un vieillard étant incapable de tenir le pas du cortège, les soldats le firent soutenir par deux hommes jusqu’à la place.
Dans la rue de la Station, les débris des maisons incendiées s’amoncelaient des deux côtés. Dès l’entrée de la rue, le cortège des civils dut monter sur les décombres fumants, tandis que l’artillerie occupait la partie libre du chemin. Dans le bas de la rue, les maisons étaient encore en feu; il nous fallait donc traverser la rue pleine de fumée, et nous dûmes courir encore plus vite, car on sentait la chaleur des incendies.
On arriva sur la place où l’on se dirigea immédiatement vers la Sambre ; on nous fit mettre tout le long de la rivière. On nous parla en allemand, mais je n’ai rien compris ; quand nous arrivâmes, nous qui formions la queue du cortège, on criait : « Vive l’Allemagne ! ».
Devant nous, étaient échelonnées trois lignes de tirailleurs à une distance de quinze à vingt mètres. Alors, je me suis rendu compte qu’on allait nous tuer: j’ai demandé l’absolution à M. le Curé. M. l’abbé Docq, de son côté, prononça ces paroles :
(p.155) « Mes amis, je crois que ça va chauffer, je vais vous donner l’absolution générale ». M. le Curé donna lui aussi l’absolution que plusieurs avaient demandée.
Comme je me doutais de ce qui allait se passer, je me suis plus ou moins tenu baissé, et au coup de sifflet, je me suis laissé tomber avant les autres qui, eux, sont tombés sur moi. Je me trouvais au milieu du groupe. Plusieurs décharges — au moins deux — ont été tirées, et chacune a au moins duré une demi-minute.
Il s’est écoulé un temps que je ne saurais pas apprécier, mais qui ne doit pas avoir été très long, après lequel des soldats doivent être venus achever les blessés, car j’ai entendu comme des coups de massue, et la plainte des blessés. (Voir page 60.)
Lorsque fut parti celui qui était blessé à l’épaule et qui était .ù côté de Georges Mouyard, j’avais place pour glisser la tête, que j’ai soulevée, et j’ai vu quelques lumières près de l’église : ceci se passait après l’achèvement.
Sur le matin, j’ai entendu des cris très perçants, et on m’a dit plus tard que c’était M. Descamps qui, pris de folie, s’était jeté à l’eau.
Peu à peu, au bruit de certaines voix, je levai la tête et je constatai alors l’étendue du massacre et l’horreur du spectacle. Il y avait à ma gauche, près du poteau télégraphique, le tas le plus épais de cadavres, tas dans lequel je reconnus l’abbé Docq, dont le buste avait été manifestement retiré d’en dessous, sur k- sommet du monceau : vraisemblablement, il avait été achevé dans cette posture. Il portait dans la gorge, sur le côté droit, une très large blessure : elle n’était pas pleine de sang. J’ai examiné ceci de près, après m’être levé.
Alors, je vis M. Labarre qui avait été puiser, dans une bouteille, de l’eau de la Sambre, et à sa demande, j’allai à mon tour chercher de l’eau pour les blessés. Ce n’est que plus tard que les Allemands vinrent apporter de l’eau potable dans un gobelet en étain ; puis, on apporta un pain et demi dans une corbeille, dans laquelle se trouvaient des miettes de biscuits, (p.156) C’est à peu près à ce moment-ci qu’eut lieu le premier entretien de M. Franz Van Heuckeloom avec le médecin major. M. Van Heuckeloom demanda ce qu’on avait l’intention de faire de nous. Le médecin répondit qu’il n’en savait rien, mais qu’on le saurait dans deux heures, car on venait d’envoyer un soldat à l’état-major dans le but de savoir quel serait notre sort.
Avant cela, un officier était venu devant le tas de cadavres et avait dit: « Vous avez tiré sur les soldats allemands ». Tout le monde nia, et il affirma une fois encore que nous avions tiré sur les soldats allemands ; nous niâmes de nouveau et jurâmes que nous n’avions pas tiré: « Vous ne savez pas jurer », dit-il en terminant et il recommanda de rester là.
Depuis un moment, on arrêtait les quelques civils venant de la route de Falisolle, d’Oignies et d’Auvelais, et on les parquait devant l’église Saint-Martin.
Il y avait deux sentinelles sur le talus près du pont. Je venais de donner à boire à M. Delsauvenière, qui se trouvait près du pont — il est mort de ses blessures — lorsque la sentinelle m’appela et me demanda mon âge et si j’étais blessé; il savait quelque peu de français, et moi un peu d’allemand. Je lui dis que mon frère de treize ans était là et qu’il était blessé ; il demanda aussi si d’autres adolescents n’étaient pas blessés, ajoutant que les jeunes gens de quinze à dix-neuf ans étaient soignés immédiatement par les Allemands. Il dit encore : « Si quelqu’un d’entre vous tente de s’enfuir, je le fusillerai ». Il me renvoya et me promit de revenir. En effet, vingt minutes après, il revint et me fit signe d’aller vers lui. Je dis à mon frère de venir aussi et à deux autres jeunes gens qui n’étaient pas blessés : Marcellin Dullier (quatorze ans) et Ernest Thomas (seize ans). Nous allâmes rejoindre le groupe des femmes en face de l’église. Celles-ci étaient venues de chez les Frères, et leur foule s’était augmentée de celles de Falisolle et d’ailleurs. Mon frère blessé se rendit à l’ambulance de l’église.
Je venais d’arriver chez les femmes, lorsque l’une d’entre elles s’évanouit : immédiatement, les Allemands lui apportèrent une chopine de vin, un œuf et du pain. Alors, ils donnèrent à (p.157) manger aux autres femmes et aux enfants : j’en ai eu à mon tour. Plus les hommes qui se trouvaient devant la maison Broze étaient nombreux, et plus les femmes étaient agitées, pensant qu’on allait fusiller leurs maris. Ceux-ci renvoyèrent à leurs femmes les petits bagages qu’ils avaient emportés avec eux et leur porte-monnaie. Plusieurs femmes demandèrent la permission d’aller dire au revoir à leurs maris : on l’accorda à certaines et on la refusa à d’autres. Comme beaucoup d’entre elles faisaient cette demande, on la leur refusa définitivement.
C’étaient des pleurs, des lamentations, des adieux désespérés ; beaucoup montaient sur des chaises prises dans une maison voisine qui n’était pas complètement incendiée, pour voir leur père ou leur mari ; on se faisait adieu de la main, bien qu’un officier ait toujours répété depuis midi qu’on ne les fusillerait plus. A moi-même également il l’assura. Les hommes devant la maison Broze ne le savaient pas. Le même officier disait qu’on allait partir à cinq kilomètres de Tamines, ce que sachant, des femmes demandèrent la permission d’aller chercher chez elles quelques objets indispensables : elles partirent accompagnées d’un soldat.
Pendant tout ce temps, on procédait à l’enterrement des morts.
Vers cinq heures, on commença à amener à l’ambulance de l’église les blessés de la fusillade ; quelques-uns allèrent dans la maison à droite de l’église.
Après cela, on organisa le cortège afin de se rendre à Velaine. Hommes, femmes et enfants, mêlés, tout le monde partit sous escorte. En face de l’église des Alloux, les femmes qui s’y trouvaient, furent jointes au défilé.
Celui-ci s’avança jusqu’au bois de Velaine ; au milieu du bois, quelques coups de feu éclatèrent; on s’affola; on leva les bras, pensant qu’on allait être fusillé. Puis le cortège poursuivit sa route jusqu’à la place de Velaine. Le chef des Allemands déclara aux premiers rangs du groupe que nous étions libres et la nouvelle se répandit parmi la foule. Nous ne pouvions pas retourner à Tamines avant les huit jours.
(p.158)
VIII. Extraits de la déposition de M. Henri Joret
… Arrivé dans la rue de la Station, je dus demander l’aide de M. Félicien Namèche, afin de pouvoir escalader les débris des maisons écroulées. Un soldat ayant voulu, un peu plus bas, me donner un coup de fouet, je l’évitai. M’étant écarté du groupe, pour me garantir du coup, je perdis tout contact avec ce groupe et arrivé en face de chez M. Hennion je me trouvai dans une drôle de situation.
Ayant perdu de vue ce groupe d’hommes je ne savais si je devais me diriger vers le pont de Sambre ou vers l’église pour le retrouver. Ayant aperçu, à la lueur de l’incendie qui achevait de consumer la maison de M. Achille Chaltin, une ouverture entre les troupes placées en bas du talus de la route de Falisolle et celles placées du côté de l’église, je m’y engageai et y trouvai mes compagnons d’infortune.
Je me plaçai dans le groupe situé du côté du Pont, par conséquent le deuxième. Mon arrivée tardive m’empêche de rapporter les préliminaires de la fusillade. Ce que je puis dire, c’est que au moment où je venais d’arriver, les soldats commencèrent à faire crier; «Vive l’Empereur!» «Vive l’Allemagne!» et employant les moyens forts, faisaient répéter ces cris.
C’est alors que, dans un moment de révolte et de défi, je criai : c Vive la France ! », voulant par là prouver aux soldats français, s’il en restait des cachés de l’autre côté de là Sambre, qu’on protestait contre ce qu’on nous forçait de crier.
Un de mes amis, placé à mes côtés, m’ayant fait remarquer que c’était « Vive l’Allemagne ! » qu’il fallait crier et que j’allais me faire fusiller, je lui répondis : « Crie, si tu veux, mais avant cinq minutes tu vas être fusillé aussi ! ».
C’est alors que, toute clameur ayant cessé, se firent les préparatifs d’exécution du premier peloton. On entendit alors des malheureux demandant grâce, mais tout à coup une décharge de (p.159) mousqueterie éclata et ces pauvres martyrs tombèrent. Le cri de : « Relevez-vous ! » retentit quelques minutes après. Le temps ne leur fut pas donné de le faire ; à peine l’ordre était-il prononcé et avaient-ils essayé de l’exécuter que la mitrailleuse fauchait ceux qui avaient échappé aux effets de la fusillade. J’ai très bien distingué le bruit saccadé de cette mitrailleuse placée derrière moi, sur la route de Falisolle.
En présence d’une telle situation, on cria dans le deuxième groupe: «Couchons-nous! ». Ce que nous fîmes. Les soldats vinrent alors nous faire relever et avancer dans la direction des troupes placées à l’autre extrémité de la Place, du côté de l’église. Ce que voyant, on cria : « A la Sambre ! A la Sam-bre ! ». Voyant la situation désespérée, je me dirigeai de ce côté, bien décidé à me jeter à l’eau et à me laisser couler à fond ; mais arrivé à environ deux mètres du bord de la Sambre, la réflexion me vint : je pensai à ma petite famille et à mes parents et je m’arrêtai. C’est alors que me croisant les bras, je me dis: « A la garde de Dieu et de N.-D. de Lourdes ». Je ressentis en ce moment un choc à la tête, du côté gauche : une balle m’avait atteint. « Je n’ai rien », me dis-je et me jetant derrière un monticule à peu près de la longueur d’un homme, je fis le mort.
J’étais à peine par terre que je sentis qu’un soldat posait le pied sur moi et tirait sur les civils qui essayaient de se sauver à la nage. Je distinguai même les cris de ces malheureux qui, blessés par les coups de feu qu’on tirait d’un peu partout sur eux, demandaient du secours et se noyaient.
Combien de temps ce soldat resta-t-il dans cette position?…
Dimanche 23 août, neuf heures vingt du matin. (Plus de douze heures après la fusillade!)
Je me retrouve debout entre la ferme de M. Gilson et la dépendance en face, à environ 150 mètres du lieu du massacre.
Comment suis-je là?
Je sais que quelque chose d’anormal s’est passé, que je dois me méfier des casques à pointe ; mais mes idées sont confuses.
(p.160) La ferme et ses dépendances sont en partie incendiées. Que signifie cela? Mais les exigences de mon estomac me rappellent à la réalité: J’ai soif, j’ai faim. Je cherche immédiatement dp quoi me désaltérer.
Ne trouvant rien à la porte, j’entre dans la ferme. Le feu a détruit tous les meubles du rez-de-chaussée. Je trouve dans un bassin de l’eau qui a servi à nettoyer la vaisselle; j’en bois, mais l’estomac ne peut supporter ce liquide. Je trouve enfin une cafetière contenant environ deux tasses de café, lequel fut bien vite absorbé. N’ayant plus trouvé dans la maison de quoi étan-cher ma soif et assouvir ma faim, je me dirigeai vers le jardin, où je cueillis des groseilles et des poires.
Voulant atteindre les poires, je m’aperçois qu’un soldat monte la garde dans le sentier qui va dans les prés. Je me jette par terre et je m’avance en rampant, afin de ramasser quelques fruits Lombes.
La nuit suivante, les Allemands vinrent voler des poules à la ferme, car j’entendis celles-ci crier…
IX.
Extraits de la déposition de M. Louis Lorette
… Nous arrivâmes enfin sur la place Saint-Martin. Là, on nous plaça par rangs de six, à dix pas de la Sambre et parallèlement à la rive, sur toute la largeur de la Place. Un cordon de troupes fut disposé en face de nous, à environ trente pas. Comment retracer l’angoisse qui étreignait nos cœurs? Devoir mourir sans aucune arme pour se défendre ! Oh ! comment oublier jamais ces horribles tortures?
L’officier commandant prend alors la parole ; il nous reproche d’avoir tiré sur ses soldats et nous accuse d’être des francs-tireurs. Il nous engage alors à crier: « Vive l’Empereur! », ce que l’on fait, pensant apitoyer ce tigre.
Tout à coup, on entendit un coup de sifflet, suivi d’une décharge (p.161) formidable. Quel instant!… On n’entendait plus que des cris de douleur et des gémissements !
Je venais d’échapper à la première fusillade : une balle m’avait seulement éraflé la tempe et je remerciais Dieu de m’avoir épargné ! Il n’en était pas de même de mon pauvre père : à la première décharge, ,il avait reçu une balle à l’épaule ! Faisant demi-tour, il me dit: « Je suis touché, Louis ». Je le tire par le buste ; en même temps une deuxième balle lui traverse les reins. Il tombe en poussant un grand cri : je me laisse tomber sur lui.
Une minute s’était à peine écoulée, que j’entends le cliquetis des fusils que l’on recharge. Au même instant, on crie : « Debout ! ». Je regardai mon père : il ne donnait plus signe de vie. Je me dégageai et, rampant, j’arrivai au bord de la Sambre. Je me relevai et me jetai tout habillé dans la rivière. J’allais atteindre la rive droite, lorsque j’entendis des balles siffler à mes oreilles. Je plongeai, pour remonter à la surface un peu plus loin : je vis à ce moment plusieurs têtes qui émergeaient. Je revins alors en amont en poussant sur la droite et j’abordai près d’un pré de M. Gilson. En arrivant au milieu de la Sambre, ma vigueur m’avait abandonné et je coulai à pic. A cet instant suprême, je rassemblai mes forces et je revins à la surface. J’avais déjà bu beaucoup d’eau et mes oreilles bourdonnaient. J’avais cependant conscience de ma situation et je me résignai en disant :
« Sainte Vierge Marie, je suis prêt quand vous voudrez ; mais, si vous m’accordez la grâce de sortir vivant, je vous promets telle chose ».
Je me sentis armé d’une nouvelle force et je parvins à gagner le bord de la Sambre. Je me dissimulai dans les roseaux, en dessous d’un buisson. Près de moi, à ma gauche, j’entends remuer quelque chose. Effrayé, j’étends le bras et je sens une jambe. Je demande tout bas: « Qui est là? ». On ne me répond pas. Je pose une seconde fois la question. On me fait signe de ne rien dire. J’entendis alors des pas étouffés au-dessus (p.162) de moi, sur la berge, et je compris le mutisme de mon voisin. Quand on n’entendit plus rien, il se fit connaître : c’était M. An-drianne, peintre, de la rue du Collège. Nous restâmes deux heures et demie à trois heures dans l’eau : notre tête seule dépassait.
Je remontai un des derniers. Nous longeâmes la Sambre, à l’exception de René Michaux, qui, malgré nos instances, ne voulut pas quitter la rive. Pendant que nous traversions la prairie, nous entendîmes le galop d’un cheval : c’était probablement un soldat qui cherchait les fugitifs. Le brouillard, assez dense, nous déroba à sa vue. Lorsqu’il nous eut dépassé et que nous n’entendîmes plus rien, nous gagnâmes la « Blanchisserie », et nous nous couchâmes dans un champ de betteraves, le long de la haie, jusque deux heures du matin. Nous étions là à, peine d’une demi-heure que nous entendîmes marcher dans notre direction. Nous regardâmes et vîmes un homme s’approcher de nous ; il se pencha au-dessus de la haie sans nous apercevoir, et il continua son chemin. Nous n’avons jamais su qui il était, ni où il allait.
Vers deux heures du matin, les troupes vinrent installer des pièces d’artillerie sur le remblai qui aboutit au pont du Ternia. Ce remblai fait face à l’endroit où nous nous trouvions cachés. M. Mouton fit observer que notre situation devenait critique, que les Allemands allaient diriger leur feu sur Arsimont et que, si les Français ripostaient, nous serions exposés au danger. Nous nous enfuîmes donc par la rue du Trou de l’Enfer. Toutes les portes étant fermées, nous nous engageâmes dans les jardins : au petit bonheur, j’escaladai un grenier situé au-dessus d’une remise, derrière l’habitation de Jules Michaux. J’étais assez bien caché, mais je n’étais pas tranquille. J’avais le pressentiment que quelque danger me menaçait encore. N’y tenant plus, je descends de ma cachette et j’escalade le mur de clôture du château de M. Lambiotte. Je frémis encore en songeant dans quelle souricière j’étais tombé : le château était occupé par un état-major allemand. Me dissimulant de mon mieux, je longeai le mur et, m’aidant d’un appareil de télégraphie sans fil qui (p.163) se trouvait là, j’escaladai de nouveau le mur et retombai dans la propriété de M. Defosse, occupée par M. Sohier, percepteur des Télégraphes.
Au moment où j’escaladais le mur, j’aperçus des soldats allemands qui arrivaient au petit grenier que j’avais quitté quelques instants auparavant.
Je n’oublierai jamais la bonté et la sollicitude de M. et de Mme Sohier. Ils me procurèrent du linge et me firent changer d’habits. Ils mirent même à ma disposition des vêtements de leur fils et enfant unique Fernand, jeune lieutenant tombé le 6 août déjà, devant l’ennemi, à Liège. Je leur racontais ce qui venait de se passer, quand nous entendîmes heurter violemment à la porte : c’étaient des soldats allemands qui nous ordonnèrent de les suivre. Ainsi, au moment où je me croyais sauvé, j’étais de nouveau prisonnier. J’avais échappé à la mort, à force de courage et de volonté ; en serait-il encore de même aujourd’hui?…
Mme Sohier, ne voulant pas laisser partir son mari seul, nous accompagna, M. Sohier, qui parle très bien l’allemand, demanda aux soldats ce qu’on allait faire de nous. On lui répond qu’on va nous conduire sur la Place. Nous partons — nous étions environ un douzaine — : cinq minutes plus tard nous arrivions sur la Place.
Près de la ferme Couvreur, se trouvaient une centaine de femmes et d’enfants. Quelques-unes d’entr’elles, apprenant que j’étais un rescapé de la veille, me demandaient comment j’avais fait pour m’enfuir. Je fis un effort surhumain pour ne pas me trahir et, feignant de ne pas entendre, je continuai mon chemin sans répondre ; et tout à coup, devant mes yeux, s’étalait un tableau que je n’oublierai jamais. Des centaines de cadavres jonchaient le sol. Derrière le tas de martyrs, une centaine de blessés et d’indemnes, miraculeusement sauvés, attendaient, pâles et tremblants, la décision qu’on allait prendre à leur sujet. A peu de distance de cet amas de cadavres, deux à trois cents civils étaient dans l’incertitude du sort qui leur était réservé.
(p.164) Je ne me faisais plus d’illusion, et comme la veille, avant le premier massacre, je recommandai mon âme à Dieu.
Le commandant se trouvait sur la Place. Il avait encore l’air plus cruel que la veille. Sa face de « Lucifer » ne reflétait plus rien d’humain. Le diable ne doit pas être plus effrayant dans l’enfer. Ses ordres, ses cris de fureur nous affolaient ; et, arpentant la Place, il nous menaçait à tout moment. Tout à coup apparaît une automobile venant de la direction de Falisolle; un des occupants agite un drapeau blanc. Un officier descend et s’entretient avec la bête fauve qui nous terrorisait. On communiqua quelques renseignements aux soldats qui se mirent à pousser des « hourras ».
Alors, notre bourreau donne des instructions à un Frère de Tamines qui faisait partie de la Croix-Rouge. Celui-ci nous dit qu’il faut enterrer les morts et porter les blessés à l’ambulance. Il demande pour cette besogne des hommes courageux. Je m’approche et demande à prendre part à cette lugubre besogne.
Quel spectacle ! Les pauvres martyrs étaient méconnaissables ; la plupart avaient la figure toute bleuie, congestionnée ; un seul avait le teint d’un cadavre ordinaire ; c’était notre cher et honoré voisin, M. l’abbé Docq, professeur au Collège de Virton. Contrairement aux autres qui étaient tombés la face contre terre, lui, était tombé à la renverse sur le cadavre de son père.
A quelques mètres de la Sambre, j’aperçois, couché sur le côté, mon père encore en vie; je ne fais qu’un bond pour arriver jusqu’à lui : il me reconnaît. « Louis, Louis, mon fils, dit-il, comme je suis heureux de te revoir ! Si tu savais comme je souffre ! ».
On ne me permit pas de rester plus longtemps auprès de lui : un soldat me cria : Los / et je dus abandonner mon pauvre père sans secours… Nous commençâmes alors le transport des cadavres. Pour effectuer ce travail nous nous servions de planches en guise de civières. Une immense fosse était creusée dans le jardin Van Herck, entre la Sambre et la maison du vétérinaire (p.165) Broze. On ne nous donnait pas le temps de reprendre haleine. On nous traquait, on nous injuriait pour accélérer la besogne. Entretemps, j’allais près de mon père ; c’est à peine si j’avais le temps de lui parler. J’aperçus, à un moment donné, notre vicaire, M. l’abbé Donnet; tout en enlevant les cadavres, je lui demandai d’aller confesser mon père. Il me promit de faire son possible, car, lui aussi, le malheureux, était grièvement blessé ; il pouvait à peine marcher et, à chaque pas qu’il faisait, une contraction douloureuse crispait son visage. Quelque temps après, comme je l’interrogeais du regard, il me dit : « C’est fait, soyez tranquille, Louis ».
La lugubre besogne continuait toujours. Bientôt, je reconnus notre pauvre curé, M. l’abbé Hottlet. Ah ! comme il était arrangé ! Lui, le brave des braves, qui aurait pu se mettre à l’abri des tortionnaires, il avait préféré sacrifier sa vie que d’abandonner ses paroissiens. J’aperçus à terre ses lunettes ; je me précipitai pour les ramasser, afin de remettre cette relique à sa famille ; mais un enragé los ne me permit pas d’accomplir ce pieux devoir. A peine mon émotion s’était-elle un peu dissipée, qu’une autre survint. Je vis tout à coup un beau jeune homme, presque un enfant : c’était Ferdinand, le fils de Joseph Sevrin, notre voisin. Ah ! comme je me sentis remué jusqu’au fond de mon être, en voyant cette fleur de jeunesse, ce modèle accompli de la paroisse. Hélas ! son malheureux frère était là, lui aussi, assassiné.
Enfin, le dernier cadavre est transporté : c’est au tour des blessés. Cette tâche n’est pas la moins pénible. Mon père fut recueilli l’un des premiers. Pendant le trajet, j’étais brisé de douleur en entendant ses plaintes : il était blessé dans les reins et souffrait horriblement… Il est mort le mardi à une heure de l’après-midi. Je pense que s’il avait été soigné, il aurait pu survivre à ses blessures…
(p.166)
- Déposition de M. le Chanoine Crousse
Je suis arrivé à la Croix-Rouge, le samedi 22 août vers quatre heures du matin; jusque dix heures, des gens viennent s’y réfugier : une centaine de personnes nous avaient précédés. En prévision d’événements possibles, beaucoup de gens se confessent.
En entrant chez les Frères, je me mêle à la foule qui va et vient dans le corridor. J’ai consommé les Saintes Espèces qui se trouvaient dans la chapelle de l’Institut et me suis communié en viatique.
Vers trois heures de l’après-midi, il y eut une accalmie ; mais avant ce temps, c’étaient des combats continuels, le feu d’artillerie ne cessa pas.
On se blottit dans les caves, au nombre de cent quatre-vingts à deux cents. Tandis qu’on apercevait les lueurs vacillantes des incendies, on était dans la plus grande obscurité. Le soir, sans soupçonner ce que c’était, on entendit les coups de fusils qui fauchaient les hommes de Tamines.
Vers huit heures du soir, on entend les bottes des soldats qui viennent occuper l’établissement des Frères pour en faire une ambulance. M. Emile Duculot et le Frère Barnabe calment la population agitée et inquiète. Jusque vers douze heures, les Allemands transforment l’Institut en ambulance militaire.
A une heure et demie du matin, tous les hommes doivent sortir du réfectoire de la communauté où ils sont emprisonnés, et ils passent un à un dans le couloir, pour être visités par les soldats. Un homme ayant une douille française sur lui, on menaça de le fusiller : mon frère, le pharmacien Crousse, intervint en sa faveur, il fut épargné.
Nous sommes alors rentrés au réfectoire des Frères et nous y étions serrés « comme des harengs » : deux soldats en armes montaient la garde devant la porte. Le commandant vient (p.167) examiner notre groupe, et, me voyant debout, par respect sans doute pour mon âge, il me fait apporter une chaise. Ensuite sont arrivés un médecin et un pharmacien qui se sont montrés bienveillants.
On a visité les femmes à leur tour et la visite a duré jusque sept heures du matin. Nous étions dans l’attente, ne sachant pas ce que nous allions devenir.
Le dimanche, M. le curé de Tamines eut la permission de dire la messe dans la chapelle des Frères.
Vers neuf heures et demie du matin, on nous mit en rangs, trois ou quatre de front, dans la cour de l’Institut, et alors, en avant ! entre deux lignes de soldats.
A la sortie de l’établissement, on nous fit tourner à gauche, et, en face de la brasserie Cochet, on nous fit obliquer vers la place par la rue Saint-Martin. En passant, nous vîmes le spectacle des maisons incendiées, des chevaux tués. Sur la place Saint-Martin, au delà de l’église, on nous range le dos tourné vers Auvelais et face au pont. On aperçoit de tous côtés des soldats en armes, des faisceaux de fusils ; au milieu de la place, quantité de soldats qui se promènent et, devant eux, le long de la Sam-bre, un parc de morts. (Voir page 86.1)
Nous avons conscience qu’on va nous tuer comme nos concitoyens. Nous pouvons nous faire à l’idée d’être tués par les soldats français qui reviendraient et en face desquels nous serions, boucliers vivants, placés par les Allemands, mais non à l’idée d’être massacrés, victimes inutiles, comme nos compatriotes.
Les soldats qui nous regardent et nous surveillent, nous refoulent toujours en nous disant : « Vous prisonniers ; vous avez tiré sur nous ». Ils voulaient évidemment nous terrifier. Ils reprenaient sans cesse ; « Vous irez en Allemagne ; vous ferez des tranchées ; vous enterrerez nos morts ; vous avez tiré sur nos troupes ». Ils étaient acharnés contre les prêtres, qu’ils menaçaient plus que les autres : leurs yeux étaient furibonds.
Sur ces entrefaites, les femmes sont amenées à leur tour et (p.168) groupées devant le portail de l’église, face a la Sambre. Quant à nous, nous étions en face des maisons incendiées. Il y eut entre les hommes et les femmes des échanges perpétuels de marques de tendresse et des scènes d’adieu ; on faisait le signe de mourir courageusement.
Tandis que nous étions là, on nous dit que nous devions creuser la fosse pour les morts. Je fais mine de m’avancer, mais on m’arrête et on me dit:« Non; vous, bénir la fosse ».
Pendant toute la matinée, les civils sont amenés par les Allemands des rues avoisinantes : les femmes et les enfants vont rejoindre les femmes en face de l’église, les hommes sont poussés près de nous.
On creuse la fosse. Pendant qu’on est en train de la creuser, des officiers arrivent sur la place en automobile et à cheval. Les officiers discutent entre eux, puis, prennent une réfection au milieu de la place. Un officier à cheval avait surtout l’air terrible et furieux. Il est alors parti. Les officiers se dispersent.
Après le départ des officiers, les soldats se sont mis en devoir à leur tour de s’attabler au milieu de la place : on leur apportait des demi-bouteilles de Champagne et des tas de cigares. Ils vident chacun leur demi-bouteille, et, une fois vide, ils la lancent en l’air, ils la font rouler à nos pieds. Nous nous disions entre nous: « On les anime au carnage, nous allons y passer ».
Nous sommes toujours dans l’anxiété. Les hommes font leurs adieux aux femmes et leur envoient de petits billets où ils écrivent: « Nous mourrons pour Dieu et pour la Patrie ». Les lommes se confessent sans discontinuer aux quatre prêtres présents. Les soldats allemands étaient très intrigués de cette scène nystérieuse : quelques soldats catholiques leur en firent com-rrendre la signification.
Je dis à M. le Curé de Tamines : « Donnez l’absolution générale à tout le monde : nous n’aurons peut-être pas le temps de les confesser tous ». M. le Curé leur dit; « Mes enfants, mourons courageusement. Vous êtes ici à côté de la maison de Dieu : vous ne recevrez pas l’Eucharistie, mais vous mourrez à côté du Saint-Sacrement ». Je pris alors la parole : « M. le Curé, (p.169) inspirons-leur l’acte de résignation à la mort de Pie X ; Mon Dieu, j’accepte la mort quand, comment et de quelle manière vous voudrez, en expiation de mes péchés et en union avec les souffrances de N. S. J. C. Vous gagnerez une indulgence plé-nière en tombant et votre âme ira tout droit au Ciel. L’acte de contrition que vous devez faire en même temps est celui de votre catéchisme ayant l’amour de Dieu pour motif ». Tous nous reçûmes l’absolution.
Les confessions durèrent tout le temps. Presque tous se confessèrent. Deux ou trois mécréants, seuls, refusèrent de le faire. Ils disaient : « II n’y a pas de Dieu, sinon on ne ferait pas cela! ». Des vieux qui n’avaient plus été à l’église depuis longtemps, étaient touchés de la grâce de Dieu et venaient dire : « Moi aussi, je veux me confesser ».
Nous restâmes sur la Place avec la conviction que nous allions être fusillés.
Vers deux ou trois heures, eut heu le transport des cadavres.
Un jeune homme arriva vers moi et me dit: « C’est malheureux, n’est-ce pas, dire que le premier mort que j’ai rencontré, c’est mon père ». C’était le fils de Constant Dogot. « Acceptez ce sacrifice, lui dis-je, au nom de votre père et comme vous avez l’intention de devenir prêtre, offrez ce sacrifice à Dieu, avant de vous offrir vous-même ».
Un spectacle navrant était de voir le vieux Curé de Tamines obligé de transporter des cadavres sur une brouette.
L’opération terminée, on transporta les blessés qui étaient au milieu des morts, à l’église et dans la ferme voisine ; dans la ferme, les Allemands arrachèrent portes, fenêtres, planches, pour porter les blessés et les cadavres. Ces blessés étaient restés sans soins depuis huit heures du soir le samedi jusque quatre heures de l’après-midi du dimanche.
Après l’enterrement, chacun croyait que la dernière heure des survivants et des autres civils était arrivée. Les prêtres se mirent les uns à côté des autres pour recevoir la balle meurtrière ; ils s’étaient placés au premier rang pour être tués les premiers et ils se disaient entre eux. « Présentons le cœur pour être tués (p.170) du coup, sinon nous aurons encore bien des tortures à supporter. » Nous nous mettons à genoux, le chapelet ou le scapulaire autour du cou.
Mon frère qui avait soigné les blessés, arrive à ce moment. Je lui dis : « Embrassons-nous, il faut mourir ».
Le médecin allemand constatant que j’étais le frère du pharmacien, m’appela au milieu de la Place. Comme nous étions tous dans l’attente de la mort et que nous savions les tortures qu’on avait fait subir aux victimes de la veille, je demandai à Dieu la grâce du martyre, comme les martyrs du Japon, et la grâce de subir avec courage tous les traitements que j’aurais à supporter.
En me rendant près du docteur, je ne le laissai pas parler et lui dis : « Nous sommes tous prêts à la mort ; nous mourons pour notre Patrie, et nous sommes innocents. J’ai été témoin de l’arrivée des troupes allemandes : je vous assure sur l’honneur que l’on n’a pas molesté vos troupes; tout le monde s’était retiré dans ses caves et chacun était consterné ; si vous voulez savoir qui je suis, voici ma carte ».
Comme il voyait que j’étais chanoine, il me dit: « Vous êtes chanoine de Sainte-Croix de Gand ». Je lui dis : « Si vous voulez épargner la foule, je m’offre très sincèrement et sans forfanterie à mourir à la place de ces braves gens ».
Il me répondit alors : « Vous ne serez tués ni vous ni les autres ». Je répartis : « Nous subirons le même sort que nos camarades enterrés. Du moins, épargnez les femmes : il y a là de petits enfants qui, eux, sont enfermés depuis un jour et deux nuits ».
- Non, dit-il, vous ne serez pas tués. Vous, ajouta-t-il en cherchant dans son dictionnaire, vous serez leur guide à dix kilomètres d’ici vers Fleurus ».
- Et là, dis-je, que ferai-je de cette foule?
- Vous la remettrez à l’autorité militaire.
- Et moi?
- Vous retournerez à Namur.
(p.171) — Permettez-moi d’implorer la grâce de ces femmes et de vous prier de les laisser partir à une certaine distance du village.
- Je vais le demander au commandant », et il part.
- Laissez-moi vous dire que nous mourons de faim et de soif », ai-je encore eu le temps de lui insinuer.
Sur un ordre donné, un soldat apporta quelques pains et l’on fit venir un peu d’eau.
Le médecin partit près du commandant et se concerta avec lui, mais il ne revint plus et il me fit de loin un signe d’adieu. A ce moment, je suis rentré dans le groupe et on me demanda ce que le docteur m’avait dit. J’ai répondu : « Soyez calmes et confiants ». Je ne voulais pas trahir ce qu’il m’avait dit, de peur d’exciter une explosion de joie qui aurait pu être compromettante.
Sur ce, retentit un coup de sifflet et les soldats se rangent en deux lignes. A l’instant, dans la foule, on clame : « Nous y sommes, c’est notre tour d’être fusillés ». Mais non, on nous fait signe de nous avancer entre les deux haies de soldats, et on permet aux femmes de venir rejoindre les hommes : ce fut une scène de joie mêlée de larmes, d’anxiété et d’angoisse, car on ne savait pas ce qui allait se passer.
En avant ! à travers les rues de Tamines ; chacun examine les ruines des maisons ; au milieu de la rue de la Station, le groupe rencontre des chariots de pontonniers. Nous traversons les décombres pour laisser la place aux pontonniers. Ceux-ci nous lancent des quolibets et des sarcasmes.
Nous avançons jusqu’au delà de la gare, nous dirigeant vers les Alloux. Là, nouveau signal d’un coup de sifflet, et les femmes et les enfants qui restaient aux Alloux sont poussés dans nos rangs. Nous étions alors deux à trois mille hommes, femmes et enfants. Cette foule affolée, composée des femmes et des enfants de ceux qui avaient été fusillés la veille, demandait, en pleurs, des nouvelles des maris et des pères : on s’ingéniait à leur cacher la terrible nouvelle.
Les prêtres confessèrent tout le long de la route jusqu’au (p.172) bois de Velaine ; plusieurs tombaient en syncope, tous étaient affolés.
Dans le bois de Velaine, on entendit encore des coups de fusil, et on croyait de nouveau que nous allions être fusillés.
A Velaine, près de l’école Saint-Joseph, le chef de file, en bicyclette, descend de machine, monte sur une éminence et dit : Arrêtez ! Levez les bras et criez : « Vive l’Allemagne ! » Les civils crièrent et remercièrent le commandant. « Vous pouvez aller par un chemin ou par l’autre, mais vous ne pouvez plus rentrer à Tamines avant la fin de la guerre ».
Accueil très sympathique et très généreux de la part de la population de Velaine. Il n’y avait plus dans la commune ni lait, ni bière, ni pain : tout avait été pris par les soldats allemands. Nous sommes restés là jusqu’environ huit jours après.
XI.
Déposition du Révérend Frère Victor Fripiat.
(Directeur de l’Institut Saint-Jean-Baptiste.)
Le vendredi 21 août, le combat se livrait entre les hauteurs d’Auvelais, Falisolle, Arsimont, et les hauteurs de Velaine. Les Français étaient à droite de la Sambre, les Allemands à gauche. Le soir, ceux-ci se sont approchés de Tamines; on commença à entendre les obus siffler au-dessus de la localité et l’ardeur du combat fut progressive jusque vers onze heures du soir. A ce moment, je suis monté au grenier et j’ai vu sur les hauteurs précitées les maisons en flammes ; et je bénissais Dieu de ce qu’il eût épargné notre commune.
Le lendemain samedi, vers trois heures du matin, commença la journée de combat. A ce moment, les clairons du jugement dernier résonnaient dans les rues. Les rues de Falisolle, de la Station, la rue Centrale étaient en feu. Vers neuf heures du matin, les progrès de l’incendie diminuèrent graduellement.
(p.173) Pendant ces heures lugubres, environ cent quatre-vingts personnes de tout âge, hommes, femmes, enfants, s’étaient réfugiés dans la maison. Vers neuf heures arrive le premier soldat allemand blessé. Vers une heure un groupe d’officiers vint visiter la Croix-Rouge. Vers huit heures du soir, il y avait environ cent cinquante soldats blessés, presque tous allemands ; quelques civils blessés s’y trouvaient aussi. Bientôt toutes les places de l’ambulance furent envahies ; c’était le Lazarett n° 4. Les Allemands arrivèrent avec le personnel et le matériel nécessaires pour une ambulance bien organisée. Les Frères des Ecoles Chrétiennes et les Sœurs de Charité, à la demande du chef médecin, prêtèrent leur concours pour soigner les blessés et les malades. L’ambulance fonctionna pendant douze jours. Les Allemands partirent d’ici pour Maubeuge. Ils se sont bien conduits pendant tout ce temps et ont délivré à la maison ainsi qu’aux Sœurs un élogieux certificat.
Leurs soldats, dans le village, se sont livrés au pillage ; ils sont entrés dans les maisons brûlées et ont pillé, saccagé, enlevé tout ce qu’ils ont pu. Il arrivait ici des paniers et des paniers de bouteilles de vin et des provisions qu’ils avaient dérobées à droite et à gauche.
Le mardi, en compagnie de civils que j’ai pu rechercher avec l’autorisation du chef du Lazarett, j’ai visité les maisons incendiées pour trouver les cadavres ensevelis dans les décombres.
D’une maison, nous avons retiré quatre cadavres de jeunes gens : c’était dans la cave de la maison habitée par Madame Veuve Fernémont. Ils étaient tombés les uns sur les autres, on aurait dit qu’ils s’étaient embrassés dans la mort. De là nous sommes descendus à la maison Jaumain, et, dans la cave avaient été consumées cinq victimes : Madame Seghin, son fils et sa servante, la belle-mère Jaumain avec une servante. C’était une petite cave dans laquelle il y avait du charbon, qui s’était allumé par l’incendie de la maison; le carbone s’est dégagé du combustible : ce gaz et la chaleur ont asphyxié les cinq personnes. Pendant leurs souffrances, les soldats allemands passant près du soupirail, entendirent l’appel des réfugiés et y (p.174) restèrent sourds. Mme Jaumain connaissait un peu la langue allemande, elle demanda secours dans cette langue, et un soldat ouvrit la petite porte en tôle du soupirail. M. Léon Jaumain put faire sortir sa famille; le corps tout couvert de blessures, il réussit encore à sortir mais ne put sauver les autres personnes. Lorsque nous sommes arrivés pour visiter cette cave, nous crûmes voir leurs restes calcinés. M. Jaumain est entré à la Croix-Rouge le samedi où l’on put le soigner tant bien que mal. Le dimanche matin, sa femme, accompagnée de ses enfants, vint le visiter ; l’un était devenu aveugle par l’incendie ; depuis, il a recouvré la vue. M. Léon Jaumain fut mis sur un char et emmené hors du village. (Voir page 102.)
Il y avait environ cent quatre-vingts personnes réfugiées dans la maison.
Pendant la journée, on circulait dans l’établissement, on se parlait, et il arrivait des fugitifs de plus en plus. Vers dix heures du soir, un des chefs de l’ambulance me demanda si c’était moi qui avais fait venir ces réfugiés dans la maison. Je lui répondis que tous étaient venus d’eux-mêmes, croyant trouver protection sous le drapeau de la Croix-Rouge. La maison fut visitée depuis le grenier jusqu’à la cave : toutes les chambres, toutes les armoires, toutes les portes durent être ouvertes, pour s’assurer s’il n’y avait personne de caché ; on ne trouva personne. La visite terminée, les réfugiés furent séparés : les hommes dans un premier groupe, les femmes et les enfants dans un second. Les hommes passèrent la nuit debout, enfermés dans le réfectoire de la communauté ; les autres personnes furent envoyées dans les caves. Tous les hommes ont été fouillés à fond. Il y avait un menuisier qui avait dans la poche de son gilet deux cartouches vides qu’il avait ramassées sur le chemin. Cela suffit pour qu’il fut menacé d’être fusillé. Il fut séparé des autres, puis je ne sais ce qu’il est devenu.
Le dimanche matin, M. le Curé de Tamines dit la messe dans la chapelle de la maison : le fils Duculot la lui servit. M. le (p.175) chanoine Crousse consomma les Saintes Espèces dans la chaelle le même jour.
Vers dix heures du matin, les deux groupes de personnes fu-;nt conduits dans la cour. Ce furent des scènes déchirantes, ar les femmes voyaient leurs maris emmenés où? Les enfants oyaient partir leurs pères sans savoir si jamais ils les rêveraient. Ils furent conduits sur la place où avait eu heu la ragédie. Les hommes furent employés à enterrer leurs concitoyens, les femmes et les enfants durent contempler cette triste esogne. Le soir, ils furent dirigés vers Velaine.
Le mercredi après-midi et le jeudi matin, aidé d’une dizaine e personnes, j’ai nettoyé l’église; nous l’avons remise en ordre t désinfectée, de manière que l’on pouvait déjà y célébrer les ffices le dimanche suivant, mais, comme aucun prêtre n’était entré, on n’y célébra pas la messe ce second dimanche.
Le bruit circulait que beaucoup de ceux qui avaient été fu-illés avaient des sommes d’argent sur eux; le manque de respect témoigné à ces braves en les jetant les uns sur les autres ans la fosse commune demandait une sépulture convenable.
Le mardi (dix jours après la fusillade), on ouvrit deux fosses, aux deux côtés de l’église, dans l’ancien cimetière béni, pour y enterrer les fusillés comme il convenait. Ceux qui furent atta-chés à cette triste besogne prirent beaucoup de précautions hygiéniques : on employa les instruments de l’école de sauve-âge qui est installée chez nous ; on ouvrit la fosse provisoire n présence du Dr Defosse et le premier cadavre retiré fut celui de M. Nalinne, horloger ; puis apparut celui de M. Hottlet, curé des Alloux. Tous les cadavres étaient déjà méconnaissables. Ce n’est qu’à certains objets et à certains signes trouvés dans leurs proches et sur leurs habits qu’on put les identifier. Nous lîmes M. le Curé dans un cercueil en bois fabriqué en hâte, et nous le déposâmes dans une fosse particulière ; son beau-frère et moi, nous fûmes les seuls à l’accompagner à sa dernière de-neure.
La triste besogne fut menée à bonne fin, mais on ne trouva (p.176) pas tout l’argent qu’on attendait : les fusillés avaient-ils été dévalisés sur la Place par les soldats allemands?
Le soir du dimanche 23 août, un officier allemand vint demander l’hospitalité à la maison et, avant de prendre son repos, il manifesta le désir de se rendre à l’église pour donner des ordres à ses soldats. Il faisait obscur déjà. Courant un certain danger de traverser les rues en ce moment, parce que les fils électriques étaient abattus et que des pans de mur menaçaient de crouler, il accepta volontiers l’offre d’être conduit à l’église. C’est pendant ce trajet qu’il exprima le regret d’avoir sévi contre la population, parce qu’elle était accusée d’avoir tiré sur les soldats. Lui ayant fait observer que la population n’avait pu se livrer à de tels méfaits, car je la connaissais depuis longtemps, il me répondit qu’il savait bien que j’avais connaissance de l’esprit des Taminois, parce que vingt-cinq générations avaient passé par mes mains et que j’étais un homme prudent en paroles ; que c’est à cause de cela que je n’avais pas partagé le sort de tous ces braves qui reposent maintenant au cimetière. Je ne saurais pas dire quels étaient ses sentiments à ce moment. Tl m’a dit que le 77e avait été éprouvé en passant sur le pont.
XII
Extrait de la relation tle M. l’avocat Goffin,
maréchal des logis fourrier au détachement des Artilleurs Volontaires fie Charleroi, qui, au nombre de dix-neuf, occupèrent Tamines depuis le dimanche 2 août jusqu’au vendredi 21 août 1914.
… Le vendredi 21, j’étais à ma fenêtre (à l’hôtel du bourgmestre Guiot, rue de la Station) dès trois heures du matin et je bouclais mon sac et ma valise : l’aube naissait à peine, et la conversation et les appels des sentinelles rompaient seuls le silence de la nuit. Quatre hommes gardaient l’entrée de Tamines ! Si les Allemands campés à Velaine à ce moment l’avaient su…
(p.177) A trois heures et demie, nous étions tous réunis devant l’hôtel, complètement équipés, les paquetages prêts à être enfermés dans la voiture du boulanger Seron, réquisitionnée pour nous précéder vers Namur.
Traversant le chemin de fer dont les clôtures avaient été démontées la veille, pour nous éviter l’ascension trop dangereuse de la passerelle, nous allâmes occuper notre position de la veille, où se trouvait déjà une demi-section d’infanterie française, des Bretons endormis sur le pavé, commandés par un adjudant d’allure énergique, à la longue moustache noire.
Lorsque le jour fut complètement levé, vers quatre heures et demie, un brouillard épais, propice à une surprise, nous empêchait de voir.
Des voisins charitables réconfortèrent avec du café chaud les cinquante hommes français et belges qui, transis par le froid, attendaient l’ennemi.
Nous fiant aux nouvelles favorables constamment propagées par la presse, nous ne croyions pas être appelés à devoir combattre. Je pensais naïvement que les Allemands, n’osant se risquer à attaquer Namur et Maubeuge, se borneraient à marcher sur Bruxelles et, de là, vers la frontière française en restant à distance de la Sambre, avec l’intention de garder seulement leur aile gauche par des patrouilles.
Vers cinq heures, nous achetâmes le Journal et la Gazette du vendredi 21 août.
Nous causions donc au bord de la route, Clément, Falleur et moi, lorsque, jetant un regard dans la direction des Alloux, nous apercevons dans le brouillard, à une centaine de mètres, quelques cavaliers arrêtés vis-à-vis de la Maison du Peuple de Tamines, trois au milieu de la route et un quatrième sur l’accotement contre les maisons.
Deux énormes roulottes étaient garées à cinquante mètres devant nous sur la droite et encombraient la rue, profonde d’environ six cents mètres en ligne droite et au bout de laquelle se trouve l’église des Alloux. La veille au soir, notre commandant — M. Fernand Gillieaux — avait signalé au bourgmestre (p.178) cet inconvénient et la nécessité de faire enlever ces voitures le lendemain avant notre arrivée.
La première roulotte était partie et les chevaux se trouvaient prêts à emmener la seconde, quand on crie; « Des cavaliers ». L’adjudant dit : « C’est des nôtres, c’est des dragons » ; mais notre commandant, grâce à ses jumelles, a à peine reconnu des uhlans que des coups de feu partent. Je vois au même instant un cheval noir, celui du milieu du chemin, faire une pirouette, s’abattre et se relever ensuite pour traverser la rue et aller s’affaler dans un champ voisin. Les autres cavaliers avaient tourné bride et s’étaient sauvés au grand.galop, poursuivis par les nôtres.
Cette scène n’avait pas duré plus de trois minutes. C’était une sentinelle avancée française qui avait tiré la première; d’autres coups de feu suivirent. Résultat: un uhlan abattu.
Les trois autres allemands ne durent leur salut qu’à l’encombrement de la rue et à l’imprudence des habitants de Tamines qui, sans se douter du danger, et malgré les ordres réitérés, se montraient curieusement sur leurs portes et circulaient dans la rue, nous empêchant de tirer en toute liberté dans la direction des fuyards.
Le uhlan blessé fut relevé à vingt mètres de son cheval : il rampait dans les betteraves et, à l’arrivée du commandant, il était immobile, faisant le mort. Après qu’on l’eut désarmé, il se dressa sur les genoux en joignant les mains, pour nous supplier de lui laisser la vie. Il se figurait que nous avions ordre de fusiller les prisonniers.
Conduit à la gendarmerie, il fut visité et dépouillé de ce qu’il portait, et ensuite escorté par un artilleur et un soldat d’infanterie, sous ma conduite, au poste français situé au delà du pont de la Sambre. Ses armes et le harnachement de son cheval furent conservés par nous et placés dans la voiture chargée de nos sacs et valises. Nous jouissions déjà du triomphe de notre prochaine rentrée à Charleroi avec ce glorieux trophée !
Notre commandant s’empressa de téléphoner à Auvelais au chef de corps, pour faire rapport sur le résultat de cette première (p.179) escarmouche et reçut les félicitations et les encouragements du commandant Dewandre.
Ce moment d’émotion passé, nous préparâmes notre défense, car un Taminois patrouillant à bicyclette, nous annonçait que trois cents uhlans étaient au passage à niveau de Velaine à trois kilomètres de nous et s’avançaient vers Tamines.
Il était à ce moment six heures et demie environ : le brouillard s’était dissipé avec l’apparition du soleil qui nous annonçait une journée brûlante.
Nous nous abritons derrière un talus légèrement élevé, précédé d’un petit jardin entouré d’une haie, position qui nous dissimule assez bien aux yeux de l’ennemi. Les soldats français se font autoriser par leur chef à se servir de leurs sacs comme d’un appui pour mieux tirer. C’est alors que l’adjudant s’emporta contre deux de ses hommes qui, n’écoutant que leur désir de combattre, s’étaient avancés plus loin en avant et s’abritaient derrière un mur pour y attendre la prochaine attaque. Je suis, moi, agenouillé derrière le poteau indicateur au bord du trottoir, et nous attendons.
Après quelques minutes, des cavaliers et des cyclistes s’avancent contre nous. Ordre est donné de les laisser venir assez près pour qu’aucun d’eux ne puisse échapper à notre feu; et je recommande à mon plus proche voisin, le garde Wauthier impatient de se servir de son Mauser, de ne pas agir avec précipitation.
Mais nos précautions sont superflues, car le brigadier Tume-laire, caché en avant de nous, derrière une roulotte, ouvre le feu; Français et artilleurs suivent, des cyclistes sont atteints, car les machines sont abandonnées. Les victimes sont emmenées par ceux qui sont indemnes et qui s’enfuient rapidement.
Après cette alerte, nous songeons à mieux nous garder, car un autre chemin venant de Velaine par les campagnes aboutit à la gare de Tamines et la prudence nous commande de garder ce passage pour éviter toute surprise.
Nous quittons donc les Français pour aller occuper le pont du chemin de fer.
(p.180) Il est environ sept heures et demie du matin. Après quelques instants de calme, nous voyons débuter la bataille d’Auvelais vers huit heures. Les tentatives d’attaques sur Tamines par les patrouilles dirigées contre nous n’avaient eu pour objet que de tâter le terrain ; les Allemands dirigeaient maintenant leurs troupes sur Auvelais pour y forcer le passage de la Sambre. Pourquoi là, plutôt qu’à Tamines? Mystère. Hasard heureux qui a permis à chacun de nous de revoir son clocher natal.
Nous assistons pendant toute la matinée au duel d’artillerie d’un coteau à l’autre, les pièces allemandes se trouvant à Ve-laine et les Français tirant de la Gripelotte, de Tamines, de Falisolle et d’Arsimont. La vallée s’emplit de fumée et nous voyons éclater des incendies. De l’endroit où nous sommes, nous ne perdons rien du spectacle prestigieux, sans courir à ce moment de danger.
L’infanterie se mêle à l’action ; nous ne pouvons évidemment suivre complètement ses mouvements ; cependant nous voyons des détachements s’avancer par le chemin de halage de la Sambre vers le pont du chemin de fer jeté sur la rivière en amont d’Auvelais. Des fantassins français se trouvent tapis sur le pont de la ligne de Mettet à huit cents mètres de là, vers Tamines.
Nous passons ainsi la matinée, au cours de laquelle divers incidents viennent distraire la monotonie de notre faction : deux dragons français venus à Tamines pour remplacer leurs chevaux tués, vont, pour passer le temps, en exploration du côté des Alloux. Lourdement vêtus et bottés, la crinière sur le dos, il ne paraît pas que leur chasse doive être fructueuse. Nous entendons cependant, quelques instants après deux coups de feu… Un uhlan avait vécu, car nous voyons bientôt reparaître nos deux Français chargés de leur trophée, harnachement et équipement. Ils paraissent avoir accompli la chose la plus simple du monde.
Les fuyards commencent à affluer : spectacle lamentable de familles épouvantées de Velaine et des Alloux reculant devant l’invasion. Je vois l’avocat Suray avec sa nombreuse famille (p.181) courant, à peine vêtu, vers la gare de Tamines où se trouvait un dernier train attendant d’être complet pour partir vers Charleroi. Nous apprenons alors que l’ennemi a mis le feu à quelques maisons des Alloux et a enfermé dans une salle une cinquantaine d’otages. Nous frémissons en songeant au sort de ces malheureux.
Vers dix heures, une femme échevelée et essouflée se précipite vers nous et nous remet un chiffon de papier par lequel les Allemands réclament le secours d’un médecin et de la Croix-Rouge pour les blessés. Il s’agit évidemment de soigner ceux qui ont été victimes de leurs tentatives de surprise contre nous. Le docteur Defosse accepte de répondre à cette demande et part avec des infirmiers et des civières; ils sont précédés du drapeau de la Croix-Rouge.
Peu après, les Allemands, des Alloux, font mander le Bourgmestre pour lui transmettre leurs volontés. M. Guiot, s’était enfui le matin vers quatre heures et ce fut M. Emile Duculot, conseiller communal, qui se rendit à cette injonction. Il passa une heure en tête-à-tête avec les officiers allemands qui voulaient surtout le contraindre à enlever le drapeau belge flottant au clocher de l’église et leur répondit par un refus, objectant l’impossibilité de cette opération, réalisable seulement par un homme du métier. Comme on lui demandait s’il y avait des troupes à Tamines, il déclara que, quand il était parti, la commune était occupée militairement.
Midi arrive ; dans le soleil brillant, nous voyons trois taubes en observation vis-à-vis de nous ; quelques camarades essaient vainement de les mitrailler.
Depuis la veille, nous n’avons pris aucun repas. Le commandant Gillieaux décide que l’on ira deux par deux, à tour de rôle, prendre rapidement quelque nourriture ; comme gradés, nous irons les derniers. En attendant, je fais prendre dans ma chambre une caisse de raisins qui nous rafraîchit en calmant notre faim.
L’heure s’avance. Nous sommes inquiets à l’idée d’une poussée des Allemands au delà d’Auvelais, par où notre (p.182) recourant, à peine vêtu, vers la gare de Tamines où se trouvait un dernier train attendant d’être complet pour partir vers Charleroi. Nous apprenons alors que l’ennemi a mis le feu à quelques maisons des Alloux et a enfermé dans une salle une cinquantaine d’otages. Nous frémissons en songeant au sort de ces malheureux.
Vers dix heures, une femme échevelée et essouflée se précipite vers nous et nous remet un chiffon de papier par lequel les Allemands réclament le secours d’un médecin et de la Croix-Rouge pour les blessés. Il s’agit évidemment de soigner ceux qui ont été victimes de leurs tentatives de surprise contre nous. Le docteur Defosse accepte de répondre à cette demande et part avec des infirmiers et des civières; ils sont précédés du drapeau de la Croix-Rouge.
Peu après, les Allemands, des Alloux, font mander le Bourgmestre pour lui transmettre leurs volontés. M. Guiot, s’était enfui le matin vers quatre heures et ce fut M. Emile Duculot, conseiller communal, qui se rendit à cette injonction. Il passa une heure en tête-à-tête avec les officiers allemands qui voulaient surtout le contraindre à enlever le drapeau belge flottant au clocher de l’église et leur répondit par un refus, objectant l’impossibilité de cette opération, réalisable seulement par un homme du métier. Comme on lui demandait s’il y avait des troupes à Tamines, il déclara que, quand il était parti, la commune était occupée militairement.
Midi arrive ; dans le soleil brillant, nous voyons trois taubes en observation vis-à-vis de nous ; quelques camarades essaient vainement de les mitrailler.
Depuis la veille, nous n’avons pris aucun repas. Le commandant Gillieaux décide que l’on ira deux par deux, à tour de rôle, prendre rapidement quelque nourriture ; comme gradés, nous irons les derniers. En attendant, je fais prendre dans ma chambre une caisse de raisins qui nous rafraîchit en calmant notre faim.
L’heure s’avance. Nous sommes inquiets à l’idée d’une poussée des Allemands au delà d’Auvelais, par où notre revenait (p.183) de notre gauche, car les Allemands avaient dépassé le pont du chemin de fer en aval de Tarâmes et s’avançaient par le chemin de halage. C’est par là qu’ils devaient entrer dans cette ville une heure à peine après notre départ. Notre Commandant nous a déclaré par la suite, avec le sang-froid qui îe caractérise, qu’il s’était décidé à ordonner la retraite, lorsqu’il avait vu se retirer les soldats français blottis derrière le pont de la ligne de Fosses. Le danger était imminent, mais nous pouvions effectuer notre retraite, et nous avions accompli notre devoir tel que l’exigeait l’ordre reçu la veille.
Laissant les Français au pont de Tamines, dont les maisons environnantes étaient transformées en forteresses, nous gravissons la côte de Falisolle, suivis de notre voiture d’intendance. La chaleur était accablante et, péniblement, nous suivons le long ruban de la route de Fosses…
XIII.
Déposition de l’autrichien Graf
(La Belgique coupable, par Richard grasshoff, Docteur en droit et en philosophie, avocat à la Cour d’Appel, Berlin, 1915, Georg Reimer, imprimeur-éditeur, p. 39).
J’habite ici à Tamines depuis treize ans. Le vendredi matin, vers six heures, cinq uhlans allemands passèrent devant l’Hôtel de Ville. A Tamines, on nous avait toujours raconté que les Allemands avaient été battus à Liège. On avait bien entendu dire aussi que des uhlans avaient été vus dans les environs, mais c’étaient des déserteurs, croyait-on. Je les avais vus passer devant ma maison; au bout de quelque temps, ils revinrent au galop, seulement, ils n’étaient plus que quatre. On m’a raconté qu’on avait tiré sur ces uhlans soit de l’Hôtel de Ville, soit d’autres maisons.
On me raconta tout d’abord qu’un gendarme de Tamines, (p.184) qui était en civil, était sorti de l’Hôtel de Ville et avait fait prisonnier le uhlan, dont le cheval avait été tué.
Il y avait alors aussi à Tamines de la Garde civique active, armée et en uniforme, de l’effectif d’une compagnie peut-être. Le commandant logeait chez le bourgmestre Guiot. Un quart d’heure environ après le départ des uhlans, il arriva de l’infanterie dans la partie de la ville où j’habite. C’est à Braille (corrigez : la Praile) dans la direction de Velaine, sur la rive gauche de la Sambre. Les fantassins ordonnèrent que tout le monde devait sortir (sic) des maisons. Ils me prirent avec trois autres pour aller chercher un bicycliste blessé devant l’Hôtel de Ville. Car aussitôt après le départ des uhlans, une section cycliste, comme on me l’a rapporté, était arrivée devant l’Hôtel de Ville ; on avait tiré sur elle et atteint un des cyclistes. Le coup semblait être parti de la direction de l’Hôtel de Ville. Je m’y rendis avec les autres, et je relevai le cycliste blessé.
Pendant que nous le relevions, une fusillade éclata de tous les côtés ; les fantassins, une douzaine environ, nous avaient, en effet, escortés jusque-là.
On ne tirait pas seulement dans la direction de la rue, mais de quatre côtés. Les Allemands ripostèrent. Voilà pour un côté. Mais les coups de feu partirent de la direction de la rue opposée, de la direction de l’Hôtel de Ville, et des maisons situées en face de ce dernier.
Je n’ai pas vu de soldats français ou autres en uniforme, mais seulement des civils.
Nous autres, qui transportions le blessé, nous étions donc exposés au feu de quatre côtés, et une balle me passa près de l’oreille droite.
Les jours suivants, j’ai entendu des habitants se vanter de leur habileté à tirer sur les Allemands sans être vus. Dans une maison située près du pont de la Sambre, à gauche en venant de Namur, une mitrailleuse pour balles Dum-dum aurait été cachée derrière un petit trou pratiqué dans le mur, de façon à être invisible, mais à balayer cependant le pont de la Sambre. Lorsque les Allemands voulurent franchir le pont, on avait tiré aussitôt sur eux de cette maison.
(p.185)
XIV Réponse de M. Fernand Gillieaux,
Capitaine-Commandant de la 1ère Batterie d’artillerie de la Garde civique de Charleroi, en détachement à Tamines du 2 au 21 août 1914, aux allégations de l’autrichien Graf
Le vendredi 21 août 1914, vers six heures du matin, quatre uhlans venant de la direction des Alloux arrivaient à quelques mètres de la bifurcation de la route de Keumiée, vis-à-vis de l’Hôtel de Ville. Ils avaient pu arriver jusque-là sans être vus grâce au brouillard. Nos sentinelles avancées (français et belges) se trouvaient exactement à la bifurcation. Dès que les Allemands furent reconnus, des coups de feu partirent et un cheval s’abattit, puis se releva, put encore traverser la rue et tomba mort à l’entrée d’un champ de betteraves, à droite. Les trois uhlans firent demi-tour et partirent au grand galop vers les Alloux, poursuivis par les nôtres dont le tir était fort contrarié par la présence, dans la rue, des habitants qui, malgré le danger, malgré mes supplications, malgré mes ordres les plus énergiques, persistaient à vouloir « regarder ». C’est grâce à la grande prudence de nos hommes qu’il n’y a pas eu de victimes parmi la population.
Le cavalier dont le cheval avait été abattu fut retrouvé par nous immédiatement après, à une vingtaine de mètres, dans les betteraves; il rampait… Je le désarmai complètement et il joignit les mains, paraissant me supplier de ne pas lui faire subir le sort qu’eux faisaient subir à nos blessés, car il était blessé.
Je le fis relever et il fut conduit par mes hommes à la gendarmerie où il fut gardé provisoirement. Contrairement à ce que le témoin déclare sous serment, aucun gendarme n’était en civil ; tous étaient en tenue de route prêts à partir. Nous occupions nos positions avec les Français depuis trois heures et demie. Notre effectif se composait de trente-cinq soldats d’infanterie (p.186) française, commandés par un adjudant et dix-neuf artilleurs de la Garde civique de Charleroi, commandés par moi.
La seconde tentative des Allemands (cavaliers et cyclistes) eut lieu vers sept heures. Ils venaient de la même direction que les autres et se trouvaient à environ cent cinquante mètres de nous quand les premiers coups de feu furent tirés. Ils s’enfuirent immédiatement par la route et à travers champs, abandonnant six ou sept bicyclettes qui furent mises en lieu sûr. Plusieurs Allemands durent être atteints par nos balles, car quelque temps après, une femme (1) vint m’apporter un billet des Allemands par lequel ils réclamaient d’urgence le bourgmestre, un médecin et le service de la Croix-Rouge.
J’affirme sur l’honneur :
1°) Que jusqu’au moment de notre départ de Tamines, le vendredi 21 août, à trois heures et demie de l’après-midi, tous les coups de feu ont été tirés par les Français et par les artilleurs de la Garde Civique, DE LA RUE et de l’endroit où nous nous trouvions, c’est-à-dire devant l’Hôtel de Ville.
2°) Pas un seul coup de feu ne fut tiré d’une habitation.
3°) Aucun civil ne participa à cette affaire. Nous étions trente-cinq Français et vingt Belges en uniforme et réunissant pour combattre toutes les conditions exigées par la Convention de La Haye.
La phrase la plus mensongère du témoin assermenté ( !) est la suivante : « Je n’ai pas vu de soldats français ou autres en uniforme, mais seulement des civils ».
Je lui réponds : « Je n’ai vu que des soldats français ou autres en uniforme qui tiraient, mais pas de civils ».
(1) C’était Mademoiselle Lorette.
(p.187)
XV.
Lettre du Feldwebel-Leutnant Weber
à M. le Bourgmestre de Tamines
ORTSKOMMANDANTUR TAMINES Tamines, 20, V. 16.
Monsieur le Bourgmestre,
tamines.
- Par ordre du Kaiserliches Gouvernement, Namur,
N. O. F. Nr 43448, du 16 mai 1916 :
Au cimetière à l’église St-Martin il y a plus qu’une douzaine de croix, portant le mot « Martyr ».
Ce mot doit être remplacé par un autre moins of-fensiv comme par exemple « victime » — ou doit être omis.
Vous voulez bien nous annoncer jour et heure du changement des croix. C’est ainsi dans votre, comme notre intérêt que l’on agisse imperceptiblement !
- C’est à cause d’une lettre du Kaiserl. Kreischef,
Namur, que notre capitaine demande la livraison : 1) de 100 essuies-main (un par soldat) à nous fournir jusque lundi soir ; 2) 2 tableaux pour un passage du chemin de fer, indiquants : « Passage sévèrement défendu ».
(sig) weber,
Feldwebel-Leutnant
(p.189)
LES VICTIMES
La liste qui suit a été dressée principalement par les soins de M. l’abbé Paul Gilon, vicaire de Saint-Martin, à Tamines. Elle contient les noms de toutes les victimes des événements de Tamines. Elle est, à sa façon, une admirable reconstitution du drame.
(…) Total des morts et des blessés: 431
Sauvés par la Sambre 63
Indemnes de la fusillade restés sur place: 64
= 132
TOTAL GENERAL 613
(dont 553 de Tamines et 60 étrangers)
|
Albert Camille, Albert Victor, Alexis Alexis Amelin Emmanuel Andrianne Laurent Barbiaux Charles Barbier Victor Baudez Joseph Baudhuin Julien Baudry Adrien Bauloys Jean-Baptiste Bauwin Augusta Benoît Jules Benoît Jules Bette Jacques Bettine Giovanni Bielande Emile (frère de 18) Bielande E’phrem Bierlaire Edmond Billard Léopold Bily Jules, Bily Orner, Biot Emile Biot Joseph Bleus Ernest Blistin Adolphe Bodart Léopold, Bodart Achille, Bodart Zéphirin Bodart Alfred (frère de 31) Bodart Joseph Bodart Auguste Bodart Emile Bodart Félix Bodart Léon Bodart Léon Bodart René Bogaerts Jean Bonboir Jules Bonnet Léonard
|
indemne. fusillé. fusillé. fusillé chez Hennion. sauvé par la Sambre. sauvé par la Sambre. fusillé, de Bruxelles. sauvé par la Sambre. sauvé par la Sambre. fusillé. fusillé, de W.-Baulet. carbonisée chez Mombeek. blessé survivant. fusillé. fusillé. blessé survivant. sauvé par la Sambre. fusillé. fusillé, de Falisolle. sauvé par la Sambre. fusillé. indemne, puis volont. de l’A. B. blessé survivant. noyé. noyé. fusillé. sauvé par la Sambre. fusillé. fusillé. fusillé. indemne. blessé survivant. fusillé. indemne. blessé, mort à l’ambulance. fusillé. sauvé par la Sambre. fusillé. indemne, de Bastogne. fusillé. de Falisolle.
|
|
Boquillon René |
sauvé par la Sambre |
|
Bosman Edouard |
sauvé par la Sambre |
|
Boulanger Victor |
blessé survivant. |
|
Bournonville Olivier |
indemne. |
|
Boutefeu Jules |
fusillé. |
|
Brichard Arthur |
fusillé. |
|
Bruart Jph (époux de 48) |
décédé, suite des événements. |
|
Bouffioulx Marie |
décédée, suite des événements. |
|
Bruyère Emile |
fusillé, |
|
Bruyère Ferdinand |
indemne. |
|
Bulens Louis |
indemne, |
|
Burniat Ferdinand, père |
fusillé. |
|
Burniat Maurice, fils |
fusillé. |
|
Cabouy Alexandre |
fusillé. |
|
Callebaut Edouard |
sauvé par la Sambre |
|
Carette Gustave |
noyé. |
|
Cavalier Antoine |
fusillé, |
|
Challe Joseph |
blessé survivant. |
|
Charlier Alphonse |
blessé survivant, |
|
Chenal Victor |
fusillé. |
|
Claes Jean |
tué chez lui. |
|
Clamot Isidore, père |
fusillé. |
|
Clamot Jules, fils |
blessé survivant. |
|
Clément Félix |
fusillé. |
|
Cleynhens Marie |
décédée, suite des événements. |
|
Close Alexandre |
fusillé, |
|
Cnudde Emile |
blessé survivant. |
|
Cobut J.-B., père |
fusillé dans les campagnes. |
|
Cobut Aline, fille |
fusillée dans les campagnes. |
|
Colin Eugène, père |
sauvé par la Sambre |
|
Colin Alexandre, fils |
sauvé par la Sambre |
|
Colin Hector, fils |
indemne. |
|
Collet Albert |
blessé survivant. |
|
Collin Emile, père |
fusillé. |
|
Collin Arthur, fils |
blessé survivant. |
|
Coppe Jean-Baptiste |
fusillé. |
|
Cornil Emile |
blessé survivant. |
|
Couvreur Alphonse |
fusillé chez lui. |
|
Croisier Eugène |
fusillé chez Hennion. |
|
Culot Bénoni |
fusillé. |
|
Damar Jules, père Damar Emile, fils Dambremont Olivier Dauchot Joseph Dautrebande Marcel Débauche Jules Deblocq Arthur Debry Joseph (frère de 89) Debry Victor Decocq Arth. (frère de 91) Decocq Charles Defays Fern. (frère de 93) Defays Léopold Defoin Léon Defosse Fernand Defoux Louis Degosserie Camille Degrez Victor Degrunne Louis Dejaifve Jean, père Dejaifve Gustave, fils Delaitte Gustave, père Delaitte Nestor, fils Delatte Emile Delcharlerie Jules Delcroix Christine Delfosse Louis Delisse Marie Delpcuch Martin Delsauvenière Jules Delvaux Ambroise Delvigne J.-Ph. (frère 113) Delvigne Siméon Delvigne Joachim Demaret Emile Demaret Orner Demeffe Joseph, père Demeffe Octave, fils Demoulin Gustave Demoulin Jules |
fusillé, beau-père du n° 535. fusillé. noyé. noyé. fusillé. fusillé, d’Auvelais. fusillé dans les campagnes. fusillé. blessé survivant. sauvé par la Sambre. fusillé. fusillé. noyé. blessé survivant. blessé survivant. fusillé. blessé chez lui. sauvé par la Sambre. sauvé par la Sambre. indemne. blessé rue de Falisolle. fusillé. sauvé par la Sambre. fusillé, gendre du n° 491. fusillé. décédée, suite des événements. fusillé. décédée, suite des événements. fusillé. fusillé. indemne. fusillé. fusillé. fusillé. blessé survivant. fusillé. blessé survivant. carbonisé chez Fernémont. fusillé dans les campagnes. fusillé.
|
|
Demoulin Louis, père Demoulin Hubert, fils Demoulin J.-B. Demuynck Hubert Denis Charles, père Denis Joseph, fils Denis Franz Dépôt Léonie De Roover Fernand Descamps Emile Descamps Jules Deschamps Georges Desguin H. (époux de 184) Delvaux Marie Desoete Georges Dessy Oscar, père Dessy Oscar, fils Detraux Emile Detraux Léopold Dève Devillers Gustave Devillez Hubert, père Devillez Georges, fils Devillez Robert, fils Docq Gustave, père Docq Adrien, abbé, fils Dogot Constant Donnet Louis Dotreppe Florimond Doucet Jean-Baptiste Dricot Alphonse Dubois Edouard Duchemin Melchior Duchêne Léon Ducoffre Joseph Dufrêne Ernest Dullier Emman., père Dullier Aimé, fils Dullier Marcellin, fils Dumont Benoît
|
fusillé. fusillé. fusillé. fusillé. blessé survivant. fusillé. fusillé. décédée, suite des événements. blessé survivant. noyé. blessé survivant. blessé survivant, fils du n° 202. fusillé. décédée, suite des événements. fusillé chez Hennion. fusillé, de Falisolle. indemne, de Falisolle. sauvé par la Sambre. fusillé. indemne, étranger. fusillé. fusillé, gendre du n° 558. blessé et carbonisé chez lui. fusillé. fusillé. fusillé. fusillé. blessé survivant (vie. des Alloux). fusillé. fusillé chez Hennion. blessé survivant. fusillé. fusillé. indemne. blessé chez Hennion, mort depuis. blessé survivant, mort depuis. sauvé par la Sambre. blessé survivant. blessé survivant. sauvé par la Sambre.
|
|
Dumont Laurent, Dumont Justinien, Dupont Camille Dupont Jean-Baptiste Dupont Florent Durez Dené Dury Joseph (frère de 168) Dury Prosper Duval Léopold Duvivier Léon Etienne Marcellin Eugène Hubert Evrard Ernest, Evrard Alidor, Evrard Fern. Evrard Léon Falque Eugène Fanuel Fernand Fauconnier Leopold Fauvelle Arthur Feuillen Florent Fiévet Leopold, Fiévet Joseph, Fondu Jules Fontaine Camille Fooz Auguste Forthomme Jph, Forthomme Marcel, Foulon Jules Fournier Auguste Fournier Joseph Frederick Charles Fruchart Arthur, Fruchart Victor, Garot Flore Gaspard J.-B., Gaspard Achille, Gaziaux Olivier, Gaziaux Emile, Genevrois François |
fusillé. blessé survivant. fusillé. indemne. blessé survivant. sauvé par la Sambre. indemne. noyé. indemne. noyé. décédé, suite des événements. sauvé par la Sambre. fusillé, de Falisolle. fusillé de Falisolle. sauvé par la Sambre. sauvé par la Sambre. fusillé. noyé. sauvé par la Samb., de Moignelée. fusillé. blessé survivant. fusillé. fusillé. noyé. noyé. fusillé. fusillé. sauvé par la Sambre. fusillé, de Falisolle. indemne. indemne. fusillé. fusillé. indemne. fusillée, rue de Falisolle. fusillé. fusillé. fusillé. fusillé. fusillé.
|
|
Geens Jean-Baptiste |
blessé survivant. i |
|
Georlette Eloïse |
décédée, suite des événements. |
|
Gérard Désiré |
indemne. : |
|
Gérard Fernand |
indemne. |
|
Gérard Joseph |
indemne, de Falisolle. |
|
Gillard Franz |
blessé en fuyant. |
|
Gilbert Antoine, |
fusillé. |
|
Gilbert Roger, |
fusillé. |
|
Gilbert Jean-Baptiste |
fusillé. |
|
Gilles Joseph, |
fusillé. |
|
Gilles Louis, |
blessé survivant. |
|
Gilson Adelin |
fusillé dans son jardin. |
|
Gilson Camille |
fusillé. |
|
Gilson Ferdinand |
blessé survivant. |
|
Gilson François |
sauvé par la Sambre. |
|
Gilson François |
fusillé. |
|
Gilson Gustave |
sauvé par la Sambre. |
|
Gilson Hubert |
sauvé par la Sambre. |
|
Gilson Joseph |
indemne. |
|
Gilson Joseph |
fusillé. |
|
Gilson Martin Joseph |
fusillé. |
|
Glime Fortuné, |
blessé survivant. |
|
Glime Alidor, |
carbonisé chez Fernémont. |
|
Glime Fortuné, |
blessé survivant. : |
|
Glime Emile, |
sauvé par la Sambre, décédé. |
|
Glime Firmin, |
fusillé. |
|
Goffin Joseph, |
fusillé. |
|
Goffin Louis, |
fusillé. |
|
Gollière Julien |
fusillé. |
|
Gosset Adolphe, |
fusillé. |
|
Gosset Joachim, |
sauvé par la Sambre. |
|
Gossiaux Louis |
noyé. |
|
Gouthière Pierre |
blessé survivant. |
|
Grenson Emile |
indemne, étranger. |
|
Grodent Alfred |
fusillé. |
|
Grosfils Georges, |
noyé. |
|
Grosfils Ernest, |
indemne. |
|
Grosfils Fortuné |
fusillé. |
|
Grosfils Thérèse |
décédée suite des événements. |
|
Gueubelle Constant |
fusillé. |
|
Guillaume Charles |
blessé survivant. |
|
Guillaume Louis |
fusillé, de Velaine. |
|
îaert Marie |
décédée suite des événements. |
|
Haesen Pierre |
fusillé. |
|
Hallet Marie-Josèphe |
décédée suite des événements. |
|
Halloin Charles |
blessé survivant, d’Auvelais. |
|
Hanappe André |
blessé survivant. |
|
Hancotte Jules |
fusillé, de Soye |
|
Hannoulle Joseph, |
indemne. |
|
ïïannoulle Alidor, |
fusillé. |
|
Hansotte Gustave |
fusillé. |
|
Hazée Jules |
noyé. |
|
ïïenin Albert |
sauvé par la Sambre. |
|
Henin J.-B., |
fusillé. |
|
Henin Jules, |
sauvé par la Sambre. |
|
Henin Joseph |
blessé survivant. |
|
Henin Zéphirin, |
fusillé. |
|
Henin Zéphir, |
fusillé. |
|
Hennion Auguste |
fusillé près de sa demeure. |
|
Henriet Arthur |
blessé survivant. |
|
Henry Florent |
fusillé. |
|
Hérode François |
sauvé par la Sambre. |
|
Hesmans Justin |
noyé. |
|
Heylen Emile |
indemne. |
|
Heylen Alphonse |
fusillé. |
|
Hittelet Alexandre |
fusillé. |
|
Hocq Félicien |
fusillé. |
|
Hottlet Antoine |
fusillé (Curé des Alloux). |
|
Hubeau Emile, |
sauvé par la Sambre. |
|
Hubeau Georges, |
indemne. |
|
Hubeau Jules, |
noyé. |
|
Hubeau Louise (sœur |
blessée dans la rue. |
|
Hubeau Maxim. |
sauvé par la Sambre. |
|
Hubeau Max. (frère de |
fusillé. |
|
Hubeau Xavier |
sauvé par la Sambre. |
|
Hucq Eugène |
fusillé. |
|
Huybrecht A. (frère de |
fusillé. |
|
Huybrecht Célin. |
fusillée dans la rue. |
|
Huybrecht Louis, |
blessé survivant. |
|
Huybrecht Aloïs, |
blessé survivant. |
|
Huybrecht Jean-Baptiste Jaumain Emile |
fusillé. fusillé. blessé, disparu. noyé. fusillé chez lui. fusillé. fusillé, de Dînant. sauvé par la Sambre. carbonisée chez elle. noyé. fusillé. fusillé. fusillé. brûlé chez Mombeek, survivant. brûlé chez Mombeek, survivant. brûlé chez Mombeek, survivant. blessé survivant. fusillé, de Moignelée. fusillé. fusillé. fusillé. blessé survivant. blessé survivant. fusillé. sauvé par la Sambre. sauvé par la Sambre. blessé survivant. blessé survivant. indemne. noyé. indemne. noyé. fusillé, de Fosses. indemne. fusillé. blessé survivant, tombé à l’A. B. sauvé par la Sambre. fusillé rue de l’Hôtel de Ville. fusillé près du pont du Tergnia. décédé, des suites de la fusillade.
|
|
Laporte Honoré, fils Lardinois Emile, père Lardinois Jules, fils Lardinois Louis, fils Lardinois Lucien, fils Laurent François Laurent Joseph Laviolette Franc., père Laviolette Sylvain, fils Lavis François, père Lavis Charles, fils Lecaille Edouard Léchât Emile Leclercq Gabrielle Ledoux Eugène, père Ledoux Arthur, fils Ledoux Lucien, fils Ledoux Fr. (frère de 339) Ledoux Thérèse Ledoux Georges Ledoux Gustave Ledoux Louis (frère de 343) Ledoux Joseph Ledoux Xav. (frère de 345) Ledoux Louis Ledoux Fernand Ledoux Sébastien Lefèvre Elmire Legrain Joseph Legrain Louis Legrand Louis Lekief Léon Léonard Marie-Louise Lemal Justin Lemineur Joseph Leroy Achille Leroy Emile Lescut Fernand Liblanc Jules Liblanc Aimé
|
indemne. blessé survivant. blessé survivant. blessé survivant. indemne. décédé, suite des événements. fusillé. indemne. carbonisé chez Fernémont. sauvé par la Sambre. sauvé par la Sambre. fusillé. fusillé chez Hennion, de Mazy. décédée suite des événements. fusillé. indemne. fusillé. fusillé. décédée suite des événements. fusillé. indemne, étranger. fusillé. fusillé dans les campagnes. décédé, suite des événements. décédé, suite des événements. fusillé. fusillé dans les campagnes. carbonisée chez Mombeek. indemne, de Falisolle. sauvé par la Sambre. fusillé. fusillé. décédée, suite des événements. fusillé. blessé rue de Falisolle. fusillé. blessé survivant. fusillé. fusillé, de Falisolle. indemne, de Falisolle |
|
Likens Hubert |
noyé. |
|
Linard G. (frère de |
fusillé. |
|
Linard Léon |
fusillé. |
|
Lison Alexis |
fusillé. |
|
Lison J.-B., |
sauvé par la Sambre. |
|
Lison Joseph, |
sauvé par la Sambre. |
|
Lorand Remy |
fusillé. |
|
Lorette Désiré, |
fusillé. |
|
Lorette Louis, |
sauvé par la Sambre. |
|
Loriaux Louis, |
fusillé. |
|
Loriaux Jules, |
fusillé. |
|
Loriaux Louis, |
noyé. |
|
Loubry Eugène |
indemne. |
|
Malonne Arsène |
blessé survivant. |
|
Malotteau A., (frère |
fusillé, de Balâtre-St-Martin. |
|
Malotteau Léon |
fusillé, de Balâtre-St-Martin. |
|
Maniet Jules |
noyé. |
|
Martin Crépin |
fusillé. |
|
Martin Jean-François |
fusillé, étranger |
|
Mary Jules |
blessé survivant. |
|
Massart Arthur |
sauvé par la Sambre. |
|
Massart Joseph, |
fusillé. |
|
Massart Fernand, |
fusillé. |
|
Massart François |
fusillé. |
|
Matagne Joseph |
fusillé, d’Emines |
|
Materne Emile, |
fusillé. |
|
Materne Arthur, |
blessé survivant. |
|
Materne Emile, |
fusillé. |
|
Materne Léonard, |
fusillé. |
|
Mathieu Anatole |
noyé. |
|
Melchior Antoine, |
fusillé. |
|
Melchior Arsène, |
décédé, suite des événements. |
|
Melchior Louis, |
fusillé. |
|
Melchior Emile |
fusillé. |
|
Michaux Fernand |
blessé survivant. |
|
Michaux Fr. (frère de 397) |
sauvé par la Sambre. |
|
Michaux Jules |
fusillé. |
|
Michaux Léop. (fr. de 397) |
sauvé par la Sambre. |
|
Michaux Gustave |
indemne. |
|
Michaux Marie |
décédée, suite des événements. |
|
Michaux René |
sauvé par la Sambre. |
|
Milquet Adrien |
noyé. |
|
Minon Alex (frère de |
indemne. |
|
Minon Alfred |
noyé. |
|
Modave Jérôme, |
fusillé. |
|
Modave François, |
blessé survivant. |
|
Molet Melchior, |
blessé survivant. |
|
Molet Arthur, |
blessé survivant. |
|
Molet Oscar, |
blessé survivant. |
|
Molet Nestor |
fusillé. |
|
Mollet Arthur |
sauvé par la Sambre. |
|
Mollet Emile, |
blessé survivant. |
|
Mollet J.-B., |
sauvé par la Sambre. |
|
Mollet Gustave |
fusillé dans les campagnes. |
|
Mollet Joseph |
fusillé. |
|
Mombeek Marcel |
décédé, suite de ses brûlures. |
|
Mme Mombeek |
carbonisée chez elle. |
|
Montpellier Joseph |
sauvé par la Sambre, |
|
Moreau Léopold |
fusillé. |
|
Moreau Ortan |
fusillé dans la rue. |
|
Moreau Pierre |
fusillé, époux |
|
Mortquin Constant |
fusillé chez Hennion, |
|
Moussiaux Franz |
noyé, |
|
Moussiaux Florent |
fusillé. |
|
Moussiaux Jules, |
fusillé. |
|
Moussiaux Jules, |
blessé survivant. |
|
Mouthuy Léopold |
fusillé et carbonisé chez |
|
Mouton Edmond, |
sauvé par la Sambre. |
|
Mouton Albert, |
fusillé. |
|
Mouton Emfle, |
blessé survivant. |
|
Mouton Théodore, |
indemne. |
|
Moutiaux Octave |
sauvé par la Sambre. |
|
Mouyard Fernand |
fusillé. |
|
Mouyard Georges |
fusillé. |
|
Mouyard Gustave |
noyé, gendre |
|
Nalinne Camille, |
fusillé. |
|
Nalinne Henri, |
fusillé. |
|
Namêche Emile |
fusillé, frère |
|
Namêche Félicien, |
sauvé par la Sambre. |
|
Namêche Fera., |
sauvé par la Sambre. |
|
Namêche Pierre, père |
noyé. |
|
Namèche Oscar, fils |
fusillé. |
|
Naniot Joseph |
fusillé, d’Arsimont. |
|
Noël Désiré |
fusillé. |
|
Noël Joseph |
fusillé chez Hennion. |
|
Notte Alexandre |
fusillé. |
|
Page Maurice |
sauvé par la Sambre. |
|
Patriarche Joseph |
fusillé. |
|
Patris Joseph |
fusillé. |
|
Patris Noël |
fusillé. |
|
Pelsmaeckers Corneille |
fusillé. |
|
Pelsmaeckers Pierre, fils |
fusillé. |
|
Pépin Paul |
noyé, de Lonzée. |
|
Permiganaux L., père |
fusillé. |
|
Permiganaux Fern. fils |
indemne. |
|
Philippart Hubert |
fusillé. |
|
Philippart Joseph |
fusillé. |
|
Pierard Octave |
indemne. |
|
Pierre Octave |
indemne. |
|
Pietquin Jules |
fusillé. |
|
Piette Désiré |
blessé survivant. |
|
Piette Félicien |
fusillé, d’Auvelais. |
|
Piette Gustave |
indemne. |
|
Piette Jean-Baptiste |
fusillé. |
|
Piette Sylvain |
fusillé. |
|
Pindeville Joseph |
sauvé par la Sambre. |
|
Piret Oscar |
blessé survivant. |
|
Pirmez Alfred, père |
fusillé. |
|
Pirmez Marcel, fils |
fusillé. |
|
Pochet Eugène |
fusillé, de Moustier. |
|
Poncin Joseph |
fusillé. |
|
Preumont A. (frère de 473) |
indemne. |
|
Preumont Em. |
indemne. |
|
Preumont Ernest |
indemne. |
|
Quinart Jules |
noyé. |
|
Radelet Jean-Baptiste |
décédé, suite des événements. |
|
Raphaël Norbert, père |
fusillé. |
|
Raphaël Raymond, fils |
blessé survivant. |
|
Reichel François |
fusillé, gendre du n° 412. |
|
Reman Lucien, père |
fusillé. |
|
Reman Jules, |
fusillé. |
|
Remy Louis |
blessé survivant, de Floreffe. |
|
Renard Constant |
fusillé, d’Auvelais. |
|
Renard Emile |
fusillé. |
|
Robert Hippolyte, |
fusillé, beau-père du n° 588. |
|
Robert Albin, |
fusillé. |
|
Robert Arsène, |
fusillé. |
|
Robert François, |
blessé survivant. |
|
Robert Marcel, |
fusillé. |
|
Robert Alfred |
fusillé. |
|
Robert Emile (frère de |
fusillé. |
|
Robert Xavier |
fusillé. |
|
Robette Fortuné |
fusillé. |
|
Rolly Ernest |
fusillé chez Hennion. |
|
Rondia Narcisse |
fusillé. |
|
Roquet Hector |
fusillé. |
|
Rosart Joseph |
fusillé. |
|
Rousselle H. (frère de |
carbonisé chez Fernémont. |
|
Rousselle Louis |
fusillé. |
|
Sadone Félicien |
indemne. |
|
Salmon J.-B. (frère de |
blessé survivant. |
|
Salmon Joseph |
fusillé. |
|
Scavée René |
fusillé. |
|
Schallenberg François |
fusillé. |
|
Schelsen Henri |
blessé survivant, d’Arlon. |
|
Schlit Désiré |
noyé, de Tongrinnes. |
|
Schockaert Joseph |
fusillé. |
|
Scieur Florestan |
noyé. |
|
Seghin (Vve), née Gailly |
carbonisée chez Mombeek, |
|
Seghin Camille, |
carbonisé chez Mombeek. |
|
Seressia Victor |
noyé. |
|
Seron Adolphe |
indemne. |
|
Servais Félix |
indemne. |
|
Sevrin Emile, |
fusillé. |
|
Sevrin Achille, |
fusillé. |
|
Sevrin Emile |
indemne. |
|
Sevrin Denis |
fusillé. |
|
Sevrin Joseph, |
noyé. |
|
Sevrin Edgard, |
fusillé. |
|
Sevrin Ferdinand, |
fusillé. |
|
Sevrin Fernand Sevrin Firmin Sevrin Jean-Baptiste Sevrin Justin Skakala M. (époux de 526) Stùrtz Bertha Skakala Henri, fils Somers François Sottiau Ernest Stasse Alexandre Stasse Jules Steenbeek Camille Steinier Aimé Steinier Alexandre Steinier Emile Steinier J.-B., père Steinier Florent, fils Steinier François Steinier Franz Steinier Georges Steinier Jules Steinier Louis Steinier Louis Steennick Joseph Stimart Louis Tahir Lucien Tesmoingt Nestor Thibaut Léopold, père Thibaut Joseph, fils Thibaut Camille, fils Thibaut Arthur Thibaut Emile Thibaut Ernest Thibaut Jean Thibaut Louis Thibaut Louis Thirion Emile Thiry Marie-Catherine Thomas Ernest Thomas Léopold
|
blessé survivant. sauvé par la Sambre. fusillé. tombé mort dans le cortège. blessé dans les campagnes. blessée dans les campagnes. blessé dans les campagnes. blessé dans les campagnes. fusillé, d’Auvelais. fusillé. noyé. fusillé. blessé survivant. blessé survivant. fusillé. fusillé. fusillé. fusillé, étranger. indemne. indemne. indemne. fusillé. fusillé à Ermeton-sur-Biert. fusillé. fusillé. indemne. blessé survivant. fusillé. fusillé. blessé survivant. fusillé. fusillé. fusillé, S.-Martin-Balâtre. fusillé. indemne. fusillé. fusillé chez Hennion. carbonisée chez elle. indemne. fusillé.
|
Total des morts et des blessés 481
Sauvés par la Sambre ……. 63
Indemnes de la fusillade restés sur place . . 64
Total général 613 (dont 553 de Tamines et 60 étrangers.)