
Les racines de la Belgique (Jean Stengers (ULB) (extraits)
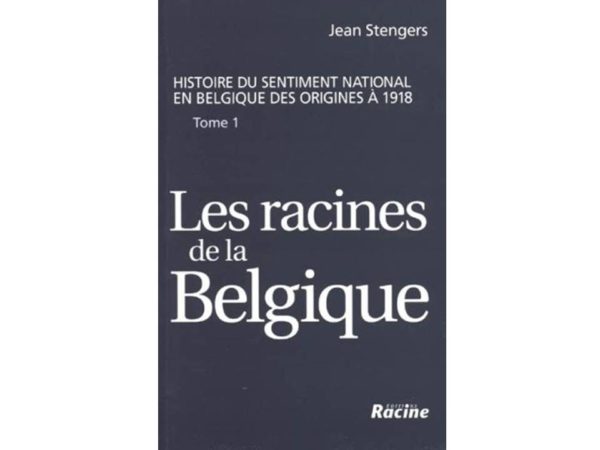
Jean Stengers - Les racines de la Belgique (extraits)
(un livre certainement à acheter)
Racines de la Belgique
Jean Stengers (ULB)
Extraits de :
STENGERS JEAN, Les racines de la Belgique, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1830, éd. Racine, 2000
(p.7-8) Anticipons sur ce que seront nos constatations ultérieures et, à la question ainsi posée, répondons très nettement par l’affirmative : les Belges de cette époque éprouvent un sentiment national belge très marqué.
(p.15) C’ est dans le courant du XVIIe siècle et plus encore du XVIIIe siècle, qu’apparaît dans les Pays-Bas du Sud, chez ceux qui s’appellent déjà des » Belges », le sentiment de plus en plus net d’une identité nationale. Ce sentiment national, que l’on peut qualifier de » belge » ( bien qu’il n’englobe pas encore les Liégeois) éclatera avec vigueur, avec les accents d’ un véritable patriotisme, lors de la révolution dite » brabançonne » de 1789-1790, où tout qui écrit se réclame avec force de la » patrie » – la patrie belge. De tout cela, bien entendu, nous parlerons avec quelque détail dans la suite de notre exposé.
(p.23) Concluons : il y a eu et il demeure à propos de Pirenne une accumulation de méprises. Lorsqu’ un homme politique wallon évoque dans un discours officiel la nécessité de «dépirenniser » l’histoire, en imaginant que Pirenne avait représenté la Belgique comme étant en quelque sorte « inscrite dans les astres » , il s’attaque au Pirenne de la légende, et non au grand, au très grand historien qu’il a été.
(p.24) La Flandre, chose paradoxale, n’en inspirait d’ ailleurs pas davantage. En 1976, un professeur de l’Université de Gand notait que, peu d’ années auparavant, la plupart des historiens flamands s’étaient dressés contre un projet de refonte d’une Geschiedenis van Vlaanderen datant de l’avant-guerre . C’ est que les historiens flamands sont de bons Flamands, mais aussi de bons historiens. En écrivant une grande histoire de la Flandre honnêtement, en hommes de métier, ils ne pouvaient que décevoir et même heurter les convictions nationales qu’ils percevaient autour d’ eux. Si l’on se refuse, en effet, à confondre l’ ancien comté de Flandre et la Flandre d’aujourd’hui – et ce sont là, rien que par leur configuration, des choses bien différentes -, on est forcé, en bonne histoire, de reconnaître dans la Flandre ce qu’ elle est : un sous-produit de la Belgique. Disons même : un sous-produit tardif. Au XVIIIe siècle, il est encore si peu question de Flandre et de peuple flamand dans l’ esprit des populations qu’il n’ existe encore aucun terme d’ ensemble pour désigner ni la région de langue flamande des Pays-Bas, ni ceux qui l’habitent.
(p.25) Nous avons évoqué des raisons flamandes de ne pas se lancer dans une nouvelle grande histoire de Belgique. Il y avait aussi des raisons, non pas francophones, mais wallonnes. En Wallonie, on avait reproché à Pirenne – largement à tort, d’ ailleurs, mais la réputation, ici encore, avait été plus forte que la réalité – d’ avoir fait à la Wallonie, et spécialement à la principauté de Liège, une part trop chiche, et d’ avoir réservé la part du lion au comté et aux villes de Flandre. À l’histoire de Belgique, d’une manière générale, telle qu’elle était couramment enseignée, on reprochait de sacrifier la Wallonie. Ces griefs s’exprimeront notamment après la Seconde Guerre au sein du Centre Harmel pour la solution des problèmes flamands et wallons.
La situation est telle que « les Wallons ignorent généralement (p.26) leur histoire », déclarait Félix Rousseau. L’idée de l’histoire de Belgique devenait ainsi liée à une certaine mise au second plan de la Wallonie.
(p.32) Voyons, aux confins de la France et des Pays-Bas méridionaux, les amputations territoriales que ceux-ci ont subies au XVIIe siècle ? Elles ont été considérables. Les conquêtes françaises, au XVIIe siècle, enlèvent l’Artois, une large tranche de la Flandre – avec Dunkerque, Lille et Douai -, près de la moitié du Hainaut – avec Valenciennes et Maubeuge -, et quelques fragments importants du duché de Luxembourg, avec notamment Montmédy et Thionville.
Quelle a été, chez les populations détachées de ce qui avait été jusqu’alors leur pays, l’évolution du sentiment public ?
Le cas de Lille au XVIIe siècle est particulièrement clair.
Lille, avant la conquête française, ne le cédait en rien en esprit national aux autres villes des Pays-Bas. L’archiduchesse Isabelle, faisant sa Joyeuse Entrée dans la cité en février 1600, y était acclamée comme « l’infante chérie de son peuple belgeois », ce « peuple belgeois » auquel appartenaient les Lillois. Les inscriptions qui ornaient les arcs de triomphe parlaient d’ailleurs toutes le même langage :
Belgia, Belgium, Belgicae provinciae, la Belge.
Les chansons, les poèmes qui sortent des presses des imprimeurs lillois à la fin du XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle sont l’ oeuvre de « Belgeois » qui traitent les «François » en étrangers, sinon en ennemis.
« c’ est à ce coup, pauvres François,
Que vous aurez la gloire estainte :
Composez en carmes françois
De la deffaicte une complainte »,
s’écrie moqueusement un de ces bardes locaux lors de la prise de Doullens par les Espagnols en 159510. Un autre, en 1638, compose un récit en vers de la bataille de Calloo :
« L’an mil six cent trent’huict, le mutin Hollandois
A faict nouvel accord avec le Roy François,
Pensant réduire à eux les valeureux Belgeois. »
Mais Dieu, continue le poète, a fait échouer leurs desseins pervers, et à Calloo, la victoire a souri aux armes du cardinal-infant.
« Rendons graces à Dieu de l’heureuse victoire,
Chantons Io Belgeois, et accordons nos vois
Sur orgues, violons, cymbales et hault-bois. »
(p.33) Durant toute cette période antérieure à la conquête française, il n’y a pas la moindre trace, à Lille, de ce que l’ on pourrait appeler un « parti français ».
En 1667 lorsque Louis XIV met le siège devant Lille, la résistance est organisée par les «bourgeois » comme par la garnison. Un témoin raconte : » L’on a mis un estandart, ou bannière, bien grande, tout au sommet de la Tourre de St Estienne, avec la Croix de Bourgogne au milieu, pour faire sçavoir aux ennemis que nous avons encore des coeurs Espagnols et Bourguignons et non pas François » . Lille, cependant, tombera, et lorsque l’année suivante, le traité d’ Aix-la- Chapelle consacrera la domination nouvelle, il sera accueilli avec tristesse . « C’ estoit une paix sans joie parce qu’on demeuroit au Roy de France», note un contemporain 13. Pendant plusieurs années, le sentiment anti-français restera ancré dans les coeurs. En 1676, un écrivain gagné à la cause de Louis XIV s’ en plaint avec amertume :
« Mais ce peuple inconstant, dans sa bizarre humeur,
Semble fermer les yeux, Grand Prince, à ta faveur;
Lorsque loin de ses murs par l’ effort de tes armes,
Il voit heureusement écarter les alarmes,
Bien loin d’ être touché de ce charmant bonheur,
Il maudit les succès que produit ta valeur,
Et voit d’un oeil jaloux les progrès de la France ;
Ses glorieux exploits font toute sa souffrance…
Mais peuple que possède une aveugle manie,
D’ où peut naître, dis-moi, cette haine infinie ?
Pour quel sujet veux-tu que cette nation ( = la nation française )
Soit l’ éternel objet de ton aversion.
Ah ! chasse de ton coeur et banny de ton âme
De cette passion la criminelle flamme… »
« Haine infinie », « éternel objet de ton aversion » : il faut évidemment tenir compte, en lisant ces mots, de l’amplification poétique, mais ils sont néanmoins extrêmement révélateurs. Sans amplification poétique aucune, Vauban, en 1699, dans un mémoire où il traite de la place de Lille, note « le peu d’ affection des habitants pour la France » .
En 1713, le spectacle a changé : les troupes françaises, revenues à Lille après une période d’occupation hollandaise, sont accueillies (p.34) avec enthousiasme . Les Lillois se sont donnés à la France, ou, disons mieux, ils se sentiront désormais pleinement et uniquement français.
En Artois, l’ évolution est la même.
« Les gens de ce pays d’ Artois », écrivait Guichardin au XVIe siècle, « sont très fidèles à leur prince et mortels ennemis des Français. »
À Arras, renchérit Pontus Payen, les Français sont abhorrés : les vieilles femmes d’ Arras font aux enfants le récit des cruautés de Louis XI envers la cité, « afin de leur faire sucher avecq le laict une haine irréconciliable contre la nation franchoise ». Richelieu confirme : les bourgeois d’ Arras, dit-il, « sont tous ennemis jurés des Français et plus Espagnols que les Castillans ». À Saint-Omer, nous explique un historien local, les Français apparaissaient de même comme « les pires ennemis des Audomarois ». On se souvenait toujours au XVIIe siècle d’ une tentative de coup de main contre la ville qui avait échoué à la fin du siècle précédent grâce à la résistance de la population contre « ces damnés Franchois, ces voleurs nocturnes ».
L’Artois est réuni à la France en 1659 ( sauf l’ « Artois réservé », avec Saint-Omer, qui ne le sera qu’un peu plus tard). Au XVIIIe siècle, les Artésiens sont devenus d’ excellents Français.
Pour le sud du Luxembourg, pour Montmédy et Thionville, qui ont été annexées par la France en 1669, nous n’avons pratiquement pas de témoignages qui nous éclairent sur les sentiments des populations au moment de l’annexion. Mais il n’y a pas de raison de douter qu’ils n’aient été ceux du Luxembourg en général. Les États de Luxembourg, qui savent, au XVIIe siècle, invoquer la « patrie » , écrivent en 1667 que leur province « a tellement en horreur la nation française qu’ elle s’ esmeut au seul nom » . Au XVIIIe siècle, les seules émotions, à Thionville et à Montmédy, seront devenues celles du patriotisme français.
Pour toutes ces annexions du XVIIe siècle, le cas de Lille, que nous connaissons le mieux, peut être considéré, selon toute vraisemblance, comme le cas modèle : avant l’ annexion, un sentiment « belge » de bon aloi, qui va de pair avec un sentiment anti-français ; après l’annexion, quelques années encore – la longueur est variable sans doute suivant les régions – d’hostilité à la France, puis une assimilation rapide qui fond les habitants dans leur nouvelle patrie.
Les petits-fils de ceux qui ont été réunis contre leur gré à la France (p.35) ne savent déjà plus que leur terre natale fut naguère autre chose que terre de France. Lorsque le jeune Watteau accourt à Paris en 1702, tout Français de coeur et de sensibilité, soupçonne-t-il que, un siècle plus tôt, les poètes officiels de sa ville natale célébraient avec enthousiasme la grandeur de la patrie « belgicque », et que en 1656, lors du siège de Valenciennes par les armées de Louis XIV « on ne redoutait rien plus que de tomber ès mains de cette insolente nation française ». soupçonne-t-il qu’en 1681 encore – à la veille de sa naissance, on pouvait entendre des Valenciennois parler avec feu « contre la gloire » du Roi de France, « qu’ ils diminuoient avec autant d’opiniastreté qu’ ils pouvoient faire dans le temps qu’ ils tenoient le parti d’Espagne » ?
(p.36-37) Louis XI, lorsqu’il envisage de de marier son fils le dauphin à Marie de Bourgogne, fait observer aux gens du Hainaut qu’ il cherche à séduire, que « ce seroit grant bien pour le pays’ à cause de la langue walonne, car le thiois n’ estoit pas à sa touche ( = ne lui était pas familier) ». Les Gantois, prétendait-on à la même époque, étaient prêts à abandonner au roi de France les comtés de Hainaut et de Namur « et tous les subjectz de ceste maison ( = la maison de Bourgogne) qui sont de langue française ».
(p.37) Certes, la langue a évidemment joué comme facteur d’assimilation nationale ( Arras et Lille, de langue française, sont certainement devenus plus facilement françaises de coeur que si l’ on y avait parlé une autre langue) et comme facteur d’ unité nationale ( inutile d’ insister, à cet égard, sur l’importance de la langue anglaise), mais gardons-nous à ce sujet de confondre notre analyse d’aujourd’hui avec la vision des contemporains. Ce qui frappe en effet le plus, si l’on considère l’Ancien Régime, c’est que la langue n’apparaît jamais, dans la bouche ou sous la plume des hommes d’État, comme un élément politique majeur de l’ unité nationale.
(p.42) En 1830, les Luxembourgeois, tous les Luxembourgeois, sont des Belges. Le Luxembourg se soulève avec le reste de la Belgique, et il envoie ses volontaires combattre les Hollandais. La ville même de Luxembourg ne peut se joindre au mouvement, car les Prussiens y tiennent garnison au nom de la Confédération germanique. Mais, comme le souligne un témoin, « ses habitants ne craignirent pas de manifester les sympathies belges les plus vives; ses jeunes gens entrèrent en grand nombre dans l’ armée belge » . À en juger par tout ce qui, à l’ époque, se dit et s’ écrit, ce Luxembourg de 1830 respire le même patriotisme belge que le reste du pays.
Dans les années qui suivent, et pendant lesquelles le Luxembourg tout entier restera incorporé à la Belgique, les autorités n’ auront qu’ à se louer de l’ attitude de la population. Le gouverneur de la province écrit en août 1835 au ministre de l’Intérieur. « Je puis dire en toute assurance que la province entière est dévouée au gouvernement et qu’ elle jouit d’une tranquillité parfaite » . Les rapports locaux vont dans le même sens. Le bourgmestre de Diekirch écrit en juillet 1835 :
« Il existe toujours unanimité de voeux pour le maintien des nouvelles institutions et la réunion de la province aux autres provinces belges » . Le commissaire de district de Diekirch écrit de même :
« Les opinions et les sentiments politiques des habitants de ce district sont éminemment patriotiques » .
Le calme cessera cependant lorsque, en 1838, sera connue la menace qui pesait sur la province. Guillaume 1er acceptait le traité des XXIV Articles ; mis à exécution, ce traité arracherait à la Belgique la moitié du Luxembourg.
Des protestations indignées fusèrent aussitôt de toutes parts : le Luxembourg était belge et il voulait, tout entier, le demeurer. Des démonstrations patriotiques furent organisées jusque dans les plus petits villages .
(p.43) « Aujourd’hui », écrivait de Schieren, le 13 mai 1838, un correspondant de l’Écho du Luxembourg, « je fus témoin d’ une scène imposante et touchante à la fois. Toute la population de Schieren-haut et bas ( commune d’Ettelbruck) s’ était réunie dans le but de réarborer le drapeau qu’ elle chérit tant… Le drapeau fut salué par une salve d’ artillerie et accueilli par une musique et des champs patriotiques ; une marche s’ organisa et l’ on promena le drapeau dans tout le village aux acclamations les plus vives de toute la population réunie. ( Ensuite), le drapeau fut porté au haut du clocher, afin de faire connaître au monde entier, s’ il le faut, les sentiments qui animent la population… Le moment… était celui de la messe ; et la cérémonie patriotique fut confondue dans la cérémonie religieuse. Il était touchant de voir tous ces hommes de coeur qu’un sentiment de dévouement patriotique avait réunis, se vouer aux ferventes prières et implorer la divinité en faveur de leur juste cause »
À Diekirch, à Mersch, ailleurs encore, le drapeau tricolore reçoit des hommages non moins fervents. À Diekirch, » quand le drapeau eut été hissé sur le sommet de la tour, une immense acclamation de Vive la Belgique ! salua cet emblème de nos voeux et de notre espoir » .
Mais la fidélité belge des Luxembourgeois comptait pour peu en face de la volonté bien arrêtée des puissances de faire exécuter les XXIV Articles. Le gouvernement et les Chambres belges n’ avaient le choix qu’ entre la soumission et la guerre – une guerre qui risquait de marquer l’ anéantissement de la Belgique. Le débat fut cornélien, dramatique. Mais au-delà de la divergence des opinions – ce fut la soumission, en fin de compte, qui l’ emporta -, un fait était hors de toute discussion : personne ne mettait en doute les sentiments des Luxembourgeois. Aux yeux de tous, les habitants de Vianden et d’Echternach étaient des Belges de la même qualité d’âme que les Brabançons ou les Hennuyers.
(p.45) Quinze ans durant, de 1815 à 1830, au sein du royaume, Belges et Hollandais constituèrent deux camps. Tous les Limbourgeois firent partie du camp belge. En 1830, le Limbourg entier participa à la révolution ou accueillit les troupes belges. Seule Maastricht, tenue militairement par un gouverneur hollandais particulièrement énergique, demeura aux mains du Roi Guillaume.
Les sentiments des Limbourgeois, à Ruremonde comme à Hasselt, à Venlo comme à Saint-Trond, en 1830-1839, sont sans équivoque : ils s’ affirment Belges, et rien que Belges. Ils participent d’ ailleurs pleinement, tous ( à la seule exception des habitants de Maastricht ), à la vie du royaume. Henri De Brouckère, qui sera par la suite chef du cabinet belge, siège à la Chambre comme député de Ruremonde .
En 1838-1839, dans la partie orientale de la province, la perspective de la cession à la Hollande, en exécution du traité des XXIV Articles, va susciter de vives, d’ énergiques et de souvent émouvantes protestations, semblables à celles des Luxembourgeois. De partout, de Conseils communaux et de groupes d’habitants, surgissent des (p.45) pétitions. Elles protestent – nous citons ici la pétition des administrations communales du canton de Meersen – contre « l’ accablante idée d’ être violemment séparés de nos frères, de perdre le nom si cher de Belges, de nous voir livrés à la merci d’ une nation étrangère et ennemie » . Ce voeu ardent de continuer à « porter le nom chéri de Belges » ou, plus simplement, de » rester Belges », de « rester frères », des pétitionnaires demandent qu’il soit » déposé sur l’autel sacré de la patrie ». ÀWeert, les onze membres du Conseil communal et 545 habitants signent une protestation où, affirmant leur » dévouement au pays » et leur attachement à leurs compatriotes belges, ils disent . » La sympathie religieuse et sociale et la conformité de caractères et de moeurs qui les lient si étroitement depuis tant de siècles les rendent heureux et doivent aussi les rendre inséparables ; une cruelle séparation renverserait ce bonheur » .
(p.52) François Mitterrand, dans une interview, le rangeait avec Monaco et Andorre . C’est tout le contraire : le Grand-Duché représente le premier tracé sur la carte de l’Europe d’une conception strictement contemporaine.
Pour le destin du Grand-Duché, ceci n’a pas été sans importance. Il est certain que, unis, ne disons pas par la langue, mais par le même dialecte – le luxembourgeois -, les habitants du Grand-Duché ont trouvé là un facteur supplémentaire d’ identité, propice lui aussi au développement d’ un sentiment national.
(p.55) Un fait est hors de doute : le premier ensemble territorial qui annonce plus ou moins la Belgique future est celui constitué au Xve siècle par Philippe le Bon : les Pays-Bas bourguignons. Et c’ est au sein de ces Pays-Bas bourguignons que l’ on verra apparaître une première forme de sentiment d’ identité nationale à laquelle on peut rattacher de manière plus ou moins directe le futur sentiment national belge.
(p.63) On a pu tracer sur la carte des Pays-Bas quatre zones concentriques, ayant pour centre la mer du Nord, et présentant au bas moyen âge des physionomies différentes . La première zone comprend plus particulièrement la Flandre, avec plus d’ un tiers de population urbaine, et une densité de population qui dépasse celle du coeur de la Toscane. Une seconde zone ( Brabant, Liège, Namur, Hainaut) est une zone où, si le taux d’ urbanisation oscille entre 28 et 31%, la vie rurale est prépondérante. La troisième zone est essentiellement rurale. Elle commence à l’ ouest avec la Picardie et l’ Artois – l’Artois qui est « le grenier de tous les Pays-Bas » et dont un ambassadeur vénitien dira au début du XVIe siècle qu’il produisait plus de blé que tout le reste du pays . Au-delà, la quatrième zone, comprenant notamment le Luxembourg, est une zone de forêts et de cultures.
(p.67) Le traité de 1339
Dans la suite des traités du XIVe siècle, il en est un cependant que nombre d’historiens ont mis hors de pair. le traité du 3 décembre 1339 entre la Flandre et le Brabant .
Lisons le texte même du traité. Nous y trouvons d’abord l’alliance militaire, nettement dirigée contre la France , nous y rencontrons l’ arbitrage obligatoire, la monnaie commune, les clauses dites « commerciales », toutes prescriptions dont nous avons souligné, au cours des pages qui précèdent, le caractère banal. Mais une idée traverse tout le texte, une idée-maîtresse qui imprègne beaucoup moins les autres conventions diplomatiques du siècle : l’ idée de la paix qui doit désormais régner à perpétuité entre les principautés alliées, de la paix éternelle – le traité n’ emploie pas moins de dix fois ce mot redoutable d’ « éternel » .
(p.69) Les termes » Avalterre ‘ » » pays d’ en bas », » basses régions », » partes inferiores « , » partes advallenses », « lage landen bi der see », » Nederlant » se rencontrent très tôt – à partir de la fin du XIIe siècle ; mais jusqu’à l’époque bourguignonne, leur sens reste extrêmement vague : il s’ agit, grosso modo, des basses régions sises autour du Rhin inférieur et des Bouches de la Meuse et du Rhin . C’ est une zone géographique aux limites aussi imprécises que les noms mêmes qui servent à la désigner, mais dont le centre de gravité semble se situer du côté du Rhin. Un chroniqueur liégeois du XIVe siècle, narrant l’arrivée à Liège, en 1349, de troupes de Flagellants, explique que ces exaltés venaient » de partibus inferioribus » . » Partes inferiores » : les régions situées à l’ ouest de la principauté de Liège ? Non point : les régions allemandes du Bas-Rhin 69. Voilà le sens que » pays bas » possède sous la plume de ce Liégeois. Celui d’ ailleurs qui, à cette époque, parle des » pays d’ en bas » ou des » lage landen bi der see » ne pense en général ni au Hainaut, ni au Namurois, ni au Luxembourg, et souvent même pas au Brabant – au Brabant méridional du moins. Ses Pays-Bas, en un mot, ne sont pas les nôtres.
(p.76) Les ambitions de Philippe /le Bon/, à l’ apogée de son règne, dépassaient d’ailleurs de beaucoup les limites des principautés des Pays-Bas : il rêvait, en obtenant un vicariat d’Empire, d’ étendre son hégémonie sur toute la rive gauche du Rhin . L’ ambition fondamentale de Philippe le Bon, telle qu’ on peut la discerner, a été de rassembler sous son sceptre un maximum de territoires, en visant de préférence ceux sis aux alentours de ses possessions héréditaires.
(p.77) Dans les Pays-Bas en tout cas, dès lors qu’un grand ensemble territorial est né, ayant un même prince, et que ce prince va le doter de certaines institutions communes, il est permis de parler d’un État bourguignon.
Avec l’ adjonction à cet État bourguignon, sous Charles Quint, de la Gueldre, d’Utrecht, de Zutphen, de l’ Overijssel et de Groningue, on aboutira à un ensemble plus vaste encore : celui des XVII Provinces.
Les XVII Provinces : tel est devenu l’ équivalent, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, de ce que l’ on appelle désormais aussi les Pays-Bas (ou le Pays-Bas) ou Nederland (ou Nederlanden), Belgia, the Netherlands, écrit Shakespeare .
XVII Provinces : l’ expression est parlante. La représentation de ces provinces l’est également.
Ainsi du sceau que les États Généraux décident de se donner en 1578.
» Résolu de faire graver ung seel pour la Généralité, où sera ung lion grippant couronné, aiant en la patte droicte une espée, en la sénestre dix sept flesches – signifians les dix sept provinces – liées d’ung roulet, où sera escript : Concordia, estant la superscription dudict seel: Sigillum ordinum Belgii, cum data 1578, et l’inscription du contre-seel :
Virtus unita fortior, avecq effigie d’une main, sortant d’une nuée, et tenant le roulet où sera escript. Concordia, duquel dix sept flesches seront liées » .
Ainsi du célèbre lion, le Leo Belgicus, que Hogenberg grave en 1583 pour le livre de von Eitzing, De Leone Belgico, et qui enserre dans son corps majestueux ses dix-sept composantes .
Ainsi des dix-sept jeunes filles arborant chacune le blason d’une province qui accueillent en 1595 l’ archiduc Ernest lors de son entrée solennelle à Anvers .
(p.78) Ces dix- sept provinces, quelles étaient-elles ? Guichardin, dans sa célèbre Descrittione di tutti i Paesi Bassi, publiée en 1567, en fournit la liste : 1) Brabant; 2) Limbourg; 3) Luxembourg; 4) Gueldre. 5) Flandre; 6) Artois; 7) Hainaut; 8) Hollande ; 9) Zélande ; 10) Namur; 11) Zutphen ; 12) marquisat du Saint-Empire (Anvers) ; 13) Frise; 14) Malines ; 15) Utrecht; 16) Overijssel; 17) Groninge. C’ est la même énumération que l’ on trouve dans le Leo Belgicus et en 1596 dans les blasons portés par les jeunes filles d’ Anvers.
(p.81) Un texte de 1488 est à cet égard aussi éloquent par ce qu’ il dit que par ce qu’il ne dit pas. C’ est le texte de l’ accord conclu le 12 mai 1488 entre la Flandre, le Brabant, le Limbourg, le Luxembourg, le Hainaut, Valenciennes, la Zélande, le Namurois, la Frise et Malines. On y surprend un grand désir de concorde et d’union: » promettons et jurrons, par meure deliberation… paix, union, amitié, alliance, intelligence entre nous et par ensemble à l’honneur de Dieu et proffit de nostre très redoubté seigneur et de ses pays et subgetz ».
(p.83) De manière concomitante, au sein de ce pays, au singulier, les principautés que l’on appelait traditionnellement des » pays » deviennent des provinces. L’emploi du terme province, et de l’ adjectif provincial, est fréquent à partir des années 1560 , il devient tout à fait ordinaire à partir des environs de 1575. Ces mots s’ entendent déjà, à cette époque, dans leur sens moderne, actuel. Ils indiquent par conséquent une conception unitaire de la constitution politique des Pays-Bas : les principautés sont considérées comme des circonscriptions territoriales d’un grand tout qui est l’État.
(p.85) L’histoire suisse, on peut l’observer, présente un phénomène assez analogue : les habitants des cantons confédérés répugnèrent assez longtemps à adopter le nom de « Suisses » ( Schweizer) sous lequel les étrangers les désignaient communément; les Suisses, aux yeux des Lucernois ou des Bernois, étaient les habitants du canton de Schwyz, avec lesquels ils ne désiraient pas être confondus. Mais dans ce cas, l’usage étranger finit par prévaloir .
(p.85) Au-dessus des partitularismes provintiaux, le sentiment national
Particularismes provinciaux très vifs, venons-nous de dire. Mais peu à peu, s’ étendant au-dessus d’ eux, les atténuant même sous certains aspects, va grandir, à l’ échelle des XVII Provinces, ce qui est un authentique sentiment national.
C’ est de la vie en commun – de la vie politique, s’ entend – que, de toute évidence, il jaillit. Bien avant que ne soit employé à propos des Pays-Bas le terme « État », au singulier, l’idée se développe que ces Pays-Bas constituent un « corps politique », ayant son individualité propre. En 1534, s’adressant aux États Généraux, l’audiencier de Marie de Hongrie exhorte les » pays » à « tenir bonne union et concorde » et à s’ » aydier, assister et conforter l’ung l’ autre » comme le doivent les » membres de pays non divisable ni séparable » .
(p.87) Mais tout lyrisme mis à part, insistons sur les mots « dat gansche Nederlant » que nous avons rencontrés dans la description de la patrie. Ils sont révélateurs. Le sentiment national, vers 1560- 1570, ne présente pas de fissure. Il englobe l’ ensemble des XVII Provinces. Pour s’ en convaincre, il suffit d’ ouvrir un recueil de chansons populaires de l’ époque. La patrie que célèbrent ces poèmes, ce sont les Pays-Bas – » onze Nederlanden » -, tous les Pays-Bas. Que l’on parcoure les pamphlets, et la constatation est la même : comme dans les chansons, c’est la patrie néerlandaise toute entière qui s’y trouve sans cesse affirmée .
Nulle part on ne saisit de trace d’un particularisme propre à la partie septentrionale ou à la partie méridionale du pays. Luttez avec nous » comme avec des compatriotes, des frères, des hommes de la même chair et du même sang », s’ écrient en 1573 les États de Hollande. Cet appel est-il réservé à la Zélande ou à la Gueldre ? Il s’ adresse à toutes les principautés des Pays-Bas indistinctement.
(p.88) Si l’on envisage les opinions contemporaines, c’est tout aussi vainement que l’on tente de découvrir un texte du temps qui oppose – ou même simplement qui distingue – le Nord et le Sud. L’idée qu’il pourrait y avoir des Pays-Bas septentrionaux et des Pays-Bas méridionaux ne se rencontre nulle part. Ce Nord et ce Sud dont notre vision du passé toute chargée de présent nous suggère sans cesse l’ image, sachons le reconnaître : avant la révolution religieuse, ils n’ existent proprement pas.
(p.91) L’historien cède à une tendance naturelle de l’esprit humain ; il projette dans le passé sa vision du présent.
(p.92) La force des sentiments linguistiques peut se mesurer tout d’ abord à l’ aune du vocabulaire. Qu’ il y ait au sein des Pays-Bas des populations de langue française, et d’ autres, par ailleurs – les plus nombreuses – dont la langue est le nederduitsch ou le nederlandsch (le «flameng », dit-on à plus d’une reprise en français) (…).
(p.93) On a pu s’y tromper, lorsque l’on a étudié les événements de 1578-1579. À cette époque, en effet, l’ injure et même l’ insulte règnent entre » Flamands » et » Wallons ». Le prieur de Saint-Vaast d’ Arras, Jean Sarrazin, écrit en octobre 1578 : c’ est « la guerre entre les Flamens et Wallons » . Il insiste encore quelques jours plus tard : » La guerre se manifeste de plus en plus des Wallons contre les Flamengs » . Mais prenons-y garde. Ces » Flamands » que les » Wallons » assaillent de reproches, ce ne sont nullement les Flamands au sens moderne du mot : ce sont les habitants du comté de Flandre . Le conflit des » Wallons » et des » Flamands » oppose fondamentalement, non point des groupes linguistiques, mais des communautés politiques : la Flandre d’ une part, et d’ autre part les principales provinces wallonnes, Hainaut, Artois et Lille-Douai-Orchies . Au lieu de dire « les Flamands », les textes disent d’ ailleurs souvent « la Flandre », ce qui rend toute équivoque impossible.
Quant au ressort de ce conflit, il saute aux yeux : c’ est essentiellement l’ antagonisme religieux. Nous assistons là à une lutte sans merci entre un catholicisme exclusif et un calvinisme conquérant .
(p.98) Est-ce à dire que, avec le particularisme provincial, on possède la clef des événements qui allaient mener à la scission des Pays-Bas, et rendre ensuite cette scission définitive ? Certainement pas. Les tendances particularistes ont sans doute affaibli la résistance commune à l’ennemi extérieur. Elles n’ont pu aboutir à la formation de deux blocs dont elles ne poursuivaient pas la réalisation. Elles n’ ont pu tuer une unité nationale dont les plus particularistes eux-mêmes reconnaissaient la légitimité et le caractère bienfaisant.
La formation d’un bloc des Pays-Bas du Nord et d’un bloc des Pays-Bas du Sud, personne, à vrai dire, ne la voulut ni même ne la prévit. Elle ne fut nulle part dans les intentions de nos ancêtres du XVIe siècle. Elle ne se présenta jamais à leur esprit avant de s’être réalisée dans les faits.
L’Union d’ Arras et l’Union d’Utrecht qui, à la lumière des événements qui les suivirent, nous apparaissent aujourd’hui comme les actes de fondation d’un État du Sud et d’un État du Nord, ne possédaient aucun caractère semblable aux yeux des contemporains. Les confédérés d’ Arras, au début de leurs négociations avec Farnèse, ne voulaient envisager une réconciliation avec Philippe II que dans le cadre d’une <, générale réconciliation » de tous les Pays-Bas. Lorsqu’ils eurent compris qu’ils poursuivaient là une chimère, et qu’ils se résignèrent à une réconciliation particulière, ils firent en sorte que celle-ci fût une invite à la réconciliation de tous. Le traité qu’ils obtinrent d’ Alexandre Farnèse stipula que « touttes provinces, chastellenies, villes ou personnes particulières » des Pays-Bas seraient admises endéans un certain laps de temps à bénéficier des mêmes conditions de paix. Quant à l’Union d’Utrecht, qui constitua une riposte directe à l’Union d’ Arras, elle ne visait nullement à grouper en un faisceau les seules provinces septentrionales ; elle était ouverte à tous ceux qui optaient pour la lutte à outrance. La plupart des grandes villes de Flandre et de Brabant en firent partie au même titre que la Hollande ou la Zélande .
Insistons sur ce point, car il est capital. Ni dans l’Union d’ Arras, ni dans l’Union d’Utrecht, on ne saisit de trace d’un véritable esprit séparatiste . Le séparatisme qui s’y fait jour n’est que nécessité politique : il est imposé par les événements. L’idéal, visiblement, est (p.99) ailleurs – il s’ appelle toujours Pays-Bas.
(p.99) Face à l’ennemi, les insurgés se comptent. Le decouragement n’est pas permis, s’ écrie en 1584 un partisan de la résistance à outrance :
« Maintenant que nous tenons avec toute la Rollande et Zeelande, autant riche et florissante qu’ elle fut oncques, le pays de Gueldre, de Frise, d’Overijssel, d’Utrecht; que nous tenons Malines, Bruxelles, Vilvorde, que nous possédons encore Gand, métropole de Flandres, si bien animée, Tenremonde, l’Escluse, Ostende, et pardessus toutes ces belles villes et pays’ la tresriche et tresflorissante ville d’ Anvers, célébrée et renommée par tout le monde, aurons nous le coeur si bas que par une orde avarice, cause de tous noz maulx et pertes de pardeçà, nous vouldrions nous faire acroire qu’ en tant de pays’ en tant de riches et puissantes villes, où se trouvent tant de riches gentilzhommes, riches et puissantz bourgeois et marchans, ne se pourra (p.100) trouver le moien de dresser une bonne armée, pour non seulement faire teste à nostre ennemi, mais aussi la luy rompre… »
Nulle ligne de partage, on le voit, tracée entre les régions du Nord et celles du Sud. L’idée d’une pareille distinction est absente de l’ esprit de l’ auteur. Pour lui, comme pour tous ses contemporains, tous ceux qui continuent à lutter contre l’Espagne forment une seule et même grande association d’ armes. Tous ensemble, ils luttent pour la patrie et pour la religion.
Ainsi donc, nous le répétons, personne ne voulut la scission. Elle fut le produit des événements. Elle se fit parce qu’ Alexandre Farnèse, après avoir reconquis, tant par la diplomatie que par les armes, les provinces méridionales des Pays-Bas, échoua devant la résistance victorieuse de la Hollande et de la Zélande.
(p.101) La scission des Pays-bas a résulté de la reconquête du Sud par les Espagnols, et de leur échec dans la reconquête du Nord, qui a permis la création et le maintien des Provinces-Unies indépendantes.
(p.104) La patrie, le « pays » demeure pendant de longues annees, aux yeux des contemporains, surtout ceux du Sud, l’ ensemble des XVII Provinces, les Pays-Bas, de Nederlanden . C’ est cette patrie qu’un tapissier d’Arras représente, en 1597, sous l’aspect d’une femme éplorée, assaillie par ses propres enfants, c’ est elle que chante un poète anonyme lors de la conclusion de la trêve de Douze Ans (1609):
« Het is nu veertigh jaer, dat ghy u selfs bestrÿdt,
ONSINNICH NEDERLANT… »
« Voici quarante ans déjà que vous vous livrez combat à vous-même, / Pays-Bas insensés »
La persistance de ce sentiment national néerlandais explique que, longtemps après 1585, l’idéal des meilleures têtes politiques du Nord et du Sud demeure la reconstitution de l’ unité des Pays-Bas. Dans le Sud, on parle de réduire à l’ obéissance les rebelles du Nord, dans le Nord de délivrer les populations méridionales du joug espagnol; mais l’idéal est le même : » réunir et rejoindre l’Estat en sa première forme et grandeur » .
(p.108) Le sentiment national néerlandais, cependant, ne s’ est pas éteint progressivement. Il a été carrément tué par l’émergence de deux sentiments nationaux nouveaux, propres au Nord et au Sud.
(p.125) Première observation : la révolution dite » brabançonne » porte un nom qui peut se justifier – car le Brabant a été réellement au cœur de la révolution – mais on peut la considérer, sans aucune réserve, comme une révolution belge, car elle débouche sur l’ indépendance d’un pays qui est déjà, au plein sens du terme, la Belgique. La Belgique de 1789-1790 porte déjà ce nom, avec des habitants qui, tous, se disent » Belges », et elle est l’ ancêtre directe, sans solution de continuité, au point de vue à la fois du territoire et du sentiment national, de la Belgique de 1830.
Ce qui, chez d’ aucuns, a créé parfois un certain malaise, voire certains doutes sur ce point, est la configuration territoriale du pays. Peut-on se demandent-ils, parler déjà de la Belgique, alors que le territoire de la principauté de Liège manque toujours à l’ appel, et que les habitants de Liège, de Huy, de Dinant, de Saint-Trond, sont toujours étrangers à cette » Belgique » ? Avec tout le respect dû aux Liégeois, ceci reviendrait à se demander si, lorsque Louis XIV monte en 1643 sur le trône, c’ est bien de la France qu’ il devient le maître, puisqu’il s’ agit d’un pays qui ne comprend encore ni Arras, ni Lille, ni Strasbourg, ni la Lorraine, ni la Franche-Comté, ni la Savoie, pas plus qu’ Avignon, Nice ou Perpignan.
Belgique 1789, France 1643 : les cas, me paraît-il, sont analogues.
L’analogie ne s’ arrête d’ ailleurs pas à l’ aspect territorial : elle s’ étend aussi au problème de la conscience nationale. Les Liégeois, les Hutois, les Dinantais de 1789 ne se sentent en aucune manière Belges – leur patrie est le pays de Liège -, mais aussi bien à Lille, à Arras, à Besançon, en 1643, on est très nettement anti-Français. Pour les gens de Lille et d’ Arras, fidèles au roi d’Espagne, nous l’ avons vu précédemment, le sentiment d’appartenance est celui qui les rattache aux Pays-Bas. C’ est la réunion à la France, et elle seule, qui fera d’ eux de bons Français, de même que seul le rattachement à un ensemble politique dans lequel ils se trouveront en compagnie des (p.126) Belges fera des Liégeois des hommes qui, en 1830, voleront au secours de la Belgique qui sera devenue leur patrie.
(p.126) C’est là d’ailleurs l’objet de notre deuxième observation : nous avons affaire en 1789 à une révolution nationale, en ce sens que le peuple qui se déclare indépendant se reconnaît à soi-même une individualité nationale qui est au-dessus de toute discussion. Les polémiques politiques et religieuses peuvent être âpres, passionnées, les partisans de l’ Empereur, les Statistes et les Vonckistes peuvent s’ entre-déchirer, il y a un point sur lequel il n’y a pas l’ ombre d’un désaccord : tous-et ils le disent-sont des Belges, des Nederlanders. » La Belgique ne se verra jamais enchaînée tant qu’il restera un Belge qui puisse la défendre, et la race sera plutôt anéantie que subjuguée », lit-on dans un pamphlet de 178733. Même si un joséphiste n’ aurait dans le doute pas signé ces lignes, il aurait lui aussi parlé de la » race » des Belges. (…)
Mais Belgique n’a pas encore détrôné Pays-Bas, qui, jusqu’en 1789, reste le terme le plus généralement employé, et garde ensuite des positions très fortes. Une petite statistique, à titre indicatif. dans les Documens politiques et diplomatiques sur la révolution belge de 1790 publiés par Gachard, Belgique est employé quinze fois, mais Pays-Bas revient à cinquante-neuf reprises .
(p.127) Par ailleurs, on utilise fréquemment, tout au long de la période, l’ expression les provinces belgiques. Elle a son reflet dans le nom officiel du nouvel État créé en 1789 : les États Belgiques- Unis . Il s’ agit là d’un hybride, on s’ en aperçoit sans peine, des Etats- Unis – dont le modèle était présent à l’ esprit des Belges de l’ époque – et des provinces belgiques.
Pour le nom des habitants du pays, par contre, pas de problème : ce sont des Belges, et rien que des Belges. Le nom n’ a aucun concurrent. On retrouve un certain flottement, cependant, quand du substantif on passe à l’ adjectif : belge ou belgique. L’adjectif belge, en fait, ne perce encore que très peu ( on ne le trouve pas une seule fois, par exemple, dans les Documens de Gachard, le titre du recueil mis à part) . Ce qui est tout à fait usuel est belgique. On parle du peuple belgique, de l’ armée belgique, de l’Église belgique, du lion belgique, de la République belgique, de la constitution belgique, de la liberté belgique, Vander Noot est le » Cicéron belgique « , le général Vander Mersch le « Washington belgique « .
Si l’ on passe du français au néerlandais, en néerlandais, en ce qui concerne le nom du pays, il y a toujours une parfaite uniformité : c’ est toujours Nederland ou de Nederlanden. Seule la forme du nom peut varier. On trouve parfois par exemple la forme contractée Neerland. Dans un codicille de son testament, en 1792, Vonck évoque le retour des Autrichiens » in het Neerland » .
Nederland, mais, soulignons-le, jamais encore België. On a beau retourner dans tous les sens la littérature de l’ époque, België est introuvable.
Les habitants du pays sont presque toujours des Nederlanders. Belgen existe, mais est encore assez peu fréquent. Plus qu’ au langage courant, les Belgen appartiennent principalement au langage poétique : on les trouve dans les poèmes patriotiques.
« Roemrugte Helden ! edele Telgen !
Gedugte Borgers van uw land :
Vereerders van het woordke Belgen… «
« Die onverwinbaer’ Belgen… «
En 1790, cependant, Belgen a tendance à se répandre davantage. Dans un appel qu’ ils lancent en juin 1790, et qui est adressé à Van Eupen, Vonck et ses amis s’ écrient . » Wy zyn Belgen, Myn Heer » .
(p.128) Belgen et Nederlanders, en tout cas, sont absolument synonymes . Parallèlement, l’ adjectif nederlandsch l’ emporte de loin sur l’ adjectif belgisch. On parlera bien des Vereenigde Belgische Staeten, mais beaucoup plus souvent des Vereenigde Nederlandsche Staeten . Notons dans l’ ensemble de ce vocabulaire, français et néerlandais, un grand absent. À l’ étranger, à la fin du XVIIIe siècle, on continue plus d’une fois à appeler les habitants de l’ensemble des Pays-Bas des Flamands. En Belgique même, le terme n’ est jamais employé dans ce sens. Le nom de Flamands, dans les textes imprimés en Belgique, est réservé aux habitants du comté de Flandre . Nous y reviendrons.
Nous venons de parler de certains flottements dans le vocabulaire. Ce sont les Français qui, arrivés en Belgique, vont par la suite y mettre de l’ ordre. On oserait presque dire qu’ ils vont faire le ménage. En néerlandais, ils élimineront presque complètement Nederland, Nederlanders et nederlandsch . En français, pour désigner le pays, ils ne connaîtront que la Belgique : le nom de Belgique, dès le début du régime français, sera le seul employé. Enfin, c’est le régime français qui tuera, ou presque, l’ adjectif belgique. L’esprit logique des Français, en l’ occurrence, a fait la loi. Un Français fait partie du peuple français, un Anglais fait partie du peuple anglais, un Espagnol du peuple espagnol, un Belge appartiendra donc logiquement et une fois pour toutes au peuple belge. Les Français emploieront uniquement l’adjectif » belge » et feront sombrer « Belgique ».
Ce n’ est pas eux cependant qui, avec le même sens logique, ont introduit België. Il allait revenir aux Hollandais, beaucoup plus tard, en 1814- 1815, de le faire . België est un don des Hollandais.
(p.134) Le Luxembourg n’ a pas participé à la révolution brabançonne : la population y est restée passive. Bien mieux : les États du Luxembourg ont toujours fidèlement soutenu l’Empereur. N’y a-t-il pas là, du point de vue des sentiments patriotiques, un fait troublant ? Il a en effet suscité, de la part des historiens, pas mal de commentaires .
Un fait cependant domine le débat, car il est clair : toute question de sentiment national mise à part, les conditions propres au Luxembourg de l’ époque étaient aussi peu favorables que possible à l’ extension au duché du mouvement révolutionnaire. Nous avons affaire à un pays rural, pauvre, où la population des campagnes est encore largement analphabète. Il n’y a qu’une seule ville qui mérite réellement ce nom, et qui est Luxembourg. Encore est-il difficile d’y (p.135) des lumières : » deux ou trois minables imprimeurs et la capitale ‘ » écrit Gilbert Trausch, » impriment et vendent des manuels de classe et des livres de dévotion » . L’Église un élément de culture plus vigoureux, mais elle ne peut le moteur d’un mouvement révolutionnaire car – contrairement à ce qui est le cas dans le reste des Pays-Bas-elle est fortement pénétrée par l’ esprit joséphiste . Dans des termes évidemment marqués par l’ esprit pamphlétaire, une Lettre d’un citoyen du Luxembourgà son ami, en mars 1790, décrit la situation des Luxembourgeois en disant : » Ce peuple isolé à l’ extrémité des Pays-Bas, éloigné du centre de l’ administration civile, toujours enchaîné, toujours tremblant sous le pouvoir militaire, qui après avoir asservi la trop faible capitale, fait peser son joug sur le plat-pays, ce peuple épars et pour ainsi dire abandonné dans l’immensité d’un désert, dans lequel il ne peut, sans des efforts multipliés, pourvoir à ses besoins physiques, pouvait beaucoup moins s’ occuper avec succès de son existence politique » . C’ était mettre le doigt sur un autre élément encore, qui est capital : le contrôle militaire de la province que les Autrichiens avaient conservé. En des termes plus emphatiques encore que la Lettre d’un citoyen du Luxembourg, le Manifeste de la nation luxembourgeoise s’écriait : » Gémissant sous la verge du despotisme militaire et dans le plus humiliant esclavage, nous avons perdu même la liberté de réclamer en faveur de nos droits… Une démarche quelconque de notre part en faveur de ces grands intérêts, quelque juste et légale qu’ elle pourrait être, exposerait ceux qui oseraient l’avouer publiquement aux traitements les plus atroces de la part du militaire, qui depuis sa déroute dans les autres Provinces belgiques, exerce des cruautés qui font frémir l’humanité » . Laissons de côté les » traitements atroces » et les » cruautés qui font frémir l’humanité » : il n’ en reste pas moins qu’ à Luxembourg tout particulièrement, où la garnison était importante, la surveillance militaire était stricte.
La fidélité des États de Luxembourg, quant à elle, n’a qu’une signification assez médiocre : les États eux-mêmes étaient fort peu représentatifs .
(p.136) En 1830, le Luxembourg – tout le Luxembourg, de Marche à Diekirch – même si on y décèle, nous l’ avons souligné précédemment, un esprit particulariste luxembourgeois particulièrement accentué, manifestera aussi un patriotisme belge ardent. Entre les deux, 1789 ne peut s’ être situé, s’ agissant de la psychologie collective, que dans une continuité.
Septième observation : si le sentiment national cohabite avec des attachements provinciaux, il n’a pas à cohabiter avec des sentiments communautaires – flamand ou wallon – pour la bonne raison que ceux-ci sont, eux, inexistants.
La dualité linguistique au sein des Pays-Bas est évidemment reconnue par les contemporains – comment ne le serait-elle pas ? -mais elle n’ intervient jamais dans les considérations politiques et, surtout, elle ne se traduit jamais par des solidarités de groupes.
(p.137) Les provinces et parties de provinces de langue française, ainsi que leurs habitants, par contre, sont mieux individualisés. Pour Verlooy, il s’ agit là des Walse provincien, des Walse gewesten . Ceux qui les habitent, surtout, portent un nom générique qui a déjà ses lettres d’ ancienneté : ce sont les Wallons.
À l’ époque de la révolution, ce nom est le plus souvent employé, non par les Wallons eux-mêmes, mais par ceux qui les apostrophent, si l’ on ose dire, de l’ extérieur.
(p.138) Huitième observation : nulle part de sentiments communautaires, nulle part non plus de question de langues.
(p.139) Neuvième observation : le sentiment national a pour fondement la conviction, solidement ancrée, que les Belges ont un caractère particulier, un caractère qui leur est propre.
Ce caractère, que d’aucuns appellent le » génie belgique « , on y trouve de multiples allusions , mais on le trouve aussi décrit dans des termes qui montrent combien les Belges ont d’ estime pour eux-mêmes. » Le peuple de la Belgique », nous dit-on, » est le plus doux, le plus patient, le plus humain de tous les peuples de la terre » .
Quel est » l’ esprit des Belges » ? . » Rassasiés comme le lion, ils s’ endorment sur leur bonheur; irrités, ils dressent la crinière, s’unissent de coeur et d’ âme, et se vengent en héros » . L’avocat démocrate Doutrepont, en 1789, exprime des idées qui, sur le plan politique, paraîtront fort avancées, mais, s’ agissant du caractère de ses compatriotes, il reste parfaitement dans la ligne. » Le Belge », écrit-il, » est (p.140) doux, calme et froid. Son caractère naît de la température du climat humide et fertile qu’ il habite. On n’ excite ses passions que difficilement, mais dès qu’ il est poussé à bout, et qu’ on l’ a bien aigri par des injustices, c’ est un Lion sans frein ; ce n’ est plus que par une espèce de miracle qu’ on parvient à le ramener à des sentiments pacifiques que son indignation repousse. Les dangers, les malheurs les plus grands, la perte de ses biens, de la vie, ne l’ effraient plus . il vole au trépas avec intrépidité » .
Qu’il y ait dans tout cela une large dose de stéréotypes, de lieux communs, nul n’ en disconviendra. Mais ce qui est significatif est que l’ on ose recourir à ces lieux communs et à ces stéréotypes sans crainte du ridicule le » caractère » propre aux Belges est chose bien admise, comme allant de soi.
(p.141) /César/. Le Horum omnium fortissimi sunt Belgae constitue en effet sans conteste le certificat d’honneur de la nation. On l’ affiche partout. Les Belges, s’ écrie-t-on, » dont la mâle et nerveuse intrépidité mérite et justifie certainement l’ éloge qu’ en a fait le premier conquérant du monde » . La nation, écrit Verlooy, » a encore cette bonne foi, cette droiture, cette grandeur d’ âme, cet amour de la liberté que passé deux mille ans les Romains reconnaissaient naturels à nos ancêtres » .
Cela s’ écrit en prose, cela s’ écrit en vers. On s’ adresse Aux Belges en leur disant :
« Généreux descendants de ces peuples guerriers
Que la gloire ceignit de ses plus beaux lauriers,
Que Rome redoutoit, et dont César lui-même
Exalta hautement la vaillance suprême » .
Un adverbe récurrent est l’ adverbe toujours. » Cette franchise, cette générosité qui a toujours caractérisé les Belges autant que leur amour pour la liberté,,. » Les Belges furent toujours de tous les peuples les plus justes, comme ils en étaient les plus courageux » . » La nation belgique s’ est toujours distinguée par sa sagesse,… ( par) ce bon esprit qui lui a fait préférer, dans tout temps, ses maximes anciennes aux systèmes de nouveauté,,. » Les sentiments de dévouement, d’union et de générosité qui ont toujours caractérisé les Belges » .
Un Ami des femmes, rédigeant un Précis historique sur les anciennes Belges, rend hommage au sexe féminin pour son rôle, à travers les âges, dans le maintien de la liberté et de son esprit : » Sexe enchanteur, vous ne faites pas moins l’ illustration de la Belgique que les héros citoyens qui l’ ont rendue à la liberté. Si les Belges, le plus ancien des peuples libres, n’ ont jamais perdu la liberté qui est comme un fruit particulier à la terre qui les porte, c’ est parce que les femmes n’ ont pas moins que les hommes travaillé, dans tous les temps, à sa conservation » .
(p.147) Ce sont les Français qui gommeront le pays de Liège et, d’autorité, lui feront partager le sort de la Belgique.
(p.150) Concluons. La révolution brabançonne, une révolution nationale ? Oui, bien sûr, et l’ on peut même dire que, du point de vue national, c’ est une révolution plus claire que celle de 1830.
Que n’ a-t-on pas dit de 1830 ? Qu’il s’ agissait d’une révolution faite par les Wallons, contre le sentiment des Flamands. Que l’ aspiration (p.151) des Wallons était de se réunir à la France, mais qu’ ils en avaient été empêchés par les grandes puissances. Que ces grandes puissances, en fait, avaient seules porté sur les fonts baptismaux une Belgique indépendante. Qu’ elles seules avaient forcé à se réunir en un État artificiel deux peuples, les Flamands et les Wallons, qui avaient peu de points communs. Autant de contrevérités, certes, mais qui, dans un climat de doute croissant au sujet de la nationalité belge, trouvent aussi une audience croissante. Chacune de ces thèses peut d’ ailleurs, si l’ on torture les faits, s’ appuyer sur un semblant de démonstration.
Pour la révolution brabançonne, les faits ne se laissent pas torturer, car ils ne donnent pas la moindre prise à des interprétations imaginatives. Pas la moindre intervention étrangère dans l’ accession du pays à l’ indépendance. Pas la moindre fracture entre Wallons et Flamands – des Flamands dont le nom n’ existe même pas encore. Pas la moindre idée, même, d’ une Belgique qui réunirait deux groupes humains individualisés.
1789 est l’instant idéal, me paraît-il, pour apercevoir, au moment où elle apparaît pour la première fois sur la scène politique, une nationalité belge incontestable, fondée sur un sentiment d’ identité nationale.
(p.160) La Belgique, entend-on souvent dire, est née en 1830-1831 de la volonté des grandes puissances. Ce seraient elles qui, en voulant que la Belgique soit un État indépendant, auraient donné aux Belges leur individualité nationale. Une telle vision est la négation de toute l’histoire authentique de la nationalité belge. Mais puisque le rôle des grandes puissances est évoqué, il faut bien voir que c’est en 1814-1815, en décidant de ramener la France dans ses limites anciennes, qu’ elles ont effectivement sauvé la nationalité belge. Celle-ci, en ce sens, doit bien sa survie au grand jeu de la politique européenne.
(p.169) La Belgique est vraiment, on en a l’ impression, mûre pour tous les partages. Elle les pleurerait, mais les subirait avec résignation . Son salut, en 1814, n’a pas dépendu d’elle-même. C’est la maison d’Orange qui, en revendiquant la Belgique toute entière et en faisant triompher ses revendications, a sauvé l’ unité du pays.
(p.172) Ils se révoltaient contre un souverain qui, cependant, leur avait rendu d’ immenses services. Il est à peine besoin d’y insister : on est d’ accord pour saluer les bienfaits matériels et les progrès intellectuels dont les Belges lui furent redevables.
(p.178) Lors du pétitionnement de 1829-1830, de nombreux villages flamands réclamèrent contre l’ emploi du hollandais, injustement préféré à leur « moedertaal » . « Liberté des langues », demandaient les habitants d’ Anzegem, » Vlaamsch, onze moedertaal, voor ons, Vlamingen. Waelsch of Fransch voor de Waelen; Duytsch voor die van het Hertogdom ( le Luxembourg), en Hollandsch voor die het willen praeten » .
(p.185) En 1814, après le départ des Français, qu’allait devenir le pays de Liège ? Les esprits réfléchis comprirent qu’ un retour à l’ ancienne principauté était impossible. Ils optèrent pour l’ union avec la Belgique. Suivre le sort de la Belgique, tel fut, en 1814, le voeu presque général des Liégeois . Mais en l’ exprimant, ils parlaient encore de la Belgique et du pays de Liège, des Belges et d’ eux-mêmes . La distinction entre les deux pays n’ était pas effacée.
Quinze ans plus tard, elle avait disparu. En 1830, il ne sera plus question, sur les bords de la Meuse, que des Belges et de la Belgique . Liège – comme tout le reste de l’ ancien pays de Liège – se sera entièrement donnée à sa nouvelle patrie. Cette assimilation complète fut l’ oeuvre – involontaire, cela va de soi – du régime hollandais. Quinze ans durant, nous l’ avons dit, le royaume des Pays-Bas fut divisé en deux camps : les Belges d’un côté, les Hollandais de l’ autre. Les Liégeois, tout naturellement, firent cause commune avec les Belges.
Très vite, ils en vinrent à se considérer simplement comme des tenants du camp belge ; les journaux de la Cité Ardente devinrent, au même titre que ceux de Bruxelles ou de Gand, des organes de la « nation belge ‘,. Contre les Hollandais, Liège avait identifié son sort à celui de la Belgique. C’ est en manifestant le patriotisme belge le plus pur que les volontaires liégeois accoururent à Bruxelles, en septembre 1830, pour aider à la défense de la capitale . » Soyons dignes », s’écriait le Politique, » de notre glorieuse renommée. Qu’il soit dit que Bruxelles et Liège ont sauvé la patrie » .
Les Liégeois, devenant des Belges, devenaient aussi, on le notera, des Wallons. On avait longtemps fait une distinction entre les habitants des provinces romanes des Pays-Bas, que l’ on appelait des » Wallons « , et les Liégeois . Cette distinction, désormais, disparaît complètement.
1830
(p.190) Le fait essentiel qu’ il convient de souligner ici, c’ est que l’ exaltation patriotique fut générale ; elle ne se limita ni à certaines provinces ni à certains milieux.
Les provinces wallonnes, sans doute, furent plus exubérantes. À Mons, le 6 septembre, le bruit court que la séparation de la Belgique et de la Hollande vient d’ être votée. L’enthousiasme est grand. Des jeunes gens se réunissent dans un café pour fêter l’heureux événement. (…).
Mais pour être souvent moins bruyantes, les manifestations flamandes témoignent de sentiments tout aussi profonds. À Saint-Nicolas, au début d’ octobre, de simples ouvriers se cotisent pour l’ achat d’ un drapeau belge, « qu’ ils sortent en cortège, précédés d’un violon et d’une clarinette, jusqu’à la chapelle de Notre-Dame située au bout de leur quartier, où ils l’ arborent sur la tourelle, au son de la clochette ». Puis, pieusement, « ils récitent le rosaire pour le repos des âmes des combattants morts à Bruxelles pendant les journées de septembre » . Une telle scène, dans sa simplicité, n’ est-elle pas parlante ?
(p.192) Sans le patriotisme belge, il n’y eût pas eu de révolution : cela est clair. Mais ce patriotisme devait-il nécessairement conduire à l’indépendance nationale ? Lorsqu’ on reconstitue la trame des événements, on peut en douter.
(p.205) En examinant ces absences de tension, qui ont évidemment contribué au succès de la révolution, on doit cependant faire une distinction. Le fait qu’il n’y ait eu ni tension communautaire ni tension de classe a été un phénomène structurel, correspondant en tout cas à une très longue phase de l’évolution de la société belge. L’absence de tension politique, elle, a été conjoncturelle : l’ opposition catholiques-libéraux avait existé précédemment, de manière très nette, et, faut-il le dire, après la révolution, elle en viendra rapidement à dominer, de manière explosive, toute la vie politique. Structure et conjoncture ont donc, ensemble, aidé à la réussite de 1830.
(p.207) Les Belges, qui avaient fait pendant vingt ans partie de la France, devaient évidemment partager ces aspirations, ils devaient soupirer après la mère-patrie. Les Français en avaient la certitude morale, et une certitude morale est plus forte qu’ une certitude intellectuelle. D’ ailleurs, un concert incessant de protestations d’ amitié pour la France ne s’élevait-il pas de toutes les régions de la Belgique ? Il n’ en fallait pas plus aux Français pour se sentir confirmés dans leur opinion.
Au wishful thinking de nos voisins du Sud, la réalité des faits opposait cependant un démenti.
Dès le début de la révolution, le ministre d’ Autriche mandait à son gouvernement : » La presque totalité des Belges ne désire pas d’ être réunie à la France » . Parlant plus spécialement de Liège, un témoin avisé observait à peu près à la même date. » À aucun moment de cette crise, nulle voix ne s’ est élevée en faveur de la France dans cette province qui y a le plus de relations » .
Plus tard, lorsque la situation du pays se fut stabilisée, on put apercevoir clairement où se localisaient les réunionistes. Au début de 1831, ils contrôlaient quatre journaux : le Journal de Verviers à Verviers, le Journal de la province de Liège et l’Industrie à Liège, l’Eclaireur à Mons .Verviers, Liège et le Hainaut : tels étaient les centres de leur influence.
À Verviers, ils dominaient. La Régence de la cité, en décembre 1830, se prononça pour la réunion, et les pétitions réunionistes se couvrirent d’ une foule de signatures. Un des défenseurs les plus intransigeants de l’indépendance belge, Jottrand, le reconnaissait honnêtement à la tribune du Congrès : » À Verviers, les pétitions pour la réunion sont évidemment l’expression de l’opinion de la majorité » . Dire » Verviers », en 1830, c’ était penser « la draperie ». La vie de la cité se résumait dans son industrie drapière. L’industrie drapière voulait la réunion.
À Liège, c’ étaient des industriels aussi qui étaient les grands protagonistes de la solution française. Mais alors qu’à Verviers, les fabricants entraînaient leurs ouvriers , les industriels liégeois réunionistes avaient peu de prise sur la classe ouvrière. Ce n’ étaient pas des leaders. Dans leur propre milieu, ils se heurtaient à des partisans de l’indépendance nationale, et à des orangistes.
(p.208) Il en était de même dans le Hainaut. Mons, avec ses 23.000 habitants ne fournit que 2 ou 300 signatures aux pétitions réunionistes . Dans d’ autres localités hennuyères, la proportion des signataires fut beaucoup plus considérable : une centaine d’habitants à Fontaine-l’Evêque, 141 à Dour, 124 à Morlanwelz. La valeur de ces chiffres reste cependant sujette à caution : les manufacturiers ou les patrons de charbonnages n’ avaient-ils pas recueilli parmi leurs ouvriers des signatures plus ou moins obligées ?
Quelle qu’ ait été la force numérique exacte du » parti français « , celle-ci n’ offrait d’ ailleurs qu’une importance secondaire. Le parti ne vivait pas du nombre de ses sympathisants : il avait pour lui la puissance économique. Comme à Verviers, comme à Liège, il se recrutait dans la classe industrielle et commerciale. En Hainaut, les patrons charbonniers, les fabricants de fer, les marchands de toile étaient fréquemment des réunionistes, avec une prédominance de tous les hommes liés à l’ industrie charbonnière . » Faction riche et puissante » disait leur ennemi, l’Observateur de Mons . Faction dangereuse aussi, puisque l’Observateur se voyait forcé de mener contre elle unepolémique incessante : aux yeux de l’ organe montois de l’ indépendance, les riches » gallomanes » constituaient une menace.
(p.209) Avec le Luxembourg, nous avons achevé le tour de Belgique du réunionisme. Dans le Brabant wallon, le Namurois, la Hesbaye, on n’ observe rien, ou presque rien. Bruxelles était le pilier de l’ indépendance belge. Les provinces flamandes, si l’ on excepte un groupuscule à Courtrai, ne manifestaient dans leur ensemble aucune velléité française .
Dominant à Verviers, diffus dans le Luxembourg, minoritaire à Liège et dans le Hainaut, extrêmement faible ou inexistant partout ailleurs, on voit donc que le réunionisme ne groupait pas un bien puissant faisceau d’ opinions. Charles Rogier pouvait à bon droit déclarer au Congrès National, en janvier 1831 : . « Plusieurs partis divisent la Belgique . telle est la suite inévitable des révolutions. Ces partis sont : les orangistes, les Français, les anarchistes. La masse de la nation les repousse tous » .
(p.215) La Belgique de 1830 était francophile, avec ardeur. Dans « cet amour, cette sympathie, cet entraînement pour la France », comment eût-on pu marquer les réunionistes au fer rouge ?
Le mouvement réunioniste n’ eut pas la vie longue. Dès la fin de 1831, il avait cessé de compter. À partir de 1832, on n’ entend plus parler de lui. La majorité des réunionistes se rendirent très vite à l’ évidence des faits. Ils avaient estimé l’ indépendance belge non viable. La Belgique indépendante vivait. Ils se convertirent à l’ indépendance.
(p.227) / Les Français :/ Ils ignorent la nationalité belge. Entre la France et le Rhin, ils n’aperçoivent pour la plupart, suivant le mot de Devaux, qu’ « un territoire sans nationalité, une espèce de terrain vague sans dénomination propre, sans propriétaire fixe, appartenant à qui peut le prendre, passant depuis des siècles d’ un conquérant à un autre ». » Les Belges! », s’écrie Guizot, » on appelle ça un peuple ! c’ est-à-dire qu’ils jouent au peuple!,,. Talleyrand n’est pas moins méprisant : » un assemblage de vagabonds couards, indignes d’ être indépendants » . » Ce n’ est pas une nation « , déclare-t-il, » deux cents protocoles n’ en feront jamais une nation » . Pays sans nationalité, la Belgique est évidemment un État sans avenir. » Chacun », note en 1834 un agent du roi Guillaume à Paris, » chacun est bien convaincu de l’inviabilité du royaume belge, que l’ on ne cesse de regarder que comme quelques départements échappés à la France et qui doivent lui retourner s’ ils ne reviennent pas à la Hollande » . L’État belge n’ est pas viable : c’ est là une des vérités dont se nourrit le Français moyen, dont se nourrissent même les hommes d’État. J.B. Nothomb écrivait en 1871 – et il n’est pas du tout sûr que ce fût par manière de plaisanterie – qu’ au cours de sa carrière déjà longue, il n’ avait rencontré que deux Français qui
acceptassent l’indépendance de la Belgique : Louis-Philippe et Guizot.
LES MYTHES DE 1830
(p.228) Il est peu de révolutions qui soient, dans le fond, aussi simples que la révolution de 1830. Une révolution nationale et libérale, et pratiquement tout est dit.
Et pourtant, il est peu de révolutions qui aient donné lieu à autant de déformations, à autant d’ interprétations qui équivalent à de véritables légendes, à de véritables mythes.
Nous avons déjà évoqué deux de ces mythes : celui de la révolution « prolétarienne » confisquée par la bourgeoisie ; celui de la révolution faite par des Wallons contre le gré des Flamands.
Le caractère « wallon » – ou disons mieux : pseudo-wallon – de la révolution, on le notera, a pris, de par la décision d’ un congrès wallon, figure officielle. La date anniversaire des journées de septembre est devenue en 1913 la date de la fête de la Wallonie, pour être choisie ensuite en 1975 comme fête de la Communauté culturelle
française, qui deviendra elle-même en 1980 la Communauté française de Belgique. Ceci aurait bien fait rire sans doute les « Brusseleirs » flamands qui se sont battus sur les barricades.
Mais du côté de certains Wallons, on a été parfois plus loin encore dans l’interprétation : oui, dit-on, ce sont avant tout desWallons qui ont fait la révolution – mais ce qu’ils voulaient en fait était de retourner à la France, de redevenir Français, et ce sont les grandes puissances qui les en ont empêchés. Cette thèse ne peut se soutenir, bien (p.229) entendu, qu’ en grossissant jusqu’ au ridicule l’ importance du « réunionisme ». Pareil grossissement n’ est pas difficile à opérer : il suffit de prendre à la lettre ce que disaient souvent les réunionistes eux-mêmes. Il suffit par exemple de prendre à la lettre ce qu’ écrivait le Journal de la province deLiège du 23janvier 1831 : parmi la « diversité des opinions », « un voeu semble pourtant prévaloir, et les provinces wallonnes inclinent visiblement pour la France. Elles voient un retour à leur vraie nationalité dans leur retour au pays dont la politique des rois les a seule tenues séparées » . Ceci, nous l’ avons vu, avait peu de rapport avec la réalité.
Les grandes puissances, quant à elles, se sont vu fréquemment attribuer – et ceci est une autre légende – un rôle dans les événements de 1830-1831 qui n’a nullement été le leur. Ce sont elles, dit-on, qui ont voulu la création de l’État belge, qui l’ont même littéralement créé, qui ont imposé à la Belgique son indépendance, qui ont forcé les Flamands et les Wallons à vivre ensemble au sein d’ un même État. Ceci est la vérité à l’ envers.
Les grandes puissances ont dû accepter l’ indépendance de la Belgique – et certaines d’ entre elles plus qu’à contre-coeur – parce que les Belges s’étaient révoltés. Certes, dans un premier temps, la France a dû agir contre les puissances conservatrices pour les empêcher de réprimer la révolution, et dans un second temps, la Grande-Bretagne a dû agir contre la France pour empêcher la Belgique d’ être divisée, mais le fait premier était la révolution elle-même, avec la volonté d’ indépendance nationale qui s’ y manifestait.
Enfin – et ceci est sans doute l’ essentiel -, le fruit de la révolution, l’État belge, est décrit comme un « État artificiel », « factice », « hybride ».
Une telle assertion sous-entend en fait qu’ il y ait eu, avant la création de la Belgique, un « peuple flamand » et un « peuple wallon ».
Certains l’ affirment explicitement. Beaucoup d’ autres le pensent. Le Président de l’Exécutif flamand, en 1987, explique que « la Flandre existe depuis des siècles, la Belgique depuis un siècle et demi » .
Ceci est, une fois de plus, la vérité à l’ envers. La Flandre et la Wallonie, le « peuple flamand» et le « peuple wallon » sont, pour l’historien, des sous-produits de la Belgique.
La seule question est de savoir si la réunion en un seul État de populations de langues différentes était en quelque sorte un » accouplement contre nature ». Tout d’ abord, soulignons-le, ce sont ces (p.230) populations elles-mêmes qui, en 1830, ont voulu vivre ensemble, comme belges, qui ont voulu cet accouplement. Pouvaient-elles pressentir leur prise de conscience collective ultérieure, et surtout le développement ultérieur du nationalisme linguistique ?
Sachons le voir clairement : le caractère » artificiel » de l’État belge de 1830 ne peut être décrété tel qu’ en vertu d’ une définition : la définition de la « nature » comme la langue. Aucun Belge de l’ époque de la révolution n’ avait l’ idée d’ une telle définition.
(p.232) Une enquête sur les origines lointaines des individualités nationales dans nos régions aboutit donc à mettre l’ accent sur le rôle primordial de l’État dans la formation de ces nationalités. Elle aboutit, par le fait même, à placer la Belgique, elle aussi, au même rang que les autres nationalités européennes. La Belgique, née de l’État, a obéi au processus de formation commun à toutes les nationalités d’ Ancien Régime. Elle a suivi la règle générale.
L’État n’ explique pas seulement les origines de notre nationalité. Il fournit aussi la clé de ses avatars.
Pourquoi la nation néerlandaise, qui apparaît au XVIe siècle comme animée d’une solidarité puissante, se disloque-t-elle au siècle suivant et donne-t-elle naissance à deux nations distinctes, Hollande et Belgique ? Pourquoi les habitants de l’ Artois, de Lille ou de Maubeuge, de Belges patriotes qu’ ils étaient avant la conquête française, se transforment-ils après la conquête en Français non moins patriotes ? Pourquoi les gens de Vianden et d’Echternach, qui se considéraient avant 1839 comme des Belges de la même qualité d’ âme que leurs compatriotes brabançons ou hennuyers, se sont-ils changés ensuite en étrangers ? Pourquoi les Limbourgeois d’ Outre-Meuse, excellents Belges à l’époque de la révolution de 1830, sont-ils devenus ensuite de bons Hollandais?
À ces questions, la réponse est toujours essentiellement la même : l’État est intervenu. D’autres facteurs, cela va de soi, ont aussi joué : la séparation de la Belgique et de la Hollande n’ aurait pas été ce qu’ elle fut sans le divorce religieux entre le Nord et le Sud des Pays-Bas. Mais par-dessus les facteurs religieux, économiques, culturels, c’ est toujours l’État qui a eu le dernier mot.
Si l’État explique, dans une mesure décisive, l’ évolution du sentiment national, le sentiment national, lui, explique la Belgique.
(p.233) Sans la force de l’ idée de patrie, sans la force du sentiment national, il n’y aurait pas eu de Belgique en 1830. Rien n’ est plus aisé à démontrer. La révolution qui éclate en 1830 vient après trente-cinq années pendant lesquelles-sauf un très court intermède en 1814, quand les Alliés installèrent un gouverneur général de la Belgique – il n’y a plus eu de Belgique politique, pendant lesquelles les Belges n’ ont possédé aucune institution, aucune magistrature propre qui ait pu leur rappeler leur qualité de nation. Et pourtant, la révolution éclate, et elle est nationale. C’est que, de 1795 à 1830, une Belgique a continué à vivre : la Belgique morale, celle qui conservait précisément une conscience propre. De cette Belgique-là, et de celle-là seule, a pu jaillir l’État indépendant de 1830.
Le sentiment national a souvent contribué de manière puissante à la cohésion de l’État.
Mais il n’ en a pas été le seul facteur de conservation, ni même toujours le plus important.
Prenons à cet égard un exemple concret : celui de la crise de 1477.
C’est une des grandes crises de notre histoire. Charles le Téméraire, dont la politique dure et autoritaire a mécontenté les populations néerlandaises, meurt en laissant comme héritière une jeune fille de vingt ans. Tous ceux qui ont courbé la tête devant le terrible duc se redressent aussitôt. Ils assaillent la duchesse de réclamations souvent menaçantes. De gré ou de force, Marie doit consentir au rétablissement de tous les privilèges qui avaient été battus en brèche par son père, voire par Philippe le Bon. Des institutions centralisatrices créées par les ducs, un bonne partie s’ effondre; le particularisme provincial et local reprend le dessus. À l’ extérieur, le danger est plus grave encore. Après quelques feintes, Louis XI passe à l’ attaque. Les troupes françaises envahissent l’ Artois et le Hainaut, poussant vers le Nord. Elles parviennent jusqu’ à Tournai, menacent la Flandre. Et pourtant, dans cette tempête, l’État bourguignon résiste. Loin de se disloquer, il demeure debout et maintient son unité. Pourquoi? Parce qu’ il existe déjà, dira-t-on, un embryon de sentiment national, parce qu’il existe déjà un certain idéal d’unité. Les faits confirment cette explication : les représentants des différentes principautés, assemblés à Gand, arrachent à la souveraine toute une série de concessions, mais ils les font consigner dans un privilège général – le (p.234) fameux Grand Privilège du 11 février 1477 -, valable pour l’ ensemble de l’État bourguignon.
Bien plus, tout en restaurant les autonomies provinciales et locales, ils s’ accordent à maintenir des organes de gouvernement communs à toutes les provinces : ils veulent donc le maintien de la vie commune.
Mais l’ essentiel n’ est pas là. Bien plus qu’un certain sentiment national, encore peu affirmé, ce qui sauve en 1477 l’État bourguignon, c’ est le loyalisme dynastique. C’est parce que leur loyalisme – un sentiment puissant, qui accuse encore les traits burinés de la fidélité féodale – commande également l’ attitude des Brabançons, des Hennuyers et des Hollandais, que tous restent groupés autour de Marie et que l’État subsiste. La parole décisive, en l’occurrence, a été prononcée par le juriste qui a dit : » Est notoire que feu monseigneur le duc Charles a delaissié maditte dame sa fille unique heritier universel, seulle et pour le tout abille a luy succeder en tous les ducéz, contéz, pays, villes et seignouries dessusdittes » . De là vient que tous ses sujets veulent « leaument servir la dame et l’iretage qui lui doit partenir ».
(p.236) Que l’ on voie la manière dont sont ordinairement traités dans les ouvrages généraux les conflits anglo-français du moyen âge, ou encore les guerres d’Italie. Les historiens français louent les Capétiens et les Valois d’ avoir lutté pour bouter les Anglais hors de France. Les rois d’ Angleterre n’ ont qu’ à s’ en prendre à eux-mêmes de leur échec; en essayant de fonder un État anglo-français, ils poursuivaient la réalisation d’ une « chimère ». Quand on arrive aux guerres d’Italie, le choeur des lamentations se déchaîne : aux rois de France, cette fois, d’entendre leur politique taxée de déraison et de chimère. Au lieu de poursuivre la politique d’expansion vers l’ est et vers le nord qui répondait aux intérêts de la France, Charles VIII, Louis XII et François Ier se sont laissé attirer par le mirage italien, et ont gaspillé les forces et les ressources de la nation dans de folles entreprises. Leurs guerres de magnificence, aussi inutiles que coûteuses, ont provoqué un arrêt d’ un demi-siècle dans la formation de la France moderne. Faute impardonnable, et qui ne leur est pas pardonnée.
Réfléchissons un instant à ces jugements, et recherchons-en le fondement. Le fondement ? Il est essentiellement dans un postulat naïf et instinctif. ce qui est arrivé – c’ est-à-dire, en l’occurrence, la constitution de la France sous la forme que nous lui connaissons – devait arriver, toute tentative de faire autre chose que cette France-là sur le sol de l’Europe était donc une « chimère » vouée à l’insuccès.
Et pourtant, si l’État plantagenet avait vécu… ; si les guerres d’Italie avaient réussi et que, par conquêtes et acquisitions successives, les rois de France avaient réussi à réunir sous leur sceptre tout le Nord de la péninsule… Eh bien! Nous lirions aujourd’hui dans nos manuels l’ éloge des souverains anglais qui, conscients des destinées (p.237) communes de l’ Angleterre et de la France de l’ ouest, parvinrent à sauvegarder l’unité de leur État contre les entreprises chimériques des Capétiens et des Valois ; ou encore, nos historiens loueraient Charles VIII et Louis XII d’ avoir compris que la véritable vocation de la France était de réunir en un seul État, en une seule nation, les deux Gaules de l’ Antiquité romaine, la Cisalpine et la Transalpine.
Je raille, dira-t-on? Non pas, j’attaque par l’absurde une attitude d’ esprit qui fait de réels ravages. Car lorsqu’un professeur aussi distingué que Jules Isaac enseigne à la jeunesse française que, en 1700, Louis XIV avait à choisir entre l’ aventure de la succession d’Espagne et un traité qui, en lui permettant d’ acquérir la Lorraine et la Savoie, assurerait « l’achèvement de la France » ;, lorsqu’un historien de la taille de Michelet décrit les acquisitions territoriales de Louis XIV dans les Pays-Bas comme « la conquête de quelques provinces qui, tôt ou tard, nous venaient d’ elles-mêmes » , ils ne parlent en réalité pas autrement que Gaston Roupnel. Ils tombent dans le même fatalisme naïf.

Jean Stengers, Eliane Gubin, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918, TOME II - Le grand siècle de la nationalité belge, éd. Racine, 2002
Jean Stengers, Eliane Gubin, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918, TOME II – Le grand siècle de la nationalité belge, éd. Racine, 2002
(p.37)
Face à cette menace française, la réaction est nationale : c’est la nation belge qui refuse de voir son indépendance mise en cause. » Le sentiment de la nationalité domine maintenant ici tous les autres « , écrit dès le 29 février le ministre d’Autriche à Bruxelles. Le même jour le Roi écrit à un de ses neveux : » Le pays se montre national au-delà de mon attente 75. » La Reine dans une lettre écrite à sa mère le 5 mars manifeste, s’agissant de la Belgique, les mêmes sentiments de satisfaction : » Tout marche ici très bien et l’attitude du pays est parfaite. L’union est dans tous les coeurs et l’ on peut dire que le pays s’ est serré comme un seul homme autour de Léopold pour le maintien de son existence et de sa nationalité 76. «
(p.38) Au premier rang de ceux qui participent aux manifestations patriotiques figurent les premiers flamingants, qui ont d’autant plus de raisons de vouloir l’indépendance du pays que la France leur fait, comme flamingants, particulièrement peur. Le journal flamand De
Eendragt célèbre « onze dierbare nationaliteit ». À Gand retentissent les accents vigoureux du Vlaamse Leeuw .
Zy zullen hem niet temmen / Den fieren Vlaemschen Leeuw
[Ils ne le dompteront pas, / Le fier lion flamand/ .
(p.40) Avant d’en arriver à 1860 qui est notre second cas important, faisons une courte halte en 1859. Jules Devaux, qui vient d’être nommé secrétaire du Roi mais qui est surtout, comme son père Paul Devaux, un libéral bon teint, se méfie des catholiques et de l’attraction que pourrait exercer sur eux la France de Napoléon III, admirée comme protectrice du pape. En août 1859, il écrit au baron (p.41) Beyens . « La France travaille énormément la droite, où il y a quelques bien mauvais sentiments. Nothomb (il s’agit de l’ancien ministre Alphonse Nothomb) est sénateur français, cela est évident. Les populations du Hainaut et du Namur sont aussi très travaillées par des agents français. Mais cela est peu important, le gros du pays est nationalissime ( et Devaux souligne vigoureusement nationalissime).»
(p.47) Et dans une autre note datée de mai 1865, quelques mois avant son avènement, le duc /de Brabant/ écrit. « La Belgique, libre seulement depuis 1830, a avant comme après cette époque subi de nombreuses amputations : Picardie, Artois, Bourgogne, Flandre zélandaise, Limbourg, Luxembourg, … etc. C’est en Orient qu’il faut rendre à la Patrie ce que nous ne pouvons reconquérir pour Elle en Europe . »
(p.58) Cette variété dialectale fondamentale donne lieu de la part des francophones à des remarques variées. Les unes collent avec un certain réalisme à la situation de fait. Ainsi Pierre-François Claes, membre du Congrès National, écrit en 1830. « Notre bon et respectable flamand ne se partage pas en deux ou trois dialectes ; il s’éparpille de ville à ville et de bourg à bourg en une multitude de modifications qu’avec un peu d’impolitesse on pourrait appeler jargons, se diversifiant partout de tant de manières que c’est à ne pas s’y reconnaître, et de telle sorte que la langue écrite se trouve être précisément la seule qu’on ne parle nulle part.» Mathieu Leclercq, parlant à l’Académie, se montre plus condescendant; il caractérise le flamand comme « un idiome, intéressant peut-être archéologiquement et (p.59) philologiquement parlant, mais d’un usage borné à un petit coin de la terre et y variant pour ainsi dire de village à village ».
Sachons un peu anticiper les choses. La vraie unification du flamand écrit et du flamand parlé surmontant la variété des dialectes n’interviendra que fort tard au XXe siècle grâce aux progrès de l’enseignement, grâce surtout aux progrès de la presse et ensuite de la radio et de la télévision. À ce moment seulement, le flamand accédera au rang de néerlandais, langue de culture uniforme sous une forme écrite et parlée également de façon en gros uniforme.
(p.62) Plaintes flamandes spécifiques
Elles émaillent régulièrement les pages de certains journaux flamingants et sont mises en valeur dans des interventions parlementaires.
Ce qui est en cause essentiellement est la présence en pays flamand d’agents et de fonctionnaires ignorant le flamand. Tantôt on s’indigne de ce qu’un substitut soit nommé à Audenaerde sans connaître un mot de flamand. Tantôt on relève avec non moins d’indignation
que deux receveurs des contributions wallons à Anvers ignorent le flamand; tantôt on dénonce le fait qu’un notaire sans connaissance du flamand ait été nommé à Ypres , tantôt on se risque à dresser une petite statistique locale : à Lierre, dont les neuf dixièmes des 16 000 habitants ne connaissent pas le français, un député, en mars 1878, fait le compte des employés ( « fort respectables, du reste, et dont quelques-uns même sont de mes amis», dit-il) qui ne savent pas un mot de flamand ; il s’agit du sous-chef de gare, d’un des employés de la station, du percepteur des postes, du commandant de la gendarmerie et du conducteur des ponts et chaussées. Cependant, plusieurs catégories de membres du personnel officiel sont surtout visés : les agents du chemin de fer, parmi lesquels même des chefs de gare sont brouillés avec la langue flamande ; des agents de la poste, des (p.63) agents des contributions, des douaniers notamment du port d’Anvers (on en compte 34, dit-on, en 1862 à ne connaître que le français) 178. et principalement des gendarmes dont le cas paraît parfois particulièrement criant car leur ignorance de la langue les empêche de remplir convenablement leur tâche.
. « À tout instant, De Baets dit à la Chambre en décembre 1861, dans nos communes des Flandres, on se trouve en face de gendarmes ne sachant pas un mot de flamand. Pour ma part, j’en ai vu plus de douze. Ces messieurs sont chargés de rechercher les auteurs de crimes et délits, et ils se trouvent au milieu d’une population qu’ils ne comprennent pas et dont ils ne sont pas compris. »
Delaet, quelques années plus tard, souligne que « la présence des gendarmes wallons dans les Flandres donne lieu à des inconvénients souvent très graves, quelquefois navrants… À chaque instant voici ce qui arrive. Un individu qui ne parle que le flamand est appréhendé sous un prétexte quelconque par un gendarme wallon qui ne parle pas le flamand. Il est clair que l’individu arrêté sans savoir pourquoi n’est pas content. Il regimbe et réclame. Comme le gendarme wallon ne le comprend pas, celui-ci prend toutes ces réclamations pour des injures et s’il ne peut pas dresser procès-verbal à propos d’une contravention quelconque qui n’existe pas, il verbalise pour résistance à la gendarmerie, à la police, et le Flamand n’en est pas moins
condamné . Cela arrive souvent, trop souvent. »
Un rapport arrivé au parquet d’Anvers le 12 février 1860 venant de Campine se terminait par les mots suivants : « Voilà, M. le procureur du Roi, tout ce que j’ai pu recueillir concernant cette affaire, et avec beaucoup de peine, à cause que je ne sais pas le flamand, et que la
plupart des autorités ne parlent- pas le français . »
Ces plaintes et ces griefs s’amplifieront dans les années suivantes lorsque la Chambre comptera en son sein un spécialiste de la récrimination en la personne d’Edward Coremans qui fera retentir dans l’Assemblée ses attaques souvent virulentes.
(p.67) Situation des Flamands et situation des Wallons
La situation des Flamands ne connaissant pas le français, ou encore faute de pratiquer autre chose que leur dialecte, ne connaissant pas le flamand des autorités, a été souvent difficile. Cependant, à y bien réfléchir, la situation n’était pas fondamentalement différente en Wallonie : la masse des Wallons, paysans et ouvriers, qui ne parlaient que le wallon – et qui étaient la grande majorité – éprouvaient les mêmes difficultés que beaucoup de Flamands. Un orateur remarquait à la Chambre en 1887. » On dit : les Flamands de la basse classe ne comprennent pas le flamand littéraire ! Je réponds : les Français (entendez les Wallons) du vulgaire ne comprennent, pas plus que les Flamands de la même catégorie, la langue littéraire quelque peu relevée. »
Impossible ici de fournir des chiffres précis car les statistiques de l’emploi du wallon face au français sont inexistantes. On aurait cependant tort de croire que l’usage préférentiel du wallon se limitait aux classes populaires. Une enquête faite en décembre 1920 auprès d’environ 900 administrations communales de Wallonie aboutissait encore à la constatation suivante : » Sur 100 communes, il y en a 73 où plus de 90 % de la population se sert de préférence du wallon ;
18 où cette proportion va de 50 à 90 %; une où elle est de 25 à 50 %, et 8 seulement où elle est inférieure à 25%. D’autre part, sur 100 (p.68) conseils communaux wallons, il n’y en a que 43 où l’on parle exclusivement le français ; le wallon est utilisé dans 56 conseils, à savoir :
concurremment avec le français, dans 33; comme unique langue de discussion, dans 23. «
Les témoignages sur les difficultés éprouvées par les Wallons, notamment devant les tribunaux au XIXe et au début du XXe siècle, émanent surtout à la Chambre de juristes qui ont une connaissance directe des faits. Ainsi Jules Bara déclarait à la Chambre en 1866. « Les juges français ne saisissent pas tout ce que disent les paysans wallons qui viennent déposer devant les tribunaux, de même que les paysans wallons ne comprennent pas tous les procureurs du Roi qui s’expriment en français. » Frère-Orban dit de son côté en mai 1878 : « Devant nos tribunaux, on entend journellement des prévenus ou des témoins qui sont des Wallons et qui ne comprennent pas ou qui comprennent fort mal les questions qui leur sont posées en français. Aussi les magistrats sont-ils obligés de les interroger en wallon. » Il répète en 1887 : « Je fais ici appel à tous mes collègues des provinces wallonnes. Tous les jours, devant les tribunaux, en police correctionnelle, on est obligé de parler le wallon aux témoins pour pouvoir se faire comprendre. Cela est incontestable ; cela se passe journellement, malgré les développements pris par l’enseignement primaire. Ces populations, qui ont été à l’école primaire, ne parlant jamais que le wallon ont oublié ultérieurement le français qu’elles y avaient appris ou le comprennent très mal.» En 1888, le député Dupont confirme : « Tout avocat qui a pratiqué dans le pays wallon, sait que les prévenus qui comparaissent ou les témoins qui sont entendus en justice, se trouvent la plupart du temps dans l’impossibilité de s’exprimer en français et que le prévenu comprend souvent très difficilement la langue française parlée par le ministère public ou par son avocat. »
Il y aura cependant une grosse différence entre la situation de la Flandre et celle de la Wallonie. Les premiers flamingants se plaindront de la tyrannie du français. Les premiers wallingants, s’ils défendent presque toujours la cause de la langue et de la littérature wallonnes, ne s’ en prendront jamais pour leur part au français.
Celui-ci jouit d’ un prestige qui le protège de toute attaque. On eût pu dire légitimement dans beaucoup de cas : Pauvres Wallons ! mais on ne le dit pratiquement jamais car c’eût été désacraliser le français.
(p.71) Le patriotisme des flamingants
Ce patriotisme est affirmé par tous et avec vivacité. La figure emblématique est ici celle du chanoine David qui achève laborieusement une Vaderlandsche Historie – et le fonds qui portera son nom, le Davidsfonds, aura pour devise : « Godsdienst, Taal, Vaderland. »
Le patriotisme est égal chez les catholiques et chez les anticléricaux. Ils se targuent tous d’être les meilleurs parmi les Belges : ceux qui, par l’originalité de leur culture, se démarquent le mieux de la France et constituent le rempart le plus solide contre la contagion française. Cet éloignement moral de la France est souvent cité comme un facteur national par excellence. Monseigneur de Ram, le recteur de l’Université de Louvain, exprime cette idée en 1840 en une formule ramassée : « La langue flamande est le plus ferme soutien de la nationalité de la Belgique214. » Un libéral anversois dit de même : « Conserver la nationalité flamande, c’est le seul moyen de conserver l’indépendance de la Belgique. » Le Journal d’Anvers décrit la
« nationalité flamande » comme la « base essentielle de la nationalité belge». Du baron Jules de Saint-Genois, De Decker disait dans son éloge funèbre de 1867. « Il avait une prédilection instinctive pour cet élément flamand dont le développement importe tant à la conservation de notre caractère national et de notre indépendance politique. »
Le sentiment de constituer le rempart de la nationalité belge est renforcé chez de nombreux catholiques, et notamment chez des prêtres, par la conviction qu’ il s’ agit là aussi du meilleur moyen de se protéger contre les idées françaises et de conserver à l’abri les mœurs et les croyances catholiques. Un des poèmes du prêtre de Bo s’intitule « Voor Godsdienst en Vaderland » et il célèbre les Flamands comme les « enfants les plus pieux » de leur pays.
(p.85) Il n’y a aucune trace, en tout cas, de l’esquisse même d’une révolte wallonne. En 1894, il n’ est pas question de parler déjà , en termes de communautés : on voit les choses avant tout sous l’ angle national.
Les réactions socialistes sont particulièrement frappantes : la Fédération gantoise du POB, au lendemain de l’élection qui avait donné un siège sur la liste socialiste liégeoise à Anseele, écrit à ses amis liégeois : » La nouvelle de votre victoire a été saluée par les ouvriers gantois avec joie et enthousiasme. Vous avez bien mérité du progrès en général et du socialisme qui est sa plus pure expression.
Grâce à votre admirable esprit de solidarité, les ouvriers flamands auront une représentation au Parlement belge… Les ouvriers et une grande partie de la bourgeoisie de Liège ont passé à côté et au-dessus de cet esprit de race, étroit et mesquin, en faisant triompher notre ami à tous Édouard Anseele… Merci aux citoyens qui ont fait taire l’amour du clocher devant cette solidarité prolétarienne et socialiste qui unit les Wallons et les Flamands, qui unit le peuple travailleur du monde entier…. Encore une fois, mille fois merci, frères liégeois, pour votre noble et fière attitude…Vive nos frères liégeois ! » » Solidarité prolétarienne », dit-on dans cette adresse. Mais aussi – les mots sont dans le texte – solidarité » qui unit les Wallons et les Flamands. » Cela, c’est le climat de 1894.
(p.89) Le temps des « affaires »
Mais surtout, la loi fut l’aboutissement d’ une série d’ affaires qui, habilement exploitées par les associations flamandes, permirent de sensibiliser l’ opinion publique. La plus célèbre, l’affaire Coucke et Goethals – deux Flamands condamnés à mort par la Cour d’Assises du Hainaut et dont la culpabilité fut remise en doute après leur exécution – créa une véritable émotion. Elle alimenta le mythe de deux Innocents, exécutés sans avoir compris un traître mot à leur (p.90) procès. L’affaire était aussi reprise dans la presse francophone où partisans et adversaires de la peine de mort se déchaînèrent presque quotidiennement au début de 1862.
Dès l’année suivante, l’affaire Karsman relançait la question de l’usage du flamand en justice. Jacob Karsman, un diamantaire et publiciste anversois, avait été condamné à 5 francs d’amende pour avoir publié un pamphlet antimilitariste sans nom d’éditeur responsable. Il avait interjeté appel. Devant la Cour d’Appel de Bruxelles, son avocat, Julius Vuylsteke, un des leaders du libéralisme flamand, se vit refuser de plaider en flamand. Karsman quitte alors l’audience et est condamné par défaut à trois mois de prison. Ce jugement provoqua l’indignation dans les milieux flamands, et de gros remous jusque dans le monde judiciaire.
Après l’essai infructueux de Jan Delaet en 1867, il faut attendre le 13 avril 1872 pour qu’Edward Coremans dépose une proposition visant à régler l’emploi des langues en matière pénale, tandis qu’une troisième affaire, l’ affaire Schoep permettait au mouvement flamand
d’exercer une pression forte sur la Chambre.
Schoep, un ouvrier molenbeekois, avait été condamné en février 1872 à 50 francs d’amende et aux frais du procès pour avoir refusé d’enregistrer la naissance de son enfant en français. La Cour d’Appel de Bruxelles avait confirmé le jugement et la Cour de Cassation, où Schoep fut défendu par Edmond Picard, avait rejeté le pourvoi. Cette affaire n’avait ni la dimension tragique ni l’ampleur de l’affaire Coucke et Goethals ; elle concernait l’emploi des langues dans l’administration et non la justice pénale visée par la proposition de Coremans, mais elle venait à point nommé pour mobiliser les forces flamandes et frapper l’opinion publique.
L’agitation fut systématiquement organisée à partir de février 1873 ; elle culmina entre le 25 et le 31 mai 1873 dans un mouvement pétitionnaire orchestré par plus de trente sociétés flamandes. Le 29 juin, une manifestation groupant près de 10 000 personnes parcourt les rues de la capitale, bannières flamandes en tête , en chantant le Vlaamsche Leeuw. Un meeting à l’Alhambra clôtura la journée; on entendit des déclarations fracassantes et même quelques appels à « défaire les liens de 1830275 ». Cette brusque f1ambée de colère flamande fut jugée intolérable par une presse francophone, toutes opinions confondues, unanime à condamner
ces violences verbales .
(p.93) De fait, la loi de 1873 marque bien une fin – mais pas celle souhaitée dans les milieux politiques. Elle marque la fin (ou pour être plus précis, le début de la fin) d’un État belge entièrement francophone, même si, à l’instar de nombreuses lois linguistiques qui allaient à l’encontre de la situation réelle des langues, elle n’ a connu qu’une application partielle. Les avocats et les prévenus continuèrent en effet à demander la procédure en français. Si les choses changèrent, ce fut très lentement, trop lentement au gré des flamingants qui dénonceront sans relâche la persistance des abus.
(p.94) Il convient enfin de souligner d’emblée qu’en 1873, le souci du législateur fut avant tout de répondre à une préoccupation pratique : que l’inculpé comprenne ce qui se passe à son procès lorsqu’il comparaît, puisque sa liberté – voire sa vie – sont en cause. Cette loi de 1873 sera d’ailleurs suivie par une série d’autres visant à l’améliorer.
En revanche, en matière civile, il faudra attendre 1935 (soit soixante ans plus tard !) pour que l’on règle l’emploi des langues, en harmonie cette fois avec les exigences de la nouvelle législation linguistique de 1932 établissant la frontière linguistique. Jusque-là, devant les tribunaux civils, on avait fait abondamment usage du français, surtout dans les grandes villes.
(p.96) Peu après, 1a question du flamand dans l’enseignement moyen fut posée. La loi de 1850, la seule qui organisait cet enseignement, imposait l’étude du flamand et du français dans les provinces flamandes mais elle était très mal appliquée. Tout l’enseignement se faisait très largement en français et la situation était encore pire dans l’enseignement libre où elle avait suscité une réaction flamingante parmi les élèves, la « blauwvoeterie ». En avril 1881, Coremans et De Vigne déposèrent une proposition de loi afin de régler l’usage des langues
dans les écoles moyennes de l’État. Les libéraux, alors au pouvoir, étaient très divisés sur la question mais le ministre de l’Instruction publique, Pierre Van Humbeeck, déposa à la Chambre le 8 décembre 1882, un projet prévoyant que les cours de la section préparatoire
annexée aux écoles moyennes de l’État seraient donnés en flamand dans les provinces flamandes. Dans la section moyenne, les cours de flamand, d’ anglais et d’ allemand seraient donnés en flamand, de (p.97) même qu’une ou plusieurs matières laissées au choix de l’établissement.
Une Belgique bilingue, une Belgique unilingue…
En dix ans, le pays était doté de trois lois linguistiques qui avaient toutes les trois la caractéristique de ne pas changer grand-chose – c’était d’ailleurs une des raisons pour lesquelles elles avaient été votées. Beaucoup pensaient qu’elles consacraient des pratiques de
bon sens, appliquées sur le terrain depuis 1831 et dont la reconnaissance légale désamorcerait le mouvement flamand et renforcerait l’union nationale.
(p.98) Pourtant ces lois, anodines en apparence, sont porteuses de conséquences lointaines. D’une part, elles départagent clairement le territoire national en une partie exclusivement francophone et une partie bilingue : de sociale, la différence des langues prenait une coloration régionale, premier pas vers la définition d’une territorialité qui allait mener progressivement le mouvement flamand à revendiquer l’unilinguisme des provinces flamandes, face à une Wallonie tout aussi jalouse du sien.
Par ailleurs les critiques récurrentes contre ces lois, jugées incomplètes, lacunaires, sans sanctions réelles, loin de désarmer le mouvement flamand comme l’espéraient les milieux politiques, alimentèrent un ressentiment permanent. Ainsi la loi de 1873 fut remaniée trois fois ( lois du 3 mai 1889, 4 septembre 1891, 22 février 1908) et, à chaque fois, le constat d’abus persistants agissait comme un ferment pour relancer le militantisme flamingant. De même, la loi sur l’enseignement moyen fut considérée comme une duperie, surtout parce que tout l’enseignement moyen catholique continuait à privilégier le français.
Dix années qui ne changent rien ?
Résumons-nous. Ces premières lois linguistiques ne bouleversent nullement la situation des langues. La prédominance du français demeure quasi inchangée, tout comme l’idée que cette langue constitue le moyen indispensable à toute promotion sociale – même en Flandre. Le bilinguisme réclamé pour les provinces flamandes conforte d’ailleurs ce sentiment.
(p.107) Ce qui s’annonce au tournant du siècle, c’est moins une lutte pour la langue qu’une lutte autour -du statut social et de la position des couches moyennes flamandes. « Pour être ministre, il ne faut connaître qu’une seule langue et pour être employé, nous Flamands, nous devons connaître une seconde langue ! » écrit avec amertume Richard Maeten, employé des douanes, en juillet 1911. Le mouvement flamand se livre d’ailleurs à un relevé systématique des incidents linguistiques, aux guichets des gares, des postes, avec le personnel des chemins de fer (particulièrement visé), à une dénonciation quasi permanente de l’emprise des « fransquillons » sur l’administration. Ces critiques se concrétisent par plusieurs (p.108) Congrès de fonctionnaires flamands, aux accents assez radicaux, dont le premier a lieu à Anvers en 1909329. La rancoeur contre les « fransquillons » s’accentue, les incidents lors des examens linguistiques pour recruter des fonctionnaires engendrent des controverses qui se prolongent à la Chambre par des interpellations.
(p.109) Sur proposition d’un représentant wallon, Montpellier, une commission spéciale, composée d’un nombre égal de Flamands et de Wallons, fut chargée d’examiner les deux textes. Elle approuva le principe de l’égalité officielle des deux langues et rédigea une troisième proposition, très proche de celle de De Vriendt, à laquelle se rallièrent Coremans et De Vriendt. C’est ce texte qui fut présenté et discuté à la Chambre le 18 novembre 1896.
(…) Mais l’opposition francophone s’était, elle aussi, déployée tous azimuts. De nombreux articles, dans Le Soir, La Chronique, Le (p.110) Patriote, La Gazette, L’Étoile belge, Le Journal de Liège, La Flandre libérale…, entretenaient une agitation fébrile, criant à la fin de la Belgique, prévoyant la révolution en Wallonie. Des magistrats et des membres du Barreau de Gand, de Liège, de Charleroi, de Tournai et de Bruxelles pétitionnèrent à leur tour contre la loi.
Lorsque la proposition arriva au Sénat le 26 janvier 1897, 1’opposition s’était ressaisie et l’assemblée se mua en haut lieu de résistance.
Les débats occupèrent huit longues séances. Les sénateurs s’arrêtèrent sur les aspects techniques, invoquèrent l’absence de précision du flamand comme langue juridique. Les catholiques étaient très divisés – comme l’indiquera le vote. Les arguments n’étaient pas neufs et soulignaient à l’envi :
– la désunion que pourraient entraîner deux langues officielles
– l’impossibilité juridique et les difficultés insurmontables qui bloqueront le travail parlementaire et l’application des lois
– l’aberration de faire voter un texte flamand par des parlementaires qui ne connaissent pas cette langue
– l’injustice à rebours, cette fois à l’égard des Wallons.
Très vite, en effet, perce la crainte de voir le bilinguisme se généraliser dans la justice, ce qui n’aurait pas seulement comme conséquence d’exclure les Wallons des tribunaux dans les provinces flamandes mais aussi dans les provinces wallonnes ! Le bilinguisme les exclura définitivement de la présidence des deux Chambres. Si la logique des choses n’impose pas ce scénario catastrophiste, « l’enthousiasme flamingant le réclamera », augure Struye. Bref, la loi aura comme résultat d’ exclure graduellement des fonctions judiciaires tout Wallon qui ne connaîtrait pas le flamand. De leur côté, les partisans de la loi taxaient les craintes des Wallons de chimériques, tout en estimant, de manière assez goguenarde, que si les Wallons
apprenaient le flamand, eh bien, quel mal y aurait-il à cela ? Cela ne pourrait que resserrer les liens entre eux.
Le 5 février, Jules Le Jeune proposa un amendement qui réduisait fortement la portée de la loi en revenant à la seule promulgation dans les deux langues. Un seul texte, le texte français, ferait l’objet d’un vote au Parlement ; puis le Roi le promulguerait dans les deux langues. Faire autrement, déclarait Nothomb, c’était s’engager dans une voie qui serait « un véritable péril national dont il faut à tout prix se garder ». Ce serait, renchérissait Émile Dupont, « un vote de malheur pour la Belgique », tandis que pour Édouard Otlet : « Une loi
(p.111) comme celle proposée peut être considérée comme le commencement de la dislocation de la patrie belge. Elle porte en elle de terribles germes de désaffection.» Paul Janson abonda dans ce sens.
L’amendement de Le Jeune fut voté à une courte majorité et le Sénat adopta donc, par 51 oui, 23 non et 23 abstentions, un texte qui dénaturait profondément l’objectif égalitaire. Mais la Chambre ne se tint pas pour battue : elle rejeta la version du Sénat et maintint massivement le texte initial par 99 voix contre 19 et 4 abstentions.
Renvoyée à la Chambre Haute, la proposition y ralluma les passions. Les débats reprirent de plus belle dès le 5 avril, au cours de cinq séances houleuses qui ressemblèrent plus, selon Paul Fredericq, à de bruyants meetings populaires qu’à une digne assemblée de « pères conscrits ». En dépit des tentatives réitérées pour assurer la prééminence du texte français, et de quelques efforts pour imposer en contrepoids une troisième langue officielle, l’allemand, le texte voté par la Chambre fut finalement adopté au Sénat par 47 oui, 39 non et 3 abstentions. Onze catholiques lui étaient demeurés farouchement opposés, et les 28 libéraux en bloc. Le vote au Sénat fut accueilli avec un enthousiasme délirant dans les rangs flamands ; De Vriendt fut porté en triomphe par ses amis dans les rues de Bruxelles, tandis que des rixes éclataient entre partisans et adversaires de la loi.
Promulguée le 18 avril 1898, la loi d’égalité clôturait une période désormais « historique » – celle d’une Belgique dotée d’une seule langue officielle.
(p.113) Par ailleurs, la réception de la loi dans les rangs flamands n’est pas dépourvue de paradoxes. Alors que sa dimension sociologique, concernant exclusivement la Flandre, et l’inquiétude bruyante qu’elle fit naître en Wallonie étaient autant de germes potentiels de
« régionalisme », la loi d’ égalité fut saluée par les flamingants comme (p.114) une loi éminemment nationale. Les ténors du mouvement flamand y virent comme un point d’orgue et comme la quintessence du redressement des griefs. Pour la première fois, le législateur prenait des mesures s’adressant à la Belgique tout entière, alors que par le passé il s’était borné à régler l’usage des langues dans les seules provinces flamandes. Les Flamands cessaient d’être des citoyens de seconde zone et leur intégration pleine et entière dans l’État belge fut saluée comme la plus éclatante des victoires.
Ainsi, par le jeu des profonds bouleversements politiques qui affectent le pays après 1893, de périphérique, la question des langues se rapproche du centre parce qu’elle devient désormais un enjeu électoral non négligeable. En ce sens, on ne change pas fondamentalement la donne de l’omniprésence du politique dans la vie intérieure belge mais on change de partenaires dès lors que l’abandon successif du système censitaire et du scrutin majoritaire (1899) a modifié les cartes et les règles du jeu.
Par ailleurs la démocratisation de la vie politique ne s’observe pas seulement au Parlement ; elle s’étend aussi aux autres organes du pouvoir. C’est ainsi qu’une série d’administrations catholiques de petites villes flamandes, comme Hasselt ou Saint-Trond, se flamandisent peu à peu356. Vers 1910, c’est chose faite pour la plupart des communes flamandes.
Mais l’argument « social » inséré dans le combat linguistique annonce tout naturellement d’autres exigences : il devient impératif pour les flamingants que le flamand (re)devienne « une langue usuelle dans les familles aisées d’où elle est actuellement proscrite ». C’est un devoir social, « c’est le devoir des classes aisées de la partie flamande du pays de connaître et de parler le flamand ».
Comme tout devoir, il peut être imposé et l’enseignement apparaît comme le moyen le plus sûr d’y parvenir.
Vers la reconquête par la contrainte : la loi Franck-Segers (1910)
Plus que jamais les » fransquillons » deviennent les ennemis de la Flandre puisqu’ ils empêchent la restauration harmonieuse du peuple flamand par l’unité de langage. Ces premiers accents annonciateurs d’ un » droit du sol » suscitent chez certains de très
fortes inquiétudes. « Voilà qu’on veut imposer le flamand comme (p.15) langue véhiculaire à des familles qui ont le français ou le wallon comme langue maternelle sous prétexte qu’elles habitent la partie flamande du pays » s’indigne Goblet d’ Alviella, qui conclut : » Il ne peut plus y avoir de nos jours, même au point de vue linguistique, de serfs attachés à la glèbe.»
Ce nouvel objectif flamand débouche directement sur une réforme de l’enseignement du flamand en Flandre, dont l’inefficacité est quasi proverbiale. Dans l’enseignement officiel, la
loi de 1883 n’ a pas produit les résultats escomptés. Le français demeure toujours la langue prépondérante : si l’on ne conteste plus la nécessité d’enseigner des notions de flamand dans les athénées, du moins cette étude doit-elle s’effectuer » sans préjudice de la connaissance approfondie du français et des autres branches du programme ». De plus, la loi de 1883 ne s’applique pas à l’enseignement libre où le français reste la langue véhiculaire. Le futur général Van Overstraeten se souvient de ses années de collège à Ostende où tout se faisait en français. Les élèves étaient punis s’ils parlaient flamand entre eux. Dans les collèges du Limbourg, le flamand était totalement absent du programme dans les classes supérieures.
Quant à l’enseignement des filles, largement assuré par les congrégations religieuses, il privilégie le français, la langue « chic » par excellence. De nombreuses religieuses sont d’ailleurs d’origine française (surtout après les lois Combes de 1902 qui ont chassé les ordres enseignants de France). Même lorsque le flamand est au programme des écoles, il est « boycotté » par les élèves : » À l’Institut de Kerckhove fréquenté par les filles de la grande bourgeoisie /de Gand], une consigne circulait à l’attention des nouvelles : « On ne fait pas le devoir de flamand. » Humiliée mais résignée, la maîtresse de néerlandais s’inclinait. »
Cette situation préoccupe fortement le mouvement flamand : les jeunes filles des classes aisées sont francisées dès leur jeune âge par leur éducation, les jeunes filles des classes populaires le sont parce qu’elles s’engagent comme domestiques dans les familles bourgeoises. Pour l’académicien de Maere, comme plus tard pour HugoVerriest, il n’y avait pratiquement plus aucune jeune fille sur le sol flamand qui soit animée par l’amour de la langue maternelle.
Il y avait donc lieu de s’inquiéter de la bonne santé linguistique des futures mères flamandes.
(p.116) En décembre 1889, Coremans avait déposé une proposition visant à appliquer la loi de 1883 à l’enseignement libre – une proposition qui rencontra de fortes réticences chez les catholiques et qui échoua.
Débute alors ce que Paul Fredericq appelle le long chemin de croix de la proposition Coremans. Elle échoue à nouveau en 1890, en 1894 ; en 1901, elle est encommissionnée jusqu’en 1907. L’épiscopat, quant à lui, se prononce pour le statu quo, dans un texte qui sera
souvent cité comme preuve de la francophilie du cardinal Mercier.
Ce texte, Instruction aux Directeurs et aux professeurs des collèges libres d’humanités sur l’enseignement de la langue flamande, est signé par les six évêques de l’époque (dont quatre étaient Flamands) et poursuit plusieurs objectifs. Le premier est évidemment de préserver la liberté de l’enseignement catholique. Le second de définir l’usage des langues dans l’enseignement confessionnel. Si l’épiscopat reconnaît qu’il faut rester fidèle aux origines historiques du pays (c’est-à-dire à une nationalité belge « issue de deux races qui, à travers douze siècles, ont mêlé leurs influences »), cela ne signifie nullement que l’étude du flamand
puisse prévaloir. Car « le flamand seul ne peut suffire aujourd’hui », et il faut donc allier l’importance sociale du flamand et la portée universelle du français. Les études supérieures se sont toujours déroulées dans une langue universelle, il importe de conserver une langue internationale qui, à l’instar du latin, permette la communication mondiale entre les savants. Agir autrement, ce serait réduire l’université à une école professionnelle et placer la race flamande « dans des conditions d’infériorité dans la concurrence universelle ». De cette position découle l’exigence d’un enseignement secondaire en français.
En 1907, la proposition Coremans resurgit au détour d’un amendement de Louis Franck. Le nouveau texte prévoyait de mentionner sur les certificats d’accès aux examens universitaires que le titulaire a bien suivi, outre les cours de flamand, d’anglais, d’allemand, deux cours au moins en flamand, conformément à la loi du 17juin 1883.
Les débats eurent lieu du 6 mai 1907 au 12juillet. L’amendement de Léon Lepage pour soustraire l’agglomération bruxelloise à l’application de la loi est rejeté. Dès le 10 juillet 1907, Janson parle d’une « loi monstrueuse »; il est soutenu par Destrée, par Léon Vanderkindere, par Henry Carton de Wiart. Le texte est renvoyé à une commission chargée d’établir un projet clair et complet. Cinq projets successifs (p.117) sont présentés, qui montrent combien les parlementaires sont divisés. Le 22 avril 1910, la loi Franck-Segers est votée par 90 oui, 46 non et 8 abstentions. Entérinée par le Sénat le 6 mai 1910, elle est promulguée le 12 mai 1910. Mais les multiples débats qui l’ont accompagnée, les amendements pour en limiter la portée, l’opposition manifeste des évêques ont provoqué déception et ressentiment dans les rangs flamands.
Ce postulat posé, il ne s’agit plus seulement pour le mouvement flamand de faire reconnaître une seconde langue nationale – ce qui est acquis en 1898 – mais bien, selon les paroles de Frans Van Cauwelaert, de « mener le peuple flamand, mais tout le peuple, avec ses hautes et basses classes, au plus grand épanouissement possible ».
(p.121) Tout débute avec l’article d’Edmond Picard sur l’Ame belge paru dans la Revue encyclopédique de Paris en juillet 1897. Dans une optique médiatrice, Picard y affirme l’existence d’une âme spécifique née « de la convivance des deux races sous une direction gouvernementale unique [depuis 1830] ». Produit de l’histoire, cette âme s’accorde aux théories historiques d’un Godefroid Kurth et surtout d’un Henri Pirenne, même si ce dernier n’utilise jamais le terme. Il préfère en effet parler de « civilisation belge », de « microcosme de l’Europe », d’une destinée commune suscitant entre Wallons et Flamands « une camaraderie civique qui les a agrégés en une même famille ».
(p.122) L’article de Picard eut un retentissement énorme, en raison de la personnalité de son auteur, éminent juriste, homme profondément engagé dans la lutte politique mais aussi sympathisant notoire et défenseur du mouvement flamand. Louis Delattre, dans un essai qu’il dédie à Picard » médiateur entre les deux races « , se fait aussi le chantre de cette coexistence » de deux mille ou trois mille ans », une cohabitation qui a déterminé à la longue, entre » Belge du Midi et Belge du Nord, un air de famille ». Et Delattre d’en chercher les preuves tangibles jusque dans les langues elles-mêmes qui fourmillent d’emprunts réciproques, passant des jurons (fourt et voort, cron et krom, schnaud et snood) aux mots du quotidien (mouffes et mof, dringuelle et drinkgeld, gatte et geit… etc.).
(p.125) En outre, comme la démarcation linguistique demeure sociale et non territoriale, l’emploi des langues se heurte aux comportements de la population flamande qui persiste à voir dans le français un élément de distinction et une voie de promotion sociale, une conviction que tout, dans la vie quotidienne et professionnelle, vient renforcer.
À Gand, comme le rappelle Suzanne Lilar, « il y avait donc la classe ouvrière et paysanne qui patoisait allègrement, la classe dirigeante qui usait d’un français assez pu – et parfois même admirable.
Entre les deux, la petite bourgeoisie qui s’y efforçait mais parlait aussi le néerlandais, mâtinant cette langue de gantois. » L’usage du français gagnait du terrain : vers 1910, toute la classe bourgeoise gantoise, y compris les boutiquiers, les instituteurs, les employés, vivait en français.
Cette situation apparaissait comme définitive : « Cette prédominance du français est un fait indéniable : le flamingant le plus dévoué devra le reconnaître, et c’est un fait contre lequel nous pensons qu’il n’est pas possible de réagir efficacement… Cela est certes fâcheux à bien des points de vue, mais nous nous bornons à faire une constatation impartiale », écrit Charles Buls en 1905. C’est l’impression qui se dégage de visu quand un étranger visite une ville flamande : clubs, hôtels, théâtres, presse, livres, affiches, vitrines, enseignes… tout est en français, de sorte que, note le Dr Reismann-Grone à la fin de 1897 « le voyageur, s’il ne considère que les choses superficielles, tiendra le Brabant et la Flandre, aujourd’hui comme il y a 50 ans, pour un pays purement francophone ». Dans les classes populaires, la caserne et le service militaire apparaissent comme un puissant vecteur de francisation.
Le bilinguisme des Flandres – l’idéal des premiers flamingants – tourne donc à l’avantage du français. En outre, il fige des représentations stéréotypées où le français est synonyme de distinction et de civilité, le flamand, de vulgarité et de rusticité. C’est là que le bât blesse. Le flamand n’est pas seulement relégué ou dédaigné, il est méprisé. S’exprimer en flamand, c’est révéler qu’on appartient à une catégorie sociale inférieure, ou que l’on vient de la (p.127) campagne, ou que l’on n’a aucune instruction. « Le flamand est considéré comme vulgaire ». Dans les familles aisées (et même moins aisées), on s’empresse de donner aux enfants une bonne allemande ou anglaise. » Une bonne flamande, cela n’est pas distingué! » » Parler flamand vous classait aussi sûrement que le port de la casquette ou du bleu de chauffe, tandis que parler français revenait à prendre un brevet de bon goût, de distinction et même, depuis l’effacement du latin, d’humanisme. » La mère du professeur Fernand Vercauteren résumait ce sentiment collectif par une formule imagée ; en parlant de telle Gantoise, elle disait : » C’est
une femme qui parle flamand en rue » . Cela signifiait que c’était une femme du commun.
À ce mépris social pour les locuteurs flamands s’ajoutent des railleries cruelles sur la langue elle-même, ce » croassement de corbeaux » défendu par des associations qui » seraient parfaitement ridicules si elles ne présentaient un danger réel dans ses conséquences ». La presse libérale surtout – assimilant flamingantisme et catholicisme – manque rarement une occasion de se moquer de la langue flamande et de ses défenseurs, qu’elle traite « d’hurluberlus », » d’imbéciles », de » forcenés », » une poignée d’agitateurs que leur naissance obscure au fond des fermes […] ont rendus incapables d’apprendre le français’.
De leur côté, des Wallons s’élèvent à chaque revendication flamande pour réclamer en contrepartie l’usage officiel du wallon – montrant ainsi qu’ils se refusent à considérer le flamand autrement que comme un dialecte. Cette déconsidération du flamand comme
langue fait des ravages; le ton des polémiques » fait comprendre aisément que la discussion n’ait pas tardé à s’envenimer et qu’une grande amertume de sentiment soit venue rendre encore beaucoup plus difficile la solution de questions déjà délicates en elles-mêmes ».
(p.128) Les flamingants des années 1840- 1850 réclamaient la reconnaissance du flamand en Flandre, aux côtés du français. Ceux des années 1900 proclament que les Flamands sont traités en parias : en se déplaçant de la langue vers les individus, le registre a changé. De voir
leur langue maternelle dans une situation subalterne, les Flamands se sentent traités eux-mêmes en citoyens de seconde zone.
Cette rancoeur, combinée à l’insuccès de la législation linguistique, catalyse chez certains une désaffectation à l’ égard de la Belgique et un repli sur la Flandre. De jeunes intellectuels flamands, de plus en plus nombreux, considèrent que le pays fait obstacle à l’épanouissement des provinces flamandes; projetant dans le passé leur ressentiment présent, ils accusent la Belgique de tous les retards et de tous les malheurs de la Flandre.
(p.130) (…) au tournant du siècle – en gros de 1896 à 1914 – l’affaire de l’université de Gand prit des proportions énormes et focalisa toutes les énergies du mouvement flamand.
Deux commissions s’y attelèrent successivement. Dominées par deux fortes personnalités, celle du biologiste Julius MacLeod puis celle de l’économiste Louis de Raet, elles en adoptent les vues radicales, excluant tout enseignement en français. Mais dans les rangs flamands, l’unanimité n’était pas totale et d’autres, plus modérés, autour d’un Paul Fredericq par exemple, défendaient une université bilingue, par cohérence avec la législation sur l’enseignement secondaire mais aussi par crainte d’un isolement scientifique et par celle de perdre des étudiants.
(…) Mais en Flandre, l’idée de flamandiser l’université de Gand avait fait du chemin dans les esprits, avait mobilisé des forces considérables pour la propagande, par voie de presse, de meetings, de conférences, de congrès ; des centaines de pétitions en sa faveur étaient parvenues à la Chambre. Ces efforts avaient suscité une riposte francophone qui, elle aussi, avait pris de l’ampleur . L’Union pour la Défense de la Langue française à l’Université de Gand, fondée en 1910, s’engagea à fond pour combattre ce qu’elle appelait « un crime de lèse-civilisation, un crime de lèse-patrie et un crime de lèse-cité ». Meetings et réunions se succédèrent de (p.131) part et d’autre, créant une forte effervescence dans un climat déjà
tendu par la résurgence de la question scolaire ( Bon scolaire, 1911).
Le gouvernement catholique restait très partagé. Dans le parti, la fraction francophone était ouvertement appuyée par les évêques et aucun des grands leaders, ni Woeste, ni Beernaert, ni Verhaegen, n’était favorable à l’université flamande. Tous voyaient dans cette revendication un péril pour l’unité belge. L’intérêt du pays, l’intérêt du parti, son allégeance à la hiérarchie catholique, l’emportèrent sur les aspirations flamandes. La Belgique demeurait travaillée par
ses divisions politiques traditionnelles et même un organe flamingant comme Hooger Leven était contraint d’admettre que s’il avait à choisir entre une université catholique (en français) et une université officielle ( en flamand), il choisirait l’université catholique.
Par ailleurs, les Flamands furent confrontés au même dilemme lors du vote de la loi Poullet instaurant l’enseignement primaire obligatoire (1914). Défendue – et votée – par les catholiques parce qu’elle faisait la part belle aux écoles libres, la loi sonnait en fait le glas des
espérances flamandes en imposant le français dans les programmes en Flandre à partir de la 4e année primaire. Elle sapait ainsi à la base, selon Julius Hoste, tous les efforts faits dans l’enseignement moyen et supérieur. Max Rooses y voyait « un coup de grâce porté à la
nationalité flamande ».
L’incapacité à mener à bien le vote des propositions de loi sur la flamandisation de l’université de Gand provoqua chez les flamingants une déception immense. Il cristallisa une amertume d’autant plus forte que les efforts avaient été grands et que la question en était venue à symboliser l’aspiration tout entière du mouvement flamand. De plus les déclarations avaient été nombreuses pour préciser l’attachement à la Belgique. » Nous ne séparons pas la petite patrie de la grande », affirmait Louis Franck à la Chambre le 8 avril 1910. » Nous les unissons dans un même et fervent amour »… » Est-ce que la race flamande n’ a pas porté assez haut le nom flamand, est-ce qu’ elle n’ a pas assez servi notre patrie commune pour qu’on ne lui marchande pas le respect de sa langue et la reconnaissance de ses droits? »
(p.132) L’armée, autre bastion francophone
Depuis 1831, l’armée était restée le bastion de la langue française, au nom de l’unité belge et du civisme. Les réformettes de 1888, introduites à l’École Militaire pour inculquer aux officiers des rudiments de « flamand usuel » apparaissaient comme une plaisanterie. Tout le
commandement s’effectuait toujours en français. À chaque réforme importante (1909, service personnel d’un fils par famille; 1913, service personnel généralisé), les flamingants tentèrent d’ imposer l’usage du flamand, notamment dans les relations entre soldats et sous-officiers. En vain. Ils se tournèrent alors vers une solution radicale, préconisée déjà par la Commission des Griefs en 1856 : la création de régiments séparés.
La levée de boucliers fut immédiate. Toucher à l’armée, symbole par excellence de la nation une et indivisible, fut ressenti comme un danger pour l’indépendance du pays, surtout en ces temps d’instabilité internationale. Dans un esprit de conciliation – mais ferme sur le principe de l’unicité indispensable du haut commandement – le ministre de Broqueville fit voter quelques réformes linguistiques qui devaient porter leurs fruits à partir de 1917.
En quelques années, trois débats fondamentaux – dont ils sortent chaque fois vaincus et humiliés – persuadent certains groupes flamands que la voie légale est inefficace. L’opposition qu’ils rencontrent jusqu’ au sein de leur propre parti, la diminution de leur groupe à la Chambre depuis 1910, l’incapacité d’imposer leurs vues suscitent une immense frustration et une méfiance croissante à l’égard de la voie parlementaire.
(p.133) Plutôt la séparation administrative ! Un tri wallon qui gagnera la Flandre. L’idée de séparation administrative prendra racine dans le terreau flamingant juste peu avant la guerre. C’est une idée d’importation : née en Wallonie, c’est en Flandre qu’elle fera souche.
L’inquiétude wallonne, perceptible dès les premières lois linguistiques, était restée longtemps circonscrite. Les groupes de défense de la langue française et les premiers congrès wallons (1890-1893) n’avaient rencontré qu’un faible écho. L’inquiétude monta cependant d’un cran avec la loi d’égalité.
En 1898, pour la première fois, Julien Delaite président de la Ligue wallonne de Liège fondée en mai 1897, exprime ce malaise en évoquant la séparation administrative. Le 28 juillet – quelques mois après le vote de la loi d’égalité – la question est mise à l’ordre du jour et Julien Delaite présente un bref rapport le 22 décembre. Cette première f1ambée émane d’un milieu bourgeois, bien implanté dans la société belge et dont l’objectif n’a rien de révolutionnaire. Afin de conserver une Belgique unitaire et officiellement francophone, il estime qu’il faut faire barrage « à la marée montante des prétentions flamingantes », et tente de mobiliser « tous les patriotes belges » pour rejeter des mesures linguistiques contraires « à l’intérêt du Pays ». La séparation administrative est brandie « comme une (p.135) menace ou un avertissement « . Plus bourgeoise que populaire, l’analyse ne fait pas l’unanimité en Wallonie. À la Chambre, le tribun socialiste Jules Destrée vote la loi d’égalité – tout en soulignant ses appréhensions, car certaines dispositions pourraient faire naître l’idée de séparation, qui serait, selon lui, » un désastre ». Destrée loue au contraire « les précieuses qualités de l’âme belge » et l’unité des deux peuples, « une unité que je ne veux pas voir briser ».
(p.135) Les années 1910-1912 sont des années de radicalisation brutale où les victoires flamandes sont fortement ressenties dans les milieux laïcs wallons comme autant de victoires cléricales. Le vote de la loi Franck-Segers, celle réglant l’usage des langues dans les Conseils de Prud’hommes, l’agitation qui prend corps autour de l’université de Gand poussent aux déclarations fracassantes. En plein Sénat, lors du vote sur les Conseils de Prud’hommes, le 9 mars 1910, Émile Dupont s’écrie : « Vive la séparation administrative ! » Ce cri, incongru à la Chambre Haute, venant de surcroît d’un septuagénaire pondéré, grand bourgeois doctrinaire, avocat-conseil de nombreuses entreprises et ministre d’État, est un bon baromètre de l’exaspération croissante dans les rangs wallons où les revendications flamandes sont ressenties en terme d’escalade.
(p.136) Beaucoup de francophones persistent en effet à ne voir dans le mouvement flamand qu’une agitation factice, une manoeuvre politique pour maintenir la prééminence catholique sur le pays. Cette idée, Émile Dupont l’avait déjà exposée sans ambages en 1897. Pour lui, la législation avait rencontré tous les griefs légitimes des Flamands et le débat était clos. »
(p.137) Dès le lendemain des élections, l’idée de séparation refait surface. Au Congrès wallon du 7 juillet 1912, un climat de révolte souffle, ranimant » toutes les vieilles rancunes à l’égard de la Flandre cléricale, rétrograde, obscurantiste et profiteuse de la richesse wallonne ». Destrée fait acclamer le principe de la séparation. (p.138) Si Destrée se lance dans une envolée lyrique sur les empiètements flamands (« Ils nous ont pris… ») (…).
Cette position est d’ailleurs critiquée, à juste titre, par le catholique Maurice de Miomandre qui, rejetant la démarcation » ethnique » du pays proposée par Destrée, fait remarquer que « la lutte est bien plus vive entre Wallons appartenant à des partis politiques différents qu’entre Wallons et Flamands. Nous sommes divisés avant tout non par la langue et la race mais par les doctrines politiques et les croyances. Un libéral wallon est plus proche d’un libéral flamand que d’un catholique wallon… Un socialiste wallon est infiniment plus près d’un socialiste flamand que d’un catholique wallon… Ces élections ne se font pas Flamands contre Wallons mais Flamands contre Flamands et Wallons contre Wallons, chacun dans leurs villes
et leurs arrondissements. «
(p.139) A ces accents wallons, se mêlèrent aussi a autres voix, issues de francophones intimement convaincus de la supériorité culturelle du français. Pour eux, l’exclusion du français des Flandres serait dommageable en premier lieu aux populations flamandes elles-mêmes. Les Flamands seraient les premières victimes en s’isolant des circuits intellectuels internationaux.
(p.141) Mais jusqu’ en 1914, l’élément politique reste prédominant : la Belgique demeure avant tout le champ d’affrontement entre catholiques et non croyants, entre bourgeoisie et classes populaires.
(p.142) Soulignons aussi combien l’époque est propice aux stéréotypes qui fondent les jugements. La société découvre l’anthropologie nouvellement érigée en science, dont elle use et abuse pour légitimer les hiérarchies sociologiques et sexuelles. C’est l’époque où la vogue immodérée pour la crânologie permet de fonder « scientifiquement » l’infériorité féminine ( plus petit crâne, plus petite cervelle) mais aussi la hiérarchie entre les « races ». La supériorité du Wallon brachycéphale sur le Flamand dolichocéphale ne fait pas de doute, « puisque le crâne est le siège du cerveau, l’âme wallonne doit différer de l’âme flamande ». Les stéréotypes entre Flamands et Wallons, qui se basaient auparavant sur des comportements et des caractères psychologiques, trouvent désormais un ‘fondement scientifique’ permettant de légitimer le dédain des francophones. Plus que jamais, la question d’honneur évoquée par Suzanne Lilar est au fond de la question flamande. Mais du côté wallon, n’y a-t-il pas aussi, en quelque sorte, un sentiment d’infériorité et une question d’honneur sous-jacente, cette fois vis-à-vis de la France ? Le mouvement wallon est composé d’intellectuels et d’écrivains soucieux d’affirmer une littérature belge d’expression française – spécifique mais reconnue dans le champ culturel et littéraire français. La crainte de voir leurs efforts compromis par une Belgique bilingue – donc nécessairement « bâtarde » et qui renforcerait le dédain de la France – n’est pas absente de leurs esprits. Bruxelles, la capitale, ne donne-t-elle pas l’image de ce métissage qu’ils redoutent et que Destrée a stigmatisé d’ une formule cruelle : » Pour un Picard, combien de Kaekebroek! «
(p.143) Chapitre X L’ENTRÉE EN GUERRE ET LE SOMMET DU SENTIMENT NATIONAL
Un petit pays paisible, dépourvu d’esprit guerrier
Le ministre de France en Belgique, Klobukowski, dans une analyse de la situation du pays, écrit en mars 1913. « La Belgique ne se dissimule pas qu’en l’état de ses armements, elle serait, au cas d’un conflit franco-allemand, à la merci du premier envahisseur, contre
qui elle ne pourrait esquisser honoris causa qu’un semblant de résistance ; consciente de sa faiblesse présente, plus adonnée par tempérament à l’ étude des problèmes économiques et au développement de son commerce et de son industrie qu’ aux choses de la guerre, elle a le souci, dans l’hypothèse d’ une catastrophe, de sortir avec le moins de dommages possible des dangers auxquels elle serait exposée.»
Appréciation isolée ? Que non ! la Belgique, sur le plan international, ne suscite que peu de commentaires – elle est neutre, et elle fait peu parler d’elle -, mais quand commentaires il y a, ils vont souvent dans le sens de celui de Klobukowski. L’attaché militaire belge à Paris, le général Collon, s’entend dire en février 1914 par le chef du deuxième bureau français : « Soyez franc. Vous savez bien que les Allemands sont convaincus que vous ne résisterez pas à leur invasion. Ils pensent que vous résisterez pour la forme485. » De fait, le (p.144) baron de Schoen, l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, disait en 1914 :
« Les Belges ? Ils feront la haie pour nous regarder passer. » Évoquant dans sa World Crisis la fin de juillet 1914, Winston Churchill écrit : « Belgium did not count so largely in my sentiments at this stage. I thought it very unlikely that she would resist. I thought, and
Lord Kitchener, who lunched with me on the Tuesday (28 July) agreed, that Belgium would make some formal protest and submit. A few shots might be fired outside Liège or Namur; and then this unfortunate State would bow its head before overwhelming might .»
(p.147) Ce qui nourrit souvent les doutes au sujet de la résistance que la Belgique offrirait à un envahisseur est l’opinion que l’on se fait de son armée. Écoutons par exemple le commandant Génie, l’attaché militaire français à Bruxelles, en 1913-1914. Le corps des officiers belges ? « Il n’est pas belliqueux, pas même militaire. Son patriotisme… ne révèle guère à l’examen qu’un goût démesuré pour le panache, les galons, les décorations. La gloire militaire est un article du temps de paix… C’est en somme le corps d’officiers d’une nation
de gens d’affaires ».
Ces jugements tranchés, certes, sont nuances parfois par d’autres, qui reconnaissent ce qu’il peut y avoir dans l’armée belge comme « bons éléments », mais Génie, dans l’ensemble, est tout sauf admiratif. Il rend néanmoins hommage à » l’oeuvre hautement méritoire » du gouvernement et de son chef, le baron de Broqueville, l’auteur de la loi de 1913, qui ont entrepris de renforcer l’appareil militaire belge. Mais ces efforts, juge-t-il, ne porteront leurs fruits qu’après un certain nombre d’années, en 1918 sans doute.
Les appréciations allemandes, avant 1914, ne sont guère plus favorables que celles de Génie. Le général von Seeckt les résume en 1919 dans une note où il écrit : » Avant la guerre, le jugement que l’on portait sur l’armée belge se résumait en une phrase : valeur de combat médiocre, armée inutilisable pour l’offensive et pour des missions importantes. » Moltke, en 1911, affirmait que l’on pouvait compter » dass die wenig leitsungsfähigen belgischen Truppen ohne Schwierigkeiten zersprengt werden « .
(p.151) L’appel aux armes
La Belgique est envahie le 4 août 1914. Le 5 août, le roi Albert – qui, conformément à la coutume constitutionnelle belge, prend personnellement en temps de guerre le commandement de l’armée – lance une proclamation « À l’armée de la nation ».
» Soldats !
» Sans la moindre provocation de notre part, un voisin orgueilleux de sa force a déchiré les traités qui portent sa signature et violé le territoire de nos pères. Parce que nous avons été dignes de nous-mêmes, parce que nous avons refusé de forfaire à l’honneur, il nous attaque…
Vaillants soldats d’une cause sacrée, j’ai confiance en votre bravoure tenace et je vous salue au nom de la Belgique… Vous triompherez. Car vous êtes la force mise au service du droit.
César a dit de vos ancêtres : De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves.
Gloire à vous, armée du peuple belge!… Souvenez-vous, Flamands, de la bataille des Éperons d’Or, et vous, Wallons de Liège, qui êtes en ce moment à l’honneur, des 600 Franchimontois.
le pars de Bruxelles pour me mettre à votre tête. »
Ne disons pas, face à ce texte : de la rhétorique classique. Chaque mot, en fait, porte, car il correspond aux sentiments de la population : l’ « honneur « , la « cause sacrée », la » force mise au service du droit», l’appel au patriotisme et aux souvenirs du passé. Dans l’appel au patriotisme, le roi sait qu’ il peut frapper fort. Le passage de César au sujet des peuples de la Gaule, « horum omnium fortissimi sunt Belgae », avait été cité dès le XVIIIe siècle par des écrivains nationaux pour faire honneur aux Belges de tous les temps509. Mais on était
venu de plus en plus à le citer avec le sourire : c’ était d’ une antiquité qui paraissait bien reculée. Aucun sourire chez le roi Albert : en invoquant César, il sait qu’ il fera vibrer les coeurs.
(p.163) Le 10 janvier 1915, cependant, le jour même où la seconde partie de la lettre pastorale de Mercier est lue en chaire, une autre lettre, secrète quant à elle, est signée par le gouverneur général von Bissing.
Elle est adressée au chancelier Bethmann-Hollweg. Von Bissing expose au chancelier ce que sont à ses yeux la situation des langues et celle des « races » en Belgique et lui fait part surtout en la matière, de ses Leitgedanken fur die Zukunft. Il s’agit de gagner à l’Allemagne,
par un langage et des promesses appropriées, la sympathie des Flamands. L’ objectif est » die ganze oder teilweise Gewinnung der Vlamen».
On peut voir dans cette lettre du 10 janvier 1915 le fondement d’une politique allemande réfléchie qui ira en se développant : la Flamenpolitik. Or la Flamenpolitik – s’ajoutant, bien entendu, à d’autres facteurs – va progressivement détacher un certain nombre de Flamands tout à fait minoritaires mais aux convictions flamandes fortes, de leur fidélité belge. Le 10 janvier 1915 voit coïncider ainsi deux phénomènes : l’affirmation éclatante du patriotisme belge, et celle du premier germe qui va partiellement l’ébranler.
(p.165) Il serait naïf de voir en chaque Belge un patriote agissant : il y eut des indifférents et des lâches, des » barons Zeep » et des profiteurs de guerre. Mais le trait dominant, pendant ces quatre années de guerre, celui qui frappe les observateurs, est un vif attachement à la Belgique. Celui-ci ne s’exprimait pas toujours de manière héroïque mais s’insérait dans les détails de la vie courante, avec les armes de l’ironie et » cette trempe d’humour particulier qu’ on appelle chez nous la zwanze et qui déconcerte singulièrement la lourdeur d’esprit des
Kreischef et des Feldwebel ».
(p.166) Une multiplicité d’engagements
L’élan d’août 1914, concrétisé par près de 30 000 engagements volontaires, sert généralement de baromètre au patriotisme des jeunes hommes adultes. Le mouvement dépassa les clivages sociaux et philosophiques. Ce fut aussi, pour la noblesse belge, une heure de gloire où elle renoua avec sa vocation militaire d’ancien régime et sa mission chevaleresque, en imposant d’emblée l’idée qu’elle avait à donner l’exemple de la droiture et de la loyauté. Chez les de Villers Grandchamps, par exemple, les trois fils s’engagent dès les premiers jours. « C’était constater … que le sang des ancêtres n’a pas changé », note leur belle-soeur Marguerite de Crombrugghe.
Mais le désir de servir la patrie ne s’est pas limité aux jeunes gens ; il a gagné toute la population avec une incroyable intensité, y compris les femmes, généralement peu sollicitées en temps de guerre. Celles-ci témoignent d’un même désir d’action que les hommes, (« depuis les premiers jours de la guerre, je cherche une occasion de me dévouer pour mon pays », écrit Gabrielle de Monge) – un désir d’ action largement justifié par le choc de l’invasion et la haine de l’envahisseur: « Rien ne peut décrire le sentiment de révolte, de nausée même que provoque la première apparition de l’ ennemi chez soi », note la princesse Marie de Croy, qui ajoute : » Nous sommes BELGES… depuis des (p.167) siècles, notre famille a possédé des terres, occupé des charges dans ce coin de pays, sous la domination des Ducs de Bourgogne, de la Maison d’Autriche, de l’Espagne, de la France.’
Ne pouvant servir sous les armes, les femmes développèrent des activités patriotiques spécifiques. Elles s’engagèrent par milliers dans des services de santé, de renseignement, d’évasion, de courrier. Certaines mirent à profit leurs relations familiales ou leur fortune pour organiser elles-mêmes divers réseaux. Sous leur plume, à chaque fois, le même patriotisme : » Comme tous les vrais Belges, » note Gabrielle de Monge « je suis entraînée par l’exemple de notre roi et par l’intervention d’une cause juste et sainte. » Chez les femmes catholiques, cet engagement patriotique se double d’un profond sentiment religieux, conforté par les messages du cardinal Mercier.
Le devoir civique n’est pas distingué du devoir religieux, comme le déclare calmement Juliette Carton de Wiart devant ses juges : » Je n’ai fait que mon devoir de Belge et de catholique. » Internée à la forteresse de Siegburg, la baronne Marthe Boël (née Kerkhove de Denterghem) rappelle aussi combien, chez les détenues d’âge et de conditions sociales pourtant très différents, on retrouvait le même besoin » de se dévouer à un idéal supérieur qui, à cette époque, se concrétisait dans l’idée de la Patrie ».
C’est peut- être Gabrielle Petit qui exprime ce sentiment avec le plus de simplicité en 1915 : » Ma patrie ! je n’y avais pas assez pensé, je l’ignorais presque. Je ne sentais pas que je l’aimais. Mais depuis qu’ils la martyrisent, les monstres, je la vois partout. Je la respire dans les rues de la ville, à 1’ombre de nos palais…, elle vit en moi, je vis en elle. »
(p.169) Le sentiment national fut aussi tenu en éveil par la célébration des fêtes religieuses, les seules permises. On ne vit jamais de foules aussi nombreuses dans les cimetières et dans les églises à la Toussaint et à la Noël. La dérision alimenta cette résistance : le jour où l’Italie entra en guerre aux côtés des Alliés, la population se promena sur les boulevards de Bruxelles avec des macaronis à la boutonnière. Le 21 juillet ou le 4 août était un jour particulier où, en dépit de l’interdiction de manifester, la population adopta à chaque fois un comportement collectif significatif. Le 21 juillet 1915, toutes les maisons de la capitale gardèrent leur volets baissés, tous les magasins et établissements restèrent fermés tandis qu’une foule nombreuse et endimanchée allait écouter la grand’messe à la collégiale Saints Michel et Gudule. La Brabançonne, jouée aux grandes orgues, déchaîna l’enthousiasme : » Il y a là des catholiques, naturellement, mais aussi des indifférents, des francs-maçons, des libéraux, des socialistes. Tous… d’une seule voix, crient leur amour de la patrie578. » Le 4 août 1915, comme l’autorité allemande avait interdit toute fermeture et toute (p.170) démonstration patriotique, les commerces restèrent ouverts, mais » naturellement aucun client ne se présentait et si par extraordinaire l’un ou l’autre demandait à acheter un article quelconque, on lui réclamait 100 francs pour un objet valant 50 centimes ». Le 21 juillet 1916, même scénario : foule nombreuse à Sainte-Gudule pour y entendre le cardinal Mercier et la Brabançonne. Rendus responsables, les bourgmestres de l’agglomération bruxelloise durent payer une amende d’un million de marks.
L’interdiction d’arborer les couleurs nationales était contournée de mille manières, comme par ce légumier dont la devanture n’était garnie que de tomates, de citrons et de pruneaux, ou ces trois dames se faisant acclamer sur un balcon du grand boulevard de Bruxelles, habillées chacune d’une seule couleur mais formant, à elles trois, le drapeau belge. Les anecdotes pullulent sous la plume des observateurs. La zwanze maintint le moral de la population – aussi sûrement que La Libre Belgique distribuée sous le manteau.
(p.174) La division progressive des ministères en une aile flamande et une aile francophone, la reconnaissance de la région flamande (capitale, Bruxelles) et de la région wallonne (capitale, Namur) le 21 mars 1917 marquent un pas supplémentaire dans la collaboration. Les
manifestations d’opposition patriotique se succédèrent et le gouvernement de Sainte-Adresse réagit par des arrêtés-lois abrogeant toutes les mesures prises par l’ occupant. La création d’un Conseil de Flandre, sorte de parlement flamand consultatif disposant de pouvoirs mal définis, constitue un point de non-retour dans l’aventure activiste. Il est définitivement atteint le 22 décembre 1917 avec la proclamation de l’indépendance de la Flandre : « L’oppression sous
laquelle le peuple flamand a vécu depuis 1830 a cessé. » Le Conseil de Flandre affirmait que la Belgique n’était qu’une invention diplomatique, sans aucune valeur face à l’existence de la Flandre, voulue par la nature et par la Providence.
(p.177) L’activisme wallon : un artefact ?
L’activisme wallon, dont l’existence était nécessaire aux Allemands pour justifier le « caractère artificiel » de la Belgique unitaire, n’est en rien comparable à l’activisme flamand. L’historiographie l’a même considéré longtemps comme totalement insignifiant, étant donné la difficulté à former un parlement wallon et le nombre peu élevé de poursuites à la libération (23 personnes poursuivies, 20 condamnées).
Aussi, à la question de savoir si cet activisme wallon a été négligeable, Jean-Pierre Delhaye répond que non. S’il n’est pratiquement rien numériquement, tout au plus une centaine d’hommes, il a mobilisé des personnalités comme Arille Carlier, Lucien et Oscar Colson, Franz Foulon, considérés comme des précurseurs du fédéralisme. Pour Chantal Kesteloot aussi, « on commettrait une erreur profonde en s’imaginant que les Wallons demeurés au pays ne se sont pas préoccupés de la réorganisation intérieure du pays. De nombreux projets ont été conçus, étudiés, discutés dans des palabres fréquentes… »
(p.178) En revanche, et curieusement, les agissements d’une petite poignée de Wallons à Paris autour de Raymond Colleye et de l’Opinion wallonne, de tendance nettement francophile, inquiètent fortement le roi Albert, plus préoccupé pendant un temps des cocoricos pro-français que des prémisses du malaise flamand dans les tranchées. C’est que pour lui, les premiers trouvaient appui auprès d’une puissance alliée, tandis que les seconds auraient dû pactiser avec une puissance ennemie et haïe.
Après l’armistice, l’activisme wallon fut totalement balayé par la vague de nationalisme belge. Les rares rapports qui témoignaient d’un malaise wallon furent submergés par l’abondance des déclarations patriotiques. À plusieurs reprises, Destrée proclame. « Le baptême du feu et du sang » a scellé la nation belge. Sans renier ses déclarations antérieures, il déclare : » La guerre m’a montré une Belgique, confondant la Flandre et la Wallonie, souffrante et militante et je la veux triomphante par l’union de tous ses enfants. »
(p.181) La confrontation avec les autorités militaires fut dure et, sous le choc, le frontbeweging se radicalisa. Bien que l’armée commençât à s’ouvrir aux réformes, elle restait avant tout une armée de classe. Partout d’ailleurs, l’armée de la Grande Guerre fut une armée de classe : le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, en est une fort belle illustration. Telle quelle, l’armée belge accusait un terrible décalage avec une société civile en voie de démocratisation depuis la fin des années 1880. La division de classe se doublait d’une division linguistique, séparant un haut commandement francophone des masses populaires dialectales.
(p.198) Voilà un « possible » très concevable. Le hasard des destins individuels en a décidé autrement : l’extinction de la maison de Brabant a permis à Philippe le Bon de joindre Flandre et Brabant, d’en faire le coeur de son État. C’est la guerre et tous ses aléas qui ont amené la séparation du Nord et du Sud des Pays-Bas ; si l’Espagne avait remporté la victoire – ce qui était concevable à certains moments – les Pays-Bas tout entiers auraient pu demeurer un État uni et riche.
Ce sont là autant de rêves possibles, mais il faut les garder à l’esprit pour nous protéger de conceptions déterministes. Le déterminisme n’est pas plus de mise au XIXe siècle que sous l’Ancien Régime.
L’État continue, au point de vue des formations nationales, à jouer souvent un rôle essentiel : naissance de l’entité morale grand-ducale du Luxembourg, rattachement national à la Hollande du Limbourg venu de la Belgique et surtout – l’on y songe trop peu – formation du sentiment national flamand qui s’est cantonné aux frontières de l’État belge.
(p.199) La Belgique du XIXe siècle vit et prospère. Ce qui lui manque par contre totalement est le prestige international (sauf celui qui s’est attaché personnellement durant leurs règnes à ses deux premiers souverains). Elle ne réussit guère à se faire prendre au sérieux à l’étranger. En France ce petit pays dépourvu de frontières naturelles, sans grande histoire nationale propre, apparaît comme soustrait provisoirement à la grande nation française. Un collaborateur de la sage Revue des Deux Mondes écrit en 1843. « On s’est accoutumé en
France à considérer le nouvel État belge comme un tronçon détaché d’un empire qui devra se reformer tôt ou tard. » Le Dictionnaire politique publié en 1842 par un groupe d’écrivains républicains et qui deviendra ce que l’on a appelé la » bible du parti républicain » fait l’éloge des institutions libérales de la Belgique mais il ajoute : » Ces institutions sont remarquables sous bien des rapports, comme on le voit. Cependant elles ne produisent pas en Belgique tous les effets qu’on en pourrait attendre. Pourquoi cela ? Parce que l’existence de la Belgique comme nation indépendante est une chimère. L’état actuel de ce pays est purement transitoire. Sa destinée est d’être un jour uni à la France ; il se révolterait vainement contre cette nécessité
providentielle de sa situation. »
Dans une petite Histoire de la Belgique depuis son origine jusqu’en 1847, publiée à Paris en 1847, l’auteur écrit : » Le petit royaume de Belgique, à quelque point de vue qu’on l’envisage, ne peut être considéré que comme une partie détachée de la France. » » Comme la Belgique n’a pas de nationalité qui lui soit propre », que tout est français chez elle, elle » ne saurait former un état indépendant. » » Ne traiterait-on pas de fou, avec beaucoup de raison, l’astronome qui afficherait la prétention de rendre un satellite indépendant de sa planète, ou le praticien qui voudrait, non seulement conserver la vie au membre amputé, mais en former un tout, un corps entier ? »
La Belgique aux yeux de la plupart des Français était donc destinée à retourner à la France. Jean-Baptiste Nothomb, à la fin d’une longue carrière diplomatique, écrivait en 1871 : « Aux yeux de tous les hommes politiques français que j’ai connus, Louis-Philippe et (p.200) Guizot exceptés, la Belgique n’a jamais eu qu’une existence transitoire.
(p.201) Pour parler en termes de nationalités, il n’existe pas en Belgique deux nations distinctes mais bien une nation, comprise dans une autre, la nation belge qui est certes déclinante mais garde de beaux restes. S’il y a une différence de densité entre, au Nord, une nation déjà bien ancrée, et au Sud une nation francophone tout au plus en devenir, il est vain par contre d’établir entre les deux une différence d’ancienneté. Une opinion très courante aujourd’hui parmi les Belges – tels ceux de la jeunesse universitaire – est qu’il y a eu des Flamands et des Wallons avant les Belges. Cette priorité est surtout revendiquée en Flandre. En 1987, le chef de l’Exécutif flamand déclare : » La Flandre existe depuis des siècles, la Belgique depuis un siècle et demi. »
On se sent flamand » par nature », c’est une expression souvent prononcée ; des catholiques ajoutent » et par la volonté de Dieu ». Et la nature n’a évidemment pas d’âge, pas plus que la volonté de Dieu !
L’idée que la Flandre est l’oeuvre de Dieu (« Dieu nous a créés Flamands ») et la Belgique l’oeuvre des hommes a été parfois si répandue que le cardinal Van Roey s’est senti tenu de protester contre elle. Il aurait suffi au cardinal pour mettre à bas cette conception de demander ce qu’avait pu être l’intervention de Dieu dans le tracé de la frontière entre la Flandre et la Hollande.
Balayons tout cela : la Flandre et le pays wallon, Wallons et Flamands sont ensemble et exclusivement des sous-produits de la Belgique686. Ceci ne fait que mieux ressortir, nous semble-t-il, l’importance de l’analyse que nous avons consacrée au tronc commun, celui de la nationalité belge.

