
La Françafrique ou l'oppression coloniale et post-coloniale de l'Afrique par la France
PLAN
La Françafrique
1 Généralités
2 L’Afrique subsaharienne
3 Le génocide rwandais fomenté par la France
4 Les pays du Maghreb
1 La Françafrique: généralités

la Françafrique... (néo-)colonialisme
» rançois-Xavier Verschave, La Françafrique, Le plus long scandale de la République, éd. Stock, 1999 (extraits)
(p.11) Au début des années quatre-vingt-dix, un capitaine français séjournant aux Comores où il avait été, à l’origine, détaché au titre de la coopération militaire, fut effaré par les trucages électoraux. Des Français étaient au coeur de la manipulation qui avait permis l’élection du président Djohar. Le capitaine rédigea un rapport. Il le remit à Jean-Michel Belorgey, qui présidait alors la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’ Assemblée nationale et, surtout, l’intergroupe des parlementaires membres de la Ligue des droits de l’homme. Le député avait quelques entrées à l’Élysée. Il y transmit le rapport, en ajoutant le compte rendu de son entretien avec l’ officier. Quelques semaines plus tard, la famille du capitaine apprenait son assassinat dans des conditions particulièrement sauvages, qu’il est impossible de décrire ici sans ajouter à l’horreur du crime. Elle n’ a jamais pu obtenir le rapport d’ autopsie, ni bien sûr de suite judiciaire, que ce soit aux Comores ou en France.
Ce capitaine est mort d’ avoir Cru en la démocratie. Il a rejoint celles et ceux qui ont appris, parfois dans leur chair, le prix du plus long scandale de la République.
/RWANDA/
(p.16) En 1990, le régime du général Habyarimana est déjà mal en point. Une famine sévit. Le clan de l’épouse du président, Agathe, accapare les richesses du pays. Aux revendications tutsies s’ajoute l’opposition des Rwandais du Sud, exaspérés par ce clan familial, l’akazu, issu du Nord-Ouest. Le 1er octobre, le FPR engage la lute armée. Le pouvoir rwandais joue son va-tout : la carte ethnique. Il lance la lutte finale des Hutus, « peuple majoritaire » authentique, contre ces étrangers » de Tutsis, ces « envahisseurs » qui, selon la (p.17) légende, auraient remonté le cours du Nil en des temps immémoriaux (1). Le slogan « Hutu Power !» cristallise le racisme.
À cette époque, François Mitterrand est secondé à la « cellule africaine » de l’Élysée par son fils Jean-Christophe. L’un et l’autre ont noué d’étroites relations avec la famille Habyarimana (le père, Juvénal, et le fils Jean-Pierre). Dès le 2 octobre 1990, le père Habyarimana téléphone au fils Mitterrand pour appeler la France à la rescousse. L’Élysée décide immédiatement d’ envoyer plusieurs centaines de parachutistes au Rwanda : ils sont rapidement six cents, parfois plus d’un millier – sans compter les instructeurs militaires, un état-major de substitution, et une profusion d’ agents secrets.
Les régiments français d’intervention « outre-mer » (Légion et Infanterie de marine) sont passés sans transition des guerres d’Indochine et d’ Algérie au maintien de l’ ordre post-colonial. Leur histoire est parsemée d’ épisodes guerriers presque inconnus (3): après 1962, seule émerge la superproduction La Légion saute sur Kolwezi (4). En Algérie, l’ armée
(1. Dominique Franche, dans Généalogie d’un génocide (Mille et Une Nuits, 1997), a démonté la construction du mythe racial, à laquelle contribua voici un siècle la raciologie européenne, française et allemande. Il a montré que les premiers pères blancs évangélisateurs du Rwanda avaient été formés par des manuels d’histoire qui faisaient une interprétation raciale de la Révolution française : la revanche du peuple gaulois contre les nobles, descendants des Francs, des » envahisseurs » renvoyés au-delà du Rhin, à Coblence… Cf. aussi Claudine Vidal, Sociologie des passions, Karthala, Paris, 1991.
- Sur les motivations de cette décision, cf. François-Xavier Verschave, Complicité de génocide ? Lapolitique de la France au Rwanda, La Découverte, 1994, p. 10-19.
- Depuis les indépendances africaines, l’armée française a effectué une vingtaine d’interventions d’envergure au sud du Sahara (cf. Observatoire permanent de la Coopération française, Rapport 1995, Desclée de Brouwer, 1995, p. 123-124) – sans compter les interventions clandestines.
- Sorti en 1981, le film s’inspire (très librement) de l’intervention des parachutistes français, en 1978, sur la ville minière zaïroise de Kolwezi (Katanga-Shaba), conquise par une rébellion » katangaise » venue de l’ Angola. On imputa aux rebelles un massacre d’Européens. Ceux-ci ont été en réalité assassinés par les troupes de Mobutu, qui voulait hâter la décision, par le président Giscard d’Estaing, d’une intervention française salvatrice. Cf. France-Zaïre-Congo, 1960-1997 Échec aux mercenaires, Agir ici et Survie/L’Harmattan, 1997, p. 30-38.)
(p.18) française défendait « la France » contre « la guérilla subversive ». Depuis, la Ve République demande à l’armée de défendre » les intérêts français » et nos alliés contre une « guérilla subversive » à l’ échelle continentale – entretenue bien sûr par « les ennemis de la France « , États-Unis en tête. Au Rwanda, les militaires français adoptent naturellement les préjugés en noir et blanc des soldats et officiers auprès desquels ils combattent. Ils diabolisent l’ennemi . Ils inventent le terme de « Khmers noirs » pour désigner les rebelles du FPR.
Jean Carbonare a soixante-six ans, l’allure modeste et les cheveux blancs. Il revient du Rwanda, où il a participé à une Commission internationale d’ enquête . Celle-ci a exhumé des charniers et constaté de nombreux massacres de Tutsis – hommes, femmes et enfants. Son rapport dénonce les tueries systématiques organisées par la mouvance présidentielle, voire par l’ entourage du général Habyarimana. Un bref reportage précède l’interview de Jean Carbonare sur le plateau de France 2. Il montre la Commission d’enquête au travail, les charniers, le regard narquois de certains villageois, l’air « étonné » d’un bourgmestre devant la fosse commune mise au jour dans son propre jardin, les parachutistes français qui, sur les routes du pays, « assurent un semblant de calme ».
L’interview commence.
(1. « Les militaires, reconnaît-on en haut lieu, ont fait du Rwanda une affaire personnelle. » Citation d’un haut responsable – anonyme – par Patrick de Saint-Exupéry dans son enquête La France lâchée par l’Afrique (Le Figaro du 2210611994).
Le 22 juin 1994, escortant deux émissaires du FPR au ministère de la Défense, Gérard Prunier y croise de ces officiers » faucons « . » Il fallut la présence d’un officier supérieur pour éviter une confrontation physique » (Rwanda : le génocide, Dagorno, 1997, p.344).
- La Commission internationale sur les violations des droits de l’homme au Rwanda a séjourné au Rwanda du 7 au 21 janvier 1993. Elle était composée de quatre organisations humanitaires : la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Africa Watch (département de Human Rights Watch), le Centre international des droits de la personne et du développement, et l’Union interafricaine des droits de l’homme. Elle a établi un rapport de 124 pages (mars 1993).)
(p.19) Bruno Masure : « […] On vient de voir des images tout à fait effrayantes, et vous avez d’autres témoignages à donner sur ces violations des droits de l’homme assez terribles ».
Jean Carbonare : « Oui. Ce qui nous a beaucoup frappés au Rwanda, c’est à la fois l’ampleur de ces violations, la systématisation, l’organisation même de ces massacres.
On a parlé d’affrontements ethniques, mais en réalité il s’agit de beaucoup plus […] : c’est une politique organisée que nous avons pu vérifier […]. On sent que, derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route. On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l’humanité dans le rapport que notre Commission a établi, et nous insistons beaucoup sur ces mots ».
Bruno Masure : « Alors, ce que vous dites, c’est qu’à la différence de ce qui se passe actuellement dans l’ex-Yougoslavie où on est un peu, malheureusement, spectateurs, là nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif nous pouvons agir sur l’événement ? «
Jean Carbonare : « Oui. Deux choses m’ont frappé. D’abord, l’implication du pouvoir [rwandais]. […] Tous les membres de la mission sont convaincus qu’il y a une responsabilité très grande, jusqu’à un niveau élevé dans le pouvoir. Notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a aussi une responsabilité. »
Après avoir cité le cas d’une femme qui a perdu ses quatre fils, il poursuit : «Les femmes de la minorité tutsie voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. […] J’insiste beaucoup, nous sommes (p.20) responsables. Vous aussi, monsieur Masure, vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose… «
Jean Carbonare est très calme, sa voix est douce, mais elle se tord soudain en un sanglot – comme si, quatorze mois à l’avance, il pressentait ce qui allait advenir du Rwanda. Sur le plateau, l’ équipe du journal télévisé est saisie par cette charge d’ émotion tout à fait inhabituelle. L’interruption est très brève. Ce n’est pas un épanchement. Jean Carbonare se reprend et achève sa phrase :
« … pour que cette situation change, parce qu’on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants ». Il poursuit, mais on entend les larmes remonter à fleur de voix. « On peut faire quelque chose pour elles. Notre gouvernement, en pesant sur les autorités de ce pays, qu’il assiste militairement et financièrement, peut très rapidement… En Yougoslavie, en Somalie, c’est un peu différent, c’est une situation qui nous échappe. Mais là on peut faire beaucoup. Nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Communauté européenne et du monde occidental « .
Cette prophétie en direct n’aura pas de suite. Jean Carbonare croyait encore qu’il était possible de convaincre l’exécutif français de changer de politique au Rwanda. Il n’a pas tout dit ce soir-là. Peut-être aurait-il dû déclarer tout cru devant les millions de téléspectateurs de la chaîne publique ce qu’il confiera en août 1994 au Nouvel Observateur (après le génocide) :
« J’ai eu deux grands chocs dans ma vie. Le premier, lorsque j’ai découvert qu’en Algérie on avait institutionnalisé la torture. Le deuxième, en janvier 1993, quand (p.21) j’ai vu des instructeurs français dans le camp militaire de Bigogwe, situé entre Gisenyi et Ruhengeri. C’est là qu’on amenait des civils par camions entiers. Ils étaient torturés et tués, puis enterrés dans une fosse commune que nous avons identifiée près du cimetière de Gisenyi ».
Peut-être aussi la divulgation de cette découverte « scandaleuse », qu’il réservait en 1993 à ses interlocuteurs officiels, n’aurait-elle rien changé. Il eût fallu que l’opinion publique se montrât concernée… « On peut faire quelque chose, […/ beaucoup », avait supplié Jean Carbonare devant des millions de témoins. Mais le « on » téléspectateur, attablé ou affalé dans un fauteuil, pouvait-il, comme on l’y invitait, se sentir « responsable » ? Était-il prêt à comprendre que son pays allait se rendre complice d’un génocide ? Qu’il suffirait peut-être de quelques milliers de courriers indignés, relayés par la presse, pour enrayer cet engrenage ? . L’Élysée était affaibli, et on était à quelques semaines des élections législatives…
Avec ses amis de l’ association Survie et l’ appui de Jean Lacouture, Jean Carbonare va mener durant le premier semestre 1993 un intense travail de couloir, jusqu’à l’Élysée, pour aviser les pouvoirs publics de ce qui se fomente dans ces marches de la francophonie. Le « Monsieur Afrique » du président Mitterrand, Bruno Delaye, est rencontré à plusieurs reprises. Jean Carbonare lui apporte un document vidéo de six heures, comportant des accusations et un témoignage² accablants à l’encontre de l » ami Habyarimana » : Bruno Delaye ne voudra pas le visionner.
(1. Le Nouvel Observateur du 04/08/94.
- Ce témoignage d’un ancien responsable des « escadrons de la mort », Janvier Afrika, ne sortira dans la presse qu’à la fin du génocide (Stephen Smith, » Rwanda : un ancien des escadrons de la mort accuse », in Libération du 21/06/1994 et Mark Huband, in The Weekly Mail and Guardian, repris par Courrier international du 30/06/1994.)
(p.23) La complicité française dans le génocide de 1994 ne fait pas de doute, hors de l’Hexagone. En France, plusieurs années après, on persiste à l’éluder. Concédons au ministre de la Coopération Charles Josselin « que ce ne sont pas les Français qui tenaient les machettes » 1. Cela n’exonère pas certains décideurs français de leurs responsabilités 2. Que Leguay ou Bousquet n’aient pas fermé eux-mêmes la porte des chambres à gaz ne suffit pas tout à fait à les innocenter.
Certes, dans la région, la violence et le malheur ne se sont pas arrêtés avec la fin du génocide d’avril-mai 1994 – un événement qui ne pouvait qu’exacerber les passions. Huit cent mille tués en un peu plus de sept semaines (un taux d’élimination quotidienne cinq fois plus élevé qu’à Auschwitz), cela signifie autant de dégâts qu’un tapis de bombes atomiques. S’ ajoutent aux morts les millions de blessés et mutilés, physiques et psychiques. Mais cela s’est passé en l’ absence quasi totale des caméras de télévision, mobilisées (p.24) par le scrutin qui, en Afrique du Sud, signifiait la fin de l’ apartheid. Ce génocide reste inouï, au sens littéral. Ses rares images ont été aussitôt effacées par la couverture médiatique sans précédent de l’épidémie de choléra à Goma, en juillet 1994 : cette fois, l’armée française omniprésente offrait aux journalistes du monde entier une logistique impeccable, et les compliments de son service de communication. Plus tard, la tragédie des réfugiés hutus massacrés, épuisés ou affamés lors de la guerre du Zaïre (1996-1997) l a achevé de brouiller les discours.
(p.25) La complicité dans l’horreur est le premier blocage. Les responsables français ont adhéré sans recul ni remords aux slogans ethnistes du génocide rwandais : le pouvoir absolu du « peuple majoritaire « , son droit illimité de « légitime défense » contre une « ethnie » minoritaire dont une composante, exilée en Ouganda, a poussé la félonie jusqu’à parler anglais! Le (p.26) catalogue des connivences avec les responsables du génocide est si épais – j’en donnerai un bref aperçu – qu’il marque notre pays au fer rouge d’une complicité imprescriptible. Il n’est pas très agréable de raviver la plaie.
(p.28) Le 7 avril 1994, les extrémistes du Hutu Power prennent le pouvoir à Kigali, avec l’appui de la garde présidentielle, des milices, de la gendarmerie, formée par des Français, et d’une partie des Forces armées rwandaises (FAR). Le noyau dur de l’organisation du génocide est un groupe d’officiers, dirigé par le colonel Théoneste Bagosora .. Le 12 avril, le général Augustin Bizimungu, un extrémiste, évince le chef d’ état-major modéré Marcel Gatsinzi. Dès lors, depuis le sommet de la hiérarchie, l’ armée s’ implique dans le génocide : elle couvre les massacres, et vient en appoint des milices lorsqu’elles sont « débordées ». Le 19 mai 1994, six semaines après le début du génocide, Philippe Jehanne, membre du cabinet du ministre de la Coopération Michel Roussin, avoue à un visiteur : « Nous livrons des munitions aux FAR en passant par Goma. Mais bien sûr nous le démentirons si vous le citez dans la presse. «
(L’expansion considérable de tous ces corps armés depuis le début de la guerre contre le FPR – de 5 000 à plus de 100 000 hommes au total, milices comprises – a été entièrement supervisée par la France (stratégie, encadrement, instruction, équipement). Cf. Patrick de Saint-Exupéry, articles cités.)
(p.29) Dix jours plus tôt, le général Jean-Pierre Huchon, qui commande alors depuis un an la coopération militaire franco-africaine, a reçu dans son bureau parisien l’un des principaux responsables des FAR, le lieutenant-colonel Ephrem Rwabalinda. Dans son compte rendu, celui-ci résume ainsi les «Avis et considérations du général Huchon » .
« a. Il faut sans tarder fournir toutes les preuves prouvant la légitimité de la guerre que mène le Rwanda de façon à retourner l’ opinion internationale en faveur du Rwanda et pouvoir reprendre la coopération bilatérale. Entretemps, la maison militaire de coopération prépare les actions de secours à mener à notre faveur.
« Le téléphone sécurisé permettant au Général Bizimungu et au Général Huchon de converser sans être écouté (cryptophonie) par une tierce personne a été acheminé sur Kigali.
Dix-sept petits postes A sept fréquences chacun ont été également envoyés pour faciliter les communications entre les unités de la ville de Kigali.
« Ils sont en attente d’embarquement à Ostende. Il urge de s’aménager une zone sous contrôle des FAR où les opérations d’atterrissage peuvent se faire en toute sécurité. La piste de Kamembe a été reconnue convenable aux opérations à condition de boucher les trous éventuels et d’écarter les espions qui circulent aux alentours de cet aéroport.
« b. Ne pas sous-estimer l’adversaire qui aujourd’hui dispose de grands moyens. Tenir compte de ses alliés puissants.
« c. Placer le contexte de cette guerre dans le temps. La guerre sera longue.
(p.30) « d. Lors des entretiens suivants au cours desquels j’ai insisté sur les actions immédiates et à moyen terme, attendues de la France, le général Huchon m’a clairement fait comprendre que les militaires français ont les mains et les pieds liés pour faire une intervention quelconque en notre faveur à cause de l’opinion des médias que seul le FPR semble piloter. Si rien n’est fait pour retourner l’image du pays à l’ extérieur, les responsables militaires et politiques du Rwanda seront tenus responsables des massacres commis au Rwanda.
« Il est revenu sur ce point plusieurs fois. Le gouvernement français, a-t-il conclu, n’acceptera pas d’ être accusé de soutenir les gens que l’opinion internationale condamne et qui ne se défendent pas. Le combat des médias constitue une urgence. Il conditionne d’autres opérations ultérieures /…/.»
Le général Huchon, à l’état-major de l’Élysée, puis au ministère de la Coopération, dirigea avec le général Christian Quesnot l’engagement militaire de la France au Rwanda. Même s’il est considéré comme l’un des partisans les plus engagés de la guerre contre le FPR (1990-1993), il est probable qu’il n’imaginait pas l’horreur du génocide. Quand celui-ci advient, suivi jour par jour par les services de renseignement français, il aurait pu avoir une réaction de recul horrifié devant le crime inouï de ses « alliés » et « frères d’armes ». Non. Il préfère s’inquiéter de leur mauvaise presse. Les gros titres sur les massacres interdisent aux Français d’aider trop ouvertement le camp du génocide à gagnerla guerre. Ils ne les empêchent pas de pourvoir abondamment, par des canaux clandestins, à son approvisionnement en armes et munitions .
(p.31) Car, sur fond de négation du génocide, « la guerre sera longue ». Ce propos prêté au général Huchon fait frémir. Dès juillet 1994, lorsque le service d’information des armées, le Sirpa, aura gagné avec l’opération Turquoise la bataille des médias, l’armée française pourra favoriser le repli de tout l’ appareil du Hutu Power. Elle collaborera avec Clément Kayishema, le préfet-boucher de Kibuye, sous l’administration duquel le génocide fit plus de 100 000 victimes. Elle transportera dans ses hélicoptères le « cerveau » présumé du génocide, le colonel Bagosora, et le chef des milices Interahamwe, Jean-Baptiste Gatete . Etc.
L’opération Turquoise fut ainsi un formidable trompe-l’oeil. L’alibi humanitaire ne trompait que les caméras complaisantes. Le corps expéditionnaire français était équipé de véhicules blindés, pour le combat. Il s’avéra souvent incapable de transporter et sauver les survivants Tutsis qu’il découvrait : drôle d’ opération humanitaire! Les organisateurs du génocide préparèrent un accueil triomphal aux troupes françaises. Leur station de radio, RTLM (« radio-machette »), avait même pensé aux détails. Plusieurs jours avant l’arrivée des Français, elle diffusait des messages du genre : « Vous, les filles hutu, lavez-vous et mettez une belle robe pour accueillir nos alliés français. Toutes les filles tutsi sont mortes, vous avez vos chances . »
L’état-major n’était pas seul à favoriser l’accomplissement du génocide. L’Élysée cautionnait l’engagement des militaires. Il organisait aussi le soutien diplomatique (aux Nations unies notamment) du « gouvernement provisoire » mis en place par le Hutu Power. Au cours de la troisième semaine d’avril, il parvint avec Mobutu à torpiller une réunion des pays de la région, en Tanzanie, pour réagir au (p.32) drame rwandais. Le 9 mai (le jour même où le général Huchon recevait l’émissaire des FAR), Bruno Delaye, le Monsieur Afrique de l’Élysée, confiait . « Nous ne voulons en aucun cas de ces rencontres en Tanzanie. La prochaine doit avoir lieu à Kinshasa [au Zaïre]. Nous ne pouvons laisser les pays anglophones [de l’Est africain] décider du futur d’un pays francophone. Nous voulons que Mobutu revienne au premier plan, il est incontournable, et nous allons y parvenir avec cette histoire du Rwanda 1. » Le génocide comme marchepied de la grande géopolitique française !. Une réaction rapide des États de la région aurait pu éviter des centaines de milliers de morts. Mais ces suppliciés ne comptaient pas face au «futur francophone du Rwanda. « Peut-on sérieusement imaginer, s’insurge la journaliste belge Colette Braeckman, que la défense de la francophonie puisse coïncider avec la protection d’un régime digne des nazis ? »
Le 27 avril, au milieu du génocide, Jean-Bosco Barayagziwa, leader du parti extrémiste CDR – aiguillon du basculement d’une part importante des élites rwandaises dans l’idéologie raciste du Hutu Power -, était reçu officiellement à l’Élysée, à Matignon et au Quai d’ Orsay, par François Mitterrand, Édouard Balladur et Alain Juppé . Pourquoi s’ en offusquer ? « Dans ces pays-là, un génocide, c’est pas trop important », confiera le Président à des proches, durant l’été 1994 .
Un an plus tard, le ministre de la Justice belge a rédigé une lettre « indignée » à son collègue français Jacques Toubon à propos des fréquents séjours en France du colonel Bagosora , – accusé d’ être, en quelque sorte, le Hitler du (p.33) génocide rwandais. En 1997,1′ avocat Éric Gillet, coordonnateur pour le Rwanda et le Burundi à la Fédération internationale des Droits de l’homme, constatait que, pour les coupables présumés du génocide, « le havre le plus sûr reste la France. Une personne arrêtée peut être libérée sous les prétextes juridiques les plus invraisemblables ». Quant aux responsables du génocide, comme le général Augustin Bizimungu, ils viennent « pour consultation ». Leurs troupes demeurent si utiles aux grandes manoeuvres franco-africaines ! Durant l’ été 1997, elles ont aidé le général Denis Sassou Nguesso, un grand ami de Jacques Chirac, à reconquérir le Congo et son pétrole …
Au bout de cette logique, on trouve une réunion interministérielle, mi-juillet 1996, à l’hôtel Matignon. Il s’ agit de décider la position de la France sur la création d’une Cour criminelle internationale (CCI) permanente, capable de juger les crimes de génocide et contre l’humanité. C’ est le grand enjeu juridique de cette fin de siècle, le premier pas vers un minimum de prévention des forfaits les plus abominables. Certes, la pénalisation ne suffit pas (on l’ a vu au Cambodge, en Bosnie et au Rwanda), mais au moins elle désigne le mal. Dans son livre L’État criminel , Yves Ternon a raconté ce qui s’ est réellement passé à Genève en 1948, lors de la discussion des conventions sur la prévention et la répression des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité : les États ont demandé à leurs représentants de trouver les discrètes dispositions qui rendraient ces conventions inapplicables.
Saisies à propos de crimes commis au Rwanda et en Bosnie, (p.34) les juridictions françaises ont, à plusieurs reprises, confirmé cette inapplicabilité …
Ces failles tragiques avaient conduit les esprits lucides à mener campagne pour la création d’une CCI. Jusqu’à l’été 1996, la France ne s’opposait pas vraiment à cette avancée institutionnelle. Certains la stimulaient : Louis Joinet, Robert Badinter, quelques diplomates. Mais, à la réunion de Matignon, le ministère de la Défense a fait valoir qu’une telle institution pourrait mettre en cause des officiers français pour leur rôle au Rwanda . L’ armée a imposé un revirement 3, qui s’est confirmé en août : à l’ONU,la France a pris la tête de l’ obstruction à la CCI, aux côtés de pays comme l’Irak, l’Iran, la Libye, la Birmanie…, au grand scandale de ses partenaires de l’Union européenne*. Ainsi, la « marge de manœuvre » passée et future de certains galonnés en Afrique, couverts par
(* Cf. Afsané Bassir Pour,À l’ONU,la Frances’oppose a la création d’une Cour criminelle internationale, in Le Monde du 06/09/1996; Michel Forst, Du « Jamais plus » au,.. « Encore un peu », in La Chronique d’Amnesty d’octobre 1996. Les délégués français demandaient par exemple de subordonner la saisine de la CCI à l’accord de l’État dont ressort le coupable présumé, de celui oont ressort la victime, de celui où s’est passé le crime, et du Conseil de sécurité de l’ONU. On ne pourraitjuger que les régimes vaincus et dépourvus de tout parrain parmi les membres permanents du Conseil de sécurité.)
(p.35) leurs mentors politiques, privera nos enfants d’une protection minimale contre le retour de l’abomination. Au même moment, Jacques Chirac, entouré de lycéens, allait à Auschwitz célébrer « le devoir de mémoire qui s’impose au monde. Et l’espérance que jamais, plus jamais, nulle part, ne s’accomplisse une telle horreur ». Prenons-le au mot, et allumons la lumière…
(p.61) Si s’ approche une échéance électorale française, il n’ est plus guère besoin pour le partenaire africain de tirer la sonnette : Paris devancera ses appels. On a pu constater une forte augmentation des aides hors projets dans l’année précédant de telles échéances. Les remontées de cash irriguent tous les partis dits « de gouvernement». Le mécanisme ne concerne pas que les dictatures affichées. Les démocraties de façade, verrouillées par la fraude électorale, ne sont pas en reste. Un haut fonctionnaire du Trésor français, situé à un poste-clef, me citait le Sénégal comme l’ exemple caricatural de l’engloutissement des flux d’aide financière – avec un degré rare de sophistication, et toutes les bénédictions présidentielles requises *.
(* Les présidents sénégalais et français suivaient de près (mais n’interrompaient pas, donc agréaient) le manège des » valises à billets » . « Rattaché à la présidence [sénégalaise], un cadre de la Banque de France informait non seulement Abdou Diouf mais le Trésorfrançais et même la cellule africaine de l’Élysée desprincipaux « porteurs de valises » bourrées de CFA, qui étaient souvent dans l’orbite de l’establishment politico-économique » (Antoine Glaser et Stephen Smith, Les « Nouveaux Blancs » aux commandes de l’Afrique, in Libération du 01/02/1994).)
(p.64) Même le Gabon, ce richissime protectorat pétrolier d’un million d’habitants (dont une moitié de travailleurs étrangers), bénéficie d’une importante « aide au développement » française. Certes, une grande partie de la population vit dans une grande pauvreté, sans par exemple d’accès aux soins ou à l’éducation. Mais c’est parce que le président Omar Bongo, (p.65) après s’ être considérablement servi lui-même, arrose tous azimuts ses nombreux amis de la politique ou des affaires, africains et français. Ces derniers se bousculent à l’hôtel Grillon, lors des fréquents séjours parisiens du munificent Omar. Moyennant quoi, le Gabon était en 1994, par habitant, le premier bénéficiaire de l’ APD française – sept fois plus que le Niger, dix fois plus que le Burkina !
On ne peut, après cela, qu’ accorder quelque crédit à la boutade de José Artur . « L’aide au développement consiste à prendre l’argent des pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres ». Il conviendrait d’ ajouter . « … parce que ces riches des pays pauvres en rendent une bonne part aux riches despays riches, qui organisent l’opération ». Ni par pure bêtise, ni par excès de philanthropie. Comme le résument deux journalistes très informés, Antoine Glaser et Stephen Smith :
» Les flots d’argent qui se déversaient dans les sables d’une Afrique nominalement indépendante, loin d’ assécher l’ ancienne métropole, l’irriguaient, voire arrosaient du « beau monde ». Une bonne partie des quartiers chics de Paris vivaient alors sur le miracle des liquidités remontant, parfois souterrainement, aux sources. […] Pour les happy few, le taux de retour de l’aide au développement « tartinée » sur la rente, déjà bien onctueuse, du pétrole et des produits tropicaux, était mirifique. À la limite de l’écoeurement. «
(p.67) Il n’étonne personne que l’on construise un hôpital, un institut technologique ou une Cité de l’information dont le coût d’entretien excède le budget de la Santé, de l’Éducation ou de la Communication du pays, une université inaccessible aux étudiants, un central téléphonique sans réseau, etc. Il ne choque personne qu’avec l’argent de l’APD on offre un Mystère 20 au richissime Bongo, puis que l’on rénove luxueusement son DC 8 personnel, qu’on achète un autre Mystère 20 au président centrafricain Kolingba2 ou, pour quelque 100 millions de francs, un Falcon 50 au général Habyarimana (p.38) l’équivalent du budget annuel de la coopération civile franco-rwandaise (avant 1994). Avec le retard qui facilite la prescription des détournements, ressortent des listes d’éléphants blancs. Antoine Glaser et Stephen Smith racontent ainsi l’université Bouygues à Yamoussoukro, la cimenterie de l’ Ouest africain à Lomé, la raffinerie du Togo, le projet d’usine de pâte à papier au Congo, celui des six complexes sucriers ivoiriens (on s’ est rarement autant « sucré »), la shopping-list gabonaise , à laquelle a aussi contribué le Conseil général des Hauts-de-Seine, à l’initiative de son président Charles Pasqua .
Depuis le bref retour de ce dernier au ministère de l’Intérieur (1993-1995), les armes et équipements des forces de sécurité intérieure peuvent bénéficier des crédits du Fonds d’aide et de coopération (FAC), comptés en APD. Au nom du renforcement de l’État de droit… Fréquemment d’ occasion, voire déclassées, ces « marchandises » sont le support de prodigieuses commissions. Et elles sont trop souvent utilisées à des exactions ou des tortures, par des régimes dédaigneux des droits de l’homme. En 1991, l’Union européenne a fixé un «code de bonne conduite » des clients potentiels : 50 des 76 pays acheteurs de matériels français n’y satisfont pas .
(p.69) Avant que les taux d’endettement de nombreux pays d’ Afrique ne deviennent aussi catastrophiques, les prêts bonifiés consentis au titre de l’APD bénéficiaient, comme en d’autres régions du tiers monde, de la garantie de la Coface, l’assurance du commerce extérieur. Cet organisme bénéficie lui-même, pour ses opérations avec les pays « à risques », de la garantie de l’État français. C’est donc le contribuable français qui, par dizaines de milliards, s’ajoutant à l’APD, a été convié à éponger les naufrages financiers de nombreux (p.70) grands contrats aidés : de 1981 à 1994, le déficit global de la Coface à la charge de l’État s’élève à plus de 100 milliards, et le coût budgétaire (intérêts inclus) à 172 milliards . Un autre Crédit Lyonnais!
Mais cela ne suffit pas. La plupart des pays « du champ » de la coopération française, ceux que notre pays a abondamment « aidés » depuis un tiers de siècle, sont désormais surendettés et comptent parmi les plus pauvres de la planète.
Les prêts qui leur sont consentis ne relèvent donc plus de la Coface. Il faut cependant traiter la dette, c’est-à-dire, selon que les cas sont plus ou moins désespérés, procéder à des annulations partielles ou à des rééchelonnements. Cela semble partir d’un bon sentiment, et répondre en partie à l’exigence « tiers-mondiste » d’une annulation du fardeau de la dette.
Mais il faut y regarder de plus près. Parmi les plus ardents défenseurs d’une remise globale de la dette, il y a tous ceux qui ont détourné les sommes prêtées (plus de 50 % en moyenne) et qui n’ont surtout pas envie d’un audit de l’utilisation des crédits. Plutôt que de répondre de l’endettement sur leurs fortunes personnelles, parfois gigantesques – celles des Houphouët-Boigny ou Mobutu ont approché ou atteint la dizaine de milliards de dollars -, ils préfèrent qu’on tourne la page. Une discrète amnistie, autorisant de nouvelles aventures…
L’hypocrisie s’installe aussi dans le calcul de l’ aide au développement . L’ ensemble des opérations de traitement de la dette sont comptées en APD! Mais c’est de l’ argent qui ne quitte pas Paris, et ne sert donc en rien au développement : simplement, Bercy règle chaque année aux créanciers, principalement la Caisse française de développement, les (p.71) échéances annulées. Il y en a au moins jusqu’en 2018, et pour plusieurs milliards de francs par an . l’APD est en quelque sorte hypothéquée pour vingt ans par ces remboursements programmés. Drôle de façon de remettre la dette : le coût de la remise est imputé fictivement au bénéficiaire, et on lui rappellera ce cadeau chaque année. Par ailleurs, ces opérations de réduction de la dette sont encore l’occasion de multiples dévoiements ou corruptions. Il y a toutes les spéculations, parfois très informées, sur la dépréciation de la dette : on rachète pour presque rien une créance sur un débiteur pas ou peu solvable, et tout d’un coup cette créance reprend de la valeur, directement ou indirectement, grâce à une opération de consolidation ou d’apurement décidée au Club de Paris ou au Club de Londres – les consortiums de créanciers publics ou privés. Ou bien une remise spécifique, ponctuelle, est accordée par Paris à un pays africain, à condition de servir au règlement immédiat d’un créancier français privé – un marchand d’avions ou d’armes, une banque, un exportateur agricole. On imagine que le bénéficiaire hexagonal d’une telle initiative n’a pas été pingre… Même chose pour les groupes français qui pourraient bénéficier d’un concept admirable : la transformation de la dette en participations dans les services publics africains privatisables (eau, électricité, téléphone, etc.).
L’État africain insolvable joue lui-même de son insolvabilité, qui n’est jamais totale, puisqu’on lui accorde régulièrement des bouffées d’ oxygène financier : il rembourse qui il veut, quand il veut, moyennant chaque fois un bakchich. On peut ainsi bâtir des fortunes sur la décrépitude d’un système, d’un État, d’un pays – le Zaïre, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, ou Madagascar, par exemple. Les entourages de l’Élysée ne sont pas forcément les moins initiés.
(p.72) On en viendrait à oublier que tout cela correspond à la malnutrition de millions d’enfants, à l’impossibilité d’ acheter des médicaments, à la ruine des hôpitaux et du système d’ éducation.
(p.74) Notre action au grand jour pourfaire parvenir à destination une partie des 40 milliards de l’ APD aura progressivement rencontré les réseaux et circuits qui, dans 1’ombre, dénaturent cette générosité collective des Français et maintiennent (p.75) les relations franco-africaines hors la loi. Jusque dans une confusion criminelle : la criminalité économique débouche sur le crime politique. Au printemps 1994, la complicité de la France avec le Hutu Power nous ancrera dans cette conviction : sans un minimum d’assainissement politique du terrain franco-africain, il n’est pas envisageable de refonder une coopération crédible.
(p.76) Le 7 avril 1994, nous apprenons l’attentat qui a abattu l’ avion du président rwandais Juvénal Habyarimana. Peu après nous arrivent les nouvelles des premiers massacres.
Nous sommes un moment stupéfaits par leur déchaînement, et par la réaction des autorités françaises : elles se contentent en apparence de sauver les Français ou autres Européens; elles exfiltrent à Paris une partie du clan Habyarimana et 34 Rwandais inconnus, sous couvert de l’évacuation d’un orphelinat. Certains reportages nous éclairent cependant, dans la presse écrite. Un génocide est en cours, exécuté par une armée et des milices équipées et entraînées par la France. Loin de se reprendre, celle-ci ne cessera, pendant et après ces massacres inouïs, d’apporter son soutien au camp du génocide.
(p.77) Il ne faut pas compter sur la télévision. Au départ, on l’a vu, ses moyens sont en Afrique du Sud pour filmer la fin de l’ apartheid. Une forte autocensure s’ exercera ensuite, et même une censure. La consigne : on ne montre que les réfugiés hutus, pas les massacres. L’Élysée est très vigilant. Comme on dit dans les rédactions, il ne faut pas tacher le futur mausolée de Mitterrand (envisagé alors près d’Alésia).
Comment arrêter les massacres ? Le 19 avril, nous lançons avec d’ autres ONG un comité Solidarités Rwanda-Grands Lacs. À partir de Montpellier, des chercheurs du CIRAD
(Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) mobilisent toute la communauté scientifique. Nous proposons un appel aux parlementaires, demandant avec insistance une intervention de la communauté internationale; demandant aussi « que les injonctions les plus fermes puissent être adressées aux instances politiques et militaires rwandaises ». Les parlementaires sont peu nombreux à réagirl. Beaucoup de nos relations politiques sont hésitantes. Elles nous écoutent exposer la tragédie, opinent du chef, puis, lorsque nous nous apprêtons à repartir, avouent leur blocage mental : « Vous avez probablement raison… Mais on ne va quand même pas se laisser marcher sur les pieds par les Anglo-Saxons ! »
La France reste scotchée au Hutu Power. Nous continuons de participer à la mobilisation des ONG françaises, mais celle-ci est rapidement aimantée vers les urgences humanitaires, au détriment de l’urgence politique. Début juin, le mal est déjà presque entièrement accompli, le mal absolu.
Nous voulons réagir vivement à l’ attitude de la France. Nous lançons une campagne de cartes postales à destination du Président. Nous multiplions tracts et courriers, jusqu’à faire (p.78)
rendre l’âme à notre photocopieur. Je veux engager une grève de la faim contre la prolongation intolérable de cette politique franco-africaine – « le plus long scandale de la République « , vient d’écrire Jacques Julliard . C’est un choix personnel, mais je suis minoritaire à Survie sur cette façon de réagir. Après de difficiles débats, nous optons pour une marche quotidienne aux Invalides, chaque après-midi, jusqu’ au 14 juillet. Elle n’empêchera pas la nébuleuse opération Turquoise.
Un Observatoire permanent de la coopération française (OPCF) venait de se constituer au début de 1994, réunissant une quarantaine d’ experts, d’ africanistes et de responsables d’ONG. Il me demande de rédiger un rapport sur la politique de la France au Rwanda. J’y passe le milieu de l’ été, muni d’une documentation déjà abondante. Le rapport, qui a la taille d’un livre, est diffusé sous forme de polycopié. Le milieu africaniste me fait passer le message : « Ce rapport sauve l’honneur des africanistes. » J’ apprécie le compliment. Mais, n’étant pas des leurs, j’eusse préféré que, montant plus hardiment au créneau, les africanistes le sauvent eux-mêmes. La Découverte me propose de faire de ce rapport un ouvrage destiné au grand public. Retravaillé, il sort de l’imprimerie juste avant le Sommet franco-africain de Biarritz, début novembre 1994 : Complicité de génocide? La politique de la France au Rwanda. Le point d’interrogation est une prudence de l’ éditeur. Je le juge pour ma part superflu.
Il m’a fallu ajouter un chapitre au rapport initial. Car au long de cet été 1994, il s’ est avéré que les horreurs franco-rwandaises n’ avaient rien d’ accidentel. Loin de tirer les leçons du carnage rwandais, les brillants concepteurs de la politique franco-africaine ont, en toute hâte, revisité leur (p.79) discipline de prédilection : la « géopolitique ». S’inquiétant du « vide » causé par l’effondrement du clan Habyarimana, ils ont multiplié les sollicitations envers le maréchal zaïrois Mobutu, le priant de prendre le relais et « d’étendre son ombre protectrice et pacificatrice sur la région des Grands Lacs ». Celui qui ruinait consciencieusement le Zaïre depuis plusieurs décennies et l’enfonçait dans le chaos, celui qui autorisait le massacre des descendants de Kasaïens au Katanga et des rwandophones au Kivu, redevenait le meilleur champion du combat francophone contre le président ougandais Museveni, qualifié d’ «anglo-saxon ». Il fallait montrer à tous les régimes autoritaires africains protégés par des accords de défense avec la France que la garantie de cette dernière ne s’arrêtait pas à une bavure, fût-elle dantesque.
Simultanément, notre pays vendait aux intégristes soudanais, le même paquet de « services militaires » qu’à l’ancien régime rwandais, pour permettre à Khartoum de mieux extermin .. er la résistance sudiste… adossée à l’Ouganda. Et l’on ébauchait une alliance franco-zaïro-soudanaise contre le « diable » ougandais et ses « suppôts » rwandais ou sud-soudanais…
En juin 1994, vers la fin du génocide, le président de la République François Mitterrand, chef des armées, imposa le passage de l’opération Turquoise par le seul Zaïre. Mobutu redevenait incontournable. On pouvait louer son « rôle stabilisateur dans la région » et sa « fidélité francophone ». Tout cela en connivence avec Jacques Foccart, le revenant gaulliste. Et en parfaite intelligence avec Charles Pasqua. Derrière les oppositions de façade, ce dernier a une conception très mitterrandienne des relations franco-africaines; il y (p.80) ajoute un sens des réseaux à faire pâlir Foccart. Depuis sa réinstallation au ministère de l’Intérieur, il militait pour la réhabilitation de Mobutu.
Le maréchal mérite bien de Turquoise. Il laisse s’installer sur le territoire zaïrois une impressionnante logistique française, puis compose avec l’exode de plus d’un million de réfugiés, provoqué par son allié le Hutu Power. Celui-ci parvient à transférer au Zaïre 20 000 tonnes de café, et les stocke dans des magasins appartenant à la famille Mobutu : un pactole, estimé à cinquante millions de dollars . Peu importe que la Garde présidentielle et l’année zaïroises continuent leurs divagations anarchiques ou que Mobutu soutienne la perpétuation de l’effroyable guerre civile angolaise : il sera invité au sommet franco-africain de Biarritz.
Entre-temps, la logistique française a pu prendre ses marques et ses aises au Zaïre. Et l’on a préparé la prise en tenailles de l’ Ouganda et de ses alliés (le Front patriotique rwandais et la SPLA du Soudanais John Garang) entre le Zaïre et le Soudan. La réelle collaboration entre les services spéciaux de ces deux pays 4 coïncide avec l’ aboutissement d’un spectaculaire rapprochement franco-soudanais, piloté par Charles Pasqua .
Qu’un ministre de l’Intérieur ait pu mener, à l’ aide de ses réseaux personnels, sa propre politique africaine et arabe, (p.81) nous en disait long sur le démembrement de la politique franco-africaine. Et la révélation des tractations qui permirent la capture de Carlos achevait de nous ouvrir les yeux sur l’ avilissement de cette politique.
Jean-Charles Marchiani, l’homme à tout faire du réseau Pasqua, a ravivé les contacts avec son « conscrit » le colonel Jean-Claude Mantion. Durant treize ans, cet officier de la DGSE, ancien mentor du président centrafricain Kolingba, avait gouverné de fait le Centrafrique, plaque tournante des évolutions de l’ armée française sur le continent. Son activité et son influence rayonnaient jusqu’à la mer Rouge. Il accepte d’ apporter son savoir-faire aux intrigues pasquaïennes.
De Bangui, il avait déjà resserré les liens avec les « services » soudanais, via son ami de longue date El Fatih Irwa, haut conseiller pour la sécurité du régime de Khartoum. Celui-ci deviendra le pivot des contacts franco-soudanais. Les deux amis proposeront à leurs mandants, sur un plateau, un deal en or : un booster pour la popularité de Charles Pasqua, contre la résolution d’une série de « difficultés » du régime soudanais. L’affaire est scellée lors d’une rencontre secrète à Paris, fin juillet. Hassan el-Tourabi, « guide » d’une militaro-théocratie qui ne se cache pas d’ entraîner de nombreux groupes terroristes, est reçu par le ministre français de l’Intérieur qui, en 1936, se faisait fort de « terroriser les terroristes ». Avec le succès que l’on sait.
(p.82) À Khartoum, rappelons-le, l’alliance de l’armée et des islamistes conjugue les méfaits d’un intégrisme agressif et d’un racisme de fait. Ses tenants prétendent imposer à tous leur conception de l’islam, leur Charia, pratiquée par les populations de langue arabe de la vallée du Nil : non seulement aux populations chrétiennes et animistes du Sud-Soudan, mais à l’ensemble de la mosaïque ethnique qui constitue la périphérie soudanaise . Plusieurs régions (dont les monts Nouba) et plusieurs ethnies (dont les Dinkas) ont été victimes – sous l’effet conjoint de la guerre civile, de la famine et de 1′ éviction – de destructions massives, à caractère parfois génocidaire. C’est le cas dans les monts Nouba. Au Sud-Soudan, le régime mène une atroce « guerre sainte », qui a fait plus d’un million de victimes.
Partisan de solutions radicales, le totalitarisme de Khartoum accumulait pourtant les problèmes. Le pays traversait une crise politique, sociale et économique. Placé sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, il était boycotté par la plupart des investisseurs privés ou institutionnels. Qu’à cela ne tienne. La France, promettent les négociateurs, se placera à l’avant-garde d’une campagne de réhabilitation, en direction de l’Union européenne et des États-Unis. Elle influencera dans le même sens la Banque mondiale et le FMI. Elle conseillera également à la banque Lazard d’accorder un prêt de plusieurs dizaines de millions de dollars pour permettre au Soudan de payer les intérêts de sa dette internationale.
Quant aux échéances de la dette soudanaise envers la France, elles seraient, pour l’essentiel, passées sur le compte pertes et profits de l’aide publique au développement (APD).
(p.83) Une deuxième louche d’APD pourrait bonifier des prêts à moyen et court terme. La Coface enfin, autre vache à lait, garantirait une série d’investissements français au Soudan. Deuxième problème, la rébellion sud-soudanaise. Pour la prendre à revers, on laissera aux troupes islamistes un droit de passage en Centrafrique, l’ ancien fief du colonel Mantion. En gage de bonne volonté, les services secrets français fournissent d’ailleurs des photos du satellite Spot identifiant les positions des « rebelles ». « C’est vrai que nous avons remis ces photos aux Soudanais, avoue-t-on à Paris. Cependant, nous croyions qu’ils n’étaient pas capables de les exploiter, ce qui suppose des connaissances techniques assez poussées. Mais, en fait, ils se sont dépannés avec l’aide de leurs amis irakiens… »
(cf Stephen Smith, La France aux petits soins pour la junte islamiste au Soudan, in : Libération, 12/01/1995)
Question armes, Jean-Charles Marchiani est l’homme de la situation. Ancien de la division armement de Thomson, le marché et ses filières n’ont guère de secrets pour lui. Il a carte blanche pour répondre aux besoins des Soudanais, à condition de ne pas mouiller la place Beauvau. Cela ne ferait d’ ailleurs que renforcer un appui « de routine » aux campagnes militaires islamistes : la fourniture, à des conditions très avantageuses, de munitions et pièces de rechange pour les armes françaises de l’ année soudanaise (automitrailleuses AML 90, canons de 155, hélicoptères Puma).
Question « ressources humaines », les autorités françaises accepteraient d’ accueillir un groupe d’officiers, de militaires et de policiers soudanais, pour les entraîner à la lutte anti-guérilla. À Khartoum, la France formera et équipera la « Gestapo » soudanaise .
Pour faire bonne mesure, la chaîne d’État France 2 passera au journal télévisé – après un très long entretien avec la présidente de SOS Attentats, au sujet de l’arrestation de Carlos – (p.84) un reportage « publicitaire » sur le Soudan, au terme duquel le Français moyen conviendra volontiers qu’il est urgent de déverser la manne de l’APD sur un pays si méritant.
Contre la livraison du Sud-Soudan au régime de Khartoum, la France a obtenu celle de Carlos. Plus « trente deniers » : la vente de trois Airbus, qui a généré de copieuses commissions à Paris, ainsi que des promesses de pétrole pour Total, et de grands travaux pour l’ entreprise GTM.
L’éditorialiste du Nouvel Observateur Jacques Julliard est l’un des rares à s’indigner de ce «marché de la honte ». Et cette indignation rejoint bien la nôtre, à l’époque :
« S’il s’ avérait que, pour des raisons électorales, Charles Pasqua avait troqué la livraison par le Soudan d’un assassin vieillissant contre la promesse de la complaisance, voire de la complicité française dans la guerre que mène le criminel régime islamiste de Khartoum contre les populations chrétiennes ou animistes du Sud-Soudan, alors il faudrait dénoncer l’un des forfaits les plus abominables d’une diplomatie sans scrupules et sans honneur. Quoi, cette trop longue indulgence […] témoignée à des dictateurs sanglants comme Milosevic en Serbie, Mobutu au Zaïre, Habyarimana au Rwanda ne suffit donc pas ? Faut-il vraiment que nous nous engagions maintenant dans le soutien, que dis-je, la réhabilitation d’un des pires régimes d’une Afrique toute poisseuse de sang […] ? Avant d’aider l’islam le plus intolérant à massacrer quelques-uns des plus nobles peuples de la terre, pensez-y dimanche à la messe, monsieur Balladur ».
« M. Balladur » laisse agir MM. Pasqua et Mitterrand, qui invitent MM. Tourabi, Mobutu, et quelques autres, sans parler (p.85) des visites clandestines des chefs militaires du Hutu Power. Il est loin le temps où M. Fabius s’offusquait de la réception du général Jaruzelski. Les ignominies franco-africaines ne sont ni confessées, ni réfléchies. Elles relèvent de l’impensé.
Pour tenter de les en sortir, nous décidons d’organiser avec Agir ici, lors du sommet de Biarritz, une « mise en examen de la politique africaine de la France ». Tout y passe, des dévoiements de l’aide aux errements soudanais, togolais, zaïrois et rwandais, avec une longue série de témoins. Le modeste hôtel-restaurant Le Dahu, où est organisée cette mise en examen, ne désemplit pas. Nombre de journalistes trouvent là une information moins verrouillée que celle du sommet officiel, tout proche. Les organisateurs décident de lancer le chantier des Dossiers noirs de la politique africaine de la France, dont les cinq premiers seront envoyés aux candidats à l’élection présidentielle (sauf Jean-Marie Le Pen).
Mais cela ne change rien au fond du problème. D’une part, trop d’ argent est en jeu, trop de leaders politiques sont perfusés par la « pompe A’fric ». La première valise à billets a le goût âcre de la première cigarette… et puis on reste fumeur. D’ autre part, les mondes politique et militaire français communient dans un étrange ressentiment séculaire contre les « visées anglo-saxonnes » en Afrique. La genèse et les avatars de ce « syndrome de F achoda », qui fait du régime de Khartoum, de Mobutu et du Hutu Power nos « alliés naturels », composent à eux seuls un tableau clinique stupéfiant.
Peu après l’élection de Jacques Chirac, Foccart impose ses façons de voir – contre Alain Juppé En 1996, l’année et la (p.86) coopération françaises co-organisent une énorme fraude électorale au Tchad. Puis Paris absout une escroquerie plus grande encore au Niger , et verrouille la dictature de Paul Biya au Cameroun : il s’agit, n’est-ce pas, d’accompagner ces pays francophones vers la démocratie… L’ancien patron de la DGSE, Claude Silberzahn, nous a d’ailleurs prévenus : « Dans plusieurs pays africains, les services spéciaux français protègent les hommes au pouvoir dont certains, c’est vrai, sont parfois des dictateurs mais c’est en faveur de ce que j’ appelle […] « la politique du moindre pire » ».
Mobutu est-il menacé ? Le conseiller élyséen Fernand Wibaux et le factotum de Charles Pasqua, Jean-Charles Marchiani, vont recruter des mercenaires parmi les miliciens de Karadzic, responsables du massacre de Srebrenica…
Comment est-on tombé si bas ? Qui décide de tout cela ? Ou plutôt n’en décide pas, dans un système franco-africain décérébré où une quinzaine de réseaux et lobbies entrechoquent leurs stratégies en un chaos ravageur. Il s’agit en réalité de la dérive d’un système, le foccartisme, mis en place dès 1958 par le plus proche collaborateur du général de Gaulle. Les pays francophones au sud du Sahara ont été, à leur indépendance, emmaillotés dans un ensemble d’accords de « coopération » politique, militaire et financière qui les ont placés sous tutelle. Des « amis » de la France ont été installés à leur tête, les autres ont été éliminés. Les « amis » ont été conviés à s’ enrichir, et à enrichir leurs parrains français : un système corrupteur dans tous les sens du terme, c’est-à-dire destructeur de tout projet politique et de l’État. Ce dernier a donc évolué vers la criminalisation et le clanisme, avec le risque d’incendies ethniques.
(p.87) On pourrait penser qu’après tant d’échecs et d’infamies, puis la mort de son fondateur, le foccartisme serait remisé. Mais l’ africaniste français le plus réputé, Jean-François Bayart, nous enlève nos illusions :
« La classe politique française, toutes familles politiques confondues, paraît tenir pour légitime le foccartisme comme conception des relations franco-africaines donnant la primauté à la politique des réseaux et à la confusion entre l’action paradiplomatique et les affaires privées. Il est improbable que la France renonce au foccartisme, pourtant responsable du fiasco de la politique africaine de notre pays. Tous les partis continuent d’y trouver leur compte, notamment en matière de financement des campagnes électorales . »
De plus, comme Bob Denard son corsaire, Jacques Foccart a pris en vieillissant une figure de papa gâteau, de « petit père des peuples africains », encensé à ses funérailles par une grande partie des « responsables » français.
Alors, plutôt qu’une critique historique ou géopolitique assez lointaine et trop peu évocatrice, il vaut mieux révéler la vraie logique du foccartisme à travers ses effets : des crimes, certains énormes, la plupart . occultés ou méconnus, ont ponctué depuis quarante ans l’histoire de l’Afrique foccartisée, celle des anciennes colonies françaises et de leurs voisins convoités.
Nombre de ses hommes ou mouvements politiques les plus prometteurs ont été exécutés, exterminés, justement parce qu’ils promettaient un avenir autre que la soumission. D’abominables guerres civiles ont été allumées, exacerbées ou prolongées pour élargir le pré carré francophone au détriment des Anglo-Saxons. La bannière humanitaire a été utilisée pour couvrir des trafics d’ armes – l’ entachant désormais de soupçon.
Criminelle Françafrique…
/CAMEROUN/
(p.91) « Ils ont massacré de 300 000 à 400 000 personnes. Un vrai génocide. Ils ont pratiquement anéanti la race. Sagaies contre armes automatiques. Les Bamilékés n’avaient aucune chance. /—] Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila « , témoigne le pilote d’hélicoptère Max Bardet . J’appris avec ces phrases le massacre littéralement inouï d’une population camerounaise au tournant des années soixante. Je m’ attachai à en savoir davantage. Ce ne fut pas facile, tant la terreur, là-bas, produit encore son effet. Ce n’est pas terminé .
En 1933, de jeunes Camerounais formés à l’école française créent la Jeucafra, Jeunesse camerounaise française. Parmi eux, un certain Ruben Um Nyobé, commis-greffier au tribunal de Yaoundé. Nettement pro-français, ce mouvement 8e pique au jeu de la conférence de Brazzaville où, en 1944, (p.92) le général de Gaulle avait annoncé des libertés politiques
nouvelles pour les peuples de l’Empire colonial .
Au même moment débouche le mouvement de syndicalisation suscité par des salariés français expatriés, travaillant dans l’ enseignement et les chemins de fer . Ce mouvement est proche de la CGT française, à laquelle adhéraient la plupart de ses initiateurs. Il aboutit en décembre 1944 à la création de l’Union des syndicats confédérés du Cameroun (USCC). Ruben Um Nyobé s’y inscrit, avec plusieurs de ses amis.
L’injustice sociale et politique est alors criante. Les colonies ont connu 1’« effort de guerre », l’austérité et une forte hausse des prix. A la Libération, les salaires des fonctionnaires de nationalité française sont augmentés, ceux des Camerounais restent bloqués : la ségrégation continue! Anticipant sur les libertés promises, la Jeucafra exige l’impossible : la liberté de parole et de presse, la participation des autochtones à la gestion des affaires publiques, etc. Comme en Algérie, au Sénégal, ou plus tard à Madagascar, le refus est brutal : lors d’une grève le 27 septembre 1945, une bande de colons armés tirent sur une manifestation d’ Africains. Il y a au minimum soixante morts . Ainsi restauré, l’ « ordre » colonial engendre des frustrations considérables.
(p.96) Dès la fin des années quarante, Jacques Foccart tisse en Afrique ses réseaux gaullistes, si conservateurs qu’ils en agacent le général de Gaulle lui-même, pourtant très attaché à l’Empire français. Au Cameroun, le parti gaulliste, le RPF (Rassemblement du peuple français), ne jure que par la répression. Il est en concurrence avec la coalition au pouvoir à Paris, la « troisième force » ni communiste, ni gaulliste. Mais celle-ci est tout aussi hostile que le RPF aux revendications de l’UPC.
Le haut-commissaire Soucadaux introduit les socialistes de la SFIO, tandis que Louis-Paul Aujoulat, secrétaire d’État à la France d’ outre-mer, missionne les démocrate-chrétiens du MRP. Les deux partis suscitent ensemble un « Bloc des démocrates camerounais ». Ils l’arriment aux structures coutumières conservatrices, aux régions (le Nord, le Centre) ou aux ethnies (les Doualas par exemple) sensibles à l’épouvantail bamiléké* .. Le corps électoral étant très restreint et la fraude systématique, le « Bloc » devance l’UPC aux élections de 1951 et 1952.
(* Contre l’ ANC de Mandela, le régime d’apartheid sud-africain dressera de même l’Inkatha du chef zoulou Buthelezi – futur adhérent à… la filiale africaine de l’Internationale démocrate-chrétienne.)
(p.97) Ce résultat inique a pour effet de dégoûter de la voie électorale le parti d’Um Nyobé. Ce qui lui vaut un grief supplémentaire : le refus de la démocratie ! Le 13 juillet 1955, le haut-commissaire Roland Pré, successeur de Soucadaux, décrète l’interdiction de l’UPC sur l’ ensemble du territoire. Il lance un mandat d’arrêt contre Um Nyobé, pour atteinte à la sûreté de l’État. Une seule issue est laissée aux indépendantistes : le maquis.
En 1957,le nouveau haut-commissaire Pierre Messmer, tout en réaffirmant « le maintien de la tutelle confiée à la France », tente une médiation via un prélat camerounais : Mgr Thomas Mongo rencontre Um Nyobé. La négociation tourne court. L’UPC, ancrée dans le mouvement mondial de refus du colonialisme, n’ est pas prête à céder sur l’ essentiel : l’indépendance. La position de l’Église catholique n’a pas facilité la tâche du médiateur : elle est vivement hostile à l’UPC, dont le leader est de surcroît un fidèle protestant. Dans une « lettre commune », les évêques du Cameroun avaient mis en garde leurs ouailles contre ce parti, en raison « de son attitude malveillante à l’égard de la Mission catholique et de ses liens avec le communisme athée condamné par le Souverain Pontife ». Ancien séminariste, le Premier ministre et leader du Bloc des démocrates, André-Marie Mbida, dénonce la « clique de menteurs et de démagogues » de l’UPC. À la même époque, on observe une attitude tout à fait similaire de l’Église au Rwanda, face aux partisans de l’indépendance.
(p.101) Contre ce qu’il appelle les « bandes rebelles », Jacques Foccart suit au jour le jour l’évolution de la situation : il est le premier destinataire du rapport quotidien du Sdece (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, principal service secret français, rebaptisé DGSE 2 en 1982) ; à partir de 1960, son ami le colonel Maurice Robert crée le service Afrique du Sdece, étroitement et exclusivement rattaché à Foccart. Il est ‘nécessaire, pour la suite de cette histoire, de garder en mémoire cette constante : jusqu’en 1974, depuis l’Élysée et ses bureaux annexes, Foccart tient pratiquement tous les fils, officiels ou cachés, des relations franco-africaines; sous Giscard et Mitterrand, l’ écheveau sera devenu tel et les relais africains si bien rodés que l’influence officieuse restera déterminante.
Aussitôt né, le Sdece-Afrique enfante et instruit une filiale camerounaise, le Sédoc : sous la direction de Jean Fochivé, elle sera vite réputée pour sa sinistre « efficacité « . On y torture à tour de bras. Côté police, un redoutable professionnel français, Georges Conan, démontre ses talents – dont celui de multiplier les aveux et dénonciations. Pour les affaires militaires, deux conseillers viennent encadrer le président Ahidjo : le colonel Noiret et le capitaine Leroy. L’ancien ministre des Armées Pierre Guillaumat confirme : « Foccart a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il a maté la révolte (p.102) des Bamilékés avec Ahidjo et les services spéciaux .» Au passage, on notera la présentation ethnique d’une révolte politique…
Foccart expédie au Cameroun une véritable armée : cinq bataillons, un escadron blindé, des chasseurs bombardiers T 26. À sa tête, un vétéran des guerres d’Indochine et d’ Algérie, le général Max Briand, surnommé le « Viking ». Sa réputation le précède : en Extrême-Orient, ce colosse blond a commandé durant deux ans le 22e RIC – les casseurs de Viets . Georges Chaffard décrit ainsi l’ arrivée de Briand en pays bamiléké : « Douze fois, le convoi de véhicules doit s’ arrêter, et l’escorte mettre pied à terre pour dégager la route. Ce sont de véritables grappes humaines, sans armes, mais hostiles, qui barrent le passage et s’agrippent aux voitures. Rarement insurrection a été aussi populaire .. «
Le général Briand se pose en rouleau-compresseur et le colonel Lamberton en stratège. L’objectif, éradiquer l’UPC, est poursuivi selon une double approche : d’un côté, les camps de regroupement, sous l’ autorité de « capitas » (une variété de kapos) ; de l’ autre, la politique de la terre brûlée. La lutte antiguérilla menée par les commandos coloniaux est d’une brutalité inouïe. Vagues d’hélicoptères, napalm : c’est une préfiguration de la guerre du Vietnam que se jouent les vétérans d’Indochine. Leur rage est d’autant plus grande que les maquisards, opérant presque à mains nues – mais sur plusieurs fronts – remportent des succès ponctuels.
Charles Van de Lanoitte, qui fut de longues années correspondant de Reuter à Douala, parle de 40 000 morts (p.103) en pays bassa, en 1960-1961 : 156 Oradour, autant de villages totalement détruits avec ceux qui n’ avaient pu les fuir .
(Lettre ouverte à Georges Pompidou, citée par Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun, Maspero, 1972. Jusqu’à aujourd’hui, il a été impossible (à ma connaissance) de procéder à un décompte quelque peu précis du nombre des victimes de l’éradication de l’UPC en pays bamiléké. Dans l’évocation de cette tragédie, Mongo Beti a été un précurseur. Plusieurs des sources citées plus haut sont redevables de ses travaux.)
Le journaliste décrit aussi «le régime effroyable des camps de tortures et d’extermination » dont il a été « le témoin horrifié » :
« Quelques exemples de tortures :
« LA BALANÇOIRE : les patients, tous menottés les mains derrière le dos et entièrement nus, dans une pièce à peine éclairée, sont tour à tour attachés, la tête en bas, par les deux gros orteils, avec des fils de fer qu’ on serre avec des tenailles, et les cuisses largement écartées. On imprime alors un long mouvement de balançoire, sur une trajectoire de 8 à 10 mètres. À chaque bout, un policier ou un militaire, muni de la longue chicotte rigide d’un mètre, frappe, d’abord les fesses, puis le ventre, visant spécialement les parties sexuelles, puis le visage, la bouche, les yeux. […] Le sang gicle jusque sur les murs et se répand de tous côtés. Si l’homme est évanoui, on le ranime avec un seau d’eau en plein visage. […] L’homme est mourant quand on le détache. Et l’on passe au suivant…
« Vers 3 heures du matin, un camion militaire emmène au cimetière les cadavres. […] Une équipe de prisonniers les enterre, nus et sanglants, dans un grand trou. […] Si un des malheureux respire encore, on l’enterre vivant…
« LE BAC EN CIMEN’T . les prisonniers, nus, sont enchaînés accroupis dans des bacs en ciment avec de l’ eau glacée jusqu’aux narines, pendant des jours et des jours. […] Un système perfectionné de fils électriques permet de faire passer des décharges de courant dans l’eau des bacs. […] Un certain nombre de fois dans la nuit, un des geôliers, (p.104) « pour s’ amuser », met le contact. On entend alors des hurlements de damnés, qui glacent de terreur les habitants loin à la ronde. Les malheureux, dans leurs bacs de ciment, DEVIENNENT FOUS!…
« Oui, j’ affirme que cela se passe depuis des années, notamment au camp de torture et d’extermination de Manengouba (Nkongsamba). »
Le fil conducteur est évident : l’Indochine, l’Algérie, le Cameroun… jusqu’à ces camps de torture au Rwanda d’ avant le génocide, que décrit Jean Carbonare. L’impunité encourage la reconduction.
Pendant ce temps, les « services » camerounais et français font des ravages dans les milieux upécistes. Le Sédoc se charge du tout venant : il fait arrêter des milliers de « suspects », et les conduit dans les camps ci-dessus évoqués… Au Sdece reviennent les têtes pensantes : le 15 octobre 1960, à Genève, l’un des ses agents empoisonne au thallium le chef de l’UPC Félix Moumié. Constantin Melnik, responsable des Services secrets auprès du Premier ministre Michel Debré, explique qu’une telle opération « Homo » (comme homicide) ne pouvait être déclenchée que par l’Elysée, c’est-à-dire au moins par Jacques Foccart .
C’est à un ami sexagénaire, le Franco-Suisse William Bechtel, alias « Grand Bill », que Foccart confie l’opération. William et Jacques se retrouvent régulièrement à Cercottes sur le terrain d’entraînement des réservistes du Sdece. Bechtel est un anticommuniste de choc, ancien commando d’Indochine et chargé du maintien de l’ordre chez Simca, (p.105) contre la CGT. On imagine les arguments que Foccart a trouvés pour le convaincre, du genre « l’UPC égale le Vietminh ».
Se faisant passer pour un journaliste suisse, Bechtel approche Moumié au Ghana, sympathise avec lui, puis le retrouve lors d’un déplacement à Genève. Il le convie à dîner au restaurant Le Plat d’ argent, la veille du jour où le chef de l’UPC doit reprendre l’avion pour l’ Afrique : c’est là-bas que la cible est censée mourir, loin de toute police scientifique et de la presse occidentale. Comme Moumié ne boit pas le pastis empoisonné, Bechtel verse du thallium dans un verre de vin. Mais, assoiffé par la discussion qui suit le repas, Moumié finit par avaler le pastis d’un trait. La double dose accélère l’effet du poison. Vers la fin de la nuit, le leader camerounais se fait transporter à l’hôpital, où il meurt dans d’atroces souffrances, non sans avoir diagnostiqué son propre empoisonnement et l’avoir dit au personnel soignant.
Son assassin se réfugie sur la Côte d’Azur, dans une villa louée par le Sdece. Durant quinze ans, il échappera au mandat d’arrêt international tardivement lancé par la Suisse. Arrêté à Bruxelles en 1975, extradé, il sera acquitté en 1980. Au bénéfice du doute… et des extraordinaires pressions exercées par l’Élysée . En 1995, Foccart n’ avait toujours aucun regret de l’élimination de Moumié : « Je ne crois pas que cela ait été une erreur . »
Le chef de l’UPC n’ a pu préparer sa succession. Une direction bicéphale se met en place : Abel Kingue en exil (au Ghana), Ernest Ouandié dans le maquis. Les combats, et les massacres de villageois par les troupes franco-camerounaises, durent jusqu’en 1963. Ouandié conserve un noyau de (p.106) maquisards jusqu’en août 1970. Il est trahi à son tour lors d’un déplacement organisé par l’ évêque de Nkongsamba en personne, Mgr Albert Ndongmo, qui l’a transporté dans sa 404 Peugeot. Arrêté, il est fusillé sur la place publique de Bafoussam en janvier 1971. La guérilla d’une autre branche de l’UPC, installée dans les forêts du Sud-Est camerounais à partir du Congo voisin, n’ a pas eu meilleur sort : elle a été décimée en 1966, son leader Afana Osendé a été décapité, et sa tête ramenée à Yaoundé .
Côté français, le colonel Lamberton concevait cette guerre civile comme une façon de résoudre le « problème bamiléké » . À la lumière de ce qui s’est passé au Rwanda de 1959 à 1994, il n’est vraiment pas inutile de relire ce qu’écrivait de ce « problème « , en 1960, l’officier français qui fut chargé de le « traiter » :
« Le Cameroun s’engage sur les chemins de l’indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou bien gênant. Ce caillou, c’est la présence d’une minorité ethnique : les Bamiléké, en proie à des convulsions dont l’origine ni les causes ne sont claires pour personne. […] Qu’un groupe de populations nègres réunisse tant de facteurs de puissance et de cohésion n’est pas si banal en Afrique centrale […]. L’histoire obscure des Bamilékés n’ aurait d’ autre intérêt qu’anecdotique si elle ne montrait à quel point ce peuple est étranger au Cameroun .»
(p.107) Cela ressemble furieusement à la construction raciste de la menace tutsi! Il n’est pas question de laisser les « Camerounais authentiques » (les non-Bamilékés) se charger seuls de soumettre ces « étrangers » conscients et solidaires :
« Sans doute le Cameroun est-il désormais libre de suivre une politique à sa guise et les problèmes Bamiléké sont du ressort de son gouvernement. Mais la France ne saurait s’en désintéresser : ne s’est-elle pas engagée à guider les premiers pas du jeune État et ces problèmes, ne les lui a-t-elle pas légués non résolus ? ».
Mais le pompier de ce problème incandescent n’ est-il pas aussi le pyromane ? Selon le philosophe camerounais Sindjoun Pokam, « c’est la France qui produit, crée, invente le problème bamiléké et l’impose à notre conscience historique. Derrière le problème bamiléké, il y a en vérité le problème français quis’exprime sous les espèces du conflit entre les intérêts de l’État français et ceux du peuple camerounais « . De la même manière, il y avait le problème belge derrière le problème hutu-tutsi : les querelles Flamands-Wallons, entre autres, ainsi que des enjeux financiers et religieux.
C’est en tout cas le moment de rappeler la maxime du plus célèbre des colonisateurs français, le maréchal Lyautey : « S’il y a des moeurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu’il faut démêler et utiliser à notre profit, en opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres . «
(p.108) Depuis 1984, je compte parmi les Français plutôt bien informés sur l’Afrique. C’est seulement en 1993 que j’ai pris connaissance des massacres français au Cameroun. Pourtant, ce crime de guerre à relents racistes, si ample et si prolongé, est proche du crime contre l’humanité. Décrire et faire connaître ce premier grand crime foccartien est indispensable à l’intégrité d’une mémoire française. Comprendre pourquoi la presse n’en a rien dit, et comment il a pu être si longtemps ignoré, ne serait pas sans enseignements sur les contraintes et tentations des correspondants français en Afrique. L’étude reste à faire…
Les massacres commis par l’ armée française ont aussi bénéficié, il faut le reconnaître, d’une conjoncture médiatique très propice : de 1960 à la fin de 1962, l’attention de l’opinion hexagonale est captivée par l’issue mouvementée du conflit algérien. La proximité d’un drame qui concerne un million de nationaux, les Pieds-Noirs, occulte les cris d’horreur qui s’échappent difficilement d’une Afrique équatoriale à faible immigration française. En métropole, l’opinion n’a d’ailleurs jamais eu qu’un infime écho des massacres coloniaux. Depuis la Libération, leurs auteurs poursuivaient leur besogne en toute quiétude : Sétif, Hanoï, Madagascar …
(cf Yves Benot, Massacres coloniaux, La découverte, 1994)
/TOGO/
(p.109) Le 27 avril 1960, le Togo accède à l’indépendance. Cette ancienne colonie allemande, sous mandat français depuis quatre décennies, est un pays tout en longueur, dix fois moins vaste que la France. Très ouvert sur l’extérieur, il l’est aussi au débat politique. Ses habitants ont obtenu que soit organisé en 1958, sous supervision des Nations unies, un scrutin incontestable, largement remporté par l’Union nationale togolaise. Le chef de ce parti, Sylvanus Olympio, est un cadre international de très haut niveau . C’est aussi un militant chevronné de l’ émancipation africaine. À cinquante-huit ans, il touche au but de son existence.
(p.111) Mille jours n’ ont pas passé, ce samedi 12 janvier 1963. Parlant six langues, Olympio est un de chef stature internationale. Sexagénaire, indépendantiste de longue date, il acquiert l’influence d’un sage et peut prétendre, au même titre qu’Houphouët, au rô1e de juge de paix régional. Diplômé de la prestigieuse London School of Economics, il travaille sans relâche au développement de son pays. L’exportation de phosphates, de toute première qualité, alimente les caisses de l’État. On vit en démocratie au Togo, ce qui est rare et va le rester. Le Président n’éprouve pas le besoin d’une protection particulière. La France ne veille-t-elle pas aux humeurs des minuscules forces de sécurité togolaises, qu’elle a formées et qu’elle encadre?
Il est près de minuit à Lomé. Au premier étage de sa villa proche de l’Océan, gardée seulement par deux policiers, le Président dort du sommeil du juste . Toute la journée, il a (p.112) travaillé au projet de charte de l’Organisation de l’unité africaine (OU A), dont la rédaction lui a été confiée. Dina, la femme de Sylvanus, est réveillée. Elle a entendu des bruits bizarres devant l’entrée de la villa. Une altercation monte. Soudain, des coups de feu éclatent. Réveillé à son tour, Sylvanus Olympio se lève. Il allume la lumière et regarde vers la rue. Des balles le visent. Vite, il éteint. Lui et sa femme s’ aplatissent.
Quand la fusillade cesse, au bout d’une dizaine de minutes, le Président enfile un short kaki, une chemisette et des sandales légères. Il demande à son épouse de l’ attendre et descend au rez-de-chaussée. Il cherche à sortir par la salle à manger, mais la porte est bloquée de l’extérieur. Il passe par une fenêtre, traverse le jardin et franchit le mur de la propriété voisine – qui se trouve être l’ ambassade des États-Unis. Le centre de la cour est un parking. Olympio se cache dans une vieille Buick.
Pendant ce temps, la dizaine d’assaillants cherche à défoncer la porte principale de la villa. Ils y parviennent et, vers 1 heure du matin, six d’ entre eux investissent la maison.
Manifestement, ces hommes en tenue de combat sont des militaires. Ils repoussent contre un mur Dina, ses enfants et les .domestiques, fouillent la maison, mitraillent les placards, s’acharnent sur la bibliothèque. À leurs questions, Dina Olympio ne peut répondre que la vérité : elle ne sait pas où est passé son mari. Le chef du groupe décroche alors le téléphone : « Allô Monsieur Mazoyer . Nous sommes chez lui ! Il a disparu. » Henri Mazoyer est l’ ambassadeur de France à Lomé…
(p.113) Le chef du commando qui pourchasse Olympio est un certain Étienne Gnassingbe Eyadéma. Sergent de l’ armée française, âgé d’ environ vingt-sept ans, il vient d’ être démobilisé au terme de la guerre d’Algérie. Ils sont un certain nombre dans son cas à traîner leur désoeuvrement au pays natal. Une milice idéale. Un autre ancien d’ Algérie, l’ adjudant Emmanuel Bodjollé, a recruté une fine équipe dans la région de Kara, au nord du Togo. Chef apparent des opérations putschistes, il est basé à Lomé, au camp militaire de Tokoin. C’est le point de ralliement des insurgés, à cinq kilomètres environ de la villa présidentielle. Un second commando, dirigé par le sergent Robert Adewi, a réussi à arrêter la quasi-totalité des ministres et les a conduits au camp Tokoin. Étienne Eyadéma, lui, rentre bredouille. Bodjollé le renvoie vers la villa d’ Olympio, avec mission de procéder à une fouille plus minutieuse. En vain.
La gendarmerie du Togo est commandée par un officier français, le commandant Georges Maîtrier – que l’on a vu plus haut « nettoyant » le pays bamiléké. Il est aussi, choisi par l’Élysée, le conseiller militaire du président de la jeune République togolaise. Il appartient au Sdece, comme son adjoint le capitaine Henri Bescond . On avertit le lieutenant de gendarmerie Bodjona des menaces qui pèsent sur le président Olympio. À 3 heures du matin, cet officier togolais s’ en va, avec quelques hommes, demander armes et munitions à Georges Maîtrier. Après un temps de réflexion, le (p.114) commandant leur remet des fusils-mitrailleurs et un carton de munitions. Les gendarmes filent en Jeep vers la villa d’Olympio. Arrivés sur les lieux, ils veulent charger leurs armes : les munitions ne correspondent pas. Le sergent Eyadéma leur propose de se joindre aux putschistes. Les gendarmes refusent, et retournent vers Maîtrier : introuvable.
De son côté, Eyadéma n’ arrive à rien. Il fait plusieurs allers-retours à Tokoin. Les mutins s’inquiètent. Léon Poullada aussi, depuis l’étrange coup de fil de son confrère Mazoyer. Il quitte son domicile et va jusqu’à son ambassade, à trois kilomètres de là. Il y arrive vers 5 heures, et doit longuement négocier pour que les insurgés le laissent entrer. Sitôt franchi le portail, il emprunte une lampe-tempête au veilleur de nuit et inspecte la cour. Vers le parking, il entend l’appel chuchoté d’Olympio. Il s’approche. Le président togolais lui résume ce qu’il sait des événements. Léon Poullada veut l’abriter dans les bureaux de 1’ambassade, mais le personnel n’est pas arrivé, et lui-même n’a pas pris les clefs.
Il retourne à son domicile, non sans avoir été interpellé par les mutins à sa sortie de l’ambassade. Chez lui, il appelle son collègue Mazoyer. Il lui raconte innocemment ce qu’il a vu et entendu. Henri Mazoyer lui déconseille vivement d’accorder l’asile au président Olympio et l’invite à ne pas se mêler d’une affaire purement togolaise. Léon Poullada réveille alors par téléphone son vice-consul Richard Storch, qui habite juste en face du portail de 1’ambassade. Il lui demande de veiller au grain. En échec, les putschistes sont réunis chez le sergent Robert Adewi, prêts à laisser tomber. Vers 6 heures, ils voient arriver un émissaire du commandant Maîtrier. Informé par l’ambassadeur Mazoyer, ce dernier leur fait savoir où est
Olympio, et leur demande d’« achever le travail commencé», au risque sinon d’être exécutés. Les plus « mouillés », dont Eyadéma, Bodjollé et Adewi, décident alors de repartir vers l’ ambassade des États-Unis.
(p.115) Entre-temps, deux députés du Nord-Togo, Moussa Kona et Jules Moustapha, sont allés porter à Dina Olympio un message des insurgés : ils exigent la démission du chef de l’État. La femme du Président ne sait toujours pas où est son mari. Instinctivement, elle regarde par une fenêtre donnant sur 1’ambassade voisine. Le jour se lève. Elle aperçoit Sylvanus, qui, de la Buick, lui fait signe de venir. Et puis des militaires qui escaladent le mur d’enceinte. Elle s’empresse d’aller mettre un pagne pour sortir.
Le sergent Eyadéma a raconté la suite à deux journalistes, le surlendemain : Chauvel, du Figaro et Pendergast, de Time-Life . « À l’ aube, nous sommes allés vers leparking de 1’ambassade américaine. L’homme, tout sali, était blotti sous le volant d’une Plymouth de 1’ambassade, garée là. On lui a dit : ‘Nous t’avons repéré, sors de là! » Olympio a répliqué . « D’accord, j’arrive. Où m’emmenez-vous ? – Au camp militaire », avons-nous répondu. Il est descendu de la voiture et a marché vers le portail de 1’ambassade. Là, il s’est arrêté [réalisant sans doute que, s’il continuait, il perdait toute protection diplomatique], et nous a dit qu’il ne voulait pas aller plus loin. Je décidai : c’est un homme important, et ilpourrait y avoir des manifestations de foule s’il restait ici. Aussi, je l’ai descendu. »
En face, le vice-consul américain de faction « n’a pas bien vu » : prenant l’homme en short et chemise pour un aide-cuisinier, il dit être allé se restaurer à la cuisine. C’ est à ce moment que les coups de feu ont éclaté. Eyadéma abrège probablement ]’histoire. Il n’était pas encore là quand quatre soldats sont allés déloger Olympio et l’ont conduit au portail : ne sachant pas conduire, il avait dû chercher un véhicule et son chauffeur qui le ramène du (p.116) camp Tokoin vers le quartier présidentiel. Sortis de la cour de l’ ambassade, ses comparses sont perplexes : ils ont laissé repartir leur Jeep , . eux aussi, il leur manque un véhicule pour emmener leur prisonnier au camp Tokoin. Ils hèlent une Volkswagen de passage, croyant avoir affaire à un Européen. C’est en réalité un métis togolais, Yves Brenner, rédacteur en chef de Togo Presse. Il leur répond en éwé (la langue du Sud). S’apercevant de leur méprise, les insurgés le chassent.
Survient le sergent Eyadéma, en Jeep. « Qu’attendez-vous ? » demande-t-il aux soldats. « La Jeep. – Pour quoi faire ? Descends-le! » crie-t-il au soldat Kara. Celui-ci tire aux pieds d’Olympio. Furieux, Eyadéma lui arrache son arme et tire trois balles, à la poitrine et l’ abdomen du Président, qui s’écroule. Encore vivant, il se tord de douleur. Alors, Eyadéma sort son poignard et lui coupe les veines. Pour finir, il lui taillade la cuisse gauche avec la baïonnette. « C’est comme ça que je faisais en Algérie, pour m’assurer que mes victimes étaient bien mortes », conclut-il en souriant, avant de rembarquer dans la Jeep avec ses complices. Il est 7 h 15. À son bulletin de 6 heures, France Inter avait déjà annoncé la mort de Sylvanus Olympio…
Dina Olympio surgit au coin de la rue . « [Je] trouvai mon mari gisant au sol, criblé de balles et mutilé à coups de baïonnette. Me voyant arriver, les militaires se sauvèrent. Une Française qui avait suivi la scène vint me raccompagner à mon domicile. Ainsi mourut mon mari. Jusqu’à l’ultime instant de son existence, i1 n’a jamais fait preuve de violence; c’est ainsi que je l’ai vu mourir en homme digne et courageux, rendant son dernier soupir pour un pays dont il avait toujours été fier et qu’il aimait de toute la force de son âme . «
(p.117) Ce meurtre fondateur, le premier d’un chef d’État de l’ex-Empire français, fera du sergent Eyadéma l’indéboulonnable Président-dictateur général de son pays, après quelques péripéties. Mais aussi un maréchal en Françafrique – la nébuleuse des réseaux franco-africains. Avant de chercher à comprendre le pourquoi de ce crime, essayons d’ en cerner les acteurs.
Le commandant Maîtrier est au coeur du complot. Chef de la gendarmerie nationale et conseiller du Président pour les affaires de sécurité, il tient en main la force publique, dans le cadre de la coopération militaire franco-togolaise. Son contrat arrivait à terme en 1962. Sylvanus Olympio ne voulait pas prolonger sa mission, qu’il ne jugeait pas indispensable. Avec le recul, il avait raison : la Présidence était plutôt mal conseillée en matière de sécurité, et le lieutenant Bodjona aurait bien mieux commandé la gendarmerie… Puisque le pays « aidé » participe au coût de l’ assistance technique, on peut dire que le Togo n’en a pas eu pour son argent! Mais, en 1962, 1’ambassadeur Henri Mazoyer a mis le paquet : il a fait convaincre Olympio de garder encore un peu Maîtrier.
Ce dernier ne cessait de gonfler un problème social, la difficile réinsertion des sous-officiers rentrés de la guerre d’ Algérie. Démobilisés de l’ armée française avec un modeste pécule, vite f1ambé, ces demi-soldes réclamaient leur enrôlement dans les forces de sécurité togolaises. Olympio trouvait que l’effectif de ces forces, trois cents hommes, était suffisant : ce n’était pas pour lui un poste de dépense prioritaire. Sans jamais laisser les protestataires exposer directement leurs requêtes au Président, Georges Maîtrier les montait contre Olympio – cet « intellectuel » qui, répétait-il, les traitait de « mercenaires ». Maîtrier dressait la meute, caressant (p.118) dans le sens du poil un ressentiment ethnique latent : la plupart des sous-officiers démobilisés, à commencer par Eyadéma, étaient originaires du Nord du pays, tandis que les élites du Sud, plus nombreuses, occupaient la majorité des postes de responsabilité. Olympio, d’origine sudiste et de mère nordiste, s’ appliquait toutefois à brider le régionalisme.
En novembre 1962, l’opposant Antoine Méatchi, réfugié au Ghana, avait préparé un coup d’État avec le sergent Robert Adewi – l’un des mutins du 12 janvier 1963. Dénoncé au ministre de l’Intérieur Théophile Mally, Adewi fut arrêté. Ses collègues nordistes manifestèrent violemment. Le ministre Mally libéra Adewi… à qui Maîtrier s’ empressa de confier les clés du magasin d’armes ! Les mutins n’avaient qu’à se servir.
Leur chef, l’adjudant Emmanuel Bodjollé, fait porter le 12 janvier après-midi un pli non cacheté à Maîtrier. En l’ absence du commandant, son cuisinier, le gendarme Lollé, ouvre l’ enveloppe : « Ce soir, nous passerons à l’action « . Il court porter le message au ministre de l’Intérieur. Théophile Mally photocopie la note, puis demande au gendarme de remettre le tout à son patron, comme si de rien n’ était. Le ministre n’alertera personne. Mais le gendarme sera, le soir même, emprisonné par Maîtrier… Olympio n’avait aucune chance d’ en réchapper.
Dans la nuit du crime, le commandant Maîtrier fait la navette entre Lomé et Kpémé, siège de la Compagnie togolaise des mines du Bénin, le monopole des phosphates. Un autre opposant, Nicolas Grunitzky, en principe réfugié au Dahomey, est aperçu cette nuit-là à Kpémé. Beau-frère d’Olympio, mais néanmoins son ennemi, Grunitzky avait été dans les années cinquante, à l’ Assemblée de l’Union française, un autre des poulains de Foccart. C’est avec lui et pour lui que Foccart avait préparé l’ « indépendance » du Togo.
(p.119) Grunitzky avait naturellement étrenné le fauteuil de Premier ministre, avant d’en être éjecté en 1958 par le triomphe électoral du parti d’Olympio. Au grand dam de Foccart, de Gaulle… et Mitterrand. Le triomphe était tel que la puissance coloniale fut contrainte de s’incliner, remisant l’ astuce médiocre qu’elle avait concoctée : l’inéligibilité d’Olympio, à la suite d’une amende fiscale.
Après l’ assassinat de son rival, Grunitzky se laisse porter à la Présidence par ceux qu’il appelle dans sa déclaration « nos amis qui sont lespromoteurs du coup d’État » : une désignation en forme d’aveu ! Nommé vice-Président, Antoine Méatchi obtient aussi sa récompense . Jusqu’ au banco d’Eyadéma…
Beaucoup plus tard, lorsqu’il se sera brouillé avec son complice Etienne, Robert Adewi racontera la transaction initiale : après la réunion qui prépara le coup d’État, Maîtrier aurait pris à part Eyadéma; il lui aurait demandé d’abattre 0lympio, pour 300 000 francs CFA (6 000 francs français).
Ni Maîtrier, ni 1’ambassadeur Mazoyer ne sont par hasard en poste à Lomé : Foccart avait voix prépondérante dans le choix du personnel de décision à affecter en Afrique. Il n’est pas pensable que Maîtrier ne l’ait pas fait informer du coup d’État qui se tramait : la carrière du commandant en eût été brisée, alors qu’elle va s’accélérer. D’autre part, Foccart donnait pour consigne, en cas d’urgence, de le déranger à toute heure de la nuit. Si la prise au piège d’Olympio avait été une surprise, il n’est pas concevable que Mazoyer n’ait pas téléphoné à Monsieur Afrique, avant ou juste après son appel à 1’ambassadeur Poullada – soit quatre heures au moins (p.120 avant le meurtre. Visiblement, le représentant officiel de l’ex-métropole n’a pas eu consigne de réagir. Ou il n’a pas eu besoin de solliciter de nouvelles instructions.
Le 13 janvier au matin, Maîtrier est à l’ ambassade de France, auprès de Mazoyer. Survient l’ ambassadeur américain Poullada, qui a trouvé le corps d’Olympio devant son portail. Il suggère à Maîtrier de mettre en mouvement l’année togolaise. Le commandant répond que l’armée n’aime pas assez Olympio…
Les liens entre l’armée française et les armées africaines qu’elle a formées, entraînées, équipées, encadrées, sont d’une force considérable. Il est utile de le savoir. C’était encore plus manifeste en 1963. Aussi, quand le commandant Maîtrier déclare que l’armée togolaise n’aime pas Olympio, il pourrait bien aussi dire : l’armée française. Celle d’alors, du moins, qui srot à peine des guerres d’Indochine et d’Algérie, qui massacre au Cameroun – Maîtrier en sait quelque chose. Olympio a fréquenté l’université. Il pense. Une certaine armée française préfère Eyadéma, renvoyé de l’école primaire à seize ans pour « fainéantise et voyoucratie » après avoir triplé, en vain, le cours élémentaire première année . De la bonne matière première pour les guerres coloniales, où on l’ enverra : l’Indochine puis l’ Algérie.
(p.122) Olympio voulait une vraie indépendance. En s’appuyant sur l’Allemagne, la Grande-Bretagne et plusieurs pays africains, il voulait desserrer le carcan franco-togolais. Il préparait, crime inexpiable, le lancement d’une monnaie qui lui aurait permis de sortir de la zone franc. Une monnaie qui, espérait-il, serait gagée sur le deutschmark ! Il avait retardé l’inauguration du Centre culturel français, de telle sorte qu’elle fût précédée par celle du Goethe Institut. Il ne reniait pas sa vieille amitié envers Sékou Touré, l’homme à qui jamais l’on ne pardonna d’avoir refusé la « Communauté », lors du référendum de 1958.*
(* Le leader guinéen n’avait pas encore sombré dans la paranoïa sécuritaire où l’ont poussé les innombrables agressions des services secrets français. Cf Roger Faligot et Pascal Krop, La Piscine, p.245-249))
Il militait pour une union régionale africaine avec le Dahomey (futur bénin) et … le Nigeria, ce géant régional devenu, nous le verrons, l’ennemi numéro un de la stratégie foccartienne.
Trente-cinq ans après le putsch meurtrier de 1963, Gnassingbe Eyadéma est toujours le dictateur du Togo. Le (p.123) 13 janvier, anniversaire conjoint de l’ assassinat d’Olympio et du coup d’État de 1967, est « sa » fête nationale, régulièrement honorée par les plus hautes personnalités françaises. François Mitterrand s’y est abaissé en 1983, lors du vingtième anniversaire de la mort d’Olympio : le Président français, ex-ministre anglophobe de la France d’outre-mer, continuait encore de reprocher à Olympio d’avoir été trop proche des Anglo-Saxons… Eyadéma n’ a pas manqué d’exploiter cette visite hautement symbolique : « On ne pouvait mieux reconnaître la légitimité de la politique conduite depuis cette date » – le 13 janvier 1963. La longévité politique d’Eyadéma se nourrit ainsi des secrets partagés avec les plus hauts responsables civils et militaires parisiens. L’assassinat d’Olympio est le premier d’une longue série de méfaits occultes, ponctuée par le pillage des phosphates et le manège des valises à billets. .
Économiquement et politiquement, le Togo est un protectorat sinistré. Eyadéma a pris Mobutu pour modèle. En 1987, la gestion de l’Office togolais des phosphates, qui commercialise la richesse la plus monnayable du pays, a été rendue plus opaque par la mise en réseau d’une vingtaine de sociétés-écrans, domiciliées à Jersey, au Panama, au Liberia, en Suisse… Les finances de l’État, les entreprises publiques et le secteur privé dit « moderne » sont presque exclusivement entre les mains du clan présidentiel, centré sur le village d’origine, Pya, et l’ethnie Kabiyé. Malgré une forte dose d »‘ aide » extérieure (21 % du Produit national brut en 1995) (p.124) le pays est surendetté. Les grands projets tels que la Cimenterie de l’Ouest africain (Cimao) ou la « raffinerie » nationale n’ont jamais marché. La Cimao est la plus magistrale ardoise de la Caisse française de développement . Où sont les milliards envolés ?
Lomé est une étape très prisée des dirigeants politiques français en période pré-électorale. L’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua est le plus assidu. En raison d’un contexte particulier, évoqué plus haut, la quasi-totalité du cadeautage franco-africain ne laisse pas de traces. D’ autant plus remarquable est cette commission de 10 % accordée à l’ association pasquaïenne Demain la France sur un contrat de communication de 4 800 000 francs, décroché auprès de la présidence togolaise par l’ agence BK2F d’ Alexis Beresnikoff.
Sylvanus Olympio ne voulait pas d’ armée ? Le Togo paye la garde prétorienne d’Eyadéma : quatorze mille hommes en armes, provenant à 80 % de la région du chef de l’État et commandés par des membres de sa famille. Cette armée, qui a brisé par la terreur la revendication démocratique, est équipée par la France, encadrée par une soixantaine d’instructeurs et de conseillers militaires français .
Le dictateur togolais est parvenu à se faire « réélire » le 25 août 1993 sans trop d’embarras. Son rival le plus dangereux n’était autre que Gilchrist Olympio, le fils de Sylvanus.
Les éminents juristes français dont Eyadéma cultive l’ amitié, à commencer par le professeur Charles Debbasch et l’avocat, Jacques Vergès, ont trouvé des astuces de procédure pour
écarter ce rival : (p.125) son dossier médical de candidat, par exemple, avait été établi non à Lomé, mais à Paris. Effectivement, Gilchrist Olympio avait été soigné au Val-de-Grâce. Il avait été blessé en 1992 lors de l’agression de son petit convoi électoral, en tournée dans le fief du général Eyadéma. L’attaque fit plusieurs morts. Selon des témoignages dignes de foi, elle était commandée par… le capitaine Ernest Gnassingbe, le propre fils de l’ ex-sergent Eyadéma .
Le jugement de Jacques Foccart sur son protégé et la manière dont il réécrit l’histoire du Togo, en 1995, n’en ont que plus de sel :
« [J’ai] beaucoup d’amitié, d’affection et d’admiration à l’égard du général Eyadéma. […] La junte militaire qui a éliminé son prédécesseur Sylvanus Olympio, pour conduire Grunitzky au pouvoir, lui a ensuite fait confiance pour conduire le pays, dans l’ordre et la tolérance. Le général Eyadéma a, dès lors, administré le Togo avec un sens remarquable de l’organisation qui lui a valu, après les péripéties de la démocratisation, la reconnaissance internationale ».
Les parents de manifestants massacrés, les journalistes emprisonnés et les centaines de milliers d’ exilés apprécieront. Plus fort encore, Foccart fait parler de Gaulle :
« Les liens que le Général de Gaulle avait établis avec le général Eyadéma dépassaient de beaucoup l’ aspect purement politique. Il faut dire que dès cette époque la gestion rigoureuse appliquée à la direction du pays, son ouverture d’esprit au niveau panafricain et le fait qu’il ait permis au Togo, petit pays sans grands moyens, de devenir la Suisse de l’ Afrique faisaient du président Eyadéma un modèle.
(p.126) « D’autre part, l’attachement profond qu’il manifestait à l’égard de la France, l’ardeur et la conviction qu’il mettait au développement de son pays étaient des éléments auxquels le général de Gaulle était sensible, ce qui avait tissé au fil des dans un mode relationnel, une estime mutuelle. On peut aller jusqu’à dire, un lien filial de coeur et d’esprit . »
Commanditaire du sergent-boucher de 1963, via Georges Maîtrier, Jacques Foccart publie ce propos édifiant dans une revue, Lumières noires, financée par la belle-famille de Baby Doc Duvalier. Souvent, les sbires foccartiens n’ ont pas grand-chose à envier aux tontons-macoutes haïtiens. Nous n’avons pas fini de nous en apercevoir.
/CÔTE-D’IVOIRE/
(p.127) Les formidables fortunes de Félix Houphouët-Boigny et d’ Albert-Bernard Bongo sont connues. Leur rô1e d’agent d’influence également. Avec eux, Abidjan et Libreville Sont devenus des tourniquets de valises à billets. S’y installent aussi parfois des norias de colis d’ armements – lors des complots ou conflits contre la Guinée, le Nigeria, le Liberia, le Congo, etc., quand ce n’ est pas le Moyen-Orient. Ce que l’ on sait moins, et qui mérite un détour, c’est à quel prix furent imposés, en Côte-d’Ivoire et au Gabon, ces parrains inexpugnables.
C’est en 1950 que l’Ivoirien Félix Houphouët a changé de camp , un retournement auquel oeuvra particulièrement François Mitterrand, ministre de la France d’ outre-mer. On négligera le suffixe Boigny, à peu près aussi décisif que le d’Estaing de Giscard. Le jeune Félix est né autour de 1900. Il a étudié et brièvement exercé la médecine. Héritier d’une chefferie traditionnelle et d’un vaste domaine agricole à Yamoussoukro, il s’est affirmé peu à peu comme le leader des (p.128) planteurs ivoiriens. En 1944, il accède à la tête de leur syndicat. En 1946, il fonde et préside le Rassemblement démocratique africain (RDA), parti précurseur de l’anti-colonialisme panafricain. Il est élu à la Chambre des députés, à Paris, où il obtient l’ abolition du travail forcé. Beau début !
Mais la répression déclenchée en 1949-1950 par le gouverneur péchoux va changer la donne. De nombreux militants du Parti démocratique de Côte-d’Ivoire (PDCI), la section ivoirienne du RD A, sont emprisonnés et condamnés. Le sénateur Victor Biaka-Boda, de l’ aile intransigeante du PDCI, est torturé et assassiné par des supplétifs syriens de l’armée coloniale, le 28 janvier 1950. Il a été trahi par ceux qui, dans son parti, prônent la collaboration avec le
colonisateur . Leader déjà célèbre du RDA panafricain, chef d’un PDCI honni par les colons, Houphouët a peur pour sa vie . Ses intérêts de gros planteur l’éloignent des révoltes urbaines. Une plainte pour détournement de mineure (une de ces très jeunes filles françaises qu’il affectionne) est étouffée . Parce qu’il se sent menacé, parce qu’il est tenu, parce que c’ est son avantage, et parce qu’il sera pris au piège de son nouveau discours francophile, Houphouët devient l’homme des Français. Ce n’est pas seulement qu’il sert leurs intérêts, et les siens au passage. Son ascension politique, de 1952 au tournant de l’indépendance, ira de pair avec un consentement : être exclusivement entouré de conseillers politiques, financiers et militaires français.
(p.131) Le docteur Houphouët assiste personnellement à la torture de ses principaux rivaux ou opposants potentiels : flagellation au nerf de boeuf, à la lanière tressée, au fouet de liane, à la matraque p1ombée; cataplasmes de piment pilé sur les plaies, onguents de même composition dans les orifices ou chantage sur les proches. Les uns sont disqualifiés naturels; l’aveu de crimes imaginaires, les autres vont croupir trois ou quatre ans en prison . Quelques-uns, comme Ernest Boka, périssent sous la torture, ou de mauvais traitements. C’est peu, diront certains, par rapport aux crimes commis en d’autres pays. Mais l’opposition est brisée. Toute résistance, au pillage intérieur comme à l’aventurisme extérieur, est découragée pour plusieurs décennies.
Dès lors, la richesse d’Houphouët ne va cesser d’ enfler, surpassant longtemps la plus grosse fortune française . Elle a été évaluée à60 milliards de francs français : plus que le produit national brut ivoirien. Même si ce chiffre est surestimé, plusieurs indices étayent son ordre de grandeur – à commencer par l’ ampleur des cagnottes concédées aux courtisans. Houphouët a mobilisé sans peine, « sur sa cassette personnelle », le milliard de francs qu’ a coûté la basilique de Yamoussoukro. À la fin de sa vie, i1 détenait d’innombrables intérêts et propriétés en Côte-d’Ivoire, en France et en Suisse. Une voie d’accumulation parmi bien d’autres : Houphouët produisait plus de 30 000 tonnes d’ ananas par an, un tiers de la production ivoirienne, avec des ouvriers payés par le budget de l’État !
/GABON/
(p.132) Je ne m’ étendrai pas sur la dilapidation des exceptionnelles richesses du Gabon, oeuvre conjointe d’Omar Bongo et de ses nombreux amis français : il y faudrait plusieurs ouvrages. Les juges Éva Joly et Laurence Vichnievsky, aidées par le procureur de Genève Bernard Bertossa, sont en train d’ailleurs d’en écrire quelques chapitres. Avec Affaires africaines , Pierre péan a commencé à lever le voile. Plus tard, dans L’Homme de 1’ombre, il a raconté un épisode clef de l’ accession au pouvoir de Bongo – l’ événement qui, dit-il, l’ a décidé à se dresser contre le système Foccart. Il s’ agit encore d’un assassinat, tellement significatif qu’il n’ es pas possible, ici, de ne pas en faire mémoire.
(p.135) Omar Bongo est peut-être l’auteur de la définition la plus explicite du clientélisme néocolonial : « L’Afrique sans la France, c’est une voiture sans chauffeur. La France sans l’Afrique, c’est une voiture sans carburant . » Pour la France, le moteur gabonais est une merveille géopolitique, à double injection : pétrole et uranium. La politique d’indépendance atomique du général de Gaulle passait par l’organisation d’une filière ultra-protégée d’ approvisionnement en uranium. Pierre Guillaumat fonda le CEA (Commissariat à l’ énergie atomique) et présida Elf-Aquitaine. Le haut-commissaire à l’énergie atomique de Giscard, Michel Pecqueur, devint président d’Elf sous le premier septennat de Mitterrand, avant d’ atterrir dans le nucléaire gabonais : la présidence de la Compagnie des mines d’uranium de Franceville. La surveillance de cet ensemble ultra-sensible était assurée par la Comilog, en principe vouée à l’exploitation des mines de manganèse. Dirigée par Delauney, homme lige de Foccart, cette société aux « pertes » vertigineuses a su accueillir Jean-Christophe Mitterrand au sein de son conseil d’ administration…
Bongo a joué un rôle décisif dans les négociations franco-arabes sur le pétrole. Adhérant à l’Opep, l’organisation des pays exportateurs de pétrole, il s’est converti dans le même mouvement à l’islam, avec la bénédiction de Foccart. Roland Dumas a jumelé son fief de Sarlat avec Franceville, la ville natale de son ami Omar – qui paie généreusement ses (p.136) conseils . Dans le grand marchandage franco-iranien de l’ « affaire des otages du Liban », Libreville a discrètement accueilli les négociations entre Charles Pasqua et Gorbanifar, l’homme de l’Irangate. Foccart, Pasqua, Dumas, Jean-Christophe Mitterrand, Elf, le nucléaire, le pétrole,… : comme la suite de Bongo à l’hôtel Crillon, la corne d’abondance gabonaise est un aimant surpuissant.
C’est aussi une sorte de Superphénix des relations franco-africaines, un surgénérateur tous comptes faits ruineux pour l’intérêt de la France, mais tout le monde. On tente d’y bétonner de lourds secrets y compris nucléaires , en s’inquiétant de la sismicité de l’ex-Zaïre tout proche. On est débordé par ces déchets à vie longue, que confinent de plus en plus mal les banques suisses ou l’assassinat de quelques gêneurs. Malgré toute l’énergie qui s’y brasse, le coeur en fusion ne parvient pas à brûler toutes les traces des entreprises les plus déraisonnables, ou les plus déshonorantes, basées ou échafaudées à l’abri de la forteresse gabonaise – avec souvent le parrainage d’Houphouët. Ainsi la guerre du Biafra.
/BIAFRA-NIGERIA/
(p.137) En 1967, le Nigeria entrait dans une terrible tragédie. La décolonisation avait laissé une Fédération précaire, composée ‘de trois régions et d’une multiplicité de peuples. Depuis un an, les luttes de pouvoir dégénéraient en pogroms inter-ethniques. Certains leaders ibos, emmenés par le lieutenant-colonel Odumegu Emeka Ojukwu, décidèrent la sécession du Sud-Est, leur région d’ origine, sous le nom de « Biafra ». Ils la décidèrent, admet l’un des principaux collaborateurs d’Ojukwu, contre la volonté de la majorité des habitants de cette région, « y compris les Ibos » : la population en aurait « rejeté complètement l’idée si elle avait été consultée librement ». Mais la sécession av ait une forte odeur pétrolière : le « Biafra » était la principale zone de production du Nigeria – alors sixième producteur mondial, avant l’Algérie et la Libye.
Le tandem franco-ivoirien Foccart-Houphouët sauta sur ce qui lui parut une magnifique opportunité : on pouvait à la fois diviser le Nigeria, géant anglophone toisant des voisins (p.139) francophones dix fois moins peuplés, et damer le pion aux majors pétrolières anglo-saxonnes en ouvrant un boulevard à une nouvelle venue : Elf, filiale pétrolière des services secrets foccartisés.
(p.140) La scission du Nigeria sert ces perspectives. « Même sans parler en termes militaires, que pèserait une poussière d’États francophones devant ces deux puissances ? », le Nigeria et le Ghana, s’interroge le gaulliste Yves Guena. Jacques Foccart est aussi clair . « de mon point de vue, le Nigeria était un pays démesuré par rapport à ceux que nous connaissions bien et qui faisait planer sur ceux-ci une ombre inquiétante ». Pour de Gaulle lui-même, « le morcellement du Nigeria est souhaitable ». Par sa taille, ce pays est forcément suspect d’impérialisme envers une Afrique francophone balkanisée – une balkanisation délibérée, qui relègue cette Afrique sous la houlette de l’Empire français. (p.141) Le Nigeria, de surcroît, avait poussé l’insolence jusqu’à rompre les relations diplomatiques avec Paris pour protester contre les essais atomiques français au Sahara. Impardonnable! À la première occasion, donc, l’Empire contre-attaque… Pour compléter l’ ambiance, on peut noter que la sécession du Biafra est proclamée onze jours après le veto gaullien à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté européenne.
L’aubaine biafraise suscite en fait une véritable « ligue latine » contre les Anglo-Saxons. Les visées françaises sont en effet soutenues par le Portugal de Salazar, qui conservait son empire africain contre l’ avis américain, et par l’Espagne de Franco, qui possédait encore la Guinée équatoriale. C’est de la partie insulaire de cette colonie, Fernando Po , que partira vers le Biafra une grande part des approvisionnements en armes. Grâce aux excellents contacts de Mauricheau-Beaupré, le régime d’apartheid sud-africain et le pouvoir blanc rhodésien s’ allient à cette coalition archéo-impérialiste du Sud-Ouest européen .
(p.141) Alors que la sécession, proclamée le 27 mai 1967, était en passe d’être réduite par le gouvernement nigérian, les mercenaires, les armes et les fonds secrets franco-africains ont prolongé durant trente mois une effroyable guerre civile, qui fit deux à trois millions de morts.
(p.142) Dès août 1967, Le Canard enchaîné5 signale la présence au Biafra de « conseillers » européens « qui ressemblent à s’y méprendre à des barbouzes français dépendant de Jacques Foccart, secrétaire général à la Communauté et à l’Élysée ».
(p.143) Le Canard n’ a pas tort. On retrouve le colonel Roger Faulques, cet ancien officier du 11e Choc (le service Action du Sdece) qui, avec l’aval foccartien, avait commandé sept ans plus tôt les « affreux » du Congo. Aux côtés du leader de la sécession katangaise Moïse Tshombe, ces anciens militaires français, à peine sortis des guerres d’Indochine et d’ Algérie, avaient constitué l’ ossature de la « gendarmerie katangaise »* . Un cas de figure assez voisin de celui du Biafra : la France aidait une riche province minière à se détacher d’une ex-colonie vaste et fragile, émancipée par une métropole européenne concurrente. Roger Faulques, qui n’avait encore que le grade de commandant, dirigeait les opérations militaires des sécessionnistes katangais contre les forces de l’ONU. Selon Le Monde , il « s’était rendu tristement célèbre par son rôle lors des interrogatoires qui ont eu lieu à la villa Susini pendant la guerre d’Algérie.»
Un autre ancien mercenaire du Congo, le très médiatique Bob Denard, s’ agite autour du Biafra. Blessé, il ne participe pas aux combats, mais il veille au recrutement et à la logistique. Il va s’ affirmer comme le chef d’une milice foccartisante, pour trois décennies.
(*Cf. Roger Trinquier et Jacques Duchemin, Notre guerre au Katanga, témoignages présentés par J. Le Bailly, La Pensée moderne, 1963; France-Zaïre-Congo, 1960-1997 Échec aux mercenaires, Agir ici et Survie/L’Harmattan, 1997, p.22.)
(p.144) Les livraisons d’armes massives ont déjà commencé – dès les premiers succès de l’armée fédérale du Nigeria. (p.145) Le 13 juillet 1967, selon le mercenaire Rolf Steiner , un «premier avion français chargé de munitions » atterrit à Uli, au Biafra, « venant du Gabon « . L’ambassade américaine à Lagos signale la fourniture par l’ armée française d’un bombardier B26, « illégalement acheminé à Enugu, capitale du Biafra, par un équipage français « .
À partir d’août 1968, des dizaines d’avions déversent sans arrêt des tonnes de matériel militaire sur les deux aérodromes – deux morceaux de route droite – que les Biafrais peuvent encore utiliser. L’avance fédérale est stoppée brutalement. À Lagos, on manifeste contre la France. Mille tonnes d’armes et de munitions sont livrées en deux mois ! Libreville, Abidjan et Fernando Po sont les points de départ d’un véritable pont aérien. Ce que confirme Ojukwu : il y a « plus d’avions atterrissant au Biafra que sur n’importe quel aérodrome d’Afrique à l’exception de celui de Johannesburg ». Une dépêche d’ Associated Press précise : « Chaque nuit, des pilotes mercenaires transportent de Libreville au Biafra une vingtaine de tonnes d’armes et de munitions de fabrication française et allemande. […] Les avions sont pilotés par des équipages français et l’entretien est aussi assuré par des Français . «
Le journaliste Michel Honorin a suivi des mercenaires au Biafra. Il achève de tirer le portrait d’une France semi-officielle surprise en plein délit de trafic d’armes. « De trois à six avions [arrivent] chaque soir au Biafra. […] Une partie (p.146) des caisses, embarquées au Gabon, portent encore le drapeau tricolore et l’immatriculation du ministère français de la Guerre ou celle du contingent français en Côte-d’Ivoire . »
Il ne s’agit pas que d’armes légères. La France fournit à l’ armée biafraise 20 automitrailleuses et 16 hélicoptères . En 1969, le pilote suédois Carl-Gustav von Rosen, qui mène des attaques aériennes pour le compte des sécessionnistes, ne cache pas la provenance de son escadrille : il dispose, indique-t-il au Monde , de cinq avions Saab « équipés pour le combat, sur une base aérienne militaire proche de Paris ».
Cet afflux d’armes, cette noria d’avions-cargos et cet appui aérien installèrent durablement la guerre civile, décuplant le nombre des victimes. Le soutien diplomatique apporté au Biafra par le général de Gaulle en personne contribua à faire échouer les négociations de paix d’Addis-Abeba, durant l’été 1968 : adossée à ce personnage prestigieux, l’intransigeance biafraise écarta, selon le New York Times, « la dernière chance de mettre un terme à un sanglant jeu militaire qui pourrait être un suicide pour les Biafrais». En 1969 encore, alors que Foccart, conscient de l’impasse, songeait à une relance des négociations, de Gaulle estimait « que le moment n’était pas venu, qu’il fallait aider les Biafrais à marquer des points sur le terrain, en sorte qu’ilspuissent négocier en meilleure position».
L’appui diplomatique n’est qu’un élément, et pas le plus important, d’une campagne terriblement moderne, et à bien des égards prophétique, visant à capter la sympathie (p.147) internationale. D’un côté, la misère de plus en plus tragique causée par la prolongation de la guerre civile suscitait un sursaut de générosité incontestable – celui des premiers French doctors, qui deviendront Médecins sans frontières -, de l’autre, une formidable intoxication médiatique et l’utilisation intensive du camouflage humanitaire aidaient à prolonger la guerre… Ralph Uwechue, délégué du Biafra à Paris parlait clairement d’ une « conquête de l’opinion publique » française.
L’action psychologique fut conçue et menée, magistralement, par la société Markpress, basée à Genève . En dix-sept mois (de février 1968 à juin 1969), cette agence de publicité lança une série d’actions de presse dont l’édition abrégée comprend, en deux volumes, quelque 500 pages de textes, d’ articles et de communiqués. Cette propagande permit aux thèses biafraises de tenir le haut du pavé, étouffant les arguments de Lagos. Le thème le plus martelé fut celui du «génocide » par la faim.
Pour y couper court, le gouvernement nigérian accepte, dès septembre 1968, qu’une équipe internationale de quatre observateurs, des officiers supérieurs canadien, suédois, polonais et anglais, vienne enquêter sur ces accusations. À l’unanimité, la commission conclut que « le terme de génocide est injustifié». En France, personne ne la croira. Personne ne ignalera le traitement correct des prisonniers de guerre biafrais, ni des groupes ibos vivant dans les zones reconquises par l’ année fédérale.
(p.148) La propagande développe aussi l’image d’une guerre de religion : une marée de musulmans s’apprêterait à exterminer 14 millions de chrétiens biafrais. On oublie que, sur quinze membres du Conseil exécutif fédéral de Lagos, neuf sont chrétiens, et que le clivage de départ ressortait plus d’une exacerbation ethnique que du fanatisme religieux; après la capitulation du Biafra, l’ amnistie aussitôt proclamée par Lagos viendra contredire les prédictions de « génocide » encore répétées par Ojukwu depuis son premier exil ivoirien.
Chevaliers blancs des chrétiens affamés, les mercenaires sont pleinement réhabilités. Leur chef, Bob Denard, retrouve (p.149) une virginité perdue au service de Mobutu : elle resservira dans de futures aventures foccartiennes. La presse célèbre les exploits de ces baroudeurs, encadrant un peuple de résistants héroïques . C’est tout juste si elle ne leur confère pas l’aura des volontaires des Brigades internationales, trente ans plus tôt – bien que Franco fasse partie de la coalition pro-biafraise.
En France, une grande campagne de collecte de fonds. est lancée avec l’appui de la télévision publique, l’ORTF, et du gouvernement. Le présentateur sollicité reçoit 30 000 francs «pour galvaniser la générosité des Français en faveur du Biafra». Mais l’urgence humanitaire couvre le trafic d’armes. Significativement, à Paris, le Conseil des ministres du 12 juin 1968 a décidé simultanément l’ embargo sur les armes et l’intensification de l’aide humanitaire. Le commandant Bachman, un officier suisse, déclare tranquillement à la Feuille d’Avis de Lausanne « être parti pour le Biafra sous le pavillon de la Croix-Rouge » et y avoir livré des armes.
Livraisons de vivres et de matériel de guerre sont intimement mêlées sous ce pavillon protecteur, et très rémunérateur (plus de 30 000 dollars par mois pour un chef de bord ) : (p.150) on fournit «pétoires et munitions en caisses de baby-food et lait concentré de la Croix-Rouge », raconte le docteur Ducroquet, un Foccartien de Libreville . L’opération est facilitée par une coïncidence : le délégué de la Croix-Rouge dans la capitale gabonaise n’ est autre… que l’ attaché militaire français, le colonel Merle.
Même l’ Agence France-Presse l’ admet, les avions-cargos chargés d’armes « atterrissent de nuit sur l’aérodrome d’Uliplus ou moins sous la protection des avions d’aide humanitaire 4».
Ce qui n’empêche pas ces derniers de se voir imposer des « droits d’atterrissage », qui serviront à acheter des armes …
Laissons Jacques Foccart résumer la méthode employée, avec le détachement de l’age et d’une insensibilité raffinée : « Les journalistes ont découvert la grande misère des Biafrais. C’est un bon sujet. L’opinion s’émeut et le public en demande plus. Nous facilitions bien entendu le transport des reporters et des équipes de télévision par des avions militaires jusqu’à Libreville et, de là, par les réseaux qui desservent le Biafra . »
Tout rapprochement avec la « couverture » d’événements survenus un quart de siècle plus tard, du côté de Goma, au début de l’été 1994, ne saurait procéder que d’esprits mal pensants. En 1994, le convoyage passera plutôt par Bangui, les médias seront dirigés vers les colonnes de réfugiés hutus affluant vers les militaires français, au Kivu. (p.151) Et l’émotion de l’opinion face à l’épidémie de choléra enfouira l’horreur du génocide. En Afrique, la France des « coups tordus » sait admirablement mêler les logistiques de la guerre et de la compassion. Cela ne date pas d’hier (le Rwanda) : dès le Biafra, berceau de la révolte humanitaire française, nous avons été manipulés dans les grandes largeurs. S’ en souvenir fait partie du devoir de mémoire.
/TCHAD/
(p.157) En mars 1963, un commissaire de police (français!) vient avec un détachement tchadien arrêter Outel Bono à son domicile. Un autre commissaire français, « Pierre », conseiller technique au ministère tchadien de l’Intérieur, pointe son nez. L’interpellé est accusé de complot contre la sécurité extérieure de l’État et de tentative d’assassinat du chef de l’État. C’est l’époque de pseudo-complots similaires en Côte-d’Ivoire, où le président Houphouët est également cerné de conseillers français. Un bon moyen de « faire le ménage ».Le commissaire Pierre a alourdi le dossier d’accusation : il a falsifié et postdaté (en 1963) les courriers qu’ Outel Bono avait adressés en 1961 à de jeunes militants . Jugé par une » Cour de sûreté de l’État « , le médecin est condamné à mort en juillet 1963. Me Pierre Kaldor, son avocat français a, a été (p.158) arrêté au domicile des Bono par trois gendarmes français et interdit de plaider par un décret de circonstance, excluant opportunément tout défenseur « étranger « . Telle se maintient la présence française : une police inique, la force sans le droit.
(p.159) Au bout d’un an, les Bono sont autorisés à revenir à Fort-Lamy. Tombalbaye propose de nouveau à Outel Bono de devenir ministre. Nouveau refus. Le médecin veut continuer de soigner la population. À la fin de 1968, il finit par accepter le poste de directeur de la Santé.
Moins de six mois passent. En avril 1969, un groupe d’anciens militants étudiants de la FEANF a l’audace d’organiser une conférence sur la culture du coton – le pivot de l’économie néocoloniale dans le sud du pays. Cette culture de rente est entièrement contrôlée par la Cotontchad, filiale d’une société française, la CFDT (Compagnie française du textile). La rémunération des paysans producteurs est évidemment très faible. Outel Bono est invité à s’exprimer. On imagine qu’il ne bénit pas cette forme d’exploitation, au sens littéral. Il déplore la stagnation du prix d’achat du coton. Le lendemain soir, Bono et les organisateurs de la conférence sont arrêtés, pour offense au chef de l’État. Il faut dire que l’atmosphère politique est électrique : on est à un mois de l’élection présidentielle, et certains voudraient pousser Outel Bono, déjà très populaire, à se présenter. On le condamne à cinq ans de prison pour lui en ôter toute envie.
Mais cette fois la réaction des habitants de Fort-Lamy est plus vive. Après une série de manifestations, Outel Bono est libéré en août 1969. Il reprend son poste de directeur de la Santé. En un peu moins de trois ans, il aura le « malheur » de trop bien réussir : il multiplie les dispensaires à travers le pays, il parvient à enrayer une épidémie de choléra. Son aura est au zénith, tandis que celle de Tombalbaye continue de plonger.
Le colonel Camille Gourvenec, qui est depuis 1966 le conseiller très spécial de Tombalbaye (après un passage par la guerre d’Algérie), ne sait comment remonter la pente. Ce Franco-Tonkinois, marié à un professeur d’ anglais, fait la pluie et le beau temps à Fort-Lamy. Il commande la garde (p.160) nationale. Surtout, il dirige le CCER (Centre de coordination et d’ exploitation des renseignements), une officine de services secrets et de basses oeuvres policières, où l’ on torture volontiers. Une sorte d’ équivalent tchadien du Sédoc camerounais. Il y est secondé par le capitaine Pierre Galopin qui sera plus tard exécuté par le rebelle Hissène Habré, et par le gendarme Gélinon. Au titre de la coopération militaire franco-tchadienne.
(p.161) En février 1973, Djiguimbaye, directeur de la Banque de développement du Tchad (après avoir été ministre du Plan), propose à Outel Bono de construire, en concertation avec plusieurs figures politiques tchadiennes – Adoum Hel Bongo, Saleh Kebzaboh, Julien Maraby, l’ ambassadeur Toura Ngaba… -, une alternative politique au régime discrédité de Tombalbaye : le « Mouvement démocratique de rénovation tchadienne » (MDRT). Djiguimbaye, franc-maçon affilié à la Grande Loge nationale française (GLNF), profite d’un voyage à Paris pour présenter à Outel Bono son « frère » (p.162) Henri Il est difficile d’imaginer que Bono ne ]’ait pas compris, Bayonne est en réalité un officier des services secrets : il y a rang de colonel, après une longue carrière commencée à Londres, dans le BCRA (Bureau central de renseignement et d’ action) gaulliste, et poursuivie sous différentes couvertures, dont celle d’intermédiaire en affaires et spécialiste en gisements de diamants; bref, une trajectoire typiquement foccartienne. Bono présume sans doute que l’affabilité de Bayonne témoigne d’un feu vert ou orange de la cellule africaine de l’Élysée, excédée par la versatilité et l’inefficacité de Tombalbaye. Ou il estime que sa cuillère est plus longue que celle du diable.
(p.164) Avec ses amis politiques, le docteur veut tenir une conférence de presse à Paris le mardi 28 août pour lancer officiellement le MDRT. Une rencontre préparatoire est prévue le dimanche 26 à 10 heures. Peu avant 9 h 30, Outel quitte l’appartement de la rue Sedaine. Il rejoint sa voiture, une DS Citroën, garée face au80, rue de la Roquette. Il s’installe au volant, pose son porte-documents à côté de lui, met la clef de contact et s’apprête à démarrer quand un homme ouvre brutalement la portière et l’abat de deux balles de revolver. L’homme s’enfuit en 2 CV, par une rue en sens interdit. La police arrive. Plusieurs témoins fournissent un signalement précis du meurtrier, qui attendait près de sa 2 CV quarante minutes au moins avant le crime.
(p.165) À L’Isle-Adam, chez les Bayonne, un « frère » tchadien , procuré par l’ ami Djiguimbaye, Jérôme Djimadoum, faisait office de serviteur non déclaré. Il a assisté aux six mois de relations Bayonne-Bono. Il manifeste une envie de parler. Il meurt d’une « diarrhée », moins d’un mois après le meurtre du docteur Bono.
Le porte-documents de ce dernier a disparu. L’appartement a été perquisitionné dès le 26 août, hors la présence de Nadine Bono. Tous les papiers du défunt ont été escamotés.
Dans son Canard déchaîné, Tombalbaye a cessé aussitôt d’attaquer Foccart. Il avait pourtant très mal pris le message codé du 28 juillet . « Lâchages ». Ce titre de l’ article de Jeune Afrique évoquant l’ avenir politique d’Outel Bono ne pouvait que signifier sa propre disgrâce. Via un numéro furibond de son Canard, il avait répliqué en menaçant Foccart de nouvelles révélations. L’assassinat d’Outel Bono donne le signal de la trêve.
Saisi du meurtre, le juge d’instruction Alain Bernard essaie de le faire passer pour un crime passionnel tout comme, au même moment, il égare l’ affaire des « p1ombiers » du Canard enchaîné (le périodique français, à ne pas confondre avec son ersatz tchadien). Il esquive les évidences que lui met sous le nez Me Kaldor. Il dilue tant et si bien l’enquête qu’il est promu procureur général à Bastia, un poste où il est recommandé de s’assoupir. Il sera remplacé par un collègue de la même veine artistique, le juge Pinsseau.
(p.166) Thierry Desjardin, du Figaro, découvre que l’assassin d’Outel Bono serait un certain Léon Hardy, ou Leonardi . Ce nom, en réalité un pseudonyme, suffit à la police pour remonter jusqu’ au tenancier d’un bar d’ Avignon, de son vrai nom Jacques Bocquel . C’est un séide du Sdece, et un ami de Gourvenec, comme l’ attestent de nombreuses correspondances. Il avait monté en Centrafrique une police politique au service de Bokassa, dans le genre du CCER de Fort-Lamy. Il s’y mêlait aussi des oppositions et rébellions tchadiennes – tantôt les soutenant, tantôt « interrogeant » leurs militants exilés. Brouillé avec Bokassa, il s’était fait expulser de Bangui au début de 1972. Arrêté à l’escale de Fort-Lamy par des policiers tchadiens soupçonneux, il avait été récupéré par la fine équipe de son ami, le Fouché de Tombalbaye. (p.167) Plus tard, interrogé par la police dans le cadre de l’affaire Bono, Bocquel ne cachera pas que Gourvenec lui a proposé plusieurs missions délicates, dont celle d’ enlever le leader rebelle tchadien Abba Siddick. Si on le lui avait demandé, admet-il, il n’ aurait pas hésité à abattre Outel Bono. Mais il nie l’avoir fait. Il n’est pas entendu par le juge d’instruction, et encore moins inculpé.
Pourtant, son dossier est accablant. Il possède une 2 CV à six glaces latérales, semblable à celle dans laquelle s’est enfui l’ assassin. Son signalement correspond aux témoignages. Entendue, la serveuse de son bar témoigne que Bocquel a reçu la veille du crime un coup de téléphone qui l’ a très perturbé, et qu’il est parti aussitôt. Elle-même a été priée de se faire voir ailleurs. Il est établi que, début 1974, Bocquel a soudain sorti 200 000 francs pour acheter une villa. .
Me Kaldor demande au juge d’ instruction de trancher l’affaire en comparant les empreintes digitales de Bocquel avec celles, très lisibles, relevées le jour même sur les vitres de la DS d’Outel Bono (garée chez les Bayonne tout au long de l’instruction!). Le juge finit, en apparence, par céder à la partie civile : il fait comparer les empreintes, non à celles de Bocquel, mais à celles des policiers qui ont extrait Bono de la voiture ! Il refuse les confrontations décisives. Ses commissions d’enquête mettent jusqu’à plus d’un an pour parvenir à la police judiciaire, et leurs résultats plus de quatre ans à rentrer. Près de neuf ans après le meurtre, le juge Pinsseau rend un non-lieu, le 20 avril 1982.
Nadine Bono se pourvoit en appel, puis en cassation. Le procureur de la Cour de cassation produit un réquisitoire qui convainc totalement de la culpabilité de Bocquel… mais conclut au rejet du pourvoi. Ce qui est fait, le 6 décembre 1983. Le dossier est clos. Ultime mesquinerie : on demande à Nadine Bono de payer les frais de justice – au prétexte qu’ elle n’a pas pu prouver qu’il s’agissait d’un assassinat !
Un (p.168) peu comme en Chine, où l’on demande aux familles des condamnés à mort de payer la balle de l’exécution…
(p.169) Un grief politique a pu servir de prétexte. L’hebdomadaire allemand Der Spiegel avait révélé un accord secret entre Paris et Tripoli : la France laisserait à la Libye la bande d’ Aouzou. Cette zone désertique au nord du Tchad, revendiquée par Tripoli, paraissait dotée d’un très riche sous-sol. Les compagnies occidentales auraient préféré placer ce pactole sous la férule d’un Kadhafi plutôt que le laisser dormir en lisière d’un Tchad anarchique. Devant Bayonne, Outel Bono avait signifié sa ferme opposition à ce marchandage – un nouveau signe de son insuffisante flexibilité.
Le 15 janvier 1975, à N’Djamena (le nouveau nom de Fort-Lamy), le fantasque Tombalbaye fait arrêter Djiguimbaye et Mahamat Outmane, un entrepreneur qui fut en affaires avec Henri Bayonne pour des livraisons de fers à béton : on les accuse d’ avoir, avec Bayonne, commandité l’ assassinat d’Outel Bono ! Tombalbaye « cuisine » lui-même les deux prisonniers, qui en savaient sûrement beaucoup. Mais il est (p.170) bientôt renversé et tué dans un coup d’État, que Gourvenec a pour le moins laissé faire. Les deux accusés sont libérés.
En décembre 1973, peu après le dernier interrogatoire de son ami Jacques Bocquel, le colonel Gourvenec meurt d’une indigestion brutale après avoir mangé de la pâtisserie. Dans ses « mémoires », Foccart renie durement cet agent gênant. Si on l’en croit, le colonel aurait pu presque par hasard s’introduire auprès de Tombalbaye et occuper durant neuf ans une position aussi l’ aval ni du Sdece, ni de la cellule africaine de . Foccart applique en cela la règle non écrite des services secrets : le pouvoir politique lâche ceux dont l’ action, découverte, les dessert. On peut quand même rappeler cette règle à tous ceux dont le ton patelin des souvenirs foccartiens endormirait la vigilance.
/BURKINA-FASO/
(p.173) Le 15 octobre 1987, un commando attaque les bâtiments du Conseil de l’entente à Ouagadougou, capitale du Burkina-Faso – le « pays des hommes intègres « . Tel est le nom africain, d’une fierté modeste, qu’une révolution assez brève a donné depuis trois ans à un ex-territoire de l’Afrique occidentale française, la Haute-Volta. Haute par rapport à quoi, si ce n’est en référence désuète aux appellations fluviales des départements français ? Cette révolution est animée, portée, par un jeune capitaine de trente-huit ans, intègre et passionné, Thomas Sankara. Il a réuni son secrétariat dans ces bâtiments sans faste. Il travaille sans protocole et sans guère de protection. Les assaillants, des soldats d’élite de l’ armée burkinabé, viennent l’ abattre. Ils tuent aussi sept de ses proches collaborateurs et son infime garde personnelle. Un médecin délivre le permis d’inhumer : Sankara, (p.174) « mort naturelle ». Son corps est enterré à la sauvette dans une tombe trop petite.
(p.180) En attendant, le nouveau pouvoir adopte un style conforme à son souci du bien public: Sankara roule en Renault 5 et vend toutes les limousines de l’État, (p.181) il impose à ses ministres le même train de vie modeste qu’il s’applique à lui-même. Il parle fréquemment en langue africaine encore une incongruité en Françafrique. Et il instaure des modes de décision collective, qu’il préservera jusqu’à la fin.
(p.182) Dès 1984, le dictateur du Mali voisin, Moussa Traoré – un Françafricain cruel et richissime -, reçoit une grosse quantité d’ armes. Le Burkina n’ en a guère. Rien de tel pour donner l’envie d’une nouvelle guerre, au prétexte d’un litige frontalier pourtant en voie d’arbitrage. Sankara résiste tant qu’il peut aux provocations mais, minoritaire au sein des instances burkinabé, il doit consentir à un bref conflit fratricide . Le pays et la révolution tiennent le choc.
Contre l’intrus Sankara, Houphouët crée une quatrième région militaire dans le nord du pays, à proximité du Burkina. La Côte-d’Ivoire, rappelons-le, est liée à la France par un accord de défense : l’armée ivoirienne est quasiment un corps supplétif de son homologue française, qui la tient en étroite tutelle. Sankara ne cesse de fustiger l’impérialisme et ses relais locaux : Houphouët ne peut pas ne pas se sentir visé. Et l’ idéalisme de la révolution burkinabé séduit la jeunesse ivoirienne.
(p.183) Malgré une brève réconciliation en février 1985, les escarmouches se multiplient entre Houphouët et Sankara. En septembre 1985, le second claque la porte du Conseil de l’Entente : ce regroupement régional des ex-colonies francophones, sous 1a houlette d’Houphouët, est depuis deux décennies l’ apanage du Président ivoirien. Sankara accuse ce rassemblement, d’ « origine réactionnaire, droitière, conservatrice, arrière-gardiste », d’être un instrument de la « stratégie néocoloniale française ». Les autres chefs d’État du Conseil de l’Entente sont désignés comme « des alliés locaux de l’impérialisme qui gambadent de sommet folklore en sommet folklore à la recherche d’un soutien moral et logistique ». C’ est ce qui s’ appelle secouer le cocotier !
(p.184) Le président togolais Eyadéma se situe d’emblée, on l’imagine, dans le camp anti-sankariste. Au fil des années, il est devenu très proche du vieil Houphouët, qui songe à lui léguer la gérance régionale des intérêts françafricains. L’hostilité du général togolais contre le capitaine burkinabé s’ exacerbe quand, le 23 septembre 1986, un commando de soixante-dix hommes venus du Ghana tente de renverser son régime. Eyadéma accuse son voisin révolutionnaire d’ avoir formé et encadré les assaillants, et dénonce l’intervention imminente de deux cents parachutistes burkinabé. Selon Foccart, c’est une affabulation . L’épisode reste confus. La préparation d’une telle attaque ne pouvait échapper aux services français, et il était inévitable que Paris envoie des troupes pour maintenir son pion togolais. Ce qui advint.
Eyadéma est le premier à reconnaître le régime installé par les assassins de Sankara, dès le surlendemain du coup d’Etat. Deux mois après, il réserve un accueil grandiose à Compaoré en visite au Togo. À la grande satisfaction de leur ami commun, le ministre français de l’Intérieur Charles Pasqua.
À Paris, en mars 1986, Jacques Foccart est revenu dans les coulisses du pouvoir, aux côtés du Premier ministre de cohabitation Jacques Chirac. Les deux hommes, à peine installés à Matignon, se sont (p.185) précipités chez Houphouët, à Yamassoukro, pour bétonner la Françafrique.
/France PRO-APARTHEID/
(p.190) La première cohabitation (1986-1988) restera dans les mémoires comme la belle époque de la Françafrique. Le réseau Mitterrand brasse à plein régime, grâce à ses poissons-pilotes : le fils du Président, Jean-Christophe, qui a reçu en bénéfice la cellule Afrique de l’Elysée, son ami Jeanny Lorgeoux et le conseiller de l’ombre François de Grossouvre.
Le réseau Pasqua se déploie, autour du nouveau ministre de l’Intérieur et de son fils, Pierre. Jacques Foccart s’est installé en face de Matignon, près de Jacques Chirac. Les affaires souterraines marchent fort entre les deux continents. Jusqu’ en Afrique du Sud, où les émissaires françafricains vont littéralement au charbon.
Le régime sud-africain, qui continue d’imposer l’ apartheid, est l’objet d’une réprobation universelle et d’un boycott international. Côté réprobation, Foccart et Houphouët s’ activent depuis seize ans déjà à réinsérer politiquement leurs amis de Pretoria, qui furent leurs alliés durant la guerre du Biafra; le président Pieter Botha, leur grand homme, a été invité en (p.192) France à la fin de 1986 . Côté boycott, la France des réseaux est la championne des contournements en tous genres : importations clandestines de charbon (via la Belgique, notamment. La France se met à raffoler du charbon « belge ».), coopération dans le nucléaire, trafics d’ armes, etc.
Le Parti socialiste et la droite ont chacun leur » Monsieur Afrique du Sud « , Jeanny Lorgeoux et Jean-Yves Ollivier – devenus forcément amis. Comme par hasard, tous deux ont été administrateurs d’une filiale de Charbonnages de France et se sont investis dans le négoce charbonnier. Jeanny Lorgeoux s’ entremet volontiers pour Alsthom, lourdement engagée dans le nucléaire sud-africain,. Le journaliste Yves Loiseau impute à Jean-Yves Ollivier un coup plus audacieux entre Téhéran, Pretoria et Paris : l’ échange de pétrole contre des armes, sur fond de prise d’otages au Liban. On aurait apaisé les exigences des mollahs en dépannant le régime d’apartheid! Acheteur théorique du pétrole destiné à l’Afrique du sud, l’archipel des Comores aurait servi de support à ce » grand troc « .
Les mercenaires de Bob Denard gardent ces îles de l’océan Indien, devenues la base avancée des opérations occultes franco-sud-africaines : ventes et achats d’ armes, circuits financiers abrités par les casinos ou l’hôtellerie, guérillas diverses contre les régimes anti-apartheid, dont le Mozambique voisin. Assez naturellement, une forte proportion des affairistes et aventuriers français mêlés à ces opérations sont issus des diverses chapelles de l’ extrême droite française.
(p.193) À Paris, il /Nelson mandela/ a délégué une ancienne enseignante du Cap, Dulcie September. Dans un pays, la France, beaucoup moins mobilisé que d’autres par le combat contre l’apartheid , l’aura médiatique de la déléguée de l’ANC ne peut être que limitée. Cela convient tout à fait à cette militante, accoutumée à diffuser ses idées auprès de ses semblables, les citoyens ordinaires. C’est une femme de conviction, que la ségrégation éducative a révoltée. Surtout, c’ est quelqu’un d’obstiné, qui n’admet pas les infractions au boycott et qui a décidé de leur faire la chasse…
Au printemps 1986, l’ANC a déménagé son bureau parisien dans un immeuble du Xe arrondissement, 28, rue des Petites-Écuries, au quatrième étage. Le même jour, sur le même palier, s’est installée une petite société, Sport Eco, éditrice d’un lettre bimensuelle sur l’ économie du sport. Coïncidence ? Son rédacteur en chef, Pierre Cazeel, est un ancien reporter de Radio-France, spécialiste de l’ Afrique du Sud. Il a réalisé un long reportage sur l’ attentat à la bombe, qui a saccagé en 1982 le bureau londonien de l’ ANC. Sans savoir tout cela, Dulcie September se méfie de ce voisin : elle a l’impression qu’il l’ observe. Mais qu’y faire, à part surveiller jalousement l’ arrivée du courrier ?
(p.194) Dulcie September, d’ailleurs, a d’autres soucis en tête. Elle recueille des informations sur les complicités dont bénéficie le régime d’apartheid. Via une source militaire, elle en sait davantage sur les trafics d’armes entre Paris et Pretoria. Elle juge ces renseignements très importants. Elle n’est sans doute pas la seule de cet avis, mais ceux qui le partagent ne sont pas ses amis. Plusieurs fois, au début de 1988, elle téléphone à son supérieur londonien, Aziz Pahad : elle lui demande de venir la voir à Paris; elle ne lui en dit pas plus sur ses découvertes, mais Pahad a l’impression qu’elles touchent au nucléaire. Dulcie September joint à Oslo un responsable de la Campagne mondiale contre la collaboration militaire et nucléaire avec l’ Afrique du Sud, Abdul Minty. Elle lui annonce un envoi de documents… qui n’ arrivera jamais. Relevons au passage l’extrait d’un article de Vincent Hugeux, paru dix ans plus tard dans L’Express : parmi les raisons de l’engagement français dans le camp du génocide rwandais, il signale la piste de « la « dette » contractée envers Kigali pour son rôle de transit docile lors de livraisons secrètes d’armements destinés à l’Afrique du Sud de l’apartheid. […] La commande aurait porté […] sur de l’équipement nucléaire ».
Dulcie September déclare à son chef Pahad qu’ elle se sent menacée. À l’ autre bout du fil, celui-ci trouve « paranoïde » l’insistance inquiète de son interlocutrice. Il ne donne pas suite. Dulcie September demande au gouvernement français de lui accorder une protection policière. Bien que le représentant de l’ANC à Bruxelles vienne d’échapper à un attentat, le ministère de l’Intérieur refuse de protéger la déléguée parisienne.
(p.195) Selon « La Lettre de l’océan indien » (07/04/1988), Jean-Dominique Taousson, journaliste de profession, ancien activiste de l’OAS recyclé dans le réseau Pasqua, toujours rédacteur en chef du « Courrier austral parlementaire », l’organe du lobby pro-Pretoria, « aurait donné l’ordre aux services compétents de ne pas renouveler le titre de séjour en France de Dulcie September, qui arrivait à échéance en octobre 1897 ». mais la déléguée de l’ANC (p.196) réussit à contourner cette instruction en passant par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Cet épisode, démenti bien sûr par le ministère de l’Intérieur, se situe en pleines grandes manoeuvres.
Vers la fin de l’ année 1987, des échafaudages recouvrent les façades de l’immeuble qui abrite l’ANC : un chantier de ravalement commence. Durant trois mois, ce ne seront qu’ allées et venues dans les étages, les escaliers et les couloirs, bruits de raclages et de seaux. Le patron de l’entreprise de peinture insiste pour obtenir la clef du bureau de l’ ANC, ce que Dulcie September refuse. Stéphane, un jeune ouvrier, vient souvent bavarder avec elle. Il fait mine de s’intéresser à la cause de l’ ANC. Ses collègues en sont passablement étonnés, vu les opinions d’extrême droite qu’il affiche auprès d’eux. Un ami de Stéphane, Daniel, travaille aussi sur le chantier. Ou plutôt il bricole : manifestement, il ne connaît pas grand-chose du métier.
(p.197) Le 29 mars 1988, Daniel et Stéphane sont étrangement seuls. Un seul autre ouvrier est à la tâche, loin du quatrième étage. On a demandé au contremaître, ce qui ne lui est encore jamais arrivé, d’aller donner un coup de main sur un autre chantier. Dulcie September est assassinée de cinq balles, tirées de face, sur le palier. L’accoutumance est telle aux bruits du chantier que personne dans l’immeuble ne prête attention aux coups de feu. Durant une demi-heure, jusqu’à l’arrivée de la police, Pierre Cazeel reste seul près du corps de la victime. Le courrier du jour et le sac à main de Dulcie semblent, d’après ses amis, avoir été fouillés.
L’enquête s’enlise rapidement. Pour la majeure partie de la presse, Dulcie September a été tuée par un commando sud-africain, aussitôt reparti . (Pourtant, François Mitterrand comme Jacques Chirac – le duo cohabitationniste – n’envisagent pas un instant de rompre les relations diplomatiques avec Pretoria). D’avance, la police se voit accusée de ne rien trouver. De bonnes âmes lui suggèrent une série de fausses pistes , où elle prend le temps de s’égarer. La (p.198) société Sport Eco a quitté l’immeuble de l’ANC peu après le meurtre. Selon les peintres de l’entreprise de ravalement, leur « collègue » Daniel est parti pour la Suisse, dont il avait le passeport…
Plus grand monde ne s’intéresse à l’ assassinat de Dulcie, simple victime en apparence de règlements de compte « interafricains ». Sauf quelques Néerlandais, dont la journaliste Evelyn Groenink. Elle a repéré des bizarreries, sur Sport Eco en particulier. Venue à Paris, elle s’ en ouvre à un confrère, Hervé Delouche, qui s’ enthousiasme pour son investigation. Il la présente à l’équipe du mensuel qu’il vient de rejoindre, J’accuse. Ce périodique en cours de lancement affiche un objectif téméraire : enquêter sur les scandales du gouvernement et des services secrets. Le rédacteur en chef, De Bonis, et son adjoint Michel Briganti se montrent aussi emballés que Delouche. Evelyn Groenink reçoit une confortable avance pour l’exclusivité du reportage qu’ elle prépare. En prime, on lui offre le plus beau bureau, et trois assistants. La journaliste va pouvoir chercher à loisir, et tenir en haleine la rédaction de J’accuse sur la progression de son enquête.
Le rôle de plusieurs sociétés françaises (Sport Eco, l’entreprise de ravalement) s’avère de plus en plus étrange. Subitement, on prie Evelyn Groenink d’arrêter les frais et de rentrer à Amsterdam. On lui promet une publication qui ne viendra jamais. J’accuse, d’ ailleurs, ne connaîtra qu’une existence éphémère…
La journaliste tente vainement de partager ses découvertes avec la Brigade criminelle. Elle est accueillie par des visages consternés, mutiques. Seul un jeune inspecteur finit par lui lancer . « Vous ne pensez tout de même pas que nous allons arrêter nos propres collègues ? »
(p.201) D’ aucuns objectent encore que « Dulcie September a été tuée parce qu’elle constituait une cible plus facile que d’autres représentants de l’ANC mieux protégés « . A supposer que ce fût le cas, pourquoi la cible était-elle si facile ? Parce que la Françafrique était la meilleure alliée du régime de l’apartheid, dont Dulcie September était l’ ennemie! Accueillir à Paris le bureau de l’ANC ne valait pas protection diplomatique – des manières que les réseaux ont toujours méprisées, d’ ailleurs.
Qu’avait donc découvert Dulcie September? Un lourd secret touchant au nucléaire ? Ou peut-être rien d’ autre que ce que connaissaient déjà tous les milieux bien informés : la massive collaboration franco-sud-africaine, gauche mitterrandienne et droite confondues. Mais il ne fallait surtout pas que l’ indignation militante fasse déborder l’ information au-delà du microcosme des initiés. Car alors tout le discours hypocritement bienveillant envers les Noirs africains eût été dévalué. Le cynisme eût apparu sans masque, dans une nudité insupportable.
/LIBERIA/
(p.202) Presque vingt ans après le Biafra, on retrouve en 1989 le zélé foccartien Mauricheau-Beaupré au secours d’une autre terrible guerre civile : l’invasion du Liberia par les milices de Initial est le même qu’au Biafra : Charles Taylor . L’objectif initial est le même qu’au Biafra : tailler des croupières aux « Anglo-Saxons » – les Américains en l’ occurrence, « protecteurs » d’un pays fondé par leurs anciens esclaves, et les Africains anglophones du trop puissant Nigeria. L’objet du conflit n’est pas nouveau : en 1904 déjà, Ernest Roume, gouverneur général de l’Afrique occidentale française, avait profité des incursions des guerriers kissis pour intervenir au Liberia et tenter de l’annexer . Abidjan et Lagos, les mégapoles ivoirienne et nigériane, guignent toutes deux les énormes ressources naturelles du Liberia. Toutes deux s’Intéressent au potentiel mafieux de la capitale libérienne – le port franc de Monrovia, avec ses pavillons de complaisance, ses entrepôts de contrebande et ses commodités pour le blanchiment de narco-dollars .
(p.203) Contre le Nigeria, le tandem Foccart-Houphouët et la galaxie françafricaine tiennent leur revanche de la faillite biafraise. Une revanche commerciale d’ abord, par l’ avantage donné aux réseaux libano-ivoiriens (très influents à Paris) sur leurs rivaux nigérians dans le contrôle de l’or, du bois, des pierres précieuses et des trafics locaux. Une revanche militaire aussi, par la mise en échec de la force d’intervention interafricaine EcoMoG, à dominante nigériane.
Comme champ de tir, le Liberia remplace le Biafra. Le Burkina de Blaise Compaoré se substitue au Gabon d’Omar Bongo comme premier associé du tandem Foccart-Houphouët.
La Libye se montre curieusement coopérative. Le réseau mitterrandien pointe son nez. Tous ces jeux d’intérêts prolongent durant six années le massacre : au minimum 150.000 civils
(1990-1996). Qui parmi les millions de téléspectateurs français s’ émouvant au spectacle des enfants libériens faméliques, s’alarmant de la prolifération des drogués de la kalachnikov, sav ait que les réseaux françafricains étaient derrière cet abominable conflit? Des centaines de milliers de personnes ont répondu généreusement aux sollicitations des associations humanitaires. françaises engagées au Liberia. Leur argent tentait vainement d’ éteindre l’incendie qu’ attisaient des pyromanes français, que nourrissaient des trafics français. Qui s’en doutait parmi ces donateurs* ? Autre crime enfoui, autre exploration salutaire – même si c’est la plus ardue, en raison de la multiplicité des acteurs, de la complexité des stratégies et de leurs dimensions occultes
(* Fabrice Weissman, de la Fondation Médecins sans frontières, admet cependant l’ «implication discrète » de la France « au travers de divers acteurs économiques » dans un article paru à la fin de la guerre civile (Liberia : Derrière le chaos, crises et interventions internationales, in Relations internationales et stratégiques, n° 23, automne 1997).
(p.205) Le Liberia passe pour être le seul pays d’ Afrique, avec l’Éthiopie, à n’avoir pas été colonisé. Certes, les Blancs n’y ont jamais détenu officiellement le pouvoir. Mais la contrée a été colonisée à partir de 1822 par des Noirs affranchis venus d’Amérique, cherchant à faire de la « côte des Graines » un pays où la liberté serait exemplaire : le « Liberia ». Le nom même de la capitale, Monrovia, vient de Monroe – un président américain opposé à l’esclavage. Cette colonisation ne se fit pas sans violence. Le clivage a subsisté entre les élites côtières descendant des affranchis américains et les populations de l’arrière-pays – entre métis américano-libériens et natives .
(p.210) Non sans quelques concessions au Nigeria, Taylor et ses sponsors françafricains se sont donc emparés d’un Liberia exsangue, après sept ans de sévices. Comment? Les armes (p.211) n’ont jamais manqué, ni les trafics permettant de les acheter . Les réseaux et lobbies français s’y sont mêlés. La Côte-d’Ivoire houphouëtienne, le Burkina normalisé et la Libye américanophobe ont assuré un appui indéfectible, vital même dans le cas ivoirien, avec la garantie d’une base arrière. Taylor et Cie ont surenchéri dans la nuisance en étendant la guerre civile au Sierra Leone. Ils ont écoeuré le gendarme EcoMoG et, profitant de ses point faibles, ont poussé à un armistice l’ennemi régional, le Nigeria. Aperçus de cette sombre histoire.
Il en a vite les moyens. Dès 1990 reprennent les exportations de l’un des meilleurs minerais de fer du monde, celui des monts Nimba, avec entre autres clients la Sollac, filiale du groupe sidérurgique français Usinor – pour 750 000 tonnes et 11,5 millions de dollars en 1991. L’argent allait à des proches de Taylor, dans le consortium AMCL. En mars 1993, la perte du port de Buchanan compromet cette ressource. Mais au début de 1994 un organisme parapublic français, le BRGM (Bureau de recherche géologique et minière), s’associe à l’AMCL pour un énorme projet : l’exploitation, via le Liberia, du prodigieux gisement de fer guinéen de Mifergui (4 milliards de tonnes de réserves), guigné par les Nigérians .
(p.219) L’engagement libyen en faveur de Taylor (entraînement et armes) repose en partie sur des considérations plus politiques : la double hostilité de Kadhafi contre les États-Unis et le Nigeria. C’ est un bonus aux yeux de la Françafrique. On ne s’étonnera donc pas qu’elle ait tissé des liens méconnus avec le régime libyen. Le Nigeria, principale puissance régionale, est ressenti par Kadhafi comme un obstacle à ses constantes ambitions. Le retrait des Américains n’a pas permis à Kadhafi, comme il en avait l’intention, de profiter du conflit libérien pour leur mettre le nez dans la boue – en restant poli. Par contre, l’implication du Nigeria dans l’EcoMoG offrait l’occasion de régler des comptes à ce grand rival. Le passif va d’ailleurs s’alourdir en décembre 1990 lorsque le Nigeria recueillera une sorte de légion anti-Kadhafi : installée jusque-là au Tchad, elle en a été évacuée par les Américains lorsque le général pro-libyen Déby, propulsé par la DGSE, a pris le pouvoir à N’Djamena .
Mais l’engagement de la Libye dans le camp françafricain ne tient pas qu’à une conjonction d’objectifs stratégiques.
Parmi les artisans de connexions plus souterraines, il faut (p.220) mentionner l’homme d’affaires comorien Saïd Hilali. Ce pivot des relations franco-comoriennes vit en France, mais a beaucoup investi dans son pays avec les groupes sud-africains. Très introduit en Libye, il fut en 1995, avec son partenaire français Jean-Yves Ollivier, l’un des tireurs de ficelles d’une opération conjointe Paris-Tripoli-Pretoria : la mise sur la touche du président comorien Saïd Mohamed Djohar, qui avait cessé de plaire. Renversé par Bob Denard, Djohar a été remplacé « démocratiquement » par le candidat commun aux trois capitales, Mohamed Taki. L’affaire a bénéficié des sollicitudes, conjointes ou successives, d’une série de figures du RPR : Jean-François Charrier (vieux grognard des réseaux basé à la mairie de Paris), le député pasquaïen Jean-Jacques Guillet, Fernand Wibaux et Robert Bourgi (les duettistes foccartiens de la cellule africaine bis, au 14, rue de l’Élysée), le ministre Jacques Godfrain, etc. L’Événement du jeudi ajoute : « La Libye et la nébuleuse gaulliste ont des projets communs aux Comores. L’un d’eux est la création d’unpôle bancaire off-shore, où les gains de toutes sortes d’opérations pourraient être recyclés . » Si la nébuleuse gaulliste et la Libye en sont à mijoter un pôle de recyclage commun de profits non déclarables, c’ est que leur complicité est vraiment très établie. Les manoeuvres communes autour du Liberia ne sont donc pas accidentelles, elles n’ ont pu que conforter d’ anciennes connivences.
(p.221) Pour augmenter le chaos qui leur profitait tant, Taylor et ses amis ont réussi l’ exploit d’ exporter la guerre civile dans le voisin occidental du Liberia, le Sierra Leone – encore un pays anglophone, comme son nom ne l’indique pas. Dès mars 1991, le NPFL y fait des raids. Il faut dire que le président sierra-léonais est alors un ami de feu Samuel Doe, le général Joseph Momoh. Taylor parvient un moment à contrô1er l’est du pays. Mais il comprend très vite qu’il lui faut un prête-nom local. Il pousse l’un de ses combattants, le caporal sierra-léonais dissident Foday Sankoh – une sorte d’ associé étranger dans l’ entreprise NPFL – à créer sa propre rébellion, le RUF (Revolutionary United Front). Sous cette bannière « sierra-léonaise », des employés détachés par la maison-mère NPFL plus aisément mettre à sac, à feu et à sang le Sierra Leone : un pays riche en diamants, qui est aussi la base logistique du gendarme EcoMoG, coincé à Monrovia. Cette extension stratégique a un avantage supplémentaire : elle permet à Taylor de poursuivre ses opérations sur un autre territoire lorsqu’il lui arrive, au Liberia, de signer une trêve ou un arrêt des achats d’armes.
/LIBERIA , SIERRA LEONE/
(p.222) Coût de cette tentative d’OPA de la firme Taylor sur un second pays : des dizaines de milliers de morts, 400 000 affamés derrière les lignes rebelles, et 500 000 réfugiés ou déplacés. Après le Liberia, c’est le Sierra Leone qui va être ruiné – devenant en 1994 le pays le plus pauvre du monde. Mais le groupe NPFL-RUF peut contrôler en mai 1991 les gisements diamantifères sierra-léonais de Tongo Fields. La communauté libanaise du Sierra Leone lui consent aussitôt un don important.
(p.225) Entretemps, sous la botte du général Sani Abacha, le Nigeria s’est enfoncé dans la dictature. Sur fond d’exploitation pétrolière sauvage, la pendaison en 1995 du leader des populations Ogoni, Ken Saro-Wiwa, et de ses compagnons, a suscité une telle réprobation que le régime a été mis à l’index du Commonwealth. Choyé par Elf, le dictateur s’ est cherché de nouveaux amis. Il a participé au sommet franco-africain de Ouagadougou, les 6 et 7 décembre 1996. Jacques Chirac a été le premier chef d’Etat occidental à le rencontrer depuis l’exécution des chefs Ogoni. Le général Abacha a fait transférer de Londres à Paris le siège européen de la société nationale des pétroles nigérians, la NNPC – un must de la corruption . Et il ne tarit plus d’éloges sur l’attitude française envers l’Afrique, « profondément enracinée » dans un respect et un intérêt mutuels … Il est des éloges moins funèbres.
Cet accès de francophilie musclée va de pair avec le retour au premier plan de l’ancien président du « Biafra », l’ex-colonel Emeka Ojukwu. Leader imposé aux populations du Sud-Est nigérian, il a été le principal concepteur, en 1994, du programme politique du général Abacha. En 1996, son fastueux (re) mariage dans la capitale fédérale Abuja a été sponsorisé par le gouvernement fédéral. Puis il a entrepris une tournée mondiale de promotion de la junte nigériane. La gestion militaire des affaires pétrolières lui semble toujours la meilleure. Un point de vue entièrement partagé par Elf et l’état-major français.
/France –SOUDAN/
(p.236) En France, l’alliance avec le peu recommandable régime soudanais fut révélée en août 1994, à l’occasion de la livraison par Khartoum de l’ ancien terroriste Carlos. La presse publia alors les éléments du deal conclu, sous le Couvert de Charles Pasqua, par son « chargé de mission » Jean-Charles Marchiani et par celui qui, à l’époque, jouait les proconsuls en Afrique centrale, le colonel Jean-Claude Mantion : on les a exposés plus haut. Si l’on finit par tant en savoir sur ces peu avouables relations franco-soudanaises, c’ est que s’y mêle une guerre des services : la DST, vouée en principe à la « sûreté du territoire » français, y a, au prétexte de l’islamisme, déployé un activisme débordant, marchant allègrement sur les pieds de la DGSE. Elle a notamment inspiré la réorganisation de la Sécurité générale soudanaise. Elle a veillé à faire équiper la Sécurité extérieure d’un matériel français de communication et d’ écoutes téléphoniques . Nous retrouverons plus loin la DST – décidément à l’écoute de cette région du monde -, à propos des mercenaires.
Signalons enfin que les sympathies françafricaines envers le pouvoir soudanais ne sont pas étrangères au fait Washington l’a pris en grippe. Les États-Unis lui reproche son soutien au terrorisme jusque sur le sol américain et ses manoeuvres de déstabilisation chez ses nombreux voisins, par guérillas interposées. Ils ont fait du renversement de ce régime leur objectif prioritaire en Afrique de l’Est . Ils ne se cachent pas d’ armer l’opposition soudanaise, via l’Érythrée, l’Éthiopie et l’Ouganda – qui répliquent ainsi aux guérillas islamistes soutenues par Khartoum.
/CONGO-ZAÏRE, RWANDA/
(p.244-245) Dès septembre 1994, un autre journaliste, Simon Malley, avait parfaitement situé les deux variantes du jeu français contre Kigali. Paver la voie de la reconquête du Rwanda par le Hutu Power, ou s’engager plus concrètement à ses côtés :
« Le problème essentiel en ce qui concerne l’avenir à court et moyen terme de la situation au Rwanda est bien de savoir ce que veut Paris, ce qu’il souhaite, quel jeu il joue. En fait, si la classe politique actuellement au pouvoir est divisée, ses objectifs sont identiques. Une forte tendance se dessine en faveur d’un pourrissement maximum de la situation rwandaise. Cela permettrait le retour des forces de l’ancien gouvernement et un partage du pouvoir sous une forme ou une autre […/, éventualité que rejettent catégoriquement les dirigeants hutus et tutsis du FPR, qui ne sauraient cohabiter avec les massacreurs d’un million de Rwandais.
« Une autre tendance, encore plus radicale, pense que le gouvernement devrait considérer le Zaïre comme base arrière permettant aux FAR de se réorganiser, de s’entraîner avec le concours de la garde présidentielle de Mobutu (et, pourquoi pas, avec des instructeurs français), de s’armer et de se refinancer afin d’envahir le Rwanda ou de provoquer les forces du FPR, de telle sorte qu’une riposte de ces dernières contre les bases des FAR au Zaïre pourrait ouvrir la voie à une reconquête du pouvoir à Kigali par les FAR et leurs alliés. Les milliards de francs qu’un tel plan pourrait coûter ne seraient-ils pas compensés par le retour du Rwanda dans le giron français ? »
Paris a effectivement oscillé entre les deux attitudes : tout en misant sur le pourrissement de la situation provoqué par la présence d’un million de réfugiés partiellement militarisés aux portes du Rwanda, la France a aidé indirectement le Hutu Power, par Mobutu interposé – certains réseaux n’hésitant pas à l’aider plus directement. Le rapport publié en mai 1995 par Human Rights Watch (HRW) était déjà édifiant. L’engagement franco-zaïrois aux côtés du Hutu Power ne (p.246) s’est pas arrêté aux livraisons françaises d’artillerie, de mitrailleuses, de fusils d’assaut et de munitions aux génocideurs en action, en mai-juin 1994 :
« Pendant la durée de l’opération Turquoise [23 juin-22 août 1994], les FAR ont continué de recevoir des armes à l’intérieur de la zone sous contrôle français, via l’aéroport de Goma. Des soldats zaïrois, alors déployés à Goma, ont aidé au transfert de ces armes par-delà la frontière. […] « Les forces françaises ont laissé derrière elles au moins une cache d’armes dans la ville rwandaise de Kamembé, dans la zone [Turquoise] […]. « Selon des officiels de l’ONU, les militaires français ont emmené par avion des chefs militaires de premier plan, dont le colonel Théoneste Bagosora et le chef des milices Interahamwe Jean-Baptiste Gatete, ainsi que des troupes d’élite des ex-FAR et des milices : une série de vols au départ de Goma les a menés vers des destinations non identifiées, entre juillet et septembre 1994.
« Selon des témoignages recueillis par HRW, des militaires et des miliciens hutus ont continué de recevoir un entraînement militaire dans une base militaire française en Centrafrique après la défaite des FAR. HRW a appris de leaders hutus qu’ au moins en une occasion, entre le 16 et le 18 octobre 1994, des membres des milices rwandaises et burundaises ont voyagé sur un vol d’ Air-Cameroun de Nairobi à Bangui, capitale de la Centrafrique (via Douala au Cameroun), pour y être entraînés par des militaires français. […]
« Des compagnies d’avions-cargos […], enregistrées ou basées au Zaïre, ont transporté la plupart des armes fournies secrètement […/. Ces compagnies opèrent sous contrat avec des officiels du gouvernement zaïrois et des officiers de haut rang des FAZ (Forces armées zaïroises), habituellement (p.247) alliés au président Mobutu. Elles ont transporté les armes de plusieurs points d’Europe ou d’ Afrique . »
Amnesty International a confirmé la poursuite des livraisons d’armes au Hutu Power, via Goma » une fois par semaine – les mardi à 23 h locales […], jusqu’à la mi-mai 1995″. En janvier et juin 1996, deux avions-cargos russes, trop lourdement chargés, se sont écrasés au décollage de Kinshasa : ils participaient à la livraison de matériel militaire . Pour les enquêteurs des Nations unies, l’aéroport de Kinshasa était la « plate-forme » de l’approvisionnement en armes des ex-FAR, organisé à partir du Kenya .
De plus, l’ ex-armée d’Habyarimana gardait la disposition d’une partie des armements (blindés AML 60 et AML 90, véhicules dotés de mortiers de 120 millimètres, armes anti-aériennes, lance-roquettes, obusiers, camions militaires,.etc.) que les forces françaises de Turquoise leur avaient permis de sortir du Rwanda (l’autre partie a été revendue par des officiers zaïrois).
(p.248) La France a conservé des contacts avec le général Augustin Bizimungu, le chef d’état-major – inchangé – des ex-FAR.
Selon plusieurs diplomates, il a été reçu à Paris début septembre 19951. Un vice-consul honoraire français l’aurait encore rencontré vers la fin de l’été 1996, au camp de réfugiés de Mugunga .
C’est là que seront retrouvées, dans un bus, les archives de l’état-major du Hutu Power. On y a découvert des factures et bordereaux de livraison de l’entreprise Luchaire – une filiale du groupe public français GIAT. Selon l’institut anversois Ipis, la Fabrique nationale belge d’Herstal aurait livré quelque 500 kalachnikovs chinoises et roumaines aux ex-FAR. Son actionnaire majoritaire n’est autre que le GIAT…
L’avalanche d’informations et de présomptions devenait telle, en novembre 1996, que Le Monde n’y tint plus. Soutenant alors fortement le projet français d’une intervention militaire internationale, il crut bon de préciser dans un éditorial. « La France doit […] diligenter une enquête pour dissiper enfin les graves soupçons pesant sur elle. C’est à ce prix qu’elle peut prétendre intervenir à nouveau en toute neutralité dans la région des Grands Lacs. » Ce prix n’ a pas été payé. Le réarmement dans les camps de réfugiés rwandais du Kivu a permis de rendre opérationnels au moins dix-sept mille hommes, sous le commandement des généraux Augustin Bizimungu et Gratien Kabiligi : une machine à bouffer du Tutsi. Mi-mars 1997, ces tirailleurs de la Françafrique seront six mille à se battre en première ligne pour la défense de Kisangani .
(p.249) Après son élection en mai 1995, Jacques Chirac avait tergiversé sur la conduite à tenir dans la région des Grands Lacs africains : le temps qu’en matière de relations franco-africaines la ligne Foccart balaye la ligne réformatrice d’ Alain Juppé . C’est fait en juillet 1995. Jacques Chirac choisit, en Afrique centrale, de chausser les bottes de son prédécesseur, astiquées par la hiérarchie militaire. De même, il laisse le lobby militaro-africaniste continuer de choyer la junte soudanaise, après une velléité de prise de distance . L’alliance France-Zaïre-Soudan-Hutu Power peut donc prospérer. Le régime islamiste de Khartoum affiche sa volonté d’ expansion en direction des réfugiés rwandais, venus d’un pays où la population musulmane a nettement augmenté depuis un siècle. Dès la fin de l’été 1994, Mobutu avait autorisé l’organisation caritative soudanaise, Dawa Islamyia, proche du Front national islamique soudanais (FNI), à financer l’ envoi d’une équipe médicale dans les camps de réfugiés du Kivu. Un coup de sonde, sans doute…
(p.251) Contre l’ Alliance de Kabila et la coalition qui la soutenait, la Françafrique a ainsi rameuté : des officiers et soldats zaïrois que trente ans d’exemple mobutiste ont, pour beaucoup, mué en soudards pillards et violeurs ;
- les militaires et miliciens du génocide rwandais, et leurs alliés burundais;
- des restes de l’armée de l’Ubu ougandais Idi Amin Dada;
- la LRA (Armée de la résistance du Seigneur) de l’illuminé Joseph Kony, qui enlève les enfants du Nord-Ouganda pour en faire ses recrues;
- des fondamentalistes musulmans, soutenus comme les deux groupes précédents par le régime de Khartoum (« nettoyeur » des monts Nouba et autres contrées soudanaises);
- et, on va le voir plus loin, la « crème » des mercenaires blancs européens : miliciens serbes fanatiques de l’ épuration ethnique, vieux chevaux de retour des guerres néocoloniales, «gros bras » proches du Front national. Etc.*
* On a signalé la présence sur la ligne de front, en mars 1997, de soldats (ou mercenaires) marocains. Hassan II est un vieil ami de Mobutu. Cf. Sam Kiley et Ren Macintyre, French plan intervention force in developing struggle for Kisangani (La France prépare une force d’intervention tandis que s’intensifie la bataille de Kisangani), The Times, l3/03/l997 ; Jacques Isnard, Deux « conseillers américains » auraient été tués aux côtés des rebelles, in Le Monde, 29/03/l997. Tant l’Ouganda et le Rwanda que le Zaïre ont mentionné, pour la dénoncer ou s’en féliciter, la participation aux combats de militaires togolais, aux côtés des Mobutistes. Au printemps l997 enfin, l’Unita – une rébellion angolaise fortement discréditée – engagera plusieurs bataillons : l’avancée des forces de l’AFDL (alliée au gouvernement angolais) menace ses sanctuaires sud-zaïrois.
Ce cocktail oecuménique marie curieusement certaines franges fanatisées du catholicisme, de l’orthodoxie et de l’islam.
LA CREME DES MERCENAIRES
(p.253) En septembre 1996, cela fait presque un que le Hutu Power allié à la soldatesque de Mobutu pratique impunément au Kivu l’ épuration ethnique des Tutsis zaïrois, Masisi au Nord, puis les éleveurs banyamulenge au Sud. Les miliciens hutus accroissent leurs incursions au Rwanda. Les guérillas ougandaises multiplient les fronts. Soudain, c’est la contre-ffensive. En apparence, elle se limite à une vive réaction armée des Banyamulenge. Puis, «sorti du néant de l’Histoire », apparaît Laurent-Désiré Kabila, porte-parole d’une Alliance politique introuvable, l’ AFDL. Puis des armes lourdes, une stratégie, l’appui de pays voisins…
D’ abord prise au dépourvu par l’ ampleur de l’ attaque, la Françafrique se laisse vite emporter par une rhétorique de la reconquête. Elle en escompte un jackpot politico-minier : en sautant sur Kolwezi, en 1973, les parachutistes français avaient durablement assuré l’ influence militaire française sur le régime Mobutu; cette fois, avec un Mobutu affaibli, Paris pourrait rafler la mise. L’armée zaïroise, pillée par ses propres généraux, défaillait. Il fallait ressortir la bonne vieille (p.254) recette : des conseillers pour l’état-major zaïroIs; un fort contingent de militaires baroudeurs, encartés ou non à la DGSE, pour les « missions spécales »; un assortiment d’ armements; enfin un lot de mercenaIres pour manier les armes les plus sophisiIquées et entraîner les troupes « indigènes « . Entré en maI 1995 dans le cabinet du ministre foccartien de la Coopération Jacques Godfrain, l’ancien du Katanga et du Biafra Philippe Lettéron ne manquait pas de références en ces domaines.
Les deux premiers ingrédIents (conseillers et baroudeurs militaires) posent moins de problèmes que les deux derniers (armes et mercenaires), qui risquent d’offusquer l’opinion française. Ayant replacé à la tête de l’armée zaïroise l’un des rares généraux à peu près fiables, le général Mahele, on l’entoure de « coopérants » français, des officiers « détachés ». Cela ne peut suffire : l’armée zaïroise est vraiment déliquescente. « Décourageant, se plaindra l’un de ces experts français . Le verrou de Bafwasende, l’aéroport d’Isiro, le pont sur la rivière Oso .. pas une ligne ne tient. «
Quant aux baroudeurs encartés, on dépêche dans l’ est du Zaïre une bonne part des commandos disponibles : ceux du 13e RDP (RégIment de dragons parachutistes), et les CRAP (Commandos de recherche et d’ actIon en profondeur).
« A priori pour des opérations de renseignement… Mais ils peuvent tout aussi bien mener des opérations derrière les lignes ennemies, s’ils en reçoivent l’ordre. » Selon le colonel Yamba,officier zaïrois réfugié en Belgique, ces CRAP compteraient cinq cents hommes, venus de Bangui, et une partie d’entre eux seraient » déguisés » en mercenaires .
(p.255) Question armement, on signale l’escale à Marseille, le 12janvier 1997, de deux gros porteurs Antonov 124 en provenance de Biélorussie, chargés de deux cents tonnes d’armes à livrer à Kisangani. La douane et la police françaises ont fermé les yeux … Les militaires français présents à Faya-Largeau, au Tchad, ont fait de même quand d’importantes quantités d’armes venues de l’obligeante Libye ont transité par cet aéroport stratégique .
A Ostende, par contre, les douaniers belges ont intercepté fin décembre un lot de onze véhicules militaires d’occasion, des camions Mercedes tout-terrain en provenance de France : prétendument destinés à des organisations humanitaires, ils étaient en réalité promis à l’armée zaïroise, à Kisangani. Ces véhicules se prêtaient parfaitement au montage d’une mitrailleuse lourde, d’un mortier ou d’une arme anti-chars.
Mais il fallait davantage pour faire la décision, et d’abord une supériorité aérienne (chasseurs-bombardiers, hélicoptères de combat). On entrait alors dans le domaine des mercenaires, donc de l’occulte, dont se régale le pagailleux microcosme des réseaux.
Le 31 octobre 1996, deux types d’émissaires français se rendent à Lausanne, rencontrer Mobutu qui y soigne son cancer. L’ ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua précède un tandem qui s’entre-surveille : le Secrétaire général de l’Élysée, Dominique de Villepin, et le « Monsieur Afrique bis » de l’Élysée, Fernand Wibaux, représentant permanent de Jacques Foccart. Dans la logique chiraquienne, cela ouvre droit à exercer des missions officieuses dans un cadre officiel, et à disposer d’un étage dans 1’immeuble de l’ état-major (p.256) présidentiel, 14, rue de l’Élysée . Selon la Télévision suisse romande , Mobutu demande à Charles Pasqua « qu’il l’aide à recruter rapidement des mercenaires qui seraient immédiatement engagés dans la région des Grands Lacs ». Il sollicite également une aide logistique en avions gros porteurs et en camions. L’entrevue dureplus de deux heures. Le maréchal était bien placé pour savoir que son armée, vidée de toute substance, ne tiendrait pas le choc sans appui extérieur contre des adversaires organisés.
Le duo Foccart-Wibaux commence par activer la clique de Bob Denard. Comme celui-ci souffre d’un excès d’années (soixante-sept) et de notoriété, il sera remplacé par un vieil ami, un familier comme lui du Congo-Zaïre : le colonel-barbouze belge Christian Tavernier. Hasard ? Fernand Wibaux a rencontré celui-ci à l’Élysée dès juin 1996.
(p.257) On lorgne du côté de l’ex-Yougoslavie, qui déborde de guerriers désoeuvrés. Il se trouve que, fin 1995, Jean-Charles Marchiani a été le pivot d’une négociation avec les chefs politico-militaires serbes et bosno-serbes en vue de la libération de deux pilotes français capturés en Bosnie. D’utiles contacts ont été noués dans ce milieu très martial. Celui qui deviendra le chef des mercenaires balkaniques au Zaïre, le colonel franco-serbe (?) « Dominic Yugo « , ne cessera de rappeler’ aux journalistes cette tractation douteuse (1), où il prétend avoir joué un rôle décisif en relation avec Marchiani.
« Dominic était sous contrôle de la DST », nous dit une source branchée (2). Donc mal vu de la maison rivale, la DGSE. Il préfère « assurer » en signalant, à tout hasard, le deal secret dont il fut témoin en compagnie de l’indéboulonnable Marchiani (3) . Côté français, deux intermédiaires interviendront avec la DST dans le montage de cette filière serbe. Un certain Patrick F., et une très curieuse PME, Geolink, sise à Paris et Roquevaire, près de Marseille. Geolink est spécialisée dans le commerce de gros de matériel de télécommunication. Elle s’employait à fournir en téléphones satellites (écoutables ?)
(1. Avec le général Mladic, notamment, bourreau de Srebrenica.
- » Un spécialiste du dossier » , cité par Arnaud de la Grange, Zaïre : la débâcle des chiens de guerre, in Le Figaro, 07/04/1997.
- Même le Premier ministre Alain Juppé se fit désavouer lorsqu’il voulut le démettre de ses fonctions de préfet du Var – après, entre autres, l’affaire du Centre culturel de Châteauvallon. Jacques Foccart s’était fait son avocat. Devenu Premier ministre après la mort de ce dernier, Lionel Jospin a obtenu la mutation de Jean-Charles Marchiani au poste de secrétaire général de la zone de défense de Paris. Encore moins de représentations officielles, encore plus près des aéroports !)
(p.258) les journalistes couvrant les événements d’ Afrique centrale, et en téléphonie de campagne l’ armée zaïroise . Opportunément, elle affiche de bonnes relations tant avec le clan Mobutu – notamment Séti Yale, le « financier » – qu’avec les nationalistes serbes. Elle se propose de faire le joint entre les deux.
Selon Arnaud de la Grange, du Figaro, Geolink aurait envoyé le 12 novembre 1996 une note confidentielle à Fernand Wibaux, lui proposant de recruter « 100 commandos serbes pour déstabiliser » le Rwanda et ses protégés, les rebelles zaïrois. Le tout pour la modique somme de 25 millions de francs .
Le feu vert – ou tout au moins le feu orange – fut donné depuis le 14, rue de l’Élysée . Il le fut malgré les fortes réticences d’un certain nombre de diplomates et de militaires, estimant que la France traînait déjà assez de « casseroles » à propos du Rwanda. Comme dans l’affaire du Biafra, les hiérarchies occultes l’ emportent sur les officielles. Pour quel bénéfice ?
Le 2 mai 1997, le New York Times révèle ces actions parallèles et affirme que leur coût, 5 millions de dollars pour le (p.259) seul mois de janvier, a été réglé par la France . Cela fait grand bruit . Les dirigeants de Geolink, André Martini et Philippe Perrette, doivent affronter les questions des journalistes. Ils se contredisent. Au New York Times, Martini prétend avoir découvert sur le tard que Perrette – qui représentait Geolink au Zaïre -, travaillait pour les services secrets français. Il s’en serait alors séparé, fin avril 1997.
Accusation aussitôt rétractée : Martini confie au Monde, .dans la plus parfaite langue de bois, que Perrette « a été prié de quitter la société au motif qu’il était soupçonné d’avoir dépassé la déontologie des affaires dans des activités incompatibles avec ses fonctions « … Perrette, de son côté, dément travailler pour les services secrets français, mais admet avoir mis en relation des autorités zaïroises avec des mercenaires serbes par l’intermédiaire d’un mercenaire français présent à Kinshasa : une conception assez large des télécommunications.
Le Quai d’Orsay, bien entendu, dément toute implication de la France dans cette affaire de mercenaires et d’avions serbes. Mais les démentis deviennent lourds à prononcer, car (p.260) c’est la deuxième fois que l’affaire des mercenaires envoyés par la France au Zaïre se répand dans les médias. Le 7 janvier 1997 en effet, Le Monde (daté du 8) titrait : « D’anciens militaires français encadreraient des mercenaires au service du pouvoir zaïrois . » Était ainsi révélée la présence au Zaïre d’ une « légion blanche » forte de deux à trois cents hommes, recrutée par d’ anciens officiers français. On vérifiera ensuite que la majorité de ces hommes sont des Français. L’identité de leur chef, le colonel belge Christian Tavernier, n’est pas encore dévoilée. Mais l’article deux « sergents recruteurs » : les « ex-gendarmes de l’Elysée » Alain Le Caro et Robert Montoya. Ceux-ci s’en défendent si énergiquement : que l’on en vient à se demander si, effectivement, la fuite de leurs deux noms n’est pas un règlement de comptes dans le milieu françafricain , ou un leurre destiné à masquer le véritable recruteur : le réseau Foccart.
Quoi qu’ il en soit, le commanditaire politique de la « légion blanche » est connu. L’homme lige de Jacques Foccart, Fernand Wibaux, a reçu à quatre reprises Christian Tavernier, (p.261) le chef de cette cohorte de quelque deux cent quatre-vingts mercenaires : en juin 29 novembre 1996 dans son bureau du 14 rue de le 2 décembre à l’hôtel Bristol et le 23 mars 1997 à l’hôtel Vigny . S’il fallait un indice supplémentaire de la responsabilité foccartienne, il suffit de remarquer les liens étroits entre Tavernier et Bob Denard, d’une part, et ceux qui existent depuis trente-six ans au moins entre Denard et Foccart. Pas seulement via l’ entreprenant Mauricheau-Beaupré ou l’ ami commun Maurice Robert, chef du Sdece-Afrique : Foccart a toujours tutoyé Denard .
Ajoutons que Mobutu, replié en France au moment du recrutement des mercenaires, était en contact téléphonique permanent avec Foccart, et la boucle est bouclée. La boucle historique aussi : déjà en 1960, Foccart avait été l’initiateur de l’envoi de mercenaires français au Katanga, contre le gouvernement de Lumumba, et il avait poursuivi ces jeux troubles jusqu’en 1967, via Bob Denard et l’inévitable Mauricheau-Beaupré .
« Aucune autorité française ne doit être mêlée à cette affaire de mercenaires pour le Zaïre », faisait savoir l’Élysée à la fin de 1996. Complaisamment distillées, ces « consignes très strictes » ne trompaient plus grand monde en février 1997. L’origine et la constitution du dispositif mercenaire étaient élucidées, et les responsabilités identifiées : la DST, le réseau de Charles Pasqua et celui de Jacques Foccart .
(p.262) Foccart, c’est la ligne directe avec Chirac. En 1967, lorsqu’il commanda le soutien massif de la France à la sécession biafraise par mercenaires interposés, Jacques Foccart était, après de Gaulle, l’homme le plus influent de la Ve République. Or il en impose plus à Chirac qu’à de Gaulle. Certains jours, le Président l’appellerait jusqu’à dix fois ! ! L’impératif catégorique « aucune autorité française ne doit être mêlée… « , joue sur les mots. Il y a « autorité » et autorité celle des organes officiels de la République ; celle des hommes de 1’ombre d’une monarchie élyséenne décadente, qui tient l’ Afrique francophone pour son « domaine réservé » – comme jadis le roi des Belges possédait personnellement le Congo. Prince de 1’ombre, Jacques Foccart faisait figure de Deng Xiaoping du néo-gaullisme…
Il est décédé en même temps que se consommait, à Kisangani, la déroute des mercenaires. Commence alors un étonnant exercice de camouflage rétrospectif. Le 20 févrie r1997, L’Événement du jeudi avait livré toutes les clefs du recrutement de mercenaires serbes pour le Zaïre : « sous la houlette de Jacques Foccart », « à l’initiative de Fernand Wibaux ». « la connexion avec les Serbes aurait été l’oeuvre d’un membre important de la DST », «au grand dam de la DGSE « . Le 27 février, L’Express avait dressé le portrait du chef serbe, un certain « colonel Dominique » ou Malko.
(p.263) Aussi fut-on stupéfait de lire un mois plus tard, dans Le Monde du 29 mars, ce papier inspiré « de sources militaires françaises » :
« Auprès des forces armées zaïroises restées fidèles au maréchal Mobutu, il existe aussi des mercenaires étrangers, singulièrement des Serbes […/. La présence de l’un d’entre eux, qui s’est fait appeler « colonel Dominic Yugo », a été détectée durant les derniers jours des combats qui ont, à la mi-mars, marqué la chute de Kisangani. […/
« Les services français ont cherché à identifier le « colonel Dominic Yugo » avec davantage de précision. Il pourrait s’ agir – sous un autre pseudonyme – de l’un des Serbes qui ont servi d’intermédiaires lors de la mission que Jean-Charles Marchiani, préfet du Var, a menée en Bosnie pour faciliter la restitution, en décembre 1995, de deux pilotes français .»
Pas question des commanditaires français. Et le conditionnel (« il pourrait s’agir ,,) suggère que la DGSE n’ en est encore qu’au stade des hypothèses – sur un sujet labouré depuis un mois par la presse internationale, à la suite de L’Événement du jeudi. D’où l’alternative : soit la DGSE ne lit pas les journaux, elle n’a rien compris au film Mercenaires serbes au Zaïre; soit elle se moque du Monde et de ses lecteurs.
La première hypothèse paraît a priori incroyable. Il faut donc trouver la finalité des histoires diffusées aux journalistes par des « sources bien informées ». Ces sources développent la version (crédible) d’une « guerre des services » et soulignent (p.264) le rôle personnel, déterminant, joué dans cette affaire par Fernand Wibaux, en lien avec Geolink :
« Le relais est pris par le « colonel Dominic ». Un personnage trouble que la DGSE mettra un certain temps à identifier. L’homme – d’origine yougoslave – aurait pourtant été au mieux avec un autre « service ». « Dominic était sous contrôle de la DST », assure un spécialiste du dossier .» (Arnaud de la Grange, in : Le Figaro, 07/04/1997)
Les réseaux Foccart et Pasqua ayant recouru à la DST, voilà comment la DGSE, court-circuitée en « son » Afrique, aurait pris un mois de retard sur le lecteur de L’Événement du jeudi! Plus fort encore dans le nous conte la fureur des gens raisonnables de le diplomate
Dominique de Villepin et Jacques Chirac soi-même, en Janus face Villepin (la face Foccart est soudain momifiée). On nom fait savoir que le conseiller élyséen Fernand Wibaux est placé sous surveillance! Il aurait même été filé lorsque, le 23 mars, il rencontre pour la quatrième fois le chef mercenaire Christian Tavernier, dans un hôtel parisien. Lorsque le « conseiller spécial » de Mobutu, Honoré Ngbanda, vient début mai à Paris chercher des armes pour son patron, la DGSE fait savoir qu’elle a mis le holà. Ainsi, l’idée peut s’installer que le recours aux « affreux» n’est l’oeuvre que du réseau Pasqua, et d’un Wibaux dévalué par la mort de Foccart Bon pour le sacrifice.
(p.265) Il en faudra quand même davantage pour faire oublier que Fernand Wibaux était installé au rez-de-chaussée de l’état-major particulier du président de’la République… C’est comme pour l’affaire Greenpeace, en plus grave : soit Jacques Chirac a donné son aval au recrutement de mercenaires, soit l’Élysée est une pétaudière ; soit les deux propositions cohabitent.
(p.266) Bob Denard a commencé sa carrière de mercenaire dans l’ex-Congo belge, en 1960. Il a contribué, en 1965, à mater la vaste rébellion anti-mobutiste des Mulele, Gizenga, Soumialot, à laquelle participait déjà Laurent-Désiré Kabila.
Il a tiré sa révérence aux Comores fin 1995. Dans ce pays brutalisé, il a installé deux présidents, Ali Soilihi et Ahmed Abdallah; il en a écarté ou éliminé trois : les deux précédents, plus Saïd Mohamed Djohar en 1995. Vice-roi des Comores de 1978 à 1989, il put émarger aux multiples trafics dont cet archipel est le havre. Un grand foccartien, l’ex-ambassadeur au Gabon Maurice Delauney, trouve Bob Denard « ni affreux, ni assassin ». Il lui a décerné un brevet de patriotisme, pour avoir exécuté nombre d’interventions non officielles, « le plus souvent dans les meilleures conditions, toujours dans l’honneur ».
Christian Tavernier, présenté comme un officier des services secrets belges , est comme Bob Denard un multirécidiviste des guerres par procuration. Dès 1961, il a opéré au Congo comme chef mercenaire : aux côtés de Denard, il a combattu pour la sécession katangaise de Moïse Tshombé, puis pour l’armée de Mobutu contre la rébellion néo-lumumbiste de 1964-65. Ensuite, il n’a jamais vraiment quitté le Zaïre . il assistait au Conseil de sécurité de Mobutu et accomplissait pour lui des missions de confiance. Il dirige la revue Fire, spécialisée dans les armes, qui fait aussi office de bourse pour l’emploi d’ex-militaires en disponibilité . Le rédacteur en chef n’ est autre que… Bob Denard.
(p.267) Lorsque le colonel Tavernier se rend à l’Élysée en juin 1996, parrainé par l’homme politique belge Léo Tindemans, c’est pour s’enquérir auprès de Fernand Wibaux de la maladie de Mobutu et de la manière dont « on pourrait tenir le pays ». La question n’ a pas dû rester indéfiniment en suspens. « Comme Denard n’est plus opérationnel depuis la débâcle des Comores, un Belge a pris la tête du groupe qu’il aurait autrement commandé », explique un diplomate français~. Le 15 novembre (deux semaines avant la deuxième rencontre Tavernier-Wibaux), la lettre confidentielle sud-africaine Southscan mentionne déjà la possibilité que Christian Tavernier soit chargé de mener la contre-offensive. Selon des proches du milieu mercenaire, ce sont les hommes de la nébuleuse Denard qui, sitôt le feu vert de Fernand Wibaux, « ont recruté l’équipe française pour le compte du Belge Christian Tavernier « .
Le 1er décembre 1996, Arnaud de la Grange, signale dans Le Figaro « le retour des « affreux » « , avec « l’arrivée de trois cents à cinq cents mercenaires « . Le 3janvier 1997, Tavernier s’installe à Kisangani avec l’ état-major des mercenaires, composé à 80 % d’« instructeurs » français. Dans le tout venant de la « légion blanche » (276 hommes à la mi-janvier), on compte aussi nombre de baroudeurs français. Tavernier fait croire qu’il est en colonie de vacances : « Nous n’avons pas encore tiré un seul coup defeu », dit-il au Soir de Bruxelles, (p.268) fin janvier. Puis, gagné par la mode militaro-humanitaire : « En ce moment, je me contente de distribuer du sel aux populations civiles … «
La revue Raids a enquêté auprès des hommes de Tavernier. Elle a repéré trente-trois mercenaires français et autres (italien, chilien, portugais, américain et belge), constitués en deux groupes d’intervention, à côté d’une centaine de Serbes. Ils ont été recrutés pour 30 000 francs par mois et par homme, trois mois payables d’ avance. Ce sont d’ anciens des Comores , mais ils ont oeuvré dans le passé en Birmanie, au Cambodge, au Bénin et en Rhodésie. Tavernier, le chef des mercenaires non-serbes, était secondé par des anciens commandos de Bob Denard. Leurs armes provenaient en partie de Serbie, d’Ukraine et d’Égypte.
Chez les mercenaires français, « la cheville ouvrière [du recrutement] a été (…), aujourd’hui permanent du Front nationa1». (…) /Il/ fut, aux côtés de Bob Denard, le lieutenant Allix lors de l’expédition de 1995 aux Comores. La présence d’un adjoint d’extrême-droite ne semble pas avoir chagriné Denard, ni l’ avoir éloigné des réseaux « républicains » de décideurs, civils et militaires. Côté civils, signalons l’ avis d’un connaisseur sur l’ absence de carrière (p.269) politique de Pierre Pasqua, fils unique de Charles : il affiche une telle « ferveur pour l’extrême droite » qu’il n’est « politiquement pas présentable « . Il est pourtant au coeur du réseau africain de son père, auquel Mobutu adressa en premier sa demande de mercenaires. Autre pivot du réseau, le préfet Jean-Charles Marchiani s’est montré dans le Var d’une grande complaisance envers le Front nationa1. Charles Pasqua lui-même, selon son biographe non officiel, « n’a jamais non plus rechigné à préserver des passerelles avec tous les anciens mercenaires, partisans de l’Algérie française, ex-militants de l’extrême-droite qui se sont dispersés dans toute l’Afrique francophone au milieu des années soixante » .
Du côté des militaires, l’ amiral Antoine Sanguinetti rappelle la persistance dans l’armée française d’une vigoureuse tradition d’ extrême-droite, marquée par la colonisation et l’insurrection de l’OAS (Organisation de l’ armée secrète) contre l’indépendance de l’ Algérie . Elle influe dans la formation des cadres militaires africains francophones (47 000 depuis 1960). Cette chapelle reste en mesure « de contrôler la coopération militaire, et d’occuper, pour le compte de l’Élysée – en l’adaptant à ses propres concepts – une position stratégique sur le continent africain « .
Le témoignage suivant n’est pas étranger à l’affaire. Il vient d’un membre repenti du DPS (Département protection-sécurité), le service d’ ordre du FN, surnommé la « petite légion » de Le Pen : (p.270) « Je vote FN depuis longtemps. Je n’avais pas de boulot. […/ Comme j’ai servi dans l’armée, on m’a intégré dans un groupe un peu spécial : une équipe légère d’intervention […/, 25 types, tous des anciens bérets rouges ou bérets verts, c’est-à-dire anciens paras ou légionnaires. […/ La plupart ont participé à des conflits, au Tchad, au Centrafrique ou au Liban. […] Entre nous, on s’amuse à se surnommer les « Pompiers du Reich » et on se salue par de petits « Sieg Heil! » .»
Le DPS est dirigé par Bernard Courcelle, ancien capitaine du 6e RPIMa – l’ infanterie de marine, l’ ex-« coloniale ». Son frère, Nicolas Courcelle, dirige la société de sécurité Groupe Dans la mouvance de cette société, une quinzaine de vieux routiers du mercenariat ont été recrutés pour l’ expédition zaïroise par (…) .
Contactés, beaucoup d’anciens de Denard, trop vieux ou trop avisés, ont boudé l’opération. Alors, » les recruteurs ont fait leur marché au sein de groupuscules d’extrême-droite comme le GUD […/. Des jeunes sans grande expérience militaire. « Une année de Service national pour les mieux formés, précise un ancien mercenaire reconverti dans la sécurité industrielle. Des colleurs d’ affiche très aguerris au maniement du manche de pioche dam les rues de Paris, moins rompus à celui du mortier ». […] Les Zaïrois n’ont pas apprécié de se voir fourguer des mercenaires « incompétents militairement et dépourvus de professionnalisme »
Le jugement est du général Mahele, le patron de l’armée de Mobutu. Un homme qui en a pourtant vu d’autres en matière d’inaptitude militaire .»
/BIRMANIE, …/
(p.271) Il ne faut pas généraliser. Le passage en Birmanie de certaines recrues est une référence. En ce pays, la junte au pouvoir (le Slorc) « réduit » les ethnies minoritaires. Elle les
« déblaye » notamment, autour du gazoduc construit par Total. Le groupe a engagé des «consultants en sécurité « , qui collaborent avec l’ armée birmane. Anciens militaires ou mercenaires, ils seraient issus des milieux d’ extrême droite .Au Zaïre, ils vont se retrouver en bonne compagnie fasciste, pour venger Jeanne d’ Arc et Fachoda.
« Deux ans après s’être trouvée malée à un génocide en 1994, la France parraine l’envoi de criminels de guerre serbes coupables de purification ethnique aux côtés des ex-FAR pour sou-
tenir Mobutu… C’est le bouquet », s’exclame Jean-François Bayart.
Cette filière serbe, on l’ a vu, a été montée par la DST et un certain Patrick F., sous la houlette de Jacques Foccart et de son adjoint Fernand Wibaux. De Belgrade, une série de vols ont été organisés pour transporter plusieurs centaines d’hommes, mais aussi de l’équipement et des armes, la part la plus juteuse du contrat : quelques avions de combat, quantité de lance-roquettes, des uniformes, etc. Une base avancée a été établie au Caire (l’Égypte est un partenaire habituel des opérations françafricaines). De tels marchés sont, pour l’ex-
Yougoslavie , le moyen de se procurer les liquidités dont elle a désespérément besoin.
(p.272) Le premier contingent de cent quatre-vingt mercenaires, principalement des Bosno-Serbes, est parti au Zaïre pour un contrat de trois mois (en gros, le premier trimestre 1997). ,
Puis un autre contingent l’a relayé . D’autres sources parlent d’un premier envoi de trois cents mercenaires. Le premier objectif était de défendre l’angle nord-est du Zaïre, ses mines d’or et ses guérillas anti-ougandaises. Puis il fallut défendre Kisangani.
Le gouvernement ex-yougoslave dément toute implication étatique, mais il tolère cette exportation – à cause probablement des commissions sur les ventes d’armement. Un reportage télévisé a montré des recrues zaïroises vêtues d’uniformes yougoslaves, et des avions de fabrication yougoslave portant encore des inscriptions en serbo-croate sur leurs fuselages. En principe, l’ ex-Yougoslavie continue d’ être soumise à un embargo sur les achats et ventes d’ armes, mais il faut supposer que certains des officiers de l’Otan chargés de surveiller l’application de cet embargo ont fermé les yeux.
On compte bon nombre de Français parmi eux… Le deal avec les Serbes aurait été amorcé à l’occasion d’une visite au Zaïre du président de l’ex-Yougoslavie, Zoran Lilic, durant l’été 1996. Un officier de la délégation aurait promis mille hommes.
Le chiffre de cinq mille mercenaires serbes combattant au Zaïre, avancé par le quotidien belgradois Dnevni Telegraf, est sûrement exagéré. Un intermédiaire affirme en avoir convoyé
173 le 6 janvier à l’aéroport de Surcin-Belgrade : cela semble tout à fait vraisemblable. Parmi les engagés, on trouve d’ anciens officiers d’ élite de l’ ex-armée yougoslave. L’un d’ eux « a clairement fait savoir qu’il travaillait pour l’État » (p.273) yougoslave, ce qui accrédite l’idée d’un montage Belgrade-Paris-Kinshasa .
L’un des hommes clefs du recrutement a été Milorad Palemic, alias « Misa », qui commanda un groupe de quatre-vingts Bosno-Serbes impliqué dans le massacre de Srebrenica. Il aurait recruté pour le Zaïre nombre de miliciens bosno-serbes, dont plusieurs suspectés d’ avoir participé à ce massacre. Beaucoup de recrues sont originaires de la vallée de la Drina, où le nettoyage ethnique fut le plus féroce.
(p.274) Début mars, Kabila déclare à la radio que la ville est « infiltrée par ses hommes « .
« Alors, les mercenaires sont devenus paranoïaques, ils voulaient tuer et arrêter tous ceux qu’ils soupçonnaient », reprend Adamo. Pour la seule raison qu’ils sont originaires de la région du Kivu, place forte des insurgés de Kabila, les quatre frères sont enlevés une nuit de février. « Nous avons été mis dam une maison au bout de la piste de l’aéroport. Nous étions avec une centaine d’ autres personnes qu’on accusait d’aider la rébellionparce qu’ils allaient aux champs, parlaient politique, ou se rassemblaient à plus de cinq sur le trottoir », poursuit Adamo. Torturé une semaine sous la garde de l’armée zaïroise, il a vu une vingtaine de ses camarades exécutés. « Celui des mercenaires qui le voulait, pouvait entrer dans la maison etfaire de nous tout ce qu’il souhaitait, nous donner lefouet, des tabassages, nous couper les oreilles. Nous
étions ses animaux ».[…/ La « bande des Serbes », comme on les a baptisés, a fui avant le début des combats, vendredi soir dernier [14 mars/ .»
(p.275) Ce témoignage est corroboré par un autre, de source ecclésiastique, parvenu à La Croix . Le témoin ajoute :
« L’interrogatoire est souvent mené par le terrible Yougo, chef incontesté des mercenaires. Tout cela se passe en plein air. Ce colonel, revolver au poing, appuie chaque question avec un coup de feu tiré près du prisonnier, pour le terroriser. Après cette horrible session, tout le groupe, résigné et silencieux, est conduit par Yougo et ses hommes derrière les hangars, bien loin, dans la partie est de l’aéroport. Et c’est la fin! Ils sont abattus avec une mitrailleuse munie de silencieux, puis jetés dans une grande fosse creusée avec une pelle mécanique. »
D’ autres témoins encore confirment ces tortures et exécutions : ceux interrogés le 18 mars 1997 par le correspondant de Reuter. Benjamin Auta, directeur médical de l’hôpital catholique de Kabonda . un journaliste de Newsweek International, qui a vu les charniers laissés par les
mercenaires .
Passons maintenant aux hauts faits militaires. Les Mig 21 procurés par Geolink et transférés d’ ex-Yougoslavie avec pilotes et mécaniciens étaient dépourvus des cartes et instruments qui
leur auraient permis de s’ orienter autour de la forêt tropicale .
En janvier, le général Mahele, chef de l’ armée zaïroise, admit que des mercenaires d’Europe de l’Est (des Serbes, en fait) pilotaient les hélicoptères Mi 24 Hind récemment acquis en Géorgie par le Zaïre . Devant Kisangani, ils ont (p.276) accompli de nombreuses actions par le moyen des missiles, voire des bombes au napalm et au phosphore dont ils étaient dotés .
Ce sont encore des mercenaires serbes qui, avec des avions de fabrication yougoslave, bombardèrent le 17 février les villes de Bukavu, Shabunda et ‘Walikale . Ces raids, visant
les marchés et les quartiers résidentiels, firent de nombreuses victimes civiles (au moins 19 morts et 50 blessés à Bukavu). « Frappes chirurgicales », affirmaient les officiels.
« Ici, rétorque un Belge, ça signifie que le chasseur ne se trompe pas de ville . »
Le 14 mars à Kisangani, sentant le vent tourner, les mercenaires serbes décidèrent de fuir par la voie des airs. Ils rejoignirent un aéroport sécurisé par des commandos français, officiellement chargés de protéger l’ évacuation des humanitaires, et profitèrent des appareils de l’ armée française… Ceux-ci évacuèrent aussi les hauts gradés zaïrois. Mais la piétaille des Forces armées zaïroises ne voulait pas se laisser abandonner : durant plusieurs heures, les Serbes firent feu sur leurs « alliés » zaïrois, causant de nombreux morts .Un ancien du groupe Denard n’est pas tendre :
« Massacrer des petites vieilles dans les Balkans ne prépare pas à tenir tête à l’une des guérillas les plus combattives du continent africain. À la décharge des mercenaires, […] leur mission de combat est vite devenue secondaire. Ils ont surtout dû faire du maintien de l’ordre auseind es FAZ (Forces armées zaïroises) pour empêcher la débandade. »
(p.278) A la trappe, d’abord, les ressortissants serbes, et autres Est-européens. La centaine de mercenaires français est renvoyée (p.279) au « titre privé », ce qui sauvegarde la virginité de la « politique de la France ». Au regard de cette noble politique, est-il féal ou félon le militaire français de haut rang qui confie : « Cette aide est providentielle [—/ elle permettrait de redonner du souffle et du temps au régime du maréchal Mobutu » ?
S’ il s’ avère que les mercenaires « ressortissants français » ont été dépêchés au Zaïre à l’instigation d’un conseiller du président de la République, ne devrait-on pas le condamner d’une façon «plus nette » encore ? Ou doit-on admettre que l’Élysée est un domaine extra-territorial, non concerné par les déclarations du Quai d’Orsay, et qui peut se permettre de mener une double «politique de la France », parfaitement contradictoire ?Si oui, peut-on s’étonner que plus grand monde ne comprenne cette politique, et que la France, lorsqu’ elle la propose, se trouve totalement isolée sur la scène internationale ?
(p.282) Il aurait fallu parler aussi de l’élimination du marocain Mehdi Ben Barka (1965), du gabonais Germain M’Ba (1971), des tentatives de coups d’Etat en Guinée qui ont radicalisé le régime de Sékou Touré, etc.
/LA DECOMPOSITION D’UN SYSTEME/
(p.285) 15 mars 1997 : Kisangani tombe comme un fruit mûr. Les rebelles de Laurent-Désiré Kabila et ses alliés africains bousculent la coalition hétéroclite qu’ avaient tenté de leur opposer le clan Mobutu et les réseaux français – ceux de Jacques Foccart et Charles Pasqua, alliés sur ce coup.
Kabila et ses troupes sont accueillis en libérateurs : les Zaïrois hésitaient à reconnaître cette résurgence improbable du lumumbisme, mais le désir est plus fort de se débarrasser enfin du système Mobutu, leur ruine personnifiée, chaque fois remis en selle par les interventions occidentales – françaises, surtout.
Le signe zaïrois est vaincu : des Africains ont triomphé des mercenaires, et non l’inverse. À l’image de Bob Denard, les recruteurs vieillis ont montré leurs limites. Kisangani sera peut-être au néocolonialisme de la France ce que Diên Biên Phu fut à son colonialisme : le commencement de la fin. Comme les symboles mènent l’histoire, on peut s’attendre à (p.266)
des ondes de choc dans tout le « pré carré » francophone, à commencer par le Centrafrique .
17 mars 1997 : Jacques Foccart s’éteint. Le concepteur d’un système transfusionnel de relations franco-africaines, la « Françafrique « , en était redevenu la clef de voûte. Certes, sa
maladie réduisait de plus en plus les fils de son réseau à ceux du téléphone (eux-mêmes remplacés, souvent, par les liaisons satellite), mais quel magnétisme ! Il exerçait sur Jacques
Chirac un ascendant extraordinaire :
« Rares sont ses soirs où, vers 23 heures, presque comme un rite, Jacques Chirac ne lui téléphone pas. Rares aussi sont les dimanches où, à l’Élysée, le vieil homme ne vient
pas partager quelques confidences avec le Président. Depuis longtemps, Foccart est /—] pour Chirac une sorte de père, se tuteur, de sage, de sorcier peut-être. /—] « On a l’impression, témoigne un de ses récents visiteurs, qu’à l’autre bout du fil Chirac est à genoux « ‘ (Daniel Carton, Foccart, l’homme des court-circuits, in : Le Nouvel Observateur, 09/05/1996)
Revenu au pouvoir en 1953, le général de Gaulle avait perçu l’inéluctabilité des indépendances africaines. Jacques (p.267) Foccart devient son plus proche collaborateur. Patron d’une entreprise d’import-export, la Safiex (de 1944 à 1991), il organisait aussi depuis onze ans l’ arrière-cuisine gaulliste : renseignement, financement , « services d’ordre », placement et coordination des amis en métropole et outre-mer, dans la politique, les affaires et les services secrets. Il installe à l’Élysée un « domaine réservé » franco-africain, avec une
double obsession : assurer une succession stable à l’Empire, en le plaçant entre les mains d’ « amis de la France » , pourvoir aux financements secrets dont la vie politique est fort nécessiteuse (rappelons que le financement officiel des partis et des campagnes politiques n’apparaîtra que trente ans plus tard, après une série de scandales en métropole).
D’où le choix, stratégique, d’un système clientéliste, le patrimonialisme , mêlant intérêts publics et privés dans l’exploitation conjointe de deux rentes . celle des matières premières, agricoles et minières, et celle de l’ aide publique au développement (APD). Il fut jugé naturel que cette double captation construise là-bas des fortunes inouïes (Houphouët, Moussa Traoré, Eyadéma, Mobutu,… ), puisque le taux de retour en France était, lui aussi, faramineux. Mais, aurait-on pu prévoir, un tel processus était tout, sauf durable : il (p.288) stérilisait le développement, car l’ économie rentière redoute et sabote souvent l’ apparition de secteurs productifs autonomes . il légitimait la corruption; il stimulait la course à l’ endettement, sans guère d’autre contrepartie que les investissements de prestige, les « éléphants blancs » et les comptes en Suisse; enfin, il a fait le lit de l’ethnisme. Avec la chute des cours des matières premières et l’inéluctable « ajustement structurel », la rente s’est faite plus rare, donc plus violemment contestée. En période d’abondance, les miettes du gâteau nourrissaient tout le monde; avec la crise, les luttes politiques, se distinguant de moins en moins de la course à la
rente, sont devenues des luttes au couteau .
(p.289) Parallèlement à la criminalisation de nombre de pouvoirs africains, s’ est manifesté l’ éclatement du système pyramidal foccartien, centralisé à l’Élysée jusqu’à la mort de Georges
Pompidou, en 19742. Ce système a été sapé, entre autres, par le familialisme : le népotisme d’abord (rôles africains accordés à la parenté du président Giscard d’Estaing), puis le
filialisme. Pierre Pasqua cogère le réseau paternel. Plus dangereusement, François Mitterrand a placé son fils Jean-Christophe à la tête de la cellule africaine de l’Élysée, l’autorisant à nouer d’inextricables relations avec quantité de fils et filles d’autocrates africains. Profitant de cette réduction de la Communauté gaullienne à une entreprise familiale, les groupes d’intérêts que le pouvoir exécutif avait utilisés, tolérés, ou laissé prospérer, se sont émancipés.
Ainsi, le réseau Foccart , dominant jusqu’ au milieu des années soixante-dix, s’est trouvé concurrencé par une dizaine de clans, réseaux et lobbies politico-affairistes, militaires ou
corporatistes : les réseaux Mitterrand et Pasqua; quelques grandes entreprises (Elf, Bouygues, Bolloré-Rivaud, Castel…); les composantes très divisées de la coopération militaire et policière, les multiples services de renseignements, ainsi que des officiers plus ou moins retraités ou détachés, qui fonctionnent en électrons libres (tels Paul Barril, Jeannou Lacaze, Paul Fontbonne, Pierre-Yves Gilleron, Robert Montoya,… ). On peut y ajouter, en vrac, le lobby de la francophonie, le Trésor (qui gère l’essentiel de l’aide au développement dans une superbe méconnaissance de ses effets), certaines fraternelles franc-maçonnes, une secte
mystico-politique (les Rose-Croix) et, un peu perdus, un ensemble d’acteurs plutôt généreux – parmi les ONG, les coopérants, les villes jumelées, etc. Les micro-stratégies de tous ces groupes s’enchevêtrent. Désordonnées, leurs manoeuvres tactiques entrent fréquemment en collision, comme dans un manège d’ autos tamponneuses.
(p.291) On pourrait dire aussi que le réseau pyramidal de Foccart s’est dégradé en une sorte de trame, de grille de mots croisés. Pour comprendre l’action – de plus en plus aléatoire et contradictoire – de la France en tel ou tel pays d’Afrique, il faut deviner les croisements chaque fois différents (les cases noires), entre cette série d’intervenants (verticalement) et une
échelle horizontale de motivations. On ne peut en exclure, chez certains acteurs plutôt désintéressés, la conscience ou l’humanisme. Mais il faut accorder tout leur poids aux schémas géopolitiques primitifs cultivés par les services secrets. Ils démonisent les « hordes hamites » ou les « pions des Anglo-Saxons » : le président ougandais Museveni et ses alliés rwandais et sud-soudanais sont ainsi leurs ennemis jurés. Ces schémas sont renforcés par une vieille tradition coloniale de manipulation de l’ ethnicité, encore très présente chez les officiers de l’ infanterie de marine . Ils se mêlent à une conception très myope des intérêts commerciaux de la France, et de la défense de la francophonie. Il faut encore décliner les variantes de 1″‘ amitié », qui dégénèrent en prises de participation dans les dispositifs mafieux de certaines familles présidentielles africaines (trafics multiformes, blanchiment de narcodollars, réseaux de prostitution, etc.). Il convient enfin de ne pas oublier les multiples moyens de chantage accumulés par les présidents » amis » (à l’occasion, entre autres, de remises d’ espèces ou de pierres précieuses, ou lors de » parties fines »)…
(p.296) Pendant près de quarante ans, il s’est abrité, aux frais du contribuable français, derrière deux assurances tous risques : financière (la zone Franc) et politique (les accords de défense ou de coopération militaire). Des garanties en voie d’ obsolescence accélérée.
(Cf. François-Xavier Verschave, Complicité de génocide ? La politique de la France au Rwanda, La Découverte, 1996, chap. 1, 3, 5 et6.)
(p.297) En tous ces épisodes, on retrouve la phobie des Anglo-Saxons, et la volonté de leur tailler des croupières, géopolitiques et commerciales. À propos du rô1e de la France au Rwanda, nous citions cette question de Colette Braeckman :
« Peut-on sérieusement imaginer que la défense de la francophonie puisse coïncider avec la protection d’un régime digne des nazis ? » On pourrait, à propos de Jacques Foccart, élargir l’interrogation : en promouvant comme hérauts de la grandeur française en Afrique les Eyadéma et Mobutu, entre autres, en se fourvoyant avec l’ « exemplaire » Côte-d’Ivoire
dans les guerres civiles nigériane et libérienne, Jacques Foccart n’a-t-il pas outragé pour très longtemps l’image de la France au sud du Sahara ?
(p.300) La vieille garde françafricaine est là, ou de retour, avec ses entourages insatiables : le Gabonais Omar Bongo, le Togolais Gnassingbe Eyadéma, le Camerounais Paul Biya, l’Ivoirien Henri Konan-Bédié, le Sénégalais Abdou Diouf, le Mauritanien Maaouya Ould Taya, l’Équato-Guinéen Teodoro Obiang, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Béninois
Mathieu Kerekou, le Malgache Didier Ratsiraka, le Djiboutien Hassan Gouled, le Comorien Mohamed Taki, le Marocain Hassan II, le Tunisien Ali Ben Ali, l’Égyptien Hosni Moubarak. Au coeur du Sahel, lajeune garde des généraux monte au créneau : le Burkinabé Blaise Compaoré, le Nigérien Ibrahim Baré Maïnassara, le Tchadien Idriss Déby. Le Nigérian Sani Abacha est aussi preneur de relations françafricaines, comme l’ Angolais Josué Eduardo Dos Santos, le Kényan Daniel Arap Moï, le tandem soudanais Béchir-Tourabi et les généraux algériens, sans parler du Libérien Charles Taylor. On en passe…
(p.309) La guerre civile au Congo-Brazzaville, de juin à octobre 1997, et la victoire par KO de l’ ancien président Denis Sassou Nguesso sont un bon indice de la vitalité persistante de l’hydre françafricaine après la mort de Foccart, et des plongées qu’elle opère. Dans le conflit meurtrier opposant les milices de Sassou Nguesso et de son successeur Pascal Lissouba, la France a affiché dès le départ une neutralité officielle, au nom d’une nouvelle virginité : finie l’ingérence dans (p.310) les affaires intérieures des États africains; on se contente d’un « service minimum », l’ évacuation des Français et autres Européens. On pouvait comprendre cette posture. Les deux vétérans de la politique congolaise, aux premières loges depuis un tiers de siècle, ne luttaient manifestement pour le gros lot : les royalties pétrolières et l’ appropriation clientéliste du budget de l’État.
Au tournant de 1990, le mécontentement populaire et une Conférence nationale souveraine avaient chassé le dictateur Sassou Nguesso et rétabli les élections, portant Lissouba à la
Présidence en 1992. Depuis, les deux hommes n’ont cessé de se battre, alternativement par les armes et dans les urnes. Celles-ci ne peuvent plus les choisir sans être bourrées, tant la population est lasse de ces compradores, ces prédateurs branchés sur les circuits françafricains: Elf bien sûr, mais aussi les réseaux Foccart et Pasqua, des filières corses , des
excroissances maçonniques , etc.
Le pays est en faillite. Sa dette extérieure est le triple de son Produit intérieur brut. Pour parer les coups de l’adversaire et éviter les aléas du scrutin présidentiel, prévu en juillet 1997,les rivaux dégainent leurs milices, sans épargner les civils. Ils ont assez volé pour faire la joie des marchands d’armes. La drogue s’en mêle, disjonctant un peu plus les miliciens. Il est difficile de prendre parti. Mais il se confirme rapidement que la Françafrique penche massivement pour son vieil affilié Sassou Nguesso. Le 3 juin, deux jours avant le début du conflit , une curieuse livraison de 25 tonnes de fret aérien part du Bourget sous label « présidence du Gabon », puis est transférée aux partisans de Sassou Nguesso via l’ aéroport gabonais de Franceville. Utile précision, le président du Gabon Omar Bongo est le gendre de Sassou Nguesso.
(p.311) On voit réapparaître la très serviable PME Geolink, qui monta l’intervention des mercenaires et avions serbes au Zaïre : elle procurerait cette fois une centaine de mercenaires
à Sassou . Selon La Lettre du Continent (19/6/1997), même des conseillers élyséens recherchent des « instmcteurs » pour le beau Denis. Lequel s’allie ouvertement à d’autres alliés de la Françafrique :une partie des forces du Hutu Power (les ex-FAR) et la Division spéciale présidentielle de Mobutu, repliées au Congo-Brazza.
Mais on va faire plus fort. « Avions français au Congo ? » fait mine de s’interroger Le Nouvel Observateur du 25 septembre. Citant l’opposition tchadienne, l’hebdomadaire indique que l’armée de l’air française mettrait des avions de transport militaire à la disposition de soldats tchadiens, envoyés au Congo pour combattre aux côtés de Sassou Nguesso. Les appareils décolleraient d’Abéché (Tchad), où la France a ses aises. On peut sans doute ôter le point d’interrogation. Même si l’ armée française au Tchad pratique volontiers l’autogestion, il est impensable que Jacques Chirac n’ait pas donné son feu vert à cet engagement d’appareils français.
(p.312) Ainsi, sous une neutralité de façade, une Françafrique branchée sur le bureau présidentiel se range aux côtés de l’une des factions qui déchirent le Congo. Dans ce combat,
elle se retrouve avec l’armée tribale du président tchadien Idriss Déby, une partie de la garde mobutiste, un morceau du Hutu Powerrwandais, et des mercenaires recrutés parles services secrets français. Au ministère de la Défense, on a de la suite dans les « idées ». Le Monde le confirmera après coup :
« Dans les états-majors français, on a du mal à cacher le parti pris en faveur de Denis Sassou Nguesso. […/
« Selon les services de renseignement français, les « Cobras » de M. Nguesso […1 ont pu disposer d’armements lourds et individuels en provenance de plusieurs États africains proches de la France, comme le Gabon. Les mêmes sources françaises laissent entendre que ces milices ont pu, grâce à des circuits de financement occultes fréquents dans les milieux pétroliers, acheter des matériels en Europe . »
Pendant ce temps Omar Bongo, ami de Chirac et obligé d’Elf, préside le Comité international de médiation chargé de dénouer la crise congolaise…
Mi-octobre, la guerre de position entre milices cède à une conquête-éclair du pays par le camp Nguesso. Aux considérables apports en hommes et en armes déjà mentionnés s’ajoute un élément plus décisif encore : l’intervention de (p.313) l’ armée angolaise depuis l’ enclave pétrolière voisine de Cabinda .
Pourquoi l’ Angola est-il monté au front ? La vieille amitié entre le président angolais Dos Santos et l’ex-président congolais Nguesso n’est pas une explication suffisante. En interrogeant les généraux qui détiennent la réalité du pouvoir à Luanda, on perçoit deux niveaux de motivations. Il s’est agi d’ abord de frapper deux rébellions angolaises que Lissouba ne cessait de favoriser : l’Unita de Savimbi et les sécessionnistes du FLEC-Rénové (Front de libération de l’enclave de Cabinda). Les généraux de Luanda ne cachent pas non plus leurs ambitions. Ils entendent faire de l’Angola une puissance régionale, ce qui suppose d’endiguer les visées de deux grands « voisins » : l’ Afrique du Sud (qui serait alors canton-
née dans l’Est africain) et l’ex-Zaïre, renvoyé à la difficile gestion de l’après-Mobutu. L’Angola, lui, pourrait devenir le «parrain » d’une longue côte gorgée de pétrole, allant de ses
propres gisements off-shore jusqu’ au Cameroun, en passant par Cabinda, Pointe-Noire au Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.
Il n’est pas surprenant que ces ambitions angolaises rejoignent un corps expéditionnaire venu du Tchad : ce protectorat français à fortes promesses pétrolières s’est vu confirmer un rôle de verrou stratégique par le ministre de la Défense socialiste Alain Richard .
Mais plus que du ministre français de la Défense, i1 faut parler de la Tour Elf à la Défense… Car il est clair qu’ en toute (p.314) cette affaire la stratégie du groupe pétrolier a été déterminante. Alors qu’il vient d’enchaîner les découvertes de champs pétroliers majeurs au large des côtes angolaise et congolaise, il voyait cet eldorado marin exposé à la vague révolutionnaire issue de la région des Grands Lacs. Les régimes corrompus du Gabon, du Cameroun et de Guinée-Équatoriale étaient menacés. Celui de Brazzaville sombrait… Il y avait le feu au lac… de pétrole! Des bateaux-navettes ordinairement utilisés par Elf ont débarqué des unités angolaises et des « Cobras » de Nguesso pour s’emparer du port de Pointe-Noire, centre névralgique de l’exploitation pétrolière et clef de la conquête du Congo .
Opportunément, en 1996, le réseau Pasqua-Marchiani avait gavé d’armements russes les troupes angolaises. En avril 1997, le PDG d’Elf Philippe Jaffré avait fait un séjour remarqué à Luanda. À l’Élysée, Jacques Chirac n’ avait donc plus, en ligne directe avec l’ami Bongo, qu’à sceller la coalition anti-Lissouba, sans lésiner sur les moyens proprement français : l’ armée de l’ air et les « services » spécialisés dans les trafics d’ armes. Les services secrets de l’État et ceux d’Elf, rappelons-le, ont beaucoup d’ agents en commun. Depuis le temps du Biafra, ils savent organiser conjointement des livraisons occultes d’ armements.
La neutralité française dans le conflit congolais n’ était donc qu’une fiction. Les médias ont vendu la mèche. On a vu François Blanchard, le « Monsieur Afrique » de Thierry Saussez – homme-protée de la communication politique françafricaine -, être le premier Occidental à embrasser devant une caméra de télévision le général vainqueur Sassou Nguesso a. Moins d’un mois après cette victoire, la (p.315) Françafrique, emmenée par Thierry Saussez, a affiché son amour du régime angolais : Elf, Castel, et compagnie, se sont payé dans L’Express du 13 novembre vingt pages de publireportage en quadrichromie, « Angola tourné vers l’avenir ». Des fleurs au bout des fusils…
Un axe Elf-Élysée-N’Dj amena-Brazza-Luanda se dessine. Il pourrait, accessoirement, faire le ménage en Centrafrique, étouffer dans l’ oeuf des turbulences contestataires au Cameroun, et couver ceux qui rêvent d’une reconquête de l’ex-Zaïre.
Jospin a-t-il eu son mot à dire dans tout cela ? A-t-il ou non aquiescé à ce Kriegspiel, à cette énième variante du découpage de l’ Afrique, à ces manoeuvres de consolidation d’un chapelet de régimes prédateurs, au triomphe, peut-être éphémère, de la compagnie Elf? Selon La Croix, le trio Nguesso-Bongo-Dos Santos a « de bonnes relations avec l’Élysée et nombre de responsables du Parti socialiste français « . Selon Le Canard enchaîné , «le gouvernement Jospin a suivi, sans trop d’enthousiasme ».
L’affaire se conclut par une série de plaintes. Chassé de Brazzaville, l’ ex-Président Lissouba a porté plainte contre Elf au tribunal de grande instance de Paris pour complicité de destructions et d’homicides (5 000 à 15 000 civils), actes de terrorisme et association de malfaiteurs. Il accuse Elf d’avoir financé une guerre civile dont il estime le coût, pour le camp Nguesso, à plus de 100 millions de dollars. Il demande l’ examen de la comptabilité d’Elf, et notamment de sa banque très privée, la Fiba. Une plainte bien épineuse, dont le parquet s’emploie à démontrer l’irrecevabilité.
Lissouba ne manque pas de documents compromettants. Lui aussi arrosé par Elf, il connaît parfaitement les circuits (p.316) financiers de la corruption . Il rengainera probablement ses
pièces à conviction contre un gros pactole.
Cela fera encore ça de moins pour les Congolais, qui ne voient guère la couleur des revenus pétroliers. La guerre des concessionnaires de la rente leur aura, au contraire, laissé une capitale en mine. L’état de Brazzaville évoque Grozny, ou Berlin en 1945. La première capitale de la « France libre » fait honneur à un demi-siècle de politique franco-africaine !
(…)
À défaut d’être citoyens, nous pouvions en spectateurs assister mi-décembre 1997 à un remarquable défilé. Deux mois à peine après la fin du carnage, Sassou Nguesso recevait
dans le fastueux hôtel Grillon une grande partie de la distribution parisienne du présent ouvrage : Vincent Bolloré, Robert Feliciaggi, Philippe Jaffré, Jean-Christophe Mitterrand,
Charles Pasqua, Guy Penne, Fernand Wibaux, etc. Il était reçu en tête à tête par Jacques Chirac à l’Élysée, moins intimement par Lionel Jospin à Matignon. Le tout sous la haute
protection des hommes de main de Paul Barril…
(cf La Lettre du Continent, 0110111998. On peut s’étonner à ce propos que le gouvernement Jospin laisse opérer à l’hôtel Grillon, haut lieu de la diplomatie parisienne officieuse, la milice d’un personnage aussi » incontrôlable » et sulfureux que Paul Barril, qui se flatte par exemple d’avoir combattu aux côtés du Hutu Power.)
/DENARD/
(p.320) (…) ce genre de milice denardienne peut à l’ occasion intervenir dans la politique française, par patriotisme autoproclamé, pour en «finir avec ce bazar ». Manifestement, si
la partie n’avait pas été gagnée, Foccart n’aurait pas hésité à (p.321) faire intervenir les porte-flingues de Denard. Pas plus en métropole qu’au Zaïre ou au Biafra. Rien d’étonnant chez
1’ « homme-orchestre » des complots du 13 mai 1958, celui qui fit planer sur la République la menace des 7 800 réservistes du Sservice Action du Sdece , qui fonda le SAC, puis un syndicat d’ étudiants pas vraiment non-violent, l’UNI (Union nationale interuniversitaire).
En mai 1968, d’ailleurs, Denard n’avait pas attendu l’édifiante entrevue racontée par Foccart pour emmener ses troupes faire le coup de poing dans les facs, en compagnie d’excités d’extrême droite rameutés par le SAC . Rappelons-le aussi, cet ancien des commandos de marine en Indochine a participé le 17 juin 1954 à une tentative d’assassinat contre le président du conseil Pierre Mendès France – accusé de brader l’Empire .
(p.322) Le 13 mai 1978 (anniversaire remarquable), ils débarquent aux Comores et renversent le président Ali Soilihi, au profit de son prédécesseur Ahmed Abdallah. Cette fois, Foccart admet avoir été informé . L’expédition était commanditée par Paris et Pretoria. Le régime d’ apartheid cherchait à déstabiliser les pays voisins, en particulier le Mozambique où il entretint, comme en Angola, une terrible guerre civile. Les Comores devinrent une base idéale pour les raids anti-mozambicains.
Foccart raconte : « Denard était l’hommefort des Comores, à la tête d’une garde présidentielle de six cents hommes dont trente Européens, sans compter la centaine de civils qu’il employait à sa ferme, tout cela payé par l’Afrique du Sud . » Ses mercenaires ne se contentaient pas de torturer les opposants comoriens . Après un accident de la circulation consécutif à un réveillon trop arrosé, l’un des adjoints de Denard n’ a pas hésité, le 1er janvier 1937 à deux heures du matin, à casser la figure au médecin coopérant français qui, à l’hôpital de Moroni, tentait de soigner sa maîtresse. La plainte a évidemment été classée sans suite .
(p.323) Dans la nuit du 25 au 26 novembre 1989, le président comorien Abdallah ne sort pas vivant d’un entretien avec Bob Denard. Les sponsors sud-africains et français de ce « Sanders » à la détente trop facile le rapatrient le plus discrètement possible. Ils installent Saïd Mohamed Djohar à la place d’ Abdallah.
(p.324) En réalité, les chefs d’Etat en question savent pertinemment, depuis l’assassinat de leur collègue togolais Olympio en 1963, qu’en Françafrique la « loyauté » se mesure d’abord à l’épaisseur des liens d’affaires, ou des dossiers de chantage.
L’armée française finit par débarquer et arrêter Denard. Au vu de sa « douloureuse reddition », on pourrait en déduire que, dans le couple Denard-DGSE, la seconde a doublé le premier : la « Piscine » aurait ferré son brochet. Mais il s’ agit plutôt d’une savante comédie. Le scénario a été écrit conjointement jusqu’à son terme : un bref emprisonnement « à la Santé », et l’assistance de Me Soulez-Larivière, qui fut à Auckland l’avocat des faux époux Turenge dans l’affaire DGSE contre Rainbow-Warrior.
(p.325) En tout cas, l’acteur qui a si magistralement bluffé journalistes et téléspectateurs méritera d’ être rapidement libéré : le vieux corsaire boite, avez-vous vu ? Grâce à ses loyaux services, Paris semble avoir gagné sur tous les tableaux : Djohar est remplacé par une équipe plus présentable – mais non moins dépendante; tel un shérif triomphant des outlaws, le corps expéditionnaire tricolore raye les mercenaires de la carte d’Afrique, s’imposant en garant de la loi et de l’ordre.
(p.327) Au fil de ses missions, qui s’ étendent au Moyen-Orient, Barril a accumulé un matériel de chantage extraordinaire, tout comme son avocat et ami Jacques Vergès, prodigue en conseils aux dictateurs françafricains.
(p.328) Les livraisons d’armes clandestines au Hutu Power rwandais sont passées en partie par une société « couverte », DYL-Invest, basée à Cran-Gevrier – près d’ Annecy et de la Suisse. Il est impossible que le commerce massifet illégal de matériels de guerre auxquels cette PME s’est adonnée ait échappé aux services français, surinvestis en tout ce qui touche au Rwanda. Le dirigeant de DYL, Dominique Lemonnier, était donc pour le moins un honorable (p.329)
correspondant, soumis aux règles de la discrétion.
Malencontreusement, à la suite d’ embrouilles financières, son commerce clandestin a été évoqué en justice sur plainte de… Paul Barril, un concurrent dans le business pro-Hutu Power.
Écroué, puis libéré sur un non-lieu, Lemonnier a eu la fâcheuse idée de porter plainte à son tour contre Barril et de faire savoir qu’il solliciterait un dédommagement de l’État français. Il meurt opportunément d’une crise cardiaque le 11 avril 1997 , en sortant d’un déjeuner d’affaires à Annecy .
Alors même qu’elle embauchait pourle Zaïre des cadres du Front national ou des massacreurs de Srebrenica, un rapport des Nations unies constatait que les mercenaires sont, le plus souvent, des criminels aux idéologies fasciste et raciste, associés aux trafics illicites d’ armes, de stupéfiants, voire aux prises d’otages. Ce qui devrait conduire à « châtier de manière
sévère » les gouvernements et les mouvements qui les engagent. Le rapport cite les Comores, où s’illustrèrent à maintes reprises les Denard et compagnie …
(p.330) La France n’ a toujours pas signé la convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires, adoptée en 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU . Trop d’apprentis-Foccart ne s’imaginent pas sans élèves de Denard. Trop d’adeptes d’une fausse grandeur de la France ne la conçoivent pas sans toutes ces opérations clandestines, tous ces « coups tordus » qui, depuis un demi-siècle, de l’Indochine au Rwanda et au Zaïre, en passant par l’Algérie , ont si lourdement contribué à déshonorer notre pays.
(p.331) A l’automne 1997, l’une des responsables de Survie, en mission dans la région des Grands Lacs, passe par Butare, la capitale universitaire du Rwanda. Elle accepte l’invitation du recteur de la faculté des lettres, qui lui propose de rencontrer ses étudiants. Face à une salle bondée, elle propose à l »auditoire de renverser les rôles convenus : au lieu de faire un
exposé de ses propres vues, elle suggère que ce soient plutôt les étudiants qui l’interrogent.
Elle est vite mitraillée par une série de questions impitoyables sur le rôle joué par la France en Afrique, durant et après la colonisation. Elle répond sans faux-fuyants. La discussion déborde sur les aberrations de la Françafrique – pas le mot, mais le contenu, largement expérimenté à travers le continent, et qui a pris là-bas une tournure catastrophique. Toute la relation Nord-Sud, les jeux et les conflits d’intérêts entre nations, le monde tel qu’il va et ne va pas, sont au rendez-vous.
Subitement, une jeune étudiante fait taire ses condisciples et lance : «Je ne savais pas qu’il y avait des Français comme vous, je les mettais tous dans le même panier. Il faut que vous
restiez, que vous rencontriez tout le monde à l’Université, pour que ça se sache. Il n’y a pas de raison que nous soyons les seuls à pouvoir discuter avec vous. »
(p.332) Vouloir corriger les torts commis en notre nom n’est ni un acte désespéré, ni un acte de courage. C’ est une manière de vivre pour ce que l’ on croit, de faire vivre le meilleur du pays auquel on appartient.
(p.335) Dès juin-juillet 1997, Elf et l’armée ont fait tranquillement avaliser par le gouvernement de gauche leurs options stratégiques au Gabon, au Tchad, au Niger, au Cameroun, etc. Ou plutôt leur pilotage automatique… Ainsi, la sismicité politique qui affecte le continent africain n’aura pas libéré une nouvelle conception de la relation franco-africaine. Elf continue de mettre son pétrole en équation avec les autocraties corrompues du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, etc.; l’armée française croit qu’elle a besoin d’exotisme pour affirmer sa grandeur et attirer des recrues. Elf et l’armée inoculent leurs raisonnements aux
ministres, qui ne peuvent qu’ échouer dans l’habillage politique d’ aussi pauvres arguments.
(p.337) La révolte ne peut être que collective. Le magistrat qui préfère la justice à sa carrière, le journaliste qui ignore les innombrables séductions qu’on lui tend, le fonctionnaire, la femme ou l’homme politique qui rejettent la corruption, le témoin qui parle (tant de choses essentielles restent scellées), l’électeur qui soutient les hommes et les femmes libres qui se présentent à lui, font reculer d’un pas le mensonge. Dans cet ordre de choses, rien n’est vain. C’est pourquoi, si un seul lecteur pouvait rejoindre les rangs de cette résistance invisible et quotidienne, au nom de l’ Afrique, ce livre n’aura pas été écrit pour rien.
2 L’Afrique subsaharienne

Chiracreçoit Omar Bongo (président du Gabon) au Palais de l'Elysée en novembre 2006
(FAZ, 16/06/2009)

Mayotte wordt departement 101 van Frankrijk / Mayotte devient le département 101 de la France
(DS, 30/03/2009)

Elfenbeinküste - die Einheit "Licorne" / Côte-d'Ivoire - l'unité "Licorne"
(LW, 12/04/2011)

France / Des valises pleines d'argent en provenance de la Françafrique
(DZ, 13/09/2011)

France / Briefcases of cash from Africa
(The Economist, 17/09/2011)

Gabon / Extraction d'uranium - Des mineurs irradiés et ... oubliés
(LB, 31/12/2012)

2013 - Centrafrique / La France lance son intervention
(VA, 06/12/2013)

90.000 oeuvres provenant de la Françafrique, volées par la France, se trouvant dans les musées français
(Corriere della Sera, 24/11/2018)


RD Congo - Répression des chrétiens: la France et l'Espagne pointées du doigt
(LB, 04/01/2018)


Mayotte, une source inépuisable de soucis pour la France ... et l'Europe
(The Economist, 07/04/2018)
3 Le génocide rwandais fomenté par la France
3.1 Analyses des événements
3.2 Réactions
3.1 Analyses des événements
|
1997 |
Commission Rwanda — Rétention d’informations à la Défense?, LB 15/03/1997
Officier de renseignement à Kigali, le capitaine De Cuyper mentionne des documents que sa hiérarchie lui a interdit de communiquer. La commission avait entendu dans la matinée trois anciens sénateurs qui se sont rendus au Rwanda peu avant le génocide. Willy Kuijpers (VU) a décrit une situation particulièrement préoccupante. Questionné sur l’existence d’ un climat anti-belge, il a évoqué la préparation d’un coup d’état par des milieux pro-français, ajoutant que les milices étaient endoctrinées contre les Belges. Il a aussi prêté aux 370 militaires français sur place un rôle actif dans l’entourage du colonel rwandais Théoneste Bagoqora et a estimé qu’il serait intéressant d’ approfondir le rôle joué par la sûreté de l’ état française.
|
|
1998 |
RWANDA – Un dirigeant du FPR accuse Paris et Bruxelles, LB 18/03/1998
“La France et certains partis belges sont complices de la rébellion”, a déclaré lundi le président du groupe parlementaire du Front patriotique rwandais (FPR). “La France nous a toujours rejetés et l’on sait que certains partis belges comme le CVP soutiennent indirectement la rébellion”, a ajouté Tito Rutaremara, l’un des membres les plus importants du comité exécutif du RPR.
|
|
1998 |
RWANDA – L. D’Hondt, Hubert Védrine met en cause la Belgique, LB 06/05/1998
Ancien secrétaire général de Mitterrand et actuel ministre des affaires étrangères, il affirme que le Congo, …, le Rwanda et le Burundi étaient mal préparés à l’indépendance et qu’il n’était pas étonnant que ces trois pays se soient tournés vers la France, “pays qui a toujours gardé un intérêt et une amitié particulière pour l’Afrique …” Et dans ce “retournement”, M. Védrine a même vu un “hommage” rendu par les pays africains à la politique française sur le continent noir …
|
|
2016 |
http://www.bbc.com/afrique/region-37831990?SThisFB Génocide rwandais : 22 officiers français épinglés
Partager avec Ces liens sont externes et s’ouvriront dans une nouvelle fenêtre
Le Rwanda a publié, une liste de 22 officiers supérieurs français impliqués, selon lui, dans la planification et l’exécution du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide (CNLG), qui a rendu public le document, soutient que ces « acteurs français ont été impliqués dans le génocide à la fois comme auteurs et complices. » Parmi les officiers supérieurs français accusés d’avoir joué un rôle dans le génocide de 1994 au Rwanda, figure le général Jacques Lanxade. Au moment des faits, le général Lanxade était le chef d’État-Major des armées françaises (1991 à 1995). Kigali considère que l’opération française Turquoise autorisée par les Nations Unies alors déployée au Rwanda, était une « véritable force d’occupation impliquée dans des crimes graves », soutenus et occultés par la France. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide a publié sur son site, les noms ainsi que les agissements supposés de ces 22 hauts gradés de l’armée française. La CNLG estime que les forces françaises ne « veulent pas que leurs actes soient connus malgré leurs preuves ». Début octobre dernier, la justice française a rouvert l’enquête sur l’attentat contre l’avion du président Juvénal Habyarimana, considéré par les experts comme étant l’élément déclencheur du génocide de 1994 dans lequel 800 mille personnes ont été tuées selon l’Onu.
|

(LB, 12/12/2003)
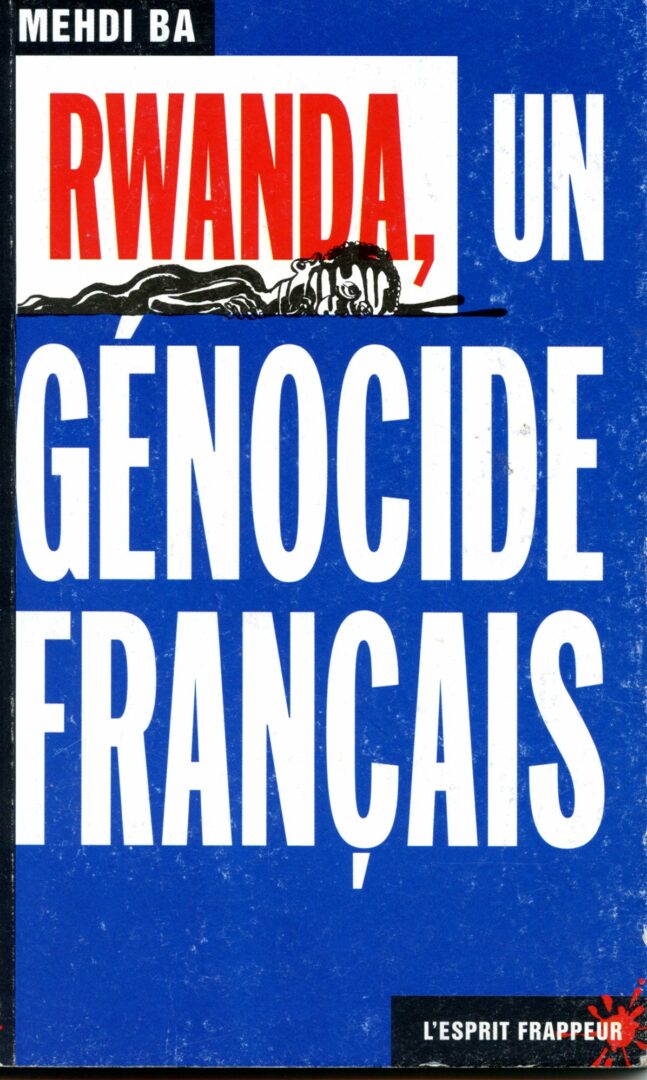
Mehdi Ba: "Rwanda, un génocide français"
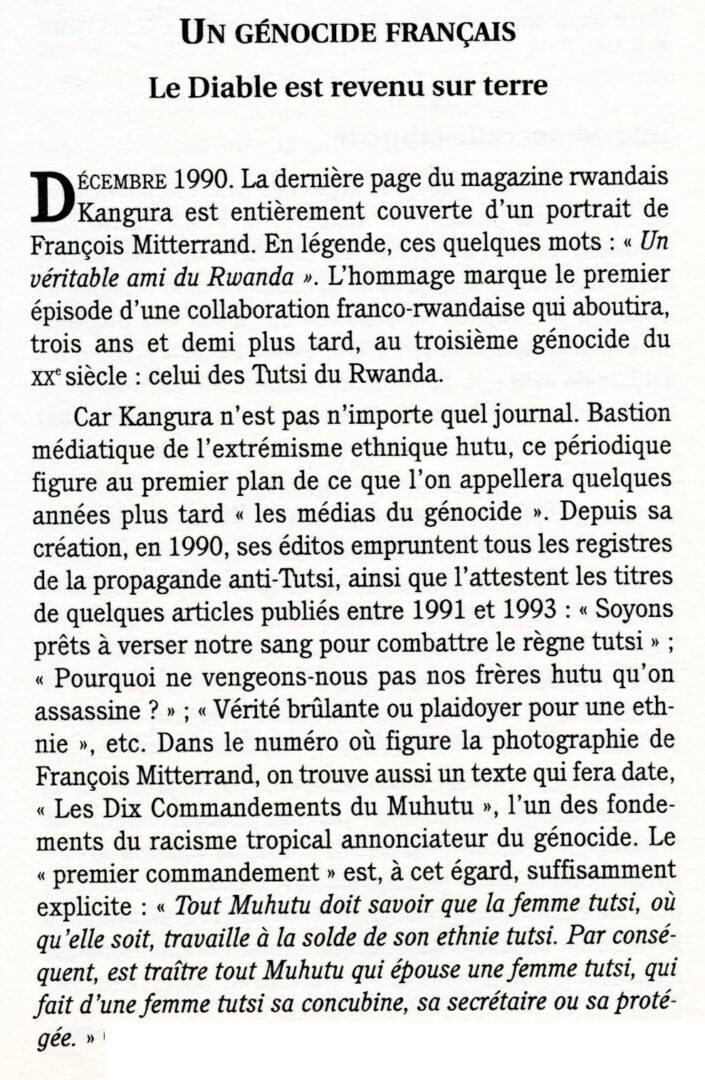
(p.5)

La Nuit rwandaise, l'implication de la France dans le dernier génocide du 20e siècle (extraits) (par Jean-Paul Gouteux, Izuba & L'Esprit frappeur éd., 2004 (un livre à se procurer absolument))
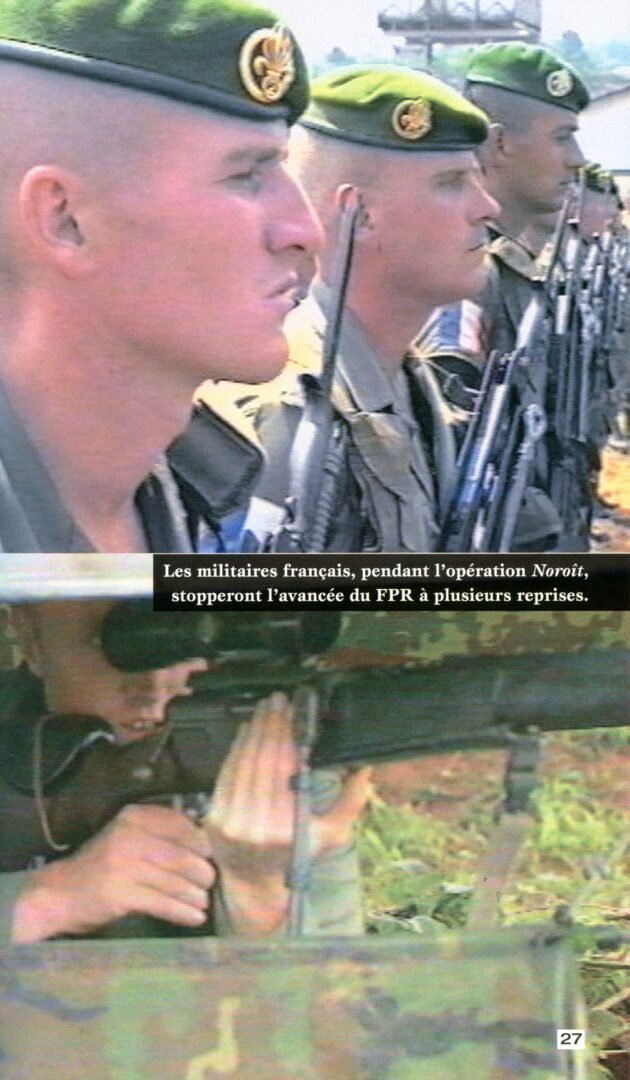

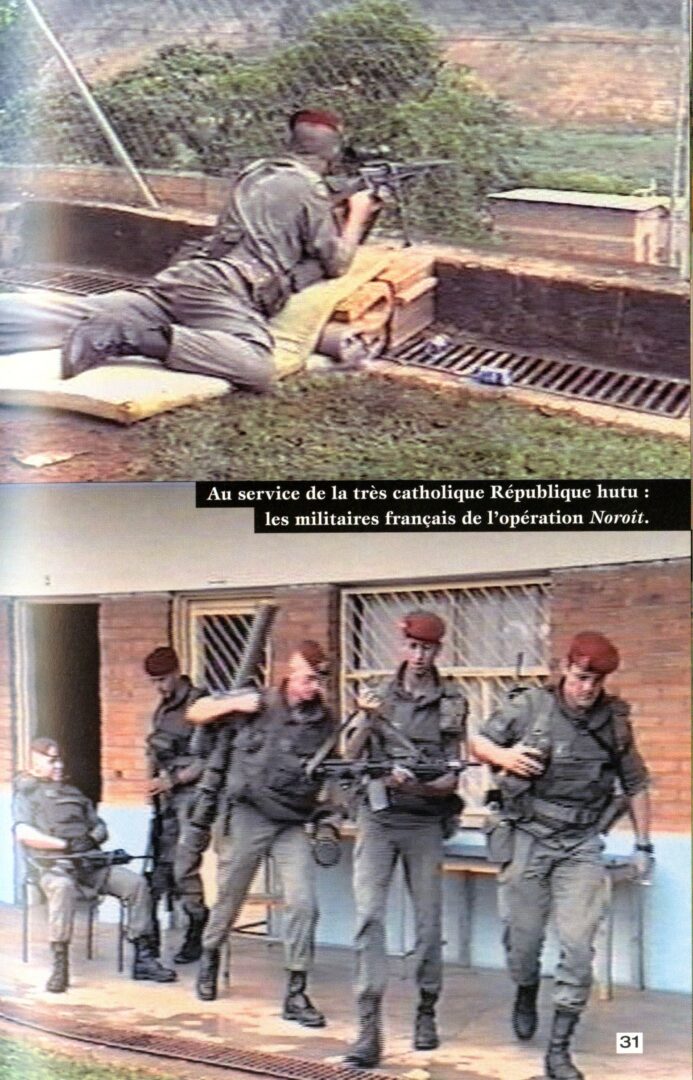

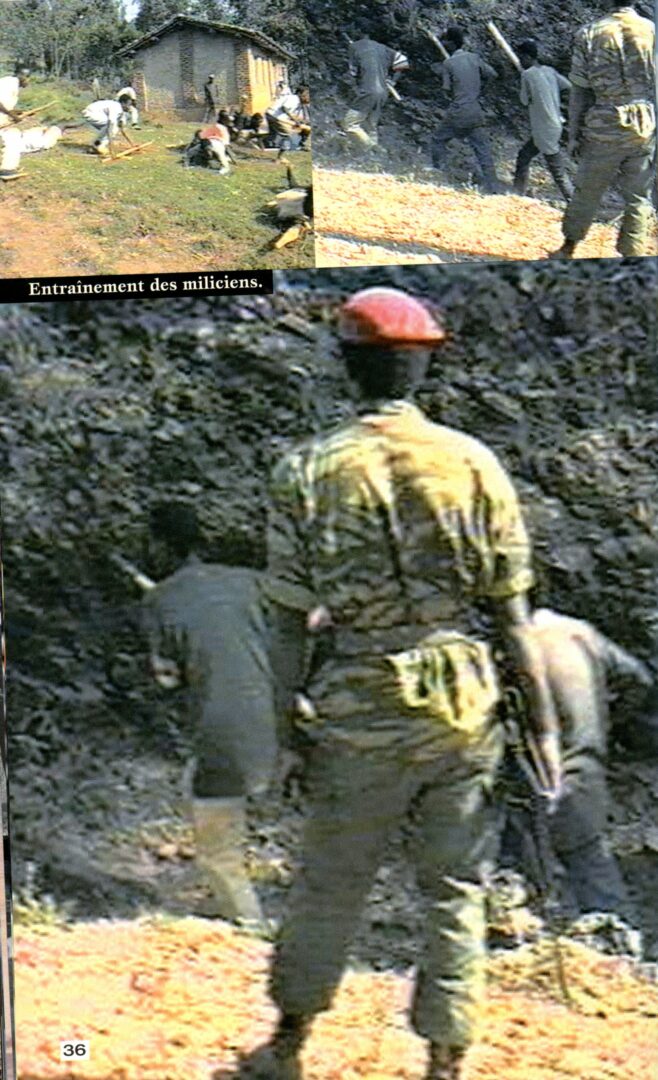
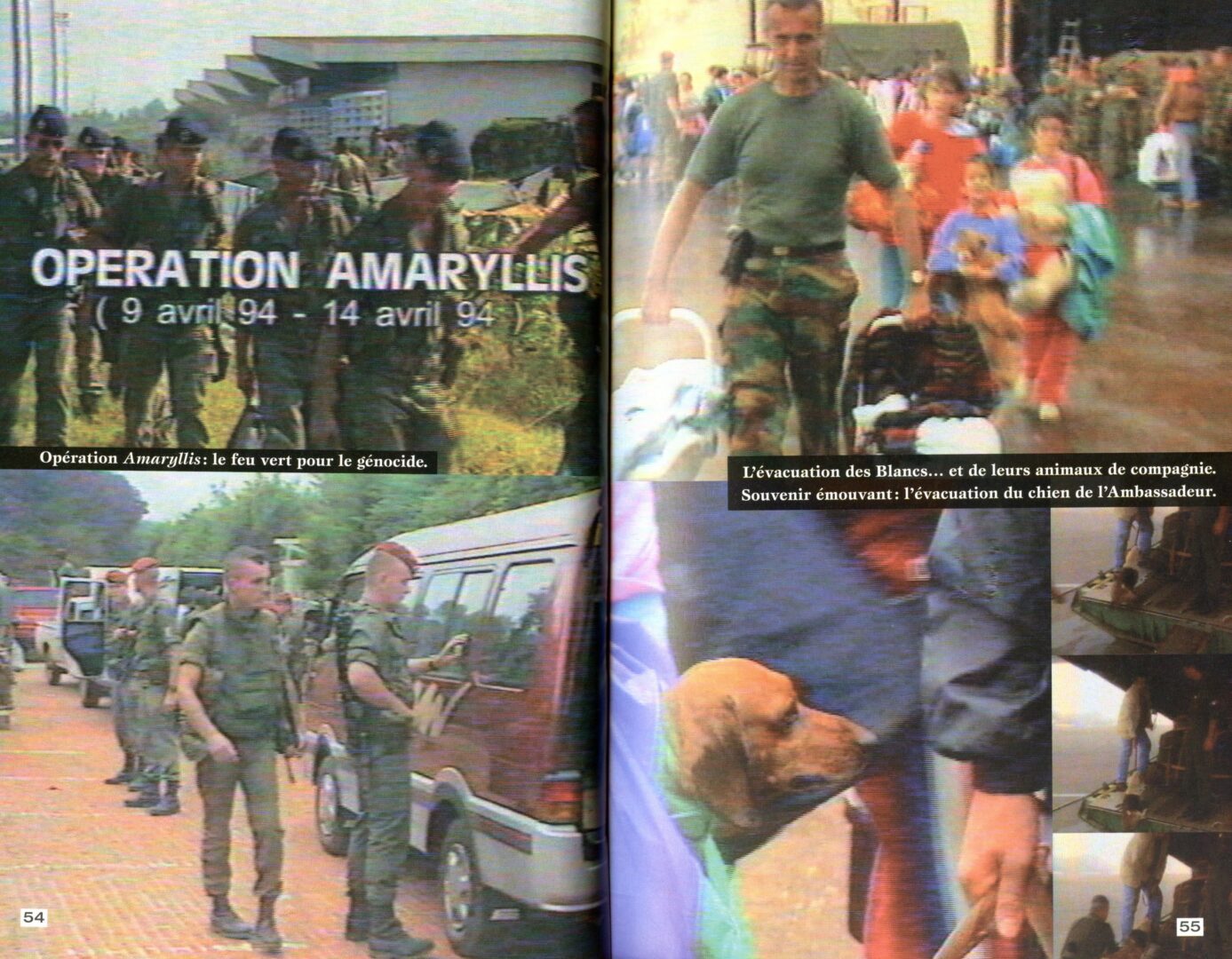

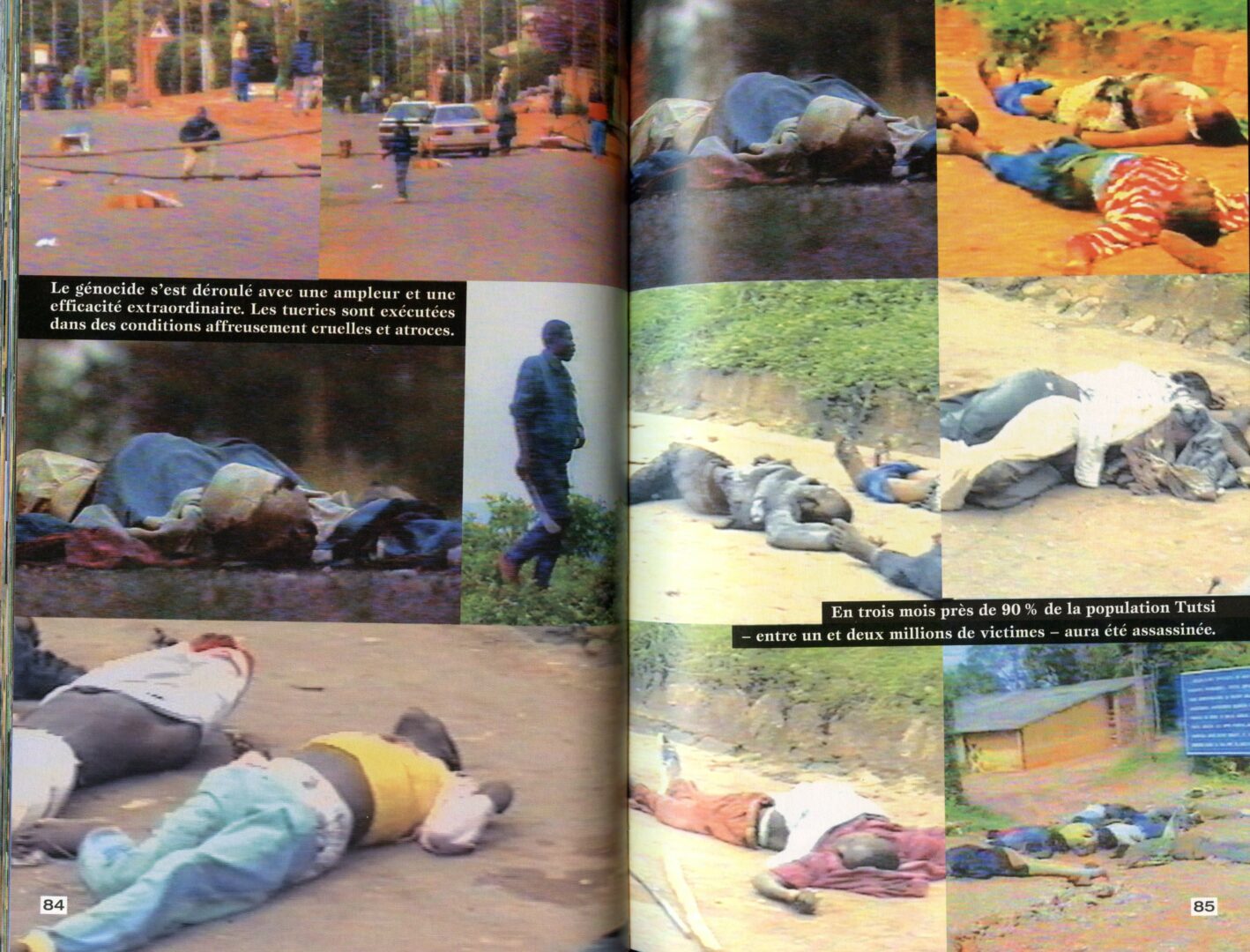
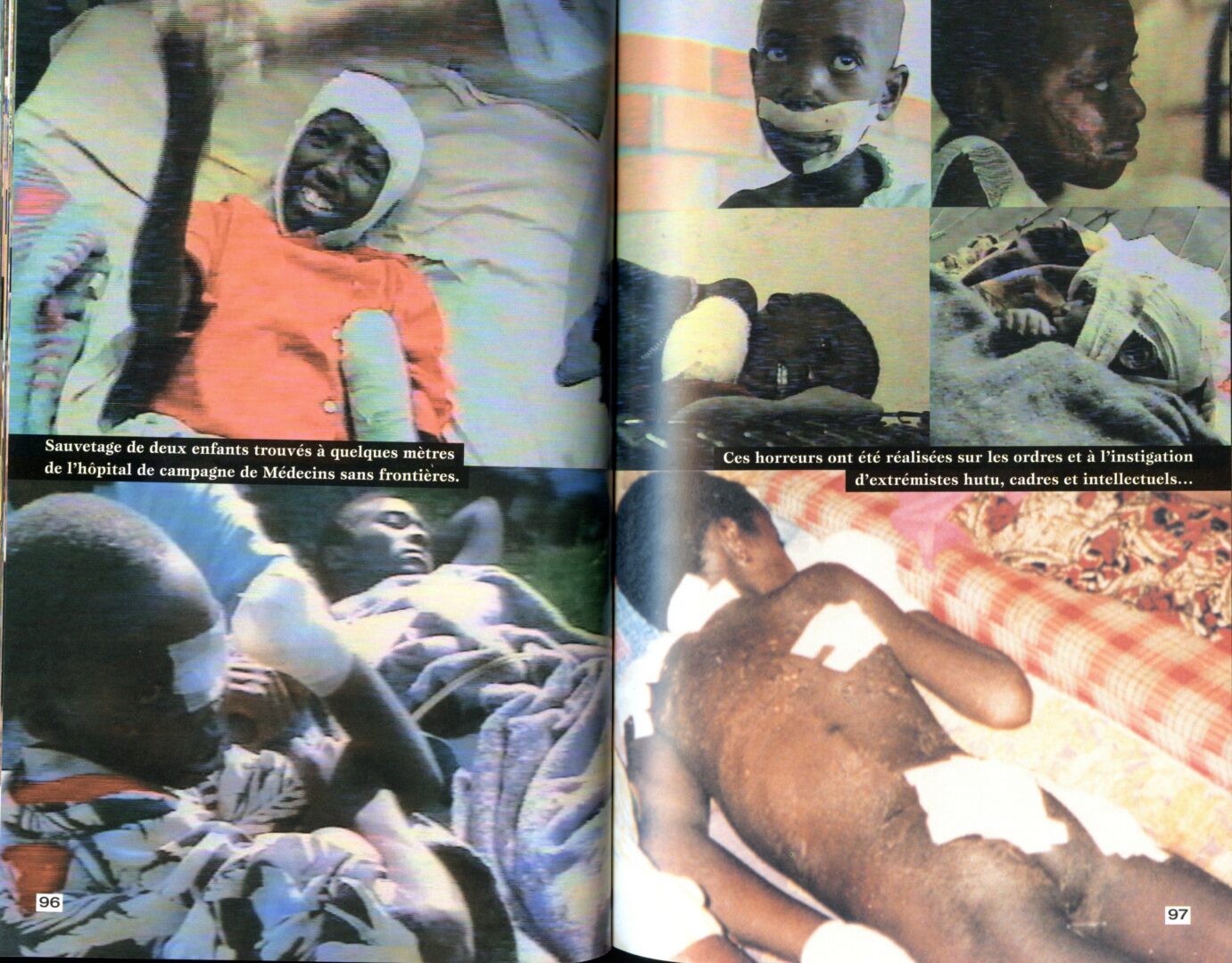
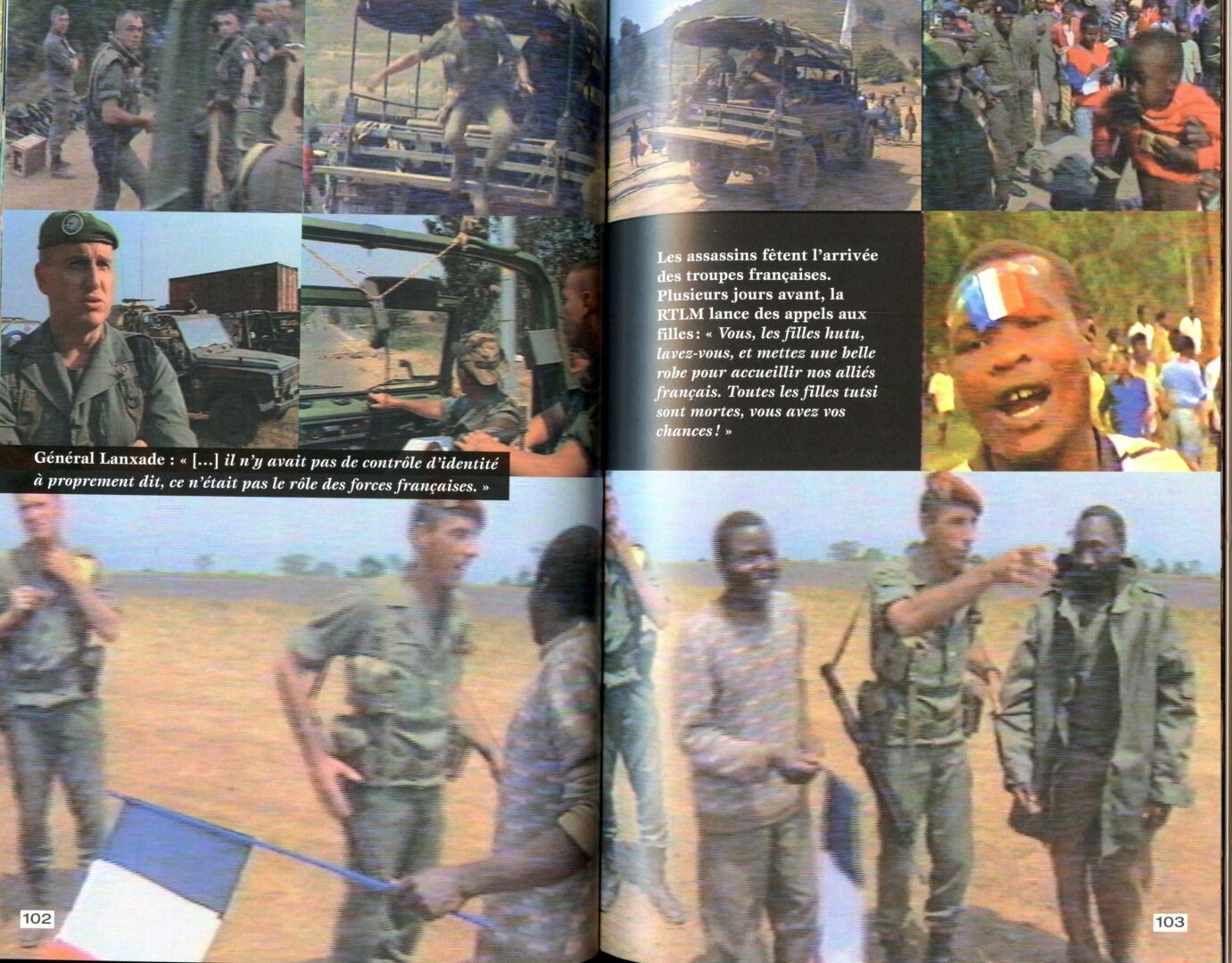
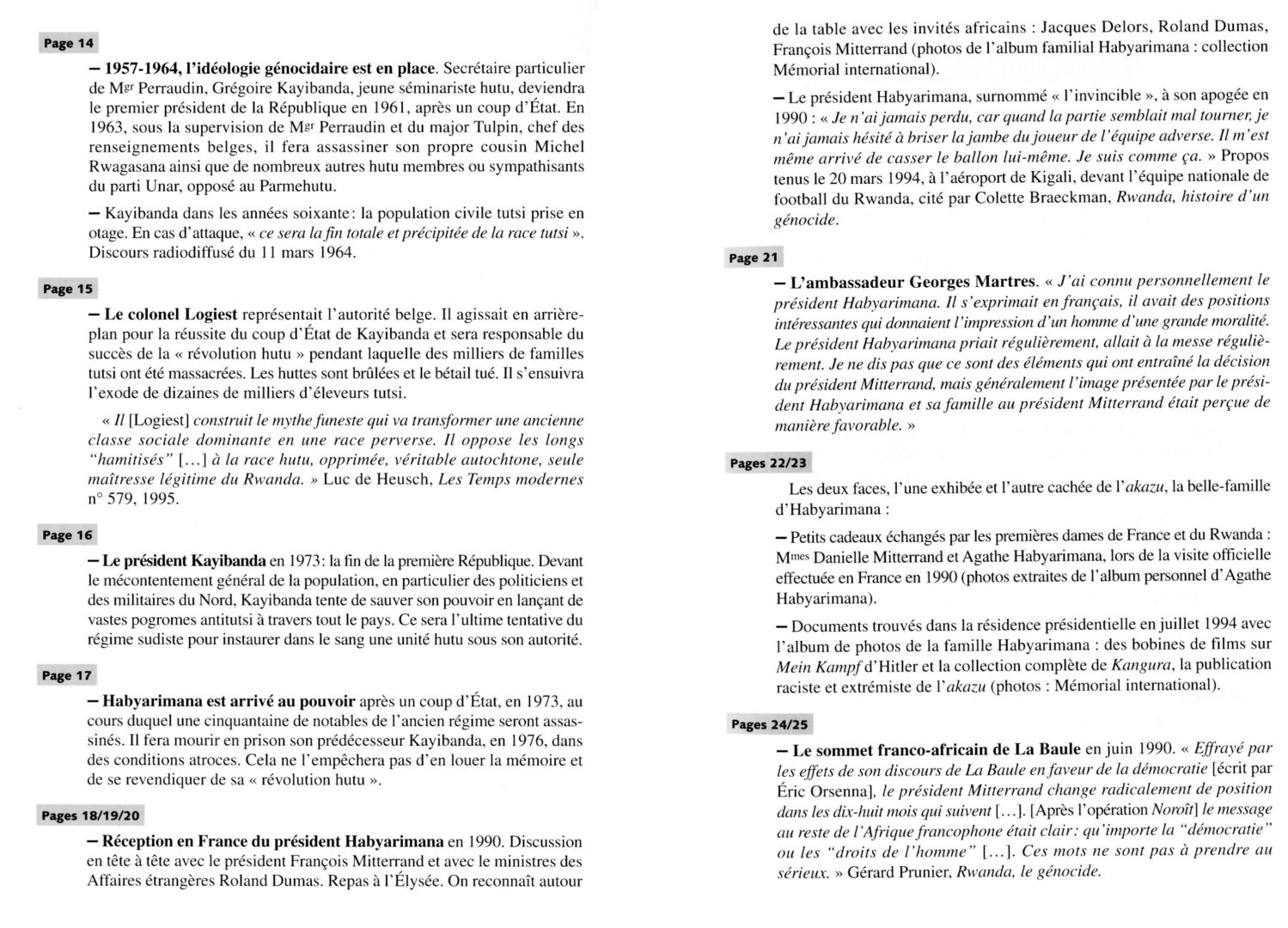
(in: La Nuit rwandaise)
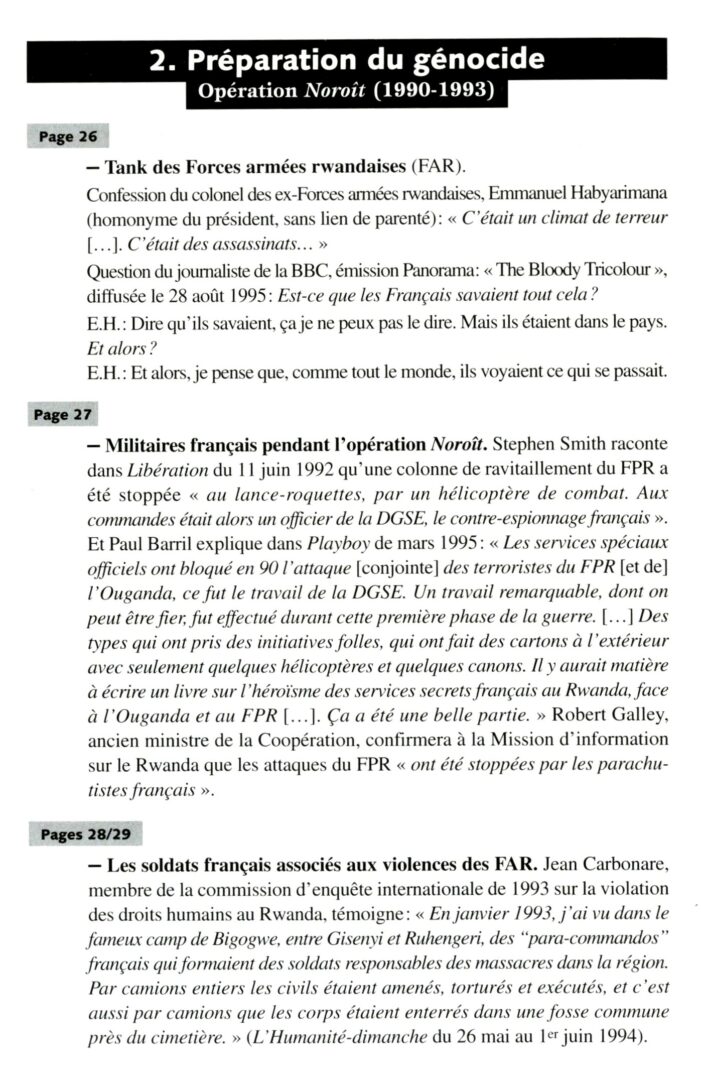
Préparation du génocide rwandais, avec la collaboration active de la France
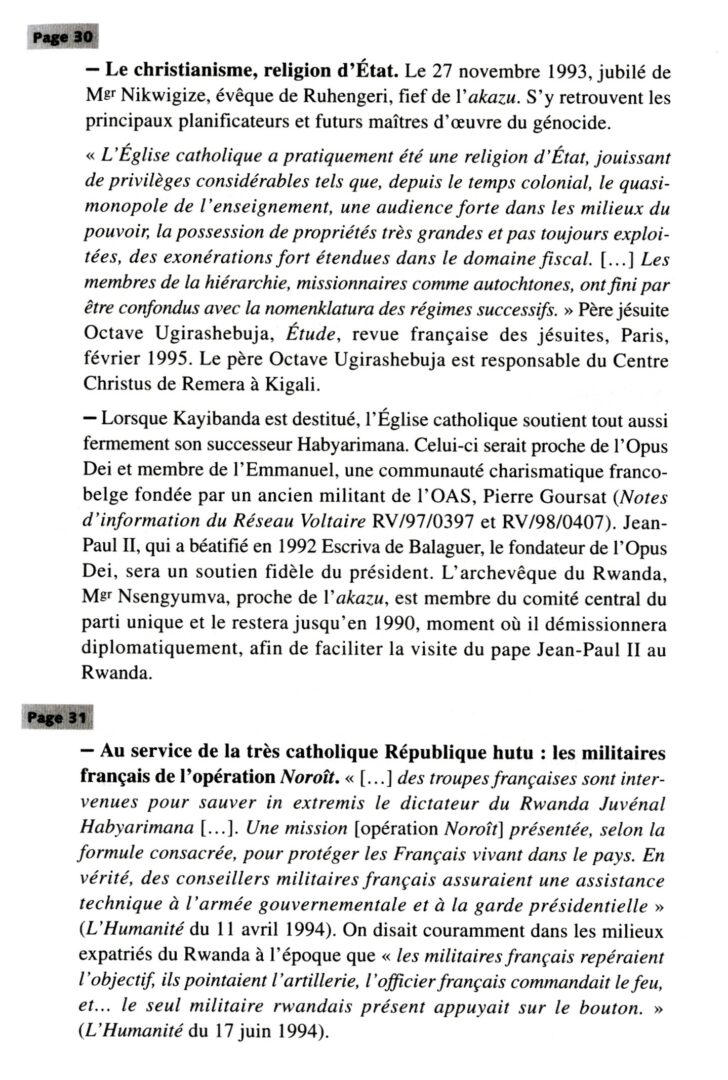
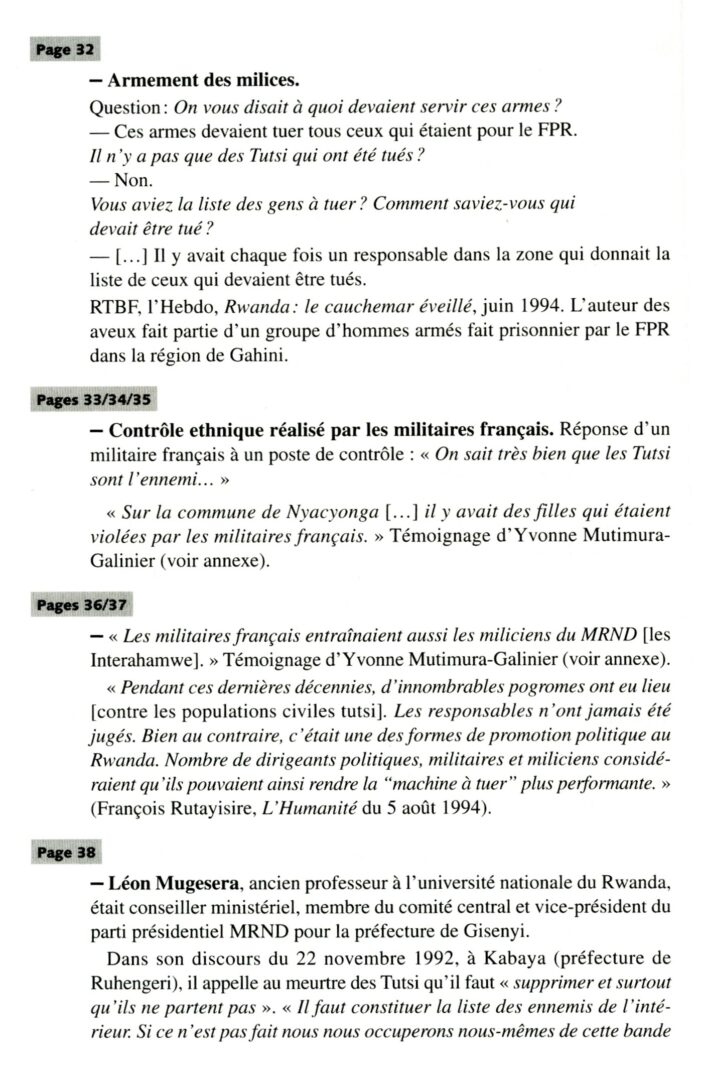
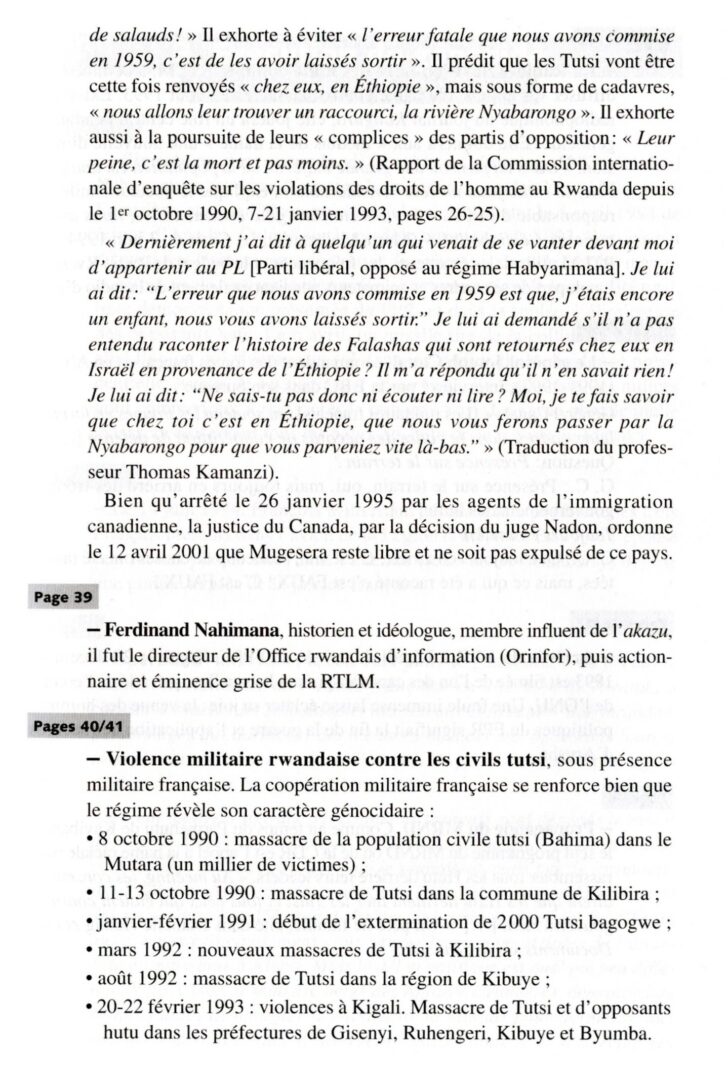

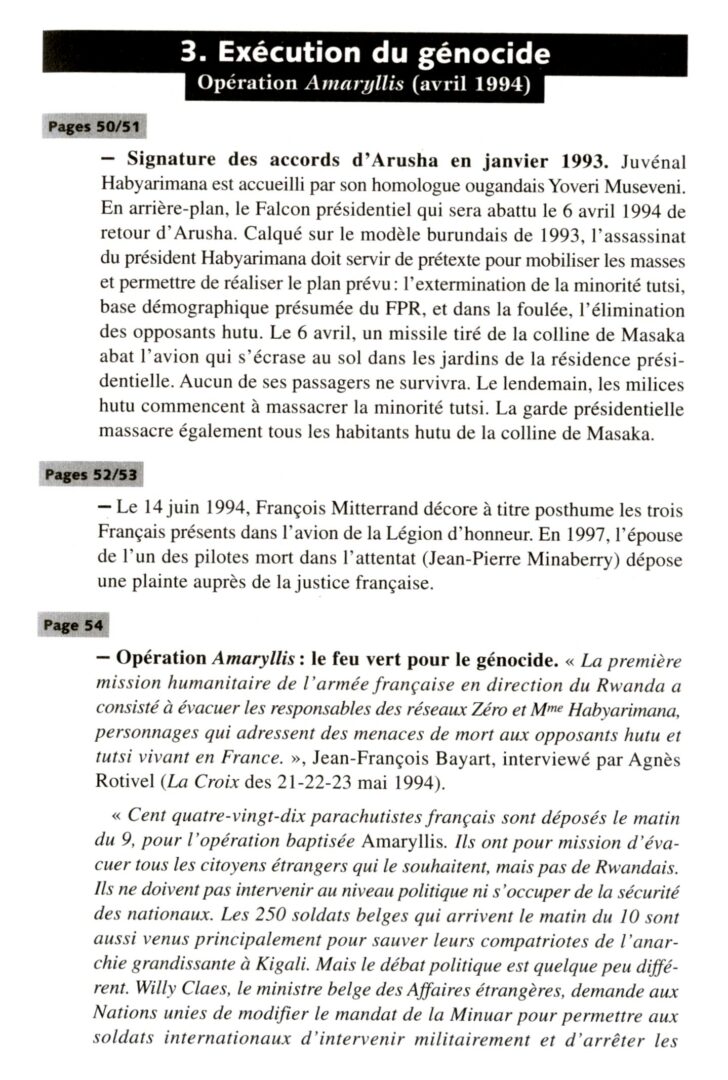
Exécution du génocide rwandais, avec le concours de la France: l'opération "Amaryllis" (avril 1994)
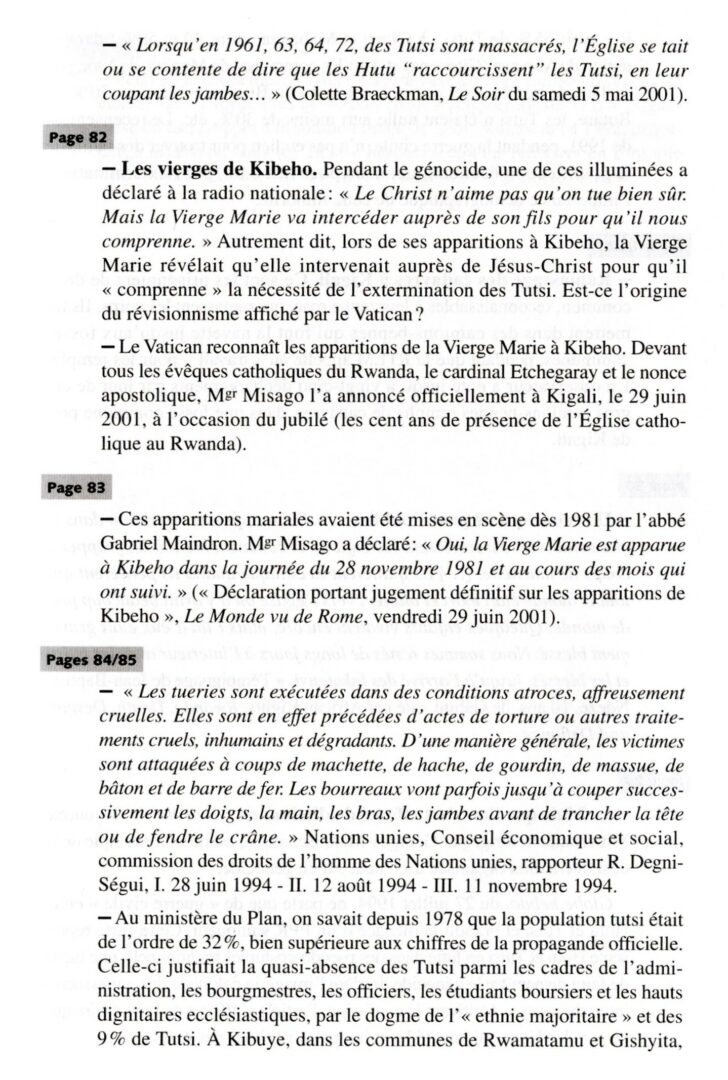

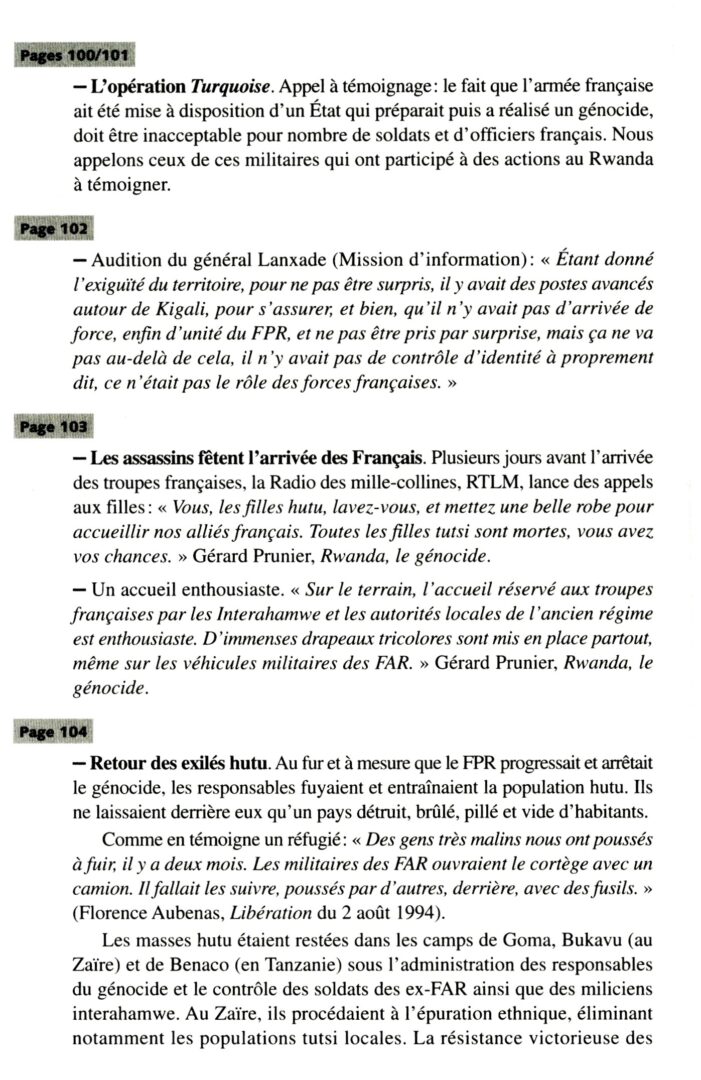
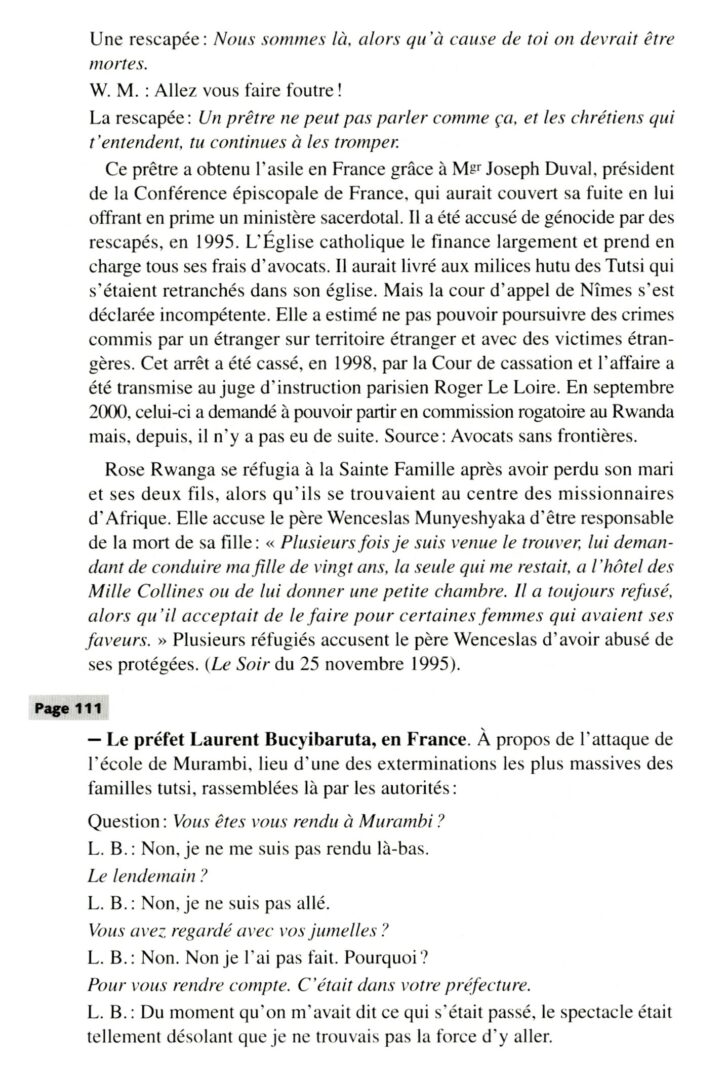

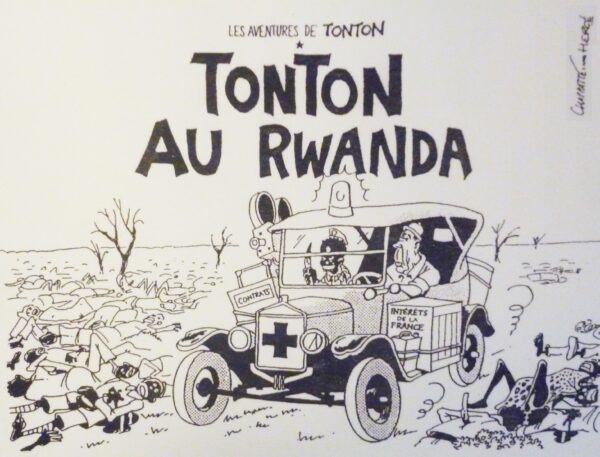
Les aventures de Tonton au Rwanda
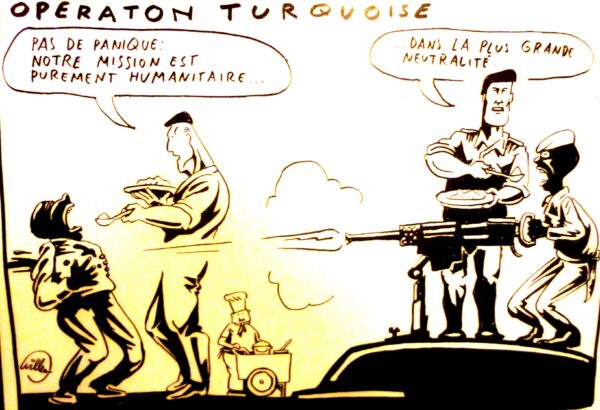
(exposition sur le génocide rwandais perpétré par les Français à Arel / Arlon (2014))
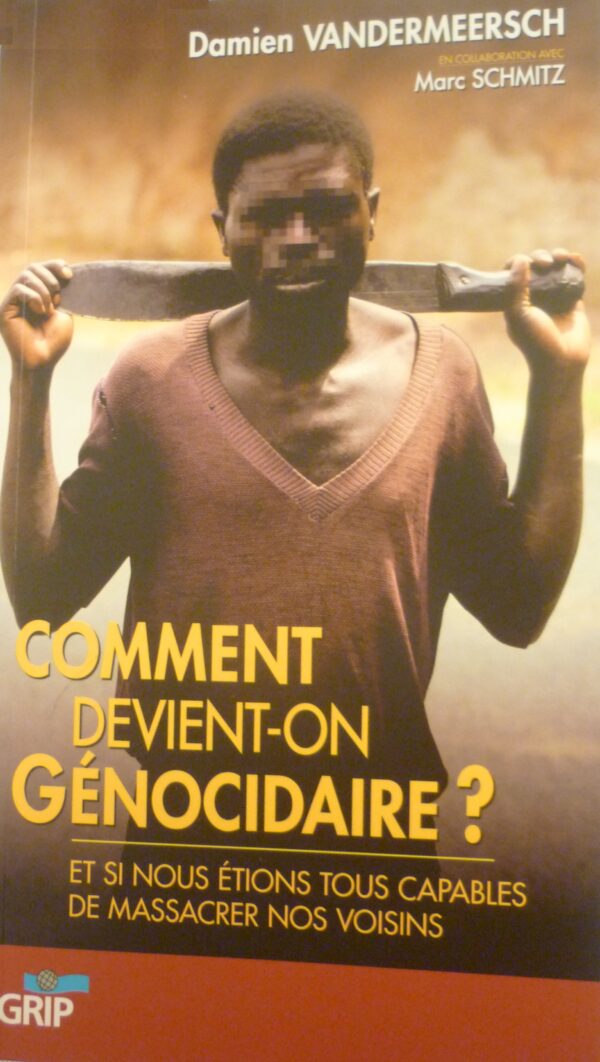
Comment devient-on génocidaire? (Damien Vandermeersch, Marc Schmitz)
Extraits
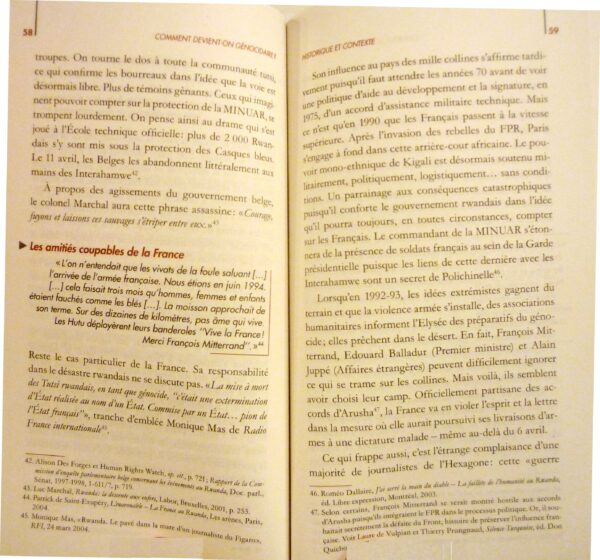
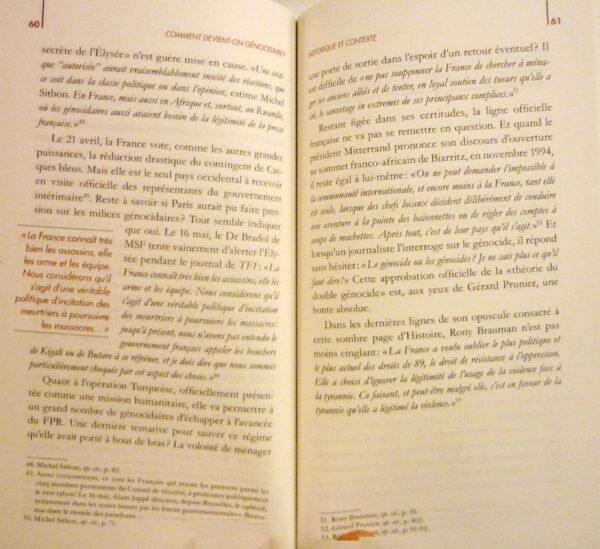
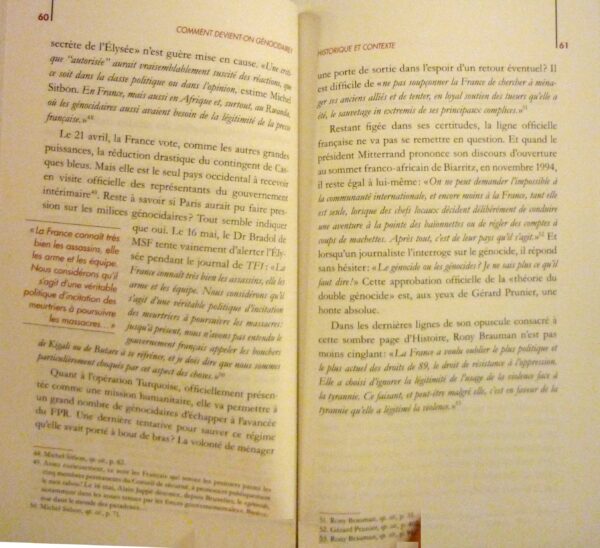
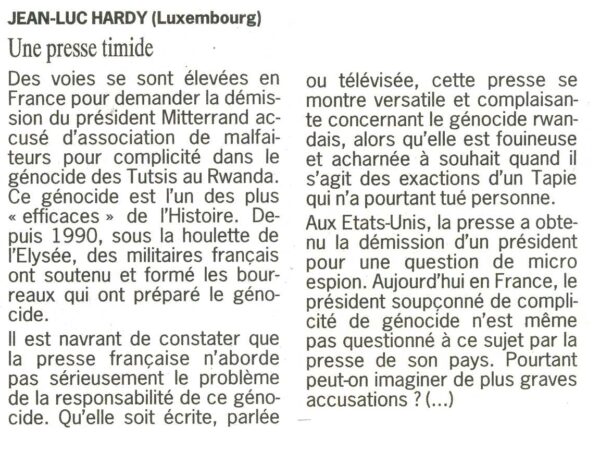
la presse française nie le génocide rwandais (Jean-Luc Hardy (Luxembourg))
(LS, 10/07/1994)

La France, responsable du génocide rwandais (Jean-Thierry Fromont (Bruxelles))
(LS, 27/07/1994)
4 Les pays du Maghreb
|
1983 |
in: Algerije, Wereldwijd, Juli 1983, p.22-23
(p.22) « Tijdens de bevrijdingsfeesten /1945/ werden nationale vlaggen rondgedragen in Sétif en het Franse leger en politiemacht gebruikten wapens om de betoging uit elkaar te drijven. Er vielen naar schatting minstens 10.000 doden. » (p.23) « De brutaliteit waarmee het Franse leger de FLN trachtte te stuiten; het groeperen van minstens 2 miljoen mensen in « beschermde dorpen » die in feite meer op strafkampen leken; de bloedige acties tegen de burgerbevolking vanwege de OAS (Organisation de l’Armée Secrète) die Algerije « Frans » wou houden, hebben de Algerijnen geholpen om zich bijna éénparig achter de FLN te scharen… »
|
|
1989 |
La France va aider l’Algérie, LB 03/06/1989
« L’Algérie désire développer ses capacités touristiques » à un rythme régulier et raisonnable. Et elle aura le soutien de la France, a déclaré M. Stirn, ministre chargé du Tourisme. » … « Plusieurs autres pays, dont l’Italie, le Canada, la Chine et le Koweit, vont participer au développement touristique de l’Algérie. »
|
|
1990 |
LIBAN / L’ambassade de France « mouillée » dans un trafic, LB 26/09/1990
Des responsables de l’ambassade de France à Beyrouth sont mis en cause dans le trafic d’armes entre le Liban et la France, a affirmé un témoin masqué sur la chaîne de télévision française TF 1 – Vingt-quatre personnes, dont treize policiers et deux gendarmes, sont déjà inculpées dans cette affaire.
|
|
1990 |
Les Algériens seront arabisés d’ici 1992, LB 28/12/1990
« La Ligue de la dawa (Appel) islamique, regroupant les différents courants intégristes, a dénoncé pour sa part, dans un communiqué de soutien aux députés, ce qu’elle a appelé « les partis revendiquant la prolongation de l’existence de la colonisation culturelle de l’Algérie. »
|
|
1990 |
Marie-France Cros, Attentat anti-français à Djibouti, LB 29/09/1990
« Il y a 10.700 Français à Djibouti, dont quelque 4000 militaires (…) stationnés en permanence sur le territoire depuis son indépendance. » « L’armée djiboutienne, (…,) ne compte que 2300 hommes. » Aincien Territoire français des Affars et Issas, le territoire de 23.000 km2 dont le centre est Djibouti est indépendant depuis 1977.
|
|
1991 |
M-F. Cros, Djibouti appelle la France à son secours, LB 25/11/1991
« Paris tient à sa base sur la Mer Rouge. » Il existe un accord militaire (sic) avec la France qui prévoit une intervention de cette dernière en cas d’agression extérieure contre Djibouti. Paris s’est dit prêt à assurer « pleinement sa mission d’arbitre. » 2 peuples: les Afars (aussi en Erythrée/Ethiopie) et les Issas (aussi en Somalie): clans qui ignorent pratiquement les frontières. Suivant l’opposition, il s’agirait d’opposants intérieures en révolte et non d’agresseurs extérieurs.
|
|
1991 |
Le Maghreb: une guerre injuste, LS 05/02/1991
« Algérie, Tunisie, Maroc: le Maghreb francophone (sic) se dresse derrière Saddam. »
|
|
1991 |
Diouri retrouve les siens à Neuilly, LB 17/07/1991
Il est rentré en France après 25 jours de réclusion dans un hôtel de Libreville. M. Diouri avait annoncé la prochaine publication d’un livre consacré à la fortune du roi Hassan II du Maroc.
|
|
1991 |
Robert Verdussen, Paris expulse un écrivain marocain, LB 22/06/1991
Il s’apprêtait à publier un livre sur la fortune du roi Hassan II. ! un réfugié politique, l’écrivain Abdelmoumem Diouri expulsé, en vertu de la « procédure d’urgence absolue sur décision du ministre français de l’Intérieur, Philippe Marchand. », vers le Gabon, pays ami du Maroc …
|
|
1994 |
Baudouin Loos, Algérie: Paris a choisi mais étudie les éventualités, LS, 21/12/1994
Les ultra-islamistes font face depuis deux mois à une offensive en règle des forces de sécurité qui, selon des sources militaires françaises citées par ‘Libération’ hier, recourent au napalm, au mitraillage par hélicoptères et à l’extermination de la population d’un village suspect, sans parler de la torture systématique. « Ces sources ont d’autant plus de crédibilité que les informations se font plus précises sur la collaboration entre autorités françaises et algériennes au niveau militaire. Ainsi, le général Mohamed Lamari effectuerait de fréquents séjours en France; Il s’agit du chef d’état-major de l’ armée algérienne. » Le 16 novembre, le consortium franco-allemand Eurocopter évoqua la cession de neuf appareils d’occasion et ‘non armés’. Selon ‘Le Monde’, la France livrait aussi des équipements de combat nocturne et de contre-guérilla, un marché qui aurait été interrompu au début décembre en raison des fuites dans la presse. Suivant l’ gence Reuter, des pilotes algériens d’ hélicoptères ont bénéficié d’ un entraînement au Luc, près de Toulon.
|
|
1994 |
Soudan / Marie-France Cros, La ‘French Connection’ des islamistes soudanais, LB, 09/11/1994
Pax Christi Nederland publie en effet un rapport sur la collaboration secrète entre la France et le gouvernement islamiste du Soudan, intitulé ‘The French Connection’. « Celle-ci fut lancée fin 1993 et apparaît comme uune sorte de pacte de non-agression: le Soudan cesse de soutenir les fondamentalistes musulmans dans les pays sous influence française, mais demeure libre de poursuivre cette politique dans les pays anglophones; dans le même temps, Khartoum facilite un contact des autorités françaises avec les fondamentalistes algériens du Front islamique du Salut (FIS), voire avec les Palestiniens du Hamas. En échange, Paris aide le gouvernement islamiste soudanais à sortir de son isolement international, notamment en empêchant son expulsion du Fonds monétaire international (FMI), et à obtenir du Zaïre et de la Centrafrique l’autorisation pour l’ armée de Khartoum de traverser leurs territoires afin de prendre à revers la guérilla sud-soudanaise (animiste et chrétienne). » « La France reçut, outre la livraison, l’ été dernier, du terroriste Carlos – au grand bénéfice politique de M. Pasqua – de fréquentes visites d’ officiers des services secrets soudanais. Ils purent se rendre dans des camps d’entraînement de commandos dans le Midi, ce qui déclencha une protestation américaine. »
|
|
1994 |
Zaïre / M.-F. Cros, La ‘French Connection’ des islamistes soudanais, LB, 09/11/1994
« Il se trouve que le général de réserve français Jeannou Lacaze est conseiller du président Mobutu pour les affaires de sécurité. »
|
|
1994 |
Algérie / Robert Verdussen, Les Berbères, ces oubliés, LB, 27/09/1994
« S’agissant de la seule Algérie, le colonisateur français sut jouer sur le particularisme berbère pour mieux régner. »
|
|
1995 |
Baudouin Loos, « Tentation soudanaise » et « French Connection », Quand les intérêts de Khartoum et de Paris coïncident …, in: LS, 21/01/1995
« L’implication française va très loin: les services secrets soudanais auraient été réorganisés par la DST, alors que l’armée, en guerre civile contre la rébellion noire au sud du pays, aurait reçu de l’état-major français des cartes provenant du satellite Spot (que des experts … irakiens auraient aidé à déchiffrer). La France a également usé de son influence dans son ‘pré-carré’ noir africain pour permettre aux forces soudanaises d’opérer à travers les territoires de la Centrafrique et du Zaïre pour prendre les rebelles à revers . Ce n’est pas tout! Sur le plan financier, Paris a empêché l’expulsion du Soudan du Fonds monétaire international (dont le comité exécutif avait voté le principe le 14 février, en raison d’arriérés d’intérêts pour 1,6 milliards de dollars vis-à-vis du FMI et d’une mauvaise coopération). Michel Caldessus, le président (français) du FMI, a donc réussi cet été à éviter l’exécution d’une mesure sans précédent au sein de l’ institution mondiale. » Ce régime détient une triste réputation en matière des droits de l’homme. Une grande idée au départ de ces manoeuvres: protéger et renforcer l’ influence de l’ Hexagone dans les pays ‘amis’ – Djibouti, Tchad, Centrafrique, Zaïre et, jusqu’ il y a peu, Rwanda – et contrer les visées des autres, notamment les Etats-Unis. « La France entretient aussi de sérieux espoirs de retombées économiques de son aide. L’entreprise Total ambitionne de remplacer Chevron comme interlocuteur privilégié des autorités locales pour l’exploration et l’exploitation des gisements pétroliers prometteurs, mais qui se situent dans ce sud actuellement peu sûr … Des réalisations d’infrastructures (chemins de fer et routes) pourraient également tomber dans l’escarcelle de la technologie française à l’ avenir, ainsi que de nouvelles commandes d’ Airbus. »
|
|
1995 |
Centrafrique / M.-F. Cros, La ‘French Connection’ des islamistes soudanais, LB, 09/11/1995
« Le colonel Jean-Claude Mantion, après 13 ans passés en Centrafrique où il était tout puissant, est rentré en France en 1993 pour s’occuper du Soudan. »
|
|
1995 |
Déclaration de guerre, in: LB, 01/01/1995
L’Armée islamique du Salut s’en prend directement à la France. Elle estime que « la guerre contre la France est devenue un devoir légal » (aux yeux de la Charia, la loi coranique)
|
|
1997 |
Joëlle Meskens, La France menait des essais chimiques au Sahara!, LS 23/10/1997
“Bien après 1962, date de l’indépendance de son ancienne colonie, l’Hexagone a poursuivi des essais chimiques dans le Sahara! Sous le nom de “B2-Namous”, l’armée française a maintenu une base ultra-secrète dans le désert jusqu’en 1978. Et quelle base: après les installations russes, il s’agissait du plus vaste centre d’expérimentation d’armes chimiques du monde: 100 km de long sur 60 de large! Paris a toujours nié avoir procédé où que ce soit à des essais en plein air …”
“Ces essais, menés dans le désert, étaient-ils pour autant sans danger pour la population algérienne?”
|
|
1998 |
Francis David, Dans un mois, le français sera hors-la-loi, LS 09/06/1998
M. Zerhouni, responsable de l’arabisation auprès du Premier Ministre: “Les journaux qui utilisent la langue du colonialisme destructeur sont à l’origine de tous les maux et malheurs qui secouent le pays … La presse francophone n’a rien à voir avec le peuple algérien et sa culture … Cette presse est en contradiction avec la Constitution du pays car elle est française dans la forme et dans le fond.”
|
|
2001 |
(Des terroristes bien français …) Branche Raphaëlle, Thénault Sylvie, La guerre d’Algérie, in : La documentation photographique, n° 8022, 2001
(p.56) AS : Organisation Armée Secrète. Ce sigle symbolise la folie meurtrière qui atteint l’Algérie dans les mois qui précèdent l’indépendance. Née au début de l’année 1961, l’OAS est d’emblée une réaction violente et clandestine au déroulement politique des événements d’Algérie. Elle est une structure complexe où se mêlent des Européens d’Algérie, parfois activistes de la première heure, des militaires nostalgiques d’une certaine grandeur impériale, des poujadistes, des monarchistes, etc. Les militaires y ont une place importante et leurs effectifs grandissent après l’échec du putsch d’avril 1961 et le passage des généraux Salan et Jouhaud dans la clandestinité. L’ancien commandant en chef en Algérie, Raoul Salan, est le chef de l’OAS, qualifié de « commandant supérieur » – ce qui explique l’équivalence, dans le slogan peint sur les murs d’Alger, entre l’OAS et Salan. L’OAS reçoit, dans un premier temps, le soutien de la majeure partie de la population européenne d’Algérie, particulièrement à l’automne l961. Mais son raidissement à la veille du cessez-le-feu lui aliène ce soutien, tandis qu’en métropole elle peine à trouver des relais. Le portrait d’une petite fille mutilée dans un attentat qui visait André Malraux fait le tour de la France et stigmatise durablement l’OAS. L’organisation terroriste a deux tactiques : les explosions au plastic, qui devient sa marque, et les assassinats individuels appelés « opérations ponctuelles » Ses commandos, appelés aussi Delta, sont les acteurs principaux de ces violences. Les plasticages ponctuent le quotidien des habitants des villes d’ Algérie pendant un peu plus d’ un an. L’OAS organise aussi des « nuits bleues », occasions d’ explosions répétées.
|
|
2001 |
Dehay C., Guerre d’Algérie / La torture était « légitime », VA 04/05/2001
La torture et les exécutions sommaires ont accompagné l’Algérie tout au long de son histoire coloniale. Témoignage d’un général tortionnaire. Le général français Paul Aussaresses : «Nous étions un escadron de la mort. » Mitterrand, alors ministre de la Justice, disposait d’un émissaire à Alger auprès du général Massu qu’informait son cabinet régulièrement et couvrait ces faits et gestes sordides. Ceux qui devaient être interrogés – jamais plus de six – étaient envoyés dans une villa près d’Alger et n’en sortaient jamais vivants. Les méthodes employées étaient toujours les mêmes : coups, électricité et eau. « Est-ce que ça m’a posé des problèmes de conscience ? Je dois dire que non », affirme sans le moindre remords le général tortionnaire, commandeur de la Légion d’honneur et décoré de la médaille de la Résistance.
|
|
2001 |
Paul Aussaresses, Services spéciaux, Algérie 1955-1957, Ed. Perrin, 2001
Le SDECE, devenu aujourd’hui DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), était chargé d’intervenir secrètement et hors du territoire national contre tout ce qui portait atteinte aux intérêts de la république française, éventuellement en commettant des actes de violence contre les biens et les personnes. (p.11)
(p.12) 1954 : François Mitterrand, le ministre de l’Intérieur chargé des départements français de l’Algérie
(p.28) « Ils /= les policiers/ me firent vitre comprendre que la meilleure façon de faire parler un terroriste qui refusait de dire ce qu’il savait était de le torturer. Ils s’exprimaient à mi-voix, mais sans honte, sur ces pratiques dont tout le monde, à Paris, savait qu’elles étaient utilisées et dont certains journaux commençaient à parler. » (…) J’avais entendu dire que des procédés semblables avaient déjà été utilisés en Indochine, mais de manière exceptionnelle (sic). »
(p.30) « Les policiers de Philippeville utilisaient donc la torrure, comme tous les policiers d’Algérie, et leur hiérarchie le savait. Ces policiers n’étaient ni des bourreaux ni des monstrers mais des hommes ordinaires. » (p.33) « Alors, sans état d’âme, les policiers me montrèrent (p.34) la technique des interrogatoires « poussés » ; d’abord les coups qui souvent, suffisaient, puis les autres moyens dont l’électricité, la fameuse « gégène », en fin l’eau. La troture à l’électricité se pratiquait à l’aide des générateurs de campagne utilisés pour alimenter les postes émetteurs-récepteurs. Ces appareils étaient très répandus. On appliquait des électrodes aux oreilles, ou aux testicules, des prisonniers. Ensuite, on envoyait le courant avec une intensité variable. Apparemment, c’était un procédé classique. »
(p.42) 1955 : Robert Schuman : Ministre de la Justice
(p.69) « A Constantine, le neveu de Ferhat Abbas, jugé francophile, avait été assassiné dans sa pharmacie. »
(p.71) « /Après une embuscade par les Français qui a fait nombre de morts parmi les combattants du FLN,/ j’ai fait creuser une fosse de cent mètres de long, deux mètres de large et u mètre de profondeur. Nous y avons enseveli les corps. Le lendemain, une femme des services d’hygiène de la préfecture est venue à mon bureau. Elle représentait les autorités d’Alger qui me faisaient envoyer de la chaux vive pour faire disparaître les cadavres. »
(p.72) « Brigitte Friang, une journaliste, par ailleurs ancienne des services spéciaux, (…). »
(p.96) « En Indochine, il /= le général Massu/ avait été amené à reprendre Hanoi, le 19 décembre 1946, avec une telle énergie qu’il avait été rappelé en métropole à la demande de Bao Daï. Il avait fait nettoyer la ville au mortier et, que je sache, il n’y avait pas eu de prisonniers. »
(p.118) « Nous opérions de fructueux échanges avec les policiers. En règle générale, il s’agissait de dénonciations, souvent destinées à assouvir des rancunes personnelles. »
(p.153) « … j’allais avoir douze hommes de plus à exécuter la nuit suivante. (…) Quand il a fallu tuer ces prisonniers, nous n’avons pas douté un instant que nous exécutions les ordres directs de Max Lejeune, du gouvernement de Guy Mollet et de la République française. »
(p.155) « Quant à l’utilisation de la torture, elle était tolérée, sinon recommandée. François Mitterrand, le ministre de la Justice, avait, de fait, un émissaire auprès de Massu en la personne du juge Jean Bérard qui nous couvrait et qui avait une exacte connaissance de ce qui se passait la nuit. » (p.153) « Il était rare que les prisonniers interrogés la nuit se trouvent encore vivants au petit matin. »
(p.155) « Les méthodes que j’ai employées étaient toujours les mêmes : coups, élecricité, eau. »
(p.177) « La mort de Boumendien /avocat pro-FLN/ eut un incroyable retentissement et fit couler beaucoup d’encre. On atteignit les sommets de l’hypocrisie, puisque le gouvernement, comme il est d’usage en des circonstances analogues, exigea à grand bruit toutes sortes d’enquêtes et de rapports. On en débattit jusque dans l’hémicycle de l’Assemblée. »
|
|
2001 |
Raphaëlle Branche, Sylvie Thénault, La guerre d’Algérie, in : La documentation photographique, n° 8022, 2001
(p.3-4) Mai 1945 : les révoltes de Sétif et de Guelman
/Des manifestations ont lieu dans de très nombreuses villes pour la libération de Messali Hadj, chef de file des indépendantistes, déporté à Brazzaville en avril 1944/ C’est dans ce contexte que des milliers de manifestants défilent à Sétif le 8 mai 1945. A l’appel du PPA, ils souhaitent faire la démonstration de leur attachement à la liberté, en ce jour d’armistice . « Vive la Charte de l’Atlantique », « Vivent les Nations unies », « Vive l’Algérie libre et indépendante » proclament en effet leurs pancartes et banderoles tandis qu’un jeune scout musulman porte pour la première fois un drapeau vert et blanc marqué d’une étoile et d’un croissant rouges. La police ayant reçu l’ordre de se saisir des banderoles, pancartes et de tout symbole nationaliste, le jeune porte-drapeau est tué et des affrontements éclatent. La nouvelle qui se répand suscite quatre jours de soulèvement dans la région, pendant lesquels sont attaqués les bâtiments publics, les centres de colonisation et les maisons des gardes forestiers, trois symboles forts de la colonisation. Le 8 mai, d’autres manifestations se produisent, notamment à Bône, mais c’est à Guelma que la répression est la plus dure, le sous-préfet Achiary ayant constitué une milice civile qui se livre à des centaines d’exécutions sommaires. L’armée et la police interviennent aussi pendant ces quelques jours : arrestations de militants nationalistes dont dix sont exécutés dans la cour de la prison civile de Guelma, ratissage de villages, bombardements aériens … Plus de 13 000 armes, dans leur immense majorité des fusils de chasse, sont saisies, des redditions et soumissions collectives exigées, d’ où l’image largement diffusée de ces files d’hommes bras levés, fusil à l’épaule. S’il est établi que les émeutes ont fait 102 morts dont 86 civils européens, 14 militaires français et 2 prisonniers de guerre italiens, le bilan de la répression reste inconnu : de 1 500 à 20 000 morts selon les sources, la fourchette est trop importante pour donner un autre ordre de grandeur que celui de milliers de victimes. Les tribunaux militaires ont jugé 3 630 prévenus, prononcé 1 868 peines d’emprisonnement diverses, 157 peines capitales dont 33 ont été suivies d’exécution. Des personnes arrêtées se sont plaintes d’avoir été torturées.
(p.40-41) La torture
DES les premières semaines de la guerre la torture est policière mais l’armée prend rapidement le relais, dans le bled comme en ville : c’est le cas pour Abdelaziz Boupacha, arrêté à Alger en février 1960. Ceux qui justifient la torture mettent en avant la recherche d’informations sur les troupes armées ou sur les réseaux de soutien aux nationalistes dans la population, appelés « organisation politico-administrative » ou « politico-militaire » En fait, comme le perçoit nettement le sous-lieutenant appelé en Kabylie, « il ne fallait pas grand chose pour être suspect ». Dans la lettre qu’il adresse, dans un français phonétique, à son avocate, Me Gisèle Halimi, Abdelaziz Boupacha décrit les différentes étapes de son arrestation et de sa détention. Convaincus d’avoir affaire à une famille de militants – la fille d’Abdelaziz, Djamila, est en particulier accusée d’avoir posé des bombes – , les militaires procèdent à leur arrestation dans la nuit, les malmènent d’ emblée et les emmènent immédiatement pour les torturer. Les expressions imagées de la lettre disent à quel point les tortionnaires atteignent profondément l’humanité de leurs victimes. Le gonflement du ventre par l’action de l’eau massivement injectée par un tuyau introduit de force dans la bouche ; le corps qui tressaute sous l’effet des électrodes déplacées sur sa peau humide ; les coups, enfin, marquent durablement cet homme qui, plus de trois mois après, souffre encore de séquelles physiques importantes. Ces trois types de torture sont les plus utilisés pendant la guerre d’Algérie, mais la lettre du sous-lieutenant témoigne que d’autres violences ont cours, en particulier la pendaison par les pieds et les poings. Accomplies par des militaires de carrière ou du contingent. les tortures sont parfois l’ occasion de défoulements accomplis dans l’ impunité que procure l’absolue puissance ; la peur de l’ennemi ou le racisme (« pas d’humanité pour les Arabes » répond son tortionnaire à Abdelaziz Boupacha) y trouvent un terrain d’expression propice. Mais la torture est aussi perpétrée, sans haine particulière, par des militaires persuadés d’accomplir leur mission : gagner la guerre. Ainsi, ce capitaine du 7e bataillon de chasseurs alpins semble sûr d’assumer sa responsabilité de chef et de remplir ses devoirs de chrétien en se chargeant lui-même des exécutions sommaires et en les accompagnant d’un signe de croix et du De profundis. Certains « suspects » en effet ne sortent vivants des cantonnements que pour être exécutés, victimes de ce qu’on a pris l’habitude de maquiller sous l’expression « corvée de bois »,
Les « suspects » arrêtés ne sont pas toujours torturés, mais ils sont parfois retenus prisonniers longtemps après avoir été arrêtés. La photographie représente une de ces « prisons » qui participent de l’humiliation des Algériens : les prisonniers y sont parqués dans des trous creusés à même la terre, recouverts de barbelés qui leur interdisent de relever la tête et de bénéficier de la moindre hygiène, exposés aux intempéries. Que les tortures soient interdites par toutes les lois, qu’elles foulent au pied le message civilisateur que la France est censée apporter en Algérie, qu’elles atteignent profondément l’humanité des individus qui la pratiquent, sans parler des effets sur ceux qui la subissent, perturbe certains militaires. Des chrétiens, à l’instar de ce séminariste, s’en ouvrent à leur confesseur ; d’autres en parlent à leurs proches. Mais la plupart se taisent, parfois encore aujourd’hui.
(p.41) De Boupacha Abdelzaiz à maître Gésel Halimi, in : Simone De Beauvoir, Gisèle Halimi, Djamila Boupacha, Paris, Gallimard, 1962 :
« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’effet suivant au sujet de notre arrestation dans la nuit du 10 au 11 février 1960 […] pendant la perquisition, [les gendarmes] ont trouvé une lettre quel ma été adresser par un voisin quil avait mal écri son nom et qui est actuellement au maquis, cette lettre elle datte depuit plus d’un an, que je l’ait reçu par la poste, […] alors il mon demander dout été venu cette lettre, comme moi je me souvien plus, j’ai répondu je ne sait pas, un geune sous lieutenant ma giflé devant mes petits enfants, qu’ils ont commencé à pleurer, [,..] aussitôt ont nous a emener, moi, ma fille et mon beau fils a el biar sans mot dire directement à la torture, dans la chambre a torture il y avait inviron 8 à 10, le nombre des tortionnaires, gendarmes et asurtés, mon demander si mes dents sont a moi, j’ai répondu non, enleve les parce que vont être cassé [..,] quant ont commencé à m’attacher, l’attacheurs a mis un pied de chaque coté sur mes épelles quil me les a fait craquet, je dit un peu d’humanité, une voix se lève un peu plus loin de mes pieds, me dit pas d’humanité pour les arabes, les yeux bander douche avec caoutchouc l’eau froide de la nuit du 10/2/1960. J’ai été frigorifier tuyaut dans la bouche, que la femme il est enceinte dans 9 mois, moi j’ ai été enceinte dans 9 secondes et non pas 9 minutes, aprè sé la séance de l’électricité qui commence, une espèce de tirboulette avec fil dans la prise du courant, je me suis considéré comme un poisson dans une poile sur le feu, au bout d’un demi heure environ, j’ai été presque à la mort, j’ai été évanué, j’ai été jeté, dans une cellul sans connaissance, le lendemain, j’ai été reveillés par la semelle d’un soulier sur ma figure, j’ai pas pu bougé de ma place sur le lendemain ils mon fait monté à l’interrogatoire [..,] alor moi je dit, le general de gaulle et contre les tortures et les sevices, si lui si ma repondu que le general de gaulle ne commende pas ici, chez nous ; ici si nous qui nous commendions [,..], Aprè les tortures j’ai été bien bouleversé et presque perdu la memoire par suite des chocs des coups de points sur la tête et a la figure tous des bosses jentant presque pas le bourdonnement et la cigal qui sifle nuit et jour dans mes oreilles sant compté les brelures de l’ectricité qui font foi sur mon corps actuellement, Escusé moi je ne sait pas bien écrire j’ai jamais été a l’école
Recevez mes meilleur salutation
Boupacha père de Djamila Beni-Messous, 28 mai 1960
(Le témoignage d’un soldat français, Letrred ‘un séminariste sous-lieutenant appelé au 7e BCA, à son conseiller spirituel, La Croix, 3-4 mars 2001 🙂 Lyon, 9 décembre 1956 : Mon père, […] j’étais chef de section sur un « piton » isolé, un poste dominé par des rochers, au bout d’une piste où les convois sautaient fréquemment. Pour obtenir des renseignements sur l’organisation politico-militaire du douar, le capitaine fit appel aux méthodes utilisées dans la compagnie où ses hommes avaient passé un mois « pour se mettre en condition », Les suspects (et il ne fallait pas grand chose pour être suspect !) passaient donc à la torture. Cela commençait dans le bureau du capitaine ; armé de gros gants, il commençait par « tabasser » le gars : coups de poing à la figure, au ventre, aux parties, coups de genou aussi, ou bien à la tête, cognée contre le mur dix ou douze fois de suite, ou encore coups de pistolet tirés au ras des oreilles. Comme en général le gars ne parlait pas, on l’emmenait dans une salle spéciale pour le passer à la « crapaudine » . le type attaché, pieds et poings liés derrière le dos, à une corde passant dans une poulie fixée au plafond. La position est déjà mauvaise, les muscles du ventre complètement distendus, les articulations écartelées, etc. Alors commençait la torture : on laissait le type tomber sur le sol de toute la longueur de la corde, on lui chargeait les reins de sacs de 50 ou 100 kilos de sable, on lui brûlait le ventre avec une flamme, on lui tapait avec un bâton sur la plante des pieds ou.,. ailleurs, On pratiquait aussi le « téléphone », c’est-à-dire des décharges de courant, avec la magnéto du téléphone de campagne, dont on branchait les deux fils sur diverses parties du corps… Après pareil traitement, le gars passait la nuit dehors, attaché à un poteau. Le matin, le capitaine sortait avec une patrouille et descendait le gars ; il le faisait toujours lui-même, « pour ne pas donner cette responsabilité à ces hommes », après avoir, d’ailleurs, fait un signe de croix et récité le De Profundis.
|
|
2001 |
Sahara occidental / Le Front Polisario dénonce le rôle perfide de la France, LB 27/06/2001
Mohamed Abdelaziz, le chef du Front Polisario, qui revendique l’indépendance du Sahara occidental a déclaré que « la France a joué un rôle perfide et a été déterminante dans le dévoiement du processus de l’ONU qui prévoyait un référendum. Elle a influencé la quasi totalité du rapport. » Rappelons que l’accord-cadre proposé par l’ONU veut doter le Sahara occidental d’une large autonomie au sein du Maroc.
|
|
2001 |
Y.B., Comment Ben Barka fut enlevé, tué et dissous dans l’acide, La Province, 03/07/2001
On sait désormais par qui et comment Ben Barka, le fameux opposant marocain, a été enlevé, assassiné et dissous dans l’acide. Le scénario a été révélé conjointement par Le Monde et Le Journal, un hebdomadaire marocain, qui ont recueilli les confidences d’Ahmed Booukhari, un ancien espion marocain. Le 29 octobre 1965, au cœur de Paris, deux policiers français, de m èche avec les services secrets marocains, arrêtent Mehdi Ben Barka, figure charismatique de la gauche maghrébine, et par railleurs catalysateur de l’opposition au pouvoir autocratique dans de nombreux pays du Tiers Monde. Ben Barka est dirigé vers une maison de Fontenay-le-Vicomte, où l’attendent quatre agents secrets marocains. Torturé, suspendu à une corde, les mains liées dans le dos, Ben Barka est interrogé par le commandant Dlimi, le bras droit du ministre marocain de l’Intérieur. Le tortionnaire a beau lui entailler le buste avec un stylet, Ben Barka ne pipe pas mot. Dlimi applique alors un chiffon imbibé d’eau sale sur le nez et la bouche de Ben barka. Peu après, il expire. On va rapatrier discrètement le cadavre à Rabat, où il sera dissous dans de l’acide.
|
|
2001 |
Al-Ahram Weekly On-line
Ahmed Ben Bella: Plus ça change For the first president of independent Algeria the freedoms worth fighting for then are still worth fighting for now Profile by Gamal Nkrumah
In the 1950s Ahmed Ben Bella — a zeitgeist warrior of at least seven decades’ standing — was instrumental in placing Algeria in the vanguard of Third World Revolution. It was almost inevitable that he should then become something of an icon, and he still is revered by many in the Arab world, Africa and beyond. « Everything has changed and nothing has changed. » His broad brow furrows. « Fifty million people die of starvation annually. One quarter of the world’s population suffers from curable tropical diseases. Three quarters of the world’s population owe $4,000 billion in debt and cannot possibly pay interest let alone pay the debt back. We struggle against imperialism, against the men who are the symbols of this barbaric system. We must continue to fight, » he explained in the airport lounge as we waited to board a plane to take us to the seaside desert town of Sirte, Libya, to witness the signing of the Constitutive Act of African Union, better known as the « Sirte Declaration, » by African heads of state. Ben Bella sees the quest for African unity as a step towards the elimination of hunger, poverty and the continent’s indebtedness. « This is what is unfair and so wrong about the present situation — the new world order, » he says, punching his palm. « But the tide is turning. Witness the anti-globalisation movement worldwide, the demonstrators who ruined the World Trade Organisation summit in Seattle and disrupted the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, the World Bank and International Monetary Fund meeting in Prague and elsewhere. Something’s afoot. These are changing times. » Ben Bella, now based in Switzerland, was born in 1916 in the small town of Maghnia, perched high in the rugged mountains in the far west of Algeria, a stone’s throw away from the Moroccan border. He half jokingly ascribes his longevity and good health to the crisp and clean mountain air of his adolescence and youth. He speaks fondly of dramatically steep mountain backdrops and snow-capped peaks blanketed in fog and clouds. His roots, he proudly acknowledges, are with the shepherd and peasant stock of the wild mountains of western Algeria. He recalls, and with obvious nostalgia, the rugged beauty of the remote mountain region of his youth. The people of western Algeria are noted for their zestful passion for life — they are called, half pejoratively, half admiringly, « hot-blooded » by other Algerians. The region is the home of the much celebrated and sensual rai music, now popular around the world. After what sounds like an idyllic early childhood the adolescent Ben Bella quickly came face to face with the brutal realities of French settler colonialism. He was raised in a religious environment. His father was the sheikh of a Sufi order and at a tender age he was introduced to the teachings of Sufi Islam. Indigenous Algerians held tenaciously to their religion, a receptacle of their cultural heritage in face of the vicious French cultural onslaught. Inexorably he was drifting away from his family and the traditional setting of rural Algeria towards direct political involvement and ultimately, the armed struggle. « I entered politics at 15, » he says. « And, I was thrown in at the deep end. » Institutionalised racism and colonial oppression remain at the core of his memories of those early years. Now an octogenarian, Ben Bella continues to loom large, a figure of great influence on a new generation of North Africans determined to introduce a more just economic order. Ben Bella is leader of the Movement for Democracy in Algeria (MDA) and heads a number of non-governmental organisations, including the Democratic Revolutionary Arab Dialogue Forum, a leftist pan-Arab group. His active membership of several regional and international NGOs evinces a continued passion for change. Politically it remains difficult to pigeon-hole Ben Bella. « I am Muslim first, Arab second and then Algerian. I am also proud to be an African. » He is also an internationalist, these days showing up frequently at anti-globalisation gatherings, travelling most recently from his lakeside home in Lausanne to Porto Allegre, Brazil, to participate in the alternative WEF. « The progressive forces in Africa, in the Arab world and in the South must link up and work closely with like-minded people in Europe, in the West, » he says. If the ideology and emotion that underpin his remarks recall a bygone era there remains a freshness and innocence that has withstood the travails of a lifetime of struggle. Ben Bella is not averse to playing the savant to a younger audience. None of his contemporaries are around. His eye dart quickly, scanning the opulent Ougadougou Halls, Sirte, where the OAU summit was held. He scanned the premises to pick out old acquaintances, friends, comrades in arms. A hug here, a wave there. He throws a kiss here, a smile there. His face breaks into a seemingly spontaneous, sunny smile. He is a politician at heart. Twenty years of imprisonment only served to strengthen his political resolve. Prison helped Ben Bella concentrate his mind and compelled him to become a whirlwind of activity in the struggle against injustice. Ben Bella participated in the Algerian opposition parties, including the Islamic Front for Salvation (FIS), meeting at the Community of Sant’Egidio in Rome in January, 1992, but he shies away from making public statements about his beloved Algeria. He is far more vocal on issues of African, Arab and international concern, and is highly critical of the United States in the post-Cold War era, particularly the manner in which it « has made a war council of the UN Security Council. » He denounces UN sanctions as a declaration of war on the defenceless civilians of Cuba, Iraq and Libya. « Sanctions must be outlawed and eliminated just like small pox and polio. The US controls the UN. Five countries have the right to vote against the rest. Is this democracy? » The international dimensions of Ben Bella’s political struggle were recognised first in Egypt. He was one of the nine members of the revolutionary committee first convened in March 1954 in Cairo under the auspices of the late President Gamal Abdel-Nasser that evolved into the National Liberation Front, better known by its French acronym FLN. Few other acronyms of liberation movements became as universally recognisable in the 1950s as the FLN, and Ben Bella came to symbolise the movement. He remembers the headquarters of North African liberation movements on Abdel-Khaleq Tharwat street in downtown Cairo, a city that was, for a time, the hub of revolutionary and anti-colonial activity. « In those days I was the target of many assassination attempts. I never stayed long in one place. I was always on the move. It was a hectic time but I loved Cairo all the same and it was there that I polished my Arabic. » The first time Nasser introduced Ben Bella to an Egyptian audience, the Algerian leader could not hold back his tears as he took to the podium. He could not speak Arabic and apologised profusely. Subsequently he refused to teach his eldest daughter, Mahdiya, French, and she only learned the language when studying in Europe. He is proud that his daughters speak Arabic fluently. Yet to this day, and notwithstanding the fact that he is fluent in Arabic, Ben Bella remains more at home in French, the language of the nation that had historically covetted Algeria. It began on 4 July 1830, when a French occupation army led by Louis Auguste Victor de Boumont captured the fortress of Algiers, the centre of a scavenging pirate principality nominally under Ottoman Turkish suzerainty, and then proceeded to conquer the city’s hinterland. The ruler was deposed on the pretext that his pirate warships constituted an unacceptable menace in the Mediterranean. French settlers followed the French Army, plundering the countryside and grabbing the most fertile land. They had soon colonised the coastal strip and later moved into the mountainous hinterland and the Sahara Desert. Algeria’s indigenous population was decimated in the early years of French settler colonial rule, falling from over four million in 1830 to less than 2.5 million by 1890. Systematic genocide was coupled with the brutal suppression of Algerian cultural identity. Indigenous Algerians were French subjects, but could only become French citizens if they renounced Islam and Arab culture. A ruthless policy of acculturation followed, and the remaining Algerians were forced to cease speaking their native Arabic and use the French of their colonial masters instead. The indigenous Muslim population of Algeria was not permitted to hold political meetings or bear arms. They were subjected to strict pass laws that required indigenous Muslim Algerians to seek permission from the colonial authorities to leave their hometowns or villages. Ironically, Ben Bella served in the French Army during World War II and was decorated for bravery. « The Algerian people have lived with blood. We brought De Gaulle to his knees. We struggled against French rule for 15 years under the leadership of Emir Abdel-Kader Al-Jazairi. The Algerian population was then four million. French repression cost us two million lives. It was genocide. We survived as a people. Barbaric French atrocities did not subdue our fighting spirit. » The French dispatched 400,000 troops to pacify the anti-colonial uprising. But the revolt soon turned into a fully-fledged war of liberation in which Ben Bella played a decisive role. In 1956 he was arrested by the French aboard a Moroccan airplane en route to Casablanca and charged with procuring arms for the FLN. Ben Bella spent the next five years in French jails. When, following a referendum held in Algeria on 1 July 1962 France declared Algeria independent, an estimated one million French settlers fled the country and Ben Bella became Algeria’s first prime minister. A year later, in 1963, he was elected president. As Ben Bella stepped out of the aircraft that brought him to Sirte, birthplace of Libyan leader Muamar Gaddhafi, he paused and gazed at the desolate landscape. He had not set eyes on it for over five decades. Back then he was a gun-runner, not any procurer of arms but a freedom fighter who smuggled arms to those fighting against French settler colonialism in Algeria. Now, though, he was in Sirte to participate in the extraordinary summit of the Organisation of African Unity during which the idea of African Union was officially launched. Ben Bella reminisced about other OAU summits he had attended, remembering those of his peers — Ghana’s Kwame Nkrumah, Guinea’s Ahmed Sekou Toure, Congo’s Patrice Lumumba and, above all, Egypt’s Gamal Abdel-Nasser — to whom he owed most. « The first Suez Canal proceeds after nationalisation were presented to us, the FLN leaders, by Gamal Abdel-Nasser. How can I not be a Nasserist? » Ben Bella places himself firmly in the Nasserist tradition, holding Nasser in the greatest esteem. However, his unconventional views on what constitutes Nasserism often confound critics and sympathisers alike. « The essence of Nasserism is to struggle against imperialism and for social justice. I fear that some of those who claim to be Nasserists today might inadvertently mummify Nasserism the way the communists mummified Lenin. We must not speak as if it was still 1956. I believe that the Hizbullah in Lebanon have incorporated many aspects of the Nasserist philosophy. Times have changed. » Ben Bella makes a compelling case for keeping the vision of the OAU’s founding fathers alive. Asked if national interest can indeed give way to common continental interest, he is unequivocal: « We have no alternative to continental unity. This is why I am here today, to lend this venture my support. I am all for Maghrebi unity, but only on condition that it forms part of a wider Arab unity. I support African unity, and I am acutely aware of the strategic importance of African-Arab solidarity. » Nowadays, with the advent of a new millennium, Ben Bella rubs shoulders with a different set of post-independence African and Arab heads of state, many half his age, some not even born when he was overthrown in a palace coup in 1965 engineered by his Defence Minister Houari Boumedienne. Yet contrary to what was commonly predicted after his ouster from power, following which he spent 15 years in prison, Ben Bella is not a spent force. He remains an unabashed idealist and, as he grows older, hangs ever more tenaciously to his ideals. At conferences and international symposiums Ben Bella speaks easily and often without notes. He pauses occasionally, emphasising concepts, lending weight to phrases. He is passionate about what he believes and articulates his vision with vigour. He moves and inspires his audience. On recent events in Algeria Ben Bella takes a clear stand: « I am against military interference in politics. Military intervention in the political arena is a grave threat to democracy. » Ben Bella’s own removal by the military ushered in a new chapter in Algeria’s history, one in which the military dominated the political arena. His successors, he laments, ran regimes notable only for their corruption and incompetence. « For the first time I took in what it meant to have failed my people’s expectations. We who had liberated Algeria from French colonialism let our people down. The masses were betrayed. » Che Guevara’s murder, Lumumba’s assassination and the abrupt end of the progressive regimes of Africa and Asia — Nkrumah’s Ghana, Nasser’s Egypt and Sukarno’s Indonesia, all occurred when he was in solitary confinement. « Che was a courageous fighter who had to struggle unremittingly with a body wracked by asthma. Once, when I climbed with him to the Chrea Heights overlooking the town of Blida, I saw him suffer an attack that turned him green in the face. I first met him in autumn 1962 on the eve of the Cuban missile crisis and the blockade decreed by the US. I was due to attend the September session of the UN in New York at the first Algerian flag-raising ceremony. » If politics was Ben Bella’s first love, it was a love difficult to purge. « For long I refused to get married, thinking that I had married the liberation struggle. My mother visited me in prison and pleaded with me to get married before she died. I laughed and said, ‘How can I get married while I am in jail?’. She was brokenhearted and died four months later. » Yet it was, ironically, in the stultifying prison that he met and married the woman who has played no small part in his political comeback. His wife, Zahra, he says, « is my kindred spirit, my soul mate. I cannot stay away from her for over a week. » Zahra visited him in prison and they were married after three visits. She came to live with him in prison, leaving every couple of months to visit her family and then returning. Their daughter, Mahdiya, spent the first seven years of her life in jail. « She grew up surrounded by 600 prison guards and wardens. They watched our every move. » A Trotskyite Marxist and one of his staunchest critics when he was in power, Zahra is today a devout Muslim. She was associated with the Socialist Forces Front (FFS), created in 1963 to oppose Ben Bella’s one-party rule. Back then, as an ultra-leftist journalist, she was immediately struck by his strength of character and personality. After three visits he proposed and she accepted. Before Zahra prison was a desolate, forbidding and at times terribly frustrating place. For Ben Bella is not an arm-chair intellectual but a revolutionary at heart who even in his 80s hates to sit around « doing nothing. » Following his release from prison Ben Bella was placed under house arrest until 1980 when he eventually left Algeria for exile only to return, albeit briefly, in 1990. In prison the Qur’an was the only book permitted, something, Ben Bella says, that led to him becoming « a stronger and more spiritual man » during his incarceration. And if, over the years Ben Bella has held tenaciously to his leftist, progressive ideals, in later years an infusion of Islam — what he terms the spiritual element sadly lacking in doctrinaire Marxism — has seeped into his own brand of socialism. « I am an Islamist. And I am an Islamist Pan-Arabist before I am an Algerian. The West tried hard and long to obliterate our Arab and Islamic culture. We Algerians are only too aware of this historical fact. That is why being a Muslim is an essential, a sacrosanct component of our identity. » He does not, though, espouse the militant Islamism of some of his compatriots. « I condemn violence because it does harm only to Algeria and Algerians, » the former guerrilla fighter is keen to make clear. « We were fighting against French colonial rule. We took up arms to liberate our country, not to settle old scores. Yet we imported Western culture piecemeal, and still do. » Islamist militancy, he believes, is the inevitable backlash. Economic woes and social discontent were, he insists, the spark that ignited the violence in Algeria. « Yet at the height of the tensions the Islamists were responsible for just 20 per cent of the violence in Algeria. State security forces committed 80 per cent of the atrocities, » he believes. « Islamist militancy is a result of a faulty interpretation of Islam and perhaps governments are to blame for not enlightening the youth about the true spiritual dimensions of Islam. » Be that as it may, Ben Bella also sees a hidden foreign hand in the current crisis. « France pours oil on Algeria’s flames. »
|
|
2001 |
Le général Aussaresses, « d’office en retraite », AL 07/06/2001
Le général Paul Aussaresses, qu a reconnu avoir pratiqué la torture durant la guerre d’Algérie, a été mis à la retraite par mesure disciplinaire par le Conseil des Ministres. La mise à la retraite d’office est en fait la seule sanction dont disposait le ministre de la Défense à l’encontre du général.
|
|
2001 |
G. Dy., Le témoin Boukhari fait faux bond au juge, LB 20/07/2001
Avec la complicité des autorités françaises, on aurait transporté le corps de Ben Barka, assassiné, à Rabat, pour y être immergé dans une cuve d’acide au centre de torture Dar-el-Mokri.
|
|
2001 |
Dehay C., Guerre d’Algérie / Le cynisme du tortionnaire, VA 04/05/2001
Le général français Paul Aussaresses, coordinateur des services de renseignements militaires à Alger, affirme que le pouvoir politique couvrait ses exécutions sommaires, mettant en cause les socialistes, François Mitterrand en particulier. Et il justifie aussi la « légitimité » de la torture : « C’est efficace (…), la majorité des gens craquent et parlent. »
|
|
2002 |
Bernard Delattre, Le pavillon français est enfin de retour à Alger, LB 22/01/2002
Alger avait vivement protesté après que Paris eut jugé « profondément légitime » l’aspiration à la démocratie des jeunes manifestants kabyles.
|
|
2002 |
Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, Gallimard, 2002
(p.24) Les habitants de confession juive devinrent magnanimement et autoritairement citoyens français de plein droit en 1870, tandis que les autres se voyaient assigner une identité religieuse musulmane incompatible avec un tel statut. Les arrivées régulières de colons et la naturalisation massive des Européens à la fin du XIXe siècle installèrent les deux pôles de la vie algérienne, dans laquelle la majorité de la population se trouvait reléguée dans une situation de mineure politique et d’exclue économique et sociale. Que des passerelles existassent entre ces deux pôles, que la complexité caractérisât aussi les liens entre eux, ne les empêchait pas de se durcir en cas d’affrontements. Ceux qui se trouvaient au milieu étaient alors sommés de s’aligner ou balayés. La peur latente devenait violence ouverte, le grondement ou la rumeur, revendication.
(p.41) Le 5 juillet 1830, quelques troupes françaises débarquent à Alger : l’acte de naissance de l’Algérie française n’est encore qu’une opération indécise, soumise aux aléas politiques français. La monarchie de Juillet, plus embarrassée qu’enthousiasmée par cet héritage, tarde à se lancer dans la conquête de cette régence, province de l’Empire ottoman1. Les premières opérations militaires françaises sont pourtant d’emblée marquées par une violence extrême. Les rapports faits au roi à ce sujet en 1833 sont sans ambiguïtés : « Nous avons envoyé au supplice, sur un simple soupçon et sans procès, des gens dont la culpabilité est toujours restée plus que douteuse […]. Nous avons massacré des gens porteurs de sauf- conduits, égorgé sur un soupçon des populations entières qui se sont ensuite trouvées innocentes ; nous avons mis en jugement des hommes réputés saints dans le pays, des hommes vénérés parce qu’ils avaient assez de courage pour venir s’exposer à nos fureurs, afin d’intercéder en faveur de leurs malheureux compatriotes. (p.42) Les tactiques de la terre brûlée et de la razzia sont appliquées systématiquement. Ce qui est présenté comme une adaptation et une reprise des méthodes de l’adversaire fait basculer la guerre dans une guerre totale. « Voilà comme il faut faire la guerre aux Arabes », explique un officier français à un ami6 : (p.43) «Tuer tous les hommes jusqu’à l’âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampe pas à nos pieds comme des chiens. » La liberté du propos tient à son caractère privé ; il n’en est pas moins révélateur des violences qu’ont pu subir les populations algériennes, qui atteignent un sommet en 1845 avec la mort de plus de cinq cents personnes enfumées dans des grottes où elles s’étaient réfugiées7. Massacres, incendies mais aussi emmurements sont le lot de cette guerre sans lois, gagnée globalement par la France à la fin de l’année 1847. (…) Alors que la République triomphe en France, elle ne s’attache qu’imparfaitement à s’imposer en Algérie. Les Juifs d’Algérie sont définis comme citoyens français depuis le décret Crémieux du 24 octobre 1870 alors que les Algériens musulmans demeurent exclus de la citoyenneté9. Ainsi, la conservation de leur statut personnel confessionnel ne les soumet pas au code civil, auquel obéissent, (p.44) en revanche, les citoyens français. Contrairement à ce qui prévaut sur le territoire métropolitain, la nationalité française ne s’accompagne pas, pour la plus grande partie des habitants d’Algérie, de la citoyenneté10. Les Algériens et les Français sont donc différents aux yeux du droit, produit tout autant que fondement de la « mission civilisatrice » de la France en Algérie. La torture trouve son chemin au milieu de ces distinctions multiples qui rassurent le citoyen français sur son identité de civilisé et le mettent à distance des « indigènes ». Le racisme autorise sans aucun doute plus aisément la violence à l’encontre des Algériens : « La majorité des citoyens français pensent qu’il n’y a rien que de très normal à frapper un Nord-Africain », constate encore Casamayor en 1961″.
(p.45) « L’homme revient d’autant plus vite à l’état bestial que son vernis de civilisation est plus mince », explique ainsi doctement une brochure médicale sur les mutilations criminelles en Algérie, diffusée si largement au début de 1957 qu’on peut la considérer comme un véritable instrument de propagande du gouvernement général. « Les faits historiques, les mœurs et le facteur religieux, ont contribué à donner à l’indigène musulman algérien un comportement tout à fait spécial, marqué par la dureté et le fatalisme, le mépris de la vie humaine et de la propriété, la servilité et l’orgueil, le sens particulier de l’honneur, la fabulation et le mensonge, et le respect sacré de l’hospitalité. On comprend ainsi l’impossibilité dans laquelle il se trouve parfois de discerner le bien du mal dans certaines de ses actions13. » La violence exercée par les Algériens entre eux, notamment, fonctionne comme un miroir justifiant les violences contre eux. C’est pourquoi, répond par exemple le colonel Argoud au général Pâris de Bollardière, elles « ne creuseront en aucune manière le fossé entre les deux communautés14».
(p.46) Torture et colonisation Les méthodes employées par les autorités françaises en Algérie à partir de 1954 ont une double origine : le rapport colonial propre à l’Algérie et son histoire, d’une part, la répression des « troubles » nationalistes dans les autres territoires de l’Empire, de l’autre. Des témoignages arrivent d’Indochine dès les années 1930 ; dans ces confins extrême-orientaux des possessions françaises, l’électricité est déjà testée sur le corps des suspects. La torture est pratiquée ensuite pendant la guerre, venant s’ajouter aux multiples violences illégales qui caractérisent la guerre d’Indochine, comme l’expose particulièrement crûment le journal du caporal Philippe de Pirey publié en 195315. À Madagascar, les abus des colons sont aussi une tradition ancienne. Le travail forcé continue même après son abrogation dans l’ensemble de l’Union française en 1946. La Sûreté, qui a reçu le renfort d’inspecteurs de police venus du Constantinois, est très favorable aux colons et soutient leurs revendications d’accroître la fermeté face aux nationalistes16. Elle organise la répression à la suite du soulèvement de la grande île le 29 mars 1947 et recourt massivement à la torture, comme le prouvent de nombreux rapports officiels17. Ce sont aussi des policiers qui perpètrent des sévices au Maghreb : ainsi en Tunisie en 1951 ou au Maroc. Après l’exil forcé du sultan (p.47) Mohammed V, le protectorat connaît la rétention massive de « suspects » dans des camps d’internement. Les policiers se rendent coupables de tortures sur des militants syndicalistes ou nationalistes, que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) déplore encore en 195518. (p.48) Quelques années plus tard, c’est au tour des Britanniques de rencontrer des difficultés et d’y répondre violemment. Après s’être déchargés habilement de leurs possessions indiennes, ils sont interpellés dans une tout autre partie de leur empire : le Kenya. En effet, l’hostilité des colons aux revendications d’une partie des Kikuyus a fait basculer les Mau-Mau dans la résistance armée. Le gouvernement, refusant d’y lire un mouvement politique, tente d’isoler des meneurs supposés avant d’organiser de vastes opérations de police dans la Rift Valley, à la suite de quoi il décrète l’état d’urgence en octobre 195222. Face à cette révolte devenue guérilla, la puissance coloniale use d’un arsenal législatif et répressif très semblable à celui qu’emploieront les Français en Algérie à partir de 1955 : représailles collectives, déplacement de populations, centres de détention provisoire, zones interdites. Les policiers torturent massivement, comme le constate la députée travailliste Barbara Castle en 1955 : « Au cœur de l’Empire britannique, rapporte-t-elle après son enquête, il y a un État policier où le règne de la loi a été brisé, où les meurtres et les tortures d’Africains par des Européens ne sont pas punis et où les autorités jurent de (p.49) faire respecter la justice normalement et ferment les yeux sur sa violation23. » L’armée aussi est accusée de brutalités et le général Erskine, arrivé au Kenya en lin 1953, s’attache à faire condamner certains des errements les plus graves24. Les tortures et exécutions sommaires sont dès lors, semble-t-il, l’apanage exclusif des forces locales25. Cependant, si la révolte armée est vaincue à la fin de 1955, l’état d’urgence est levé qu’en 1960. Les Kenyans obtiennent le droit à l’autonomie en 1961 puis l’indépendance en 1963.
(p.52) /le 1er novembre 1954/ « Tous les services de police, gendarmerie, PJ et PRG, utilisèrent plus ou moins, au cours de leurs interrogatoires, les coups, la baignoire, le tuyau d’eau et l’électricité ; mais d’une façon générale c’est le tuyau d’eau qui, par la généralité de son emploi, paraît avoir les préférences. » L’auteur présente ces pratiques comme un moindre mal et, proposant de « lever le voile d’hypocrisie » dont on les recouvre, il suggère d’en réglementer l’usage et de le réserver à la PJ : (…). (p.53) Dans des rapports beaucoup plus critiques, le directeur général de la Sûreté nationale, Jean Mairey, dénonce vivement ces méthodes et leurs justifications. En effet, si les propositions de l’inspecteur général Wuillaume n’avaient pas été officiellement
(p.58) C’est plus exactement dans la région comprise entre Collo, Philippeville, Constantine et Guelma qu’éclate l’insurrection du 20 août 1955 marquée par le soulèvement coordonné de milliers de paysans et surtout par une répression féroce souvent estimée à douze mille victimes10. De nombreux témoignages attestent de la violence des troupes chargées de la répression : Max Lejeune lui-même, secrétaire d’État aux Forces armées, reconnaît qu’il n’est pas faux de la qualifier d’« aveugle11 ».
(p.72) Le général Cherrière commandant la 10e Région militaire, c’est-à-dire l’Algérie, l’avait établi dans un télégramme, le 13 mai 1955. Dès le 21, le général Par- lange le mit en vigueur dans les Aurès-Nementcha : tout sabotage ou attentat a pour conséquence la responsabilité du douar le plus proche. Un an plus tard, après une embuscade meurtrière près de Palestro, le principe est appliqué avec une rigueur extrême puisque des mechtas sont incendiées et cinquante Kabyles du douar le plus proche passés par les armes42.
(p.76) Une simple réputation aboutit à la mort. La fama sur laquelle s’appuyaient les Inquisiteurs pour étayer leurs accusations et, finalement, leurs condamnations, n’est pas loin.
(p.86) Le capitaine Pierre-Alban Thomas a découvert la torture en Indochine : « Le premier interrogatoire que j’ai vu en Indochine, eh bien, la nuit, j’ai très mal dormi ! Et puis après on s’habitue, on s’habitue, on s’habitue… » Il évoque les conditions dans lesquelles cette habitude s’installe : « Quand on en parle avec du recul, évidemment, on est assez horrifié. Au même titre que quelqu’un qui, comme vous, suppose ce que ça pouvait être ou qui découvre. Mais quand on est dans le bain, on n’a pas la même mentalité. Quand on a une arme, qu’on a fait des opérations, qu’on est fatigué, qu’on a tiré sur des hommes, qu’on s’est fait tirer dessus, que… qu’il y a l’odeur de la poudre, qu’on a… on n’a pas (p.87) la même mentalité… on n’est plus des êtres humains tels qu’on peut les considérer parlant tranquillement dans un fauteuil. »
(p.107) Les militaires réclament, dès le début de la guerre d’Algérie, une justice plus rapide et plus sévère qui mette hors d état de nuire les ennemis de la France et empêche les individus arrêtés par les troupes françaises de leur faire de nouveau face quelques mois après. Frustrés dans leurs attentes, certains n’hésitent pas à pratiquer une justice expéditive. Comme l’explique clairement un inspecteur général de l’administration en 1956, « le souci des autorités militaires de ne point revoir dans le secteur où elles l’ont arrêté un suspect qui sera relâché quelques jours après par la police ou le juge d’instruction, faute de preuves suffisantes, mais sur lequel pèsent de sérieuses présomptions [les conduit] au procédé radical et définitif, mais intolérable, qui consiste à supprimer purement et simplement le suspect10 ». La « corvée de bois » devient rapidement synonyme pour (p.108) les soldats français d’un départ pour une exécution sommaire. Les récits des soldats y font très souvent référence. Un séminariste, rappelé dans un régiment de tirailleurs algériens, écrit ainsi à un de ses amis : « Les “corvées de bois” ont reparu. Je ne le sais que pour être tombé sur les gars partant, le soir, pelle sur l’épaule et pistolet-mitrailleur sur l’autre. S’il s’agissait de vrais coupables, ils devraient être exécutés au su de tout le monde ». ». La « corvée de bois » est l’occasion d’appliquer les ordres sur les fuyards abattus : sitôt emmené en corvée, le prisonnier peut devenir un fuyard et il est alors légitime de le tuer. Chargé du rapport sur la mort d’un « chef rebelle », exécuté sommairement, un soldat explique : « J’inscrirai qu’au cours d’une corvée d’eau, le prisonnier suspect a essayé de s’enfuir, et que, malgré les sommations d’usage, il ne s’est pas arrêté. Nous avons été contraints de tirer12. » Les rédacteurs des JMO ont la même démarche : des mentions telles que « au cours d’une corvée, un suspect détenu tente de s’enfuir et est abattu » peuvent cacher des exécutions sommaires, surtout quand elles sont fréquentes ou accompagnées d’autres morts suspectes. Outre les corvées, les sorties accompagnées d’un prisonnier servant de guide peuvent être des occasions de « tentatives d’évasion ». Ainsi, alors qu’il est censé indiquer à un détachement l’emplacement d’une cache d’armes, un « rebelle fait prisonnier les armes à la main », plus d’un mois avant, « tente de s’enfuir dans les broussailles. Ne s’arrêtant pas malgré les sommations réglementaires, il est abattu d’une rafale de mitraillette par l’un des hommes du détachement »13. Cette pratique inquiète le commandant du corps d’armée de Constantine, le général (p.109) Olié. Après avoir constaté qu’un agent avait été tué « alors qu’il servait de guide dans une opération montée sur renseignements qu’il venait de donner », il va jusqu’à recommander de ne plus utiliser des indicateurs comme guides opérationnels14.
(p.120) Puisque les « événements » d’Algérie ne sont pas reconnus comme une guerre, il n’est pas question d’appliquer les lois de la guerre telles qu elles ont été acceptées par la France en 1951, lors de son adhésion aux conventions de Genève. Les responsables des opérations en Algérie doivent fixer eux-mêmes les règles à observer et la légalité propre à ce conflit. La tâche est difficile « du fait qu’il ne s’agit pas de guerre mais de pacification », comme le déplore Robert Lacoste en février 19563.
(p.175) Dans les salles de torture Les lieux et les victimes Avec la nouvelle réglementation de l’assignation à résidence, le temps de l’arbitraire est ramené à vingt- quatre heures mais il ne disparaît pas pour autant. Des centres clandestins continuent à fonctionner et, dans les centres devenus officiels, les assignés sont toujours exposés à la torture. Les aménagements du printemps 1957 jouent sur les marges, mais n’entament pas le cœur du dispositif répressif : les interrogatoires. En effet, le nouveau gouvernement de Maurice Bourgès-Maunoury choisit de renouveler sa confiance à Robert Lacoste et au général Massu. Le 15 juin, l’IGAME d’Alger demande aux responsables du maintien de l’ordre « d’accentuer leur action policière », confirmant les pouvoirs du général Massu. L’unité du commandement est concentrée dans les (p.176) mains de celui-ci, qui peut actionner directement « toutes les polices, sans exception, tous les organismes chargés du maintien de l’ordre », notamment grâce au colonel Godard, nouveau commandant du secteur, chargé de coordonner les opérations police- armée. L’IGAME valide les méthodes employées et tente même de donner au commandant de la 10e DP le contrôle de la police judiciaire. Il ne peut pas dessaisir le procureur de la République mais ce dernier, constatant qu’il est impossible de concilier « Droit et efficacité », décide de « s’effacer » pourvu, dit-il, que les militaires soient discrets et coopérants. Si, officiellement, la dernière barrière légale ne cède pas, le soutien que l’IGAME apporte au général Massu marque un nouvel approfondissement de la répression : la cause est en fait entendue28. Quelles que soient les déclarations des autorités affirmant que les interrogatoires sont menés avec humanité, les pratiques sont tout autres et hors de contrôle. Pendant toute la « bataille d’Alger », des « suspects » sont torturés par des équipes pour qui ces violences illégales deviennent le quotidien. Les centres, même quand ils sont clandestins, sont connus et beaucoup d’Algérois pourraient les citer. L’avocat Maurice Garçon a ainsi reçu des informations sur Alger. « Quelques lieux d’interrogatoire par les parachutistes » lui sont signalés : « Alger : la villa Susini [sic], Clos Salembier, biar es-saada (Alger), sous-sol mairie d’Alger (nouveaux bâtiments), stade municipal rue de Lyon, caserne du 19e Génie à Hussein-Dey, 94 avenue Clemenceau à El Biar, caserne de Zouaves place Henri Klein, immeuble rue marquis de Mores (Belcourt), immeuble allée des mûriers prolongée à Belcourt (avec souterrains très développés), Amirauté. Bouzaréah : immeuble DST. Birkadem : ferme Perrin où Boumendjel a séjourné29. » Les informations de Me Garçon sont incomplètes mais (p.177) reflètent une connaissance obtenue sans doute par témoins directs. Chaque lieu dépend plus particulièrement d’une unité de l’armée30 : ainsi, le 1er REP est présent villa Sésini et villa des Roses, au 74 boulevard Gallieni, la 4e compagnie du 9e Zouaves est installée à la caserne de l’intendance rue Bruce, la lre compagnie du 2e RPC dans une villa luxueuse de Birmandreis, face à des champignonnières, le 1er RCP occupe un immeuble en construction à El Biar31.
Des sources particulièrement riches permettent d’étudier en détail le centre de la villa Sésini. Croisées avec des témoignages écrits ou oraux, elles offrent un tableau assez complet de la torture pendant la « bataille d’Alger » et font émerger un système méthodique où une violence réfléchie est infligée en laissant une place réduite au hasard et aux improvisations. Il s’agit de plaintes pour sévices graves reçues par le procureur du Parquet d’Alger entre le 21 mars et le 18 avril 1957. Certaines ont été adressées au journal Le Monde ou à des personnalités politiques et syndicales, dans le but d’alerter l’opinion publique. Les archives du ministre résidant et celles du ministère de la Justice en ont aussi conservé quelques-unes. Enfin un cahier saisi dans une cellule de Barberousse, la prison d’Alger, le 8 avril 1958, contient le texte des plaintes déposées auprès du procureur général par plusieurs femmes. Il s’agit majoritairement de Français d’origine européenne, communistes ou progressistes. Les premiers sont notamment membres du réseau clandestin La Voix du soldat, animateur du journal du même nom. Le groupe des « libéraux », appelés aussi (p.178) « progressistes », est composé pour partie de membres des centres sociaux32. Le fait que la plupart d’entre eux soient d’origine européenne comme leurs appartenances politiques les distinguent de la masse des « suspects » arrêtés à Alger ; ils révèlent en revanche l’amplitude de la répression, qui n’épargne aucun secteur de la société. Les femmes, en particulier, sont touchées : elles ont posé les premières bombes à Alger, ce qui n’a pas manqué de les rendre suspectes. Les témoignages font apparaître une spécialisation de certains endroits (la villa Sésini et le centre de tri d’El Biar) et de certaines unités : les Français d’origine européenne arrêtés par le 1er RCP sont en effet, à un moment ou à un autre, conduits villa Sésini ou confrontés au capitaine Faulques — ce qui prouve la spécialisation de sa compagnie dans ce domaine sensible. Sans être jamais majoritaires, les femmes sont nombreuses à être interrogées et torturées à la villa Sésini comme à l’école Sarraouy (située rue Mont- pensier, tout près de la Casbah, cette dernière n’est vraisemblablement utilisée que pendant les vacances scolaires. En septembre, il semble que les parachutistes se soient déplacés dans un bain maure de la rue Scipion). Toutes les femmes arrêtées ne sont pas torturées : Denise Walbert estime que deux tiers l’étaient, en mars 1957, contre 80% des hommes33. « Neuf gars sur dix parlaient tout de suite, avant même qu’on les interroge. Mais il y en a eu effectivement qu’il fallait un peu forcer », admet le colonel Allaire. Maniant l’euphémisme à trois reprises en une phrase, il ne peut nier qu’on emploie la torture pour faire parler au cours d’interrogatoires que son commandant qualifie d’« interrogatoires de choc ». Le témoignage de Claude Lecerf, qui servait dans (p.179) une autre compagnie du même régiment, abonde dans l’autre sens : « Pratiquement tous les gens qui ont été arrêtés ont été torturés, plus ou moins, mais ils ont tous été torturés — y compris les femmes. » Les motivations d’un officier de carrière, interpellé sur sa pratique de la torture, et celles d’un appelé, militant communiste, qui a choisi de dénoncer ce à quoi il a participé en Algérie sont certainement opposées et colorent leurs récits. Tous les deux s’accordent cependant sur la réalité de la torture et il est vraisemblable que si tous les suspects arrêtés ne sont pas torturés physiquement, la grande majorité l’est34.
De l’arrestation à l’internement : un arbitraire organisé Après leur arrestation, les « suspects » sont interrogés puis souvent placés en détention. André Gal- lice, conseiller municipal proche du maire d’Alger Jacques Chevallier, est arrêté chez lui à 5 heures du matin, en février 1957. Conduit villa Sésini, il est interrogé par le capitaine Roger Faulques, OR du 1er REP, qui l’accuse d’avoir hébergé Benyoucef Ben Khedda, le responsable de la direction politique du FLN dans la zone autonome d’Alger. Le capitaine Faulques accueille toujours les suspects et mène le premier interrogatoire, accompagné souvent de gifles, de coups et d’insultes. Son ancien camarade de régiment Hélie de Saint Marc dépeint un homme de grand courage, solitaire et intransigeant. Après s’être battu dans les maquis pendant la Résistance, il setait distingué dans les combats de la RC 4 et pendant l’évacuation de Cao Bang. « Quand il parlait, son menton et les muscles de son cou se crispaient de passion contenue. Son regard brûlait d’une lueur (p.180) dévorante qui fascinait ses interlocuteurs ou qui les effrayait. On le disait brutal. Il était au-delà de ces étiquettes », ajoute l’ancien putschiste35.
Au bout d’une ou deux heures au maximum, les « suspects » sont descendus dans les cellules de la villa Sésini. Les autres centres de la ville et de sa banlieue sont également équipés en cellules plus ou moins improvisées. Ainsi, à El Biar, les prisonniers du 3° RPC sont détenus dans de petites pièces munies de fenêtres à barreaux, tandis que la compagnie de Pierre Leulliette installe ses premiers prisonniers dans des champignonnières face à la villa quelle occupe. Au contraire, à la ferme Perrin, les « suspects » sont « parqués dans un espace découvert entouré de barbelés36 » et, à l’école Sarraouy, ils sont attachés aux bancs des salles de classe dans lesquelles sont aussi installés des lits de camp37. Une fois détenu, André Gallice est laissé quarante- huit heures en cellule sans être interrogé. Pendant ces deux jours, il a le temps de découvrir la torture : « Là se trouvait un homme, avec une corde autour du cou qui, passant dans un anneau au mur, revenait sur ses bras attachés derrière le dos : soit il était étranglé, soit ses bras étaient engourdis. Pour soulager ses douleurs, les autres détenus se relayaient sous lui pour le porter, ce qui supprimait cette tension. Et, quand les soldats arrivaient, nous nous écartions de lui, pour qu’ils ne réalisent pas l’aide que nous lui apportions ainsi38. » Cette confrontation à la souffrance d’autrui vise à faire pression sur les « suspects » pour qu’ils parlent. Les victimes affirment souvent avoir vu, immédiatement après leur arrivée en détention, des personnes souffrantes ou torturées ; ce quelles croient être un hasard, une réalité entrevue dans un couloir ou par une porte, est (p.181) en fait organisé dans un but précis. Le récit de Claudine Lacascade ne laisse aucun doute à ce sujet : On me montra Colette, les cheveux trempés d’eau et l’air hagard. On amena, à peu près au même moment, Lucie que l’on déshabilla pour l’enrouler dans une couverture. Devant moi, je les vis appliquer, pendant qu’elle hurlait, des électrodes sur le corps de Colette. Je les vis pratiquer des débuts d’asphyxie sur Lucie. Ils lui déversaient lentement sur la figure de l’eau contenue dans deux jerricans. J’assistais à tout cela dans un coin de la salle, nue et les menottes aux mains. De temps en temps ils me faisaient appeler pour « que je la regarde »39. Ce délai sans interrogatoire après la mise en cellule, qui peut durer plusieurs jours, participe d’une tactique visant à laisser « mûrir » les personnes arrêtées, à les mettre en condition pour faciliter leurs aveux, ce qui permet de relativiser l’argument du terroriste qu’il faut faire parler d’urgence pour connaître l’emplacement de la bombe qu’il a déposée et qui s’apprête à tuer des innocents40. Pendant ce temps, le « suspect » est parfois confronté à des gens cagoulés, qu’on engage ainsi à dénoncer en toute sécurité. L’expérience d’André Gallice ressemble à celle de la plupart des suspects détenus villa Sésini : un véritable sas de mise en condition psychologique prélude à d’éventuelles tortures. Celles-ci ont lieu dans des endroits spécifiques. À la ferme Perrin, ferme coloniale typique flanquée d’un bosquet et noyée au milieu des vignes, « quelques sacs étendus entre les arbres délimitent le lieu des tortures […]. Des cordes pendent aux branches des arbres. Au bout de ces cordes se balancent des détenus ficelés41 ». L’absence de locaux et de voisinage (p.182) autorise ici une pratique en plein air que la ville interdit — en particulier si, comme à la caserne du 19e Génie, d’autres soldats sont mêlés aux parachutistes. À Hussein-Dey, les tortures ont donc lieu dans des caves situées sous les garages et séparées des bâtiments en dur dans lesquels logent les militaires du génie par les tentes des parachutistes. Fernand y est conduit par un camarade, qui lui fait partager sa découverte, ignorée du nouvel arrivant : « On ne savait vraiment pas qu’il y avait des cellules de torture là. » Quand les parachutistes sont entre eux, tant de précautions ne sont pas nécessaires. A la villa Sésini, André Gallice se souvient de la cour : « La baignoire se pratiquait au su et au vu de tous, dans la vasque située au centre de la cour de la villa. » D’autres témoignages décrivent une topographie plus complexe puisqu’un lieu fermé existe aussi villa Sésini, où André Gallice n’a pas été conduit : au fond du jardin, un pavillon appelé « le café maure » sert de « chambre aux aveux »42. Le capitaine Faulques n’est pas toujours présent aux séances de torture mais les informations sont demandées aux « suspects » sur ses indications. Il décide de leur passage ou non à la torture et peut venir présider les séances. Ainsi, quand Claudine Lacascade est torturée, le capitaine demande à ses hommes de faire moins de bruit et commande la puissance de la gégène. Elle se souvient qu’« ils [lui] appliquèrent les électrodes sur le dos et les seins, le capitaine Faulques donnant des ordres tels que “plus fort”, “moins fort”43 ». Enfin, il reçoit toujours dans son bureau les victimes pour les interrogatoires qui succèdent aux tortures, de jour comme de nuit44.
Le capitaine Faulques n’est pas une exception et le fonctionnement de la villa Sésini est à l’image (p.183) des autres centres. Le lieutenant-colonel Bigeard veille à ce que les interrogatoires soient « menés obligatoirement par un officier45 » ; c’est aussi le cas dans les autres régiments. Les OR dirigent donc autant que possible les séances de torture. Moussa Ben Belkacem Aici, arrêté le 24 février et détenu villa des Roses, affirme ainsi que « toutes les tortures qui [lui] ont été infligées l’ont été sur l’ordre du capitaine toujours présent » et qu’il décrit, faute de connaître son nom, comme étant « grand et maigre et [avec] les cheveux blancs46 ». Dans le cas d’Henri Alleg, le lieutenant Charbonnier, auteur de son arrestation, mène le premier interrogatoire sommaire et le suit pendant tout son séjour à El Biar. Détenu au même endroit, le docteur Georges Hadjadj se souvient précisément qu’un lieutenant dirige les séances de torture à l’électricité : « À chaque commandement du lieutenant « allez”, la machine se [met] en action47. » Parfois ils manient eux-mêmes les instruments de supplice mais, le plus souvent, ils laissent agir d’autres militaires, lieutenants, sous-officiers, petits gradés ou hommes de troupe. Dans la compagnie de Pierre Leulliette, le capitaine supervise ainsi un lieutenant et deux sergents, aidés « les jours de grands « arrivages” […] [par] deux ou trois autres hommes de troupe48 ». Au cours des séances de torture, une répartition des tâches laisse le plus gradé poser les questions. Au 1er RCP, la hiérarchie semble très strictement respectée : si le capitaine Devis est présent aux séances de torture d’Henri Alleg, c’est lui qui donne les ordres ; sinon les lieutenants Erulin ou Charbonnier s’en chargent, à moins qu’ils ne laissent le sergent Jacquet ou le policier Lorca seuls avec le directeur d’Alger Républicain — ce qui est rare. A la Bouzaréah, (p.184) dans une ancienne école d’EDF, une compagnie du 3e RPC torture ; Claude Lecerf fait partie des tortionnaires mais ce sont les officiers qui dirigent : ils « postent] des questions et puis ils se mett[ent] à gueuler comme des ânes, ils braill[ent]. Ils [font] peur quoi. Et puis, ça tend… Le fait de faire… le gars qui gueule, le gars qui donne des ordres, le gars qui crie, ça nous crispe, ça nous lave quoi49 ». À la villa Sésini, quand le capitaine Faulques n’est pas présent, un lieutenant le remplace, comme à l’école Sarraouy où le lieutenant s’incline devant les ordres donnés par le capitaine50.
Le plus haut gradé est parfois un policier. L’organisation de la répression à Alger a amené les polices à travailler en commun avec l’armée et cette collaboration se retrouve jusque dans les salles de torture, comme le signalent de nombreuses victimes31. Affectés à certaines unités précises, les policiers peuvent aussi passer de l’une à l’autre, tel Charles Lévy, adjoint occasionnel de la PJ d’Alger, qui travaille au 20e GAP en juillet 1957 puis au 3e RPC et enfin au 1er REP, son « endurance », sa « connaissance de l’arabe et des Arabes » le conduisant à mener de nombreux interrogatoires52. A la villa Sésini, la présence de trois ou quatre officiers de police soulage considérablement l’équipe du capitaine Faulques qui repose sur le lieutenant Louis Bonnel et l’adjudant Feldmeyer. Un « sous-lieutenant », inspecteur de la Sécurité du territoire, participe ainsi à certaines séances habillé en militaire : il accompagne tantôt l’adjudant Feldmeyer, tantôt une équipe augmentée du « capitaine Henri ». Tous n’y participent pas : ainsi, quand Colette Grégoire entend le capitaine Faulques l’envoyer aux tortures, un policier en civil « présent à l’interrogatoire [part] alors, disant ne (p.184) pas supporter la vue des tortures et qu’il [la laisse] aux mains des militaires ». On ne peut exclure une mise en scène destinée à effrayer la jeune femme. Cependant, alors que cet officier de police est bien détaché auprès du 1er REP, aucun témoignage ne mentionne sa participation aux tortures. Sa qualité de « conseiller technique », pour reprendre les mots du lieutenant Louis Bonnel, semble s’être limitée à enregistrer des procès-verbaux d’interrogatoire dans le bureau du capitaine Faulques — où se terminent aussi les séjours des « suspects » qui quittent la villa Sésini pour un CTT ou la prison53. Ces interrogatoires — entrecoupés d’arrestations — constituent le quotidien du capitaine Faulques. Pendant celui d’André Gallice, « il a téléphoné à sa femme pour lui dire : « Je rentrerai encore tard ce soir, j’ai beaucoup de boulot” ». Les séances de torture appartiennent à cette routine. Dans chaque compagnie, une petite équipe dirigée par un homme semble affectée à cette tâche précise. Dans le centre où Henri Alleg est torturé, le policier Lorca occupe cette fonction, aidé par un ou deux parachutistes. À la villa Sésini, l’adjudant Feldmeyer est de toutes les séances54. Pour ces chevilles ouvrières du système, et contrairement aux hommes des compagnies qui participent aux contrôles et aux arrestations, les séances de torture constituent l’unique activité quotidienne : elles lassent même le sergent de la compagnie de Pierre Leulliette qui lui confie « qu’il ne travaille] plus que machinalement, distraitement. Il s’ennu[ie], C'[est] toujours la même chose55 ». Pour les victimes, évidemment, l’impression est exactement opposée. La lecture de leurs témoignages fait cependant apparaître des pratiques récurrentes, éléments d’une violence appliquée avec précision et (p.186) dans un désir d’efficacité, ingrédients d’une véritable machine tortionnaire. (p.188) Les tortures physiques interviennent aussi selon un rythme et des modalités précises. Celles qui sont infligées villa Sésini sont toujours les mêmes : application d’électricité sur le corps et ingurgitation forcée d’eau. Ces deux tortures de base sont pratiquées avec quelques variations. La victime est soit plongée dans un bassin, soit forcée à avaler l’eau par l’intermédiaire d’un entonnoir — le maintien de la cagoule surajoutant alors une sensation d’étouffement. Quant à la torture électrique, elle varie selon les endroits où sont placées les électrodes et la force du courant appliqué — mais les organes sexuels sont systématiquement visés. Le récit de Cornélie, institutrice conduite dans la nuit du 25 mars 1957 à la villa, ressemble à celui de beaucoup d’autres victimes, c’est pourquoi nous avons choisi de le citer largement. Au (p.189) cours d’un premier interrogatoire sommaire, elle voit Colette « hagarde, blême, méconnaissable ». Puis on la frappe violemment et son récit continue ainsi : On me couvrit la tête d’une cagoule et on me fit descendre au milieu du jardin dans un pavillon qu’ils m’avaient complaisamment dit s’appeler « chambre des aveux ». Là on me déshabilla complètement. On me lia les mains et les pieds. On m’accabla de plaisanteries grossières, on me fit des attouchements extrêmement gênants pendant qu’un homme était allé « recharger la batterie ». Quand il revint mes bourreaux commencèrent à m’appliquer les électrodes d’abord sur les seins. Sous la douleur, et comme mes pieds étaient liés, je tombais. Ils me relevèrent à coups de pied. Atteinte d’une affection à la colonne vertébrale […], je ressentis une violente douleur à la base du dos. On m’appliqua ensuite des électrodes sur les régions ovariennes, à la face interne des cuisses et sur la gorge. L’intensité du courant augmentait sans cesse. On me coucha ensuite dans une couverture mouillée et on m’y enroula en m’attachant solidement. J’avais toujours la cagoule. Le plus gros des hommes s’assit sur mon estomac en me dégageant la bouche et en la maintenant ouverte, tandis qu’un autre y versait de l’eau à l’aide d’un jerrican. Comme j’essayais de me débattre, ces hommes me donnèrent d’abord de violents coups de pied dans les tibias ensuite ils s’assirent sur mes jambes. Ils recommencèrent plusieurs fois et me déversèrent dans la bouche le contenu de plus de trois jerricans. Alors ils s’arrêtèrent, m’essuyèrent le corps et la tête, me frottèrent les poignets et les chevilles pour faire disparaître les traces de cordes. Ils me firent monter au secrétariat et me donnèrent immédiatement une feuille de papier en m’ordonnant d’écrire ce qu’on m’avait fait dire sous les tortures60. Ces deux tortures sont presque toujours appliquées ensemble au cours d’une même séance qui peut durer(p.190) deux à trois heures. On les retrouve dans tous les autres centres d’Alger. Le général Massu lui-même écrit, dans son livre dédié au préfet Serge Baret, que « le procédé le plus couramment employé, en sus des gifles, était l’électricité, par usage des génératrices des postes radio (la gégène : première syllabe du mot génératrice) et application d’électrodes sur différents points du corps61 ». Les « renseignements officieux » parvenus au procureur général d’Alger lui permettent d’affirmer que « les sévices infligés par certains militaires aux personnes appréhendées — sans distinction de race ni de sexe — auraient été relativement fréquents [et qu’] ils sont toujours sensiblement les mêmes : application de courant électrique, supplice de l’eau, et, parfois, pendaison par les mains62 ».
La volonté d’obtenir très rapidement un renseignement pousse les militaires à interroger parfois les gens chez eux, comme Mustapha Bouhired torturé devant ses enfants et sa femme, qui l’a raconté à Djamila Amrane : « Ils l’ont torturé à l’électricité (ils avaient branché leurs appareils dans la maison), à l’eau (ils avaient apporté une grande bassine pleine d’eau)63. » La plupart sont emmenés ensuite dans des centres où ils sont de nouveau torturés. Arrêtée dans la nuit du 4 mars, Chafika Meslem est ainsi immergée de force dans la baignoire de l’appartement quelle occupe puis emmenée à la villa Sésini où elle passe trois semaines. Là-bas elle n’est plus torturée physiquement mais elle peut voir sa collègue des centres sociaux, Nelly Forget, Salima « dans le même état que Nelly », un ami, Mahmoud « complètement défiguré par les coups » et Madeleine qui lui raconte ce quelle a subi64… Elle est interrogée et menacée. Les renseignements sont demandés aux suspects au cours des interrogatoires de l’OR, qui interviennent (p.191) le plus souvent après les séances de torture : c’est ce qui permet à certains d’affirmer qu’ils interrogent tout au plus avec quelques gifles, les tortures plus violentes ayant eu lieu ailleurs et avant. Quelles que soient les unités qui les détiennent, les personnes arrêtées sont soumises aux supplices de l’eau et de l’électricité selon des modalités voisines de celles de la villa Sésini. Quelques tortures spécifiques permettent d’identifier certains centres. Dans la compagnie de Pierre Leulliette, le sergent utilise des « étaux d’établi […] pour broyer notamment les parties sexuelles » et surtout de lourdes cordes « commando » puis des bâtons pour frapper les « suspects récalcitrants ». À la villa des Roses, des trous creusés à plus d’1,50 mètre dans le sol et entourés de barbelés constituent des « tombeaux » dans lesquels les suspects sont enfermés, selon une pratique de brimade usitée dans la Légion. Au centre de tri du sous-secteur de la Bouzaréah, Henri Alleg a le corps brûlé par le feu, méthode qui semble courante là-bas65. À la caserne d’Hussein-Dey, Fernand se souvient des caves : Les murs étaient couverts de sang ! Il y avait des crochets au mur, il y avait des gégènes — bon les gégènes c’est des appareils à produire de l’électricité pour faire marcher les radios — il y avait plusieurs gégènes et il y avait du sang sur tous les murs. [Silence.] R. B. : Et il n’y avait pas d’eau ? F. : Il y avait de l’eau. Il y avait des trucs à eau. Il y avait des entonnoirs, si, il y avait ça66. Mais ces différences n’altèrent pas le fond du système qui ressort de l’analyse des plaintes sur la villa Sésini. La torture est pratiquée de manière systématique sur les « suspects » arrêtés : le plus souvent (p.192) caractérisée par des sévices, elle alterne avec des interrogatoires sans violence physique visant à confirmer les renseignements livrés dans les caves ou les cellules. Elle n’est pas un dérapage de la répression, encore moins la pratique isolée de quelques unités sadiques : elle est au cœur des usages des unités engagées dans la « bataille d’Alger ». Les modalités en sont surveillées par des officiers et obéissent à des normes d’efficacité. Il est vraisemblable qu’on n’inflige pas de sévices à quelqu’un dont on sait tout ou qu’on espère faire fléchir autrement. L’analyse des plaintes révèle aussi deux soucis dans l’application de la douleur : les tortionnaires s’efforcent de ne pas laisser de traces et de ne pas mettre en danger la vie d’une personne dont ils attendent des renseignements. (p.216) La présence des députés communistes et progrès (p.217) sistes au sein des opposants à la reconduction des pouvoirs spéciaux, le 19 juillet, n’est pas surprenante. Parmi les deux cent quatre-vingts parlementaires ayant voté pour, on ne s’étonne pas non plus de trouver les soutiens du gouvernement à gauche — y compris des minoritaires socialistes — comme à droite. Le gouvernement doit toutefois demander une seconde délibération à propos de l’extension des pouvoirs spéciaux à la métropole et poser finalement la question de confiance pour obtenir l’adoption de la loi. Vingt-neuf abstentionnistes volontaires témoignent du malaise de certains députés, sensibles aux violences incontrôlables que les pouvoirs spéciaux permettent et peu convaincus par les barrières que le gouvernement Mollet a in fine installées contre elles. L’abstention de François Mitterrand exprime, plus qu’aucune autre, ce malaise. Comme Maurice Bourgès-Maunoury, l’homme a été un des piliers des gouvernements depuis le début des « événements » et il a accompagné l’enfoncement dans la guerre aux postes les plus importants. Ce partisan de l’intégration a estimé que les pouvoirs spéciaux étaient nécessaires pour mater la « rébellion » : il les a soutenus et a signé avec Guy Mollet, Robert Lacoste et Maurice Bourgès-Maunoury le décret élargissant la compétence de la justice militaire. La « bataille d’Alger » a révélé un ministre de la Justice inquiet mais solidaire du gouvernement. À la chute de celui-ci, il préfère rester à l’Assemblée : son abstention semble indiquer une réserve sur les méthodes dont il a pu observer de près l’application, mais le président de l’UDSR ne s’exprime pas à ce sujet et continue toujours à soutenir le gouvernement23.
(p.232) « Torture », explique le général Massu quarante ans après, « c’est un mot très général qui n’était pas valable pour l’action que nous avons menée en Algérie — à mon humble jugement —, qui n’a rien à voir avec la torture pratiquée dans les camps de déportation nazis. » Accusée de se conduire comme la Gestapo ou comme les SS, l’armée française répond sur le même terrain. La comparaison avec l’époque nazie est très sensible dans la France de 1957 : elle est d’autant plus douloureuse quelle éclate dans une société qui souhaite plutôt oublier ce passé et ses propres compromissions. Elle touche les officiers au cœur. Ils s’attachent à la faire exploser en déniant à leurs adversaires le statut de résistants, ce qui entraîne automatiquement la chute de l’autre élément de la comparaison, la Gestapo. La démonstration est pourtant fragile et beaucoup préfèrent, tel le général Massu, s’attacher à décrire les différences de méthodes58.
(p.413) Malgré l’interdit social pesant sur le viol, la surenchère dans l’affirmation de l’identité virile que la guerre permet au quotidien — par la pratique de la violence, par la possession d’une arme, par l’exaltation de la force — amène des soldats à ignorer la valeur transgressive de cet acte. En effet, tout se passe comme si les hommes entre eux, dans ces petits groupes que sont les unités militaires élémentaires, obéissaient à d’autres codes. Ce monde de valeurs décalées par rapport aux normes sociales, qui en sont un dérivé atténué, existe déjà en temps de paix. Mais l’atmosphère exclusivement masculine de la vie combattante accroît son importance — les contrepoids sociaux et féminins étant, pendant de longs mois, à distance. Beaucoup, déplore le père Péninou, « perdent de vue ce sens de la femme, de sa valeur, de sa dignité. On laisse s’oblitérer les exigences de fidélité conjugale ou de chasteté personnelle67 ». (p.414) Plusieurs témoins décrivent des hommes se vantant de leurs crimes : la perversion des valeurs fondamentales de l’humanité, sur laquelle repose en partie la guerre qui impose de tuer son prochain, se retrouve dans cette ignominie devenue acte de gloire. Le viol est un acte de violence dans lequel le sexe de l’homme est le moyen — mais un objet peut lui être substitué — et dont le sexe de la femme n’est pas la fin ultime. C’est la femme elle-même qui est visée. Le désir y est moins sexuel que volonté de possession et d’humiliation. C’est pourquoi les hommes peuvent en être aussi des victimes. Le soldat qui viole ne choisit pas sa victime, il la prend. L’unique caractéristique de celle-ci est d’être algérienne et, dans la guerre engagée, ce critère suffit à dégager un vaste espace des possibles. À travers la femme, bousculée, violentée, violée, le soldat atteint sa famille, son village, et tous les cercles auxquels elle appartient jusqu’au dernier : le peuple algérien. Si les militaires violeurs n’ont pas conscience de cette dimension, les Algériens, eux, l’éprouvent, comme en atteste Mouloud Feraoun. Les fellagha, note-t-il, « ont expliqué aux femmes, texte du Coran à l’appui, que leur combat à elles consistait précisément à accepter l’outrage des soldats, non à le rechercher spécialement, à le subir et à s’en moquer. […] Au surplus, il est recommandé de ne pas parler de ces choses, de ne pas laisser croire à l’ennemi qu’il a touché la chair vive de l’âme kabyle si l’on peut dire, de se comporter en vrai patriote qui subordonne tout à la libération de la patrie enchaînée68 ». Ces recommandations contribuent à expliquer le faible nombre de plaintes déposées par les Algérien(ne)s. Le viol, ce crime si particulier dont l’auteur se sent innocent et la victime honteuse, (p.415) est une tache, que les femmes taisent, mais que les hommes cachent aussi puisqu’il a dévoilé leur impuissance à protéger leurs femmes, pierre de touche de leur autorité et de leur honneur69. (p.420) « Les femmes dévêtues systématiquement » quand elles sont arrêtées pour interrogatoire sont aussi nombreuses que les « enfants battus, gardés plusieurs jours attachés par des menottes à une table de fer dans un garage », écrit ainsi un sous-lieutenant stationné dans la basse vallée de la Soummam entre mai 1960 et juillet 1961. Au cours de missions dans d’autres endroits d’Algé- ^ rie, il affirme y avoir constaté les mêmes pratiques3. (…) Un témoignage exceptionnel à de nombreux égards ‘ permet une plongée dans la transgression majeure qu’est l’atteinte à la dignité des enfants5. Rédigé plus de vingt ans après les faits par Saïd Ferdi, devenu officier dans l’armée française, ce texte pourrait être celui d’un Mouloud Feraoun enfant, au quotidien rythmé par les combats des Aurès dès l’âge de dix ans. La vie de l’auteur bascule à treize ans et demi quand il est arrêté par des militaires pour une vérification d’identité, qui dégénère en séance de torture à propos de ses deux frères partis au maquis et des renseignements qu’il pourrait apporter sur le FLN. D’abord frappé jusqu’au sang par des coups de canne sur la tête, il est ensuite torturé à l’électricité. La séance ayant été interrompue sur ordre d’un capitaine, (p.421) il est maintenu en isolement pendant plusieurs jours. Rien ne distingue les traitements réservés à cet enfant de ceux que reçoivent les adultes. C’est le frère et/ou le « chouf » que les militaires français torturent, pas l’enfant. (…) à partir de quatorze ans, un enfant 1 peut être arrêté et torturé, comme les plus grands8. La recherche de renseignements a effacé l’interdit portant sur l’enfance innocente (p.424) Toutefois les violences faites aux femmes présentent des caractéristiques sexuelles évidentes et le viol est une technique de torture répandue17. Il s’agit surtout de pénétration réalisée au moyen d’objets, morceau de bois ou bouteille de verre. Le viol apparaît sous son vrai visage : le vagin des femmes est un nouveau lieu pour appliquer la douleur, une porte par laquelle la violence peut faire effraction. (…)
Le cas de Djamila Boupacha est particulièrement connu dès l’époque de la guerre. La jeune militante accusée d’avoir transporté des bombes a été arrêtée la nuit du 10 février 1960 avec son père, sa sœur et son beau-frère19. Le 11, elle est assignée à résidence surveillée au centre de tri du sous-secteur de la Bouzaréah et y reste une semaine pour exploitation opérationnelle avant d’être transférée pour quelques jours à la caserne d’Hussein-Dey pour d’autres interrogatoires. Les 8 et 10 mars, des officiers de la police judiciaire viennent prendre sa déposition, après avoir été prévenus par le capitaine Damei qu’elle avait avoué le dépôt d’une bombe le 27 septembre 1959 dans un café d’Alger et ses rapports avec des rebelles recherchés20 ». Elle est transférée au centre de Béni- Messous et inculpée d’association de malfaiteurs et (p.425) tentative d’homicide volontaire. Présentée au juge d’instruction, elle renouvelle ses aveux mais se plaint d’avoir été torturée. Djamila Boupacha n’est pas une exception. Dans ses travaux, Djamila Amrane a mis en avant le sort particulier des « terroristes » : alors que toutes les femmes arrêtées ne sont pas torturées, cette pratique est « presque systématique » pour les fidayate qui, par ailleurs, totalisent 37 % des condamnations à plus de trois ans de prison quand elles ne représentent que 2 % des femmes engagées dans la guerre. Pendant que l’opinion française est alertée, que François Mauriac puis Simone de Beauvoir s’indignent des sévices et du viol subis par la jeune femme, la demande d’examen médical de Djamila Boupacha suit son cours ; les experts rendent leur rapport le 4 juin. Le 7 juin, elle renouvelle ses accusations. Son procès-verbal permet de recomposer pes de son séjour et de ses supplices : les premières violences commencent dès l’arrestation et continuent au centre de tri où elle est confrontée à son beau-frère, tuméfié et trempé22. C’est seulement une semaine plus tard, dans la caserne du génie de Husseinin-Dey, quelle est torturée, pendant plusieurs jours, à l’électricité, brûlée par des cigarettes puis plongée dans une baignoire au moyen d’un bâton autour duquel elle est attachée comme à la broche. Les tortures électriques ont déjà abîmé ses parties génitales quand elle est jetée à terre, nue, « les bras relevé et maintenus au sol ; une bande de toile [la serrant] à la ceinture » tandis qu’on lui « introduit successivement dans le vagin le goulot d’une bouteille dee bière et une brosse à dents ». Ce viol est le dernier acte de son supplice. Il intervient bien pour clôturer les séances de torture de Djamila Boupacha : (p.426) dans l’échelle des violences infligées, il est au sommet. Plus aucune question ne lui est d’ailleurs posée à ce moment-là23.
(p.437) Yvon assiste aussi, impuissant, au déchaînement de violences qui suit l’arrestation par sa compagnie d’un homme qualifié de « chef de front dangereux ». À en croire le journal de marche, l’homme, à qui un handicap physique valait le surnom de « manchot », a bien été arrêté par la compagnie d’Yvon où celui-ci le dit et a été tué au cours d’une tentative de fuite14. Les souvenirs de l’ancien caporal sont tout autres. Il évoque avec précision cet homme, arrêté et interrogé longuement sans qu’on obtienne rien de lui (p.438) et la décision qui est finalement prise. Yvon la raconte avec indignation : Le manchot ne parlait pas : c’était le jeudi soir. Là je reviens sur le… arrêté le jeudi, il a été pendu… en croix… Quand je pense que le capitaine disait qu’il avait été séminariste, qu’il avait été au séminaire ! Et au couteau… R. B. : Tué au couteau ? Yvon : Oui. R. B. : Lacéré ? Yvon : Lacéré au couteau comme ça [il fait le signe de lancer un couteau sur quelqu’un] ! Il était blessé déjà au tibia, touché le jeudi soir. R. B. : On lui plantait des couteaux dans le corps comme des fléchettes ? Yvon : Oui, c’est ça. Oui. R. B. : D’accord. Yvon : Le vendredi matin, il était pffff… il était… il est mort épuisé. 11 n’a pas dit un mot, pas dit un mot. […] R. B. : Et tous les hommes pouvaient venir comme ça s’amuser, jouer aux fléchettes ? Yvon : Oui. C’est là où j’ai vu à quel point quand… plus les repères moraux… quand on est pris dans un contexte de guerre, la guerre n’a plus de repères… les hommes n’ont plus de…
(p.439) Loin d’être des tortionnaires occasionnels, il s’agit ici de spécialistes du renseignement. En janvier 1998, une émission de France-Inter consacrée à la guerre d’Algérie laisse longuement la parole à un de ces hommes. Les réactions tantôt effarées, tantôt indignées, suscitées par son témoignage révèlent la prégnance d’un déni de réalité dont chacun aimerait se persuader : la torture serait affaire d’engagés et de militaires de carrière. Les appelés n’y seraient pas mêlés directement. Rien de moins vrai en effet : que ce soit en tant qu’officiers ou que soldats, des appelés du contingent torturent et appartiennent notamment aux équipes des OR. Si un souci d’épargner les appelés, ou de se protéger, peut amener certains officiers supérieurs à réserver cette tâche aux militaires de carrière, le besoin en hommes est tel que le recours aux appelés est souvent obligatoire. Un appel aux volontaires est alors fait. Pour l’aspirant de réserve Olivier, cité à l’ordre de la brigade avec la croix de la valeur militaire étoile de bronze, quelques semaines après son arrivée au 6e Hussards, ce volontariat est un des souvenirs les plus amers. Au moment des affectations, « un officier… : « Alors qui est-ce qui est volontaire pour le commando de chasse ?” Très, très peu. “Alors pour travailler avec l’officier de renseignement ?” Alors là une forêt de bras s’est levée, ça, j’ai vu ça ! Ce sont des choses inoubliables ! C’est inoubliable ! L’opinion qu’on a sur la nature humaine est changée pour toujours ! »16. Raymond est un de ces volontaires. A Daniel Mermet, il explique son geste : « Pour les faire souffrir», «c’était notre plaisir… comme ça on se vengeait »17. Engagé dans un bataillon de chasseurs (p.440) alpins au tout début de la guerre, Michel évoque aussi ce sentiment : quand on en piquait… excusez-moi, on prenait un plaisir à leur mettre… l’électricité avec des fils électriques et pis sur les parties et pis on… on était contents. R. B. : Vous étiez contents de faire mal ? Michel : je ne sais pas si c’était pour faire mal ou pour le tuer. C’était… c’était un excitant, vous voyez. On disait : « T’en as tué un ? », « T’en as tué deux, ben tu vas payer » […] On voulait le tuer nous. Il en avait tué chez nous, hein. C’est bien simple ; on est partis à 87 et on est revenus à 41 quand même ! […] A chaque fois qu’on en piquait, ben nous, il fallait qu’ils restent sur place ! Il fallait qu’ils meurent ici ! Jusqu’à temps qu’ils… qu’ils essayent, on essayait de les faire parler, mais comme ils ne voulaient pas parler, et ben, on se vengeait’8. Les sentiments de vengeance, de haine de l’Autre, de mépris jouent certainement un rôle dans ce volontariat. Le désir de garder l’Algérie française peut aussi l’expliquer. D’autres raisons, plus sourdes, plus difficiles à percevoir, restent encore à mettre au jour, comme la volonté d’échapper aux combats ou ce sentiment de toute-puissance obtenu sans aucun danger I physique.
(p.443) des harlis, des mogazhnis …
(p.445) Les soldats que nous avons rencontrés mentionnent souvent des « anciens d’Indo » dépréciant l’Algérie à Faune de leur expérience indochinoise. Jean Suaud évoque ainsi le cas sans doute extrême d’un sous- officier d’origine basque « qui regrettait de ne plus avoir les bambous qu’il avait en Indochine, parce que les bambous sous les ongles, c’est parfait28 »… (p.455) Le camp où Benoît Rey est affecté, à l’automne 1959, présente ces caractéristiques. Les prisonniers sont entassés dans une pièce. Font face à cette pièce, de l’autre côté de la cour, quatre cellules, notamment pour les femmes et pour les tortures avec « une poulie, des cordes, “gégène”, quelques gourdins et des bracelets de fer, scellés au mur ». (p.456) Les coups sont de toutes les séances, comme une introduction, une entrée en matière, mais pas seulement. Ils accompagnent souvent les fouilles de villages, les arrestations et installent une relation où celui qui les reçoit ne peut pas les rendre. Livrant, plus de vingt ans après sa déportation, son témoignage, Jean Amery décrit avec précision les coups qu’il reçut des SS en 1943. Son témoignage est absolument exceptionnel. Nous l’utilisons pour cette raison. Il ne s’agit en aucune manière de faire passer, en contrebande, une assimilation des soldats (p.457) français aux SS, mais ce qu’il dit sur la torture qu’il subit alors peut nous servir de guide pour accéder à la souffrance des victimes. Il insiste sur « le premier coup » et précise aux lecteurs soupçonnés d’incrédulité : « Les coups assénés pendant les interrogatoires n’ont pas grande importance en criminologie. Ce sont des représailles normales, tactiquement autorisées et pratiquées envers les détenus récalcitrants qui refusent d’avouer. […] La France a même inventé un mot pour minimiser gentiment la chose : on parle du “passage à tabac” des prisonniers. […] Ainsi donc, si quelques coups de poing — qui n’ont par ailleurs aucune commune mesure avec la vraie torture — ne suscitent que de faibles échos dans le public, celui qui les endure en fait quant à lui une expérience profondément traumatisante, pour ne pas galvauder ici les grands mots plus explicites et parler de monstruosité. Le premier coup fait comprendre au détenu qu’il est sans défense, et que ce geste renferme déjà tout ce qui va suivre à l’état embryonnaire8. » Est-ce par souci de cet engrenage ? Toujours est-il que le général Challe affirme avoir « formellement interdit […] toute torture même du genre « passage à tabac” ». Il se dit sûr que son ordre a « été transmis et exécuté ». La réalité le dément amplement9. En 1956, Paul Fauchon raconte les «coups de poing, pied » qui accueillent le premier prisonnier qu’il est chargé d’interroger10. En 1957, les photographies prises au 7e BCA confirment cette pratique, que celles de Marc Garanger enregistrent encore11. Comme elles, le certificat de décès du cheikh Daoud- dine est sans ambiguïté : le corps de ce chef de laouïa, dont la mort a mis toute la sous-prélecture de Bougie en émoi, porte « une plaie au cuir chevelu, de légères ecchymoses cutanées au niveau des muscles abdominaux, des muscles paravertébraux, des traces d’ecchymoses au niveau des bourses et des traces de ligature au niveau des deux malléoles et des deux poignets ». Si la cause de la mort est jugée « naturelle » par les médecins, le cheikh semble bien avoir été bourré de coups et avoir été précisément frappé aux testicules12. En 1959 encore, Jean-Louis Gérard se souvient qu a Aïn Terzine les coups sont la torture la plus fréquente, tandis que quelques mois plus tard Gilles note, dans son journal, qu’il a vu un homme de soixante ans tabassé « sans ménagement à coups de poing, chaussures, ceinture ». Cet homme avait été préalablement « pendu la tête en bas à un arbre, accroché par un pied ». Comme lui, de nombreux fruits étranges enlaidissent les arbres d’Algérie. Pierre Leulliette en a découvert, pendus pendant une journée, le visage noirci par le sang. Mais ces manifestations publiques sont sans doute rares : elles tiennent autant de l’exposition de cadavres que de la torture. Elles visent surtout à terroriser les villageois, qui ne peuvent qu’assister, impuissants, à la mort lente de leurs proches ou d’autres Algériens inconnus. La pendaison par les pieds est sans doute aussi fréquente qu’une autre que certains soldats français ont subie dans les camps du Viêt-minh et qu’Yvon nomme « le chevalet ». Ce système nécessite simplement un anneau au plafond et une corde : la victime est suspendue en l’air par les poignets, préalablement maintenus dans le dos13. Au bout de quelques heures, la dislocation des épaules et/ou des omoplates survient. René Trouchaud a laissé un homme suspendu toute une nuit à quelques centimètres du sol, au matin, « ses pieds touchent presque le sol, la corde a dû s’étirer », note-t-il, alors que c’est plus (p.459) vraisemblablement le corps de l’homme qui a comblé cet espace14. Dans le régiment de Jean, les membres de l’équipe OR pendent parfois leurs victimes par les pouces, toujours dans cette même position. La méthode de la pendaison n’est que ponctuellement utilisée, par rapport à « la baignoire, la gégène [qui sont] les plus fréquentes ». Ce que tous continuent à appeler la « baignoire » a souvent peu à voir avec un élément de salle de bains : « Quand on allait sur le terrain, une lessiveuse, une auge… il y avait toujours moyen… » Les victimes, la tête maintenue sous l’eau, étouffent au gré de leurs bourreaux. Certains salent l’eau ou la mélangent à de la lessive, ajoutant la brûlure à la sensation d’asphyxie. Le plus souvent, il semble que ce résultat soit obtenu autrement. Est-ce par réticence à refaire des gestes tant associés à la Gestapo — dont la baignoire est devenue pratiquement synonyme ? En tout cas, en Algérie, le supplice de l’eau est plutôt réalisé par l’intermédiaire d’un tuyau. Renversée en arrière sur le dos, la victime est « rempli[e] d’eau », comme le constate Louis Devred entrant par surprise dans le « local réservé aux prisonniers » de son unité15. « Des fois on leur mettait un tuyau dans la bouche avec un entonnoir et puis on leur versait de l’eau… pour leur faire avouer. Ah ! Tous les litres d’eau de la jerrican… ils n’étaient pas absorbés, il en coulait de chaque côté, mais c’est bon, il en absorbait au moins… une dizaine de litres, hein ! Ah, on n’était pas feignants pour y verser !» : le récit que Raymond fait à Daniel Mermet corrobore les témoignages à propos de victimes au ventre gonflé sur lequel les soldats s’asseyent pour leur faire régurgiter l’eau16. On leur recouvre le nez au moyen d’un tissu gorgé (p.460) d’eau, ne laissant plus passer un seul filet d’air, et on leur maintient la bouche ouverte par un morceau de bois, quand un tuyau ne vient pas directement déverser le liquide dans leur corps. Henri Alleg a décrit ses souffrances quelques mois après les avoir endurées : « J’essayais en contractant le gosier, d’absorber le moins possible d’eau et de résister à l’asphyxie en retenant le plus longtemps que je pouvais l’air dans mes poumons. Mais je ne pus tenir plus de quelques instants. J’avais l’impression de me noyer et une angoisse terrible, celle de la mort elle-même, m’étreignit17. » Comme pendant la « bataille d’Alger », le supplice de l’eau est rarement appliqué seul. Il est souvent le terrible adjuvant de la torture à l’électricité, puisque l’eau accentue l’effet des décharges. Raymond le précise d’ailleurs : une fois les fils fixés, « on les remettait un coup les pieds dans l’eau, avec la génératrice ». Cet appareil, qui sert à produire du courant, est plus souvent cité comme « la gégène », dans un cousinage sonore étrange avec la géhenne. De tailles variables, ces génératrices peuvent être portatives, pour faire fonctionner des radios ou des téléphones de campagne. Celles des postes radio, ANGRC9 ou SCR284, produisent un courant de 80 volts. Il y en a dans chaque régiment. Ainsi, en faisant l’inventaire de son matériel, Marcel Gui- gon, nouvellement nommé officier de transmission, repère l’absence d’une génératrice pour poste radio : on lui explique quelle est chez l’officier de renseignement18… Alain Maillard de La Morandais se voit conseiler par son capitaine de passer un suspect au « téléphone », la torture à base d’électricité la moins puissante19… « Ce procédé a été reproché très souvent (p.461) à nos troupes », remarquent les services de Robert Lacoste en décembre 1956, précisant, sans ironie, que « mises au courant, les autorités responsables ont réagi avec vigueur » et que décrire « l’emploi de cette méthode dans le bled [comme généralisé… est] une exagération évidente »20. Pourtant, si le « téléphone » n’est pas généralisé, la torture à l’électricité est bien répandue sur tout le territoire algérien. Présentes partout, des dynamos sont presque toujours à portée de main des tortionnaires, que ce soit au PC d’une opération ou dans un cantonnement. Ceux qui en parlent aujourd’hui accompagnent ou remplacent souvent leurs paroles par un geste de la main : ils tournent une manivelle imaginaire. La « gégène » ne produit en effet du courant qu’actionnée par un homme qui la tourne. Plus on accélère le mouvement, plus le courant est fort — ce qui invalide l’argument selon lequel les décharges sont toujours faibles, comme certains veulent le faire croire. Une photographie publiée par Jean-Charles Jauffret et prise par l’infirmier d’un régiment d’artillerie montre cet appareil, posé sur un tabouret, relié par deux fils à un homme maintenu à terre par plusieurs soldats21. Henri Alleg a décrit la variation des souffrances éprouvées, selon que son tortionnaire tourne le rhéostat de sa magnéto à fond, selon qu’on l’asperge d’eau en même temps, selon la taille de l’appareil aussi : « Dans la souffrance même je sentis une différence de qualité [quand on se mit à me torturer avec « la grosse Gégène”]. Au lieu des morsures aiguës et rapides qui semblaient me déchirer le corps, c’était maintenant une douleur plus large qui s’enfonçait profondément dans tous mes muscles et les tordait plus longuement22.» La torture à l’électricité réunit beaucoup d’avantages (p.462) pour des tortionnaires consciencieux. Les appareils peuvent être transportés n’importe où — pour être camouflés ou utilisés. La douleur est instantanée et peut permettre un « résultat » rapide. Surtout, la possibilité de moduler la décharge électrique, et celle de varier l’emplacement des électrodes, permettent de graduer les souffrances et de s’adapter immédiatement au comportement des victimes. En concurrence avec les autres méthodes, l’électricité semble avoir toujours eu la préférence des tortionnaires français. L’accroissement du nombre d’hommes engagés dans le conflit s’est aussi traduit par une arrivée massive de ces appareils en Algérie. Cette méthode se diffuse progressivement entre 1955 et la fin de l’année 1956, remplaçant le tuyau d’eau qui avait la préférence des policiers. Quand l’électricité est installée dans des lieux en dur, la « gégène » n’est pas toujours nécessaire. « C’est plus facile, [car] on n’a pas besoin de tourner la manivelle23 » : des fils tirés de la prise sont appliqués sur les corps des victimes. Le courant peut être de 110 volts mais aussi de 220. Au camp de Djidjelli où est arrivé Armand Frémont, c’est le cas, mais « c’est ennuyeux, car c’est beaucoup trop fort, alors que le 110 convenait parfaitement. On est tout de même un peu gêné », rapporte-t-il au style indirect dans son journal24. Qu’il s’agisse de pinces crocodiles, d’électrodes ou de fils dénudés, ils sont appliqués à deux endroits du corps. « [Ils branchaient] des fils dans les prises et puis… une électrode… sur les parties, une autre sur la lèvre ou sur l’oreille et puis tant que le type n’avait pas craché quelque chose […], l’électricité continuait, alors c’était horrible : le gars était révulsé, pfff…25 » Les endroits d’application des fils ne sont (p.463) pas toujours les mêmes. On les plaçait parfois dans les plaies des blessés, néanmoins la conductivité et la sensibilité des muqueuses en font un endroit de choix, avec les oreilles et les organes génitaux. Outre la soif terrible qui succède à ce supplice, les corps en ressortent d’autant plus brûlés que la peau est fine et fragile — sans compter parfois les brûlures de cigarettes.
La dimension sexuelle de la torture est, enfin, directe : femmes et hommes subissant des viols au cours de leurs « interrogatoires », le plus souvent par l’intermédiaire de ce que Paul Fauchon nomme, dans son journal, des « bouteilles mal placées26 ». Jean les évoque aussi, accompagnés de « menaces d’émasculer » : les mots devenant dans ce cas instruments de torture. La variation des sévices, leur multiplication à différents endroits du corps contribuent à perturber les sens de la victime. Elle accentue son impression que tout son corps devient souffrance et que le tortionnaire le domine absolument. C’est aussi ce que le bourreau recherche.
(p.464) Les victimes n’ont aucune autonomie. Ce sont leurs bourreaux qui décident pour elles du temps et de l’espace. Combien de temps va durer l’interrogatoire ? Y aura-t-il d’autres séances ou est-ce la seule ? Une fois les premiers renseignements donnés, en voudra-t-on d’autres ? Combien de temps durera la détention en cellule ? Les prisonniers ne maîtrisent rien et ces inconnues sont lourdes d’angoisse et de déstabilisation. Le temps, comme le reste, appartient totalement aux soldats français. La manière dont les prisonniers sont gardés symbolise bien cette privation totale de liberté. De trop nombreux témoignages (p.465) attestent de conditions de détention délibérément humiliantes, voire inhumaines, qui plaident pour une volonté consciente d’attenter à la dignité des prisonniers. De prime abord, le prisonnier se voit signifier son appartenance à une autre espèce d’hommes quand les tortionnaires le mettent nu. Dès lors que le stade du « passage à tabac » est dépassé, le prisonnier (ou la prisonnière) est systématiquement déshabillé(e). La séance photographiée dans un cantonnement du T BCA révèle ainsi un jeune homme complètement nu, les mains et les pieds accrochés à une barre. C’est dans la position humiliante du gibier qu’on ramène de la chasse qu’il est frappé à coups de grands bâtons, peut-être sur la plante des pieds. La nudité est l’expression pure de l’omnipotence des tortionnaires. Le corps exposé, parce que nu, devient, devant des gens habillés, une cible.
Les victimes cherchent à maîtriser leurs corps, en retenant leurs cris, en retenant leurs muscles. Mais celui-ci dit souvent leur souffrance. Des hurlements leur échappent, leurs sphincters se relâchent — venant parfois se mêler, chez les femmes, à un sang menstruel déclenché par le stress. Une odeur tenace s’installe sans doute, irrespirable. Trente-cinq ans après, un appelé évoque « l’odeur de sang » qui hantait le réfectoire, « sorte de pièce en tôle d’aluminium » où les soldats mangeaient parfois trop peu de temps après des interrogatoires ; cette odeur lui donne encore des nausées30. À Aïn Terzine, les interrogatoires ont lieu dans les douches, ce qui permet de « nettoyer après », le sang et « les excréments, parce que les pauvres, ils faisaient sous eux, ça je l’ai vu ! », se souvient encore, en soupirant, Jean-Louis Gérard31. Dans son journal, Alain Maillard (p.466) de La Morandais décrit les tortures subies par un « suspect ». Après avoir été pressé de questions, il a été attaché comme un animal à une barre de fer et « deux cosses lui furent fixées aux lobes des oreilles, et deux autres à l’extrémité de la verge. Et l’homme commença à hurler d’une voix rauque, sauvage, quasi inhumaine, étouffée par le pied qui était appuyé sur sa tête. Il rejetait sa tête en arrière sous l’effet des secousses électriques et ses membres attachés se crispaient de façon effrayante, son ventre se contractait convulsivement. Il vomit à plusieurs reprises, quelques aliments, du liquide, puis du sang apparut. Les bourreaux arrêtaient quelques instants les décharges pour le questionner. « Je ne sais, je ne sais rien… » et les hurlements reprenaient ». Il est ensuite soumis à la torture de l’eau. L’officier se décrit oppressé par « une odeur âcre, mélange (. d’acides, de féculents, de sang et d’ozone32 ». (p.469) Les médecins entrent parfois dans les salles de f torture. Jacques Faure a livré le récit de sa première confrontation avec la torture, le 27 décembre 1959, à 11 heures du soir. On l’appelle pour venir soigner un prisonnier « dans un état grave » : « L’homme, 35 ans, est couvert d’ecchymoses, les deux jambes fracturées et gémit, en état de semi-coma. “Il est tombé, pense-t-on, à moins que ce ne soit une rixe, m’explique embarrassé l’officier responsable. Mais il ne faut surtout pas qu’il meure, il détient des informations importantes sur la rébellion.’’ L’hospitalisation est impossible vu les risques d’évasion et l’isolement du poste. Seule la morphine pourra soulager ses derniers moments. » Par la suite, le jeune médecin est amené à soigner huit à dix victimes par jour, pendant les deux ans qu’il passe en Algérie40. D’autres, confrontés à cette exigence terrible qui consiste à maintenir des gens en vie pour qu’ils puissent continuer à être torturés, choisissent, soit d’aider à mourir des prisonniers, soit de collaborer autrement avec les militaires. C’est ainsi que Jean Suaud explique la décision de son médecin-chef de (p.470) faire croire à certains prisonniers qu’ils reçoivent une piqûre calmante alors qu’il s’agit de penthotal : il « prenait sur lui, devenait coopérateur de l’armée, pour… tenter par le biais du sérum de vérité… […] d’obtenir des informations que les autres pouvaient avoir par la torture physique41 ». (…) A contrario, l’hospitalisation dans un hôpital civil de Mohamed Chouchaoui, le « corps constellé de cicatrices » et le pied amputé, révèle au grand jour les pratiques cruelles d’un Deuxième bureau de l’arrondissement de Teniet-el-Haad au début de 1961. Les mauvais rapports entretenus par le sous-préfet avec le commandant du secteur hâtent le déclenchement d’une enquête. Le responsable civil se rend lui-même sur place, fait dresser un certificat médical, prendre des photos, et demande à voir le fils de Mohamed Chouchaoui, arrêté avec son père. Il le trouve enfermé dans une pièce de neuf mètres avec seize autres personnes, extrêmement maigre, les pieds bandés et les poignets portant des cicatrices identiques à celles de son père, « vraisemblablement, elles aussi, provoquées par des liens, sans doute des (p.471) fils de fer ». Il repère, enfin, les crochets auxquels le père dit avoir été suspendu, les fait emporter et photographier43. (…)
Les blessures de Mohamed Chouchaoui sont T représentatives de celles des autres victimes de tortures : traces de ligature aux poignets et chevilles, cicatrices sur le corps, éventuellement début de gangrène et — ce qui n’est pas mentionné ici — brûlures. Exception faite des cas particulièrement graves, les atteintes corporelles étant standardisées, les séquelles le sont aussi. Ainsi, en deux ans, et avec près d’une dizaine de patients par jour, Jacques Faure a pu constater la banalité des lésions et des soins : « La plaie, l’hématome, la brûlure étaient notre seul terrain de contact [avec les victimes…]. Les lésions, très standards, permettaient l’application de soins répétitifs. Seule une lésion inhabituelle venait nous rappeler qu’il ne s’agissait pas d’une pathologie banale45. » Le médecin aussi peut s’installer dans une routine, accomplissant toujours les mêmes gestes. La torture électrique laisse des traces spécifiques (p.472) que victimes et médecins connaissent bien. Sur le corps, les emplacements des pinces ou des fils sont imprimés, petites taches brunâtres à la surface de la peau qui peuvent partir en quelques semaines et qu’une pommade peut faire passer plus vite, quand elles ne sont pas sur les parties les plus sensibles. Les secousses du corps martyrisé sous les décharges électriques ont souvent enfoncé dans la peau les liens qui maintiennent la victime attachée : les membres sont alors écorchés et doivent être badigeonnés d’un désinfectant, par exemple de mercurochrome. Mais les brûlures les plus graves sont celles des parties les plus sensibles, en particulier les organes génitaux. Infirmier au 9e Hussards au printemps 1957, Jacques soigne régulièrement des brûlures au deuxième degré sur les jambes et les bras des Algériens suppliciés46, mais, dans le cantonnement précédent du régiment, à Descartes, le secrétaire du médecin-chef a même vu arriver deux hommes encore plus gravement atteints : « L’un d’eux, assez âgé, parlant fort bien le français, avait la verge complètement rongée sur tout le pourtour. Il nous a indiqué que cela était dû à ce que le membre avait été enroulé autour d’un fil relié à un pôle de la batterie. D’autres brûlures au> chevilles témoignaient de l’application à cet endroi du second pôle. Le second beaucoup plus jeun* était brûlé aux mêmes endroits mais avec moins d( gravité47. » Dans l’entretien que nous avons eu avei lui, plus de quarante ans après, il évoque encor les sexes des hommes « comme des choux-fleurs » c’est-à-dire « boursouflés à chaque endroit où le électrodes avaient été posées ». Selon lui, ces « app< reils génitaux d’homme tuméfiés, marqués à jamai [étaient] incurable[s] [et] à partir de ce moment-là il (p.473) y a une espèce de fuite qui fait que l’aboutissement était la corvée de bois48 ». Les médecins voient ces gens et les soignent, car les tortionnaires n’en ont pas fini avec eux. Mais ils n’ont quasiment aucune possibilité d’imposer leur volonté. Leur intervention est cantonnée dans des lieux et dans un temps dictés par les autres militaires. Même quand ils soignent, les médecins participent encore à la machine torturante : qu’ils aident des futures victimes à se reconstituer ou qu’ils accélèrent la disparition des séquelles physiques des tortures, ils restent des auxiliaires. Finalement, c’est moins l’avenir des blessés qui conditionne l’action du corps médical que celui des bourreaux — des marques physiques pouvant constituer des preuves à charge. Une fois leurs corps lissés, comme on essuie les traces d’empreintes dans une demeure pillée, les victimes sont laissées à leurs angoisses phobiques, dépressions chroniques, cauchemars et autres séquelles psychiques, loin des médecins militaires.
(p.484) Rompant avec les usages habituels, le ministre clôt la lettre qu’il adresse au général Challe par des instructions qu’il lui dicte littéralement : que, « en ce qui concerne les arrestations, celles-ci s’opèrent strictement dans le cadre défini par la directive du général de Gaulle en date du 17 décembre 1958 [et que,] en ce qui concerne les méthodes d’interrogatoire, les procédés coercitifs tels que l’eau, l’électricité ou le palan soient rigoureusement prohibés3 ». Jamais aucun responsable de haut niveau n’avait admis . aussi clairement connaître les méthodes employées au cours de certains interrogatoires4. (…) Le général de Gaulle considère les directives de Pierre Guillaumat comme visant seulement à faire « cess[er] certaines erreurs » alors que ces « erreurs » sont moins l’exception que la règle dans de nombreux secteurs d’Algérie. De fait, sa volonté de réformer et de régulariser les procédures d’arrestation vise exactement les mêmes illégalités que la lettre de son ministre, car c’est bien un système qui est partiellement hors la loi de l’autre côté de la Méditerranée.
(p.569) La bienveillance des juges à l’égard des militaires fautifs continue jusqu’à la fin de la guerre, comme l’atteste le procès de trois officiers du 9e Zouaves accusés de coups et blessures ayant entraîné la mort d’une jeune femme. L’instruction a été extrêmement longue (la plainte a été déposée par son mari à la fin de mai 1960) et l’on a vraisemblablement cherché à la faire traîner jusqu’à la fin des hostilités23. Dès le mois de juillet 1960, pourtant, le président Patin, qui avait mené une enquête parallèle, tirait les conclusions suivantes : arrêtée de nuit avec d’autres femmes par l’officier de renseignement et ses hommes qui avaient décidé de lutter contre la propagande abstentionniste du FLN aux élections, Sadia Mebarek avait été retenue au poste alors que ses compagnes étaient relâchées. A 6 heures du matin, le cadavre de la jeune femme enceinte était ramené chez elle par une ambulance. Son corps portait des traces qui alertèrent sa famille. L’autopsie, quoique ordonnée plus de cinquante heures après le décès, permit de repérer « des lésions érythémateuses circonscrites sur le pourtour du mamelon droit et gauche », « des lésions du pubis et des grandes lèvres et de l’hyperpigmenta- tion des petites lèvres » ainsi que des ecchymoses sur les bras et une lésion annulaire de la cheville gauche. Selon les médecins légistes, ces lésions pouvaient «être en rapport avec des agressions diverses ». La jeune femme était morte d’une syncope cardiaque24 (p.570) Ce n’est pourtant qu’un an après que le renvoi de l’affaire en métropole est ordonné, et il faut attendre encore six mois pour que le procès ait lieu devant le TPFA de Paris. Les témoignages de l’interprète et de deux soldats ayant assisté à l’interrogatoire permettent d’établir que Sadia Mebarek a été battue puis soumise à la torture électrique, appliquée sur ses orteils, ses poignets, ses seins et son sexe. Ils désignent précisément le sous-lieutenant Blanié comme ayant tourné la manivelle et donné les coups les plus forts, tandis que le sous-lieutenant Sanchez n’aurait fait que maintenir la jeune femme. Le lieutenant Maindt, qui aurait en outre organisé les fausses dépositions de ses hommes devant la justice au début de l’enquête, participait aussi aux coups qui se sont abattus sur Sadia Mebarek25. Le débat a lieu à huis clos : le commissaire du gouvernement requiert une lourde peine mais, au bout de quarante minutes de délibération, le tribunal militaire prononce l’acquittement du lieutenant d’active et des deux sous-lieutenants de réserve26. Rejetant les motivations du pouvoir politique et ignorant la sensibilité de l’opinion publique à ce sujet, les juges militaires font preuve d’un esprit de corps éloigné de tout esprit de justice. Ils vont jusqu’au bout de la logique qui a fait user de la torture les officiers accusés : dans cette guerre, la fin justifie les moyens et les juges, qui servent aussi la guerre dans leurs tribunaux, le savent bien. Le commentaire de Casamayor pointe parfaitement cette réalité : « Accusés d’avoir torturé une femme jusqu’à ce que la mort s’ensuive, des hommes ont été acquittés. C’étaient des officiers. On peut imaginer que, pour les mêmes faits, des policiers auraient eu une peine avec sursis. De simples citoyens à part entière auraient été (p.571) condamnés à 5 ou 10 ans de détention, et des Arabes auraient été condamnés à mort27. » Effectivement, aux yeux de la justice militaire, soldats ou officiers semblent constituer des citoyens d’un genre particulier, que leur mission place au-dessus des lois. Alors que ce procès aurait pu être le procès expiatoire d’une guerre où la justice, jusqu’alors impossible à rendre, aurait été dite, l’acquittement proclame que l’armée — par la bouche de la justice militaire et du TPFA de Paris — n’entend pas endosser la responsabilité des exactions commises pendant la guerre, dont elle tient in fine le pouvoir politique pour responsable. Refusant de conclure à la culpabilité des acteurs directs, les juges pointent la spécificité des violences illégales commises en service commandé. Dans cette guerre, l’exigence de justice semble intenable car elle conduit nécessairement à poser la question des responsabilités respectives des parties engagées dans la guerre. (p.585) La torture, ce crime par obéissance commis par des soldats de la République, est effacée par l’amnistie du 22 mars 1962, qui scelle définitivement la porte du passé. Grâce à elle, l’État sort juridiquement blanchi. Mais c’est au détriment des victimes comme des citoyens en général : le décret englobe en effet tous les militaires ayant participé à la guerre dans une même totalité. Or, puisque aucun coupable n’est nommé, puisque aucun coupable n’est connu et que l’amnistie touche des faits qui n’ont pas été dits, chacun pourrait les avoir commis… ou non. Contrairement à ceux qui, bénéficiant des amnisties postérieures — les déserteurs, les membres de l’OAS, les généraux putschistes —, sont exclus de la cité un guerre un temps, avant d’y être réintégrés, les soldats français ont toujours été dans la cité et à son service. Ce titre suffit à ce qu’ils soient finalement concernés par l’amnistie puisque celle-ci interdit de nommer précisément victimes et coupables. Elle laisse les familles des soldats hantées par des fantômes, nés du silence des uns et des questions non posées des autres.
(p.600) Un an après, le 14 juin 2000, les députés durent encore affronter ces questions, posées cette fois par un Algérien : le président Abdelaziz Bouteflika. Celui qui s’engageait au même moment dans une réhabilitation en forme de récupération de certains fondateurs du nationalisme algérien, jusqu’alors exclus de l’histoire officielle, appella les représentants de la nation française à continuer les « examens de conscience les plus intrépides ». Après avoir accordé un satisfecit à la France, il l’engageait en effet à mettre à plat l’histoire sans ignorer « le fait colonial » C’est alors que le débat sur la torture pendant la guerre émergea, adossé à ce contexte et suscité par la publication en première page du journal Le Monde du récit des tortures subies par Louisette Ighilahriz à Alger en 1957. Pourtant, en dépit de ce double point de départ, les principales victimes de la guerre furent globalement absentes les semaines puis les mois qui suivirent, laissant les Français s’interpeller entre eux.
L’automne 2000 offrit un concentré des difficultés que posait l’évocation des aspects les plus douloureux de cette guerre dans le champ public français. Ce fut aussi l’occasion pour douze anciens acteurs de l’opposition à la guerre de demander à l’État de tirer les conséquences politiques de la loi du 10 juin 1999, en « condamnfant] la torture qui a été entreprise [au nom de la France] durant la guerre d’Algérie26 ». La réponse du Premier ministre, Lionel Jospin, fut aussi rapide que décalée face à ses attentes : il déplora l’usage de la torture pendant cette période et indiqua qu’il préférait le travail des historiens à toute autre forme d’enquête, judiciaire ou parlementaire.
(p.601) De fait, il refusait de reconnaître la responsabilité des autorités de l’époque, arguant que l’État n était pas mis en cause dans cette affaire et que les actes de torture avaient été « minoritaires ». Le chef de l’État, Jacques Chirac, ancien d’Algérie lui-même, lui fit écho quelques semaines plus tard en rappelant les mérites de l’armée française pendant cette guerre. Six mois après, il précisait dans un communiqué qu’il condamnait « les atrocités, les actes de torture, les exécutions sommaires et les assassinats qui ont pu être commis pendant la guerre d’Algérie » et appelait de ses vœux une mise en lumière par les historiens des « responsabilités » tout en saluant « les millions de jeunes Français, d’origine algérienne ou métropolitaine, qui se sont battus avec courage et honneur27 ».
(p.603) Impliquer l’État est essentiel. Il fut un acteur 7 fondamental de la guerre. Pour autant, si sortir du singulier et des accusations ad hominem permet d’éviter le cantonnement de la question à des minorités violentes qui placerait l’État au-dessus de tout soupçon, ce mouvement vers le collectif doit être complexifié. L’État n’est pas la seule structure collective à interroger : l’armée, les partis politiques, les syndicats, les Églises, les différentes composantes de l’opinion publique, etc., sont autant de groupes dont les actions et les positions doivent être considérées. Complexifier le déplacement du singulier au collectif, c’est aussi faire en sorte que ce mouvement englobant ne fonctionne pas comme un transfert de responsabilités et que la part de liberté de chacun soit conservée, même dans ce qu’elle a de plus déplaisant.
|
|
2002 |
Algérie / La marche du Siècle, LS 12/02/1992
30 ans après être appelés de l’Algérie: des témoins ont parlé de la ‘gègène’.
|
|
2002 |
G.P., Plongée dans l’enfer algérien, LB 04/03/2002
« L’ennemi intime » (Patrick Rotman) : soldats et officiers français racontent la torture ordinaire pendant la Guerre d’Algérie. (France3) « Pour autant d’exécutants de ces atrocités, pourquoi aussi peu de résistants, par rébellion ou désertion ? »
|
|
2003 |
Marc Ferro, éd., Le livre noir du colonialisme, éd. Robert Laffont, 2003 (p.13-14) /Algérie/
La Paix des Nementchas14
Serait-il possible que six mois de tortures vues, entendues, acceptées, voire exercées, serait-il possible que ces visions d’Afrique d’un genre nouveau n’alimentent pas les cauchemars de nos nuits de France ? À Chéria, dans les postes du GMPR, un suspect, ligoté, couché dans la poussière, en plein midi, au soleil de juillet. Il est nu, enduit de confiture. Les mouches bourdonnent, jettent des éclairs verts et dorés, s’agitent voracement sur la chair offerte. Les yeux fous disent la souffrance. Le sous-officier européen en a marre ! « S’il n’a pas parlé dans une heure, je vais chercher un essaim d’abeilles. » À Guentis, quatre gendarmes tiennent garnison avec nous. Ils occupent un gourbi de l’ancien hameau et y interrogent les suspects cueillis dans la montagne. Peu de temps après notre arrivée, un gendarme rend visite à l’électricien de la compagnie, lui demande deux morceaux de fil téléphonique. Le camarade propose de faire la réparation lui-même et, intrigué par le refus du gendarme, le suit, assiste à l’interrogatoire, revient horrifié. Le suspect est ligoté sur une table avec des chaînes, garnies de chiffons mouillés, auxquelles on fixe les électrodes. Un gendarme tourne la manivelle du téléphone de campagne ; il fait varier l’intensité de la décharge en changeant le rythme de son mouvement ; il sait que les variations d’intensité sont particulièrement douloureuses ; il raffine, il fignole, il est à son affaire. Le supplicié hurle, se tord dans ses liens, a des soubresauts de pantin burlesque, des convulsions désespérées d’agonisant. « Tu parleras, salopard ? Tu parleras ? » Les électrodes se fixent aussi bien aux tempes, sous la langue, au sexe ou à toute autre partie sensible du corps humain. Des piles ou une génératrice peuvent remplacer la dynamo du téléphone. Le supplice ne laisse pratiquement aucune trace. Il procure à ceux qui y assistent sans préjugés moraux un plaisir d’ordre sexuel d’une qualité rare. La France a-t-elle encore des préjugés moraux ? Les gendarmes de Guentis en avaient-ils ? Entre les siestes, les parties de bridge, les lectures érotico-policières, les tournées d’anisette au foyer, les repas chargés et les discussions vantardes, ils exerçaient la surabondante énergie de leurs grands corps adipeux sur les minables constitutions des fellahs sous-alimentés du canton. Je me souviens du jour où la compagnie, d’une patrouille matinale, ramena deux Algériens, rencontrés dans la steppe, que le capitaine, je ne sais pourquoi, avait trouvés suspects. Ils s’en occupèrent aussitôt, sans même prendre la peine de préparer « l’électricité ». Poings velus armés de lourdes chevalières, avant-bras charnus, pieds chaussés de Pataugas : ils visaient le bas-ventre, le foie, l’estomac, le visage. Quand le sang coula, quand le sol du gourbi en fut trempé, les malheureux, agenouillés, durent lécher le temble mélange de leur propre terre et de leur propre substance. C’est dans cette position qu’ils reçurent, pour terminer (les tortionnaires étaient en nage), un grand coup de pied en pleine figure. On leur fit pendant une heure encore déplacer d’énormes pierres sans autre but que de les épuiser et d’aggraver les saignements. Et le soir même ils furent libérés. 14. Robert Bonnaud, Paris, Esprit, avril 1957, p. 581-583. (NDLR.) (p.14) Histoire absurde, sadisme gratuit ? Non. Dans ce pays, l’énorme majorité des suspects, et aussi de ceux qui ne le sont pas, aident réellement les patriotes, ne serait-ce que par leur silence. On ne court pas grand risque, par des tortures ou des brimades intempestives, de se mettre à dos la population : le peuple algérien a perdu confiance en notre faux libéralisme et nos promesses menteuses. Les gendarmes de Guentis, comme tous les pacificateurs de quelque expérience, partaient du point de vue qu’on ne saurait être algérien innocemment. Le déchaînement de brutalité perverse dont ils nous donnaient l’exemple, exemple parfois suivi, hélas, dérivait de cette constatation élémentaire, de l’exaspération aussi et du sentiment d’impuissance. Il faut savoir ce que l’on veut. Le maintien de notre domination a exigé, exige, exigera des tortures de plus en plus épouvantables, des exactions de plus en plus générales, des tueries de plus en plus indistinctes — il n’y a pas d’Algérien innocent du désir de dignité humaine, du désir d’émancipation collective, du désir de liberté nationale. Il n’y a pas de dieu suspect arrêté à tort et torturé par erreur. Ces deux Algériens de Guentis dont je parlais tout à l’heure, tellement silencieux et tellement pitoyables avec leur démarche chancelante, leur visage ensanglanté, les accoutrements bizarres (l’un portait un sarouel rouge vif que nos yeux perçurent longtemps dans le poudroiement jaune de la steppe), ces deux misérables devaient bien avoir quelque relation avec les patriotes des djebels, puisque, la nuit qui suivit leur aventure, le bordj fut harcelé par le tir des Statti, sanction habituelle de nos écarts de conduite. Dans ces conditions, les mieux intentionnés et les plus naïvement pacificateurs glissent très vite sur la pente de l’immoralisme répressif. J’ai vu des officiers s’initier au tabassage et, empruntés au début, devenir d’excellents auxiliaires es tortures ; d’autres, qui en avaient déjà le goût, comme ce forcené, lieutenant du bataillon de Corée, qui commanda quelque temps une compagnie en poste dans la montagne, se réserver l’interrogatoire des suspects, c’est-à-dire des Algériens quelconques, parfaitement en règle souvent, rencontrés au hasard des patrouilles. J’ai vu des soldats, saisis d’émulation, encouragés par les gendarmes, frapper eux aussi, garder trois jours la main enflée, recommencer à la première occasion. Et qui s’étonnait à Chéria de la baignoire du GMPR dans laquelle on mettait d’abord le suspect, ensuite l’électricité ? Qui s’étonnait des ongles arrachés et du gonflage à l’eau ? Qui ignorait qu’à Tébessa, dans les salles de police où on interrogeait, les portes étaient, vers le bas, d’une étrange tonalité grenat sombre, parce que, la peinture partie, le sang des malheureux avait imprégné le bois, ineffaçablement ? Que les victimes de ces horreurs soient favorables aux rebelles, que les rebelles tuent et supplicient éventuellement des civils français, est-ce une bonne raison ? Car précisément celui qui a commencé, celui qui a imposé à l’Algérie cette guerre civile, celui qui le premier a torturé et massacré des non-combattants, qui est-ce, sinon l’envahisseur colonial, sinon le mainteneur de l’ordre colonial ? « La faute originelle de la colonisation a précédé toutes les agressions unilatérales des indigènes », écrivait Paul Ricœur dans Réforme dès 1947.
|
|
2003 |
Marc Ferro, éd., Le livre noir du colonialisme, éd. Robert Laffont, 2003
(p.30) (…) à part quelques spécialistes, quelle idée de vouloir s’intéresser à la société autochtone… En Inde, « il était ridicule, ce Strickland, qui voulait en savoir plus sur les habitants de ce pays et portait ses explorations en pleine fripouille indigène52 ». C’est bien aussi ce que pensaient les jeunes élèves de l’auteur, au lycée Lamoricière d’Oran, en 1948 : quand il leur dit qu’après les grandes invasions du Moyen Âge on étudierait la civilisation arabe, il déclencha un immense éclat de rire… « Mais, m’sieu, les Arabes, ils ne sont pas civilisés. » Quand on est soi-même sans culture, comment concevoir que ceux qu’on domine puissent être civilisés ?… |
|
2003 |
Marc Ferro, éd., Le livre noir du colonialisme, éd. Robert Laffont, 2003
/La conquête de l’Algérie/
(p.491) En s’inscrivant contre la traite, l’esclavage et la piraterie, la conquête de l’Algérie se place dans un colonialisme de deuxième type, celui qui préfigure sa « vocation civilisatrice ». Quand, vers 1802, Bonaparte imagine une première expédition, il juge que les Barbaresques déshonorent l’Occident par leurs pratiques — lui qui vient de rétablir l’esclavage à Saint-Domingue. Autre donnée, l’idée, qui date d’avant la Révolution française, que l’Empire turc est un « homme malade » et que l’heure est venue d’en dépecer les morceaux : conquérir l’Egypte ou l’Algérie, tel est le dilemme. (p.491) La morale de sa pratique, c’est… Victor Hugo qui la définit : « Deux partis à prendre : civiliser la population, coloniser le sol… Civiliser la population ? Je veux bien, mais quelle affaire… Ce n’est pas seulement fondre deux peuples, c’est fondre deux races […] c’est rapprocher des siècles ; d’une part, chez nous le XIXe siècle, celui de la presse libre et de la pleine civilisation ; d’autre part, chez eux, le siècle pastoral et patriarcal, homérique et biblique. Quel triple abîme à franchir… Ces hommes-là se ressemblent-ils autrement devant Dieu? […] Dans la vie, ils se repoussent et s’excluent, et l’un chasse l’autre. Donc, coloniser le sol… Alors, dira-t-on, il faut bien être un peu barbare parmi ces sauvages […]. La barbarie est en Afrique, je le sais […]. Nous ne devons pas l’y prendre, nous devons la détruire. Nous ne sommes pas venus ici pour rapporter l’Afrique mais pour y apporter l’Europe1. » À l’heure où Hugo était royaliste, les généraux répondent : « Nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes ; l’ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux ; dans l’armée, il n’y a pas cinq tués et quarante blessés. » En 1841, Tocqueville, ce grand notable, concluait d’un voyage d’enquête en Algérie : « Nous faisons la guerre de façon beaucoup plus barbare que les Arabes eux-mêmes […] c’est, quant à présent, de leur côté que la civilisation se 1. Reliquat, 1847.
(p.492) rencontre. » Le colonel de Montagnac écrivait d’ailleurs en 1843 : « II faut anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. » En 1845, le général Pélissier enfuma un millier d’Arabes dans une grotte du Dahra. Ces méthodes excitent les soldats à qui Bugeaud impose une discipline de fer. Mais en échange, après la victoire, il les laisse piller, violer — s’amuser, quoi. Il est toujours au milieu d’eux, au cœur des batailles, d’où sa popularité et le célèbre refrain : « L’as-tu vue, la casquette, la casquette, l’as-tu vue, la casquette du père Bugeaud ? » (p.499) Après Sétif, en 1945, et le comportement ambigu des communistes5, le dernier espoir de ceux qui avaient foi en la France résidait en la prise du pouvoir par la gauche. Or, il n’y eut jamais plus de truquages que lors des élections de 1947, « à la Naegelen », qui devaient donner un nouveau statut de l’Algérie : elles s’accompagnèrent de provocations, d’humiliations, de violence… L’« humanitarisme » au service du colonialismeDans une communication au colloque de Newcastle sur la colonisation (avril 2002), Bertrand Taithe, de l’université de Manchester, a analysé la réaction des autorités françaises aux calamités que l’Algérie a connues : sécheresse de 1866, tremblement de terre de 1867, famines et épidémies qui ont suivi. Il y aurait eu entre 130 000 et 450 000 victimes dans le Constantinois pour une population d’environ 1,4 million d’habitants en 1861. A cette date, cette région se prouvait sous un régime géré par des militaires plus que par les civils et il ne manqua pas de bonnes âmes pour juger que les populations étaient vouées à une inéluctable extinction. Leur impuissance à combattre ces fléaux ne témoignait-elle pas de leur inculture, de leur arriération… Un article satirique dans Le Figaro du 18 mai 1868 attacha le grelot : cinq colons auraient été victimes du cannibalisme indigène. De fait, il y avait eu là une erreur de frappe : — on avait voulu les tuer, ils avaient été manques (pas mangés). Mais l’incident ouvrit le dossier de la violence indigène, des meurtres commis, des pratiques de vendetta, etc., de l’impossibilité d’« assimiler ces sauvages », comme avait pu l’imaginer la politique de Napoléon III. Dans les faits, l’armée ne disposait pas de moyens suffisants pour sauver les populations, qui ne pouvaient compter que sur les réseaux de charité musulmane, insuffisants eux aussi. 4. Pour les autres figures du racisme colonialiste, voir notre introduction et l’article de Catherine Coquery-Vidrovitch, « Le postulat de la supériorité blanche et de l’infériorité noire ». 5. Cf. l’article suivant.
(p.500) Pour mettre fin à la misère, pour sauver le pays, il fallait ques les colons prennent la situation en main, se saisissent de la terre, mettent fin au régime militaire — ce que préconisaient les libéraux, tels Prévost-Paradol, Emile Olli-vier ; il fallait franciser les pratiques, christianiser le pays. Au nom de l’humanitarisme, on déplaça des populations vers des lieux de regroupement. La prolétarisation de la population était ainsi en marche. Au mythe d’une population langoureuse, qu’incarnaient les bains turcs et la débauche, succéda celui d’un pays sauvage, ainsi « africanisé », vidé, qu’il fallait sauver en l’occupant ; mais en l’occupant vraiment.
|
|
2003 |
Marc Ferro, éd., Le livre noir du colonialisme, éd. Robert Laffont, 2003
En Algérie : du colonialisme à la veille de l’insurrection par Marc Ferro
L’héritage de Vichy
(p.506) En 1948, à Oran, au lendemain des élections, on pouvait encore lire sur les panneaux électoraux de la ville : « Voter de Saivre, c’est voter Pétain ». À cette date, en métropole, on eût jugé qu’il s’agissait d’une de ces formules dont les communistes étaient familiers pour discréditer leurs adversaires politiques. En Algérie, nenni. C’était le slogan choisi par Roger de Saivre lui-même, un des anciens proches de Pétain chargé entre autres de sélectionner ceux qui méritaient de porter la francisque. Or de Saivre obtint plus de 20 % des voix au premier collège, celui des Européens. Ainsi, le régime de Vichy était demeuré populaire, cinq ans après le débarquement de novembre 1942 puis l’installation à Alger du GPRF (Gouvernement provisoire de la République française, présidé par de Gaulle), quatre ans après la libération de Paris et la restauration des institutions républicaines. Il est vrai que le régime de Vichy avait fait les belles heures des Français d’Algérie. Tout en s’étant montré, en métropole, plus intransigeant vis-à-vis des Allemands que ne l’étaient Pétain, Laval ou Darlan, le général Weygand avait appliqué en Algérie les lois de la révolution nationale avec la rigueur la plus extrême, à rencontre des juifs notamment. Quant aux indigènes, le régime avait flatté leurs traditions, certes, comme un folklore, mais, sur l’essentiel, les Européens se sentaient renforcés dès lors qu’étaient écartées les velléités de l’époque de Blum et de Violette de promouvoir des mesures qui visaient à l’émancipation politique des musulmans. Les obstacles que les autorités gaullistes rencontrèrent en 1943-1944 pour abolir les lois de Vichy, par exemple le retard à libérer des camps les internés, communistes, ou même gaullistes, témoignent de la résistance des colons à ce retour aux institutions républicaines, de la solidarité qu’ils entretenaient avec les fonctionnaires demeurés en place. (p.555) Le coût humain de la guerre d’Algérie Les données chiffrées qui ne sont pas sujettes à contestation concernent les colonisateurs. 1) Les pertes de l’armée française : 15 580 morts jusqu’au 19 mars 1962 ; 9031 morts «accidentellement» dans la même période; 2056morts dans la Légion étrangère ; 1 000 disparus (environ) ; 1 277 morts des suites de leurs blessures. Total : 28 944. L’armée admet qu’il y aurait eu à peu près 500 déserteurs, chiffre que certains jugent trop faible. La proportion étonnamment élevée des « accidents » mortels n’a pas reçu d’explication satisfaisante. 2) Les morts civils européens, toujours au 19 mars 1962, auraient été au nombre de 2 788, plus quelque 857 disparus. L’OAS a à son bilan 2 360 assassinats et 5 419 blessés, dont une écrasante majorité d’Algériens. 3) Les pertes algériennes sont beaucoup plus difficiles à chiffrer. Il faut d’abord mentionner 8 000 villages incendiés et détruits et un million d’hectares de forêts incendiées. L’armée française admet avoir tué 141 000 combattants FLN, et affirme que 69 000 « musulmans » auraient été éliminés par le FLN. Une donnée plus sûre est que 2,137 millions d’Algériens et Algériennes ont été déportés dans des camps dits de regroupement, sur environ 8 millions d’Algériens en 1954. Quant au nombre de morts parmi la population algérienne : tombés au combat, prisonniers de guerre « abattus », suspects ou simples villageois pris dans (p.556) le déchaînement de la fureur guerrière, les historiens hésitent entre 200 000 — un minimum — et 500 000, ce qui est plus vraisemblable. Mentionnons que le ministère algérien des Anciens Combattants avait recensé 336 000 combattants et combattantes de la libération en vue de l’attribution de la carte de combattant aux survivants ou aux ayants droit des morts. Y. B.
|
|
2005 |
Algérie / ARTE – 20.45 Les mercredis de l’histoire (s.d.) – Les massacres de Sétif: un certain 8 mai 1945
Documentaire réalisé par Mehdi Lallaoui et Bernard Langlois Le 8 mai 1945, Liesse chez les Alliés.
A Sétif, parmi les drapeaux qui fleurissent les cortèges, apparaissent pour la première fois le drapeau algérien et des banderoles revendiquant l’indépendance. La police française abat le porte-drapeau. La manifestation pacifique se transforme en émeute et en quelques heures, l’insurrection va gagner toute la région de Constantinople. S’ensuivra une répression aveugle et atroce, on parle de 10.000 morts.
(Sans l’émission:) On parle de 35.000, voire 50.000 morts en quelques jours. Hommes, femmes et enfants, les soldats français massacraient tout le monde … Nombre de victimes furent envoyées dans un four à chaux… On a parlé de génocide.
|
|
2005 |
http://membres.lycos.fr/troubles/francalg.htm La France et l’Algérie face à leur guerre DÉCLARATION SUR LE DROIT Ã L’INSOUMISSION DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE (dite « des 121 » – septembre 1960)
Un mouvement très important se développe en France, et il est nécessaire que l’opinion française et internationale en soit mieux informée, au moment où le nouveau tournant de la guerre d’Algérie doit nous conduire à voir, non à oublier, la profondeur de la crise qui s’est ouverte il y a six ans. De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour s’être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Dénaturées par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui auraient le devoir de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est pourtant insuffisant de dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable. Protestation d’hommes atteintes dans leur honneur et dans la juste idée qu’ils se font de la vérité, elle a une signification qui dépasse les circonstances dans lesquelles elle s’est affirmée et qu’il importe de ressaisir, quelle que soit l’issue des événements. Pour les Algériens, la lutte, poursuivie soit par des moyens militaires, soit par des moyens diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C’est une guerre d’indépendance nationale. Mais pour les Français, quelle en est la nature ? Ce n’est pas une guerre étrangère. Jamais le territoire de la France n’a été menacé. Il y a plus : elle est menée contre des hommes que l’Etat affecte de considérer comme Français, mais qui, eux, luttent précisément pour cesser de l’être.. Il ne suffirait même pas de dire qu’il s’agit d’une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par surcroît de racisme. Il y a de cela dans toute guerre, et l’équivoque persiste. En fait, par une décision qui constituait un abus fondamental, l’Etat a d’abord mobilisé des classes entières de citoyens à seuls fin d’accomplir ce qu’il désignait lui-même comme une besogne de police contre une population opprimée, laquelle ne s’est révoltée que par un souci de dignité élémentaire, puisqu’elle exige enfin d’être reconnue comme communauté indépendante. Ni guerre de conquête, ni guerre de « défense nationale », ni guerre civile, la guerre d’Algérie est peu à peu devenue une action propre à l’armée et à une caste qui refusent de céder devant un soulèvement dont même le pouvoir civil, se rendant compte de l’effondrement général des empires coloniaux, semble prêt à reconnaître le sens. C’est, aujourd’hui, principalement la volonté de l’armée qui entretient ce combat criminel et absurde, et cette armée, par le rôle politique que plusieurs de ses hauts représentants lui font jouer, agissant parfois ouvertement et violemment en dehors de toute légalité, trahissant les fins que l’ensemble du pays lui confie, compromet et risque de pervertir la nation même, en forçant les citoyens sous ses ordres à se faire les complices d’une action factieuse ou abilissante. Faut-il rappeler que, quinze ans après la destruction de l’ordre hitlérien, le militarisme français, par suite des exigences d’une telle guerre, est parvenu à restaurer la torture et à en faire à nouveau comme une institution en Europe ? C’est dans ces conditions que beaucoup de Français en sont venus à remettre en cause le sens de valeurs et d’obligations traditionnelles. Qu’est-ce que le civisme lorsque, dans certaines circonstances, il devient soumission honteuse ? N’y-a-t-il pas des cas où le refus de servir est un devoir sacré, où la « trahison » signifie le respect courageux du vrai ? Et lorsque, par la volonté de ceux qui l’utilisent comme instrument de domination raciste ou idéologique, l’armée s’affirme en état de révolte ouverte ou latente contre les institutions démocratiques, la révolte contre l’armée ne prend-elle pas un sens nouveau ? Le cas de conscience s’est trouvé posé dès le début de la guerre. Celle-ci se prolongeant, il est normal que ce cas de conscience se sont résolu concrètement par des actes toujours plus nombreux d’insoumission, de désertion, aussi bien que de protection et d’aide aux combattants algériens. Mouvements libres qui se sont développés en marge de tous les partis officiels, sans leur aide et, à la fin, malgré leur désaveu. Encore une fois, en dehors des cadres et des mots d’ordre préétablis, une résistance est née, par une prise de conscience spontanée, cherchant et inventant des formes d’action et des moyens de lutte en rapport avec une situation nouvelle dont les groupements politiques et les journaux d’opinion se sont entendus, soit par inertie ou timidité doctrinale, soit par préjugés nationalistes ou moraux, à ne pas reconnaître le sens et les exigences véritables. Les soussignés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes qu’il est désormais impossible de présenter comme des faits divers de l’aventure individuelle; considérant qu’eux-mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d’intervenir, non pas pour donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des problèmes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser prendre à l’équivoque des mots et des valeurs, déclarent :
Arthur Adamov, Robert Antelme, Michel Arnaud, Georges Auclair, Jean Baby, Hélène Balfet, Marc Barbut, Robert Barrat, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bédouin, Marc Begbeider, Robert Benayoun, Yves Berger, Maurice Blanchot, Roger Blin, Dr Bloch-Laroque, Arsène Bonnafous-Murat, Geneviève Bonnefoi, Raymond Borde, Jean-Louis Bory, Jacques-Laurent Bost, Pierre Boulez, Vincent Bounoure, André Breton, Michel Butor, Guy Cabanel, François Chatelet, Simone Collinet, Georges Condaminas, Michel Crouzet, Alain Cuny, Jean Czarnecki, Dr Jean Dalsace, Hubert Damisch, Adrien Dax, Jean Delmas, Danièle Delorme, Solange Deyon, Jacques Doniol Valcroze, Bernard Dort, Jean Douassot, Simone Dreyfus, René Dumont, Marguerite Duras, Françoise d’Eaubonne, Yves Elléquet, Dominique Eluard, Escaro, Charles Eestienne, Jean-Louis Faure, Dominique Fernandez, Jean Ferry, Louis-René des Forêts, Rd Théodore Fraenkel, Bernard Franck, André Gernet, Louis Gernet, Edouard Glissant, Georges Goldfayn, Christiane Gremillon, Anne Guérin, Daniel Guérin, Jacques Howlett, Edouard Jaguer, Pierre Jaouen, Gérard Jarlot, Robert Jaulin, Alain Joubert, Pierre Kast, Henri Kréa, Serge Laforie, Robert Lagarde, Monique Lange, Claude Lanzmann, Robert Lapoujade, Henri Lefebvre, Gérard Legrand, René Leibowitz, Michel Leiris, Paul Lévy, Jérome Lindon, Eric Losfeld, Robert Louzon, Olivier de Magny, Florence Malraux, André Mandouze, Maud Mannoni, Jacqueline Marchand, Jean Martin, Renée Marcel-Martinet, Jean-Daniel Martinet, Andrée Marty-Capgras, Dionys Mascolo, François Maspero, André Masson, Pierre de Massot, Marie-Thérèse Maugis, Jean-Jacques Mayoux, Jehan Mayoux, Andrée Michel, Théodore Monod, Marie Moscovici, Georges Mounin, Maurice Nadeau, Georges Navel, Claude Ollier, Jacques Panuel, Hélène Parmelin, Marcel Péju, Jean-Claude Pichon, José Pierre, André Pieyre de Mandiargues, Roger Pigault, Edouard Pignon, Bernard Pingaud, Maurice Pons, J.-B. Pontalis, Jean Pouillon, Madeleine Rebérioux, Paul Rebeyrolle, Denise René, Alain Resnais, Jean-François Revel, Paul Revel, Evelyne Rey, Alain Robbe-Grillet, Christiane Rochefort, Maxime Rodinson, Jacques-Francis Rolland, Alfred Rosmer, Gilbert Rouget, Claude Roy, Françoise Sagan, Marc Saint-Saëns, Jean-Jacques Salomon, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre, Renée Saurel, Claude Sautet, Catherine Sauvage, Lucien Scheler, Jean Schuster, Robert Scipion, Louis Seguin, Geneviève Serreau, Simone Signoret, Jean-Claude Silbermann, Claude Simon, Siné, René de Solier, D. de la Souchère, Roger Tailleur, Laurent Terzieff, Jean Thiercelin, Paul-Louis Thirard, Tim, Andrée Tournès, Geneviève Tremouille, François Truffaut, Tristan Tzara, Vercors, J.-P. Vernant, Pierre Vidal-Naquet, J.-P. Vielfaure, Anne-Marie de Vilaine, Charles Vildrac, Claude Viseux, François Wahl, Ylipe, René Zazzo
THÉODORE MONOD : POURQUOI J’AI SIGNÉ LE MANIFESTE DES 121 (Afrique Nouvelle, 23 novembre 1960, et « Les carnets de Théodore Monod, Le Pré aux Clercs, 1997)
Bien que fonctionnaire, je persiste, à tort ou à raison, à me considérer comme un homme libre. D’ailleurs, si j’ai vendu à l’Etat une certaine part de mon activité cérébrale, je ne lui ai livré ni mon coeur ni mon âme. Si puissant soit-il, César s’arrête au seuil du sanctuaire, où règne un beaucoup plus grand que lui, et auquel l’Ecriture nous prescrit d’obéir plutôt qu’aux hommes… À dire vrai, ce n’est pas à la question du refus de participer à une guerre inique que j’ai, en signant le manifeste des 121, attaché le plus d’importance : il s’agissait de cela, bien sûr, et il était salutaire que les puissants du jour -et d’un jour- se vissent rappeler que, si le Pouvoir veut être respecté, il lui faut, d’abord, se montrer respectable. Je voyais dans le document global une expression nouvelle, très forte et très nécessaire, de l’indignation, de la honte et de la douleur dont nos coeurs, désormais, débordent. Il y en a trop… On n’en peut plus… Et s’il ne nous reste que nos cris et nos larmes, eh bien, qu’on crie, et qu’on pleure un bon coup : cela soulagera, et puis, qui sait si ce spectacle inaccoutumé d’hommes respectables sortant de leur paisible retraite pour s’offrir à la réprobation des bien-pensants et, certains, aux persécutions, ne sera pas capable de réveiller, sous la cendre, des consciences assoupies et rassurées, l’étincelle qui va ranimer la flamme ? Et pourquoi hésiterait-on à crier sa révolte ? Un gouvernement qui couvre systématiquement les tortionnaires -quand il ne les récompense pas par des décorations et des galons- est un gouvernement qui se déshonore et a perdu par là même le pouvoir d’exiger l’approbation de nos consciences. Si les larmes d’un enfant sont plus précieuses que tout l’or du monde, qu’eût dit Dostoïevski de la fillette rendue folle par le bombardement français -et chrétien- des environs de Souk-Ahras, et qui vit, depuis, attachée à un piquet comme une bête ? Lequel de nos seigneurs et maîtres lui rendra ses larmes et sa raison ? On commence par mépriser, et puis, un beau jour, on tue, enfants compris pour faire bonne mesure, avec une parfaite bonne conscience et la patriotique certitude d’avoir louablement travaillé pour l’Occident et, pour un peu, pour le christianisme… Car ce n’est pas là une plaisanterie : ils en sont là… et sont prêts à prêcher la croisade, au napalm. Et l’on voudrait obtenir, au besoin imposer, voire acheter, notre silence ? De qui se moque-t-on ? J’ai donc signé le fameux manifeste, non sans avoir d’ailleurs au préalable suggéré quelques modifications de détail, dont il n’a pas pu être tenu compte. Je faisais remarquer, par exemple, qu’il était inexact d’affirmer que c’est l’armée qui a inventé la torture en Algérie. Cette honteuse priorité revient, indubitablement, à la police et l’on n’a pas oublié la question fameuse : « Y a t-il une Gestapo française en Algérie ? » qui n’a jamais reçu, et pour cause, de démenti officiel. Il s’agissait, avant tout, non pas tant d’insister sur tel ou tel aspect de la résistance à la guerre d’Algérie que d’appuyer une tentative qui pourrait, por beaucoup d’esprits et de consciences, constituer une chose salutaire et l’occasion -enfin- d’un réveil. En 1767, le prince de Beauvau, coupable, aux yeux du roi, d’avoir manifesté une indignation exagérée devant l’injustice faite aux prisonnières de la tour de Constance, est menacé par le ministre de se voir révoqué de ses fonctions de gouverneur du Languedoc. Mais le fonctionnaire était un homme et un homme libre. Aussi sa réponse fut-elle que « le roi était maître de lui ôter le commandement que Sa Majesté avait bien voulu lui confier; mais non de l’empêcher d’en remplir les devoirs selon sa conscience et son honneur ». Ces mots de conscience et d’honneur ont-ils rien perdu, cent quatre-vingt-treize ans plus tard, de leur actualité, de leur force et de leur signification, quand d’autres ministres s’emploient à réprimer d’autres révoltes du coeur et de l’esprit ?
Paris, 17 octobre 1961APPEL DU COLLECTIF UNITAIRE 17 OCTOBRE 1961 – 17 OCTOBRE 2001
Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs algériens et leur famille manifestaient pacifiquement à Paris contre le couvre-feu raciste qui leur était imposé. Ils défendaient leur droit à l’égalité, leur droit à l’indépendance et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce jour-là et les jours qui suivirent des centaines de manifestants furent tués par des policiers aux ordres de leurs supérieurs. A l’occasion du quarantième anniversaire, nous appelons à une grande manifestation le 17 octobre 2001, à Paris et dans toute la France, pour commémorer ce tragique événement. Nous demandons : – La reconnaissance officielle de ce crime contre l’humanité ; – Le libre accès aux archives pouvant aider à écrire l’histoire de cette guerre coloniale et en particulier de cette journée du 17 octobre 1961 ; – L’introduction et l’étude de ces événements dans les programmes et les manuels scolaires; – La création d’un lieu du souvenir à la mémoire des victimes; Les organisations suivantes ont d’ores et déjà signé cet appel:Alternative Libertaire ; Association 17 octobre 1961 contre loubli ; Association pour la Démocratie à Nice ; Association Républicaine des Anciens Combattants et victimes de guerre ; ATMF ; CEDETIM ; CIMADE ; Comité national des chômeurs CGT ; DROIT au logement ; Droits devant ; Droit Solidarité ; FIDH, Fédération de Paris du Parti socialiste ; la FTCR ; France Libertés ; la Fédération Syndicale Etudiante ; la FSU ; Institut Mehdi Ben Barka mémoire vivante ; LCR ; LDH ; LO ; Mémoire, Vérité, Justice sur les assassinats politiques en France ; MRAP ; Observatoire des libertés publiques ; Parti communiste ; Pionniers de France ; SGEN-CFDT ; SUD-PTT ; Les Verts(Reuters 1.12, 3.12, Jeune Indépendant 4.12) D’anciens militants du FLN ont dénoncé le silence qui prévaut en Algérie à propos du débat en France, sur la torture et les exactions dont l’armée française s’est rendue coupable pendant la Guerre d’Algérie. Ces militants, dont Louiza Ighil Ahriz et Noui M’Hidi Abdelkader, exigent l’accès aux archives du FLN pour faciliter le travail des historiens. Alors que le débat fait rage en France, et implique les autorités gouvernementales, les autorités algériennes restent silencieuses. Louiza Ighil Ahriz dénonce « le mutisme condamnable des officiels algériens, à commencer par le ministère des moudjahidines, sur un débat qui interpelle toute la société algérienne ». Pour Louiza Ighil Ahriz, « les officiers français ont été rattrapés par l’histoire », mais il s’agit aussi, pour les Algériens, de « défendre l’honneur de l’Algérie, de rendre hommage à nos martyrs », et « ce silence (des autorités algériennes) paraît comme de la complicité ». La militante algérienne, qui considère que « c’est une très bonne nouvelle de savoir que le chef du gouvernement français a donné son aval pour ouvrir les archives » concernant la révolution algérienne, souhaite « que les archives soient également ouvertes très prochainement en Algérie ». Pour Noui M’Hidi Abdelkader, « les peuples (français et algérien) ont le droit de tout savoir sur les exactions qui ont été commises par l’armée coloniale sur les nationalistes algériens au nom de la République française ». L’ancien militant de la Fédération de France du FLN fustige le silence des autorités algériennes et s’interroge sur le sort des documents et des témoignages recueillis par le FLN en 1966 déjà, et qui n’ont jamais été rendus publics. Au passage, Noui M’Hidi Abdelkader révèle que le FF-FLN avait reçu l’ordre « d’abattre Messali El Hadj », « que tous les militants étaient invités à considérer les éléments du MNA, tous sans exception comme des traîtres », et que lui-même a participé à l’assassinat de Filali. Noui M’Hidi Abdelkader considère qu’il règne en Algérie « un silence incompréhensible sur les actions qui mettent en cause la France » et confirme que la pratique de la torture a continué en Algérie après l’indépendance, l’un de ses propres enfants en ayant été victime en 1994. En France, Jean-Marie Le Pen, lui-même tortionnaire en Algérie, a déclaré lors d’une conférence de presse, qu' »à la différence du FLN et du PCA qui terrorisaient les populations civiles, l’armée (française) ne terrorisait que les terroristes », et ne procédait qu’à « des interrogatoires qui pouvaient aller jusqu’à l’imposition de douleurs physiques graduées mais sans séquelles invalidantes ». Au passage, Le Pen a dénoncé une « campagne de propagande communiste sur le torture en Algérie » et accusé l’ancien Premier ministre Michel Rocard d’être un « ancien porteur de valises du FLN ». (CREOPS 22.11) Après une campagne de presse et une manifestation de rue, l’extrême-droite locale avait réussi en octobre à obtenir de la Ville de Marseille qu’une salle réservée (et payée) pour un séminaire « Mémoire de l’immigration algérienne – la guerre d’Algérie en France » organisé par le CREOPS -lequel avait reporté son colloque aux 2 et 3 décembre, à la faculté Saint-Charles. Les pressions de l’extrême-droite ont repris, et le préfet de région a averti l’Université qu’il ne pourra pas (c’est-à-dire qu’il ne veut pas) assurer la protection des participants au colloque. L’Université a dès lors retiré son accord pour que le colloque ait lieu dans ses locaux. Le CREOPS en appelle au Premier ministre Lionel Jospin, qui vient de s’exprimer en faveur du « devoir de mémoire » sur la Guerre d’Algérie, pour qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que le colloque se tienne « en toute sécurité à Marseille aux dates et lieu prévus et qu’il ne soit pas dit que l’extrême droite impose sa loi ». (AFP 30.11, 1.12, corr) Les organisateurs du colloque du CREOPS (Centre régional d’étude et d’observation des politiques et pratiques sociales) sur la guerre d’Algérie en France (« Mémoires de l’immigration algérienne »), déjé refoulés de toutes parts à Marseille sous la pression d’associations de piers-noirs et de partis d’extrême-droite, on essuyé le 30 novembre un nouveau refus de mise à disposition de salle, le troisième, cette fois de la part du maire socialistes des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille, Georges Hovsepian, qui a renoncé à autoriser le tenue du colloque les 2 et 3 décembre dans une salle de son arrondissement, au prétexte d' »apaiser les tensions entre les différentes composantes de notre population ». Le 28 novembre, le journal du Front National, « Présent », criait « victoire sur les fellouzes et leurs porteurs de valise » après que l’Université de Provence ait renoncé, le 22 novembre, à accueillir les débats. L’adjointe à la Mairie de Marseille chargée des rapatriés, Solange Moll, avait déclaré qu’elle ferait « tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette réunion ». Finalement, le Maire des 13e et 14e arrondissements est revenu sur sa décision et a annoncé qu’il autorisait la tenue du colloque dans une salle municipale, après que des responsables départementaux et régionaux (et au-delé) du PS soient intervenus auprès de lui pour qu’il accorde cette autorisation. Georges Hovsepian a expliqué avoir obtenu « toutes les garanties pour qu’il n’y ait aucun incident ». La préfecture des Bouches du Rhône a indiqué qu’elle allait « renforcer les patrouilles de police sur la voie publique » autour du colloque, une contre-manifestation d’extrême-droite ayant été annoncée, pour protester contre la présence au colloque d’anciens dirigeants de la Fédération du France du FLN et d’anciens « porteurs de valise » du Front. (La Tribune 2.12, AFP 5.12, Le Monde, Le Matin 7.12) Une thèse de doctorat d’histoire sur « l’armée et la torture pendant la guerre d’Algérie. Les soldats, leurs chefs et les violences illégales » a été soutenue (avec succès) le 5 décembre par Raphaëlle Branche. Sur la base, notamment, des « journaux de marche des opérations » tenus par les régiments, du dépouillement d’archives civiles et militaires et d’entretiens, la thèse confirme que la torture n’a pas été une « création » de la guerre d’Algérie, ni un fait exceptionnel, ni une méthode d’interrogatoire, mais qu’elle participait d’une stratégie globale d’intimidation de la population algérienne. Pour Raphaëlle Branche, la torture s’inscrit dans l’histoire de la colonisation et de sa remise en cause radicale par l’insurrection algérienne, dès 1954; l’ampleur de l’usage de la torture s’explique par celle de l’affrontement : l’ennemi n’est pas seulement le FLN (et l’ALN), mais, progressivement, tout le peuple algérien. Face à l’insurrection, l’armée, tout juste sortie de la guerre (et de la défaite) d’Indochine, assimile le FLN au VietMinh et l’insurrection algérienne à une guerre révolutionnaire liée au communisme -vision du conflit à laquelle s’ajoute un profond racisme « anti-arabe ». L’armée va donc tenter d’appliquer en Algérie les enseignements de l’Indochine, et mener une « guerre contre-révolutionnaire » fondée sur les enseignements de la guerre révolutionnaire elle-même. Les détachements opérationnels de protection (DOP), l’une des principales structures pratiquant la torture, sont d’ailleurs nés en Indochine. En Algérie, cependant, la torture préexistait à la guerre, et était pratiquée avant 1954, mais elle s’est généralisée pendant la guerre : l’armée y a eu largement recours pendant la « bataille d’Alger » de 1957. Cette généralisation de la torture correspond, pour Raphaëlle Branche, à l’arrivée du général Salan à la tête de l’état-major d’Alger, en décembre 1956. Quant au pouvoir politique, il était informé de l’usage généralisé de la torture : l’historienne a ainsi retrouvé la trace d’un « gros dossier » transmis par le fondateur du « Monde », Hubert Beuve-Méry, au Premier ministre de l’époque, Guy Mollet, et contenant de nombreux témoignages -dont Mollet n’a fait aucun cas. La torture est devenue en Algérie un moyen d’intimidation de l’ensemble du peuple, fondé sur une menace constante, et une pratique généralisée de l’humiliation : mise à nu systématique des victimes, enfants et vieillards torturés comme les autres, fréquence des viols (d’hommes et de femmes) avec des objets : « La torture n’a jamais été un moyen parmi d’autre d’obtenir des renseignements (et) le fait que des Algériens soient torturés était considéré comme aussi important que le fait que tous les Algériens aient peur de subir de tels traitements », estime Raphaëlle Branche, pour qui « torturer, ce n’est pas seulement faire parler, c’est aussi faire entendre qui a le pouvoir ». L’hostorienne estime « crédible » le nombre de 108’175 Algériens passés par le centre de torture de la ferme Améziane, dans le Constantinois (mais des personnes y sont passées plusieurs fois), et considère que « des centaines de milliers d’Algériens » ont été torturés à l’électricité pendant le conflit. Les douze* signataires de l’appel demandant au président Chirac et au Premier ministre Jospin de « condamner par une déclaration publique » l’usage de la torture pendant la guerre d’Algérie ont réitéré le 6 décembre leur demande, invitant le président Chirac, resté silencieux, à s’exprimer, et le Premier ministre Jospin à aller « plus loin » que ses engagements actuels, jugés positifs. Les signataires de l’appel ont demandé à rencontrer les deux dirigeants. La majorité d’entre eux écartent tout prolongement judiciaire à leur action : pour Nicole Dreyfus, « notre but n’est pas de sanctionner des individus, mais de faire reconnaître des faits historiques. (…) Nous ne prônons ni le lengeance, ni le retour à une époque douloureuse ». Madeleine Rebérioux ne veut « ni repentance, ni finance, ni veangeance », et espère que l’on pourra aussi « parler des crimes du FLN sans insulter les Algériens », mais en les aidant à « interpeller leur gouvernement sur les réalités d’aujourd’hui ». Le débat français sur la torture pendant la guerre d’Algérie commence en effet à avoir des répercussions en Algérie ( Le quotidien « El Youm » a organisé le 30 novembre un forum sur la torture, à Alger, entre anciens dirigeants et militants de la lutte pour l’indépendance (comme Lamine Khene) et journalistes) malgré la persistance d’un silence officiel rompu seulement par des réactions officieuses de milieux proches du gouvernement, mais surtout par des commentaires de la presse et de personnalités, comme Hocine Aït Ahmed, qui voient dans le débat français une occasion d’assumer, en Algérie aussi, le « devoir de mémoire » : « (D’)une France qui reconnaît ses fautes, montre ses généraux qui ont déshonoré leur armée, nous avons beaucoup à apprendre », écrit « La Tribune » du 5 décembre, qui regrette qu' »aucun débat à l’Assemblée » n’ait été ouvert, et que les Algériens laissent « les ONG nous mettre le nez dans notre … », se demande si « le gouvernement, l’ONM (Organisation nationale des moudjahidines), les groupes parlementaires » n’ont vraiment « rien à dire », et considère que « les aveux français mettent sûrement mal à l’aise les « détenteurs » sinon les bénéficiaires de la légitimité historique ». « Le Quotidien d’Oran » considère pour sa part que les réactions officieuses aux déclarations de Hocine Aït Ahmed, qui avait évoqué l’usage de la torture pendant la guerre d’Algérie, non seulement du côté français mais également du côté algérien, « montrent que l’on n’est pas encore prêts à aborder des questions qui ne se limitent pas à l’histoire, car elles continuent d’avoir un prolongement dans le présent ». Les deux quotidiens, officieux et officiel, du FLN, « El Moudjahid » et « Sawt El-Ahrar » ont pour seule réponse accusé Hocine Aït Ahmed de vouloir mettre sur le même plan les « crimes » de l’armée française et la « lutte » des combattants algériens, et le Bureau politique du FLN a condamné « toute tentative visant à porter atteinte à la glorieuse lutte de libération menée par le peuple algérien sous la bannière du FLN et de l’ALN ». Quant au général Khaled Nezzar, il a assuré que le « débat actuel sur la torture concerne, en premier lieu, les Français » et que « le pouvoir algérien n’est pas tenu » d’y entrer. Au-delà du débat sur la torture pendant la guerre d’Algérie, qu »il s’agisse de la torture pratiquée par des policiers et militaires français (ou des harkis), ou de la torture et des exécutions sommaires pratiquée par des membres du FLN et de l’ALN (à l’encontre de harkis, mais également de messalistes, voire de membres du FLN et de l’ALN pris, à la suite d’intoxications lancées par les services spéciaux français, pour des traîtres), c’est le débat sur la torture pratiquée actuellement qui risque fort de « rebondir » en Algérie. *Laurent Schwartz, Nicole Dreyfus, Gisèle Halimi, Henri Alleg, Josette Audin, Mme de Bollardière, Alban Liechti, Pierre Vidal-Naquet, Madeleine Rebérioux(Le Matin 13.12) Le décès, le 8 décembre à Paris, de la militante communiste oranaise Gaby Gimenez, dont l’ancien directeur d' »Alger Républicain » retrace brièvement, dans « Le Matin », la vie d' »infatiganble militante » du PCA, puis du PAGS, illustre l’ancienneté de la pratique de la torture dans l’Algérie « française », à l’encontre de toute forme d’opposition au système colonial -que cette opposition soit nationaliste, communiste -ou les deux à la fois : Secrétaire des jeunesses communistes, Gaby Gimenez a été torturée par la police de Vichy, qui la condamne à la prison à perpétuité; membre des « combattants de la libération » (organisation de combat du PC algérien, absorbée par l’ALN en 1956), elle sera torturée par la police française en 1956 (le gouvernement d’alors étant dirigé par le chef de la SFIO, Guy Mollet), et condamnée à vingt ans de prison. (POUR 13.12, APS 17.12, El Watan 18.12) Georges Mattei, militant français de la solidarité avec l’Algérie (pendant et après la guerre d’indépendance) est décédé le 12 décembre. Issu d’une famille de résistants communistes, il avait été l’un des premiers à dénoncer, après avoir été envoyé en Algérie comme « rappelé » en 1956, l’usage de la torture, dans « Les Temps Modernes ». Il a ensuite participé aux réseaux de soutien au FLN, dans le cadre du réseau d’Henri Curiel. Il a été l’un des fondateurs du bulletin « POUR ». (FFS 11.12, Le Monde 14.12) Après que la presse gouvernementale s’en soit pris violemment (mais sans le nommer) à Hocine Aït Ahmed pour ses déclarations faites au congrès du PS français, à propos de la torture pendant la Guerre d’Algérie (Aït Ahmed avait rappelé que les Français n’avaient pas eu le monopole de la pratique de la torture et des exécutions sommaires), et que plusieurs articles aient accusé le chef du FFS d’avoir mis sur le même plan l’ALN et l’armée française (alors qu’il avait explicitement souligné qu’on ne pouvait pas considérer la violence de l’opprimé de la même manière que celle de l’oppresseur), le FFS dénonce dans un communiqué « une campagne médiatique des plus haineuses (…) où les amalgames les plus grossiers se doublent d’affirmetions mensongèes », campagne qui a pour but d’empêcher « tout débat » au sujet de la torture, alors qu’il est « de notoriété publique que pendant la révolution des dérapages sanglants ont été perpétrés contre des Algériens par des membres de l’ALF-FLN ». Pour le FFS, le moment est venu, en Algérie aussi, d' »ouvrir un large débat qui implique les historiens, pour que la jeunesse en particulier sache la vérité sur cette période tragique de notre histoire », débat dont les enseignements seront « édifiants sur les réalités tout aussi tragiques que vit notre peuple depuis quelques années ». Le FFS dénonce « l’instrumentalisation par le pouvoir de l’histoire », avec la même finalité que celle que « recherchait le colonialisme : soumettre les Algériennes et les Algériens ». Considérant, comme Hocine Aït Ahmed lui-même dans « Le Monde », que le débat français doit être « salué », et considérant comme son chef que ce débat français « ne doit surtout pas conduire à occulter les violences et les violations massives des droits de l’Homme que subit à ce jour le peuple algérien », le FFS réaffirme le caractère « universel » des droits de l’homme. (AP 14.12) « la France peut être fière » des « milliers de jeunes Français d’origine algérienne ou métropolitaine qui se sont battus sous le drapeau français aux ordres du gouvernement français », et qui « l’ont fait avec courage, avec détermination », a déclaré le président Jacques Chirac dans une intervention télévisée, en réponse à une question portant sur la reconnaissance de la pratique de la torture pendant la Guerre d’Algérie. Le président français a exclu toute idée de repentance collective pour les actes de torture commis à l’poque, et a assuré qu’il ne fera rien « qui puisse abîmer (l’) image ou salir (l’) honneur » des combattants français de la Guerre d’Algérie : « il y a eu en Algérie, et deux deux côtés, des atrocités que l’on ne peut que condamner » mais qui étaient le « fait de minorités », a conclu Jacques Chirac. (L’Humanité 20.12) « L’Humanité » publiera à la mi-janvier un numéro spécial hors-série consacré à la torture pendant la Guerre d’Algérie, rassemblant toutes les interventions, contributions et témoignages déjà publiés par le quotidien communiste. Les « Amis de l’Humanité » proposent le 27 janvier une rencontre sur le thème de la torture pendant la Guerre d’Algérie, rencontre lors de laquelle sera notamment projeté le film (inédit en France) qu’André Gazut a consacré au « Général de Bollardière et la torture » (Le Monde 23.12) Né français du viol de sa mère algérienne par des soldats pendant la guerre d’Algérie, un homme de 40 ans souhaitait obtenir une mension de l’Etat (français). La Cour régionale d’appel des pensions militaires a commis lée 21 décembre un expert chargé de déterminer si les troubles dont souffre Mohamed Garne sont ou non imputables au crime commis par les militaires français en Algérie, et s’il souffre de sequelles « physiques » de ce viol, les sequelles « psychologiques » n’étant pas prises en compte. La Cour a reconnu que Mohamed Garne est bien né du viol de sa mère de 17 ans par des soldats français, dans un camp de regroupement. Son avocat a expliqué qu’en outre, la jeune femme avait été torturée à l’eau et à l’électricité « pour provoquer une fausse couche ou un avortement ». La Cour a admis que pendant la guerre d’Algérioe « de multiples exactions et crimes, tortures, exécutions sommaires, attentats aveugles, représailles barbares ont été perpétrés de part et d’autre », et qu’il est « vraisemblable que des viols aient pu être perpétrés par des militaires français »… (Le Monde 24.12) La préfecture de police de Paris a finalement, sur injonction du ministre de l’Intérieur Daniel Vaillant, ouvert ses archives sur la répression contre le FLN dans la région parisienne pendant la guerre d’Algérie. La lettre officielle de Yves Le Breton, chef de cabinet du préfet de police Philippe Massoni, accordant à Jean-Luc Einaudi l’autorisation de consulter « l’ensemble de la série H (guerre d’Algérie 1958-1962) et les pièces annexes relatives à cette période (registre de l’institut médico-légal, notamment) par dérogation aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives », est arrivée le 19 décembre à l’historien, qui s’était précédemment vu refuser quatre fois cet accès, par le même fonctionnaire, ce qui entrait évidemment en contradiction avec les déclarations du Premier ministre sur la nécessité d’un « travail de vérité » scientifique sur la guerre d’Algérie, y compris la répression, les 17 et 18 octobre 1961, des manifestations algériennes dans la région parisienne (répression qui a fait selon J.-L. Einaudi près de 300 morts algériens, noyés dans la Seine, tués par balle ou assomés). Le ministre de l’Intérieur, Daniel Vaillant, a adressé une note au préfet de police rappelant les grandes lignes de la circulaire de Lionel Jospin, recommandant d’accorder « largement » les dérogations à la loi de 1979, qui fixe un délai normal de 60 ans pour l’accès aux documents d’archives contenant des « informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale ». (Le Monde 27.12) « Le Quotidien d’Oran » a régani vigoureusement, le 16 décembre, aux propos télévisés du président français Jacques Chirac, qui refusait d’engager le débat sur la pratique de la torture par les forces françaises pendant la guerre d’Algérie : « Chirac lave plus blanc ! », titre le quotidien, pour qui il est « incompréhensible » que le président français puisse rendre hommage à l’armée française « à un moment où une partie honorable de l’intelligentsia française, à l’image de Pierre Vidal-Naquet, invite l’Etat français à admettre sa responsabilité dans les horreurs commises » en Algérie. Mais le quotidien se demande aussi si le débat sur la torture peut « rester franco-français comme semble le souhaiter le pouvoir algérien » (et comme le souhaite le général Khaled Nezzar), « avec une gêne silencieuse mais néanmoins bruyante ». Cette gêne s’est exprimée notamment par des articles de la presse gouvernementale, en réponse à l’intervention dans ce débat de Hocine Aït Ahmed, qui, précisant qu' »on ne peut pas mettre en balance des actes commis par une vraie invasion et des actes de résistance », avait demandé que le débat ne porte pas seulement « sur les exactions françaises, mais aussi sur les exactions des éléments du FLN et de l’ALN pendant cette guerre ». Si aucune réaction officielle au débat français n’a été enregistrée en Algérie, on note que des associations y sont intervenues : la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH) de Boudjemaa Chechir a adressé une demande d’aide à la Ligue française pour la mise au point de dossiers judiciaires à l’encontre de militaires tortionnaires de haut rang, et le dirigeant d’une association nationales de victimes civiles de la guerre, Rabah Amroun, a accusé les autorités algériennes de « non-gestion des dossiers des populations touchées physiquement, psychiquement et matériellement pendant la guerre ». (Le Monde 28.12) Selon une enquête du « Monde », 350’000 anciens de la guerre d’Algérie (sur le 1,7 million de Français ayant servi en Algérie entre 1954 et 1962) souffriraient de troubles psychiques (voire physiques) liés à leur expérience de cette guerre : insomnies, cauchamers à répétition sont les symptômes les plus fréquents. Les trois quarts des Français ayant été envoyée en Algérie en sont revenus sans troubles majeurs, mais chez un quart d’entre eux ce conflit et l’expérience qu’ils en ont eue ont provoqué des traumatismes psychiques « se traduitant par des troubles plus ou moins invalidants, fréquents et d’apparition rapide. Pour parvenir à cette conclusion, les experts français se sont basés sur les études américaines faites sur les anciens du Vietnam, et les ont validées par des études à échelle réduite effectuées par des spécialistes français, comme Marie-Odile Godard, auteur d’une thèse de doctorat portant sur quatorze anciens d’Algérie, dont deux seulement estiment n’avoir pas souffert de trouble majeur ou durable après leur retour (mais remarquent néanmoins qu’encore aujourd’hui, l’évocation de cette période provoque des insomnies et des cauchemars). Huit de ces quatorze appelés ont présenté des troubles psychiques tels qu’ils ont du être hospitalisés; les quatre autres ont soigné leurs troubles (insomnies, cauchemars, flash-backs, hallucinations, angoisse, phobies, dépressions, idées de suicide) avec des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Dans l’ensemble, les troubles s’atténuent avec les années, mais réapparaissent à l’heure de la retraite. Bernard Sigg, militant contre la guerre d’Algérie, auteur de « Le Silence et la Honte » et vice-président de l’Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) souligne que les anciens appelés choisissent de taire leurs angoisses et les soignent à l’alcool : « tous, absolument tous, ont au minimum entendu ou vu pratiquer la torture. Leur grand drame, me disent-ils aujourd’hui, c’est de n’avoir pas si dire non à l’époque. D’avoir eu vingt ans et de n’avoir pas su réagir »; mais ils avaient à faire face à la peur : « les appelés redoutaient les conséquences de leur résistance ou de leur refus, surtout à l’égard de la question de la torture » et dans une ambiance de violence continuelle, voire de sadisme, notamment de la part des détachements opérationnels de protection (DOP). Deux médecins généraux militaires, Claude Barrois et Louis Crocq, considèrent qu’on ne peut guérir ces « blessures de l’âme » que par la « reconnaissance » du « drame » vécu, et l’accès à un suivi médico-thérapeutique gratuit est une revendication commune à tous ceux qui cotoient les anciens d’Algérie. Pour « Le Monde », « il importe que la cure ne se limite pas aux individus, si nombreux soient-ils, dont la vie a été bouleversée par le conflit ». Il faut qu’elle soit prise en charge par la nation toute entière. Car c’est bien la mémoire collective de la France qui est blessée », et c’est bien de « quarante ans, ou presque, de silence contraint » qu’il faut sortir. Et le quotidien d’ajouter que « la responsabilité des autorités françaises est lourdement engagée », notamment celle du président Chirac, qui « a préféré s’en remettre au temps qui passe », et du Premier ministre Jospin, qui renvoie le travail aux historiens « sans que l’Etat lui-même fasse le moindre geste ni que soit réglée la difficile question de l’accès aux archives les plus sensibles ». Et l’éditorial du « Monde » de conclure : « Ces prudences ne sont plus acceptables. On attent des pouvoirs publics l’expression d’une réelle volonté politique dans ce nécessaire travail de mémoire ». 2001(APS 20.1, Liberté 21.1) Le Comité (algérien) contre la torture et les disparitions durant la guerre de libération nationale a appelé le 20 janvier au respect du « devoir de vérité » sur les pratiques de la torture, des crimes contre l’humanité et des disparitions durant la période de 1954 à 1962. Le président du comité, Ali Fawzi Rebaine, qui trouve « inexplicable » le silence des autorités algériennes dans le débat en cours sur les pratiques de l’armée et de la police françaises pendant la guerre, a précisé que l’objectif du comité était de créer une association prenant en charge la question de la torture et des disparitions, et qu’elle constituera dans cette perspective des dossiers à partirs de faits, de preuves et de témoignages. Ali Fawzi Rebaine a appelé les autorités algériennes à « faire connaître officiellement » leur position Le comité se réserve la possibilité d' »ester devant toutes les juridictions nationales et internationales compétentes en la matière, les tortionnaires et auteurs d’atteintes aux droits de l’homme et de crimes contre l’humanité ». « Nous voulons que le cas de Pinochet fasse jurisprudence », a déclaré Ali Fawzi Rebaine. (Reuters 31.1) Pour protester contre la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens en 1915, la municipalité d’Ankara envisage d’ériger un monument à la mémoire des victimes algériennes de la France, et de dépabtiser des rues portant des noms français (Paris, De Gaulle, Strasbourg) Aux termes des propositions soumises au Conseil municipal par le Maire, Melib Gokcek, le mémorial aux victimes de la Guerre d’Algérie serait érigé à proximité de l’ambassade de France pour « entretenir le souvenir du massacre des Algériens » (AFP 12.4) L’éditeur Jérôme Lindon, PDG des Editions de Minuit, est décédé le 12 avril. Jérôme Lindon s’était notamment engagé pendant la Guerre d’Algérie dans le combat contre la torture et les pratiques des forces françaises d’Algérie : « Il a été le seul éditeur à s’être battu de manière continue et très courageuse contre la guerre d’Algérie et la façon dont elle était menée », a déclaré le directeur de La Découverte, François Gèze. Les Editions de Minuit, sous la direction de Jérôme Lindon, ont notamment publié en 1957 « Pour Djamila Bouhired » de Jacques Vergès et Georges Arnaud, en 1958 « La Question » d’Henri Alleg et « L’Affaire Audin », en 1959 « La gangrène », en 1961 « Le Déserteur » de Maurienne, en 1972 « La torture dans la République » de Pierre Vidal-Naquet. (Liberté 23.4) Le ministre des Moudjahidines (anciens combattants), Mohamed Cherif Abbas, a annoncé le 22 avril la découverte à Chréa, dans la région de Tebessa, d’un « grand charnier » datant de la guerre d’indépendance. 290 squelettes ont été retirés d’une fosse commune, dans un lieu abritant un siège de la « Section administrative spécialisée » (SAS) de l’armée française pendant la guerre. Selon le ministre, il s’agit d’hommes, de femmes et d’enfants torturés par des militaires français. Certains portent encore des traces de torture, d’autres avaient les mains et les pieds liés avec du fil de fer. Les victimes auraient été tuées à des moments et en des lieux différents avant d’être jetées pêle-mêle dans la fosse commune. (AP 26.4) Un mémorial national en hommage aux soldats français morts pendant la guerre d’Algérie sera édifié en 2002 à Paris (quai Branly), a annoncé le 26 avril le Premier ministre Lionel Jospin. Sur ce monument seront inscrits les noms de « tous ceux qui sont morts pour la France en Afrique du Nord », a précisé le Premier ministre. Lionel Jospin a également annoncé que des représentants de la « communauté harkie » siégeraient désormais au sein des conseils départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le gouvernement est « soucieux d’exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui se sont battus ou se battent pour notre pays », a déclaré Lionel Jospin. (APS 27.4, Le Monde 28.4) Le « Journal Officiel » français du 26 avril publie une circulaire du Premier ministre Lionel Jospin, destinée à favoriser « l’accès aux archives publiques en relation avec la guerre d’Algérie ». Adressés aux ministres de l’Emploi et de la solidarité, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Défense, de la Culture et de l’Intérieur, la circulaire note que « le retour sur les événements liés à la guerre d’Algérie, comme les récents débats qui se sont développés à ce sujet, montrent l’intérêt qui s’attache à ce que les faits correspondant à cette période reçoivent l’éclairage de la recherche historique » afin de leur donner « une connaissance claire et impartiale ». Une loi de 1979 fixe à trente ans le délai « ordinaire » d’accès aux archives publiques, mais un délai de soixante ans a été jusqu’à présent appliqué aux archives concernant la guerre d’Algérie, considérées comme « contenant (encore) des informations mettant en cause la vie privée, ou intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, ou encore relatifs aux affaires portées devant les juridictions ». La nouvelle circulaire de Lionel Jospin vise à faciliter les dérogations à ce délai de soixante ans, et donc a appliquer le plus généralement possible le délai de 30 ans aux archives concernant la guerre d’Algérie. Le Premier ministre « souhaite que (les autorisations de consulter les archives « algériennes ») soient largement délivrées à titre individuel » aux chercheurs, et souhaite également que les six ministères concernés fassent appel aux « conseils d’une personnalité spécialement désignée à cet effet, et disposant de la hauteur de vue et de l’expérience requises » afin de veiller à la « cohérence du traitement qui sera fait de ces demandes ». L’historien Jean-Luc Einaudi, spécialiste de la répression du mouvement national algérien en France, en notamment des manifestations d’octobre 1961 et de leur répression, considère que la circulaire de Lionel Jospin va dans le bon sens, à conditions qu’elle soit réellement mise en oeuvre, mais estime qu’elle reste insuffisante : « il faut que le pouvoir politique (actuel) dise ce qui en a été du recours (au) système criminel » de la torture en Algérie, a estimé Jean-Luc Einaudi. Le 26 avril, Lionel Jospin a estimé qu’il était « temps d’éclairer mieux les événements d’Algérie », et qualifié d' »hypocrisie » l’appellation, de rigueur pendant 45 ans, d' »événements d’Afrique du nord » pour désigner la guerre d’Algérie.
L’Affaire Aussaresses
(Le Monde 2.5, 5.5, 6.5 / Le Temps 5.5 / AFP 5.5, 6.5 / AP 3.5, 4.5, 6.5 / Reuters 4.5, 5.5 / Le Quotidien d’Oran 6.5 / Le Matin 7.5) Dans « Services spéciaux, Algérie 1955-1957 », paru le 3 mai aux éditions Perrin, et dont « Le Monde » du 2 mai publie de larges extraits, le général Paul Aussaresses (83 ans) raconte le rôle qu’il a joué pendant la guerre d’Algérie, notamment pendant la bataille d’Alger : tortures, exécutions sommaires de suspects parfois maquillées en suicides, comme dans les cas de l’avocat Ali Boumendjel et du chef du FLN algérois, Larbi Ben M’Hidi, massacres de civil… « c’est vrai : nous étions un escadron de la mort », résume Aussaresses dans un entretien au « Monde ». Aussaresses, commandant au moment des faits, explique que la torture était déjà une pratique policière courante en 1955 lors de son arrivée en Algérie, à Philippeville (Skikda) : « Jusqu’à mon arrivée à Philippeville, j’avais été amené à interroger des prisonniers, mais je n’avais jamais torturé. (…) J’avais souvent imaginé que je serais torturé un jour, mais je n’avais jamais imaginer la situation inverse : torturer des gens ». Mais « les policiers de Philippeville utilisaient (…) la torture, comme tous les policiers d’Algérie, et leur hiérarchie le savait »… La justification est toujours la même : « la torture devenait légitime dans les cas où l’urgence l’imposait. Un renseignement obtenu à temps pouvait sauver des dizaines de milliers de vies humaines ». Et d’ajouter que « la quasi-totalité des soldats français qui sont allés en Algérie eurent plus ou moins connaissance de la torture, mais ne se posèrent pas trop de question car ils ne furent pas directement confrontés au dilemne. Une petite minoritp d’entre eux l’a pratiquée, avec dégoût, certes, mais sans regrets ». Quant aux méthodes de torture, Aussaresses évoque « d’abord les coups qui, souvent suffisaient, puis les autres moyens, dont l’électricité, la fameuse ‘gégène’, enfin l’eau ». Le 3 avril 1955, le Parlement vote la loi d’état d’urgence, « qui permettait notamment de resserrer les liens entre la police et les services militaires de renseignement ». Aussaresses commente : « c’était une façon d’institutionnaliser ce que je pratiquais déjà officieusement ». Il commence à pratiquer lui-même la torture après une série d’attentats le 18 juin 1955 à Philippeville. Un « musulman » arrêté pour avoir attaqué un pied-noir est interrogé : « L’homme refusait de parler. Alors j’ai été conduit à user de moyens contraignants. Je me suis débrouillé sans les policiers. C’était la première fois que je torturais quelqu’un. Cela a été inutile ce jour-là. Le type est mort sans rien dire. Je n’ai pensé à rien, je n’ai pas eu de regrets de sa mort. Si j’ai regretté quelque chose, c’est qu’il n’ait pas parler avant de mourir. Je n’ai pas eu de haine ni de pitié )…) j’avais sous la main un homme directement impliqué dans un acte terroriste : tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’étaient les circonstances qui voulaient ça ». A El Halia, près de Philippeville, le FLN a lancé une attaque contre les civils européens, avec (selon Aussaresses) comme consigne de les tuer tous. Les forces françaises font une soixante de prisonniers. Aussaresses donne l’ordre de les « descendre ». Quelques jours plus tard, les Français font à nouveau une centaine de prisonniers. ils sont « abattus sur le champ ». La torture devint systématique pendant la bataille d’Alger, en 1957, et Aussaresses se présente comme en ayant été l’organisateur secret. Au début de l’année, il est désigné par le général Massu, qui a reçu les pouvoirs de police du gouvernement présidé par Guy Mollet (François Mitterrand est ministre de la Justice, Robert Lacoste est ministre résident en Algérie) comme responsable de l’action « secrète ». Il la mène conjointement avec le colonel Trinquier, responsable du renseignement. Il infiltre notamment au sein du FLN (selon ses dires) un agent, auprès de Yacef Saadi. « La face nocturne et secrète de la mission m’amenait à organiser les arrestations, à trier les suspects, à superviser les interrogatoires et les exécutions sommaire », écrit Aussaresses, qui ajoute que son rôle était « par ailleurs de soulager les régiments des corvées les plus désagréables et de couvrir celles qu’ils accomplissaient eux-mêmes ». A Mustapha, à la périphérie d’Alger, Aussaresses dispose d’une villa (la villa des Tourelles) où il interroge, torture, exécute sommairement des suspects arrêtés : « Pour tous les suspects arrêtés à Alger, c’était moi, en principe, qui décidais de ceux qui devaient être interrogés séance tenance et de ceux qui devaient être conduits directement dans les camps lorsqu’ils n’avaient pas une importance majeure. Les autres, dont la nocivité était certains, ou du moins hautement probable, nous les gardions, avec l’idée de les faire parler rapidement avant de nous en débarrasser. (…) Parmi les opérations qui nous revenaient et auxquelles je participais, la plupart amenaient à des interrogatoires. D’autres aboutissaient à des liquidations pures et simples qui se faisaient sur place. (…) Le cas de ceux qui entraient aux Tourelles était considéré comme assez grave pour qu’ils n’en sortent pas vivants. (…) Aux Tourelles, comme dans les régiments responsables de secteurs, la torture était systématiquement utilisée si le prisonnier refusait de parler, ce qui était très souvent le cas. » « Quand on voulait se débarrasser de quelqu’un, il finissait par arriver aux Tourelles », et les exécutions sommaires se faisaient « la plupart du temps » à la périphérie d’Alger : « les suspects étaient abattus d’une rafale de mitraillette, puis enterrés ». « Il était rare que les prisonniers interrogés la nuit se trouvent encore vivants au petit matin. Qu’ils aient parlé ou pas, ils étaient généralement neutralisés ». Et à la fin de chaque nuit, Aussaresses relatais ses activités en quatre exemplaires : l’original pour Massu, une copie pour les archives d’Aussaresses lui-même, les deux autres copies pour Robert Lacoste et le général Salan. Aussaresses décrit comment son commando (deux équipes) torturait et tuait à Alger, la nuit. Il l’assume, sans remords. Au « Monde », Aussaresses déclare : « c’est efficace, la torture, la majorité des gens craquent et parlent. Ensuite, la plupart du temps, on les achevait. (…) Il aurait fallu qu’on les refile à la justice, on l’a fait dans certains cas, avec Alleg et le docteur Hadjadj, par exemple. Mais pour les autres, on n’avait pas le temps. Est-ce que ça m’a posé des problèmes de conscience ? Je dois dire que non ». Aussaresses affirme cependant ne « rien » savoir du cas de Maurice Audin, tout en reconnaissant l’avoir « vu une fois » à El Biar, avec Henri Alleg et le docteur Hadjadj. Aussaresses assure que « mis à part l’entourage de Massu ainsi qu’une poignée d’officiers de la 10e DP (division parachutiste), nul n’a jamais soupçonné que j’étais le chef d’orchestre de la contre-terreur », précise que « parmi les gens que je voyais tous les jours, il n’y a que Paul Teitgen (secrétaire général de la police à la préfecture d’Alger) qui n’ait jamais rien compris », et affirme que le pouvoir politique couvrait les crimes commis au nom de la lutte antiterroriste, et met en cause notamment les socialistes au pouvoir à l’époque, le Premier ministre Guy Mollet et le ministre-résident Robert Lacoste, mais également François Mitterrand (pas encore socialiste à l’époque, mais successivement ministre de l’Intérieur et de la Justice pendant la guerre d’Algérie). Pour Aussaresses, « en demandant aux militaires de rétablir l’ordre à Alger, les autorités civiles avaient implicitement admis le principe d’exécutions sommaires » (dont elles étaient par ailleurs régulièrement informées). « Les exécutions sommaires faisaient partie intégrantes des tâches inévitables de maintien de l’ordre. C’est pour ça que les militaires avaient été appelés. On avait instaurer la contre-terreur, mais officieusement, bien sûr. Il était clair qu’il fallait liquider le FLN (…). C’était tellement évident qu’il n’était pas nécessaire de donner des ordres dans ce sens à quelque niveau que ce soit. Personne ne m’a jamais demandé ouvertement d’exécuter tel ou tel. Cela allait de soi ». Et d’ajouter : « lorsqu’il nous a semblé utile d’obtenir des instructions plus explicites, ce principe a toujours été clairement réaffirmé ». Lorsqu’à fin janvier 1957, une douzaine de membres du groupe FLN de Notre-Dame d’Afrique ont été arrêtés, c’est directement au Secrétaire d’Etat à la guerre Max Lejeune que le général Massu demande s’il fallait les remettre à la justice ou les liquider. Et Max Lejeune de répondre, de manière à la fois sibylline et fort claire, en donnant l’exemple de l’arraisonnement par la chasse française de l’avion qui transportait Ben Bella, Boudiaf, Aït Ahmed et leurs compagnons : l’ordre avait été donné non pas de détourner l’avion, mais de l’abattre, et si finalement l’avion n’a pas été abattu, c’est parce que son équipage était français. Et Lejeune d’ajouter : « Pour le gouvernement, il est regrettable que Ben Bella soit encore vivant. Son arrestation est une bavure. Nous devions le tuer ». Ce que Massu traduit immédiatement par : liquidez vos prisonniers. Ce qu’Aussaresses fit : « quand il a fallu tuer ces prisonniers, nous n’avons pas douté un instant que nous exécutions les ordres directs du Max Lejeune, du gouvernement de Guy Mollet et de la République française ». Aussaresses reconnaît avoir assassiné le dirigeant du FLN d’Alger, Larbi Ben M’Hidi, arrêté par Bigeard dans la nuit du 15 au février février 1957, traité « avec égards » par Bigeard, qui refusait de le livrer aux policiers « pensant qu’ils l’auraient certainement torturé », et assassiné par Aussaresses et ses hommes (assassinat maquillé en suicide), avec le feu vert de Massu et pratiquement sur suggestion du juge Bérard. Aussaresses reconnaît également avoir donner l’ordre d’assassiner l’avocat Ali Boumendjel, précipité du sixième étage d’un immeuble d’El Biar le 23 mars 1957 (assassinat lui aussi maquillé en suicide). Il nie cependant avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Maurice Audin. Pour Pierre Vidal-Naquet « Il ment sur ce point ». Pour les historiens, en tous cas, Aussaresses ne fait que confirmer ce que l’on savait déjà, et dire tout haut ce que d’autres officiers taisent : pour Pierre Vidal-Naquet (qui relève quelques erreurs « pas très graves » dans le livre, erreurs qu’il attribue au « nègre » du général), le témoignage d’Aussaresses, qu’il faut prendre pour « les Mémoires d’un assassin », signifie que « la responsabilité du gouvernement de la République de l’époque est à présent clairement établie »; pour Benjamin Stora, Aussaresses est le premier officier à avouer « la mise en place d’un véritable système à l’intérieur de l’armée française d’exécutions sommaires, d’assassinats planifiés, en connivence avec le pouvoir judiciaire et politique »; pour Jean Lacouture, « les politiques savaient que tous les moyens étaient employés. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir ». Pour la soeur de Larbi Ben M’Hidi, François Mitterrand, Garde des Sceaux de l’époque, était directement informé par Aussaresses lui-mêmes des exactions qu’il commettait. Aussaresses lui-même affirme que « l’utilisation de la torture (était) tolérée, sinon recommandée », et que François Mitterrand, ministre de la Justice, avait « de fait un émissaire auprès de Massu en la personne du juge Jean Bérard qui nous couvrait et qui avait une exacte connaissance de ce qui se passait la nuit. J’entretenais les leilleures relations possibles avec lui et je n’avais rien à lui cacher ». Drifa Hassani affirme que « Mitterrand décidait du sort réservé aux responsables du Front de Libération Nationale » et était donc parfaitement au courant des tortures infligées à son frère, et de son assassinat maquillé en suicide. Drifa Hassani appelle le gouvernement français « à sauver l’honneur de son peuple et de son armée, en ayant le courage de dévoiler » à l’opinion publique les enregistrement réalisés de l’interrogatoire et des tortures subis par son frère. Le témoignage d’Aussaresses met effectivement en cause, non seulement les actes de son auteur, et sa responsabilité personnelle, mais la responsabilité politique des autorités françaises de l’époque. Il a suscité de très nombreuses réactions en France, mais des réactions beaucoup plus rares en Algérie, de la part de responsables politiques. Le Premier ministre Jospin a exprimé sa « condamnation morale » des « exactions terribles » avouées par Aussaresses, et s’est dit « profondément choqué » par son « cynisme révoltant ». Le président Jacques Chirac s’est dit « horrifié » par les propos du général et a demandé sa suspension dans l’ordre de la Légion d’honneur, et des « sanctions disciplinaires », mais a ajouté que les « actes injustifiables » commis par Aussaresses (et quelques autres) ne doivent pas « faire oublier les millions de jeunes Français, d’origine algérienne ou métropolitaine, qui se sont battus avec courage et honneur ». Le colonel Pierre Dabezies, ancien parachutiste en Algérie, a accusé le général Aussaresses de « couvrir d’opprobre toute l’armée comme si tout le monde avait torturé », et affirme que « la bataille d’Alger, où tous les coups étaient permis, (n’était) pas toute la guerre d’Algérie ». Dabezies accuse Aussaresses d’une « déformation simpliste » des événements, mais reconnaît que « le pouvoir politique était au courant dans l’ensemble d’un certain nombre de méthodes qui étaient utilisées et d’un certain nombre d’excès qui étaient commis ». Pour lui, le pouvoir politique s’est « défaussé sur l’armée » en lui confiant une mission politique pour laquelle « l’armée n’est pas faite ». Le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine a estimé « absolument répugnant d’avoir torturé ainsi et surtout de s’en vanter ». Le président de l’Assemblée nationale a exprimé son « dégoût », mais appelé à « tourner la page », en affirmant que « sur le terrain, le pouvoir civil était relativement tenu à l’écart ». La plupart des responsables politiques ont persisté à refuser toute idée de « repentance nationale » pour les actes commis pendant la guerre d’Algérie. A droite, cette idée est beaucoup plus nettement refusée qu’à gauche : pour le RPR Jean-Louis Debré, « nous n’avons pas à rechercher 40 ans après les responsabilités des uns et des autres ». A gauche, le PCF, par la voix de son secrétaire général Robert Hue, s’est distancé des positions officielles en demandant que le chef de l’Etat et le gouvernement « décident d’un acte fort, solennel, pour que la France, aux yeux du monde, condamne ce qui a été fait en son nom » pendant la guerre d’Algérie. Les Verts, par la voix de Noël Mamère, réclament une commission d’enquête sur ce qu’ils qualifient de « crimes contre l’humanité » : « Les historiens ne suffisent pas, car c’est une affaire qui concerne la mémoire collective de notre peuple »; la Ligue communiste révolutionnaire demande que soient sanctionnés « auteurs et commanditaires » des tortures. Le socialiste François Loncle souhaite plutôt qu’une commission d’historiens « fasse la vérité ». Le PS a par ailleurs souligné que les travaux d’une commission parlementaires seraient, selon le règlement de l’Assemblée, interrompus par l’ouverture de procédures judiciaires (or plusieurs procédures ont déjà été annoncées). Plusieurs commentaires mettent en évidence le risque de faire d’Aussaresses une sorte de « bouc émissaire », de « salaud parfait », sans que soit posée la question de la responsabilité de la France elle-même, par ses autorités. Dans « Le Temps » de Genève, Etienne Dubuis constate que les mémoires d’Aussaresses « ont suscité un véritable tollé ces derniers jours à Paris. Mais contre quel crime les protestations se sont-elles élevées ? Les atrocités commises par l’armée d’occupation ? Non. Le feu vert accordé aux bourreaux, en toute connaissance de cause, par les autorités politiques de l’époque ? Pas davantage. L’indifférence avec laquelle l’opinion hexagonale suffisamment informée pour savoir ce qu’il en retournait, a suivi cette descente aux enfers ? Encore moins. Les attaques se sont massivement dirigées contre l’auteur des confessions », coupable sans doute d’avoir dit ce qu’il ne convenait pas de dire. « Dans « Le Monde », Pierre Georges écrit ainsi : « il faut prendre ce livre pour ce qu’il est : non pas l’autojustification cynique, glaçante, d’un préposé aux abominations. Non pas des mémoires de torture comme il en fut de guerre. Mais une sorte de témoignage à charge du bourreau contre son propre pays, sa propre armée, son propre gouvernement de l’époque ». En éditorial, le 6 mai, « Le Monde » poursuit sur la même ligne : « Ici et là, les aveux circonstanciés du général Aussaresses ont été curieusement qualifiés de ‘malsains, odieux’ (Raymond Forni), relevant d’un ‘cynisme révoltant’ (lionel Jospin) ou encore ayant un caractère ‘intolérable’ (la Ligue des droits de l’Homme). Ce sont les crimes commis qui furent intolérables, malsains, odieux; ce sont les autorités qui les ont couverts ou ordonnés qui furent d’un cynisme révoltant; ce n’est pas l’aveu par l’un des criminels qui nous choque, mais la réalité qu’il dévoile (…). (Aussaresses) est condamnable non pour ce qu’il dit, mais pour ce qu’il a fait. Or ce qu’il a fait, il l’a commis non pas en franc-tireur, mais en soldat discipliné d’une République à la dérive ». Aussaresses lui-même raconte : « On m’avait appris à crocheter les serrures, à tuer sans laisser de traces, à mentir, à être indifférent à ma souffrance et à celle des autres, à oublier et à me faire oublier. Tout cela pour la France ». Aussaresses a expliqué au « Monde » qu’il avait décidé d’aller « plus loin » que ces premières déclarations, et de s’expliquer « davantage » sur ses actes car « la guerre d’Algérie (est) redevenue d’actualité et qu’elle (intéresse) beaucoup de monde ».Mais Aussaresses ajoute : « d’autres que moi auraient pu (parler). Massu, par exemple, ou Bigeard. Mais Bigeard ne veut pas parler, il m’a d’ailleure reproché de l’avoir fait en octobre. J’ai pensé qu’il valait mieux que ce soit moi qui le fasse, en connaissance de cause, plutôt que de laisser n’importe qui dire n’importe quoi ». Aussaresses lui-même répond à ceux qui ont condamné son témoignage (et à travers lui, ses actes) qu’il a « rendu compte tous les jours de (son) activité à (son) supérieur direct, le général Massu, lequel informait Robert Lacoste (ministre résidant à Alger) et le commandant en chef. Il aurait été loisible à toute autorité politique ou militaire d’y mettre fin ». Et le général affirme avoir restitué « les faits tels qu’ils étaient en leur temps », et avoir « rempli durant six mois la mission » qui lui avait été impartie en Algérie. Et de réitérer le sophisme par lequel il n’a cessé de justifier ses actes depuis qu’il a commencé de les rendre publics : « si demain et tous les jours, des bombes éclataient à Paris dans des stades, des cafés ou ailleurs, croit-on que le gouvernement, la police et la justice lutteraient par des moyens classiques » ? Aussaresses affirme ne pas redouter un procès : « j’en prends le risque. (…) Je redirais exactement ce que je vous ai dit et ce que j’ai écrit dans mon livre », déclare-t-il au « Monde ». La question est de savoir quelles sanctions, et pourquoi, pourraient être prises contre lui. La ministre de la Justice Marylise Lebranchu a estimé « qu’en l’état actuel du droit, de spoursuites semblent a priori difficiles », sauf pour « apologies de crimes de guerre ». Il pourrait théoriquement être poursuivi pour crimes contre l’humanité, définis par le code pénal français par « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ». Le 4 mai, la Ligue des droits de l’Homme a déposé plainte contre Aussaresses pour « apologie de crimes et de crimes de guerres ». Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) a annoncé son intention de déposer plainte pour « crimes contre l’humanité », crimes imprescriptibles. Le Parquet de Paris a mis les poursuites judiciaires à l’étude. La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme demande dans un communiqué qu’Aussaresses soit jugé « en tant que criminel contre l’humanité », et envisage de saisir la justice française à cet effet. La FIDH souligne que les amnisties intervenues en 1962 et 1968 pour les faits liés à la guerre d’Algérie sont inopposables à des poursuites, car « contraires aux obligations internationales de la France » (c’est-à-dire aux normes de droit international ratifiées par la France, et pour lesquelles les crimes contre l’humanité, dont la torture, sont imprescriptibles et ne peuvent être couverts par une amnistie a priori). Amnesty International a appelé la France à s’engager dans un processus judiciaire concernant la Guerre d’Algérie, comme elle a été capable de le faire à propos de l’Etat français de Vichy. La soeur de Larbi Ben M’Hidi a déclaré qu’elle envisageait de porter plainte contre l’assassin de son frère; la veuve de Maurice Audin a réclamé sa comparaison en justice. Le président Chirac a demandé la suspension d’Aussaresses dans l’ordre de la Légion d’Honneur et des « sanctions disciplinaires ». Le ministre de la Défense Alain Richard a annoncé qu’il allait réunir le Conseil supérieur de l’armée de terre à cet effet. Général de brigade en « deuxième section » (c’est-à-dire théoriquement en réserve), Aussaresse est soumis au devoir de réserve et au respect du secret défense. Mais n’étant plus en activité, il ne peut pas être sanctionné disciplinairement. Il est en revahcne passible de sanctions statutaires pour « insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur », c’est-à-dire « tout manquement grave ou répété à ses devoirs d’homme, de citoyen ou de représentant de la force publique pouvant porter atteinte à des intérêts matériels ou moraux, à la probité ou aux bonnes moeurs ». Il s’agit là de crimes imprescriptibles, contrairement aux crimes de guerre, prescrits par dix ans après les faits, et qui supposent normalement l’existence d’un conflit armé entre deux Etats. Reste à savoir, si ce motif était retenu, si ce que l’on reprocherait à Paul Aussaresses est d’avoir été un tortionnaire et un assassin, ou de l’avoir publiquement reconnu. Aussaresses avait déjà révélé en novembre 2000 qu’il avait ordonné des tortures et procédé lui-même à des exécutions sommaires en Algérie, ce qui avait poussé le PC à réclamer la création d’une commission d’enquête parlementaire. Le Premier ministre Lionel Jospin s’y était refusé, mais avait soutenu l’appel des intellectuels appelant à la reconnaissance et à la condamnation de la torture durant la guerre d’Algérie, tout en estimant qu’il devait s’agir là d’un « travail de vérité » devant être mené par des historiens, et non d’un « acte de repentance collective ». Le Président Chirac, également opposé à toute « repentance », avait quant à lui renvoyé dos à dos le FLN et l’armée française. Dans l’opinion publique française, selon un sondage effectué après, et à propos des déclarations du général Aussaresses, 70 % des Français (sur la base d’un échantollon « représentatif » de 1005 personnes de plus de 18 ans) jugent la pratique de la torture « condamnable », et que rien ne peut la justifier de la part d’une armée régulière. 20 % des personnes interrogées considèrent tout de même que la pratique de la torture « n’est pas condamnable au vu de la situation sur le terrain à l’époque », et 10 % de se prononcent pas. La condamnation est beaucoup plus vive chez les sympathisants des Verts (85 %) et du PS (80 %) qu’à droite (63 % des sympathisants de l’UDF contre 29 %, 62 % des sympathisants du RPR contre 33 %). Ce sondage aboutit dans l’ensemble à une condamnation beaucoup plus forte et catégorique de la torture qu’un sondage comparable effectué en novembre 2000 : 33 % des personnes interrogées s’étaient refusées à condamner la torture pendant la guerre d’Algérie. En Algérie, les aveux circonstanciés du général Aussaresses ont été accueillis sans surprise par les milieux politiques et la presse, et par un silence total des autorités. Le bureau politique du FLN a estimé que les aveux d’Aussaresses mettaient « à nouveau la France devant la réalité des crimes commis en son nom », et a demandé que les auteurs de ces crimes soient jugés pour « crime contre l’humanité ». Le FLN a estimé que l’Algérie ne pouvait pas se contenter des déclarations du président Chirac et du Premier ministre Jospin. Le Front des Forces Socialistes a pour sa part déclaré, par la voix de son Premier secrétaire Ali Kerboua, que « les révélations faites aujourd’hui n’étonnent que ceux qui doutaient » de la réalité des crimes commis en Algérie au nom de la France, mais qu’il s’agissait « pour le moment » d’une affaire « franco-française ». « Il faut que les Français assument leur histoire », a estimé Ali Kerboua. Le président du FFS, Hocine Aït Ahmed, a estimé pour sa part que la demande de jugement pour crimes contre l’humanité était « un minimum » à l’égard d’Aussaresses, que Hocine Aït Ahmed qualifie de « monstre ». Mais pour le président du FFS, le débat provoqué par le témoignage du tortionnaire a également pour effet que « tous les Algériens savent désormais que l’immunité n’existe pas et que les crimes, tôt ou tard, rattrapent leurs auteurs ». A quoi « El Moudjahid » répond indirectement en affirmant que les déclarations d’Aussaresses « jettent l’anathème et un lourd discrédit sur toute la politique française en matière de donneur de leçons, tant en démocratie qu’en Droits de l’Homme ». La presse privée, elle, note le silence des autorités. « L’Authentique » considère que ce silence est du au fait que les autorités algériennes se sentent « fragilisées » après le dépôt en France de plaintes pour torture contre le général Nezzar. « Le Matin » rappelle qu’en Algérie, « tout au plus l’holocauste algérien était-il exploité chaque fois que la France se surprend à donner son avis sur nos problèmes », et écrit même qu' »à la France colononiale coupable d’avoir systématisé l’atteinte à l’intégrité humaine l’Algérie d’aujourd’hui ne peut offrir qu’un miroir où se reflètent les mêmes méfaits ». (AP 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 / Reuters 9.5 / AFP 9.5 / CCFIS 9.5 / Le Monde 9.5 / Le Quotidien d’Oran 9.5) La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) a annoncé le 7 mai le dépôt d’une plainte pour crime contre l’humanité contre le général Paul Aussaresses. La FIDH considère que « le caractère systématique, généralisé et institutionnalisé (participant d’un plan concerté) des crimes commis en Algérie ressort clairement » du témoignage publié par le général. La FIDH fait savoir que le juge français « est non seulement compétent mais a, en outre, l’obligation de réprimer les auteurs de tels crimes en vertu du droit international coutumier ». Le 4 mai, c’était la Ligue française des droits de l’Homme qui avait déposé plainte contre Aussaresses, pour « apologie de crimes de guerre », compte tenu des doutes que la LDH a sur la possibilité d’aboutir d’une plainte pour des crimes sur lesquels les défenseurs d’Aussaresses invoqueront certainement les amnisties survenues pour les actes commis en Algérie. Le 9 mai, c’est le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) qui annonçait le dépôt d’une plainte pour « faits de crimes contre l’humanité », et qui se constituait partie civile dans la procédure. Pour le MRAP, le juge d’instruction devra instruire les faits de tortures, d’exécutions sommaires et d’assassinats « revendiqués et assumés par Aussaresses ». Le MRAP lance un appel à témoignages pour que « les victimes et les familles des victimes de ces crimes contre l’humanité puissent s’associer à cette démarche de justice et de vérité ». La veuve de Maurice Audin, enseignant communiste « disparu » en pleine bataille d’Alger, le 21 juin 1957, a annoncé qu’elle allait également déposer plainte (contre X) avec constitution de partie civile pour « crimes contre l’Humanité » et « séquestration ». Le corps de Maurice Audin n’a jamais été retrouvé, mais sa famille soupçonne le commando du général Aussaresses (qui le nie) de l’avoir torturé à mort. Du côté des « politiques », Le Parti socialiste s’est déclaré le 7 mai favorable à la création d’une « commission mixte » composée d’historiens, de juristes et de responsables politiques pour veiller à l’ouverture des archives de la guerre d’Algérie. « La France doit être capable de faire face à son histoire », a déclaré le porte-parole du PS, qui a ajouté que le PS ne considérait « pas qu’une commission parlementaire permettrait d’atteindre cet objectif », mais a insisté sur le fait que « toutes les archives doivent être ouvertes » afin que « les historiens aient accès au maximum de sources ». Le Premier secrétaire du PS, François Hollande, « la France doit demander pardon aux Algériens concernés » par des actes « inadmissibles », dont Hollande affirme qu’ils n’ont « en aucune façon été autorisés par la République ». Le Secrétaire général du PCF, Robert Hue, a quant à lui demandé au Président Chirac et au Premier ministre Jospin de « condamner officiellement » par « un acte fort, significatif, solennel (…) ce qui a été la faillite morale de la République à l’époque où elle a décidé de couvrir et même de proposer, d’instituer la torture ». Le président du Mouvement des Citoyens, Jean-Pierre Chevènement (ancien ministre de la Défense) a jugé qu’une procédure judiciaire devait être ouverte à l’encontre d’Aussaresses, dont « les propos provocateurs » constituent également « la révélation d’un état d’esprit qu’il faut combattre avec détermination ». Jean-Pierre Chevènement a estimé que « plus de 40 ans (ayant) passé, la prescription et la loi d’amnistie jouent » (ce que contestent par ailleurs certains juristes), mais que « si des procédures peuvent être ouvertes, (…) elles doivent l’être ». Pour l’ancien ministre, le pouvoir politique de l’époque était « bien évidemment responsable ». Jean-Pierre Chevènement ne croit pas que le pouvoir politique ait « ordonné » la torture, mais qu’il a « laissé faire » et que « ces actes étaient connus » de lui. Il a cependant affirmé que lui-même, qui a « été amené à servir en Algérie », n’a « jamais été témoin d’actes de torture » et que ceux-ci « ont été le fait de forces spéciales ». Plusieurs ministres ont par ailleurs exprimé des doutes sur la nécessité d’un acte de « repentance » à l’égard de l’Algérie : « Je ne sais pas ce que cela signifie aujourd’hui », a déclaré la ministre de la Justice Marylise Lebranchu, qui s’est dite « outrée » par l' »apologie des crimes de guerre » faite sans « remords ni regret » par Aussaresses. « Qui se repentirait, à qui va-t-on demander de se repentir », s’est demandé le ministre de la Santé Bernard Kouchner, qui a ajouté que « repentance ou pas, (il faut) savoir ce que nous avons fait en Algérie ». Bernard Kouchner a en outre estimé que les aveux du général Aussaresses ne pouvaient étonner que « les gens qui feignaient de ne pas savoir », et a dénoncé l’utilisation de « moyens ignobles ». Pour l’ancien chef de cabinet du président Mitterrand, André Rousselet, « c’est toute la classe politique qui a subi une situation gérée sur place ». Quant Aussaresses lui-même, interrogé au sujet des plaintes déposées contre lui, il a déclaré : « J’ai pour moi le droit et les ordres que j’ai reçu ». Son livre a déjà été tiré à 40’000 exemplaires. Selon un sondage publié le 9 mai par le quotidien « Libération », 56 % des Français seraient « tout à fait » (22 %) ou « plutôt » (34 %) favorables à ce que Jacques Chirac et Lionel Jospin demandent officiellement pardon au peuple algérien au nom de la France. 24 % des « sondés » sont opposés à un tel acte de repentance. 50 % des 967 personnes sondées estiment que les autorités politiques françaises de l’époque sont les principales responsables de la pratique de la torture pendant la guerre d’Algérie, et 56 % (contre 30 %) des « sondés » se disent d’accord avec des poursuites judiciaires contre les officiers ayant ordonné des actes de torture. En Algérie, après un temps de silence, une première autorité politique s’est exprimée explicitement en la personne du ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Belkhadem, qui a déclaré : « Nous n’avons pas été surpris, en tant qu’Algériens, par le contenu du livre de ce général car nous en savons plus que ce qui est dit dans cet ouvrage sur la torture pratiquée contre notre peuple », mais Belkhadem s’est cependant dit « réellement surpris » par « cette persistance à ce sujet de la part d’un homme qui appartient à un Etat venu coloniser l’Algérie au nom de la civilisation ». . Avant que cette première réaction officielle ne tombe, les partis et personnalités politiques, la presse et les organisations de défense des droits de l’homme s’étaient toutefois déjà exprimés. Le président Bouteflika, sans évoquer explicitement le cas d’Aussaresses, a déclaré dans un message adressé au président de la « Fondation du 8 mai 1945 » à l’occasion de la célébration des émeutes de Sétif, que « les aveux des bourreaux ne sont qu’une goutte d’eau dans les océans de crimes qui débordent encore sur l’oubli »La ligue algérienne des droits de l’Homme considère que « les révélations (d’Aussaresses) apportent les preuves indéniables de l’existence de violations massives et systématiques des droits de l’Homme ne pouvant être ignorées ou oubliées et couvertes par les lois protectrices garantissant l’impunité ». Le FLN déclare que les aveux du général « mettent à nouveau la France devant la réalité des crimes commis en son nom » et demande le jugement des auteurs de ces crimes, pour crimes contre l’humanité. Le Premier secrétaire du FFS, Ali Kerboua, considère cependant que « les révélations faites aujour’hui n’étonnent que ceux qui (doutaient) » et que « pour le moment, il s’agit d’une affaire franco-française ». Le président du FFS, Hocine Aït Ahmed, est cependant allé plus loin, en estimant d’une part que « la demande de jugement pour crimes contre l’humanité » est « un minimum » à l’égard d’Aussaresses, et que les prises de position de Jacques Chirac et de Lionel Jospin sur les propos d’Aussaresses sont « un bon début », mais également que le débat provoqué par son témoignage fait que « tous les Algériens savent désormais que l’immunité n’existre pas et que les crimes, tôt ou tard, rattrapent leurs auteurs » -ce qui est vraisemblablement autant un message à l’intention des tortionnaires français pendant la guerre d’Algérie qu’un message à l’intention des responsables, de tous bords, des crimes commis en Algérie après l’indépendance, et jusqu’à aujourd’hui. Pour sa part, le Conseil de coordination du FIS (CCFIS) accuse les « services de la junte » algérienne de faire pression sur les familles de victimes de torture, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis pendant la guerre d’Algérie, pour les « dissuader de porter plainte ou de faire des déclarations qui ‘mettraient en péril les relations algéro-françaises' ». Le CCFIS écrit : « En 1957, Nezzar, Belkheir, Lamari, Touati, Saadi, Gheziel, Guenaizia, Tounsi et tant d’autres étaient dans l’armée de Massu et d’Aussaresses quand Larbi Ben M’hidi et ses frères se faisaient pendre pour que vive l’Algérie libre », et suggère que « les généraux » pourraient être « gênés par des procès à venir » et auraient « peur par exemple que les archives françaises commencent à parler ». (AFP 10.5 / AP 10.5 / Reuters 11.5 / Le Monde 12.5 / El Watan 13.5, 14.5) Le débat suscité en France par les « confessions » du général Paul Aussaresses porte désormais, entre autres, sur les responsabilités de François Mitterrand, ministre de l’Intérieur puis ministre de la Justice entre 1954 et 1957, dans la « couverture » officielle donnée à la pratique généralisée de la torture en Algérie. Le 10 mai, l’avocat Jacques Vergès a accusé Mitterrand d’avoir donné l’ordre en 1957 de faire assassiner le chef du FLN algérois, Larbi Men M’Hidi, assassinat qu’Aussaresses a reconnu. Le 6 mai, l’ancien Conseiller de François Mitterrand à l’Elysée, Jacques Attali, estimait que Mitterrand avait « créé les conditions légales de la torture » en étant à l’origine de la loi sur les pouvoirs spéciaux en 1956. Henri Alleg rappelle toutefois que la torture en Algérie ne date pas de l’insurrection de 1954, mais qu’elle « a débarqué en Algérie en même temps que les troupes du corps expéditionnaire du général de Bourmont, en 1830 » François Mitterrand est garde des Sceaux du gouvernement Guy Mollet du 1er février 1956 au 12 juin 1957. Une année où la justice civile cède le pas à la justice militaire, où les premiers condamnés à mort du FLN sont guillotinés, où commence la bataille d’Alger et où l’emploi de la torture devient systématique. Début 1957, le général Massu, à qui le préfet d’Alger a confié ses pouvoirs de police, fait appel à Paul Aussaresses, qui met en place son « escadron de la mort ». François Mitterrand sait qu’on torture à Alger, et il en informe Guy Mollet (qui le sait d’ailleurs aussi). Mais il ne dénonce pas clairement cet usage, et surtout il ne démissionne pas du gouvernement. « Il attend que passe l’orage. Dans l’espoir sans doute d’être président du conseil d’un prochain gouvernement, écrit « Le Monde ». Et Jean Lacouture confie que Mitterand reconnaissait avoir « commis au moins une faute dans (sa) vie », celle de n’avoir pas démissionné du gouvernement qui couvrait la pratique généralisée de la torture et des exécutions sommaires en Algérie. Les historiens sont généralement assez mesurés sur les responsabilités de Mitterrand : s’ils s’accordent à considérérer que la torture était connue des politiques, et couverte par certains d’entre eux, ils sont moins affirmatifs sur le degré de connaissance et de complicité de l’ensemble des gouvernants. Pour Benjamin Stora, « la responsabilité de Mitterrand se pose en termes de refus de grâce pour des dizaines de condamnés à mort algériens », mais non en termes d’incitation à la torture, même s’il est vrai que « Mitterrand a laissé faire et n’a pas combattu les pratiques de la torture ». Stora insiste d’ailleurs sur le fait que lors de la bataille d’Alger, débutée en janvier 1957, « Paris avait progressivement perdu le pouvoir politique en Algérie, au profit de l’armée ». Dès le 12 mars 1956, la majorité de gauche a voté (communistes compris) la loi sur les « pouvoirs spéciaux », qui donne pratiquement carte blanche au gouvernement pour « raéblir l’ordre » en Algérie, et accroit considérablement les pouvoirs de la justice militaire. François Mitterrand est ministre de la Justice : il cosigne la loi sur les pouvoirs spéciaux et les décrets. Mais pour l’historienne Sylvie Thénault l’action de Mitterrand est « sans commune mesure avec celle, par exemple, du ministre radical-socialiste Maurice Bourgès-Maunoury, qui fut sans arrêt au pouvoir de février 1955 à mai 1958. Jean Lacouture estime que la polémique sur le rôle de Mitterrand « a lieu d’être », et que « le rôle de Mitterrand, ministre de la Justice en 1956/1957, est hautement criticable » car il ne pouvait ignorer (pas plus que Guy Mollet ou de Gaulle ne le pouvaient) la pratique de la torture en Algérie, mais que « Mitterrand est à la fois le ministre de la Justice qui couvre des actes profondément injustes et un homme public qui essaie de limiter les dégâts ». Ainsi, en octobre 1956, il fait remplacer le procureur général d’Alger, Paul Sisini, très proche de Robert Lacoste et des « ultras », par Jean Reliquet, procureur de Versaille. Dans une lettre à Guy Mollet, le 22 mars 1957, François Mitterrand écrit : « les nouvelles qui me parviennent d’Alger sur le traitement qui est réservé aux individus appréhendés par les diverses autorités investies des pouvoirs de police me créent des inquiétudes dont il est de mon devoir de vous rendre compte. Il semble en effet que la plupart d’entre eux y soient privés des garanties les plus élémentaires que les traditions du droit français apportent à la défense, même dans les heures les plus graves (…) ». Mitterrand s’inquiète du « nombre d’arrestations sans commune mesure avec celui des individus présentés par (les autorités militaires) au parquet » : sur plus de 900 personnes arrêtées avant le 14 mars 1957, seules 39 ont été présentées au parquet, « laissé par l’armée dans l’ignorance la plus compléte du sort qu’elle a réservé aux autres individus appréhendés ». police a affirmé que 48 individus avaient été abattus poiur avoir refusé d’obtempérer. Et Mitterrand d’écrire qu’il y a « tout lieu de penser qu’un tgrand nombre de tueurs, chefs de cellule ou collecteurs de fonds se trouvent encore aux mains des autorités militaires ». Il note que « les résultats obtenus par l’armée, dans le domaine de la répression du terrorisme, ont été, certes, très important », mais déplore que des « individus arrêtés pour faits de terrorismes (soient) encore soustraits à leurs juges naturels », que les procédures soient bâclées, que « trop de fuyards (soient) abattus après leur arrestation », et surtout que l’armée puisse « s’ériger en degors des lois ». Mais en écrivant à Mollet, Mitterrand ne lui apprend rien : tout le gouvernement sait ce qui se passe en Algérie. Pierre Mendès-France a quitté le gouvernement en 1956, Alain Savary en octobre 1956, Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d’Alger, démissionne en mars 1957 (le gouvernement refuse sa démission) après avoir reconnu « sur certains assignés (à résidence) les traces profondes des sévices ou des tortures qu’il y a quatorze ans (il) subissait personnellement dans les caves de la Gestapo à Nancy », mais Mitterrand, lui, ne démissione pas. Il reconnaît devant la commission de la justice de l’Assemblée nationale, le 2 avril, des « sévices ou faits regrettables » en Algérie, mais affirme qu’ils sont « certainement » moins nombreux « que la presse ne l’a dit » (alors qu’ils sont bien plus nombreux). La pratique de la torture avait été dénoncée en janvier 1955 déjà par François Mauriac dans l' »Express » et par Claude Bourdet dans « France Observateur ». En mars 1955, l’inspecteur général Wuillaume explique que la police « ne comprend pas » qu’on lui reproche d’utiliser des procédés (la torture, précisément « qu’elle utilise de longue date ». Le directeur de la Sûreté nationale, Jean Mairey, constate qu’en Algérie « l’exécution sommaire n’effraie pas nos collègues ». Le 16 avril 1957, c’est le procureur Jean Reliquet qui lui confirme que « les sévices infilgés par certains militaires aux personnes appréhendées -sans distinction de race ni de sexe » sont « relativement fréquents ». Le procureur n’exige rien de plus que la transmission aux militaires des plaintes pour torture. Et le procureur se félicitera bientôt de la bonne collaboration avec les militaires : de janvier 1957 à mai 1958, 1509 condamnations à mort ont été prononcées. Sur la responsabilité de la France face à la pratique généralisée de la torture et des exécutions sommaires en Algérie, le RPR (droite gaulliste) s’est opposé le 10 mai à tout « acte de repentance » officielle de la République, mais s’est prononcé pour la condamnation de « la revendication de ces faits » par le général Aussaresses. La veuve d’Ali Boumendjel, tué en mars 1957 à Alger, a lancé pour sa part un appel au président Chirac et au Premier ministre Jospin que pour « la vérité soit dite par ceux-là même qui représentent la France aujourd’hui et qui n’ont eu aucune responsabilité directe dans la guerre d’Algérie ». « Comment penser que le général Aussaresses ait agi en franc-tireur pendant la bataille d’Alger », demande Malika Boumendjel, qui, rappelant que « la grande figure du nationalisme algérien (…) Abane Ramdane, a été tué par les siens dans l’année qui a suivi » l’assassinat d’Ali Boumendjel par les Français, appelle à « regarder l’Histoire en face des deux côtés de la Méditerranée ». L’historien Mohammed Harbi, lui, souligne que les pratiques avouées par Aussaresses « ont à nouveau cours aujourd’hui en Algérie, mises en oeuvre par certains de nos généraux contre le peuple, qui ne l’oubliera pas ». La procédure de sanctions disciplinaires contre Aussaresses a d’ailleurs été lancée, a annoncé la présidence de la République. Le 4 mai, le président Chirac avait saisi le ministstère de la Défense pour que lui soient proposées des sanctions. Le ministre Alain Richard a fait au président une liste des sanctions possibles, et va consulter le Conseil supérieur de l’armée de terre pour que celui-ci fasse des propositions, que le ministre transmettra au président, seul habilité à prendre finalement la décision, qui fera l’objet d’un décret. La sanction la plus probable est une « mise à la retraite » essentiellement symbolique (Aussaresses à déjà 83 ans). Quant à Paul Aussaresses, il a exprimé pour la première fois le 11 mai ses « regrets sincères d’avoir été amené à commettre de pareilles actions », et a révélé que sa famille avait été littéralement traumatisée par son témoignage, que ses enfants le reniaient et que l’une de ses filles voulait cesser de porter son nom. Dans un entretien avec Jean-Pierre Elkabach, sur la chaîne parlementaire « Public Sénat », Aussaresses a par ailleurs révélé avoir « monté dans les moindres détails une opération visant à liquider Ben Bella et ses camarades » de la direction du FLN, détenus avec lui en France (Hocine Aït Ahmed, Mohamed Khider, Mohamed Boudiaf et Mustapha Lacheraf). L’opération serait passée pour un « acvcident dû au gaz », et les cinq hommes auraient été involontairement sauvés par François Mitterrand, alors ministre de la Justice. En Algérie, une procédure a été lancée, et acceptée par le procureur, contre Aussaresses à Tebessa, pour crime de guerre et acte de torture, par la famille d’un homme (Messaoud Amrani) arrêté et torturé en 1956 puis condamné à dix ans de travaux forcés. Le général Paul Aussaresses, né en 1918, est passé de la Résistance à la guerre d’Indochine, puis à celle d’Algérie, puis au commerce des armes. Il est entré dans les services spéciaux de la France Libre en 1942, dans les réseaux « africains » de Jacques Foccart après la guerre, puis au SDECE (contre-espionnage). Il a fait la guerre d’Indochine sous les ordres du général de Bollardière, qu’il qualifie d' »archange » dans son témoignage -mais qui lui, refusera d’accepter la pratique de la torture. Il arrive en Algérie, à Philippeville (Skikda) en 1955. Il est désigné en 1957 par le général Massu pour coordonner les renseignements à Alger. Au début des années 60, on le retrouve au Vietnam, formant les militaires américains. Commandant du 1er RCP en 1966, il est ensuite représentant de la France à l’OTAN, puis attaché militaire au Brésil. Nommé général en 1973 (au moment où il quitte l’armée d’active), il se reconvertit dans le civil. Dans les années ’80, il était chargé de décrocher des contrats d’armements pour Thomson. Paul Aussaresses est commandeur de la Légion d’honneur depuis 1965, et médaillé de la Résistance.LA LDH INTENTE UN PROCÈS À L¹ENCONTRE DU GÉNÉRAL AUSSARESSESCOMMUNIQUÉ DE LA LIGUE DES DROITS DE L¹HOMMEParis, le 4 mai 2001La LDH a saisi M. le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris d’une plainte pour apologie de crimes et de crimes de guerre à l’encontre du général AUSSARESSES. La LDH considère, en effet, que, si l’hypothèse de juger le général AUSSARESSES et tous autres pour les crimes commis durant la guerre d’Algérie reste ouverte, les propos de ce militaire constituent, en tout état de cause, une apologie des crimes qu’il a commis. Ces faits sont prévus et réprimés par la loi sur la presse et la LDH entend que le général AUSSARESSES en réponde. Elle rappelle, en outre, qu’elle a demandé dès le 30 janvier 2001 au président de la République d’entamer toutes les procédures nécessaires pour que le général AUSSARESSES et toutes autres personnes concernées, civiles ou militaires, soient privés de leurs décorations. Elle se félicite qu¹enfin le président de la République ait pris la décision de suspendre le général de l¹ordre de la Légion d¹Honneur. Mais cela ne doit pas se borner au seul général AUSSARESSES. De la même manière, il appartient au président de la République de reconnaître, au nom de la France, les responsabilités de notre pays. AMNESTY INTERNATIONAL INTERPELLE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU SUJET DE LA TORTURE EN ALGERIE APRES LA PARUTION DU LIVRE DU GENERAL AUSSARESSES(4 mai, traduit de l¹Anglais par Jacques Becker)France / Algérie : la France doit faire face à ses obligations juridiques.Dans un livre intitulé : Services Spéciaux. Algérie 1995 – 1957, publié le 3 mai, le gouvernement français est directement impliqué dans la torture et l¹exécution sommaire d¹Algériens pendant la guerre d¹Algérie. Ces allégations sont faites par le général Aussaresses, officier de haut rang pendant la guerre d¹Algérie et coordinateur des services de renseignements pendant la bataille d¹Alger en 1957. Quoique Amnesty International ne puisse affirmer aujourd¹hui que les accusations du général Aussaresses qui impliquent directement le gouvernement français dans des crimes contre l¹humanité sont fondées, celles-ci sont extrêmement sérieuses et nécessitent une enquête rapide et sérieuse. La France a le pouvoir de faire comparaître devant un tribunal les criminels de guerre de la période de Vichy. Pour Amnesty International, aujourd¹hui il devrait être possible pour la France de remplir ses obligations légales concernant la guerre d¹Algérie. Dans son livre, le général Aussaresses justifie non seulement l¹usage de la torture et des exécutions sommaires auxquelles il a personnellement pris part mais affirme encore que le gouvernement français, notamment par l¹entremise du Ministre de la Justice de l¹époque, François Mitterrand, devenu plus tard Président de la République, était régulièrement informé de ces pratiques et tolérait l¹usage de la torture, des exécutions sommaires et des déplacements forcés de population. Le général prétend que le bureau de François Mitterrand était personnellement informé par un juge-enquêteur qui faisait office d¹émissaire en Algérie. Lorsque le 24 novembre 2000,un certain nombre d¹officiers de l¹armée, parmi lesquels le général Aussaresses et le général Massu, ont admis publiquement leur implication dans la torture et les exécutions extra-judiciaires, Amnesty International a appelé le gouvernement français à organiser le procès de ces responsables pour crime contre l¹humanité et crime de guerre. L¹organisation affirmait qu¹il n¹était pas suffisant de reconnaître que de tels crimes avaient eu lieu, la vraie question était l¹impunité, toujours actuelle, de leurs responsables. « Les procédures légales contre un certain nombre de criminels de guerre, parmi lesquels Barbie, Papon et Touvier, en relation avec des crimes commis sous le régime de Vichy pendant la seconde guerre mondiale, ont montré qu¹il n¹y avait pas limite de temps pour juger les crimes contre l¹humanité. » ajoutait Amnesty International. Toutefois, en dépit du fait que le gouvernement français se soit félicité de l¹arrestation du général Pinochet en Angleterre, les autorités françaises se sont refusées depuis cette époque à faire quoique ce soit ou même à créer une commission d¹enquête sur l¹usage de la torture. Le 14 décembre, le Président Jacques Chirac a rejeté les appels à une approbation officielle de l¹usage de la torture par les militaires durant la guerre. Les allégations contenues dans le livre renforcent l¹urgence de la nécessité pour la France de faire face à ses obligations légales, non seulement en regard de la Convention de Genève mais aussi en rapport de l¹article 212-1 de son propre code pénal où les crimes contre l¹humanité sont définis, entre autre, comme la pratique massive des exécutions sommaires et de la torture pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux et sociaux, et sont reconnues imprescriptibles. Amnesty International ajoute : « Sachant tout cela et étant donné les graves révélations et les sérieuses accusations du général Aussaresses, les autorités françaises n¹ont plus aucune excuse pour ne pas engager des poursuites judiciaires. » (AP 16.5) Le Premier ministre français a rendu le 16 mai à l’Assemblée nationale un hommage appuyé aux militaires français « qui ont fait le devoir avec honneur » pendant la guerre d’Algérie, et qui « n’ont pas à se sentir coupables » des « actes inhumains et barbares » commis lors du conflit, « des deux côtés, même si chaque camp, trop longtemps, a eu tendance à nier les siens » pour mettre en évidence ceux de l’adversaire. « Ces actes, nous ne les découvrons pas aujourd’hui » et beaucoup d’entre eux « étaient connus ou ont été révélés en leur temps », a rappelé Lionel Jospin, pour qui « le moins que l’on puisse faire c’est de permettre que l’histoire de cette terrible soit écrite librement ». Le Premier ministre français a également souhaité « que la justice passe si elle peut encore le faire ». Pour lui, les soldats du contingent engagés dans une guerre « que souvent ils ne voulaient pas » n’ont pas à se sentir « coupables », pas plus que « les officiers et les soldats de carrière qui ont fait leur devoir avec honneur ». Quant aux autres, « ceux qui ont accompli des actes barbares et inhumains non conformes à l’honneur », ils doivent être « stigmatisés », alors que « tous ceux qui ont simplement fait leur devoir, qui ne doivent en rien être confondus avec les tortionnaires, ceux-là méritent seulement, quarante après, d’être saliés ». Interrogé sur son attitude au moment de la guerre d’Algérie, Lionel Jospin a affirmé s’être alors « élevé » à sa « modeste place à l’époque contre l’usage de la torture ». et « contre le vote des pouvoirs spéciaux accordés à un gouvernement le 12 février 1956 ». Cette guerre « longue, déchirante et cruelle », qu’il a vécue « comme jeune lycéen puis comme étudiant », Lionel Jospin était trop jeune pour avoir à la faire (« Je faisais mes classes au moment où sont intervenus les accords d’Evian, si bien que le peloton que je m’apprêtais à aller conduire en Algérie, dans une guerre que je n’aimais pas et que j’avais combattue, n’a pas eu à aller sur cette terre »), mais pas trop jeune la combattre : « Je me suis engagé pour la paix, (…) j’ai pris position en faveur de l’autodétermination, puis en faveur de l’indépendance », a affirmé le Premier ministre français. (Le Monde 15.5, AP 16.5) L' »affaire Audin », du nom du jeune mathématicien communiste enlevé par les parachutistes à Alger le 11 juin 1957 et jamais réapparu depuis, connaît un rebondissement, avec le témoignage dans « La République des Pyrénées » du 11 mai d’un homme, Yves Cuomo, sergent à l’époque des faits, mis en cause par le général Paul Aussaresses. Yves Cuomo révèle que le prisonnier qui s’est enfui de la jeep qu’il conduisait le 21 juin 1957 était cagoulé et qu’il pourrait ne pas s’agir de Maurice Audin, la version officielle de l' »évasion » de celui-ci pouvant avoir été montée de toutes pièces pour « camoufler » une exécution sommaire ou la mort d’Audin sous la torture. « Paul Aussaresses tient à couvrir quelqu’un (…). C’est vraio que j’ai été mouillé dans cette affaire, mais vraiment sans rien savoir », explique Yves Cuomo. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1957, des hommes du 1er régiment de chasseurs parachutistes arrêtent à son domicile Maurice Audin, 25 ans, assistant à la faculté des sciences d’Alger, membre du PC algérien (dissous trois ans plus tôt). Ni sa femme, ni leurs enfants ne le reverront, ni mort, ni vivant. Le 1er juillet, Josette Audin est informée par le commandement militaire de la région d’Alger que son mari s’était évadé (avait « bondi » hors du véhicule dans lequel il avait pris place avec deux sergents, Yves Cuomo et Pierre Misiri) et avait disparu, après que Pierre Misiri ait tiré plusieurs rafales de pistolet-mitrailleur dans sa direction. Pour l’armée, l’affaire était classée. Une enquête minutieuse, aboutissant en 1958 à la parution du livre de Pierre Vidal-Naquet « L’Affaire Audin », contestera rapidement la version officielle, mais celle-ci restera inchangée pendant 44 ans, malgré plusieurs enquêtes et instructions judiciaires, dont aucune n’aboutira. On se demande encore aujourd’hui si Maurice Audin est mort sous la torture, à laquelle il a été soumis à El Biar, ou assassiné (étranglé) par un lieutenant Charbonnier exaspéré par son mutisme. Le Secrétaire général de la police à la préfecture d’Alger, Paul Teitgen, penchait pour cette deuxième hypothèse, mais les pouvoirs politiques et judiciaires ont toujours « couvert » l’armée, y compris dans le « montage » d’une « évasion ». Le sergent Cuomo assure qu’une réouverture du dossier Audin, et un éventuel procès, ne lui font pas peur. Il a été présenté par Paul Aussaresses comme le membre d’une « seconde équipe », occulte, de l' »escadron de la mort » qu’il commandait pendant la bataille d’Alger. Cuomo dénonce cette affirmation et affirme qu’il n’était « ni directement, ni indirectement sous les ordres d’Aussaresses », dont il se demande qui il veut « couvrir ». Le 11 mai, la veuve de Maurice Audin avait annoncé son intention de porter plainte contre X pour « séquestration » et « crimes contre l’humanité », procédure qui a plus de chances d’aboutir que toutes celles lancées contre le général Aussaresses, puisque le corps de Maurice Audin n’a jamais été retrouvé, ce qui exclut l’invocation de la prescription. La veuve de Maurice Audin a effectivement déposé le 16 mai une plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour « crimes contre l’humanité » et « séquestration », plainte qui implique obligatoirement la désignation d’un juge d’instruction. (El Watan 17.5) Dans un entretien au quotidien « El Watan », l’historien algérien Mohamed Harbi, qui souhaite que les autorités françaises et algériennes ouvrent toutes leurs archives concernant la guerre d’Algérie aux chercheurs, doute qu’elles « soient en mesure de le faire », d’une part parce que des lois imposent des limitations à l’accès aux archives, mais également parce que ces archives pourraient « sûrement » contenir des choses gênantes « pour nombre d’acteurs qui trichent sur leur itinéraire ». En Algérie, s’agissant de la connaissance de l’histoire de la guerre d’indépendance, « les pouvoirs qui se sont succédé depuis 1962 ont été en dessous de tout » et « notre histoire récente a été occultée pour des raisons politiques », estime Mohamed Harbi, qui signale que « ce sont les chercheurs français qui ont le plus produit » sur des thèmes comme les prisons, les camps de regroupement ou d’hàbergement, la répression, et cela faute d’un véritable « champ intellectuel en Algérie » -un tel champ supposant « une totale liberté d’expression, un climat propice à l’échange et au débat en dehors de toute intervention de l’Etat ». Sur la question de la torture, l’historien algérien estime que « pour être crédible » dans la dénonciation, « il faut d’abord balayer devant sa porte (…). Si nous voulons que notre société quitte les ornières de la violence, il faut commencer par respecter l’intégrité physique des individus. La question de la torture nous concerne tous. Or je constate que chaque groupe ne la dénonce que lorsque les siens en sont victimes ». Et de témoigner qu’en 1964, il avait posé le problème de la torture au comité central du FLN : « Boumediène a répondu froidement : ‘Donnez-moi un autre moyen d’avoir des renseignements' »… (HRW 14.5 / Reuters, AP 17.5 / MRAP, FIDH 17.5 / AP 18.5 / El Moudjahid 20.5 / CSSI) Le général Aussarresses sera poursuivi pour ses écrits, mais pas pour ses crimes : une enquête préliminaire pour « apologie de crimes de guerre » a été confiée à la police judiciaire de Paris pour procéder à l’audition de Paul Aussaresses et de son éditeur (Perrin). A l’issue de cette procédure, le général de 83 ans devrait être cité devant le tribunal correctionnel. Il encourt théoriquement une peine maximale de 5 ans de prison et de 300’000 francs d’amence. Son avocat, Gilbert Collart, a estimé « un peu inéquitable que le général Aussaresses, parce qu’il a fait un livre, soit le seul à porter le poids de cette période de notre histoire voulue par beaucoup d’hommes dont certains vivent encore ». L’avocat, qui considère que « ce serait trop facile qu’un seul soit responsable de ce qui a été finalement tout un fonctionnement d’Etat », et qui insiste sur le fait que son client a « exécuté des ordres qui ont été dénnos par des militaires » couverts par le pouvoir politique, insiste sur le fait qu' »on ne reproche pas au général d’avoir fait ce qu’il a fait au nom des oprdres reçus », mais « de l’avoir dit ». Pour le procureur Jean-Pierre Dintilhac, « en justifiant l’emploi de la torture par le contexte de la guerre, le général semble déclarer que si le contexte se reproduisait, il faudrait agir de même, ce qui pose un problème moral », mais la torture et les assassinats reconnus par Aussaresses ne constituent pas juridiquement (selon le procureur) des « crimes contre l’humanité » mais des « crimes de guerre » couverts par la loi d’amnistie du 31 juillet 1968 (ce que la plupart des ONG contestent par ailleurs). Le crime contre l’hamnité suppose l’exisytence d’un « plan concerté » visant à l’extermination, la réduction en esclavage ou la déportation d’une population, ce qui selon le parquet n’a pas été le cas en Algérie. Le parquet a été saisi de deux plaintes contre Aussaresses : l’une de la Ligue française des droits de l’homme pour « apologie de crimes » (c’est cette plainte qui a été retenue), l’autre de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme pour « crimes contre l’humanité ». Deux autres plaintes pour « crimes contre l’humanité », cette fois avec constitution de parties civiles (ce qui implique obligatoirement la saisie d’un juge d’instruction, qui pourra ouvrir une procédure contre l’avis du parquet), ont été déposée auprès du doyen des juges d’instruction de Paris : l’une par le MRAP (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), l’autre par Josette Audin, veuve d’un militant communiste disparu en 1957 après son arrestation par l’armée. La plainte de Josette Audin vise également des faits de « séquestration », un acte qui serait juridiquement considéré comme étant commis actuellement puisque le corps de Maurice Audin n’a jamais été retrouvé et que, formellement, il est considéré comme « disparu », donc présumé vivant. La loi d’amnistie de 1968 stipule cependant que tous les faits « en relation » avec la guerre d’Algérie ne peuvent plus recevoir de qualification pénale. Pour le MRAP, « la condamnation pour apologie de crime contre l’humanité (…) ne saurait en aucun satisfaire la recherche de justice et de vérité attendue (car elle) revient à condamner quelqu’un non pas pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il dit avoir fait ». Cela étant, le MRAP entend se constituer partie civile dans la procédure pour apoligie des crimex contre l’humanité, « le succès de librairie du livre de Paul Aussaresses constituant à lui seul un outrage à toutes les victimes ». Le MRAP demande en outre la mise sous séquestre des droits d’auteurs perçus ou à percevoir. Il réitère également sa demande de « reconnaissance officielle, par le Président de la République et le Premier ministre, des crimes qui ont été commis » pendant la guerre d’Algérie. La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) s’étonne pour sa part que le Parquet n’ait « pas souhaité ouvrir une information » pour crimes contre l’humanité, alors que « suffisamment d’éléments (démontrent) que les exactions décrites par le Général Aussaresses (sont) constitutives de crimes contre l’humanité ». Pour la FIDH, il ressort du témoignage d’Aussaresses, des études historiques et des témoignages de certains des supérieurs d’Aussaresses, dont le général Massu, « que la pratique des arrestations massives et arbitraires, des disparitions, de la torture et des exécutions sommaires avait été institutionnalisée », ce qui est constitutif de crimes contre l’humanité. La FIDH annonce dès lors son intention de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Paris, pour crimes contre l’humanité. Dans une lettre adressée à jacques Chirac le 14 mai, l’ONG américaine Human Rights Watch lui demande d’ordonner « une enquête complète et indépendante au suijet des allégations formulées par le Général Paul Aussaresses d’après lesquelles le gouvernement français a ordonné ou toléré le recours à la torture et aux exécutions sommaires » en Algérie. « Si elles étaient avérées, les allégations du Général Aussaresses impliqueraient directement les responsables du gouvernement français » dans la violation des Conventions de Genève, estime HRW, qui ajoute que « le fait que les forces indépendantistes algériennes aient régulièrement violé ces même règles auxquelles elles étaient tenues, notamment en s’attaquant systématiquement à la population civile », ne peut justifier « la pratique de la torture et des exécutions sommaires » par des forces française, ni ne peut « constituer aujourd’hui, aux yeux des autorités françaises, un prétexte pour ne pas ordonner une enquête sur ces faits ». Pour HRW, les actes allégués peuvent constituer des crimes contre l’humanité, en tant qu' »actes de violence commis dans le cadre d’attaques contre des personnes appartenant à un groupe déterminé, national ou non. (…) (ces crimes) ne peuvent être couverts par l’amnistie, ni par toute autre forme d’immunité (…). Ils sont imprescriptibles ». Dans un communiqué, le ministère algérien des Moudjahidines (anciens combattants), au motif de « lever toute équivoque circulant dans certains milieux journalistiques sur la prétentue négligence de notre département ministériel en vue d’une prise de position officielle sur la question » (de nombreux articles et commentaires parus dans la presse algérienne à la faveur du débat provoqué en France par les « aveux » d’Aussaresses, ont mis en évidence non seulement le silence des autorités algériennes sur la question de la torture pendant la guerre d’Algérie, mais également fréquemment dénoncé l’amnésie organisée » de la société algérienne sur sa propre histoire), affirme que les déclarations du « tortionnaire » Paul Aussaresses « ne nous apprennent rien de nouveau » et que « la reconnaissances des crimes commis par ce général tortionnaire et sanguinaire (…) est comme un arbre qui cache la forêt, car le peuple algérien a toujours été conscient des génocides et des crimes commis par le colonialisme ». Quant à Aussaresses lui-même, s’il affirme dans « Le Parisien » du 18 mai qu’il a des regrets et même des remords » pour ce qu’il a fait, il refuse d’en demander pardon, refuse que « d’autres, l’armée, a fortiori la France demandent pardon » et se déclare « indigné » par les sanctions disciplinaires proposées (à la demande du président Chirac) par le ministre de la Défense, Alain Richard. Le général affirme qu’il s’opposera « totalement » à ces sanctions « injustes », et qu’il n’acceptera « pas de perdre la Légion d’Honneur ». « Je n’ai commis aucun crime », estime Paul Aussaresses : « aucun prisonnier n’est mort de mes propres mains, sous la torture », si certains ont succombé « bien sûr » des mains de ses subordonnés. Mais « c’étaient des actes de défense », affirme le général. (L’Humanité 18.5 / Le Monde 19.5, 20.5) Les douze signataires de la déclaration parue dans « L’Humanité » en octobre 2000, réclamant une condamnation par le président Chirac et le Premier ministre Jospin de la torture pendant la guerre d’Algérie, ont publié, toujours dans « L’Humanité », un nouveau texte réitérant cette demande après la publication du témoignage du général Aussaresses » : « Il est urgent que la condamnation de la responsabilité des gouvernants d’alors intervienne sous forme d’une déclaration officielle des plus hautes autorités. Sans cela, demeure une équivoque sur la raison d’Etat dont se recommandent toujours les tortionnaires », écrivent Henri Alleg, Madeleine Rebérioux, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, Nicole Dreyfus, Gisèle Halimi et Josette Audin, qui demandent à être reçus par Jacques Chirac et Lionel Jospin et estiment que « la France, en condamnant solennellement les actes incriminés, donnerait un exemple salutaire ». « Chacun à sa manière, les anciens appelés de la guerre d’Algérie sortent de quarante ans de silence », constate par ailleurs « Le Monde : « Jamais les livres, les débats, les témoignages à usage familial, les manuscrits publiés à compte d’auteur, les journaux de campagne ressortis des tiroires n’ont été aussi nombreux. Comme si une catharsis générale touchait enfin la génération des djebels ». Les témoignages « spectaculaires » d’Aussaresses et de Massu font l’événement politique et médiatique, mais plus généralement et plus profondément, c’est toute la génération de la guerre d’Algérie (des appelés aux « porteurs de valise ») qui non seulement se met à parler, mais surtout qui commence à être entendue : « On a l’air de se souvenir qu’on a torturé en Algérie alors qu’on le sait depuis quarante-cinq ans. On a essayé d’en parler, mais personne ne nous a écoutés : on était tout de suite traités d’assassins », raconte Grégoire Alonso, ancien parachutiste. Pour sa part, l’historienne Claude Mauss-Copeaux considère que « quand Lionel Jospin dissocie ‘ceux qui ont fait leur devoir’ des tortionnaires, il entretient l’ambiguïté, car des soldats, pour obéir, ont torturé ». Claude Mauss-Copeaux demande que l’on rende hommage à « ceux qui ont eu le courage de dire ‘non’, comme le général de Bollardière, sanctionné pour avoir protesté contre la torture, ou Noël Favrelière qui, refusant d’être complice d’une corvée de bois (exécution sommaire), a déserté avec son prisonnier ». Deux millions de Français nés entre 1932 et 1943 ont effectué leur service militaire en Algérie entre 1955 et 1962. Au plus fort de la guerre, 400’000 militaires français, dont 80 % d’appelés, étaient en Algérie, aux côtés de près de 120’000 Algériens combattant dans le camp de la France (40’000 appelés, 20’000 engagés et 58’000 harkis) -mais dont de nombreux ont cependant déserté ce camp. La guerre a fait des centaines de milliers de victimes : les pertes militaires françaises s’élèvent officiellement à près de 25’000 morts (dont plus d’un tiers par accident), 65’000 blessés et 485 disparus. Les pertes civiles françaises d’Algérie se sont officiellement élevées à 2788 tués, 7541 blessés et 875 disparus. Entre 30’000 et 150’000 harkis ont été tués dans les combats ou dans l’épuration après 1962. Du côté algérien, le discours officiel parle d' »un million et demi de martyrs ». Le bilan officiel français retient le chiffre de 200’000 morts. Les recherches historiques les plus récentes suggèrent un demi-million de morts, y compris les victimes algériennes de la lutte menée par le LFN contre ceux qui refusaient son hégémonie (les messalistes, notamment). Ces pertes équivalent, par rapport à la population, à la saignée de la guerre de 1914-1918 pour la France. « Le Monde » estime qu’en France aujourd’hui « quelque six millions de personnes ont une partie de leur vie liée à l’Algérie » (pied-noirs, harkis, Algériens, Français d’origine algérienne, Français solidaires du FLN, ainsi que les descendants des uns et des autres). (Le Monde 23.5) Le Comité national de liaison des harkis prépare une plainte pour « crimes contre l’humanité » visant l’abandon par la France, en 1962, des supplétifs algériens engagés dans l’armée française pendant la guerre d’Algérie, a annoncé l’avocat du comité, Philippe Reulet, le 19 mai. Selon l’avocat, la procédure sera introduite devant le Tribunal de Grande instance de Paris sur la base de « dizaines de témoignages de harkis abandonnés en Algérie ou refoulés du territoire français à leur arrivée à Marseille et réexpédiés en Algérie ». Entre 30’000 et 150’000 harkis, selon les sources, ont été massacrée en Algérie en 1962 après avoir été désarmés et abandonnés par la France aux représailles algériennes. Seuls 20’000 d’entre eux, soit un dixième du total des harkis, ont pu se réfugier en France, où ils ont d’ailleurs été particulièrement mal accueillis et mal traités. Pour l’avocat du Comité national de liaison des harkis, « La France, avant de se repentir à l’égard de ses ennemis d’hier, devrait le faire pour ceux qui l’ont défendue ». (Libération 24.5 / Le Monde 26.5) Dans une contribution (dans « Libération ») au débat sur la torture pendant la guerre d’Algérie, l’ancien éditeur Nils Andersson (éditeur en Suisse pendant la guerre d’Algérie d’ouvrages interdits, saisis ou non diffusés en France, comme « La Question », « la Gangrène », « les Disparus », ainsi que de textes du FLN), considère que « l’horreur de la torture ne doit pas cacher, bafouant les lois et les valeurs de la République, les autres crimes de guerre commis pendant la guerre d’Algérie. On ne peut se satisfaire d’une mémoire sélective ignorant qu’il y eut des camps de regroupement, des ratonnades, comme celle du 17 octobre 1961, ou des opérations « homo » (pour homicides), l’assassinat de personnalités par les services secrets », opérations dont Andersson donne plusieurs exemples : assassinats de responsables du FLN (Aït Ahcène à Bonn, Nouasri à Francfort, Aissiou à Bruxelles, Boularhouf à Rome, Ould Aoudia à Paris) ou de militants contre la guerre, comme Georges Laperche, professeur de Liège, favorable à l’indépendance de l’Algérie, tué par un colis piégé le 25 mars 1960. Ces assinats étaient le plus souvent attribués à la « Main Rouge », qui n’était qu’une émanation des services spéciaux français, le SDECE. L’un des responsables de ces opérations, Constantin Melnik, alors conseiller technique auprès du Premier ministre Michel Debré pour les questions se sécurité et de renseignements affirme lui-même, clairement, que « la communauté du renseignement n’est que la servante obéissante du pouvoir politique ». Et Nils Andersson de conclure par un appel à « faire la clarté sur les opérations ‘homo » qui touchent au plus près à la raison d’Etat et à la responsabilité directe du pouvoir à son plus haut niveau ». (AP 29.5, 30.5) Le Conseil supérieur de l’armée de terre s’est réuni le 29 mai pour étudier les éventuelles sanctions à prendre contre le général Aussaresses pour ses déclarations sur la torture en Algérie, et a transmis des propositions -qui n’ont pas été rendues publiques- au ministre de la Défense Alain Richard, qui devra les transmettre au Président de la République Jacques Chirac, habilité à prendre la décision finale. La sanction disciplinaire la plus probable, une mise à la retraite d’office du général (âgé déjà de 83 ans…) aurait évidemment une valeur purement symbolique. Une nouvelle plainte pour crimes contre l’humanité avec constitution de partie civile a été déposée contre Aussaresses le 30 mai, par la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), après qu’une première plainte sur le même chef d’accusation, mais sans constitution de partie civile, déposée par la FIDH ait été classés sans suite -ce qui ne sera pas possible avec le nouvelle plainte, puisqu’en droit français la constitution de partie civile implique une instruction. (AP 1.6, 3.6) La Ligue des droits de l’Homme a annoncé qu’elle demandait au Garde des Sceaux (ministre de la Justice) d’ordonner la révision des procès relatifs à l' »affaire El-Halia », après les révélations de Paul Aussaresses dans son ouvrage « Services sp-ciaux, Algérie 1955-57 ». En 1955, une insurrection dans le village minier d’El Halia avait fait 35 morts côté « européen ». L’armée française avait mené une répression féroce (Aussaresses admet avoir fait exécuter une soixantaine d’insurgés sur les lieux et le jour même du massacre) avant d’arrêter des mineurs algériens sur leur lieu de travail. Torturés pendant plusieurs semaines, mis au secret pendant près d’un an, ils avouent être les auteurs de la tuerie d’El Halia, mais 44 d’entre eux se rétracteront lors du premier procès de Philippeville, en février-mars 1958. 15 d’entre eux avaient tout de même été condamnés à mort, les autres aux travaux forcés, mais ce jugement avait été annulé en cassation. En octobre 1958, 31 accusés seront relaxés, et deux condamnations à mort confirmées, commuées ensuite en travaux forcés par le général de Gaulle. Mais la plupart des hommes acquittés ont tout de même été mis dans des camps, et plusieurs d’entre eux furent tués par l’OAS, ou ont disparu. Les avocats de la Ligue des droits de l’Homme, Michel Zaoui et Gisèle Halimi, invitent la ministre de la Justice Marylise Lebranchu à « prendre l’initiative d’une procédure de révision qui permettra de réécrire la page la plus importante de l’histoire judiciaire française pendant la guerre d’Algérie ». Toujours à propos de la guerre d’Algérie, Jean-Marie Le Pen s’est distingué le 3 juin en déclarant que le recours à la torture par l’armée française ne lui semblait « pas particulièrement injuste » et que « face à une offensive terroriste dont l’un des éléments de puissance est le secret, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de moyens de briser le secret sinon par la force ». (Reuters 6.6) Le général Paul Aussaresses a été « placé d’office en position de retraite » (c’est-à-dire mis à la retraite d’office) « par mesure disciplinaire », selon un décret adopté par le Conseil des ministres pous santionner les déclarations et les aveux du Général à propos de la pratique de la torture et des exécutions sommaires en Algérie. Cette sanction, prise pour la première fois depuis plus de vingt ans, est motivée, a déclaré le ministre de la Défense Alain Richard, « par les déclarations publiques de cet officier général se prévalant de façon répétée de comportements injustifiables en les présentant comme légitimes dans la situation du conflit algérien ». La sanction a été prise après « avis unanime favorable » du Conseil supérieur de l’armée de terre. Le seul effet concret de cette sanction, essentiellement symbolique vu l’âge de l’intéressé (83 ans), est qu’il ne pourra plus porter l’uniforme. Selon le ministre des relations avec le Parlement, Jean-Jack Queyranne, les déclarations d’Aussaresses portent « gravement atteinte à la dignité militaire et au renom de l’armée ». Le Parquet de Paris a pour sa part ouvert une enquête préliminaire contre Aussaresses pour « apologie de crimes de guerre ». La veuve du général de Bollardière, qui avait décidé de démissionner de son poste en Algérie pour protester contre la pratique de la torture, explique au « Nouvel Observateur » qu’elle ne comprend pas le procès fait à Aussaresses : « Finalement, dans cette histoire, deux généraux auront été sanctionnés. L’un parce qu’il a refusé de torturer. L’autre parce qu’il a reconnu l’avoir fait. A croire que ce que la France attendait d’eux, c’est qu’ils torturent et en silence ». (Le Monde 9.6) Les harkis ont décidé de saisir l’occasion de la résurgence du débat sur la guerre d’Algérie, après les aveux du général Aussaresses, pour poser le problème de la reconnaissance par la France de leur abandon après les accords d’Evian. Plusieurs associations ont exprimé l’intention de déposer plainte pour « crime contre l’humanité ». Le 19 mai, une semaine après l’ouverture d’une information judiciaire contre le général Aussaresses, pour « apologie de crimes de guerre », 43 présidents d’associations harkies se sont accordés sur la perspective d’une procédure pour « crimes contre l’humanité ». Mohand Hamoumou, fils de harki et auteur de « Et ils sont devenus harkis » explique : « nous n’en serions pas là si la France avait reconnu ses torts ». Boussad Azni, également fils de harki et président du Comité de liaison de la « communauté harkie » est l’un des initiateurs d’un projet de plainte pour « crimes contre l’humanité »; il explique que « puisque la France veut faire la lumière sur la guerre d’Algérie, qu’elle assume complètement, sans oublier les milliers de harkis qu’elle a abandonnés en 1962 », et les milliers de harkis rapatriés en France, souvent malgré les ordres formels de les laisser aux mains du FLN, mais traités ensuite indignement en France : « arabes » pour les racistes, « traîtres » pour les Algériens. Plusieurs dizaines de milliers de harkis ont été abandonnés aux représailles du FLN après les accords d’Evian de 1962. Une éventuelle plainte des harkis pour « crimes contre l’humanité » se heurterait, de l’aveu même de l’avocat de Boussad Azni, à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais son but est de démontrer, sur la base de témoignages de rescapés et de documents historiques, l’existence d’un « plan concerté » pour l’élimination des supplétifs algériens de l’armée française. La population habituellement désignée comme « harkis » ou « Français musulmans » correspond à l’ensemble des rapatriés d’origine algérienne s’étant battus du côté de la France pendant la guerre d’Algérie, et à leurs descendants, soit au total environ 400’000 personnes. En mars 1962, la France évaluait à 263’000 le nombre total des « musulmans » pro-français (harkis, élus, anciens combattants, fonctionnaires) menacés par les représailles du FLN. Les accords d’Evian reconnaissant l’indépendance de l’Algérie ne prévoyaient aucune protection à l’égard des harkis. Le gouvernement français (Michel Debré étant Premier ministre) donna l’ordre de dissoudre les unités supplétives et le ministre des Affaires algériennes, Louis Joxe, menaça de sanctions ceux qui aidaient les « rapatriements prématurés ». Néanmoins, 20’000 supplétifs algériens de l’armée française ont été ramenés en France. Entre 30’000 et 150’000 de ceux qui sont restée en Algérie y ont été massacrés. En France, les survivants rapatriés ont été souvent regroupés dans des camps ou des « hameaux forestiers » isolés, dans des conditions précaires, perpétuant leur exclusion. L’indemnisation accordés dans les années 1970 aux pieds-noirs n’a été étendue qu’en 1994 aux harkis, à qui la loi exprimait la « reconnaissance » de la République pour les « sacrifices consensit », mais ne reconnaissait aucune responsabilité politique de la France. La loi allouait à 15’000 familles une allocation forfaitaire de 110’000 FF. En 1999, une rente viagère de 9000 FF/an pour les harkis de plus de soixante ans et ne disposant que de faibles revenus a été instaurée. S’agissant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les forces françaises pendant la guerre, Ahmed Raffa, porte-parole du Comité de liaison assure que « les harkis n’ont jamais participé à cette barbarie, sauf une minorité qui était entrée dans cette guerre pour venger des membres de leurs familles massacrées par le FLN » (des témoignages concordants font au contraire état de la pratique systématique de la torture et d’exécutions sommaire par des harkis sur territoire français métropolitain, notamment à Paris, au début des années soixante, contre des militants -ou présumés tels- du FLN). Lors de la visite du président Bouteflika en France en juin 2000, celui-ci avait refusé de s’entretenir avec les représentants des harkis, qui revendiquent le droit de se rendre dans leur pays natal, et les avaient traité de « collabos » dans un entretien télévisé. Un ancien harki refoulé par deux fois à la frontière algérienne, cité par « Le Monde », répond : « Nos terres ont été accaparées par les gens du FLN qui nous avaient dénoncés. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour nous interdire de revenir à jamais ». Le président Jacques Chirac a annoncé l’organisation, le 25 septembre 2001, d’une « journée nationale d’hommage aux harkis », commémoration unique, quelques mois avant l’élection présidentielle (les harkis ont le droit de vote…), mais à la faveur de laquelle les harkis attendent, peut-être d’un discours présidentiel, une reconnaissance officielle de la responsabilité de leur abandon par la France, et l’annonce de mesures de réparations. « Le dépôt d’une plainte me gêne en pleine turbulence électorale », reconnaît le président du Conseil national des Français musulmans, Hamlaoui Mekachera, proche de Jacques Chirac. (AP 14.6 / Le Monde 15.6) le général Maurice Schmitt, ancien chef d’état-major des armées de 1987 à 1991, est mis en cause par une ancienne militante du FLN, Malika Koriche, qui l’accuse d’avoir donné l’ordre à des soldats de la torturer. Malika Koriche affirme au « Monde » quaprès avoir été arrêtée en été 1957 pour avoir posé deux bombes (qui n’auraient pas fait de victimes), elle a été torturée pendant quinze jours à l’école Sarouy, notamment sur ordre de deux lieutenants, dont Maurice Schmitt, elle a été désahbillée, jetée par terre et torturée : « ils écartaient les jambes, branchaient des fils de fer dans le vagin et au bout des seins. A l’autre bout, il y avait une petite boîte blanche munie d’un bouton qu’ils appuyaient ». Les lieutenants, dont Maurice Schmitt, « demandaient qu’on me ferme la gueule quand je criais trop ». Le général Schmitt nie en bloc ces accusations. Le nom de Malika Koriche ne lui avoque « absolument rien », mais il affirme que c’est « un assassin » et qu’il est possible qu’elle ait interrogée, « mais pas de cette façon là ». « J’ai fait mon devoir de militaire en Algérie, tout en respectant le droit et en ayant le souci de sauver des vie », a déclaré le général Schmitt au « Monde » (ATS 15.6 / AFP 16.6) Le général Aussaresses sera jugé pour « apologie de crimes de guerre », a annoncé le 15 juin la Ligue des droits de l’Homme. Une audience de fixation pourrait avoir lieu le 6 juillet, et la comparution du général à l’automne, devant le Tribunal correctionnel de Paris, qui avait ouvert une enquête préliminaire à la suite d’une plainte de la LDH. Aussaresses sera donc poursuivi non pour ce qu’il a fait pendant la Guerre d’Algérie, mais pour l’avoir dit, mais la LDH estime que « loin d’être poursuivi pour avoir révélé de simples agissements, le général Aussaresses devra d’ores et déjà s’expliquer sur le fait d’avoir considéré comme normaux et relevant de son devoir de militaire les tortures, enlèvements et exécutions sommaires auxquels il s’est livré ». Le Parquet de Paris avait écarté des poursuites pour « crimes contre l’humanité » au prétexte d’obstacles juridiques « majeurs », et avait estimé que « les faits revendiqués par le général Aussaresses et plus généralement commis à l’occasion du conflit algérien sont incontestablement constitutifs de crimes de guerre », mais pas de crimes contre l’humanité. Et selon le Parquet de Paris, ces crimes de guerre sont prescrits et couverts par la loi d’amnistie du 31 juillet 1968 (ce qui est d’ailleurs contestable, et contesté…). »A travers Aussaresses, c’est l’armée française et le pouvoir français qui sont jugés », a déclaré à l’AFP le président d’honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Patrick Baudoin, pour qui le procès du général permettra d’ouvrir un débat « très important » : « On a occulté beaucoup de choses qui doivent remonter à la surface. On n’a jamais osé soulever le couvercle (…) Le passé resurgit toujours. On ne peut pas tourner la page avant de l’avoir lue ». Pour l’avocat du général Aussaresses, Gilbert Collard, son client « n’a quand même pas été le seul à faire la guerre d’Algérie ». Ce procès en correctionnelle « nous permettra de faire citer de nombreux témoins, car on ne peut pas faire l’économie de ce débat ». « Le général Aussaresses a exécuté des ordres qui ont été donnés par des militaires, qui les ont reçus d’hommes politiques, sans que jamais aucun juge n’ait trouvé l’occasion d’ouvrir une information (judiciaire) », avait rappelé Gilbert Collard lors du dépôt des plaintes. Communiqué de la Ligue des droits de l’HommeLe Général Aussaresses devant la justiceParis, le 15 juin 2001 La LDH a appris avec satisfaction la décision de M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris de faire citer le général Aussaresses devant le Tribunal correctionnel de Paris pour apologie de crimes de guerre. Loin d’être poursuivi pour avoir simplement révélé ses agissements, le Général Aussaresses devra, d’ores et déjà, s’expliquer sur le fait d’avoir considéré comme normaux et relevant de son devoir de militaire, les tortures, enlèvements et exécutions sommaires auxquels il s’est livré. (La Ligue des droits de l’Homme) reste cependant attentive aux suites qui seront données aux plaintes avec constitution de partie civile pour crimes contre l’humanité actuellement soumises à l’examen de la juridiction d’instruction. La LDH se constituera partie civile à l’encontre du Général Aussaresses. (Le Monde 23.6) Louisette Ighilahriz, dont le récit des tortures subies en 1957, lors de la bataille d’Alger, a provoqué l’actuel débat sur les pratiques des forces françaises pendant la guerre d’Algérie, a annoncé qu’elle allait déposer plainte pour « crimes contre l’humanité » devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance de Paris. Le MRAP s’est associé à cette plainte, en se constituant partie civile. La plainte contre X vise les tortures dont Louisette Ighilahriz a été victime lors de la bataille d’Alger, de la part de militaires français, dont « le capitaine Graziani, qui agissait sous les ordres du général Massu et du colonel Bigeard ». L’avocat du MRAP, Pierre Mairat, estime que la notion de « crimes contre l’humanité », imprescriptible par définition, englobe les faits de torture et rend inopérante la loi française d’amnistie pour les faits en rapport avec la guerre d’Algérie. (APS 23.6) Une journée d’études sous le thème « crimes de guerre et crimes contre l’humanité », dans le cadre de la recherche historique et juridique sur les actes commis par les forces coloniales durant la période d’occupation et notamment, la guerre d’Algérie (1954/62), est annoncée pour le 28 juin à Alger, à l’initiative de l’union des juristes algériens (UJA) avec la participation de la Fondation du 8 mai 1945 et la faculté de droit d’Alger. La journée d’étude devrait aborder les questions de la notion de crime contre l’humanité, des juridictions pénales internationales, de la torture, de l’idéologie coloniale et de la guerre de libération, des principes fondamentaux du droit international humanitaire et de la qualification des crimes de guerre, en particulier de la torture. (AP 27.6 / Liberté 28.6) Une nouvelle plainte pour »crime contre l’humanité » et »séquestration et assassinat » contre le général Aussaresses a été déposée mercredi par les deux soeurs de Larbi Ben M’Hidi, responsable du FLN »suicidé » après son arrestation le 23 février 1957 en pleine bataille d’Alger, par des éléments du 11e régiment de parachutistes. Dans son ouvrage »Services spéciaux algériens 1955-1957 », Aussaresses explique avoir, avec l’aide de ses hommes, pendu Larbi Ben M’Hidi »d’une manière qui puisse laisser penser à un suicide », puis avoir préparé un rapport relatant le suicide du responsable du FLN avant la mort de ce dernier. »Nous refusons que l’impunité se poursuive », a déclaré Faws Slougi, le petit-fils d’une des plaignantes, lors d’une conférence de presse au siège parisien de la Fédération internationale des Droits de l’Homme (FIDH), avant d’ajouter au sujet de la guerre d’Algérie: « il est temps que cesse la culture de l’oubli ». « L’assassinat de M. Ben M’Hidi a été commis à la suite et en liaison avec des crimes de guerre », précise la plainte, qui soutient qu’une »exécution sommaire et préméditée commise à l’encontre d’un combattant pour le motif de son appartenance à un mouvement politique et à la suite de crimes de guerre est constitutive de crimes contre l’humanité ». Eric Plouvier, l’avocat des deux plaignantes, soutient que la révélation par le général Aussaresses d’un faux rapport a interrompu la prescription qui couvrait le crime d’assassinat, et permet donc de porter plainte contre le militaire à la retraite. Le général Aussaresses devrait comparaître à l’automne, sur citation direct du parquet de Paris, devant le tribunal correctionnel, pour y répondre du délit d’apologie de crimes de guerre. (Le Monde 29.6 / El Watan 30.6) Après le général Aussaresses, c’est le général Maurice Schmitt, ancien chef d’état-major des armées (1987-1991), lieutenant pendant la guerre d’Algérie, qui est mis en cause et accusé d’avoir pratiqué, ordonné et/ou couvert des tortures pendant la bataille d’Alger. Plusieurs militants du FLN d’alors l’accusent d’avoir été le chef de l’équipe qui les a torturés en 1957, à l’école Sarouy. Ali Moulaï, responsable d’un réseau de poseurs de bombes, accuse le lieutenant Schmitt d’avoir ordonné de le passer à la « gégène » (torture à l’électricité). D’autres méthodes de tortures étaient également pratiquées à l’école Sarouy, selon Ali Moulaï : « la personne était étouffée par un torchon mouillé et salé, attachée par les mains et les pieds sur une barre qu’ils faisaient tourner comme un méchoui ». Dans l’émission « pièces à conviction de la chaîne publique française FR3, le 27 juin, une ancienne militante du FLN, Malika Koriche, à l’époque porteuse de bombes, accuse elle aussi le lieutenant Schmitt d’avoir été l’un des chefs de l’équipe qui l’a torturée, en août 1957. De même, Rachid Ferrahi, lui aussi membre à l’époque d’un « réseau bombes » à Alger, accuse le lieutenant Schmitt d’avoir dirigé les tortionnaires qui s’en sont pris à son père (lui-même n’aurait pas été torturé du fait de son âge -16 ans). Le général Schmitt qualifie d' »affabulation totale » ces accusations, mais déclare qu’il aurait pratiqué la torture « si cela avait été nécessaire », au nom de la « légitime défense », et se demande « quand fera-t-on un procès pour apologie de crimes de guerre à ceux qui présentent ces terroristes comme des combattants, voire comme des martyrs, alors que ce sont des assassins ». Selon des chiffres de Paul Teitgen, ancien secrétaire général de la préfecture d’Alger, il y a eu pendant la Bataille d’Alger plus de 3000 disparus en quelques mois. Plus de 200 000 hommes, femmes et enfants ont été arrêtés pendant la Bataille d’Alger. Quatorze centres de torture ont été recensés à Alger et 584 en Algérie (AP 28.6) Le président Jacques Chirac a suspendu « provisoirement » le 28 juin le général Paul Aussaresses de son titre de commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur, après les déclarations de l’ancien officier sur la torture pendant la guerre d’Algérie, a annoncé l’Elysée dans un communiqué. Le chef de l’Etat a pris cette décision en sa qualité de grand maître du premier ordre national »sur proposition du grand chancelier de la Légion d’Honneur, formulée après avis du conseil de l’ordre émis à l’unanimité dans sa séance du 27 juin 2001 », précise le communiqué de l’Elysée. La sanction prend effet immédiatement. Le général Aussaresses, aujourd’hui âgé de 83 ans, avait déjà été mis à la retraite d’office le 6 juin dernier. Dans son ouvrage »Services spéciaux, Algérie 1955-57 » Aussaresses, coordinateur des services de renseignements de l’armée à Alger en 1957, assume et revendique sans remords les tortures et les exécutions commises par son commando. Jacques Chirac s’était déclaré »horrifié » par ces aveux. Au chapitre judiciaire, plusieurs plaintes ont par ailleurs été déposées contre lui. Le 17 mai, le parquet de Paris avait classé sans suite une première plainte pour crimes contre l’humanité déposée par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH). Le parquet avait ouvert le même jour une enquête préliminaire pour »apologie de crimes de guerre » après une plainte déposée par la Ligue des droits de l’Homme. Une nouvelle plainte pour »crime contre l’humanité » et »séquestration et assassinat » contre le général Aussaresses a été déposée le 27 juin par les deux soeurs de Larbi Ben M’Hidi, responsable du FLN pendu en mars 1957 par le général et ses hommes. Le texte de la décision officielle de suspendre Aussaresses de la Légion d’HonneurJournal Officiel de la République française Numéro 149 du 29 Juin 2001 page 10319 Présidence de la RépubliqueGrande chancellerie de la Légion d’honneur Décision du 27 juin 2001 du grand maître de la Légion d’honneur portant suspension provisoire immédiate d’un légionnaireNOR : PREX0104932S Par décision du grand maître de la Légion d’honneur en date du 27 juin 2001, prise sur la proposition du grand chancelier après avis du conseil de l’ordre, a été prononcée, conformément à l’article R. 105 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, la suspension provisoire immédiate pour le général de brigade (er) Aussaresses (Paul, Louis), né le 7 novembre 1918 à Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn), ommandeur de la Légion d’honneur, de se prévaloir de son titre de membre de celle-ci et des prérogatives qui s’y rattachent sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l’issue de la procédure normale le concernant. La présente décision prendra effet à compter du lendemain du jour de sa notification à l’intéressé. (Liberté 1.7) Selon plusieurs journaux algériens, des pressions officielles ou officieuses algériennes seraient exercées sur les anciens militants de l’indépendance torturés pendant la guerre d’Algérie, ou sur des parents de victimes de la torture et des exécutions sommaires, pour qu’ils renoncent aux actions légales entreprises contre les tortionnaires et/ou leurs chefs. Ainsi, Louisette Ighilahriz a déclaré au quotidien « El Youm » qu’elle faisait l’objet de pressions soutenues pour qu’elle renonce à poursuivre Aussaresses en justice. Au même moment, une parente de Larbi Ben M’hidi se désolidarisait des soeurs du responsable FLN assassiné, qui ont déposé plainte contre Aussaresses, sous les ordres de qui l’assassinat fut commis. Pour « Liberté », certaines « forces » algériennes « redoutent qu’Aussaresses se mette à table » et dise réellement ce qu’il sait, et « ce sera, paradoxalement, grâce à des Algériens qu’Aussaresses échappera à la justice », malgré les Français qui veulent qu’il y soit traîné… (LDH 28.6) La section de Toulon de la Ligue des droits de l’Homme rappelle l’existence dans la ville, et depuis plusieurs mois, à l’initiative de l’ancienne municipalité d’extrême-droite, d’un « carrefour Raoul Salan » (du nom de l’ancien chef de l’OAS). La nouvelle municipalité, élue en mars dernier, n’a pas débaptisé le carrefour, ce contre quoi la LDH proteste. La LDH invite le Maire de Toulon, Hubert Falco, à faire en sorte que le carrefour en question porte un nom plus « honorable » que celui de Salan. (AP 6.7) La 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris examinera dès le 26 novembre prochain les plaintes pour « apologie de crimes de guerre » déposées par plusieurs associations (le MRAP, la Ligue des droits de l’Homme, le Rassemblement démocratique algérien pour la paix, l’ACAT) contre le général Paul Aussaresses, suite à la parution de son témoignage « Services spéciaux, Algérie 1955-57 ». L’audience de fixation de l’examen des plaintes, à laquelle le général Aussaresses était présent, lui a permis d’annoncer qu’il allait faire citer une dizaine de témoins, dont des hauts responsables politiques et militaires de l’époque. (Corr 5.7) Des élus communistes de Paris, soutenus notamment par Simone de Bollardière, Gisèle Halimi, Madeleine Rebérioux, Nicole Dreyfus, Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwartz et Henri Alleg, invite le Conseil de Paris à donner le nom de Maurice Audin, jeune intellectuel communiste, opposant à la guerre d’Algérie, « très probablement assassiné par les services d’Aussaresses », à portion d’une rue de Paris (la rue des Tourelles, entre l’av.Gambetta et le bd Mortier) portant le même nom que la caserne de la banlieue d’Alger où Maurice Audin a probablement été torturé. (Libération 24.7 / Quotidien d’Oran 25.7) Le président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, le député socialiste François Loncle, prpopose la mise en place d’une commission mixte, franco-algérienne, d’historiens pour procéder à un travail d’investigation historique sur la Guerre d’Algérie, afin de « faire toute la lumière sur cette époque troublée ». François Loncle préfère en effet confier ce travail à des spécialistes plutôt qu’à une commission d’enquête parlementaire, comme celle proposée par des députés communistes et écologistes : « le Parlement n’a pas plus pour fonction de s’ériger en tribunal qu’en institut historique », estime le député socialiste, pour qui confier à l’Assemblée nationale la mission de « dire » ou de « codifier » la vérité historique serait « une grave dérive totalitaire ». Il convient donc d’amplifier, d’accélérer et de « bilatéraliser » le travail d’investigation qui a commencé d’être fait. François Loncle propose de confier « à un comité franco-algérien d’historiens la mission d’étudier les grands problèmes de la colonisation et de la décolonisation », et si possible de produire pour les manuels scolaires « une vision commune d’une histoire commune ». Il suggère d’offrir à l’Algérie la copie microfilmée des archives la concernant et d’intensifier la coopération entre les services historiques des armées française et algérienne. (LDH-rezo 4.8) Une proposition de quatre élus communistes du Conseil de Paris de donner le nom de Maurice Audin à une rue du 20ème arrondissement a été acceptée par la majorité de gauche plurielle du Conseil (la droite n’ayant pas participé au vote). Cette proposition avait été faite dans le sillage des révélations du général Aussaresses sur les tortures, les exécutions sommaires et les disparitions pendant la Guerre d’Algérie, pratiques dont Maurice Audin, jeune intellectuel communiste algérois, avait éàté victime. Maurice Audin a très probablement été assassiné par les services d’Aussaresses. Son corps n’a jamais été retrouvé. Les élus parisiens demandent que le nom de Maurice Audin soit donné à une partie de la rue des Tourelles, près de la caserve du même nom, nom qui était aussi celui d’une villa de la banlieue d’Alger servant de centre de détention et de tortures aux services spéciaux de l’armée française pendant la Guerre d’Algérie. Il faudra cependant encore qu’une commission de la ville de Paris donne un avis favorable à la proposition, laquelle devra ensuite être approuvée par le Conseil d’arrondissement et le Conseil de Paris. Un « Comité de parrainage pour une rue Maurice Audin » vient d’être créé. (Quotidien d’Oran 5.8) Une association crée depuis six mois en Algérie avec pour but de « faire triompher le devoir de vérité » sur les pratiques de torture pendant la lutte de libération, et le cas échéant de traduire les coupables et commanditaires de torture, disparitions et exécutions sommaires devant les juridictions nationales et internationales, l’association « Verdict », dénonce dans un communiqué les « tergiversations » des responsables du ministère de l’Intérieur, chargé de donner l’agrément officiel à la création de l’association, et se refusant même à accuser réception ddu dpôt, à cinq reprises, du dossier d’agrément. « Verdict » annonce que le refus de sa légalisation ne l’empêchera pas d’afir et que « ce n’est pas le refus d’un agrément qui empêchera Aussaresses et d’autres tortionnaires de la guerre de libération nationale d’échapper à la justice ». Mais « Verdict » accuse ceux qui bloquent son agrément officiel de s’être « construit leur propre histoire en falsifiant celle de la guerre de libération nationale et celle de ses martyrs ». (El Watan 6.8) Une année après une manifestation des harkis à Montpellier, exigeant du gouvernement français la reconnaissance et la réparation de leur abandon par la France au moment de l’indépendance algérienne, des représentants de la communauté harkie ont introduit auprès du Tribunal de Grande instance de Paris une plainte contre l’Etat français pour « crime contre l’humanité », crime constitué par le désarmement et l’abandon de la plupart des harkis aux représailles des nationalistes algériens après les accords d’Evian. (AFP 28.8) Huit Harkis désireux d’être « reconnus par l’histoire » ont décidé de porter plainte le 30 août devant la justice française pour « crimes contre l’humanité ». Leur avocat, Philippe Reuler, a précisé que « la plainte sera déposée devant le tribunal de grande instance (de Paris) contre X pour des faits commis en France et en Algérie et mettant en cause le comportement des autorités françaises et algériennes ». Un ancien harki, Messaoud Belaid, explique : « nous avons été désarmés et abandonnés par la France dès le 19 mars. Elle nous a ainsi livrés aux mains du Front de libération nationale ». Selon Me Reulet, 150’000 harkis ont été massacrés après l’indépendance, et il s’agit d' »actes d’extermination (qui) constituent par leur ampleur et le fait qu’ils aient été perpétrés pour des raisons politiques des crimes contre l’humanité ». 60’000 harkis ont réussi à se réfugier en France malgré les autorités françaises, et y seront pour la plupart concentrés dans des camps pendant des années. Le président du Comité national de liaison des harkis, Boussad Azni, ajoute que c’est une série d' »humiliations » subies ces deux dernières années qui motivent finalement la plainte pour « crimes contre l’humanité » : ainsi, le 11 novembre 1999, des harkis se sont vu refuser le droit de déposer une gerbe à l’Arc de Triomphe, et en juin 2000, en visite en France, le président Bouteflika les a comparés aux « collabos » français sous l’occupation nazie. (Reuters 29.8) Le Secrétaire d’Etat français aux Anciens Combattants, Jean-Pierre Masseret, a annoncé le 29 août que la journée nationale d’hommage aux harkis, annoncée par le président Jacques Chirac en février dernier, se déroulerait le 25 septembre. Le Secrétaire d’Etat a cependant regretté que la décision de huit anciens harkis de déposer plainte contre X pour « crimes contre l’humanité », pour des faits commis en France et en Algérie et « mettant en cause le comportement des autorités françaises et algériennes », vienne « affaiblir la décision (…) de rendre un hommage particulier aux harkis », dont »tout responsable politique » français est « conscient de la souffrance et des drames » qu’ils ont vécus, « victimes de l’histoire toujours tragique de la guerre ». (Liberté 2.9) Le FLN a réagi, par la voix d’Ali Mimouni, membre de son Bureau politique, au dépôt par des harkis de plaintes contre X pour « crimes contre l’humanité » contre le tribunal de grande instance de Paris, en qualifiant cette affaire de « franco-française » ne concernant pas l’Algérie (la plainte vise cependant également les responsables algériens du massacre de dizaine de milliers de harkis après l’indépendance). Ali Mimouni rappelle que « les harkis sont bien un corps de l’armée coloniale qui était en guerre contre l’ALN, au même titre que les parachutistes de Massu, les tirailleurs et autres », et qu’il s’agissait de « supplétifs de l’armée coloniale ayant la nationalité française et agissant sous le commandement militaire français ». (AFP 29.8 / Liberté 30.8) Le ministre français de l’Education nationale, Jack Lang, a déclaré vouloir encourager le développement de la recherche universitaire sur la Guerre d’Algérie et l’ouverture des archives militaires : « Encourager la recherche historique sur la Guerre d’Algérie et améliorer son enseignement dans le cadre scolaire, c’est aussi la meilleure façon d’aider à la coexistence respectueuse des mémoires antagonistes », a déclaré Jack Lang le 29 août devant une centaine d’enseignants et de chercheurs réunis à l’Institut du monde arabe. « Il n’existe pas dans notre pays de mémoire établie, recebsée et plaintement écrite et reconnue sur la Guerre d’Algérie », a constaté le ministre, qui a ajouté que l’enseignement sur ce thème ne pouvait aboutir que si les programmes scolaires en général (et pas seulement en histoire) prenaient mieux en compte la connaissance globale du Maghreb. La Guerre d’Algérie est inscrite dans les programmes scolaires français depuis 1983, sous l’angle de la décolonisation et de la politique intérieure française, mais le sujet reste périlleux pour des enseignants confrontés à des élèves dont les familles ont vécu, contradictoirement, cette période, et la densité des programmes ne laisse que deux heures aux enseignants pour traiter du suujet. (AP 30.8) François Mitterrand a approuvé plus de trente (32) exécutions capitales de militants du FLN dans les seules années 1956 et 1957, alors qu’il était Garde des Sceaux (ministre de la Justice) dans le gouvernement de Guy Mollet, selon une enquête du « Point ». Sur 45 dossiers de militants algériens exécutés pendant son ministère, François Mitterrand n’a donné que sept avis favorables à la grâce (six avis sont manquants, les autres sont favorables à l’exécution). Selon l’enquête du « Point », 222 militants du FLN ont été exécutés par la justice française entre 1956 et 1962, « le plus souvent au terme d’une parodie de justice ». Les premières exécutions se seraient produites lors du passage de François Mitterrand au ministère, entre le 2 février 1956 et le 21 mai 1957. L’hebdomadaire publie le fac simile d’une demande d’avis du ministre sur le recours en grâce du Babouche Said ben Mohamed, avec les mots « avis défavorable au recours » et la signature de François Mitterrand. Onze jours plus tard,m les deux premières exécutions capitales de militants du FLN avaient lieu à la prison de Berberousse, à Alger. (Le Monde 1.9) L’Institut François-Mitterrand a réagi par un communiqué à la publication par l’hebdomadaire « Le Point » d’une enquête révélant que l’ancien président de la République avait, alors qu’il était ministre de la Justice en 1956 et 1957, n’avait pas préavisé favorablement à la grâce (ou n’avait pas préavisé défavorablement à l’exécution) de 32 militants algériens du FLN, condamnés à mort. Les président et vice-président de l’Institut, Jean-Louis Bianco et Jean Kahn, condamnent une « présentation qui donne à penser qu’il appartenait au Garde des Sceaux d’approuver ou de désapprouver les décisions de la juridiction répressive », et estiment qu’il était « impensable, dans le contexte politique de l’époque, que le Garde des Sceaux demande au président de la République » René Coty de faire « systématiquement obstacle à l’exécution des décisions prononçant la peine capitale ». L’Institut rappelle en outre que François Mitterrand a « dénoncé au Conseil de la magistrature les excès de zèle de certains juges en fonction dans les départements algériens ». (El Watan 9.9) Une rencontre internationale se tiendra les 10 et 11 novembre à Alger sur le thème : « les mines antipersonnel et l’impact des expériences nucléaires sur l’ênvironnement ». Elle réunira des ONG algériennes, libanaises, palestiniennes, égyptiennes, marocaines, tunisiennes, françaises, canadiennes, anglaises, jordaniennes et sud-africaines. L’Algérie y témoignera de la persistance de la menace que fait encore planer, quarante ans après la fin de la guerre, les mines antipersonnel déposées par l’armée française en Algérie. Selon l’Association nationale pour la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution (APEP), 10 millions de mines antipersonnel sont encore dispersées en Algérie, dans les zones rurales et le long des frontières, notamment dans les wilayas de Souk Ahras, Tebessa et Naâma. Ces mines ont tué plusieurs milliers de personnes depuis l’indépendance (le chiffre de 40’000 morts a été avancé*), et blessé plusieurs dizaines de milliers de personnes (80’000 selon l’APEP). L’APEP rappelle en outre que la charge financière des soins et de la réhabilitation des victimes survivantes est considérable, et que la dispersion des mines sur un espace interdit cet espace à toute activité économique régulière. *ce chiffre paraît objectivement excessif : il équivaudrait à un millier de morts par année, ou à trois morts par jour, pour la seule Algérie. Aucune recension à partir des informations disponibles ne permet de confirmer un bilan aussi considérable. Il faut vraisemblablement diviser ce chiffre par dix -ce qui nous donne déjà un bilan catastrophique de 4000 morts à ce jour pour une guerre terninée depuis 40 ans…(Libération 15.9) Le juge d’instruction désigné pour instruire la plainte déposée avec constitution de partie civilepar la FIDH et le MRAP contre le général Aussaresses pour « crimes contre l’humanité », vient d’opposer une fin de non-recevoir aux plaignants, malgré la clarté du témoignage de Paul Aussaresses à propos des actes de torture et d’exécutions sommaires commis en Algérie, par lui et d’autres entre 1955 et 1957. En 1993, la Cour de cassation a estimé que les crimes contre l’humanité ne pouvaient être poursuivis en tant que tels en France que s’ils étaient liés à la seconde guerre mondiale, conformément aux dispositions des actes instituant le Tribunal de Nuremberg. Le juge d’instruction s’appuie ensuite sur l’absence de force rétroactive des modifications apportées au code pénal en 1994 et sur la loi d’amnistie de juillet 1968 pour toutes « les infractions commises en relation avec les événements d’Algérie ». La FIDH et le MRAP ont décidé de faire appel de la décision du juge d’instruction de ne pas donner suite à leurs plaintes. (AFP 23.9) La France organise le 25 septembre un hommage solennel aux harkis. Il s’agit de la première journée d’hommage de ce genre. Elle a été annoncée le 6 février par la présidence de la République, et sa pérennité n’a pas été confirmée. Le président Chirac présidera la cérémonie en présence du Premier ministre (à moins que celui-ci ne trouve le moyen ou le prétexte de n’y pas assister), de plusieurs ministres et de représentants et des autorités militaires, et même du président égyptien Moubarak. Les représentants des harkis ont cependant fait savoir qu’ils ne se contentaient pas de ce « premier pas » et qu’ils exigaient la reconnaissance des « fautes commises par l’Etat français » à l’égard des harkis, et notamment de leur abandon par la France à la fin de la Guerre d’Algérie. (Le Monde, AFP 25.9 / La Tribune 27.9) Une journée nationale d’hommage aux harkis a eu lieu en France le 25 septembre, avec pour objectif d’apporter une reconnaissance officielle au drame vécu par ces anciens supplétifs de l’armée française en Algérie, dont la plupart ont été abandonnés en Algérie après l’indépendance, et dont des dizaines de milliers (entre 30 et 150’000 selon les estimations) ont été massacrés en représailles par le FLN après leur abandon (seuls 20’000 ont trouvé refuge en France). Le président Chirac a inauguré aux Invalides, à Paris (d’autres cérémionies ont eu lieu à Epinal, Colmar, Bias, dans la Gironde et à Lyon) une plaque témoignant de la reconnaissance de la République au « sacrifice » consenti par les harkis. Dans son discours, Jacques Chirac a réaffirmé que les harkis étaient des Français à part entière. Il a remis à plus d’une centaine de « Français musulmans » rapatriés des décorations (Légion d’honneur, Ordre du mérite, médailles militaires). Le président français a appelé au « devoir de vérité » à l’égard des harkis et a reconnu la « barbarie » des massacres -mais de ceux commis par le FLN. Il a également reconnu que la Nation française n’avait pas fait aux harkis « la place qui leur était due », et appelé à ce « que justice soit enfin rendue à leur honneur de soldat, à leur loyauté et à leur patriotisme ! Que leur dignité d’hommes libres soit enfin reconnue ! ».Jacques Chirac a enfin reconnu que « la France, en quittant le sol algérien (…) n’a pas pu sauver ses enfants » et a fait « dans l’urgence, le choix de l’isolement », en contradiction avec la tradition républicaine. Les associations de harkis se sont félicitées de l’organisation de cette journée d’hommage. Nonobstant, des plaintes ont encore été déposées par des associations de harkis et de familles de harkis, devant les tribunaux de Bordeaux et de Marseille, pour « crimes contre l’humanité ». Le 30 août, à l’initiative du Comité national de liaison des harkis, neuf d’entre eux ont porté plainte à Partis, contre X, avec constitution de partie civile (ce qui empêche le classement sans suite de la plainte) pour « crimes contre l’humanité ». Ils dénoncent la responsabilité de la France dans les massacres survenus après les accords d’Evian. Le 2 septembre, le Collectiv Justice pour les Harkis a déposé à Marseille une plainte identique. Le secrétaire général du collectif, Mohammed Haddouche, estime que la journée nationale d’hommage est « bienvenue à la condition expresse qu’il y ait une reconnaissance de l’abandon, du désarmement et du massacre de harkis, commis avec la complicité de la France ». Le président du Comité national de liaison, Boussad Azni, regrette que la journée nationale d’hommage soit unique, et souhaite implicitement qu’elle ait lieu chaque année. Quant à l’ancien ministre des armées en 1962, Pierre Messmer, il estime que le « principal responsables » des massacres de harkis n’est pas la France qui les a abandonnés, mais le FLN qui les a massacrés. Pour la France, explique Messmer, « il s’agissait de savoir si nous voulions finir une guerre de décolonisation ou si nous voulions la continuer », et « le souci de ne pas réouvrir les combats en Algérie a été la raison de notre refus d’organiser des opérations de récupération des harkis persécutés par le FLN ». Par ailleurs, le général de Gaulle « croyait que l’avenir de ces hommes-là était en Algérie, leur pays » et ne « pouvait imaginer que le FLN se comporterait avec une telle sauvagerie ». Messmer s’oppose donc à toute forme de « repentance » : « Les regrets sont à exprimer d’abord par le FLN qui a massacré les harkis. Nous n’avons massacré personne ! ». Et d’ajouter qu’il tient le président Bouteflika, « un ancien FLN », pour « l’un des principaux complices des crimes commis contre les harkis ». Les harkis et leur famille reprsésentent aujourd’hui une population d’environ 400’000 personnes. Le quotidien algérien « La Tribune » suggère que, les élections présidentielles approchant en France, « Chirac a cru bon de capitaliser (leurs) voix ». (Le Monde 26.9) La gauche parisienne a proposé le 24 septembre au Conseil de Paris la pose, sur le Pont Saint-Michel, d’une plaque commémorant les morts algériens du 17 octobre 1961. Au cours de cette manifestation, interdite par le préfêt de police Maurice Papon, plusieurs milliers d’Algériens avaient été interpellés, un très grand nombre d’entre eux battus, plusieurs dizaines tués, dont la plupart précipités dans la Seine. La droite, unanime, a voté contre la proposition. La rédaction proposée par la gauche soulignait « la sanglante répression d’une manifestation pacifique », ce que le RPR Philippe Séguin a qualifié de « tract partisan ». Les Verts ont quant à eux demandé, sans obtenir sur ce point le soutien des autres composantes de la majorité municipale, que « la préfecture de police de paris reconnaisse officiellement sa responsabilité dans le massacre du 17 octobre 1961 ». (AFP 9.10) Un mémorial de la guerre d’Algérie sera érigé à Paris, quai Branly, près du Pont d’Iéna, à l’automne 2002. Le monument rappellera, par des afficheurs électroniques, la « mort pour la France » des soldats tombés en Afrique du nord entre 1952 et 1962. Le Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, Jacques Floch, en présentant le projet, a déclarl que « la guerre d’Algérie demeure une mémoire douloureuse pour la Nation française », ce qui explique qu’on ait « mis 40 ans pour imaginer cet hommage, parce que la France n’a pas encore totalement digéré cette guerre ». Les afficheurs du monument feront défiler en continu les noms de 22’300 soldats (dont 3000 harkis) français morts en Afrique du nord, mais la plupart en Algérie. Selon les chiffres officiels français, plus d’un million 700’000 soldats français, dont plus d’un million 300’000 appelés ou rappelés, ont servi en Afrique du nord de 1952 à 1962, principalement en Algérie, où 24’300 d’entre eux ont été tués. (APS 10.10) La Commission des lois de l’Assemblée nationale française a rejeté le 10 octobre la proposition du député apparenté communiste Jean-Pierre Brard de créer une commission d’enquête sur les actes de torture de l’armée française et de ses supplétifs algériens pendant la guerre d’Algérie. La proposition faisait suite aux « aveux » et aux révélations des généraux Massu et Aussaresses, qui avaient reconnu, voire (pour le second) quasiment revendiqué avoir ordonné ou couvert des actes de torture et des exécutions sommaires. Jean-Pierre Brard souhaitait qu’une commission d’enquête parlementaire détermine l’ampleur et les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité « imputables aux autorités françaises » pendant la guerre d’Algérie. Le rapporteur de la commission, la députée socialiste Nicole Feldt estime en revanche que « le rôle de l’assemblée n’est pas décrire l’histoire » mais de légiférer. Elle affirme par contre la « légitimité » de la démarche des historiens qui souhaitent étudier cette période pour mettre à jour les pratiques des autorités et des forces françaises pendant la guerre d’Algérie, et invite le gouvernement à ouvrir « le plus largement possible » ses archives sur cette période. (AP 12.10) Les Verts appellent au « respect du devoir de mémoire » à l’occasion de la commémoration des massacres d’Algériens à Paris, le 17 octobre 1961, et estime qu’à cette occasion, « pouvoir refaire (à Paris) une partie du trajet qui fut celui des manifestants algériens il y a quarante ans est un devoir de mémoire ». Les Verts invitent donc les autorités publiques à autoriser la manifestation prévue le 17 octobre, « indispensable devoir de solidarité avec les victimes et leurs descendants ». (Le Monde 12.10) Les viols commis pendant la Guerre d’Algérie ont jusqu’à aujourd’hui constitué un tabou. Mais quarante ans après la fin de la guerre, la parole se libère : celle des victimes, mais celle aussi, sinon des coupables, du moins des témoins. Il apparaît que les viols sur les femmes ont eu un caractère massif en Algérie entre 1954 et 1962, dans les villes mais surtout dans les campagnes. Selon un ancien appelé, dont le témoignage a été recueilli par « Le Monde », il y avait deux sortes de viols : « Ceux qui étaient destinés à faire parler et les viols de « réconfort », de défoulement, les plus nombreux ». Du côté des victimes, c’est la honte et la pression sociale qui exopliquent le silence; l’une d’entre elle explique que « chez vous (en France), une femme violée est une victime, chez nous c’est tous le contraire, nous sommes les coupables ». L’historien Mohammed Harbi confirme qu’il n’a jamais réussi à obtenir de témoignages d’Algériennes victimes de viol du fait de militaires français. L’écrivain algérien Mouloud Feraoun dénonçait déjà dans son journal le viol comme une pratique courante en Kabylie. Il ne s’agit pas de simples « dépassements » mais d’une pratique massive, et plus encore à la fin de la guerre, en particulier en 1959 et 1960 lors de l' »opération Challe ». Cette pratique massive a longtemps été occultée : il n’y eut jamais d’ordre explicite, et moins encore écrits, de viol, et rares sont les hommes qui se seront vantés, dans leurs carnets ou devant témoins, d’avoir commis ce crime. Tous les appelés interrogés par « Le Monde » disent que tout dépendait en fait « du chef », des positions morales de l’officier ou du sous-officier. Il n’y avait généralement ni viol ni torture lorsque ces positions étaient claires et affirmées, et lorsque malgré tout de tels crimes étaient commis, ils étaient sanctionnés. Mais lorsque les officiers ou les sous-officiers laissaient faire les viols, ou pire encore y encouragaient, cette pratique se généralisait. Un infirmier servant dans le nord constantinois dès septembre 1959, Benôit Rey, témoigne dans son livre « Les égorgeurs » : « Dans mon commando, les viols étaient tout à fait courants. Avant les descentes dans les mechtas, l’officier nous disait : « Violez, mais faites cela discrètement » (…) Cela faisait partie de nos « avantages » et était considéré en quelque sorte comme un dû ». Pour l’historienne Claire Mauss-Copeaux, deux facteurs contribuent à expliquer l’ampleur du phénomène : d’une part, le racisme à l’encontre de la population algérienne musulmane, aggravé par le machisme (« d’abord il s’agissait de femmes, et, ensuite, de femmes arabes », résume Benoît Rey, et un autre appelé ajoute : « Les Algériens étaient considérés comme des sous-hommes, et les femmes tombaient dans la catégorie encore en-dessous, pire que des chiens ») d’autre part le type de guerre (guerilla et contre-guerilla, terrorisme et contre-terrorisme, dispersion et autonomie des unités…). Sur la centaine d’hommes de son commando, dont des harkis, Benoît Rey affirme qu’une vingtaine furent des violeurs, que deux ou trois proéestèrent, mais que tous les autres se turent. Aux viols s’ajoutèrent fréquemment d’autres tortures. Un appelé dans le secteur de Constantine raconte qu’en octobre 1961, il vit quatre femmes agoniser pendant huit jours de tortures quotidiennes, « à l’eau salée et à coups de pioche dans les seins ». En 1961, un autre appelé témoigne avoir assisté à une centaine de viols en dix mois dans la Ville Sesini (Susini), à Alger : Les viols étaient une torture comme une autre ».
Né du viol d’une Algérienne par des soldats français, Mohamed Garne demande réparation à l’Etat du préjudice subi. Devenu « français par le crime », il exige une pension, et donc une reconnaissance du crime commis contre sa mère. Mohamed Garne est né le 19 avril 1960 en Algérie, de père inconnu et d’une mère violée par des soldats français pendant des nuits, puis torturée (notamment frappés sur le ventre et torturée à l’électricité) alors qu’elle était enceinte. Sa mère l’a abandonné à sa naissance. Il souffre de plusieurs infirmités, essentiellement psychiques, qu’un rapport du professeur Crocq, psychiatre des armées, qui évalue le taux d’invalidité à 60 %, attribue explicitement à trois causes, toutes relevant de « la responsabilité de l’Etat français » : la séparation de sa mère (il a ensuite été confié à une nourrice qui le batait), la « souffrance foetale (…) éprouvée du fait des mauvais traitements et tentatives d’avortement » infligés à sa mère, et le fait d’avoir appris à l’âge de trente ans qu’il avait été « conçu dans un camp de concentration » lors du « viol collectif » de sa mère. Officiellement, plus de 10’000 femmes (pour 300’000 hommes) ont servi dans les rangs de l’ALN ou du FLN en tant qu’infirmières, agents de liaison, voire combattantes. Leur rôle a été essentiel dans la guerilla urbaine. (Reuters, AP, AFP, La Tribune 17.10 / Liberté, Le Soir, El Watan 18.10) Le Maire de Paris, Betrand Delanoë, accompagné de nombreux élus de gauche, a inauguré le 17 octobre, sur une rambarde du pont Saint-Michel, face à la préfecture de police, une plaque commémorative en hommage aux victimes algériennes de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Cette plaque, portant la simple inscription : « A la mémoire des nombreux Algériens tués lors de sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 », représente en fait la première reconnaissance officielle par une autorité française (en l’ocurrence la municipalité de Paris) du massacre perpétré ce jour là sur ordre du préfet de police de l’époque, Maurice Papon (actuellement détenu pour sa participation aux crimes contre l’humanité commis sous l’occupation nazie, par les autorités françaises, contre les juifs). Le nombre même des victimes de la répression reste inconnu et les estimations varient de 30 à 300 morts. En inaugurant la plaque du pont Saint-Michel, et après avoir observé une minute de silence en mémoire des victimes du 17 octobre, Bertrand Delanoë a précisé que cet hommage n’était « dirigé contre personne », et en particulier pas contre la police, que le Maire a par ailleurs remercié de lui avoir permis « de tenir cette cérémonie dans la sérénité ». Pour Bertrand Delanoë, dans le « devoir de mémoire », il convient de n’oublier personne, « ni les appelés, ni les pieds-noirs, certainement pas les policiers ». Précédemment, en inaugurant une exposition de dessinateurs sur le 17 octobre 1961 à la Conciergerie de Paris, le Secrétaire d’Etat au patrimoine, le communiste Michel Duffour, avait déclaré que « l’implication personnelle de Papon ne (peut) éluder la responsabilité collective de ceux qui détenaient alors le pouvoir », et a réclamé que justice soit faite pour un « crime couvert par les plus hautes autorités de l’Etat ». La brève et sobre cérémonie du Pont Saimt-Michel a été à peine perturbée par une contre-manifestation d’extrême-droite, tenue à distance par d’importantes forces de police : quelques dizaines de manifestants, certains scandant « Algérie française ! », s’étaient regroupés derrière une banderole dénonçant « les collabos du FLN ». Quant à la droite traditionnelle, en particulier le RPR « néo-gaulliste » (chiraquien), elle s’est contentée de boycotter la cérémonie, mais elle a manifesté clairement à l’Assemblée nationale son opposition à toute reconnaissance des crimes commis, en quittant la séance (quelques élus du RPR, dont Michèle Allio-Marie et Edouard Balladur, et les députés de l’UDF, restant cependant présents et ne s’associant pas à cette manifestation qualifiée d' »extrémiste » par le ministre de l’Agriculture Jean Glavany). La droite a quitté l’assemblée après que le député (apparenté PCF) Jean-Pierre Brard ait appelé au « devoir de vérité » sur le 17 octobre 1961, et se soit demandé « qui a donné le feu vert à Maurice Papon pour organiser le massacre ? », et que le Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, le socialiste Jacques Floch, ait rappelé que les Algériens n’étaient descendus dans la rue que pour protester pacifiquement contre « un couvre feu appliqué sur la base du faciès » aux seuls « musulmans ». Jacques Floch a appelé à un « travail de vérité » n’affaiblissant pas la « communauté nationale », et à un « devoir de mémoire » capable de « mettre fin à la guerre d’Algérie, car elle n’est pas terminée ». Et d’imaginer à haute voix « un jour, un président français tenant par la main le président algérien devant un monument à tous les martyrs, qui parle de paix et de réconciliation », allusion à l’image célébre du président Mitterrand et du chancelier Kohl se tenant par la main devant l’ossuaire de Verdun. L’Ambassadeur d’Algérie en Framce, Mohamed Ghoualmi, a déclaré que la reconnaissance des faits du 17 octobre 1961 était importante « pour la réconciliation d’une société avec elle-même », mais qu’elle était aussi « un acte fondateur d’une relation bilatérale ». Le Préfet de police de Paris lui-même, pour la première fois, a déploré les « exactions commises en Octobre 1961 », En fin de journée, plusieurs milliers de personnes ont défilé sur le parcours de la manifestation de 1961, à l’appel de la Ligue des droits de l’Homme, du « Collectif unitaire 17 octobre 1961 – 17 octobre 2001 », des Verts et de plusieurs organisations de la gauche révolutionnaire, derrière une banderole portant ces simples mots : « Au nom de la mémoire ». La porte-parole de Lutte Ouvrière, Arlette Laguillier, a rappelé que « tous les gouvernements de gauche et de droite ont eu une responsabilité énorme dans cette guerre d’Algérie », et que si cette guerre avait pu être évitée, « le sort de l’Algérie aujourd’hui serait différent ». Par contre, l’ancien ministre de la Défense, puis de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a estimé qu’il n’y avait « rien à gagner à sempiternellement gratter nos plaies », et que si « un pays doit assumer toute son histoire, avec ses ombres -le 17 octobre 1961 en est une- mais aussi avec ses lumières », il faut aussi que « le peuple français comme tout autre peuple (garde) une raisonnable estime de lui-même pour pouvoir continuer son histoire », et qu’il fallait travailler désormais à la « coopération » avec l’Algérie en tournant « déliébérément nos regards vers l’avenir », et non le passé. Dans un message adressé aux participants à un colloque organisé à Paris par l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) et le Rassemblement actions jeunesse (RAJ), le président du FFS, Hocine Aït Ahmed, a appelé à un travail de mémoire tourné non sur le passé, mais sur l’avenir afin d' »arrêter l’engrenage de crimes à plus grande échelle et de plus en plus atroces ». « La mémoire commence à triompher de sa lutte contre la néant », constate Hocine Aït Ahmed, qui relève néanmoins la persistance du « laisser-faire » et de l' »Indifférence de la communauté internationale », face au massacre des Algériens il y a quarante ans comme face à la guerre actuelle « qui n’en finit pas de décimer les populations civiles ». Face aux crimes du passé comme à ceux du présent, l’histoire et la mémoire doivent permettre de « modifier la vision et les projets de chacun et de tous pour faire triompher une modernité humaniste fondée sur la paix, la démocratie et la justice », écrit Hocine Aït Ahmed dans son message. (AFP 30.10) L’inventaire des archives de l’armée française de 1945 à 1967, incluant donc la Guerre d’Algérie, est achevé et sera dans les jours à venir à la disposition des chercheurs et de toute personne intéressée, a annoncé le chef du service historique de l’armée de terre (SHAT), le général Berlaud, lors de la présentation des quatre tomes (de 1556 pages au total) de l’inventaire. Le premier tome est une introduction générale permettant de repérer la « localisation » des documents recherchés dans les services qui les conservent, les deux tomes suivants dressent un « répertoire numérique détaillé » de l’ensemble des documents, le quatrième tome est un index alphabétique. Outre cet inventaire, le SHAT publie le deuxième tome d’un recueil de témoignages oraux des principaux acteurs ou témoins de la période considérée, dont l’ancien ministre Pierre Messmer, le préfet Jean Vaufour ou le général (alors commandat) Aussaresses. Les dossiers relevant de la justice militaire restent cependant inaccessibles, sauf dérogation expresse du ministè¨re de la Défense, pour une période d’un siècle (les plus anciens d’entre eux ne pourront donc être librement consultés qu’en 2045). Les dossiers de carrière sont quant à eux protégés pour 120 ans à partir de la date de naissance de la personne concernée, et les dossiers médicaux pour 150 ans, une dérogation ministérielle étant également possible (365 dérogations ont été demandées en 2000, et seules 5 % d’entre elles auraient été refusées. Communiqué de la section de Toulon de la Ligue des Droits de l’HommeToulon, le 20 octobre 2001 Carrefour Raoul Salan : LA LDH CONTINUE A DIRE NONQuarante ans après, la France prend conscience de son passé en Algérie.Juin 99, l’Assemblée nationale reconnaît que nous avons fait la « guerre »en Algérie. Septembre 2001, un hommage national est rendu aux Harkis. Ce travail de dévoilement de la vérité doit se poursuivre, pour lesvictimes et pour l’Histoire. Il serait dommage que Toulon reste àl’écart de cette démarche nationale. C’est pourquoi nous avions protestépubliquement dès le 17 décembre 2000 lorsque nous avons connul’intention de la municipalité précédente de donner le nom de « généralRaoul Salan » à un carrefour de la ville. Cette décision a été adoptéepar la majorité d’extrême droite de l’époque, lors de la séance duconseil municipal du 21 décembre 2000. Depuis, nous n’avons cessé de demander que ce carrefour soit débaptisé.Pour appuyer notre demande, nous avons lancé une pétition au début del’été : elle a recueilli plus d’un millier de signatures. Aujourd’hui,nous les déposons à la mairie. Nous demandons à Hubert Falco, maire deToulon, de donner à ce carrefour un nom plus conforme aux valeursrépublicaines et à la vérité historique. Simone de Bollardière était à Toulon ces jours-ci. Elle nous a rappeléque, pour son mari, il était essentiel de « ne pas perdre de vue lesvaleurs morales qui ont fait la grandeur de notre civilisation et denotre armée ». Nous proposons que Toulon rende hommage au général Jacquesde Bollardière en attribuant son nom à ce carrefour.
Simone de Bollardière nous l’a dit : il faut savoir dire NON !
(AFP 8.11) Le Secrétaire d’Etat français aux Anciens combattants, Jacques Floch, a souhaité « très vivement » le 7 novembre, devant l’Assemblée nationale, qu’un débat soit organisé à l’Assemblée avant la fin de la législature pour fixer une date de commémoration de la Guerre d’Agérie, ce que la plupart des groupes politiques souhaitent également. La date de cette commémoration pourrait être celle du cessez-le-feu de 1962, le 19 mars, et la commémoration devrait être un hommage à toutes les victimes de la guerre. La date du 19 mars est cependant contestée par les rapatriés (pieds-noirs) et les harkis, pour qui elle est le symbole d’une défaite et d’un exil. Jacques Floch a déclaré que le choix de la date devrait être soutenu par « au moins 70 % des députés » pour être retenu. (AP 8.11) La Cour régionale d’appel des pensions de Paris, qui devait statuer le 8 novembre sur la demande d’indemnisation d’un homme né en 1960 du viol de sa mère par des soldats français pendant la Guerre d’Algérie, a décidé de reporter sa décision au 22 novembre. La Cour avait reconnu, en appel, que Mohamed Garne était né d’un viol mais avait nommé un expert pour déterminer s’il souffrait de dommages physiques directs liés à la guerre, condition pour qu’il obtienne une indemnisation. Mohamed Garne veut faire reconnaître que les troubles psychiques (et donc, au sens de la loi, physiques) dont il souffre sont la conséquence directe des violences subies par sa mère, placée en camp de regroupement durant sa grossesse. Cette revendication est appuyée par le rapport de l’expert. (Reuters 8.11 / Le Courrier 9.11) Dix harkis ont déposé plainte contre X le 8 novembre pour crimes contre l’humanité devant le procureur de Toulon (Var). Au total, selon leur avocat, 32 plaintes seront déposées. Neuf avaient déjà été déposées fin août à Paris, et 16 autres à Marseille. (Reuters, AP 26.11 / Le Monde, La Tribune de Genève, AP, Reuters, Quotidien d’Oran 27.11 / AFP, Le Monde, Le Courrier de Genève 28.11) Le procès du général Aussaresses et de son éditeur, Olivier Orban, PDG des éditions Perrin, pour « complicité d’apologie de crimes de guerres » (en ce qui concerne le général) et « apologie de crime de guerre » (en ce qui concerne l’éditeur) s’est ouvert le 26 novembre à Paris, devant le Tribunal correctionnel. Le Parquet a requis une amende d’environ 25’000 FF, au motif que Paul Aussaresses « n’avait pas le droit de se vanter de ses crimes ». Paul Aussaresse risque un maximum de cinq ans de prison et de 300’000 FF d’amende. Il a déjà été mis à la retraite d’office (mais à l’âge de 83 ans, la sanction est symbolique) par le président Chirac, en juin 2001. Le 17 mai, le Parquet avait écarté les poursuites lancées contre Aussaresses pour « crimes contre l’humanité », en considérant que les faits revendiqués par le général étaient « incontestablement constitutifs de crimes de guerre » et à ce titre couverts par la prescription et l’amnistie depuis la loi du 31 juillet 1968. Sept plaintes pour crimes contre l’humanité avaient été déposées, mais le juge avait refusé de les instruire. Les associations plaignantes ont fait appel, et la première décision de la Chambre de l’instruction devrait tomber le 14 décembre. La veuve du militant communiste Maurice Audin, arrêté par les hommes d’Aussaresses, torturé et sommairement exécuté (Aussaresses nie y être pour quoi que ce soit, sans convaincre grand monde de son innocence) avait notamment déposé plainte pour « crime contre l’humanité », d’autant que le corps de Maurice Audin n’ayant jamais été retrouvé, sa mort n’a pas été prononcée juridiquement, et le crime d’enlèvement et séquestration est toujours formellement soustrait aux lois d’amnistie. Les lois d’amnistie de 1964 et 1968 interdisent toute action judiciaire directe aux victimes des innombrables violences commises entre 1954 et 1962, qu’elles aient été commises par les forces françaises, le FLN ou l’OAS. Mais les écrits que la Guerre d’Algérie a suscité, en particulier à propos de la pratique de la torture, ont fait l’objet de plusieurs procès en diffamation, intentés généralement par des hommes accusés d’avoir été des tortionnaires. En 1971, le général Massu reconnaissant la pratique de la torture dans « La Vraie Bataille d’Alger », mais la légitimait comme un moyen efficace de lutte contre le terrorisme (le même argument est repris par Paul Aussaresses). Paul Teitgen, ancien secrétaire général de la préfecture d’Alger en 1957, accusé par Massu d’avoir entravé l’action de l’armée en dénonçant la torture, porte plainte contre Massu… pour diffamation; de même, Jacques Peyrega, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger, traité de calomniateur par Massu pour avoir dénoncé l’exécution sommaire d’un Algérien. En 1970, le journaliste Jean-François Kahn a été condamné pour avoir accusé un ancien officier en Algérie, Roger Fauques, d’y avoir été un tortionnaire. En 1984 et 1985, « Le Canard Enchaîné » et « Libération » ont été relaxés pour avoir accusés Jean-Marie Le Pen d’avoir torturé et procédé à des exécutions sommaires : le tribunal avait estimé que Le Pen ne pouvait s’estimé diffamé par l’accusation de torture puisqu’il en approuvait l’usage en Algérie. En 1992, c’est Michel Rocard qui est relaxé dans un procès du même genre, intenté par le même Le Pen : le tribunal a estimé que Rocard avait « poursuivi un but légitime en portant (l’information selon laquelle Le Pen avait été un tortionnaire) à la connaissance » du public. Quant aux crimes de guerre, puisque la Guerre d’Algérie a officiellement été reconnue comme telle en 1999, le procureur a considéré que même s’ils étaient prescrits, leur « apologie » constituait un délit au sens de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.Le Parquet a donc attaqué 19 passages du livre de Paul Aussaresses (« Services spéciaux 1942-1954 »). La Ligue des droits de l’Homme,. le MRAP, le Rassemblement démocratique algérien pour la paix et l’Action des chrétiens contre la torture se sont constituées partie civile, et ont cité cinq témoins, dont Louisette Ighilahriz, Simone Pâris de Bollardière, Henri Alleg et Pierre Vidal Naquet; l’avocat d’Aussaresses, Gilbert Collard, en a fait citer dix autres, dont le général Massu -qui a annoncé qu’il ne viendrait pas, pour raisons de santé- et le général Schmitt, qui est venu, pour « excuser » les tortionnaires et leurs « couvertures » politiques, qui se trouvaient « dans la position de défense d’une population européenne et musulmane en danger de mort ». A quoi Henri Alleg a répondu que la guerre d’Algérie « que l’on présentait comme un combat pour notre civilisation était en fait une guerre contre l’indépendance d’un peuple, menée avec les méthodes des occupants nazis ». Quant à Aussaresses lui-même, il ne ne renie ni ne regrette rien de ce qu’il admet avoir fait, et il continue de légitimer la torture : « c’était nécessaire (…). C’est parce que je songe à toutes les morts de civils évitées, à l’époque en Algérie, que je n’ai pas de regrets. Et encore moins de remords ». Et d’ajouter : « Si j’avais Ben Laden entre les mains, je referais sans hésitation ce que j’ai fait. (…) toutes les armées du monde utilisent, aujourd’hui encore, la torture ». Ainsi, après le massacre d’El Halia*, il admet avoir abattu ou fait abattre 160 prisonniers algériens. De même, à la barre, Paul Aussaresses reconnaît-il que 3000 personnes, passées par le camp de Beni Messous, ont « disparu » (soit un détenu sur huit). Enfin, Aussaresses reconnaît être responsable de l’exécution sommaire, maquillée en suicide, du dirigeant FLN Larbi Men M’Hidi. Il affirme cependant n’avoir rien commis sans l’aval du pouvoir civil, et que le gouvernement de l’époque (en particulier les ministre de l’Algérie Robert Lacoste et de la Justice François Mitterrand) étaient au courant de presque tout (« Jean Bérard, un magistrat affecté aux côtés du général Massu, était un ami proche de François Mitterrand, il communiquait avec lui par téléphone tous les jours », et savait que les militants algériens étaient torturés et exécutés sommairement; il couvrait ces comportements et transmettait directement ses informations à Mitterrand, a affirmé Aussaresses, qui a également affirmé consigner chaque jour ses activités dans un cachier, dont trois copies étaient fournies aux autorités, dont une au ministre Robert Lacoste. Cette responsabilité du pouvoir politique a été confirmée par le général Schmitt (qui a justifié devant le tribunal l’emploi de la torture sous prétexte de « légitime défense », a déclaré qu’il serait lui-même prêt à la pratiquer, et qui a été nommément accusé par Louisette Ighilahriz d’avoir assisté aux sévices qu’elle a elle-même subi fin 1957). La responsabilité du pouvoir politique a également été mise en avant, sous forme de dénonciation, par Simone Pâris de Bollardière, veuve du seul général qui ait publiquement dénoncé la pratique de la torture et des exécutions sommaires : « Le gouvernement français est d’une culpabilité totale sur ce qui s’est fait. Il a donné les pleins pouvoirs à l’armée. Il a donné le droit de vie et de mort sur tout Algérien qui ne plaisait pas aux militaires », et d’une certaine manière, cette responsabilité du pouvoir politique le poursuit encore aujourd’hui : « Tout le monde savait ce qui s’est passé et celui qui a remis la Légion d’honneur à Aussaresses** savait ce qu’il avait fait », d’où l’absence totale de crédibilité de l' »effarement » dont ont témoigné les responsables politiques, dont Jacques Chirac, après la publication du rémoignage d’Aussaresses : « Il n’y a que ceux qui ne veulent pas entendre qui n’ont pas d’oreilles », a déclaré Simone Pâris de Bollardière, en rappelant que la pratique de la torture était connue avant qu’Aussaresses se soit mis à s’en vanter. L’historien Pierre Vidal-Naquet, témoin des parties civiles, n’attend pas grand chose du procès, et regrette, comme beaucoup, qu’Aussaresses ne soit pas jugé pour ce qu’il a fait, mais pour avoir dit qu’il l’avait fait : « la torture est un crime, pas un délit de presse », et « le seul mérite de ce vieux tueur est justement d’avoir reconnu ses actes ». Henri Alleg, auteur de « La Question », lui-même torturé par l’armée française, est du même avis : « le livre n’a apporté aucune nouveauté », mais Alleg le qualifie tout de même de « livre nocif » montrant « une jouissance perverse », avant de rendre hommage aux « dizaine de milliers de femmes qui n’ont rien dit et portent en elle les atrocités qu’elles ont subies » de la part de soldats français. En Algérie, « Le Quotidien d’Oran » constate lui aussi que « finalement, on ne juge pas Aussaresses pour les Algériens torturés et assassinés sans aucune forme de procès, mais on le juge pour avoir ‘ouvert sa gueule’, pour en avoir fait état, sans le moindre regret ». Il n’en reste pas moins qu’un procès pour « apologie de crimes de guerre » (ou de complicité dans ce délit) implique une double reconnaissance par un tribunal, et débouche sur une « double première » juridique : il y a eu guerre en Algérie, et des Français y ont commis des crimes. Le travail des historiens va sur ce terrain plus loin que celui de la justice, et les dernières études parues, notamment celle de Sylvie Thenault (« Une drôle de justice », La Découverte) confirment que la torture n’était pas une exception pathologique en Algérie, mais un véritable système. *Le 20 août 1955, 35 Européens sont massacrés dans une émeute. Suite aux révélations d’Aussaresses, les avocats Gisèle Halimi et Michel Zaoui ont saisi en juin 2001 la ministre française de la Juatice, Marylise Lebranchu, d’une demande en révision des procès de 44 auteurs présumés du massacre, 44 Algériens dont deux ont été condamnés à mort, peine communée en travaux forcés à perpétuité. Aussaresses avoue dans son livre avoir arrêté 60 émeutiers sur les lieux du massacre le jour même, et les avoir exécutés sur le champ. Autrement dit, les condamnés des procès de Philippeville et Constantine, en 1958, n’étaient pas les auteurs du massacre, ceux-ci ayant été eux-mêmes, de l’aveu même d’Aussaresses, massacrés par les forces françaises. La ministre de la Justice s’est dite « personnellement favorable » à la révision des procès.**Aussaresses a été fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1948, officier en 1952 et commandeur en 1965.(Le Monde 30.11) « Pour les parties civiles, c’est le procès de la guerre d’Algérie. Pour la défense c’est celui de la liberté d’expression. Pour moi, c’est celui d’un livre », a déclaré la substitut du Procureur, Fabienne Goget, qui a ajouté : « lorsque l’histoire entre dans un prétoire, le droit en sort ». C’est pourtant bien l’histoire qui est entrée dans le procès, à travers le débat de principe sur la torture et son apologie, à travers un livre dont la substitut a déclaré que « rédigé par un autre » qu’Aussaresses, il avait été « largement provoqué » et « exploitement médiatiquement » par les éditeurs « dans le but de le faire vendre ». Dès lors, ce sont les éditeurs (Olivier Orban, des éditions Plon, et Xavier de Bertillat, des éditions Perrin) qui ont « conçu ce livre », et sont coupables d’apologie de la torture, Aussaresses n’étant que leur complice. Le Parquet a réclamé 100’000 FF d’amende pour chacun des prévenus, soit Aussaresses,. Orban et Bertillat. Sur le fond, c’est-à-dire sur l’accusation d’apologie de la torture, l’avocat de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Guy Aurenche, a rappelé que l’interdiction de la torture était « universelle » et « absolue »; le président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme, Henri Leclerc, a ajouté que « la barbarie n’est acceptable ni d’un côté, ni de l’autre, mais (que) la force de la République, c’est la justice », ce qui lui interdit d’user des mêmes moyens que les « terroristes » qu’elle affirme combattre. Communiqué de presse du MRAP(Réf. PM131) Paris, le mercredi 28 novembre 2001Torture en Algérie : pour une reconnaissance officielleLe procès Aussaresses vient de mettre à jour toutes les exactions et les crimes, et toutes les souffrances endurées par les victimes de la torture au cours de la guerre d’Algérie. En se constituant partie civile, avec la Ligue des droits de l’homme et l’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture, le MRAP entend oeuvrer à la manifestation de la vérité. Ce faisant, le MRAP n’est pas animé par un esprit de vengeance. Il en appelle au respect du droit et de la justice. La torture en Algérie, loin d’être limitée à quelques dévoiements minoritaires ou à quelques bavures, a été une réalité massive, permanente, pratiquée par l’Armée française, dans le cadre d’un plan concerté par les pouvoirs politiques de l’époque. La vérité tend maintenant, malgré les réticences et les dissimulations peureuses, à être peu à peu révélée, libérée. La vérité libère ceux qui en ont souffert, souvent atrocement, autant les victimes directes que leurs familles. Elle libère ceux qui parfois, pris dans l’engrenage collectif, ont cédé sans avoir le courage et la force de dire non. Elle libère aussi ceux qui ont porté le lourd secret d’une conscience brisée. Mais au-delà de cette guerre, l’œuvre de vérité doit embrasser notre histoire jusqu’au bout, sans concession. La généralisation de la torture en effet n’est pas le fruit du hasard. Elle a été le prolongement d’une domination coloniale qui a asservi les populations. L’Algérie, possession française à partir de 1830, a été conquise, occupée, ses habitants humiliés, expropriés, privés de citoyenneté dans un pays qui pourtant était le leur. Ils furent soumis à un statut d’infériorité inhérent aux idéologies racistes des des politiques colonialistes. Les massacres et les tortures, des « enfumades » du 19ème siècle aux massacres de Sétif le 8 mai 1945, sont parmi les ingrédients qui ont conduit à banaliser la torture, associant le mépris et la haine dans la négation de l’humanité. Pratiquer aujourd’hui la torture comme une arme banale, ainsi que semble la définir le Général Aussaresses, c’est pratiquer l’inhumanité la plus perverse : vouloir que l’autre n’existe pas. En finir avec la culture de l’oubli est un défi pour l’avenir. Ceux qui ont su, qui ont osé dire « non » aux ordres criminels – car il y en eut, et peut-être plus qu’on ne pense – ceux qui luttent pour l’abolition de telles pratiques, tracent le chemin qui peut conduire à une cohésion nouvelle du peuple français, une cohésion qui commence par le choix premier de la paix. Répudier le mépris et l’infériorité, certains disent « demander pardon », c’est donner des signes concrets de réparations. Le chemin de la vérité doit être parcouru en même temps que celui de la justice. Poursuivre et sanctionner les auteurs de crimes contre l’humanité permettra de tourner la page, et d’entretenir des relations nouvelles avec les peuples qui furent colonisés, notamment par des aides réelles et sincères à leur développement. Faute de quoi les discriminations d’aujourd’hui, les dettes fabriquées, les promesses de développement non tenues, la soumission au profit d’abord, prépareront un terrain propice à d’autres tortures, à d’autres crimes et iniquités. Nous devons collectivement faire un choix autre et décisif. Aussi, au-delà du procès Aussaresses, le MRAP demande solennellement au Président de la République et au Premier Ministre de reconnaître dans une déclaration publique l’utilisation par l’Etat français de la pratique systématique de la torture. (Le Monde 24.11) Mohamed Garne, né d’un viol collectif commis par des soldats français sur sa mère algérienne pendant la Guerre d’Algérie, a été reconnu comme victime de ces violences, et mis au bénéfice d’une pension d’invalidité. La Cour régionale des pensions de Paris lui a acvcordé cette pension le 22 novembre, après 13 ans de procédure. La Cour a ainsi reconnu, contre l’avis du représentant du gouvernement, qu’on pouvait être victime des violences commises par des Français pendant la guerre d’Algérie, et pour la première fois, les difficultés juridiques qui entourent depuis la fin de la guerre, amnisties à la clef, les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis pendant cette période ont pu être « contournées ». Mohamed Garne est né le 19 avril 1960, en Algérie, d’une jeune fille de 16 ans régulièrement violée par les militaires français. Lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte à la suite de ces viols, les militaires l’ont frappée et torturée pour la faire avorter, sans y arriver. Après la naissance du bébé, on a éloigné sa mère, qu’il n’a retrouvée que 18 ans plus tard, plongée dans la misère, vivant entre deux tombes dans un cimetière. Le bébé a été confié à une nourrice : on le retrouvera à l’hôpital, anorexique et souffrant d’une fracture du crâne. Mohamed Garne se retrouve à l’orphelinat. On le place ensuite chez un couple, qui divorce alors qu’il a quinze ans, ce qui le conduit à nouveau à l’orphelinat. Ce parcours de vie a atteint Mohammed Garne dans sa santé : Il souffre notamment d’une lourde dépression. Le 14 mars 2000, sa demande d’indemnisation avait été rejetée par le Tribunal des pensions. Le 21 décembre, en appel, la cour désignait un expert pour déterminer son droit à une pension, droit conditionné aux termes de la loi à la nationalité française et au fait d’être victime directe de souffrances physiques. L’expertise a conclu que Mohammed Garne était bien la victime directe des souffrances physiques subies intra utero du fait des violences commises sur sa mère, et lui a donc accordé une pension (minimale, de 30 %, doit moins de 1000 FF par mois) Dans son arrêt final, la cour a d’abord estimé que le viol n’ouvrait pas le droit à une pension pour l’enfant qui en est né (il pourrait en revanche l’ouvrir pour la mère, si elle était française), car il ne s’agit pas d’une violence directe mais indirecte. Pour le tribunal, la révélation du viol, trente ans plus tard, a certes provoqué un « choc émotif », mais pas de « dommage physique ». De même, la séparation de la mère et de son fils n’est pas une violence physique au sens de la loi. Les violences subies ensuite du fait de la nourrice (ou de sa famille) sont bien, en revanche, des violences physiques, mais elles ne sont, selon le tribunal, qu’indirectement liées à la Guerre d’Algérie. En revanche, les souffrances physiques du foetus alors que la mère était battue et torturée sont bien, au strict sens de la loi, des violences physiques directes. Pour Mohamed Garne et son avocat, le jugement final est une victoire : « Je suis la première victime de guerre en Algérie », a déclaré Mohamed Garne, qui a dédié sa victoire « aux peuples français et algérien, qui ont souffert tous les deux ». Pour son avocat, Jean-Yves Halimi, « la raison du droit a prévalu sur la raison d’Etat ». Le jugement fait en outre jurisprudence : les femmes violées et les hommes torturés pendant la Guerre d’Algérie peuvent désormais prétendre à une indemnité, à la triple condition qu’ils ou elles soient français(es), victimes de violences directes, et que ces violences aient été commises par des Français. (Le Monde 8.12) Les députés français examineront le 15 janvier une proposition de loi du groupe des radicaux, du mouvement des citoyens et des Verts instituant le 19 mars comme « journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie », journée ni fériée ni chômée. (ATS 14.12) La Cour d’appel de Paris a confirmé le 14 décembre le refus d’instruire une plainte pour crimes contre l’humanité déposée par le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) contre le général Aussaresses. L’avocat du MRAP a annoncé son intention de recourir contre cette décision, dont le MRAP estime qu’elle contribue « à empêcher la vérité d’émerger sur les actes de torture, les exécutions sommaires, les déportations commis durant la période coloniale de la France en Algérie ». Quant au verdict du procès contre Aussaresses pour « apologie de crimes de guerre », il devrait être connu le 25 janvier. Le parquet n’avait pas ouvert d’enquête pour « crime contre l’humanité », comme le lui demandaient la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme et le MRAP, car il estimait que la loi de 1968 amnistiait « toutes les infractions commises en relation avec l’Algérie » et que la notion de crime contre l’humanité ne pouvait s’appliquer en France que pour des faits postérieurs à 1994, à la seule exception de ceux commis par ou sous les ordres des nazis de 1939 (voire 1933) à 1945. COMMUNIQUÉ DU MRAP :Réf. PM143Paris, le vendredi 14 décembre 2001 Procès Aussaresses : après le refus d’informer sur la plainte pour crime contre l’humanité, le MRAP se pourvoit en cassationLa chambre de l’instruction a, par décision en date du 14 décembre 2001, confirmé l’ordonnance de refus d’informer du Juge d’instruction Valat, sur la plainte pour crime contre l’humanité qui avait été déposée par le MRAP, à la suite de la publication du livre de Paul Aussaresses « Services spéciaux 1955- 1957». Cette décision, contre laquelle le MRAP, par l’intermédiaire de son avocat Pierre Mairat, a décidé de former un pourvoi en cassation, contribue à empêcher la vérité d’émerger sur les actes de torture, les exécutions sommaires, les déportations commis durant la période coloniale de la France en Algérie. De plus, elle participe à conforter l’idée que la torture pourrait être, dans certains cas, une pratique légitime, ainsi que le défendait récemment le Général Schmidt. Pourtant ni le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, ni l’amnistie ne sauraient empêcher l’application d’une norme coutumière internationale, qui s’impose en droit français. Sinon, comment aurait-on pu juger et condamner Paul Touvier, Maurice Papon, auxquels on reproche des faits de crime contre l’humanité qui lorsqu’ils ont été commis, ne faisaient pas l’objet d’incrimination particulière ni en droit français, ni en droit international ? Le MRAP, qui espère que la Cour de Cassation prendra la mesure de la nécessité impérieuse de parcourir ce chemin de vérité et de justice, appelle une fois encore de ses voeux à ce que l’Etat français reconnaisse les crimes de torture, d’exécution sommaire et de déportation commis durant la période de la colonisation. (AP 20.12) La plainte pour « crime contre l’humanité », « séquestration » et « assassinat » déposée par les soeurs de Larbi Ben M’Hidi, responsable du FLN, contre le général Aussaresses, qui avait reconnu avoir maquillé en suicide le meurtre de Larbi Men M’Hidi en mars 1957, a été déclarée irrecevable par le Parquet de Paris, qui a estimé que les faits étaient prescrits (alors que les avocats de la famille estimaient que l’aveu du meurtre et de sa falsification en suicide par Aussaresses avaient interrompu la prescription). Le Parquet estime en outre que la notion de « crimes contre l’humanité » ne s’applique en France qu’aux crimes commis par les forces de l’Axe pendant la Seconde guerre mondiale, ou aux crimes commis après l’entrée en vigueur, en 1994, de cette incrimination dans le code pénal français, ce qui exclut donc tous les faits survenus entre 1945 et 1994. Le juge n’est cependant pas tenu de s’aligner sur les réquisitions du parquet, et peut décider de continuer les poursuites. 2002(AP, Reuters 15.1 / Le Monde 16.1 / Le Monde 17.1) L’Assemblée nationale française s’est penchée le 15 janvier sur un projet de loi émanant de la majorité de gauche et instituant le 19 mars comme journée nationale du souvenir (ni fériée, ni chômée) en mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Le 9 janvier, la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée avait adopté le texte d’un projet commun aux socialistes, communistes, radicaux de gauche et Verts. La date du 19 mars correspond à celle du cessez-le-feu intervenu le 19 mars 1962, après les Accord d’Evian. Le projet fait suite à la reconnaissance par l’Assemblée nationale, le 18 octobre 1999, de la guerre d’Algérie comme guerre. Pour le président de la Commission des lois, le socialiste Jean Le Garrec, « le 19 mars n’a pas vocation à célébrer une victoire ou une défaite mais simplement à marquer un temps du souvenir ». La proposition a cependant été très vivement combattue par la plus grande partie de l’opposition de droite, et plusieurs associations d’anciens combattants (y compris de harkis) et de rapatriés, proches du Front National, avaient appelé à manifester le 15 janvier devant l’Assemblée contre une « infamie » qui va « salir l’image de la France ». Les associations d’anciens combattants ont cependant exprimé sur le sujet des avis divergents : la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie soutient le projet, que combat l’Union nationale des officiers de réserve. Le vote solennel du projet est prévu le 22 janvier, après quoi le projet devrait être soumis (et vraisemblablement rejeté) au Sénat, puis revenir à l’Assemblée nationale pour adoption définitive, l’avis du Sénat pouvant être surmonté par celui de l’Assemblée. Le président du groupe socialiste de l’Assemblée, Jean-Marc Ayrault, a cependant exprimé le souhait d’une majorité des deux tiers des inscrits à la Chambre basse, « sinon cela (voudra) dire que le débat n’est pas mûr et on restera là ». Compte tenu du fait que les députés de l’opposition favorables au projet sont très minoritaires dans leurs groupes, cette majorité des deux tiers risque fort de ne pas être atteinte, et la nature des débats le 15 janvier laisse effectivement supposer que « le débat n’est pas mur », la « droite de la droite », à l’image de Philippe de Villiers, criant à la « trahison » pendant que le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, Jacques Floch, défendait le projet, en expliquant que « la guerre d’Algérie n’a pas suscité la réflexion profonde qu’elle méritait », après avoir été « neutralisée, aseptisée, quasiment occultée » pendant près de quarante ans, et que « le travail de deuil s’en trouve inachevé » et les mémoires « encombrées par les remords, les doutes, les souffrances enkystées ». L’opposition a axé son refus du projet sur le choix de la date du 19 mars, en soulignant que les combats s’étaient poursuivis après cette date, qui avait marqué également le début du massacre des harkis (qualifié de « génocide » par un député RPR). (Le Monde 17.1) Le premier numéro d’un magazine français exclusivement consacré à la Guerre d’Algérie (dans la période 1954-1962, mais avec probablement des « coups de projecteurs » sur l' »avant » et l' »après ») vient d’être diffusé en France : « Guerre d’Algérie Magazine », édité par le groupe de presse Michel Hommel, qui affirme vouloir « évoquer avec un esprit d’ouverture et sans positionnement partisan une période essentielle de l’histoire contemporaine ». Le magazine, bimestriel, est tiré à 40’000 exemplaires. Il est le seul magazine grand public en France (et en Algérie) a être exclusivement consacré au conflit franco-algérien. (AFP, MRAP 22.1 / Libération 23.1) Les députés français ont adopté en première lecture, le 22 janvier, par 278 voix contre 204 (35 abstentions), une proposition de loi consacrant le 19 mars comme « journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Compte tenu de la majorité de droit au Sénat, devant qui le texte adopté par l’Assemblée doit maintenant être présenté, la majorité acceptante semble insuffisante pour que le gouvernement, qui souhaitait une majorité des deux tiers, inscrive l’examen du texte à la Chambre haute. La droit a en effet massivement voté contre le texte, approuvé par la seule majorité plurielle (moins six socialistes et un Vert). La droite a notamment invoqué les massacres des harkis pour refuser d’adopter la date du cessez-le-feu du 19 mars comme celle de la journée du souvenir (ni fériée, ni chômée). Le MRAP avait, avant le vote à l’Assemblée, salué la proposition de faire du 19 mars une journée du souvenir de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du nord, « jour de Mémoire à jamais, qui parle de Paix ». En même temps paraît une sorte de « manifeste des officiers généraux » anciens d’Algérie, lancé sous la forme d’un « livre blanc de l’armée française en Algérie »*, cautionné par l’Association de soutien à l’armée française et 500 officiers (généraux et colonels) à la retraite, cosigné notamment par un journaliste d’extrême-droite, Martin Peltier. Le livre est destiné à un « contre-feu » aux révélations des généraux Massu et Aussaresses (qualifié de « Tartarin de la Génène » et d’allié objectif de « ceux qui cherchent à faire honte à la France ». Le livre affirme que « ce qui a caractérisé l’action de l’armée en Algérie, ce fut sa lutte contre toutes les formes de torture, d’assassinat, de crimes idéologiquement voulus et méthodiquement organisés » . * Contretemps, 2001(Le Monde 24.1) Les services du Premier ministre ont confirmé le 22 janvier que le texte adopté par l’Assemblée nationale sur la reconnaissance du 19 mars comme « Journée nationale de souvenir à la mémoire des victimes des combats en Afrique du Nord », ne serait pas inscrit à l’ordre du jour du Sénat, faute d’une majorité suffisante à l’Assemblée pour garantir une adoption finale dépassant le clivage gauche/droite, au terme des « navettes » entre les deux assemblées. Le texte avait certes obtenu une assez large majorité à l’Assemblée nationale (278 voix contre 204), mais le gouvernement l’attendait plus large encore (au moins les deux tiers des votes), et moins « clivée » politiquement » : seuls quelques dissidents de droite (17) ont voté le texte, alors que six socialistes et trois verts votaient contre et quinze socialistes et trois verts s’abstenaient. Au delà des arrière-pensées politiciennes et des procès d’intention, le débat a notamment porté sur le choix de la date : le texte proposait le 19 mars, entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu la veille avec la signature des accords d’Evian. Le 8 avril, ceux-ci furent approuvés par 90,7 % des votants lors d’un référendum en France et en Algérie, et l’indépendance fut ensuite approuvée en Algérie par 99 % des votants (après le départ de la plus grande partie des pieds-noirs). Pour une partie de l’opinion et des élus, le 19 mars n’étaient pas la « bonne date », d’autant qu’elle marque le début du massacre des harkis par le FLN. Mais comme le commente « Le Monde », « on peut se demander si cette guerre des dates ne masque pas une analyse dépassée de l’état de l’opinion » française, la majorité de celle-ci, et en particulier des jeunes, ayant cessé de considérer la Guerre d’Algérie comme un tabou, ou même comme une blessure : près de 60 % des personnes interrogées (et de 70 % des moins de 25 ans) lors d’un sondage en 2002 avaient jugé que « tout compte fait, l’indépendance de l’Algérie a été une bonne chose pour la France ». Les étripages parlementaires ont donc une bonne génération de retard. (MRAP 25.1 / AFP 26.1 / Le Monde 28.1) Le général Paul Aussaresses a été condamné le 25 janvier par le tribunal correctionnel de Paris à 7500 euros d’amende (50’000 FF) pour « complicité d’apologie de crime de guerre » après la publication en mai 2001 de son témoignage « Services spéciaux, Algérie 1955-1957 ». L’avocat du général, Gilbert Gollard, a annoncé son intention de faire appel contre une décision qu’il qualifie de « triomphe de la censure ». Les éditeurs du général (Olivier Orban, de Plon, et Xavier de Bartillat, de Perrin) ont été condamnés à 15’000 euros d’amende (environ 100’000 FF) chacun, conformément aux réquisitions du parquet, pour « apologie de crimes de guierre ». Il s’agit d’une condamnation pour délit de presse, puisque les crimes commis pendant la Guerre d’Algérie sont supposée être amnistiés et prescrits selon le droit français, même si aux termes du droit international ils ne sont ni amnistaibles, ni prescritibles en tant que crimes contre l’humanité. Pour le tribunal, l’apologie de crime de guerre consiste à présenter ce crime (la torture, les exécutions sommaires, les « disparitions ») « de telle sorte que le lecteur est incité à porter sur ce crime un jugement de valeur favorable, effaçant la réprobation morale qui, de par la loi, s’attache à ce crime ». Que la torture ou les exécutions sommaires soient prescrites importe peu, puisque le délit d’apologie peut « avoir trait à des crimes créels, passés ou simplement éventuels ». En l’ocurrence, l’apologie est selon le tribunal caractérisée, non pas l’absence de regrets du général, ce qui ne « relève que du domaine de la morale et de la conscience », mais parce que la torture, « qualifiée d’inéluctable », est accompagnée « par un commentaire personnel légitimant cette pratique ». Aussaresses a cependant des circonstances atténuantes, selon le tribunal : il a « à l’évidence (été) influencé dans un cheminement, certes personnel, mais mal maîtrisé par lui, sinon tracé par d’autres », et il est « l’acteur d’un passé qu’il ne s’agit plus de juger » et fait d’actes et de pratiques qui, « bien que hors-la-loi, aparraissent avoir été connus et tolérés par les plus hautes autorités militaires et politiques de l’Etat français, de surcroît jamais sanctionnés, et amntstiée depuis plus de trente ans ». Mais Aussaresses a des circonstances atténuantes (non pour les crimes qu’il reconnaît avoir commis, mais pour leur « aveu » dans son témoignage), ses éditeurs, eux, n’en ont pas : ils ont « présenté sans aucune réserve cet ouvrage comme un témoignage « sans équivalent » et son auteur comme un « héros de roman », et ils ont pris « le risque d’encourager le passage à d’autres actes brutaux et inhumains ». Ils ont pu « implicitement favoriser l’émergence de nouveaux tortionnaires, convaincus par les écrits de Paul Aussaresses que certaines situations critiques autorisent les débordements de violence et de cruauté qu’il revendique et assume publiquement ». Les parties civiles (la Ligue des droits de l’Homme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, l’Action des cherétiens pour l’abolition de la torture) ont obtenu un euro symboliue de dommages et intérêts. Elles se sont félicitées du jugement (« remarquablement motivé » selon le MRAP) mais ont affirmé que le procès de la Guerre d’Algérie restait « à faire ». Pour le MRAP, le jugement « consacre la victoire du droit et de la justice » en confirmant que « les actes de torture et d’exécutions sommaires ne peuvent être légitimées de quelque manière que ce soit ». Le MRAP demande « aux plus hautes autorités de l’Etat de reconnaître officiellement la commission (d’) actes de torture et (d’) exécutions sommaires durant la Guerre d’Algérie », et considère que « la France s’honorerait en regardant son histoire avec lucidité ». Pour l’ACAT, « si le procès de la Guerre d’Algérie reste à faire, celui de la condamnation de la torture a marqué une étape nouvelle ». (Telerama) Le magazine français « Telerama » et le quotidien algérien « La Tribune » appellent Français, Algériens, Franco-algériens et Algéro-français « à écrire une lettre à un ami, vivant ou mort, connu ou anonyme, réel ou imaginaire, pour lui parler de l’Algérie, de la France, du passé, du présent, du futur », pour célébrer la date du 19 mars 1962, signature des accords d’Evian qui ont mis fin, sinon à la guerre, du moins à un « mariage colonial forcé ». « Telerama » rappelle, en filigrane, que quarante ans après l’indépendance de l’Algérie, il y a cinq fois plus d’Algériens en France et cinq fois plus de quotidiens francophones en Algérie qu’en 1962. Le président Bouteflika avait d’ailleurs lui-même rappelé qu’après quarante ans d’indépendance, le nombre et la proportion des Algériens (en Algérie) maîtrisant le français étaient considérablement plus élevés (dix fois plus quant au nombre, trois fois plus quant à la proportion) que lorsque l’Algérie était, officiellement, « française »… (El Watan 3.2) Les victimes, algériennes et françaises, des essais nucléaires effectués par la France à Reggane, dans le Sahara algérien, dès février 1960, ont décidé d’interpeller publiquement l’Etat français sur ses responsabilités, et d’engager des actions pour que la France reconnaisse les conséquences sanitaires des radiations provoqués par ces essais, sur ceux qui y ont participé et sur les population civile. En Algérie, une association a été créée (l’Association du 13 février 1960) pour regrouper les victimes potentielles des essais français dans la région de Reggane. Au Sahara algérien (Reggane, In Eker)la France a procédé à quatre essais atmosphériques et 13 essais souterrains. Les déchets sont restés sur place. Après l’indépendance de l’Algérie, les sites d’essais nucléaires français au Sahara ont été laissés par le nouveau pouvoir algérien à la disposition de la France pour cinq ans (après quoi ces essais ont été effectués en Polynésie). Après les essais atmosphérique de Reggane, la France a procédé dans le Hoggar (Taourirt Tan Affela, au nords de Tamanrasset) à des essais souterrains. Plusieurs milliers de personnes ont travaillé sur les sites des essais. Selon des spécialistes, les essais atmosphériques ont provoqué des retombées qui ont touché les populations des oasis de la région. On ignore au surplus si les installations ont été réellement et totalement démantelées, si les zonnes contaminées ont été effectivement décontaminées, et ce que l’on a fait des déchets. (El Watan 10.2) Des membres de l' »Association du 13 février 1960″, créée en Algérie pour demander réparation à la France des dommages provoqués par les essais nucléaires auxquels la France a procédé dès cette date en Algérie, notamment à Reggane, ont affirmé à « El Watan » que « les terres agricoles de Reggane, Aoulef, Zaouiet Kounda, sont devenues stériles » et que « des maladies et des habdicaps sont apparus » à la suite des essais, notamment la tuberculose et la cécité. L’Association, qui organise à partir du 13 février une rencontre à Reggane sur les essais et leurs conséquences sur l’environnement et la population, exige que la France reconnaisse sa responsabilité dans ces conséquences, et accorde réparation à ceux qui en ont été victimes. (AP 8.2) Près de 7 Français sur dix (68 %) estiment que les autorités françaises n’en font pas assez pour que soit connue la vérité sur la Guerre d’Algérie, selon un sondage publié le 8 février par l' »Humanité ». 28 % des personnes interrogées seulement déclarent être au courant de la répression policière de la manifestation anti-OAS au metro Charonne, en 1962. Les différences sont cependant considérables selon les classes d’âge : 54 % des 18-24 ans et 57 % des 25-34 ans déclarent ne pas en avoir entendu parler, alors que 79 % des 50-64 ans en ont entendu parler, et 41 % savent de quoi il s’agit. Ces différences pourraient donc signaler plutôt un manque d’intérêt des jeunes qu’un manque d’information disponible. Ce sont cependant les jeunes qui sont les plus exigeants (à l’égard des autorités) : 88 % des 18-24 ans souhaitent que « les autorités françaises fassent plus pour que soit connue la vérité sur les événements de cette époque ». (AP 13.3 / Jeune Indépendant 14.3) Onze famille de pieds-noirs ont déposé le 13 mars une plainte contre X pour crime contre l’humanité et complicité, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, auprès du tribunal de Grande instance de Paris afin de faire connaître la disparition de proches parents après le cessez-le-feu du 19 mars 1962 mettant fin à la guerre d’Algérie. Selon l’avocat des familles, la loi d’amnistie de 1968, qui vise « toutes les infractions commises en relation avec les événements d’Algérie » ne concerne que les faits antérieurs aux accords d’Evian de mars 1962 -or les faits motivant la plainte y sont postérieurs. Quant aux crimes contre l’humanité, la jurisprudence français ne les reconnaît (jusqu’à présent) que s’ils ont été commis dans le cadre de la Seconde guerre mondiale, ou après 1994. La dépôt de la plainte intervient alors que l’on célèbre le 40ème anniversaire des accord d’Evian, et en pleine campagne électorale. Le Secrétaire général de l’association « Jeune Pied Noir », Bernard Coll, menace : « les harkis et pieds-noirs ne voteront que pour des candidats qui reconnaîtront la responsabilité de l’Etat français ». L’avocat des familles accuse l’armée française de n’avoir « rien fait pour sauver les pieds-noires alors que la politique constante du FLN consistait à terroriser les populations européennes ». Officielle 3080 pieds-noirs ont disparu en Algérie. Les associations de victimes en dénombrent 6000 à 9000. L’ancien Secrétaire d’Etat aux Rapatriés André Santini avait évoqué le chiffre de 25’000 pieds-noirs disparus après le cessez-le-feu. S’agissant des harkis, l’ancien ministre du gouvernement provisoire algérien M’hammed Yazid a affirmé au forum du quotidien « El Moudjahid » qu’aucun harki n’avait été torturé en Algérie après les accors d’Evian (de nombreux témoignages de survivants affirmant cependant le contraire), et que si les harkis ont été emprisonnés par le FLN et l’ALN, c’était pour leur éviter d’être massacrés. Selon M’hammed Yazid, aucune directive n’a été donnée par le FLN pour massacrer les harkis -l’ancien ministre n’excluant toutefois pas qu’il y ait eu des « réglements de compte ». (Reuters 18.3 / AFP, AP, Reuters 19.3 / AP 20.3) Messe aux Invalides, ravivage de la flamme du Soldat Inconnu, dépôt de gerbes, cérémonies à Paris et dans d’autres villes, mais également manifestations de protestation, ont marqué le 19 mars le 40ème anniversaire des accords d’Evian mettant fin officiellement à la guerre d’Algérie (sans pour autant reconnaître qu’il s’était agi d’une guerre). « La page, très dure, très sanglante, a été tournée et la vocation de nos deux pays, l’Algérie et la France, est de retrouver la chaleur de leurs relations, qui est dans la nature des choses », a déclaré le président français (et candidat à sa réelection) Jacques Chirac (qui servit lui-même comme sous-lieutenant en Algérie, alors que son principal adversaire pour l’élection présidentielle, le Premier ministre Lionel Jospin, militait contre la guerre….). Le 20 mars, Jacques Chirac a rendu un « hommage solennel » aux harkis et aux militaires français qui ont combattu en Algérie, avec une attention particulière pour les pieds-noirs, les harkis et leur famille, « ces hommes (et) ces femmes qui ont été déchirés, obligés de quitter leur terre, la seule qu’ils aimaient, la seule qu’ils connaissaient ». Jacques Chirac a reconnu que le drame vécu après les accords d’Evian par les harkis « est une page dramatique et honteuse de (l’)histoire commune » de la France et de l’Algérie. La veille déjà, il avait déclaré que les harkis avaient été traités « de façon indigne, cruelle, inacceptable » par la France après les accords d’Evian. Le président a également salué les militaires, « qui se sont battus avec honneur, dignité et qui parfois sont suspectés de façon tout à fait indigne », référence à la multiplicité des témoignages récemment apparus sur les violations massives et systématiques des droits de l’homme (tortures, exécutions sommaires, viols entre autres) commises par des militaires français pendant la guerre. Une messe du souvenir a été célébrés en l’église Saint-Louis des Invalides à l’initiative de la Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc (FNACVA), en présence du Secrétaire d’Etat à la Défense chargé des Anciens combattants, Jacques Floch. Un cortège de 20’000 à 30’000 personnes s’est ensuite rendu par les Champs Elysées vers l’Arc de Triomphe. A Paris, le Maire Bertrand Delanoë a dévoilé la première plaque du Mémorial qui sera dédié aux soldats morts ou disparus en Afrique du Nord de 1952 à 1962, dans le cimetière du Père Lachaise. »Reconnaître l’histoire et exprimer considération et reconnaissance n’est pas chasser une souffrance pour en reconnaître une autre », et « la souffrance de ces événements tragiques (est) la souffrance des appelés, des militaires de carrière, des harkis, des pieds-noirs, des Algériens », a déclaré Bertrand Delanoë. Des manifestations de protestation des harkis et des rapatriés d’Algérie se sont déroulées à Nice et à Marseille, ou un millier de rapatriés, d’anciens combattants et de harkis ont dénoncé le choix de la date du 19 mars pour célébrérer la fin de la guerre, cette date étant pour eux celle d’une défaite (accompagnée de massacres de harkis et de l’exode des pieds-noirs). Quelques dizaines de harkis ont bloqué trois vies de la gare Saint-Charles. Deux candidats à l’élection présidentielle se sont également prononcés contre ce choix du 19 mars : le centriste François Bayrou qui y voit le risque de « raviver les blessures », et le néo-fasciste Bruno Mégret, pour qui il est aussi absurde de célébrer les accords d’Evian que de célébrer Waterloo. Par ailleurs, des harkis regroupés dans le comité « Harkis et Vérité » ont saisi le Conseil d’Etat pour contester la légalité de l’ordonnance du 21 juillet 1962 sur l’application des accords d’Evian, et la législation qui en a découlé, notamment la « loi Chirac » du 16 juillet 1987 et la « loi Romani » du 11 juin 1994, et les circulaires qui leur sont liées, tous textes que les harkis considèrent comme contraires à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Selon un sondage CSA (auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes de plus de 15 ans) publié le 19 mars par « L’Humanité », 71 % des personnes interrogées estiment que les gouvernements français de l’époque ont eu tort de mener la guerre d’Algérie, contre 19 % qui estiment qu’ils ont eu raison « parce qu’il aurait fallu que l’Algérie reste dans la République française ». Un peu plus du tiers des personnes interrogées (36 %) estiment qu’en France « on ne parle pas assez de la Guerre d’Algérie », 36 % estiment qu’on en parle « juste comme il faut » et 27 % estiment qu’on en parle « trop ». La moitié des personnes interrogées (50 %) approuvent la demande faite aux autorités française de condamner solennellement la responsabilité des gouvernements de l’époque, contre 45 % qui s’opposent à une telle condamnation. En Algérie, les accords d’Evian ont également été commémorés, alors que depuis 40 ans ils étaient occultés dans les célébrations officielles au profit de la proclamation de lindépendance (5 juillet) ou du déclenchement de l’insurrection (1er novembre). Les media algériens ont ainsi donné une couverture nouvelle à l’événement, dont la célébration n’a été introduite dans le calendrier des fêtes nationales qu’en 1998. Selon le sociologue Abdelmadjid Merdaci, ce silence de 35 ans s’explique par la main-mise des militaires sur l’Algérie, et leur peu d’inclination à célébrer la fin de négociations politiques conduites par des dirigeants civils, alors que le discours officiel reposait sur la thèse d’une victoire militaire de l’insurrection, et donc d’une victoire de l’ANP plurôt que de la direction politique du FLN. Or les accords d’Evian consacrent, à l’inverse de ce qui se passera ensuite en Algérie même, une sorte de « triomphe du politique sur le militaire », ce qui vaut d’ailleurs aussi bien pour le côté algérien que pour le côté français. En clair, le FLN a gagné la paix alors que l’ANP avait perdu la guerre, et la France a reconnu l’indépendance de l’Algérie alors qu’elle avait, militairement, vaincu la rebellion armée algérienne… Enfin, selon un sondage publié le 19 mars par « El Watan » (réalisé auprès d’un échantillon de 1144 personnes de plus de 18 ans dans 13 wilayas), plus de 48 % des Algériens seraient favorables au retour en Algérie des Européens qui y avaient vécu avant l’indépendan, et 44 % y sont défavorables. 60 % des « sondés » considèrent que les Français de métropole ne sont pas aussi responsables que les Français d’Algérie des drames vécus par les Algériens pendant la guerre. (El Watan 21.3 / Corr, CCFIS 22.3 / Reuters 23.3) A Marseille, pour son troisième grand meeting de campagne électorale, le Premier ministre-candidat à la présidence de la République Lionel Jospin a déclaré : « Un mur s’est effondré à l’Est, il faut empêcher qu’un autre mur s’élève au Sud, et a appelé à la réconciliation entre la France et l’Algérie, « patries voisines, éternellement voisines », pour qui le « besoin de vérité et de mémoire est considérable ». A l’autre bord du paysage politique français, le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, s’est élevé le 23 mars à Carpentras, dans une manifestation de pieds-noirs d’extrême-droite (dont l’ancien responsable de l’OAS Jean-Jacques Susini), contre la commémoration du 19 mars, date des accords d’Evian, et a affirmé que les exactions reprochées à l’armée française étaient sans commune mesure avec les tortures infligées par le FLN. Le Pen, qui a servi en Algérie -et a lui-même été accusé d’âvoir été un tortionnaire- a déclaré n’avoir « jamais vu » des tortures telles que celles qu’ont avoués plusieurs officiers français. Quant à l’ancien ministre de l’information du gouvernement provisoire de la République algérienne, Mohammed Yazid, il a semble-t-il découvert que « certains harkis se sont glissés dans les arcanes du pouvoir et occupent aujourd’hui des postes importants » en Algérie, quarante ans après la fin de la guerre d’Algérie… (Le Monde 29.3) Quarante-cinq ans après la Bataille d’Alger, où il commandait le 3ème régiment de parachutistes coloniaux, le général Marcel Bigeard, 83 ans, a fait savoir qu’il souhaitait pouvoir se rendre à Alger pour rendre hommage aux martyrs de la guerre de libération, c’est-à-dire à ses anciens adversaires, en déposant une gerbe au monument qui leur est dédié. Le général Bigeard explique qu’il entend d’abord rendre hommage au chef du FLN algérois, Larbi Ben M’hidi, qu’il avait arrêté en 1957, et qui a, de l’aveu même du général Aussaresses, été assassiné par ce dernier le 4 mars 1957. « Quand on se bat contre un ennemi de valeur, il naît souvent une camaraderie bien plus forte qu’avec les cons qui nous entourent », a résumé Bigeard. L’une des soeurs de Larbi Ben M’Hidi a soumis le projet de Bigeard au président Bouteflika, en expliquant qu’elle voulait qu' »on fasse un pas vers la paix », et que son frère « a été torturé jusqu’à la mort, mais pas par Bigeard, ni sur son ordre ». Par contre, torturée sur ordre des généraux Massu et Bigeard, Louisette Ighilahriz s’indigne du projet, d’autant qu’à la différence de Massu, qui a admis et regretté d’avoir utilisé la torture, Bigeard a toujours tout nié. (Reuters 9.4) Le Comité national de liaison des harkis appelle à voter pour Jacques Chirac dès le premier tour de l’élection présidentielle, le 21 avril, et lors du second tour. « L’intérêt de la communauté (harkie) c’est de voter Jacques Chirac dès le premier tour », a déclaré à l’agence Reuters le dirigeant du comité, Boussad Azn, qui ajoute que « seul le candidat Chirac répond à nos aspirations même s’il ne s’engage pas à reconnaître 100 % de nos revendications ». La communauté harkie représente aujourd’hui environ 350’000 électeurs. (AP 11.4) Le président (et candidat à sa réelection) Jacques Chirac a signé le 11 avril un décret créant une nouvelle décoration, la « médaille de reconnaissance de la Nation », destinée aux militaires qui servent sur des terrains extérieurs. En avril 1997, le gouvernement d’Alain Juppé (sous la présidence de Jacques Chirac) avait créé une médaille semblable, la médaille d’Afrique du nord, réservée aux titulaires d’un « titre de reconnaissance de la Nation » (TRN) obtenu en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Le président Chirac a décidé, « pour des raisons d’équité », d’étendre le champ des bénéficiaires de cette décoration « à tous ceux qui ont servi ou servent sous les armes dans des circonstances similaires », c’est-à-dire dans des opérations extérieures (ce qui revient à constater que l’Algérie était entre 1954 et 1962 un terrain d’opération « extérieur », alors que le discours officiel était construit sur la proclamation que « l’Algérie, c’est la France »). (AFP 28.5) Le rapport 2002 d’Amnesty International met en cause la France pour son refus, exprimé par la justice dans l’affaire Aussaresses, de rouvrir le dossier de la torture et des exécutions sommaires pendant la Guerre d’Algérie, malgré les aveux circonstanciés et public (puisque publiés dans son témoignage édité en mai 2001) du général Aussaresses, et malgré plusieurs instructions judiciaires ouvertes sur des accusations de violations des droits humains pendant la Guerre d’Algérie, instructions dont plusieurs ont été « rapidement fermées », regrette Amnesty. (Reuters 2.6) Jean-Marie Le Pen a accusé le 2 juin « Le Monde » de lancer un » véritable appel au meurtre » contre lui en publiant, dans son édition datée du 4, une semaine avant le premier tour des législatives françaises, un reportage sur la torture en Algérie, le mettant personnelement en cause alors qu’il nie avoir jamais pratiqué la torture lorsqu’il participait à la guerre d’Algérie (comme lieutenant). Le président du Front National accuse « Le Monde » de reprendre, « avec la complicité des services secrets algériens », des « faux témoignages de militants et de terroristes FLN déjà condamnée à neuf reprises par les tribunaux » (français), et d’alimenter ainsi « les attaques contre l’honneur de l’armée française et des anciens combattants d’Algérie », tout en commettant une « apologie indirecte du terrorisme » (AP 3.6 / MRAP 4.6) Jean-Marie Le Pen s’est posé le 3 juin en victime d’un complot politico-médiatique après la publication le jour même, par « Le Monde », de quatre témoignages de militants algériens l’accusant d’avoir pratiqué la torture pendant la Bataille d’Alger, en février 1957. Jean-Marie Le Pen a annoncé qu’il allait poursuivre le quotidien en diffamation pour l' »agression » que représente, selon lui, la publication des témoignages d’Abdelkader Ammour, Mustapha Merouane, Mohamed Amara et Mohamed Abdellaoui, qui décrivent les sévices que leur ont fait subir Le Pen, alors lieutenant parachutiste dans la Légion étrangère. Le Pen affirme n’avoir « jamais fréquenté » les lieux évoqués dans ces témoignages, et n’avoir jamais rencontré le commandant Paul Aussaresses en Algérie. Il dénonce dans les témoignages d’anciens militants du FLN une « apologie du terrorisme » et une « agression scandaleuse contre l’armée française et les anciens combattants d’Algérie ». Le MRAP (Mouvement contre le racisme et l’antisémitisme et pour la paix) a réagi dans un communiqué, le 4 juin, aux témoignages des militants FLN torturés : Le MRAP accueille sans surprise mais avec effroi les révélations accablantes de quatre victimes du Lieutenant Le Pen lors de sa participation à la guerre d’Algérie, à l’hiver 1957. Ces témoignages détaillés démontrent une nouvelle fois le caractère raciste de l’emploi de la torture lors du conflit, dirigée principalement contre la population indigène, et dans un but de terreur plus que de renseignement.Pour le MRAP, ces nouveaux témoignages amènent à considérer l’action de Jean-Marie Le Pen en Algérie comme un crime contre l’humanité, dont il aura à répondre devant la justice française. Il décide donc en la circonstance d’engager des poursuites judiciaires appropriées contre le tortionnaire Le Pen.Quels que soient les obstacles juridiques, le MRAP estime que désormais la responsabilité de toutes les institutions, judiciaires comme politiques est engagée, pour la réparation de ce crime. C’est pourquoi le MRAP rappelle sa demande de voir les plus hautes autorités de l’Etat reconnaître officiellement la commission de ces actes de torture et ces exécutions sommaires, durant la Guerre d’Algérie. A l’instar de la reconnaissance officielle de la responsabilité de la France durant la Seconde Guerre Mondiale, dans la commission des crimes contre l’humanité perpétrés par les nazis, la France s’honorerait en regardant son histoire avec lucidité. (Reuters 7.6) Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, a annoncé avoir déposé plainte en diffamation contre le quotidien « Le Monde » après la publication par celui-ci de témoignages de militants FLN l’accusant de les avoir torturé pendant la Bataille d’Alger, début 1957. Selon son supérieur de l’époque, le général Louis Martin, le lieutenant Le Pen n’était pas chargé d' »interroger les détenus » mais d’effectuer « des missions d’arrestation, de contrôles d’identité ». (AFP 3.7) Un juge d’instruction parisien a refusé d’instruire, pour des motifs juridiques, une plainte contre X déposée en mars par onze familles de pieds-noirs, pour « crimes contre l’humanité, arrestations et séquestrations arbitraires ». La plainte avait été déposée par des proches d’une douzaine de personnes disparues ou assassinées, principalement entre la signature des accords d’Evian le 19 mars 1962 et l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet suivant. L’ordonnance de refus d’instruire a été signée début juin, et elle reprend les réquisitions du Parquet. Les avocats des familles ont fait appel le 12 juin de cette décision, et une trenteine de nouvelles familles devraient se joindre à la procédure en déponsant plainte le 5 juillet. Le refus d’instruire se base sur la jurisprudence française actuelle : les crimes commis pendant la Guerre d’Algérie sont amnistiés par la loi du 31 juillet 1968, et la notion de crime contre l’humanité ne s’applique en France qu’aux crimes commis depuis 1994, ou pendant la seconde guerre mondiale (et à la condition que ces crimes aient été commis par des forces de l’Axe, ou des forces sous leur contrôle ». L’avocat des familles plaignantes a expliqué qu' »à partir des accord d’Evian, l’armée française s’est cantonnée dans les casernes, livrant le pays au chaos (et laissant se perpétrer) de nombreux réglements de compte, menés directement ou indirectement par le FLN », sans que les policiers et les militaires français n’interviennent « face à ces massacres et ces enlèvements », alors que « le maintien de l’ordre est le devoir premier de tout Etat », et que l’Algérie était encore sous souveraineté française (jusque début juillet) (AP 5.7 / AFP 5.7 / La Tribune 8.7) Le Secrétaire d’Etat français aux anciens combattants (lui même ancien combattant d’Algérie), Hamlaoui Mekachera, a estimé le 5 juillet, à l’occasion du 40ème anniversaire de l’indépendance algérienne, que le devoir de mémoire devait se faire « doucement, mais sûrement » à propos de la guerre d’Algérie, et qu’il ne fallait pas « traumatiser » les générations nouvelles n’ayant pas connu cette guerre, mais la leur « expliquer simplement ». Hamlaoui Mekachera, jeune officier en Algérie, a assuré n’avoir pas vu de tortures, et qu’il n’aurait pas admis des « débordements » de ce genre dans les unités où il a servi. A Marseille, environ 150 rapatriés d’Algérie ont commémoré, non l’indépendance de l’Algérie mais les « massacres antifrançais » perpétrés à Oran le 5 juillet, et exigé une nouvelle fois la reconnaissance de ce qu’ils considèrent comme un « génocide » ayant fait entre 500 et 5000 morts ou disparus. Le président de l’amicale des Oranais, Roland Soler, a demandé au président Chirac de faire du 5 juillet une journée dédiée « à la mémoire de nos martyrs (…) ainsi qu’à celle de toutes les victimes innocentes de cette guerre d’Algérie, restée sans nom si longtemps ». Onze famille pied noir ont porté plainte contre X pour crime contre l’humanité. Le président Chirac a adressé au président Bouteflika un message de félécitations à l’occasion du 40ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Le président français exprime à son homologue algérien « les voeux très chaleureux que la France forme à l’intention du peuple algérien ami », ses voeux personnels de « succès dans votre haute mission » et le souhait de la France que la coopération avec l’Algérie « porte ses fruits et participe ainsi à la construction d’un véritable espace euro-méditerranéen de paix, de prospérité et de modernité ». (Reuters 12.7) Le juge Jean-Paul Valat a décidé le 12 juillet, pour des motifs juridiques, de « refuser d’informer » la plainte déposée par la veuve de Maurice Audin, enseignant communiste « disparu » en juin 1957 à Alger après son arrestation par l’armée française. Le juge estime que les faits sont prescrits et couverts par l’amnistie décidée pour les faits en rapport avec la Guerre d’Algérie, que les crimes contre l’humanité ne peuvent être poursuivie en France que s’ils ont été commis pendant Guerre Mondiale (et par les forces de l’Axe ou leurs alliés) ou après 1994, et qu’en outre un non-lieu rendu dans une première enquête en avril 1962 à Rennes, confirmé en 1966 en cassation, revêtait « l’autorité de la chose jugée ». L’avocate de Josette Audin a annoncé son intention de faire appel de la décision du juge. La plainte de Josette Audin avait été déposée pour « crime contre l’humanité, enlèvement et séquestration », ce qui théoriquement la faisait échapper à la période couverte par l’amnistie, puisque la « disparition » de la victime, après son arrestation, exclut que puisse être précisée la date de sa mort (l’armée française affirmait à l’époque que Maurice Audin s’était évadé, mais nul ne l’a plus revu, et son corps n’a jamais été retrouvé, ce qui laisse également ouverte l’hypothèse d’une séquestration arbitraire sans délai ni terme précis). Le juge estime cependant que l’hypothèse d’une exécution sommaire de Maurice Audin en 1957 par les parachutistes français est la plus plausible, ce que divers témoignages (que la parquet de Paris n’a pas entendu) semblent confirmer. (Quotidien d’Oran 4.8) Les enfants des anciens combattants algériens dans l’armée française lors de la seconde Guerre Mondiale ont créé, le 10 juillet à Alger, une Organisation nationale des enfants des anciens combattants de la seconde guerre mondiale (ONEACGM), pour défendre les intérêts moraux et matériels de ces anciens combattants, de leurs veuves et de leurs enfants, notamment en améliorant leurs conditions sociales, en défendant leur dignité et en luttant contre leur exclusion. (AFP 20.8) Le Recours-France (Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d’Outre-mer) a apporté le 20 août son soutien à la proposition du Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, de mettre en place une commission pour discuter la date de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. Une proposition de loi instituant le 19 mars « Journée nationale du souvenir » à la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie a été votée en janvier 2002 par l’Assemblée nationale française, alors à majorité de gauche, et sur proposition du gouvernement socialiste d’alors, mais cette date (cette du premier jours de l’application des accords d’Evian, et du début de massacres de pieds-noirs et de harkis) est contestée par plusieurs organisations d’anciens combattants et de rapatriés. Recours-France plaide pour trouver une date « consensuelle ». (AFP 15.9) Le Secrétaire d’Etat français aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachers, lui-même d’origine algérienne, a déclaré le 15 septembre que la date de la commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie devait « s’inscrire dans une démarche de rassemblement, faute de quoi elle perd son sens », et que ce sont les associations d’anciens combattants qui devront « aboutir à un accord sur cette date », que l’Etat n’a pas à imposer. Initialement envisagée pour le 19 mars par le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, cette commémoration avait été vivement contestée par les associations de rapatriés et de harkis, cette date étant celle de la signature des accords d’Evian -et donc de la fin de l' »Algérie française », mais aussi du début des plus grands massacres de harkis. (AFP 19.9) La Cour d’appel de Paris a fixé aux 20, 21 et 27 février 2003 la date du procès en appel du général Paul Aussaresses et de ses éditeurs, condamnés en première instance le 25 janvier 2002 à des amendes (de 7500 à 15’000 Euros) pour apologie et complicité d’apologie de crimes de guerre, après la publication du témoignage d’Aussaresses (« Services spéciaux, Algérie 1955-1957 »), dans lequel il détaillait les tortures et exécutions sommaires sont ils s’était rendu responsable pendant la Guerre d’Algérie. Les éditeurs d’Aussaresses avaient qualifié leur condamnation de « triomphe de la censure ». (AFP 25.9) Le gouvernement français a à nouveau fait célébrer le 25 septembre la « Journée national d’hommage aux harkis », instituée par le gouvernement socialiste en 2001 pour rendre hommage aux combattants algériens de l’armée française pendant la Guerre d’Algérie. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a déclaré que « la place des harkis est dans (le) mémoire nationale » et a rendu hommage à ceux qui ont servi la France « sans faillir, souvent jusqu’au sacrifice suprême », et a estimé qu’il était « temps de leur rendre leur histoire, partie intégrante de notre histoire nationale ». Plusieurs porte-parole des harbis et de leurs familles ont cependant estimé que cette journée d’hommage était insuffisante : « on veut que la France reconnaisse la responsabilité du gouvernement de 1962 dans les massacres commis en Algérie après le 19 mars 1962 » (accords d’Evian), a déclaré le président du Comité national de liaison des harkis, Boussad Azni, alors que le président du collectif « Justice pour les harkis » dénonçait dans la journée d’hommage « une mascarade de plus » et exigeait de la France qu’elle assume « un devoir de réparation », y compris dans ses implications matérielles, comme des emplois réservés. (AFP 27.10) Le général Jacques Massu est décédé le 26 octobre, à l’âge de 94 ans, à son domicile, dans le Loiret. Gaulliste de la première heure, engagé aux côtés du général Leclerc dans les Forces Françaises Libres, puis en Indochine, puis à Suez, Massu a commandé les forces françaises à Alger en janvier 1957, et a mené (et militairement gagné -mais politiquement perdu) la « Bataille d’Alger, en cautionnant l’usage de la torture -ce qu’il a finalement regretté en juin 2000, déclarant au « Monde » que « la torture n’est pas indispensable en temps de guerre », et considérant comme une « avancée » la reconnaissance et la condamnation par la France de la pratique de la torture en Algérie, désavouant ainsi certains de ces officiers, comme le général (à l’époque capitaine) Paul Aussaresses, qui ont justifié cette pratique par les « nécessités de la lutte antiterroriste ». (Le Monde 29.10) Le président Jacques Chirac a rendu le 27 octobre hommage au général Jacques Massu, décédé la veille, en relevant notamment dans un communiqué qu' »au soir de sa vie, alors que la France s’engage dans un débat difficile sur les pages douloureuses de son histoire récente, le général Massu assume ses responsabilités avec dignité, courage et honnêteté ». Massu avait estimé (« Le Monde », 22 juin 2000), que la torture, dont il avait reconnu avoir couvert la pratique pendant la Bataille d’Alger, n’était « pas indispensable en temps de guerre », qu’il était « désolé » de l’avoir acceptée, et qu' »on aurait pu faire les choses différemment ». Il avait encore précisé sa pensée le 23 novembre en déclarant au « Monde » que « si la France reconnaissait et condamnait ces pratiques », ce serait une « avancée ». Le Secrétaire d’Etat français aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, a lui aussi rendu hommage à Massu, « homme de courage et d’honnêteté (qui) sur aussi, récemment, porter un regard digne et responsable sur les heures douloureusers de notre histoire contemporaine ». Par contre, l’ancien subordonné de Massu, le général Bigeard, a estimé qu’on avait « profité du grand âge » de son chef « pour lui arracher des aveux ». Enfin, la veuve du général de Bollardière, qui avait dénoncé l’usage de la torture et avait demandé à être relevé de son comandement en Algérie parce qu’il n’acceptait pas cet usage, a relevé que « Massu a obéi aux ordres d’un pouvoir politique qui porte l’entière responsabilité d’avoir donné les pleins pouvoirs à l’armée, laquelle a institutionnalisé la torture en Algérie. Mon mari a dénoncé cette situation. Massu, lui, l’a couverte », mais il est tout de même « le seul à avoir opéré, en quelque sorte, un retour sur lui-même ». (AFP 6.11) Le gouvernement français a chargé le 6 novembre une commission représentative du « monde combattant » de fixer une date pour la future journée de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. Le Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, a annoncé à la presse la formation de cette commission, composée de douze présidents d’associations et fédérations d’anciens combattants, commission placée sous la présidence de l’historien Jean Favier. La commission, a annoncé le Secrétaire d’Etat, « est chargée de trouver une solution à ce qui préoccupe le monde combattant depuis des années : une date qui convienne au monde combattant pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie », et l’Etat « ne s’occupera ni de près ni de loin de ce ce débat ». Les associations d’anciens combattants sont divisées sur la date de la commémoration : la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie propose la date du 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu, date retenue dans un premier temps par l’Assemblée nationale, mais contestée par les associations de harkis et de pieds-noirs, pour qui cette date est aussi celle du début des massacres des leurs. L’Union nationale des combattants propose le 16 octobre, en référence à la date de l’inhumation des « soldats inconnus » de la guerre de 1914-18, de celle de 1939-45, de cette d’Indochine, de celle d’Indochine, et des cendres d’un déporté. D’autres proposent que la date du 11 novembre (fin de la Première guerre mondiale) soit retenue, compte tenu de la disparition inléuctable des derniers participants à ce conflit, comme une sorte de « Memorial Day » à la française, en hommage aux combattants de toutes les guerres. Le président Chirac présidera le 5 décembre l’inauguration d’un « mémorial national de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie », a annoncé le 28 novembre le ministère français de la Défense. Ce mémorial, situé Quai Branly à Paris, comprend trois colonnes de six mètres sur lesquelles un afficheur électronique fera défiler les noms et prénoms des soldats « morts pour la France », année par année. Une borne interactive permettra en outre de rechercher un nom particulier. 24’000 soldats français (Français d’Algérie ou de métropole, « indigènes » des colonies ou d’Algérie) ont été tués pendant la Guerre d’Algérie, de 1954 à 1962. Le projet d’un mémorial pour les combattants d’Afrique du Nord (côté français) avait été adopté en octobre 2001 par le gouvernement socialiste de Lionel Jospin. (Reuters 5.12) Le président Jacques Chirac a salué le 5 décembre, « loin des polémiques et des passions » (mais en ne rendant hommage qu’aux combattants du côté français) la mémoire des soldats tués en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, à l’occasion de l’inauguration du Mémorial national de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, érigé quai Branly, à Paris, au-dessus de la Seine. Le président français a rendu, devant plusieurs centaines d’anciens combattants, un hommage particulier aux harkis, supplétifs algériens de l’armée française en Algérie, qui ont « payé un très lourd tribu », et dont les enfants doivent « trouver toute leur place dans notre pays ». Le mémorial fait défiler, par ordre alphabétique, année par année, sur un afficheur électronique les noms de 22’959 soldats, dont 3010 harkis, tués en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. « Quarante ans après la fin de la guerre d’Algérie, après ces déchirements terribles, au terme desquels les pays d’Afrique du Nord se sont séparés de la France, notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire », a déclaré Jacques Chirac, qui a évoqué les soldats inconnus de la Guerre d’Algérie, dont les noms ne figurent pas sur le monument, notamment les harkis restés en Algérie après le cessez-le-feu et exécutés par l’ALN une fois l’indépendance acquise. Le président français, qui a servi en Algérie avec le grade de sous-lieutenant, a évoqué « l’expérience de la souffrance, de la mort, de la haine » mais aussi le malaise laissé par une « sale guerre » « dont on ne parlait pas, et qui a laissé de profonds sigmates dans notre mémoire nationale ». (L’Expression 19.12) La plainte en appel déposée par les deux soeurs de Larbi Ben M’hidi contre le général Aussaresses, qui avait reconnu être responsable de l’assassinat du responsable du FLN d’Alger après son arrestation en février 1957, a été jugée irrecevable pour des raisons formelles (des « obstacles juridiques ») par la Chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris, qui s’est appuyée sur l’amnistie générale du 31 juillet 1968, qui touchait tous les acteurs de la Guerre d’Algérie. Les deux soeurs de Ben M’hidi relevaient cependant que les crimes avoués par le général Aussaresses (torture, exécution extra-judiciaire) étaient, en droit français, imprescriptibles, en tant que crimes contre l’humanité. 2003(AFP 23.1) La Commission formée par le Secrétaire d’Etat français aux Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, afin de choisir une date pour la future journée nationnale de commémoration de la Guerre d’Algérie, a choisi la date du 5 décembre. L’une des associations représentées dans la commission a cependant maintenu son attachement à la date du 19 mars (anniversaire du cessez-le-feu et des accords d’Evian), choisie initialement par l’Assemblée nationale, qui ne faisait pas consensus du fait de l’opposition des associations de rapatriés et de harkis. La date du 5 décembre correspond à celle de l’inauguration en 2002 du « mémorial national », quai Branly à Paris, à la mémoire des soldats français (dont les harkis) tués en Algérie, au Maroc et en Tunisie de 1952 à 1962. (AP, AFP 19.2 / El Watan 20.2) Le procès en appel de l’ex-général Paul Aussaresses, condamné en janvier 2002 pour avoir dans son livre « Services Spéciaux, Algérie 1995-1957 » justifié et légitimé l’usage de la torture, devait s’ouvrir le 20 février devant la Cour d’appel de Paris, Aussaresses avait été condamné à 7500 Euros d’amende, et avait fait appel de sa condamnation, pour « complicité d’apologie de crimes de guerre ». Ses éditeurs avaient également été condamnés, et ont également fait appel. Aussaresses avait été condamné non pour les actes qu’il avait commis en Algérie, et revendiqué plus de quarante ans après, mais pour ses écrits. Les plaintes pour « crimes contre l’humanité », « crimes de guerre », séquestration ou assassinat avaient été déclarées irrecevables, du fait de l’amnistie de 1968, qui couvre « tous les crimes commis » en relation avec la guerre d’Algérie. Aussaresses et ses éditeurs se disent « confiants » et espèrent la relaxe : « mon livre n’est pas une apologie de la torture, c’est un témoignage », a déclaré Aussaresses, qui n’en a pas moins à nouveau, dans une déclaration à l’AFP, justifié son action en expliquant qu’elle avait pour but « de protéger la vie d’un grand nombre de gens » et qu’elle a été exercée contre des gens « comparables à ceux qui ont causé le massacre du 11 septembre ». Et Aussaresses persiste et signe, déclarant n’avoir « aucun regret ». La Ligue des droits de l’Homme et le MRAP se sont portés partie civile contre Aussaresses. A Tebessa, le 19 février, le président Bouteflika a assisté à l’inhumation des restes de 652 personnes (hommes, femmes enfants) dont les corps avaient été retrouvés dans un charnier datant de l’époque coloniale, sur les lieux où était implantée une « Section administrative spéciale » et un groupement militaire, dirigé par le commandant Connord et le capitaine Leblanc. De nombreux corps portaient des traces de torture, d’exécutions sommaires. Certains avaient les mains et les pieds ligotés avec du fil de fer. Sur les 652 corps retirés après huit mois de fouilles, les médecins légistes ont dénombré 442 adules, dont 17 femmes, 38 adolescents, 19 enfants de 7 à 14 ans et 81 bébés de moins de 18 mois, dont neuf nouveaux nés. (AFP 20.2 / Reuters 21.2) Le général Aussaresses a persisté, lors de son procès en appel, à justifier son action « spéciale » de 1955 à 1957 en Algérie, y compris sa pratique de la torture et des exécutions sommaires, mais s’est défendu d’en faire « l’apologie », ce dont l’accuse au contraire l’avocat de la Ligue des droits de l’Homme, Henri Leclerc. Le procès en appel d’Aussaresses s’est ouvert le 20 février. Le 21, le parquet a requis la confirmation de la peine de 7500 Euros d’amende prononcée en première instance contre Aussaresses, pour « complicité d’apologie de crimes de guerre », et de celles de 15’000 Euros prononcées contre les éditeurs du général (mis à la retraite d’office et suspendu de l’Ordre de la Légion d’honneur). (AFP 19.3) Plusieurs centaines d’anciens harkis se sont rassemblés le 19 mars sur le Vieux-Port de Marseille, et à Arles, pour protester contre le choix du 19 mars, en référence à la signature du cessez-le-feu du 19 mars 1962, pour commémorer la fin de la Guerre d’Algérie. Pour le président de l’association AJIR (Association Justice Information Réparation pour les Harkis), Saïd Merabti, le 19 mars est la date du début des massacres de harkis, « souvent sous les yeux des militaires français qui ne sont pas intervenus ». (AFP 25.4) Le général Paul Aussaresses a été condamné en appel, le 25 avril à Paris, à 7500 Euros d’amence pour complicité d’apologie de la torture dans son témoignage (« Services spéciaux Algérie 1955-1957 »). La Cour d’Appel a confirmé une décision prononcée en première instance. Les éditeurs du général, Plon et Perrin, ont été condamnés à 15’000 Euros d’amende pour apologie de la torture, ou complicité. La Cour d’Appel a estimé qu’Aussaresses avait justifié « avec insistance, tout au long du livre, la torture et les exécutions sommaire » et s’était efforcé « de convaincre le lecteur que ces procédés étaient ‘légitimes’ et ‘inévitables’, autrement dit (avait incité le lecteur) à porter un jugement favorable sur des actes qui constituent objectivement des crimes de guerre ». La Ligue des droits de l’Homme et le MRAP s’étaient portés parties civiles, en estimant qu’accepter les propos d’Aussaresses revenait à « ouvrir la porte à la barbarie ». Aussaresses, qui a affirmé n’avoir « ni regret, ni remord » d’avoir fait ce qu’il a fait, et de l’avoir dit, a annoncé son intention de se pourvoir en cassation et ses avocats ont annoncé qu’ils étaient prêts à aller jusque devant la Cour européenne des droits de l’Homme, au nom de la défense de la liberté d’expression. Les éditeurs ont également annoncé qu’ils allaient se pourvoir en cassation. En revanche, pour l’avocat du MRAP, la décision de la Cour est « une première victoire qui honore la France dans la mesure où elle lui permet de regarder son histoire en face avec courage et lucidité ». Une plainte pour crime contre l’humanité, déposée contre Aussaresses par le MRAP, est toujours pendante devant la Cour de cassation après avoir été jugée irrecevable par les instances précédentes. (Le Monde 17.5, 18.5) Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, poursuivait les 15 et 16 mai le quotidien « Le Monde » en diffamation, après la publication les 4 mai et 4 juin 2002, en pleines élections présidentielle et législatives françaises, de témoignages l’accusant d’avoir pratiqué le torture en Algérie. Mohammed Cherif Moulay a raconté devant la 17ème Chambre correctionnelle de Paris les tortures et l’assassinat de son père, à Alger en 1957, par Le Pen et ses hommes. Mohammed Cherif Moulay avait 12 ans le 2 mars 1957, lorsqu’une unité de parachutistes est arrivée dans sa maison, dans la casbah d’Alger. Les parachutistes étaient « dirigés par un homme blond, grand, fort, qui marchait au pas de course. Les autres l’appelaient ‘mon lieutenant’. J’ai su plus tard qu’il s’appelait Le Pen », témoigne Mohammed Cherif Moulay, dont le père était un haut responsable politico-militaire du FLN. « Le lieutenant a fait un signe du doigt en le montrant aux paras. Mon père a été basculé du haut des escaliers et il a dégringolé jusqu’à la cour ». Il a ensuite été déshabillé, attaché aux piliers de la cour, torturé à l’esu savonneuse administrée de force, puis à l’électricité. Il a ensuite été abattu d’une rafale de mitraillette. Son corps a été retrouvé le ventre gonflil d’eau, « la poitrine et le visage troué de balles, les commissures des lèvres tailladées ». Selon lui, Le Pen aurait oublié sur les lieux de ces exactions un poignard portant son nom (« JM Le Pen, 1er REP »), poignard présenté au tribunal par la journaliste du « Monde » Florence Beaugé. Abdelkader Ammour, venu témoigner au procès, rend également compte d’une opération comparable, survenue dans la soirée du 2 février 1957 dans la casbah, contre la maison de sa famille qui, ce soir là, abritait des membres importants du FLN algérois (Yacef Saadi, Djamila Bouhired, Zohra Drif, Hassiba Ben Bouali, notamment). « Celui qui dirigeait l’opération, le plus agité et le plus bruyant, grand bond à l’allure sportive, n’était autre que le lieutenant Le Pen ». Mustapha Bouhired, l’oncle de Djamila, sera le premier torturé. Abdelkader Temmour le sera ensuite, d’abord à l’électricité, par Le Pen lui-même, puis à l’eau : « Le Pen était alors assis sur mon ventre à l’affût d’un aveu qui ne venait pas ». D’autres témoignages rapportés par « Le Monde » accusent également Jean-Marie Le Pen d’avoir été un tortionnaire. Devant le tribunal, ces accusations ont en outre été portées par deux témoins de la période (et non, directement, des faits reprochée à Le Pen), l’historien Pierre Vidal-Naquet et le journaliste Henri Alleg. Le Pen, alors député poujadiste à l’Assemblée nationale française, s’était volontairement engagé en Algérie. Il n’y est resté que moins de trois mois (de janvier à fin mars 1957), le temps d’être décoré de la croix de la valeur militaire par le général Massu. Absent du procès, le Pen a produit un témoin pour sa défense, le général Louis Martin, à l’époque capitaine de l’unité dans laquelle servait Le Pen, et qui a affirmé que sa compagnie ne pratiquait pas la torture, que Le Pen n’a pas procédé à des interrogatoires, et qui a jugé « invraisemblables » les accusations portées contre Le Pen. Le représentant du Parquet, David Peyron, a demandé la relaxe du « Monde », dont il a qualifié l’enquête de « sérieuse*. L’avocat de Le Pen, Me Wallerand de Saint-Just, lui, accuse le quotidien de « manipulation » et d’information « dénaturée ». L’avocat du « Monde », Yves Baudelot, rappelle que Le Pen lui-même a reconnu avoir fait usage en Algérie de moyens « illégaux » et « exceptionnels » et de « méthodes de contrainte », et que les généraux Massu et Aussaresses ont confirmé l’usage de la torture en Algérie par les unités de l’armée. (Le Monde 17.5) Une centaine de députés de la majorité présidentielle (UMP) ont annoncé qu’ils allaient déposer une proposition de loi relative à la « reconnaissance de l’oeuvre positive des Français en Algérie ». L’un des initiateurs de ce projet, le député de Toulouse Philippe Douste-Blazy, assure qu’il ne s’agit pas de « raviver des passions, mais simplement de reconnaître le travail effectué par certains de nos concitoyens », travail qu’on ne pourrait dissimuler qu’en commettant une « erreur historique ». (AFP 17.6) La Cour de Cassation de Paris a définitivement écarté le 17 juin toute possibilité de poursuivre le général Paul Aussaresses pour « crimes contre l’humanité », pour les actes qu’il a commis (et revendiqués) pendant la Guerre d’Algérie. La Chambre criminelle de la Cour a déclaré que la loi d’amnistie du 31 juillet 1968, portant sur tous les faits commis à l’occasion de la Guerre d’Algérie, excluait toute poursuite pour les faits admis par Aussaresses lui-même, et pour lesquels des plaintes avaient été déposées (pour crimes contre l’humanité) par la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme et le MRAP, après la publication en 2001 du livre de témoignage d’Aussaresses, « Services spéciaux Algérie 1955-1957 ». Pour ce livre, Aussaresses et ses éditeurs ont été condamnés en avril 2003 à des amendes de plusieurs milliers d’Euros (en appel) pour « apologie de la torture ». Pour le MRAP et la FIDH, les crimes commis par Aussaresses, en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité, sont rendus imprescriptibles par le droit international et le droit français, mais la Cour de cassation oppose à cette imprescriptibilité l’amnistie de 1968. Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)Communiqué : Guerre d’Algérie / Affaire AussaressesUne occasion manquée au rendez-vous de la justice et de l’Histoire :La Cour de cassation rejette la poursuite des crimes contre l’humanité commis pendant la guerre d’AlgérieParis, le 18 juin 2003 – La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre sa décision dans l’affaire qui a opposé la FIDH à l’ancien général de l’armée française, Paul Aussaresses, ancien coordinateur en 1957 des services de renseignements à Alger auprès du Général Massu. La FIDH exprime sa plus vive déception quant à cette décision qui consacre l’impunité des crimes commis pendant la guerre d’Algérie. Le 29 mai 2001, la FIDH avait déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du Tribunal de grande instance de Paris du chef de crimes contre l’humanité. Le 11 septembre 2001, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de refus d’informer pour prescription des faits poursuivis. Cette décision avait ensuite été confirmée le 12 avril 2002 par un arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui constatait en outre l’applicabilité de la loi d’amnistie contre les faits reprochés. La Cour de cassation a rejeté hier le pourvoi de la FIDH contre cet arrêt de la Cour de Paris. Pour refuser de poursuivre du chef de crimes contre l’humanité le Général Aussaresses qui décrit dans son livre intitulé « Services Spéciaux Algérie 1955 – 1957 » (Editions Perrin) les actes de tortures et d’exécutions sommaires commis à cette époque en Algérie et dont il assume et revendique le bien fondé, la Cour de cassation utilise des arguments très restrictifs, en contradiction flagrante avec l’évolution récente du droit pénal international :
La FIDH condamne la frilosité et le conservatisme de la décision rendue par la Cour de cassation qui refuse encore obstinément d’appliquer la coutume internationale alors même que faits incriminés obligent pourtant les Etats à poursuivre et juger les auteurs de crimes contre l’Humanité. La FIDH dénonce également l’interprétation restrictive et historiquement étroite de la Cour de cassation qui continuent à considérer que seuls les crimes nazis peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité. «La Cour de cassation aurait pu enfin combler le vide juridique qui pour le crime contre l’humanité subsiste entre 1945 et 1994», estime Patrick Baudouin, avocat et Président d’honneur de la FIDH. « Elle lance au contraire clairement le message inverse, semblant verrouiller toute possibilité de poursuites pour cette période. La décision rendue dans l’affaire Aussaresses est un double rendez vous manqué. Elle symbolise le tabou français sur la recherche et la répression des crimes commis en Algérie et au surplus elle illustre le conservatisme de ceux qui refusent de voir les évolutions récentes de la justice pénale internationale ». En inscrivant sa décision dans l’immobilisme, la Cour de cassation consacre à nouveau le tabou de la guerre d’Algérie et clos à jamais l’espoir légitime des victimes françaises et algériennes dans leur droit à la vérité et à la justice pour les heures sombres de leur histoire commune. (AP 25.6 / AP 26.6 / le Monde 28.6) Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le 26 juin le quotidien « Le Monde », poursuivi par le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, accusé dans une série d’articles du quotidien, publiée en mai et juin 2002 (entre les deux tours de l’élection présidentielle française, qui mettait aux prises Le Pen et Chirac) d’avoir personnellement commis des actes de torture pendant la Guerre d’Algérie. L’enquête de la journaliste Florence Beaugé a été jugée « sérieuse et de bonne foi » par le tribunal, devant lequel la journaliste, et le directeur de la publication du « Monde », Jean-Marie Colombani, étaient poursuivis par le Pen pour diffamation. Pour « Le Monde », la décision du tribunal confirme que « le regard sur l’histoire fait évoluer la justice ». En effet, jusque dans les années ’80, la justice française considérait comme diffamatoire la publication de témoignages accusant notamment Le Pen d’avoir torturé en Algérie (en 1988, « Le Monde » et « Libération » avaient été condamnés pour cela. Mais en 1994, le « Canard Enchaîné » avait été relaxé, ainsi que Michel Rocard en novembre 2000). Le tribunal correctionnel de Paris doit à nouveau se pencher sur des accusations de torture pendant le guerre d’Algérie, après deux actions en diffamation intentées par la militante FLN Louisette Ighilahriz et l’appelé français du contingent Henri Pouillot, contre l’ancien chef d’état-major de l’armée française, le général Maurice Schmitt, qui avait traité Henri Pouillot de « menteur » et de « criminel » et Louisette Ighilariz d' »affabulatrice », après la publication de leurs témoignages. Pour Henri Pouillot, qui relate dans son livre « La ville Sesini » (ed. Tiresias) son expérience d’appelé confronté à la torture, le général Schmitt, qui était en 1957 dans les services de renseignements, a au moins été présent lors de séances de torture, et l’a peut-être lui-même pratiquée -ce que le général nie, contre des témoignages d’anciens militants du FLN. Le général a cependant légitimé la torture lors du procès du général Aussaresses (qui, lui, a admis l’avoir pratiqué, et l’a même revendiqué). Quant à Louisette Ighilariz, elle raconte dans son livre « L’Algérienne » (ed. Fayard) les deux mois de torture et de viols subis pendant la guerre d’Algérie, alors qu’elle était agent de liaison du FLN. (AFP 12.7 / Le Monde 13.7) Le procureur a donné tort, le 11 juillet, à l’ancien chef d’état-major des armées françaises, le général Maurice Schmitt, poursuivi pour diffamation par un ancien appelé du contingent pendant la Guerre d’Algérie, Henri Pouillot, que le général avait traité de « criminel » et de « menteur », et accusé de rafler des jeunes filles dans Alger pour les violer avec ses camarades. Dans un débat télévisé sur France 3, henri Pouillot avait témoigné des exactions commises par l’armée française pendant la Guerre d’Algérie. Pour le Procureur, le général s’est effectivement rendu coupable de diffamation. Le jugement a été mis en délibéré, à la même date (10 octobre) que celui du procès opposant le même général Schmitt à l’ancienne militante FLN Louisette Ighilariz. (AP 17.9) Le président français Jacques Chirac a choisi la date du 5 décembre pour célébrer la mémoire des 24’000 Français (les victimes algériennes « indigènes », pourtant françaises de droit à l’époque, puisque l’Algérie était formée de départements français, n’étant pas comptabilisées comme victimes françaises…) morts pendant la Guerre d’Algérie et les affrontements au Maroc et en Tunisie, a annoncé le 17 septembre le Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera. La date du 5 décembre a été retenue en référence à l’inauguration par Jacques Chirac du mémorial dédié aux combattants (côté français) d’Afrique du Nord. Une commission présidée par l’historien Jean Favier avait suggéré cette date, qui était en concurrence avec celle du 19 mars 1962 (date des accords d’Evian), à laquelle s’opposaient les organisations de rapatriés et de harkis pour qui cette date est le symbole de leur exil, et du début des massacres de harkis. La date du 19 mars, a néanmoins précisé H. Mekachera, peut continuer à être retenue pour commémoration par « ceux qui le souhaitent ». Le Parti communiste français a protesté contre le choix du 5 décembre pour célébrer la mémoire des Français morts pendant la Guerre d’Algérie : cette date n’a « aucune signification historique par rapport à cette guerre », a constaté le député PCF Maxime Gremetz, qui a rappelé que l’Assemblée nationale française avait choisi comme date de commémoration et de « Journée nationale du souvenir et du recueillement » celle du 19 mars (par référence aux accords d’Evian de 1962, marquant la fin « officielle » de la guerre). La Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie (FNACA) a également estimé que le choix d’une date sans « signification historique » était « scandaleux », et négligeait « non seulement l’acte majeur historique qui fut celui du général de Gaulle » (les accords d’Evian), mais également l’avis de « la première association d’anciens combattants au plan national, dont les 370’000 adhérents demeurent attachés à la commémoration du 19 mars ». La FNACA demande que la décision gouvernementale soit « rapportée », et annonce qu’elle ne participera pas aux cérémonies du 5 décembre. (AFP 23.9, AP 24.9, Jeune Indépendant 25.9) Le 25 septembre a été proclamé (par décret, le 31 mars 2003) « journée nationale d’hommage aux harkis » (supplétifs algériens de l’armée française lors de la Guerre d’Algérie), « en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consenti du fait de leur engagement aux côtés de la France, lors de la guerre d’Algérie », et plusieurs cérémonies devraient se dérouler, sur fonds de contestation, plusieurs associations de rapatriés et de harkis ayant décidé de les boycotter. L’Association des Français rapatriés d’Afrique du Nord (AFRAN) appelle ainsi les associations de rapatriés à s’unir pour boycotter la « journée d’hommage aux harkis » et dénoncer « l’absence de politique concrète en faveur de cette communauté ». L’AFRAN annonce que « l’ensemble des associations de rapatriés du Nord Pas de Calais » ont adopté cette position, et qu’une contre-manifestation sera organisée, afin de rappeler que la solution du « drame des harkis » doit passer « impérativement par l’indemnisation, l’insertion économique, sociale et professionnelle, la lutte contre les discriminations et les exclusions ». Par ailleurs, le Conseil de Paris (municipalité) a décidé, contre l’avis de l’opposition municipale de droite, de donner à une place du XIIème arrondissement de la capitale le nom de « place du 19 mars 1962″, date du cessez-le-feu en Algérie. L’adjointe PS au maire, chargée du patrimoine, en a profité pour qualifier d' »invraisemblable » la décision du Président Chirac de fixer au 5 décembre la date de la commémoration de la Guerre d’Algérie, ce qui, selon elle, « perpétue l’injustice et le déni de mémoire dont les anciens combattants et les victimes de la guerre d’Algérie pensaient être sortie ». Le président du groupe UMP (opposition municipale de droite, dont la composante principale est l’ex-RPR néo-gaulliste), Claude Goasguen, a dénoncé le caractère « politicien » de la décision de la municipalité de Paris, à qui il a reproché d’omettre de rappeler « qu’il y a eu 100’000 morts après la date de la signature des accords d’Evian » (Claude Goasguen omettant pour sa part de dire que ces accords ont été négociés et signés par le gouvernement du général De Gaulle, sur instruction du général). Pour le président du groupe PS, en revanche, la date du 19 mars (celle des accords d’Evian) est une « référence historique » qui permet de rendre hommage à « toutes les victimes de la Guerre d’Algérie », contrairement à celle du 5 décembre, qui ne correspond à aucun événement marquant de cette période. Dans un entretien au « New York Times », le président Jacques Chirac s’est appuyé sur l’ ‘expérience de la Guerre d’Algérie pour contester la stratégie américaine en Irak : « Nous savons d’expérience que vouloir imposer de l’extérieur une loi à un peuple, ça ne marche plus depuis longtemps », a déclaré le président français, qui a rappelé qu' »en Algérie, au départ, nous avions une armée considérable, des moyens énormes (alors que) les fellaghas étaient une petite poignée » -mais ce sont eux qui « ont gagné »… (AFP 10.10) Le général Maurice Schmitt, ancien chef d’état-major des armées françaises, a été condamné le 10 octobre pour diffamation à l’encontre d’un ex-appelé français en Algérie, et de la militante FLN Louisette Ighilahriz, qu’il avaient accusés de mentir lors de leurs témoignages sur la torture pendant la guerre d’Algérie. Louisette Ighilahriz avait affirmé avoir été violée et torturée pendant la « Bataille d’Alger », et Henri Pouillot avait affirmé avoir assisté à des séances de tortures en 1961. Le général a été condamné à un euro symbolique de dommage-intérêts pour Louisette Ighilahriz et 1500 euros à Henri Pouillot, mais n’a pas été condamné pénalement, la loi d’amnistie du 6 août 2002 ayant amnisté les diffamations commises avant le 17 mai de cette année. Communiqué du MRAPDeux procès contre la torture gagnéCe vendredi 10 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a condamnépour diffamation Maurice Schmitt, ex-chef d’état major des armées, àdes dommages et intérêts et à l’astreinte de faire publier sacondamnation dans trois journaux. Maurice Schmitt a été condamné pour ses propos visant à la fois HenriPouillot, un ancien appelé qui affirme avoir assisté à des tortures àAlger, qu’il avait qualifié de » menteur « , et Louisette Ighilahriz,qui affirme dans un livre, qualifiée d' » affabulations » par MauriceSchmitt, avoir été torturée en Algérie par des militaires français. Le Mrap se félicite de ces deux décisions de justice qui ont permis àLouisette Ighilahriz et Henri Pouillot de retrouver leur honneurbafoué par les propos de Maurice Schmitt. Nous nous félicitons de ladétermination et du courage de l’un et de l’autre contre celui qui aoccupé les plus hautes fonctions des armées en France. Pour le Mrap, cette décision a valeur de symbole : c’est la premièrefois qu’une aussi haute personnalité impliquée dans la guerred’Algérie est condamnée. C’est une étape importante sur le chemin dela justice, de la vérité, et de la mémoire. Cela permettra d’aider àce que les jeunes issues de l’immigration, en quête d’identité,puissent se reconstruire. Le Mrap attend que cette décision soit prolongée par une condamnationdes plus hautes autorités françaises de la pratique de la torture enAlgérie et du rôle de l’Etat français dans celle-ci. Paris, le 10 octobre 2003. (Le Quotidien d’Oran 16.10) La Mairie (communiste) de Nanterre a fait apposer, et inaugurera le 17 octobre, au centre ville, une plaque commémorative des massacres commis lors de la répression des manifestations du FLN le 17 octobre 1961 dans la région parisienne. Nanterre était alors le lieu d’un immense bidonville, à forte population algérienne, d’où les premiers groupes de manifestants étaient partis en direction de Paris. Le couvre-feu décrété par Maurice Papon y avait été appliqué avec une brutalité toute particulière. (AFP 17.10) La plaque commémorant à Nanterre la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961 à Paris a été inaugurée le 17 octobre à Nanterre par la députée-maire (PCF) Jacqueline Fraysse, qui, après avoir fait respecter une minute de silence à la mémoire des victimes de cette répression, au plaidé pour la « réconciliation » et le « devoir de mémoire ». Comme celle apposée à Paris en 2001 par le maire socialiste de la capitale française, Bertrand Delanoë, la plaque de Nanterre porte l’inscription : « à la mémoire des nombreux Algériens tuée lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 ». Le même jour, à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le pont Saint-Michel pour le 42ème anniversaire du massacre du 1961, et ont déposé des gerbes de fleurs devant la plaque commémorative, ou jeté des fleurs dans la Seine. Le représentant de la communauté algérienne de Paris, Lakhdar Baata, a regretté que « le chiffre officiel des morts (n’ait) toujours pas été dévoilé » Communiqué du MRAP :17 octobre 1961 : un crime d’EtatLe 17 octobre 1961, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants -qu’on appelait à l’époque » Français-musulmans » – manifestentpacifiquement contre un couvre feu raciste décrété par Maurice Papon,alors Préfet de Police de Paris. Commence alors une répressionsanglante qui se poursuivra jusqu’au 20 octobre : arrestationsmassives, assassinats, tortures, déportations frapperont aveuglémentles Algériens de Paris et de la banlieue. Plus de 200 d’entre euxseront assassinés par des policiers sur ordre de leurs supérieurs. Dès le 18 octobre 1961, le MRAP appelait à un meeting de protestation.Depuis plus de 10 ans il se bat contre l’oubli, pour la vérité et lajustice car ces pages sombres de notre histoire constituent un levierpour le racisme anti-algérien et plus généralement anti-maghrébin quitrouve ses sources dans l’amnésie et le refoulement collectif. Des avancées ont eu lieu dans la reconnaissance de ce crime d’Etat.Notamment avec la pose d’une plaque commémorative en hommage desvictimes du 17 octobre par le Maire de Paris Bertrand Delanoë. Lacondamnation du Général Schmitt pour ses propos visant Henri Pouillot,ancien appelé, témoin des tortures pratiquées à l’encontre deprisonniers à Alger, et de Louisette Ighilahriz, torturée par desmilitaires français est une nouvelle étape vers la justice et lavérité Cependant, notre combat est loin d’être terminé. Le MRAP attend unereconnaissance officielle de ce massacre d’Etat commis le 17 octobre1961 ainsi que la condamnation par les plus hautes autoritésfrançaises de la pratique de la torture pendant la guerre d’Algérie. Le MRAP appelle à se rassembler le 17 octobre 2003 de 18h à 20h sur lePont St Michel, un des lieux symboliques de cette tragédie. Paris, le 16 octobre 2003. (AFP 2.11 / AP 3.11 / AFP 5.11) Un collectif de harkis du sud-ouest a déposé à la mi-octobre une plainte contre X pour « crimes contre l’humanité » pour les massacres des harkis à l’indépendance de l’Algérie. Selon l’avocat des plaignants, Alain Bousquet, la plainte vise implicitement « les membres des gouvernements de la IVe et de la Ve République française », ainsi que les autorités algériennes. Selon les plaignants, la France était, jusqu’à l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962, et donc entre les accords d’Evian du 18 mars et cette date (période où les harkis, abandonnés par l’armée française ont été massacrés), garante du maintien de l’ordre en Algérie, et à ce titre responsable de la sécurité de ses supplétifs algériens (les harkis, prélcisément). Selon les plaignants, les massacres de harkis ont été « permis sciemment » par les autorités françaises, qui ne pouvaient pas ne pas les prévoir, et encore moins les ignorer dès lors qu’ils avaient commencé. D’autres familles de harkis ont annoncé leur intention de déposer plainte contre le ministre des Armées de l’époque (en ancien Premier ministre), Pierre Messmer, lequel a déclaré qu’il avait la conscience « tranquille », et qu’il avait « des rfegrets, mais pas de remords ». Messmer assure qu’il avait voulu réagir militairement aux massacres, mais que le général De Gaulle lui-même l’en avait dissuadé en lui demandant s’il voulait « recommencer la guerre d’Algérie ». Le président du Comité national de liaison des harkis, Boussad Azni, a cependant qualifié de « coup médiatique » la plainte éventuelle contre Pierre Messmer, et exprimé son opposition aux plaintes nominatives. Dans le même temps, un livre de Georges-Marc Benamou (« Un mensonge français. Retours sur la guerre d’Algérie » relance la polémique sur la responsabilité du gouvernement français de l’époque, en soutenant que harkis et pied-noirs ont été volontairement sacrifiés. Entre 50’000 et 150’000 harkis, selon les sources, ont été massacrés entre le 18 mars et le 31 juillet, par des membres du FLN ou des « combattants de la dernière heure » se rangeant au dernier moment dans les rangs des vainqueurs de la lutte pour l’indépendance. Selon un sondage CSA effectué à la mi-octobre auprès d’un échantillon d’un millier de personnes. 68 % des personnes interrogées estiment que la France s’est « mal conduite » à l’égard des harkis (22 % sont d’un avis contraire), 44 % qu’elle s’est « mal comportée » à l’égard des Pieds Noirs (42 % sont d’avis contraire) et 43 % qu’elle s’est « mal comportée » à l’égard des Algériens (42 % sont d’un avis contraire). Cependant, 55 % des personnes interrogées considèrent que la France ne devrait pas « demander officiellement pardon » à l’Algérie pour les 130 ans de colonisation (37 % estiment au contraire qu’elle devrait le faire), 43 % que la situation de l’Algérie et des Algériens « était meilleure » quand l’Algérie était française que depuis l’indépendance (36 % sont de l’avis inverse). 22 % des personnes interrogées estiment que la guerre d’Algérie s’est soldée par une « défaite française, et les deux tiers (66 %) que tout n’a pas été dit sur cette période. (Quotidien d’Oran 15.11) Une conférence-débat sur le thème « Algérie : devoir de mémoire, devoir de solidarité », et à laquelle participaient, à l’Institut du Monde Arabe de Paris, le 13 novembre, le président du Front des forces socialistes, Hocine Aït Ahmed, ainsi que des militants de la solidarité avec la cause algérienne lors de la guerre d’indépendance, a été interrompue par une alerte à la bombe, qui a provoqué l’évacuation de la salle. (AFP 5.12) La France a rendu le 5 décembre un premier « hommage national », officiel, aux victimes de la Guerre d’Algérie, mais dans la division des associations d’anciens combattants (la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, FNACA, qui revendique 370’000 adhérents boycottant les cérémonies en rejetant « catégoriquement » le choix de la date « abracadabrantesque » du 5 décembre, en affirmant que « seule la date historique du 19 mars, anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars en 1962 en Algérie, peut convenir pour un tel hommage », position partagée par le Parti communiste). 2004(El Watan 12.2) Plus de quarante ans après les essais nucléaires français dans le sud saharien algérien, dans la région de Reggane (w. Addar), une victime des effets de ses essais, M. Bendjebbar, et une association de victimes constituée le 15 mars 2003, tentent de lever le voile sur ce qui est toujours un secret d’Etat, en France comme en Algérie. Selon des témoins français des essais, des déchets hautement radio-actifs avaient été placés dans des bunkers bétonnés supposés étanches, qui sont toujours sur place, dans le Tanezrouft. Une assistante sociale algérienne ayant travaillé dans la région déclare avoir découvert dans la population locale une proportion anormalement élevée de handicapés, présentant des malformations congénitales des membres inférieurs et supérieurs, ou une cécité, ainsi qu’une proportion anormale de femmes ayant accouché sous césarienne, ou ayant présenté soit une puberté tardive, soit une ménopause précoce. Les essais nucléaires français se sont poursuivis dans le sud saharien algérien jusqu’en 1967, conformément aux accords d’Evian. (Politis 13.2) Michel Delsaux, Rémi Serres, Georges Treilhou et Armand Vernhettes, quatre anciens combattants de la Guerre d’Algérie, ont créé en janvier une association pour faire don de leur pension d’anciens combattants à des organisations pacifistes. Les membres de l’association s’engagent à reverser pendant au moins un an à des oprganismes oeuvrant pour la paix le montant de leur retraite d’ancien combattant (423 euros par mois). Association des anciens appelés en Algérie contre la guerreBP 229F-81006 Albi CédexCCP 960 147 E centre Toulouse (El Watan 18.2, 19.2) Un hommage a été rendu le 18 février au cimetière de Diar Essaâda, à Alger, à l’aspirant Henri Maillot, membre du Parti communiste algérien, qui avait déserté l’armée française en 1956 et avait conduit un camion bourré d’armes dans un maquis de l’Ouarsenis, dirigé par un pied-noir de Biskra, Maurice Laban (un ancien des Brigeades Internationales d’Espagne) puis avait intégré l’ALN. Condamné à mort par le tribunal permanent des forces armées françaises le 22 mai 1956, il tombera au combat en juin. Début février, un hommage a également été rendu à Fernand Yveton, pied-noir membre du FLN, guillotiné en 1957 pour avoir déposé une bombe dans un entrepôt de la Compagnie d’électricité et du gaz, sur ordre du FLN. Yveton a été exécuté après que le ministre de la Justice français de l’époque eut refusé la demande de révision de son procès. Ce ministre s’appelait François Mitterrand. (AP 10.3) Le Secrétaire d’Etat français aux Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, a présenté lée 10 mars au Conseil des ministres un projet de loi pour les rapatriés d’Algérie et les harkis. Le projet prévoit une nette hausse de l' »allocation de reconnaissance » et la participation de l’Etat à un Mémorial national de l’Outre-mer, à Marseille. Le préambule du texte reconnaît que « La France, en quittant le sol algérien, n’a pas pu sauver tous ses enfants », et évoque les « massacres » d' »innocentes victimes ». L’allocation « de reconnaissance », versée à environ 11’000 personnes, passera de 1830 à 2800 Euros par an en 2005. Elle pourra être remplacée par un capital de 30’000 Euros. Les aides au logement de 12’000 Euros seront prolongées jusqu’en 2009 (AFP 17.3) Plusieurs organisations d’anciens combattants français en Afrique du Nord, dont la FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) et l’ARAC (Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre), opposées au choix par le gouvernement de la date du 5 décembre pour rendre hommage aux victimes des conflits en Afrique du nord, ont annoncé des commémorations dans toute la France le 19 mars, date des Accords d’Evian de 1962, mettant fin à la Guerre d’Algérie. La FNACA a annoncé qu’elle allait « agir pour l’abrogation du décret présidentiel instituant la date du 5 décembre). (AFP 20.4) Le Maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, a inauguré le 20 avril dans le XIIème arrondissement une « place du 19 mars 1962 », date du cessez-le-feu en Algérie. Bertrand Delanoë a appelé à regarder « notre histoire en face ». L’inauguration de cette place, dédiée à tous les morts des guerres d’Afrique du nord, s’inscrit dans une controverse sur la date de l’hommage à ces morts. Le gouvernement a retenu la date du 5 décembre, qui n’a pas d’autre référence que celle d’être la date de l’inauguration par le président Chirac d’un monument aux morts d’Afrique du nord, alors que plusieurs organisations d’anciens combattants et de rapatriés, et 3500 municipalités, retiennent la date du 19 mars, comme pour tous les conflits )notamment les deux guerres mondiales du XXème siècle) pour lesquels la date du cessez-le-feu ou de l’armistice est retenue comme date de commémoration et d’hommage aux morts. Bertrand Delanoë, qui a rappelé qu’il était lui-même un Français d’Afrique du nord, a affirmé ne vouloir ignorer « aucune des morts survenues après (la) date » du cessez-le-feu, ce qui fait notamment référence aux harkis (combattants algériens dans l’armée française) massacrés après le cessez-le-feu, mais il a ajouté que « rien ne peut se construire d’honorable et de fidèle si nous ne sommes pas dans la vérité historique ». le Maire de Paris a dédié la plade du 19 mars 1962 « aux jeunes gens dont certains ont fait le sacrifice de leur vie, dont tous ont laissé une part de leur jeunesse, de leur vitalité, de leur espérance, parfois de leurs illusions » dans les guerres d’Afrique du nord. (Le Monde 14.5) Les douze intellectuels français* qui avaient invité le 31 octobre 2000 l’Etat français à reconnaître et condamner officiellement les exactions commises pendant la Guerre d’Algérie ont réitéré leur appel. Les signataires de l’appel voient dans le scandale suscité par les sévices perpétrés par des militaires de la coalition d’occupation de l’Irak sur des prisonniers irakiens la confirmation que le recours à la force pour régler un conflit politique « débouche immanquablement sur le pire », mais ajoutent que si la France veut être crédible dans sa condamnation des pratiques de torture, elle ne peut « pas se contenter de (les) déplorer chez les autres », mais doit aussi les condamner chez elle, et donner « l’exemple du rejet de ces pratiques qui entachent l’honneur de tout un peuple ». Les signataires de l’appel signalent d’ailleurs que les tortures dont des Irakiens ont été victimes du fait de membres de la coalition anglo-américaine en Irak ont été reconnues et dénoncées bien plus clairement et plus rapidement par les autorités des pays concernés que cela n’avait été le cas par les autorités françaises lors de la Guerre d’Algérie. *notamment : Germaine Tillon, Henri Alleg, Simone de Bollardière, Josette Audin, Pierre Vidal-Naquet et Gisèle Halimi.(APS 26.5) Le Maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, a inauguré le 26 mai la place Maurice-Audin, du nom d’un militant communiste français, militant de la cause nationale algérienne, enlevé et assassiné en juin 1957 à Alger par des parachutistes français. L’inauguration s’est faite en présence de la veuve de Maurice Audin, de l’Ambassadeur d’Algérie en France Mohamed Ghoualmi, d’Henri Alleg et de Pierre Vidal-Naquet. Pour Bertrand Delanoë, il ne faut pas « se résigner à l’oubli » mais « rechercher la vérité et l’assumer pour la regarder en face ». La place Maurice-Audin sera « un signe de fraternité entre les peuples algérien et français », a ajouté le Maire de Paris. (El Watan 27.5) Le mouvement associatif de Beni Ilmane organise le 27 et 28 mai un séminaire sur le massacre du 28 mai 1957, connu sous le nom de « Massacre de Melouza », lorsque 375 personnes, dont 267 habitants de Beni Ilmane, ont été massacrés par une unité de l’ALN -qui a également massacré des djounouds (soldats de l’ALN) qui refusaient de prendre part àé la tuerie, et des personnes étrangères au douar mais s’y trouvant au moment des événements. Les raisons du massacre sont encore controversée, mais la plupart des historiens s’accordent à le replacer dans le contexte de la lutte opposant le FLN aux messalistes pour l’hégémonie dans le mouvement de libération nationale (Beni Ilmane était messaliste). Le rôle de l’armée française, non dans la commission du massacre lui-même mais sous forme de complicité, fait également l’objet d’interrogations, des témoignages relevant la présence, pendant le massacre et à proximité immédiate, d’observateurs français, et par ailleurs d’avions survolant le douar. (El Watan 29.5) La « journée d’information » que comptait organiser le mouvement associatif de Beni Illmane sur le massacre de Melouza, le 28 mai 1957, a été interdite par les autorités, après son annonce par « El Watan ». Sur place, seule une visite guidée des lieux du massacre (commis par des éléments de l’ALN sur des civils, et sur d’autres éléments de l’ALN ayant refusé de participer à la tuerie) a pu avoir lieu, sur les hauteurs de Mechta Gasbah. (Le Monde 30.5) Un nouveau « procès de la torture pendant la Guerre d’Algérie » s’est ouvert le 28 mai devant la Cour d’Appel de Paris, à l’initiative du général maurice Schmitt, ancien chef d’Etat major des armées, qui a fait appel de sa condamnation, en octobre 2003, pour diffamation à l’encontre de l’ancien appelé d’Algérie Henri Pouillot, qu’il avait traité dans un débat télévisé de « menteur ou criminel » après qu’Henri Pouillot ait dénoncé la pratique de la torture pendant la Guerre d’Algérie, et ait déclaré en avoir été personnellement témoin. Le général Maurice Schmitt, tout en reconnaissant « qu’il y a eu des tortures en Algérie », et « quelques viols, toujours très lourdement sanctionnés » (alors que la quasi totalité des historiens de cette période s’accordent aujourd’hui à considérer que la pratique des viols, notamment dans les opérations contre les villages, douars et les mechtas était presque systématique, et en tous cas très fréquente), s’est dit « solidaire des camarades qui, en application de décisions politiques, ont dû pratiquer des interrogatoires sévères pour sauver des vies humaines ». Henri Pouillot s’est ensuite fait traiter par le général de « pleutre exemplaire » pour n’avoir pas « dénoncé » les crimes dont il a été témoin (selon le général, il aurait suffi à l’appelé d' »alerter des journalistes », alors que tous les journaux qui ont évoqué les tortures ont été censurés, et souvent saisis), puis de « menteur » et de « malade psychiatrique » par l’avocat du général, José Allegrini. L’avocat d’Henri Pouillot a appelé le tribunal à ne pas « couvrir des exactions commises au nom de la France », et à ne pas accepter l’argumentation justifiant la torture au nom des « nécessités » de la guerre. Le jugement devrait être rendu le 17 septembre. (AFP 11.6 / Quotidien d’Oran 13.6) L’Assemblée nationale française a approuvé le 11 juin, à l’unanimité, la création d’une fondation « pour la mémoire de la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie ». Les conditions de création de cette fondation feront l’objet d’un décret du Conseil d’Etat. Une majorité de députés se sont en outre prononcés en faveur de la reconnaissance par les programmes scolaires et universitaires du « rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du nord », et de l’interdiction de « toute allégation injurieuse envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d’ancien supplétif de l’armée française en Algérie ». La veille, le 10 juin, on apprenait le décès de l’un des derniers dirigeants survivants de l’OAS, le colonel Antoine Argoud, qui n’avait jamais renié son engagement pour l’Algérie française, et avait, dans un livre de souvenirs publié en 1974, justifié l’emploi des exécutions sommaires dans le cadre de la « pacification ». Il avait été condamné à mort par contumace le 17 juillet 1961, puis, après avoir été enlevé en Allemagne le 25 février 1963 par les services spéciaux français, à la détention criminelle à perpétuité, puis enfin gracié (en mai 1968…) (Le Matin 4.7) Le 2 juillet, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné un ancien appelé d’Algérie, Henri Pouillot, à 3500 euros d’amende, de dommages et intérêts et de frais de justice, sur plainte de l’ancien chef d’état-major des armées françaises, le général Maurice Schmitt, que Henri Pouillot avait accusé d’avoir fait l’apologie de la torture pendant la guerre d’Algérie (que Schmitt a fait avec le grade de lieutenant). Considérant n’avoir fait que reprendre des déclarations du général Schmitt lui-même (qui aurait notamment publiquement déclaré que la torture pouvait être nécessaire), Henri Pouillot a annoncé qu’il allait faire appel du jugement, et qu’il disposait d’informations nouvelles à l’appui de sa bonne foi. Précédemment, en octobre 2003, le général Schmitt avait été condamné pour diffamation pour avoir accusé Henri Pouillot de mensonge, après la parution d’un livre dans laquel l’ancien appelé témoignait de son expérience pendant la guerre d’Algérie, et de l’usage de la torture par l’armée française. (El Khabar 15.7) La rumeur, récurrente, d’un « retour des harkis », a repris corps à la faveur de la visite du ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, et de déclarations interprétées comme annonçant que des « facilités » seraient accordées par les autorités algériennes aux anciens supplétifs algériens de l’armée française pour qu’ils puissent effectuer des visites au pays, ce qui a d’ailleurs été démenti par les autorités algériennes. Le petit parti « Ahd 54 » de l’ex-candidat à l’élection présidentielle Faouzi Rebaïne a appelé le gouvernement algérien à prendre et à exprimer clairement une position ferme sur la « question des harkis », et a ajouté que « les enfants des harkis occupent des postes clés » dans le pouvoir algérien. Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de Moudjahidines, Mebarak Khalifa, a exprimé l’opposition ferme de son organisation au « retour des harkis, de leur progéniture ou des Pieds-Noirs ». (El Watan, Quotidien d’Oran 21.7) Le présidnt français Jacques Chirac a invité le président algérien (notamment) à prendre part à la célébration officielle du 60ème anniversaire du débarquement allié en Provence, en août 1944. Des bateaux algériens participeront aux exhibitions militaires prévues à Toulon. Cette présence du président algérien à la commémoration du débarquement de Provence, et d’une manière générale à la célébration de la libération de la France (et de l’Europe) du nazisme, justifiée par le fait que des dizaines de milliers d’Algériens (« indigènes » ou pieds-noirs), enrôlés (volontairement ou non) dans l’Armée d’Afrique commandée par le général (algérien pied-noir) Juin, y ont participé*, et que des milliers sont morts au combat, notamment en Italie, a suscité la douteuse colère d’une quarantaine de députés de droite (de l’UMP, parti de la majorité présidentielle française), qui ont adressé une pétition au ministre des Affaires étrangères Michel Barnier. Ces députés « s’indignent » de l’invitation faite à Abdelaziz Bouteflika, invitation qu’ils considèrent comme « une insulte à la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France et que M. Bouteflika a toujours ignorés, voire bafoués » (allusion, non pas aux combattants algériens de 1943-1945, mais aux harkis pendant la Guerre d’Algérie). A propos des harkis, d’ailleurs, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Belkhadem, a déclaré le 20 juillet que « leurs enfants sont les bienvenus », et que « ceux qui détienne un passeport français seront traités comme des Français », y compris s’ils sont nés en Algérie (la position algérienne sur ce sujet n’a guère varié depuis des années : ne faisant aucune différence entre ressortissants français nés en Algérie et autres ressortissants français, elle n’exclut explicitement d’accepter la venue en Algérie que des harkis eux-mêmes, et des anciens membres de l’OAS.) *On estime à 35’000 le nombre des Algériens (« indigènes » ou pieds-noirs) encore vivants qui ont combattu dans les rangs alliés entre 1939 et 1945, dont des hommes qui, à l’image d’Ahmed ben Bella, se sont ensuite illustrés dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie…(AFP 16.9) L’avocat d’un millier de « rapatriés » français d’Algérie s’estimant « spoliés » de leurs biens à l’indépendance ont annoncé leur intention de déposer plainte contre l’Etat algérien devant le Comité des droits de l’Homme de l’ONU à genève. Selon leur avocat, « les avances versées par la France sur ce qu’est en droit de verser l’auteur de la spoliation, l’Algérie, sont parfaitement insuffisantes », a déclaré leur avocat, Alain Garay. Le 25 janvier 2001, la Cour européenne des droits de l’Homme avait reconnu que quatre rapatriés d’Algérie (dont elle avait cependant jugé la plainte irrecevable) avaient été « dépossédés de leurs biens par l’Etat algérien », qui n’avait versé « aucune indemnité aux Français touchés par les nationalisations ». En France, quatre lois d’indemnisation, en 1970, 1978, 1982, 1987, ont donné au versement de plus de 14 milliards d’euros (en valeur « actualisée », la valeur nominale étant bien moindre) à 440’000 personnes. Pour autant, le président de l’Union de défense des intérêts des Français repliés d’Algérie et d’Outre mer (USDIFRA, proche du Front National), Gabriel Mène, assure que 30 % seulement de la valeur des biens des rapatriés en 1962 ont été couverts par les indemnisations reçues. (AFP 23.9) Des descendants d’Algériens engagés dans les camps opposés lors de la guerre d’indépendance, dont des harkis, ont lancé le 23 septembre un manifeste commun « pour la réappropriation des mémoires confisquées », et ont annoncé qu’ils s’uniraient pour les cérémonies en hommage aux harkis le 25 septembre et aux Algériens de France victimes de la répression policière en 1961, le 17 octobre. Les signataires du manifeste expriment le souhait de « se mobiliser pour inscrire leur histoire commune dans la mémoire collective des deux pays » et « assumer leur héritage dans la dignité et la fraternité », alors que leurs parents, « par choix, hasard ou nécessité, se sont trouvés dans des camps différents durant la guerre d’Algérie ». Le manifeste, qui dénonce la « dualité simpliste » mettant les bons d’un côté, les mauvais de l’autre, estime que « les passions, les haines, ainsi que les contentieux divers, continuent d’entraver (le) travail de mémoire (…) nécessaire à tous ». * notamment son initiatrice, Fatima Besnaci-Lancou, présidente de l’association Harkis-droits de l’Homme, Yazid Sabeg, chef d’entreprise, et Khadidja Bourcart, adjointe au Maire de Paris.MANIFESTE POUR LA RÉ-APPROPRIATION DES MÉMOIRES CONFISQUÉESlundi 27 septembre 2004 Nous, filles et fils de parents d’origine algérienne, descendants de harkis et descendants d’immigrés, souhaitons ensemble nous approprier notre histoire et en assumer toutes ses parts d’ombres et de lumière. À l’heure où la France et l’Algérie s’apprêtent à signer un traité d’amitié, nous souhaitons être acteurs de cette réconciliation qui ouvrira une nouvelle page dans la relation entre les deux pays. Nos parents, par choix, hasards ou forcés se sont trouvés dans des camps différents durant la guerre d’Algérie. De part et d’autre de la Méditerranée, les acteurs de cette guerre ont été classés selon une dualité simpliste : les bons d’un coté et les mauvais de l’autre. Cette simplification de l’histoire a pris racine et a généré des itinéraires parallèles, sans parole, entre les harkis et les immigrés alors que tout les unissait. Nos parents sont :
C’est pourquoi, nous refusons désormais le récit parcellaire de la guerre d’Algérie et l’occultation totale du drame des harkis, révélatrice d’une histoire coloniale non assumée en France et instrumentalisée en Algérie. A force d’ignorer partiellement ce qui a fait notre l’histoire, nous avons laissé libre cours à tous les fantasmes, à toutes les peurs qui ont contribué à creuser le fossé entre les Français et les Algériens et particulièrement entre les Harkis, les immigrés et leurs descendants. Les passions, les rancœurs, les haines, ainsi que les contentieux divers continuent d’entraver ce travail de mémoire, pourtant nécessaire à tous. C’est pourquoi, il est de notre devoir et de notre responsabilité de nous mobiliser pour inscrire notre histoire commune dans la mémoire collective de l’Algérie et de la France, pour réécrire enfin notre histoire, une histoire assumée de part et d’autre de la Méditerranée. Nous avons besoin de retisser la trame de cette mémoire confisquée, de cette filiation occultée. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les Français et les Algériens acquièrent une connaissance globale de ce passé douloureux mais partagé. Il nous faut établir la vérité historique, toute la vérité, et faciliter le travail des historiens des deux rives. C’est dans l’intérêt des deux pays, de leur cohésion nationale, que ce travail de mémoire doit se faire, et c’est à ce prix qu’une réconciliation franco-algérienne solide, respectueuse des identités et des mémoires de chacun, pourra voir le jour. Nous, héritiers de cette histoire, descendants d’Algériens, commémorerons, ENSEMBLE deux dates symboliques, fil d’Ariane de ce passé enfin assumé : la journée du 25 septembre dédiée aux harkis et celle du 17 octobre 1961. En reliant les deux dates, nous voulons assumer notre héritage dans la reconnaissance, la dignité et la fraternité.
Premiers signatairesFatima Besnaci-Lancou, éditrice, écrivainYazid Sabeg, chef d’entrepriseKhedidja Bourcart, maire-adjoint de ParisGhaleb Bencheikh, présentateur émission « Islam » A2Hadjila Kemoum, écrivainMouloud Mimoun, cinéasteDalila Kerchouche, écrivainMoussa Khédimellah, sociologueBétoul Fekkar-Lambiotte, fonctionnaire internationaleDjamila Azrou-Isghi, maire-adjoint StrasbourgNabile Farès, écrivainLeïla Sebbar, écrivainAli Aïssaoui, médecin, président d’UNIRFrançois Touazi, fonctionnaireZaïr Kedadouche, élu (mairie de Paris 17ème)Charles Kerchouche, chef de projetFadila Méhal, FonctionnaireTassadit Houd, cadre supérieurSamia Messaoudi, journalisteSmaïl Boufhal, enseignant, éluSoraya Saa, fonctionnaire (El Watan 26.9) Près de 40 ans après les essais nucléaires français dans le Sahara algérien, une instruction juduiciaire a été ouverte à Paris après le dépôt, le 28 novembre 2003, d’une plainte par l’Association des vétérans des essais nucléaires (AVEN) et des plaignants individuels, pour homicide involontaire, atteinte à l’intégrité physique des personnes, abstention délictueuse et administration de substances nuisibles. 210 expériences nucléaires ont été menées par la France dans le sud saharien et en Polynésie entre 1960 et 1996, les premières (dans le sud saharien) sans que les précautions et les protections nécessaires aient été assurées aux populations locales, et aux personnels civils et militaires. Selon l’AVEN, environ 150’000 personnes ont participé involontairement et sans préparation aux essais nucléaires français pendant 36 ans, et sur 720 vétérans de ces expériences, 30 % sont aujourd’hui atteints de cancers. « El Watan » note que le gouvernement algérien n’a entamé aucune démarche auprès de l’Etat français pour l’indemnisation des victimes, et le ministre des Relations avec le Parlement, Mahmoud Khoudri, s’était contenté en 2003 de déclarer que « rien n’empêche ces victimes de demander réparation auprès des autorités françaises ». Entre 1960 et 1966, la France a opété quatre essais atmosphériqaues et treize essais souterrains dans le Tanezrouft, dans la région de Reggane. (AFP 15.10 / APS, AFP 17.10) Le 43ème anniversaire des manifestations algériennes du 17 octobre 1961 à Paris, et de leur sanglante répression par la police sous les ordres du préfet Papon, a été célébré à Paris le 16 octobre, au pont Saint-Michel par un rassemblement de plusieurs centaines de personnes devant la plaque commémorative apposée en 1999 par le Maire de la capitale française, Bertrand Delanoë, et le 17 octobre à Nanterre, où une plaque commémorative avait été posée en 2003, et à Sarcelles, où une plaque commémorative a été inaugurée. Pour la première fois, des enfants de harkis, représentés par l’association « Harkis et droits de l’Homme », se sont associés (à Paris) à la commémoration de l’événement. « Nous avons plutôt été bien accueillis, et c’est un joli geste de fraternité », s’est réjouie la présidente de l’associarion, Fatima Besnaci-Lancou, même si des Algériens présents estimaient que « les harkis (n’avaient) pas leur place ici ». Plusieurs organisations de défense des droits humains (MRAP, Ligue des droits de l’Homme, Cimade, notamment) et plusieurs partis politiques français (les Verts, le LCR, le Parti socialiste, notamment) ont réclamé la reconnaissance officielle par la France de sa faute (« des exactions commises le 17 octobre 1961 », selon les termes du PS), le libre accès aux archives et l’inscription de l’événement dans les programmes scolaires. Pour l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Ghoualmi, présent aux commémorations de Sarcelles et de Paris, ces cérémonies sont un « acte de courage » des Français, notamment des él,us, qui refusent de « participer à l’amnésie collective », et de tels gestes sont très importants à un moment où la France et l’Algérie refondent leurs relations. A Alger, le 17 octobre, le président Bouteflika a rendu hommage, à l’occasion de la « Journée nationale de l’émigration », au « patriotisme » et au « sacrifice dont les émigrés ont fait montre pour exprimer, haut et fort, leur attachement indéfectible à la cause de leur peuple », malgré « la répression, la torture et les assassinats ». (Tribune de Genève 20.10) Plus d’un millier de dossiers individuels de Français rapatriés d’Algérie à la fin de la guerre d’indépendance vont être déposés devant le Comité des droits de l’Homme de l’ONU à Genève, le comité devant, à la demande des rapatriés et de leurs représentants, procéder à l’examen et au contrôle du respect par l’Algérie de ses engagements au sens du Pacte international des droits civils et politique, qu’elle a ratifié en 1989. Pour le président de l’Union de défense des intérêts des Français repliés d’Algérie (USDIFRA), Gabriel Mène, « le devoir de mémoire doit s’accompagner d’un devoir de justice ». L’avocat de l’USDIFRA, Me Garay, ajoute qu’il incombe à l’Algérie de « dédommager les personnes spoliées ». Selon le Groupement national pour l’indemnisation (GNPI), autre organisation de rapatriés, le montant total des indemnisations qui pourraient être réclamées, en sus de celles déjà obtenues de la France, pourrait atteindre les 12 milliards d’euros. Côté algérien, on estime que le dossier est clos depuis 1962, c’est-à-dire depuis les accords d’Evian, à moins que l’on souhaite le rouvrir « en entier », c’est-à-dire en y incluant les 130 ans de colonisation française, et donc le droit de l’Algérie en tant qu’Etat, et des Algériens en tant qu’individus, de réclamer à la France des indemnisations pour les spoliations inhérentes à la colonisation, en sus de celles liées aux exactions commises pendant la guerre d’indépendance. (Le Monde 30.10) La Secrétaire nationale du Parti communiste français, Marie-GHeorge Buffet, a appelé le 28 octobre, lors d’une soirée organisée par le PCF à Paris pour commémorer le déclenchement de l’insurrection armée en Algérie, le président Chirtac a « reconnaître le tort fait à la nation algérienne par le colonialisme, la répression et la guerre » (Le Monde 30.10) Un sondage d’opinion effectué en France et en Algérie (sur un millier de personnes dans chaque pays) à la demande du quotidien « Le Monde » et de la radio RTL par l’institut CSA, à l’occasion du cinquantième anniversaire du déclenchement de la guerre d’Algérie, révèle à la fois la persistance d’un fossé entre les deux peuples sur plusieurs questions (le bilan de la colonisation, le sort des pieds-noirs et des harkis), mais en même temps de nombreux points d’accords et un processus de « réconciliation » en marche. 57 % des Français et 91 % des Algériens considèrent la guerre d’Algérie comme l’un des conflits les « plus marquants » de la seconde partie du XXe siècle. 59 % des Français et 41 % des Algériens estiment qu’elle n’est pas assez abordée à l’école, ni, pour 41 % des Français et 44 % des Algériens, dans les media. 94 % des Algériens et 77 % des Français estiment que l’armée française a eu recours à la torture pendant la guerre, et 73 % des Algériens (38 % des Français) que ce recours était « courant ». Mais si 88 % des Algériens attendent de la France « des excuses officielles au peuple algérien », seuls 45 % des Français (contre 50 % d’un avis contraire) partagent cette opinion, cependant majoritaire chez les sympathisants de gauche. 70 % des Français (mais seulement 29 % des Algériens, contre 44 % d’avis contraires) condamnent le comportement de la France à l’égard des harkis après la guerre, et 50 % des Français (mais seulement 23 % des Algériens, contre 36 % d’avis contraires) son comportement à l’égard des pieds-noirs. A l’égard du peuple algérien, 46 % des Français estiment que la France s’est bien comportée après la guerre (44 % d’avis contraires), alors que 53 % des Algériens estiment qu’elle s’est mal comportée (35 % d’avis contraires) Par ailleurs, si 71 % des Français estime que la France « a beaucoup apporté à l’Algérie » pendant la colonisation, 57 % des Algérient sont d’un avis contraire. Par contre, Algériens (à 76 %( et Français (à 56 %) sont d’accord pour estimer que « l’Algérie a beaucoup apporté à la France ». Au total, 56 % des Français ont une bonne image de l’Algérie (5 % une « très bonne » image), et 52 % des Algériens une bonne image de la France (17 % une « très bonne » image); 40 % des Français ont une mauvaise image de l’Algérie (11 % une « très mauvaise » image), 41 % des Algériens une mauvaise image de la France (23 % une « très mauvaise » image. En France, la meilleure image de l’Algérie est perçue par les jeunes (62 % des 18-24 ans en ont une bonne image), des plus de 65 ans (66 %) et des sympathisants de gauche (60 % au PS, 66 % chez les Verts), et la plus mauvaise par les chômeurs (55 % en ont une mauvaise image) et les sympathisants de droite (51 %) et d’extrême-droite (61 %). En Algérie, ce sont les 18-24 ans (à 58 %), les étudiants (71 %), les cadres et les professions libérales (84 %) qui portent le regard le plus positif sur la France, et les plus de 55 ans (64 %) et les retraités et pensionnés (57 %) qui lui sont le plus hostiles, ce qui, commente « Le Monde », « tend à démontrer que l’hostilité à l’égard de la France diminue avec le temps ». Quant à la situation actuelle de l’Algérie et de ses habitants, 82 % des Algériens l’estiment aujourd’hui meilleure qu’avant 1962 (10 % estimant qu’elle était meilleure sous le régime français), alors que 46 % des Français estiment qu’elle était meilleure sous le régime français (et 40 % qu’elle est meilleure depuis l’indépendance). (L’Expression 4.12 / AFP 5.12) Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a rendu hommage le 5 décembre aux « victimes civiles de toutes confessions », lors d’une cérémonie d’hommage aux combattants morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie. Jean-Pierre Raffarin a évoqué les soldats « loyaux et courageux » ayant servi dans les forces françaises pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. « Après huit années d’affrontements et de violences extrêmes, la séparation de la France et de l’Algérie semait deuils et blessures, souffrances et malheur », mais « après le temps de la douleur vient celui de la réparation et de la reconnaissance, puis celui de l’apaisement et de la réconciliation », a ajouté le chef du gouvernement français. En Algérie, quelques jours auparavant, l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM) a clairement réaffirmé lors de son Xème congrès que « la porte de l’Algérie » devait rester « définitivement fermée aux harkis et aux pieds-noirs qui se sont rendu responsables des pires atrocités à l’encontre du peuple algérien » (Naros 11.12) Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé le 11 décembre que la France allait lancer en 2005 la première phase d’un programme de regroupement d’environ 4000 tombes de civils français, dispersées dans 62 cimetières « fortement dégradés ». Les familles des défunts sont invitées à « mettre à profit cette occasion pour transférer les restes mortels de leurs défunts », et à en informer les consulats de France à Alger ou Annaba. (AP 16.12) Le Premier mninistre français Jean-Pierre Raffarin a confié le 16 décembre au préfet honoraire Roger Benmebarek une mission pour la création d’une Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. La création d’une telle institution est prévue dans un projet de loi « portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français expatriés », soumis au Parlement. Roger Benmebarek devra en outre étudier la possibilité d’intégrer dans la Fondation pour la mémoire des conflits d’Afrique du nord celui d’une fondation spécifiquement dédiée aux harkis. Son rapport est attendu au plus tard le 30 juin 2005. 2005(Nouvelle République 15.1) Selon un sondage effectué par l’institut IFOP auprès d’un échantillon représentatif des personnes ayant servi en Algérie entre 1954 et 1962, pour la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), 76 % des Français ayant « servi en Algérie » approuvent la politique de rapprochement et de réconciliation franco-algérienne (23 % la désapprouvant) et une proportion équivalente (76 %) estime que cette guerre était « inutile » et que l’indépendance de l’Algérie était « inévitable ». Pour 60 % des sondés, les conscrits n’auraient pas du être envoyée an Algérie et cette guerre n’était « pas vraiment leur guerre ». Une très légère majorité des sondés (53 %) estime que les émissions et commentaires des media, aujourd’hui, sur la guerre d’Algérie correspondent à la réalité de cette guerre. 79 % des sondés estiment que « des atrocités ont été commises des deux côtés » pendant ce conflit (et donc reconnaissent que des atrocités ont été commises par l’armée française). 88 % approuvent l’organisation d’une « journée du souvenir » à la mémoire des soldats français tombés en Algérie, et 76 % estiment que la date qui conviendrait le mieux à une telle journée est celle du cessez-le-feu de 1962, le 19 mars. 59 % des sondés estiment enfin que les autorités et la société françaises ont oublié les anciens combattants français d’Algérie, et que ceux-ci ne sont ni suffisamment respectés, ni convenablement honorés. (AP 11.2) Le Parlement français a définitivement adopté le 10 février une loi portant « reconnaissance de la Nation et contribution nationale » en faveur des rapatriés d’Algérie (pieds-noirs et harkis). La loi prévoit notamment une amélioration de l' »allocation de reconnaissance ». Le ministre des Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, s’est félicité de ce que « pour la première fois, léa tragédie de la guerre d’Algérie et le drame du rapatriement (aient) été officiellement reconnus ». La loi reconnaît en effet « les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés » par les rapatriés, associe rapatriés et harkis à l’hommage aux combattants d’Afrique du nord, rendu chaque année le 5 décembre, et interdit toute injure ou diffamation contre les harkis et toute apologie des crimes commis contre eux après les accords d’Evian. Plus d’un milliard d’euros, dont 700 millions pour les harkis, ont été débloqués pour revaloriser l’allocation de « reconnaissance » versée depuis 2003 aux harkis et à leurs veuves. Cette allocation passera de 1830 à 2800 euros par an (ou 30’000meuros de capital). Les enfants orphelins de harkis toucheront une allocation unique de 20’000 euros. Les aides au logement octroyées aux harkis sont prolongées jusqu’à fin 2009. (Le Monde 10.3 / L’Expression 13.3) L’Ambassadeur de France en Algérie, Hubert Colin de Verdière, en déplacement à Sétif le 27 février, a évoqué dans une allocution à l’Université Ferhat Abbas les massacres commis par l’armée et la police françaises et les milices coloniales, le 8 mai 1945, à Sétif, en les qualifiant de « tragédie inexcusable », et en les reconnaissant pour avoir été des « massacres ». L’Ambassadeur s’est recueilli devant la stèle du premier martyr des « évènements ». Les autorités algériennes n’ont pas commenté la déclaration de l’Ambassadeur, mais la presse en a largement rendu compte, en s’en félicitant. Pour « El Khabar », il s’agit d’un « premier pas » ouvrant la voie à une « repentance » française bienvenue. Ce « premier pas » est, pour « L’Expression », un « pas de géant dans la reconnaissance par la France de son passé colonial ». La Fondation du 8 mai 1945, fondation algérienne créée pour entretenir la mémoire de la répression coloniale en général, et des massacres de Sétif en particulier, s’est fliicitée de ce que « la France officielle se décide enfin à reconnaître son implication dans les actes monstrueux et inhumains commis en son nom de 1830 à 1962 », mais elle demande que le président Chirac exprime une « demande de pardon » et reconnaisse « solennellement et publiquement la responsabilité de l’Etat français » comme il l’a fait pour « la déportation des juifs » dans les camps de la mort. Le 8 mai 1945, alors que la France célébrait, des deux côtés de la Méditerranée, la capitulation de l’Allemagne nazie, au terme d’une guerre dans laquelle des milliers d’Algériens ont été tués sous le drapeau français, une manifestation nationaliste d’une dizaine de milliers de personnes se déroula à Sétif, drapeau algérien déployé, à l’appel du Parti du peuple algérien, pour réclamer la libération de Messali Hadj. La manifestation dégénéra en émeute contre les Français de Sétif, dont 109 furent tués et plus d’une centaine blessés. La répression s’abattra avec une incroyable brutalité sur la population algérienne de la région : l’armée de terre, la marine, l’aviation, la police, les milices formées par les colons, furent mises à contribution pour une « pacification »qui fera entre 10’000 et 45’000 morts, selon les sources, et qui sera l’événement fondateur du mouvement national armé de libération. (L’Expression 13.3) Des onze millions de mines antipersonnel (ou autres) enfouies par la France en Algérie entre 1957 et 1962, il en reste au moins 1,3 million, disséminées le long des frontières est (avec la Tunisie) et ouest (avec le Maroc). Les plus répandues et les plus meurtrières de ces mines, qui tuent et mutilent toujours une vingtaine de personnes chaque année, sont les « mines encrier » Apid-51 et les « mines bondissantes » Apmb-51/5. Depuis l’indépendance, les mines françaises enfouies le long des anciennes lignes Challe et Maurice ont fait des milliers de morts et de blessés. Dans la seule wilaya de Tebessa, les mines auraient tué et mutilé 3600 personnes depuis 1962. A Souk Ahras, l^hôpital régional a recensé 1100 victimes depuis l’indépendance. 659 personnes touchent une pension mensuelle en Algérie du fait de leur invalidité pour cause de mine. Cette pension est cependant d’un montant aujourd’hui ridicule (4230 DA, soit une cinquantaine d’euros). Le 16 décembre 2004, un petit berger de 13 ans a été tué à Aïn El Hedid (w. Aïn Temouchent) dans l’explosion d’une mine. (Quotidien d’Oran 13.3) Les autorités françaises ont décidé de regrouper 62 cimetières chrétiens et juifs de différentes régions d’Algérie, ne pouvant plus « être entretenus ni rénovés », et de rapatrier les restes des 3000 défunts inhumés dans ces cimetières vers des cimetières en France si les familles en expriment le souhait, ou de les regrouper dans des sépultures collectives (ossuaires). Le plus grand nombre possibles de sites funéraires français en Algérie devront en outre être remis « en état de décence et de réhabilitation », ce qui pourrait concerner 250’000 sépultures, réparties dans 500 cimetières. Ces mesure, justifiées par « une attente exprimée par les rapatriés d’Algérie », avaient été annoncées en mars 2003, lors de la visite du président Chirac à Alger. Si certaines associations de rapatriés d’Algérie soutiennent ces mesures, ou s’y résignent, comme France-Maghreb, d’autres s’y opposent. (AFP 18.3) Environ 300 Français rapatriés d’Algérie, s’estimant « spoliés » de leurs biens à l’indépendance, ont déposé plainte contre l’Etat algérien devant le Comité des droits de l’Homme de l’ONU à Genève, a annoncé leur avocat le 18 mars. Ces rapatriés ont déjà été indemnisés par la France, mais l’avocat estime que cette indemnisation n’est qu’une « avance sur ce que doit verser l’auteur de la spoliation, l’Algérie ». Les plaintes ont été collectées par une associations de rapatriés proche de l’extrême-droite, l' »Union de défense des intérêts des Français repliés d’Algérie et d’Outre-mer » (USDIFRA. (AP 18.3 / AFP, Le Monde 19.3) « Le Monde » publie dans son édiition datée du 19 mars les témoignages de quatre Algériens affirmant que le général à la retraite Maurice Schmitt, ancien chef d’état-major des armées françaises, qui a servi en Algérie d’avril 1957 à octobre 1959, « dirigeait les opérations » lors de séances de tortures à Alger à l’été 1957 pendant la « Bataille d’Alger » Trois anciens militants du FLN racontent avoir été arrêtés en août, puis torturés à l’école Sarouy, occupée par le 3ème régiment de parachutistes coloniaux (3eRPC) au sein duquel le général Schmitt servait, dès fin juillet 1957 tant que chef de section d’une compagnie chargée du contrôle de la casbah et du renseignement Lyès Hanni, ancien responsable militaire FLN de la région II, raconte avoir été torturé à l’électricité, puis à l’eau, lors de séances de tortures dirigées par le lieutenant Schmitt, qui « donnait les ordres » de continuer, d’arrêter, de reprendre la torture. Mouloud Arbadji, agent de liaison de l’un des lieutenants du responsable de la zone autonome FLN d’Alger, Yacef Saadi, confirme la présence du lieutenant Schmitt. Les deux hommes rapportent également la mort d’une jeune femme, Ourida Meddad, jetée ou tombée d’une fenêtre dans la cour de l’école. Lyès Hanni témoigne des tortures, notamment à l’électricité, subies par la jeune femme en présence du lieutenant Schmitt. Zhor Zerari, nièce du commandant Azzedine, arrêtée le 25 août après avoir posé trois bombes dans Alger, affirme également avoir été torturée en présence et sur ordre du lieutenant Schmitt. Elle garde de lourdes sequelles des sévices subis. Ahmed Bachali, ancien militant du FLN, affirme lui aussi avoir été torturé à l’électricité alors qu’il n’avait que 15 ans, et après que son père, sous-officier dans l’armée française, ait lui aussi été torturé. Ahmed Bachali affirme que c’est Schmitt qui « dirigeait les opérations ». Enfin, en 2004, une sympathisante du Parti communiste algérien et des réseaux d’aide au FLN a publié sous le pseudonyme d' »Esmeralda », et en se présentant comme une « juive berbère », un témoignage impliquant le « lieutenant Schm. grand brun à lunettes d’environ 35 ans ». Le général Schmitt réfute ces nouvelles accusations; il avait déjà fait l’objet d’accusations semblables il y a quatre ans, de la part de trois anciens militants du FLN, Malika Koriche, Ali Moulaï et Rachid Ferrahi. Rachid Ferrahi maintient ses accusations : son père a été torturé devant lui, et « Schmitt dirigeait les interrogatoires ». Maurice Schmitt qualifie de « pure affabulation » les accusations dont il est à nouveau l’objet, affirme qu’il n’y a « pas eu de séance de torture », que les témoins cités par « Le Monde » ont tous été « dénoncés par leurs chefs » et ne cherchent qu’à « se venger 48 ans après qu’on les a fait tomber, en les piégeant par la ruse ». Schmitt reconnaît avoir interrogé Ali Moulaï, chef de région du FLN, mais affirme n’avoir pas eu besoin de lui faire subir « de grosses pressions physiques » pour le faire parler, parce qu’ils « pétait de trouille ». Maurice Schmitt, qui avait traité le livre d’une militante du FLN torturée en 1957, Louisette Ighilahriz, de « tissu d’affabulations », et qui avait également traité un ancien appelé français, Henri Pouillot, de « menteur » après que Pouillot ait dénoncé les séances de tortures et les viols auxquels il avait assisté entre janvier 1961 et mars 1962 à Alger, a été condamné deux fois pour diffamation. A un journaliste qui lui demandait s’il avait torturé, le général Schmitt l’avait implicitement admis : « je me sens solidaire de tous ceux qui ont été confrontés au dilemne : interroger courtoisement un assassin qui sait où se trouvent des bombes qui peuvent exploser dans l’heure, ou le faire parler », avait-il déclaré. (Le Monde 7.4) Le quotidien « Nice-Matin » a annoncé à la mi-mars la « condamnation » de 62 cimetières rrançais d’Algérie, et publié un arrêté du ministère français des Affaires étrangères du 7 décembre précédent, engageant « un regroupement en tombes ou ossuaires selon le cas » de sépultures françaises en Algérie, et donnait un délai de quatre mois aux familles pour faire connaître à un consulat français en Algérie leur souhait éventuel de faire rapatrier, à leurs frais, en France, les restes de leurs défints. L’arrêté dressait la liste de 62 petits cimetières, abritant 4000 tombes, concernés par le projet de regroupement dans des nécropoles urbaines. Le ministère précise que ce plan ne concerne que 2 % des tombes françaises d’Algérie, celles qui sont situées dans des localités reculées, et qui sont dans un état de délabrement rendant illusoire leur réhabilitation. Un « obélisque de béton indestructible » serait implanté sur les anciens cimetières. Quant au rapatriement éventuel de corps, il semble inutile, selon l’Association de sauvegarde des cimetières d’Algérie (ASCA), qui affirme que les cimetières concernés par le projet de regroupement ont été « profanés depuis longtemps » et qu’il n’y a « pas un seul corps identifiable à rapatrier ». Le ministère et l’association font également remarquer que certains cimetières ont servi de caches d’armes pour les groupes armés dans les années ’90, que d’autres servent d’abri à des indigents et que leur réhabilitation relèverait d’une « mission impossible ». Pour la réhabilitation des cimetières qui peuvent être réhabilités, 300’000 euros ont été débloqués par l’Etat et les collectivités territoriales françaises en 2005. La préservation et la réhabilitation des 209’000 tombes françaises d’Algérie, sises dans 523 cimetières, mais dégradées par le temps et que les familles ont été longtemps dans l’impossibilité d’entretenir, figuraient dans les engagements pris par le président Jacques Chirac lors de sa visite d’Etat en Algérie, en mars 2003. (Le Monde, AP, Liberté, Le Monde 8.5 / Tribune de Genève 9.5) Le président Bouteflika a appelé, dans un discours prononcé à Sétif le 7 mai, la France à reconnaître sa responsabilité dans les massacres de dizaines de milliers d’Algériens manifestant, le 8 mai 1945, le jour même de la capitulation allemande au terme de la Guerre Mondiale, pour la reconnaissance de leur droit à l’autodétermination et pour la libération du chef du Parti du peuple algérien, Messali Hadj. « Le peuple algérien attend de la France un geste qui libérerait la conscience française », a déclaré le président algérien. Dans un message adressé aux participants d’un Colloque international sur les massacres du 8 mai 1945, le président Bouteflika a estimé qu’une « reconnaissance des actes commis durant la période de la colonisation, y compris durant la guerre de Libération » permettrait d’ouvrir « de larges et nouvelles perspectives d’amitié et de coopération » entre les peuples français et algérien. Le président algérien, pour qui la réconciliation doit s’accompagner d’une « décolonisation de l’histoire », a souligné que les massacres du 8 mai 1945 s’étaient produits « au moment où les armées de combattants héroïques algériens revenaient des fronts d’Europe, d’Afrique et autres où elles défendaient l’honneur de la France et ses intérêts et oeuvraient au sein des armées alliées à défendre les valeurs de la République et de la liberté dans le monde ». Des dizaines de milliers d’Algériens (de toutes les communautés d’Algérie, mais en très grande majorité musulmans) ont été engagés dans les armes françaises, dès 1939 mais surtout dès 1942, et lors du débarquement de Provence, à l’été 1944, la moitié des effectifs français était constituée par les troupes « coloniales », dont les troupes algériennes. De nombreuses cérémonies ont marqué en Algérie la commémoration des soixante ans des massacres de Sétif et Guelma. A Sétif, plus de 20’000 personnes, dont plusieurs ministres, ont pris part à une marche empruntant le même itinéraire que les manifestants de 1945. A Paris, un millier de personnes ont participé le 8 mai à une « Marche des Indigènes de la République » pour dénoncer les discriminations subies par les enfants d’immigrants issue des anciennes colonies françaises. La « Fondation du 8 mai 1945 », créée par l’ancien président du Conseil de la Nation (Sénat) Bachir Boumaza, a exprimé l’espoir de voir un jour les présidents français et algériens se recueillir « main dans la main devant la tombe du chahid (martyr) Marbi Ben M’hidi, assassiné sous la torture » par les parachutistes français commandés par le colonel (devenu ensuite général, puis ministre) Bigeard, « à l’image du président Charles de Gaulle et du chancelier Adenauer (se receuillant) devant celle du résistant Jean Moulin ». Le 8 mai 1945, les troupes coloniales françaises ont férocement réprimé, en s’acharnant aveuglément sur les populations civiles, les émeutes survenues à Sétif et dans la région, émeutes qui ont succédé à la répression policière de la manifestation nationaliste. Une centaine d’Européens (dont 16 militaires) avaient été tués dans les émeutes, et entre 15’000 et 45’000 Algériens de souche (« musulmans », selon la terminologie coloniale) dans la répression qui s’en était suivi. On date aujourd’hui de cet événement la rupture, qui aboutira à l’indépendance au terme de huit ans de guerre, entre la France et la majorité « musulmane » de la population algérienne (et entre cette majorité et la minorité de souche européenne). Le 27 février, l’Ambassadeur de France en Algérie avait qualifié les massacres de Sétif et Guelma de « tragédie inexcusable ». Le président Bouteflika a déclaré que ces propos avaient été « favorablement accueillis par le peuple algérien ». A Paris, le Maire socialiste de la capitale française, Bertrand Delanoë, a rappelé le 8 mai que le 8 mai marquait à la fois la défaite d’une barnbarie, la nazie, et l’anniversaire « d’une autre barbarie, celle de Sétif ». Le Maire de Paris a demandé que la société française ait « le courage de la vérité » et que la France « s’honore en disant la vérité », voire « en demandant pardon » aux Algériens, comme elle l’a fait pour sa responsabilité dans la déportation des juifs pendant la Guerre Mondiale. Le ministre français des Affaires étrangères Michel Barnier a, plus prudemment, exprimé l’espoir que la France et l’Algérie parviendront « à examiner ensemble le passé afin d’en surmonter les pages les plus douloureuses pour (les) deux peuples », et a estimé que « ce travail de mémoire (se retrouve) dans le traité d’amitié » franco-algérien en préparation, et qui devrait être signé cette année encore. Dans un entretien à « El Watan », Michel Barnier a appelé à « surmonter les pages les plus douloureuses » de l’histoire franco-algérienne. Ces appels français et algériens au travail de mémoire et à la « décolonisation de l’histoire » contredisent cependant la loi adoptée par le Parlement français en février, portant « reconnaissance de la nation » en faveur des Français rapatriés d’Afrique du nord, loi qui prévoit que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du nord » (sans d’ailleurs préciser en quoi ce rôle fut positif). Une pétition pour l’abrogation de cette loi, et contre « l’enseignement d’une histoire officielle » redorant le blason du colonialisme, a été lancée par des historiens, qui dénoncent un « mensonge officiel ». On notera enfin que la célébration du 60ème anniversaire des massacres de Sétif permet en Algérie de poursuivre le trevail historique d’exhumation du mouvement national algérien d’avant le FLN, et en particulier du mouvement messaliste, dont de très nombreux anciens militants, ralliés ou non ensuite au FLN, ont témoigné dans la presse algérienne. (Corr.) L’annonce de la mort de la militante algérienne Louisette Ighilariz, qui avait témoigné de son expérience personnelle de la torture pendant la Guerre d’Algérie, annonce faite par une dépêche AFP reprise par la presse française (ET PAR NOTRE PROPRE BULLETIN), a été démentie par la presse algérienne. En réalité, c’est la soeur de Louisette, Malika, qui est morte.(Le Monde 12.5 / Beur FM 15.5) Dans une intervention lue le 6 mai par le ministre des Anciens combattants Mohamed Cherif Abbas, devant les participants à un colloque sur les massacres de 1945 à Sétif, le président Bouteflika a comparé, voire assimilé, le colonialisme français au nazisme, et la répression coloniale à un génocide. « Les commandos de la mort ont exécuté par centaines et milliers les citoyens sur les places publiques, stades et autres buissons. Les corps gisaient sur le sol, en proie aux animaux. (Des) fours de la honte (ont été) installés par l’occupant dans la région de Guelma (…). ces fours étaient identiques aux fours crématoires des nazis », écrit dans son texte le président algérien, qui ajoute : « Nous ne pouvons oublier les centaines de massacres commis auparavant et les nombreux fours installés dans notre pays » dès les premiers temps de la colonisation. « L’occupant a foulé la dignité humaine et commis l’innomable à l’encontre des droits humain fondamentaux (…) et adopté la voie de l’extermination et du génocide qui s’est inlassablement répétée durant son règne funeste ». En conclusion, Abdelaziz Bouteflika a demandé à la France « un geste qui libérerait (sa) conscience ». Le Secrétaire d’Etat français aux Affaires étrangères Renaud Muselier, arrivé à Alger le 9 mai pour une visite de trois jours, s’est gardé de commenter les propos présidentiels algériens, qui ont été peu relevés par la presse algérienne, mais condamné en France par l’association de rapatriés « Recours France », qui dénonce « la perte de sang froid et les propos insultants » du président algérien, et qui demande au ministre français des Affaires étrangères Michel Barnier d’exprimer son « vif mécontentement de voir la France laisser salir son oeuvre civilisatrice ». Tout au plus « Le Recours » admet-il « quelques erreurs » commises lors de la colonisation, « quelques erreurs » au nombre desquelles il faut sans doute compter les massacres de 1945, mais aussi, par exemple, un siècle plus tôt, ceux commis par les troupes du maréchal Bugeaud et du général Pélissier, qui avait fait enfumer dans une grotte des civils (hommes, femmes et de enfants) favorables à l’émir Abdelkader (760 personnes avaient ainsi été massacrées le 19 juin 1845 sur les hauteurs du mont Dahra). Dans un entretien à la radio privée française Beur-FM, le 15 mai, le président du Front des Forces Socialistes Hocine Aït Ahmed, a appelé les Algériens à participer au débat « franco-français » sur les exactions commises par l’armée française pendant la guerre d’Algérie, comme d’ailleurs les Français ont le droit de participer au débat sur les exactions commises par les forces de l’ALN, notamment les massacres et les tortures perpétrées par des Algériens sur d’autres algériens. (AP 23.5 / Quotidien d’Oran 24.5) Après Alger, Annaba, Bejaïa, Oran et Constantine, Tlemcen a reçu le 23 mai la visite d’un groupe de 130 Français d’Algérie, « rapatriés » en France après l’indépendance. Leur visite est organisée par « La Fraternelle », une association regroupant en France quelque 1300 Tlemçanis juifs rapatriés. Dans le cadre de leur visite, les 130 rapatriés, arrivés « dans une ambiance euphorique » selon « Le Quotidien d’Oran », ont été accueillis par les autorités locales, et même par l’ancien président algérien Ahmed ben Bella. Ils devaient notamment se recueillir sur les tombes de leurs parents, effectuer un pélerinage sur le tombeau du rabbin Ehphraïm Al Khawa (ou Enkaoua), un juif de Tolède qui avait fui l’intolérance religieuse du catholicisme espagnol de la période de la « Reconquista ». Les Tlemçanis juifs devaient enfin, rencontrer les habitants de leurs anciens domiciles, et leurs voisins de l’époque de leur vie en Algérie, que le président de « La Fraternelle », André Charbit, décrit comme marquée par un climat de « fraternité » entre les communautés juive et musulmane. Désormais, les autorités algériennes n’opposent plus d’obstacles aux visites des « rapatriés d’Algérie » (à l’exception de ceux ayant été actifs dans les rangs de l’OAS ou des milices coloniales), qu’elles considèrent comme des touristes français comme les autres. (Quotidien d’Oran 6.6 / AP 7.6) Le Front de Libération Nationale, dans un communiqué signé de son secrétaire général Abdelaziz Belkhadem, dénonce la loi adoptée par le parlement français « portant reconnaissance de la nation et contibution nationale en faveur des Français rapatriés », loi dont le FLN estime que l » »inspiration colonialiste » est « manifeste ». Le FLN estime que la loi consacre une vision rétrograde de l’histoire, qu’elle justifie la barbarie du fait colonial en « gommant » ses manifestations les plus odieuses (massacres collectifs, déportations, tortures…). Le FLN regrette que cette loi intervienne « curieusement à un moment où l’Algérie et la France se préparent à la signature, hautement symbolique, d’un traité d’amitié qui devrait confirmer le dépassement dans la dignité et sans reniement aucun, des vicissitudes de l’histoire complexe qui a emprint les relations entre les deux pays ». Le FLN observe que l’adoption de cette loi « met en relief le décalage flagrant entre la France officielle et son opinion publique », le seconde étant bien plus avancée que la première dans la reconnaissance du mal représenté par le colonialisme. Le FLN lance un appel au peuple français pour qu’il manifeste son opposition à une entreprise de « falsification de l’Histoire » -et de l’Histoire de France autant que de l’Histoire de l’Algérie. (L’Expression 8.6) Un tribunal français a accordé le 7 juin une pension d’invalidité à vie à un militaire à le retraite atteint d’une maladie liée à sa participation aux essais nucléaire en Algérie dans les années soixante. « L’Expression » note que les victimes algériennes de ces essais ne sont toujours pas reconnues comme telles par la France, et affirme qu’à l’heure actuelle encore, « des dizaines de bébés naissent chaque année aussi bien à Tamanrasset qu’à Adrar avec des malformations congénitales dues aux radiations » issues des essais nucléaires français. L’indemnisation, pour la première fois à ce titre, d’une victime des essais nucléaires sahariens, pourrait ouvrir la voie à des demandes d’indemnisation, non seulement des victimes françaises, mais également des victimes algériennes. L’Association françaises des vétérans des essais nucléaires a ouvert 200 dossiers d’indemnisation. (AP 16.6 / Libération, Le Quotidien d’Oran 18.6 / El Watan 19.6 / Le Quotidien d’Oran 21.6) Le président de l’Assemblée populaire nationale, Ammar Saïdani, a annoncé le 16 juin que le parlement algérien était en train de préparer une riposte à la loi du 23 février 2005 adoptée par le parlement français, portant « reconnaissance de la nation et contribution nationale » en faveur des Français rapatriée, pieds-noirs et harkis. Ammar Saïdani n’a pas précisé la nature de la « riposte », qui pourrait ne se traduire que par une motion de protestation. du parlement algérien au vote du parlement français, mais en Algérie les protestations contre la loi française ont été régulières, l’une des dernières en date émanant de l' »Organisation nationale des Moudjahidines » (anciens combattants de la guerre d’indépendance), qui accuse « les anciennes forces coloniales » de continuer à « faire l’amalgame entre la guerre d’agression coloniale et la lutte légitime de libération ». Pour le FLN, la loi française consacre une « vision rétrograde de l’Histoire » et exprime une « volonté de justification de la barbarie du fait colonial ». La Fondation du 8 Mai 1945, créée pour honorer les victimes de la répression des manifestations nationalistes de Sétif et Guelma, en mai 1945, a quant à elle proposé l’adoption d’un projet de loi assimilant les crimes de la colonisation à des crimes contre l’humanité, imprescriptibles et inamnistiables. Enfin, la Coordination nationale des enfants de Chouhada (famille des martyrs de la guerre de libération) a annoncer qu’elle allait intenter un procès contre la France devant un tribunal international, et organiser des manifestations de protestation dans des villes françaises. Comme pour jeter un peu d’huile sur le feu, une association proche de l’extrême-droite française, l' »Association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française » (ADIMAD), en clair une association d’anciens membres de l’OAS, a annoncé l’inauguration le 6 juillet à Marignane, près de Marseille, d’une stèle à la mémoire du chef des commandos « Delta », commandos de tueurs de l’OAS, Roger Degueldre, condamné à mort et fusillé en 1962 en France. La Ligue des droits de l’Homme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, notamment, demandent au préfet des Bouches du Rhône d’interdire la cérémonie d’inauguration de la stèle, et appellent, si cette interdiction n’est pas prononcée, à un rassemblement de protestation, le jour de cette inauguration, à Marignane. La LDH, le MRAP, mais également le syndicat FSU et un collectif d’historiens dénoncent une tentative de « réhabilitation du colonialisme » et un honneur fait à des « tueurs fascistes ». Les mêmes organisations participent au mouvement de protestation contre la loi du 23 février 2005 (Quotidien d’Oran 23.6 / El Watan 25.6 / L’Expression 28.6 / Quotidien d’Oran, El Khabar 3.7) Le président Bouteflika est revenu le 2 juillet, à l’occasion d’un colloque sur l’Armée de libération nationale, sur l’adoption par le parlement français d’une loi reconnaissant un aspect « positif » à la colonisation : « c’est une insolence de considérer la colonisation comme une mission civilisatrice », a affirmé le président algérien. Le ministre des Moudjahidines (anciens combattants), Mohammed Cherif Abbès, a pour sa part accusé les pieds-noirs d’être coupables d’une résurgence de la « nostalgie » du temps de la colonisation. Le Parlement algérien, dont on la presse algérienne avait annoncé qu’il pourrait adopter une résolution condamnant la loi française, semble y avoir renoncé, écrit « L’Expression ». Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bedjaoui, a de son côté qualifié d’affaire « franco-française » l’adoption d’une loi qui pourrait en outre être modifiée par le parlement français, qui en extirperait le contenu « colonialiste ». A Marignane, l’inauguration d’une stèle en hommage aux anciens de l’OAS, qui avait provoqué en France même de nombreuses protestations, pourrait être reportée, à la demande du Maire. La Fondation Charles de Gaulle, la Ligue des droits de l’Homme, le MRAP, l’Association France-Algérie et le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avaient dénoncé cette inauguration, le ministre des Anciens combattants Hamlaoui Mekachera et le préfet des Bouches-du-Rhône avaient demandé l’annulation de la cérémonie, le préfet se déclarant prêt à l’interdire si le Maire de Marignage ne l’annulait pas. Hamlaoui Mechahera a « déploré » et « condamné » le projet d’inguration de la stèle à la mémoire des membres de l’OAS fusillés en France. Le ministre a rappelé que ces hommes avaient été jugée et condamnés par la France pour avoir recouru contre « les institutions de la République (…) aux moyens les plus violents et les plus condamnables », et a estimé que l’hommage qu’une association d’anciens membres de l’OAS entend leur rendre « crée un risque important pour la cohésion nationale ». (AFP 16.6 / AP 20.6) Le général Paul Aussaresses, condamné en décembre 2004 pour apologie de la torture, a été exclu de la Légion d’Honneur le 14 juin par décret de Jacques Chirac. Aussaresses avait été mis à la retraite d’office en 2001, après la parution de ses mémoires sur la Guerre d’Algérie, où il justifiait la pratique de la torture et reconnaissait s’y être livré. Il avait déjà à l’époque été suspendu de la Légion d’Honneur. En revanche, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la peine infligée en première instance, en juillet 2004, à un ancien caporal de l’armée française, Henri Pouillot, qui avait accusé un autre général, Maurice Schmitt, ancien chef d’état-major des armées françaises, de faire lui aussi l’apologie de la torture. (Le Monde 29.6) Une rumeur à la fois infondée, absurde et imbécile, circulant depuis le mois de mai, selon laquelle les juifs d’Algérie contraints de quitter le pays après 1962 réclameraient à l’Algérie « 144 millions de dollars à titre de compensation », provoque de nouvelles bouffées d’antisémitisme dans la presse et dans une partie de l’opinion publique algérienne. Relayée par la presse, à partir d’une « information » parue le 12 mai dans « Le Quotidien d’Oran », faisant état d’un colloque de juifs originaires de Constantine, en avril à Jerusalem, la rumeur a enflé jusqu’à reprendre les refrains habituels du vieil antisémitisme européen sur la « rapacité juive ». En réalité, aucune demande ni réclamation d’aucune sorte n’a été faite à l’Algérie, ni à la France, ni à aucune instance internationale, par des juifs algériens . Mais l’historien Benjamen Stora rappelle qu' »il y a une bataille très dure, en ce moment en Algérie, pour faire admettre que la mémoire juive est partie constitutive de la mémoire algérienne », dans un pays qui avait « évacué », physiquement (par l’expulsion) et synboliquement (par la négation) sa part juive, et est « en train de la redécouvrir ». Le judaïsme est présent dans ce qui est aujourd’hui l’Algérie depuis près de 2000 ans, bien avant que le christianisme, puis l’islam, ne s^y implantent. Sous le colonialisme, des bouffées d’antisémitisme (au sens d’antijudaïsme) ont périodiquement éclaté, mais étaient le fait des Européens, et non des Algériens musulmans. Pendant la guerre d’Algérie, de très nombreux juifs ont milité dans les rangs des opposants à la guerre, et des réseaux français de soutien au mouvement de libération nationale. (AFP, Jeune Indépendant 6.7 / Quotidien d’Oran 9.7) Les présidents des deux chambres du Parlement algérien (Conseil de la Nation et Assemblée nationale populaire) ont dénoncé le 7 juillet l’adoption par le parlement français d’une loi reconnaissant « l’oeuvre positive » des Français pendant la période coloniale, et « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ». Le président du Conseil de la nation (Sénat), Abdelkader Bensalah, a qualifié cette loi d' »antécédent grave » er « inadmissible », et appelé la France a présenter des « excuses publiques » au peuple algérien, afin d' »asseoir une plate-forme d’amitié et de coopération ». Le président de l’Assemblée nationale a quant à lui estimé que la loi française heurtait « la conscience et les sentiments du peuple algérien ». A Marignane (près de Marseille), quelques centaines de nostalgiques de l’Algérie française, à l’appel de l’Association de défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française (ADIMAD) ont organisé le 6 juillet une cérémonie d’hommage aux anciens membres de l’OAS condamnés à mort et exécutés par la justice française, devant les portes du cimetière où devait être inaugurée une stèle, érignée en catimini, à la mémoire des ces membres de l’OAS, la cérémonie d’inauguration ayant été interdite par le préfet, au motif d’ordre public, une contre-manifestation étant organisée, à l’appel notamment du MRAP, qui a dénoncé le silence du ministre de l’Intérieur et appelé au « nettoyage des fascistes qui polluent la France ». (Le Monde 23.7 / El Khabar 25.7 / AFP 2.8) Les députés du parti islamiste légal Islah ont annoncé qu’ils élaboraient, avec des députés d’autres formations politiques, un projet de loi incriminant le colonialisme, en réponse à la loi adoptée par le Parlement français reconnaissant des « aspects positifs » à la « présence française en Afrique du nord ». Le projet de loi qui pourrait être présenté au parlement algérien évoquerait l’ensemble des violations des droits humains commises par le régime colonial depuis l’invasion de l’Algérie par la France en 1830, et jusqu’à l’indépendance, y compris les crimes commis par l’OAS, ainsi que les conséquences des expériences nucléaires françaises dans le sud saharien. En visite officielle à Madagascar, le président français Jacques Chirac a dénoncé, le 21 juillet, le « caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial », en faisant notamment référence à la meurtrière répression de la révolte malgache de 1947. « On doit assumer son histoire, (…) ne pas oublier les événements (ni) nourrir indéfiniment aigueur et haine. L’histoire est faite d’affrontement et de réconciliation », a déclaré Jacques Chirac, qui a ajouté que « rien ni personne ne peut effacer le souvenir de toutes celles et de tous ceux qui perdirent injustement la vie » dans la répression de 1947, et s’est associé « avec respect à l’hommage qu’ils méritent ». Le 29 mars 1947, deux ans après les émeutes de Sétif en Algérie, et leur répression sanglante par la police, l’armée et les milices coloniales françaises, un soulèvement armé se produisait à Madascar, soulèvement condamné par le principal parti indépendantiste, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM), parti légal qui sera néanmoins dissous et ses chefs arrêtés. L’armée française exercera, trois ans avant l’indépendance de la Grande Ile, une répression massive, avec tortures, exécutions sommaires et déportations à la clef : « Nous faisons (à Madagascar) ce que nous avons reproché aux Allemands » de nous avoir fait, écrira Albert Camus dans « Combat ». La répression du soulèvement malgache fera officiellement 80’000 morts, mais certains historiens estiment aujourd’hui que le bilan serait plus proche des 20’000 à 30’000 morts, presque tous malgaches (il n’y aura que 140 « Blancs » tués lors de l’insurrection). A Marseille, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une demande de suppression de la stèle érigée à Marignane par les nostalgiques de l’OAS à la mémoire des chefs de l’organisation condamnés à mort et exécutés par la justice française. Cette décision ne préjuge cependant pas de celle, sur le fond, que rendra ultérieurement le tribunal administratif sur la demande déposée par « Ras l’Front » et une association de victimes de l’OAS de suspendre l’arrêté municipal autorisant l’érection de la stèle, dont l’inauguration publique avait été interdite pour « trouble à l’ordre public » par le préfet de région. (Quotidien d’Oran 21.8) En lançant la campagne pour le référendum sur son projet de « Charte de la paix et de la réconciliation » à l’occasion de la commémoration des « offensives » nationalistes du 20 août 1955, le président Bouteflika a relancé les attaques contre la loi française du 23 février 2005, sans jamais la citer mais en s’en prenant au colonialisme dont ladite loi prétendait relever les aspects « positifs ». Pour le président algérien, l’ordre colonial mettait en oeuvre « un projet macabre dont l’objectif était une Algérie sans peuple », en massacrant les Algériens mais également en aliénant » leur identité, en altérant leur langue, leur religion, leur culture et leur histoire ». Et cette pensée exterminatrice a été pour le président algérien « au coeur de la politique de l’Etat colonial », en se traduisant en « une guerre globale contre l’Algérie, n’épargnant ni homme, ni mémoire, ni nature ».Les crimes du colonialisme, a ajouté Abdelaziz Bouteflika, ne « doivent pas devenir imprescriptibles ni oubliés ». (Le Quotidien d’Oran, El Watan 27.8 / Le Monde 30.8) Le président Bouteflika à évoqué le 28 août le traité d’amitié entre la France et l’Algérie, dont la signature est théoriquement prévue avant la fin de l’année, en assurant que cet objectif était toujours à l’ordre du jour, mais qu’il ne sera atteint que « dans le respect mutuel », ce qui implique que la France reconnaisse les crimes de la période coloniale : « Ce que nous demandons (à la France ne relève pas de l’impossible », a estimé le président algérien dans un discours prononcé à Sétif, mais en ajoutant que « nos amis en France (…) n’ont pas d’autre choix que de reconnaître qu’ils ont torturé, tué, exterminé de 1830 à 1962 (et) qu’ils ont voulu anéantir l’identité algérienne ». Ces dénonciations des crimes du colonialismes sont devenues récurrentes dans les discours présidentiels algériens, depuis que le parlement français a adopté, en février 2005, à l’initiative de la droite, une loi très controversée attribuant des « aspects positifs » au colonialisme. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a appelé les historiens et chercheurs français et algériens à » travailler ensemble (…) et en toute indépendance » sur la période coloniale, et s’est refusé à commenter les propos du président Bouteflika. Il apparaît d’ailleurs que le gouvernement français est lui-même très embarassé par cette loi, dénoncée par la gauche et les historiens, et qui est « tombée » à un très mauvais moment, alors que les autorités françaises et algériennes semblaient s’être mises d’accord sur la signature d’un traité d’amitié franco-algérien. Un proche du Premier ministre français Dominique de Villepin, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a d’ailleus déclaré à l’hebdomadaire « L’Express » que « ce n’est pas au Parlement de légiférer sur la mémoire, c’est au peuple et aux historiens de l’entretenir ». (Le Monde 10.9) L’ancien chef-d’état major des armées françaises, le général Maurice Schmitt, est à nouveau confronté devant la justice à la question de la torture pendant la guerre d’Algérie, en se retrouvant le 8 septembre devant la Cour d’Appel de Paris, après avoir fait appel de sa condamnation en octobre 2003 pour diffamation à l’encontre de l’ancienne militante du FLN, Louisette Ighilariz, elle-même violée et torturée par les parachutistes français fin 1957 à Alger. Le témoignage de Louisette Ighilariz avait été qualifié de « tissu d’affabulations et de contre-vérités » par le général Schmitt, et le tribunal correctionnel de Paris avait estimé que Maurice Schmitt ne pouvait pas être mis au bénéfice de la bonne foi. Entre-temps, de nouveaux éléments sont venus enrichir la polémique, dont la longue enquête effectuée par la journaliste du « Monde » Florence Beaugé, et en particulier le témoignage d’un ancien parachutiste, Raymond Cloarec, confirmant sur plusieurs points celui de Louisette Ighilariz, et qui a ensuite fait l’objet de pressions du général Schmitt pour qu’il démente ce témoignage. (Liberté 11.9) Le Président Bouteflika a réaffirmé, en assistant à un cours sur la « réconciliation nationale » dans un lycée de Blida, que les Pieds-noirs était les bienvenus en Algérie, mais que « nour restons vigilants face à ceux qui caressent encore le rêve du paradis perdu », et a ajouté que les enfants de harkis qui voudraient revenir en Algérie et être des Algériens comme les auttres peuvent le faire, avec « les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres Algériens ». Le président algérien confirme ainsi ses déclarations du 9 septembre, à Oran, où il avait admis des « erreurs » dans « le traitement du dossier des familles de harkis ». « Nous n’avons pas fait preuve de sagesse », a admis le président algérien, et « nous avons suscité* » auprès des familles et des proches de harkis « un sentiment de haine et de rancoeur portant préjudice au pays » (Le Monde 17.9 / Nouvel Obs 20.9 / AP 21.9 / AFP 26.9 / El Watan 27.9) Moins d’une semaine après que le président Bouteflika ait publiquement regretté « les haines entretenues (à l’égard des harkis) depuis l’indépendance », son ministre de l’Agriculture, Saïd Barkat, a déclaré le 13 septembre que la majorité des Algériens refusaient « la venue des harkis en Algérie car ce sont des traîtres à leur pays et à leur nation », « des vendus et de vieux gradés de la honte », et que si les enfants des harkis étaient « les bienvenus », c’était à la « condition qu’ils reconnaissent de facto les crimes de leurs parents ». Cet appel au reniement de leurs pères par les enfants de harkis, et cette contradiction entre le geste du président Bouteflika et le discours de l’un de ses ministres, a suscité en France, au sein des associations de familles de harkis, de l’incompréhension et de l’amertume. Le président du Comité national de liaison des harkis, Azni Boussad, a demandé au président Boutelfika d' »adopter une ligne claire et définitive sur ce sujet », et Fatima Lancou-Besnaci, présidente de l’associations Harkis et droits de l’Homme, qui trouve l’attitude du pouvoir algérien « incohérente », estime inacceptable de demander aux enfants de harkis de demander pardon pour « les crimes » de leurs parents. Dans une lettre au président Chirac, rendue publique le 21 septembre, la ligue des droits de l’Homme (LDH) estime qu’il est temps que la France reconnaisse qu’elle a eu un « comportement indigne » à l’égard des harkis et de leurs familles, à qui elle avait fait à la fin de la guerre d’Algérie des « promesses » qu’elle n’a pas tenues, et qui a abandonné les harkis et leurs familles. Le Premier ministre français Dominique de Villepin a exprimé le 25 septembre la « reconnaissance de la Nation » envers les harkis, lors d’une cérémonie à Paris à l’occasion de la « journée nationale d’hommage aux harkis ». La loi du 23 février 2005 « témoigne de la volonté de la France de ne pas oublier (une) page tragique de l’histoire et de rendre hommage à ceux qui ont été trop souvent et injustement oubliés », a déclaré Dominique de Villetpin, qui a décoré cinq anciens combattants et représentants des associations de harkis. Le ministre français aux Anciens Combattants, Hamlaoui Mekachera, a déclaré le 15 septembre que la loi française du 23 février sur le « rôle positif de la présence française outre-mer » était un « problème franco-français », et que les protestations suscitées en France par cette loi étaient « complétement absurdes ». Plusieurs historiens français (notamment Claude Liauzu, Jean Baubérot, Raphaêlle Branche et Pierre Vidal-Naquet) ont répondu au ministre en rappelant d’abord que leur protestation et leur demande d’abrogation de ladite loi était soutenue par plus de mille enseignants et chercheurs français et étrangers, ainsi que par la Ligue des droits de l’Homme, la Ligue de l’Enseignement, le MRAP, la LICRA. Les historiens estiment que cette loi, qu’ils considèrent comme une tentative de réhabilitation du colonialisme, « risque de mettre la France dans une situation comparable à celle du Japon », dont les relations avec la Chine et la Corée, notamment, sont plombées par son refus de reconnaître les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les armées d’occupation japonaises durant la seconde guerre mondiale. Les historiens estiment également qu’ériger les discours des nostalgiques de l’Algérie française « en vérité officielle reviendrait à nourrir les tenstions internes de la société française et à dégrader les relations extérieures de la France », notamment avec l’Algérie. Pour sa part, le président du Front des Forces Socialistes, Hocine Aït Ahmed, a estimé que la loi du 23 février « réussit l’exploit d’être à la fois scandaleuse et stupide. Scandaleuse car elle est une insulte pour les souffrances endurées par les Algériens (…). Stupide, car elle revient à désavouer la formidable dynamique anticoloniale qui a permis à de nombreux peuples (…) de recouvrer leur souveraineté ». Mais, ajoute Hocine Aït Ahmed, « l’instrumentalisation démagogique d’un nationalisme archaïque et revanchard de cette loi par le pouvoir n’est pas moins détestable » que la loi elle-même. Et « tout se passe comme si le pouvoir n’exigeait aujourd’hui de la France une repentance -par ailleurs (…) légitime- que pour mieux contraindre les responsable français à continuer d’observer un silence assourdissant sur la situation » de l’Algérie. (Nouvel Obs 3.11) La Cour d’appel de Paris a relaxé le 3 novembre le général Maurice Schmitt, ancien chef d’état-major des armées, poursuivi pour diffamation sur plainte de l’ancienne militante du FLN pendant la guerre d’Algérie, Louisette Ighilahriz, qu’il accusait d' »affubalutaions et de contreverités » après qu’elle ait, dans son témoignage publié en mars 2001, accusé un officier français, le capitaine Graziani, de l’avoir torturée et violée. Pour le tribunal, le général Schmitt bénéficie, comme tout autre, de la « liberté d’expression » et ne devrait donc pas être poursuivi pour diffamation. Cette position a également été celle de l’accusation.
|
|
2005 |
8 mai / La commémoration, LB 09/05/2005
Une autre commémoration Plusieurs milliers de personnes ont participé dimanche à Sétif, à 300 km à l’est d’Alger, à une marche commémorant le 60e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, lors desquels de 20000 à 45000 personnes, selon les estimations, avaient été tuées par les forces coloniales françaises. Les participants à cette marche ont emprunté le même parcours qu’avaient suivi les manifestants qui s’étaient rassemblés dans la ville pour demander l’indépendance de l’Algérie le 8 mai 1945, alors que 1es Alliés célébraient leur victoire sur le nazisme. Le 27 février dernier, l’ambassadeur de France en Algérie, M. Colin de Verdière, avait rendu hommage aux victimes des massacres de Sétif, qu’il avait qualifiés de « tragédie inexcusable ». Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a néanmoins réaffirmé que « le peuple algérien attend encore de la France un geste plus probant » sur la reconnaissance de toutes ses responsabilités. (AFP)
|
|
2006 |
in : LB 18/04/2006
La colonisation a réalisé un génocide de notre identité, de notre histoire, de notre langue, de nos traditions.
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA Le président algérien a dénoncé, lundi, la colonisation française de l’Algérie de 1830 à 1962. « Nous ne savons plus si nous sommes des Amazighs, des Arabes, des Européens ou des Français », a-t-il précisé, en citant des expressions de l’arabe algérien truffées de mots français.
|
|
2007 |
Une coopération nucléaire franco-lybienne irrite outre-Rhin, LB 28/07/2007
» Pour Nicolas Sarkozy.il ne faut y voir aucun lien avec la libération des Bulgares. La proposition française de coopération nucléaire avec la Libye fait polémique en Allemagne, où de nombreux députés considèrent qu’elle est une nouvelle manifestation de l’attitude de « cavalier seul » du président Nicolas Sarkozy en matière de politique étrangère. Nicolas Sarkozy a signé un mémorandum d’entente portant sur la fourniture par la France d’un réacteur nucléaire à la Libye, au cours d’une visite à Tripoli qui avait pour but de renforcer les relations entre les deux pays. Cette visite a été annoncée dans la foulée de la libération par la Libye des infirmières et du médecin bulgares condamnés à mort après avoir été accusés d’avoir inoculé le virus du sida à des centaines d’enfants libyens. Bien que cette libération ait coïncidé avec une médiation effectuée en Libye par Cécilia Sarkozy, et dont l’Elysée n’a pas communiqué les détails, le président français a affirmé qu’il ne fallait voir aucun lien entre le dénouement de l’affaire des infirmières et la conclusion d’un accord sur le nucléaire. Vendredi, un des plus hauts responsables du parlement allemand a accusé Sarkozy de « chercher à faire trop de choses à la fois » en lui reprochant de ne pas avoir consulté ses partenaires européens avant de prendre une décision aussi stratégique que l’accès à l’énergie nucléaire. « Même si cela prend du temps, la France devrait s’intéresser au renforcement des politiques extérieures et de sécurité de l’Europe », a déclaré Rupretch Polenz, le chef de file de la commission des Affaires étrangères au Bundestag. « Mais ce n’est pas ce qui se passe avec ces initiatives unilatérales. »
« La preuve »
D’autres responsables de la coalition d’union au pouvoir à Berlin ont estimé qu’il était prématuré, voire dangereux, de s’engager sur un projet d’énergie nucléaire avec un Etat qui vient à peine de sortir de plusieurs décennies d’isolement diplomatique. Cela fait moins de quatre ans que le dirigeant libyen a annoncé qu’il renonçait à ses programmes d’armes nucléaires, chimiques et biologiques. « Même si Kadhafi ne s’intéresse plus aux armes nucléaires, on ne peut pas savoir qui sera au pouvoir après lui, et ce qui se passera alors », a dit Ulrich Kalber, adjoint du chef de file du groupe social-démocrate au parlement. Les capitales ont levé leurs sanctions diplomatiques contre la Libye et les grandes puissances lorgnent désormais du côté des lucratifs contrats à saisir dans le secteur des hydrocarbures. « Cette coopération franco-libyenne dans le domaine du nucléaire civil est la preuve que les pays qui respectent pleinement leurs engagements internationaux de non-prolifération peuvent retirer tous les bénéfices des usages pacifiques de l’énergie nucléaire « , a fait valoir le ministère français des Affaires étrangères. « // ne faut pas confondre l’usage civil avec l’usage militaire », a souligné le Quai d’Orsay, précisant que la négociation avec Tripoli avait débuté en 2004 et que les partenaires de la France en avaient été informés « en de multiples occasions ». Ce n’est pas la première fois depuis son accession à l’Elysée, le 16 mai, que Sarkozy se heurte à la chancelière Angela Merkel. Les efforts du président français pour affaiblir l’euro et ses appels en faveur d’un contrôle accru de la Banque centrale européenne ont provoqué des tensions entre les deux capitales. Les spécialistes de la relation franco-allemande affirment que la rivalité entre les deux dirigeants s’est vue lors du dernier sommet européen. Sarkozy, disent-ils, a volé la vedette à Merkel qui, pourtant, le présidait. Sarkozy a justifié l’accord sur le nucléaire avec la Libye par la nécessité de faire confiance aux pays arabes quant à leur capacité à développer ce genre de technologie à des fins pacifiques au risque, dans le cas contraire, de froisser les populations de cette zone et de favoriser une guerre des civilisations. (Reuters)
|
|
2007 |
Liban / Les infirmières contre des armes françaises ?, LB 02/08/2007
LE FILS DU COLONEL KADHAFI, SEIF EL-ISLAM, affirme dans un entretien au « Monde » de jeudi qu’un important contrat d’armement passé avec la France et une décision de justice en Grande-Bretagne sur un ancien agent secret libyen ont joué un rôle important dans la libération des infirmières bulgares détenues en Libye. Selon le quotidien, le « cœur du sujet » entre Paris et Tripoli n’est pas le projet de fourniture d’un réacteur nucléaire civil, mais « /’a/foire militaire ». « Nous allons acheter à la France des missiles antichar Milan, à hauteur de 100 millions d’euros », révèle-t-il. « Ensuite, il y a un projet de manufacture d’armes », affirme Seif el-lslam. Le Président français a de son côté assuré mercredi que la France n’avait offert « aucune » contrepartie à la Libye pour la libération des praticiens bulgares. Le fils du colonel Kadhafi espère aussi un prochain retour en Libye d’un ancien agent Emprisonné en Grande-Bretagne pour l’attentat de Lockerbie, Ali al-Megrahi a été autorisé, fin juin, à faire appel de sa condamnation pour la seconde fois. Seif el-lslam Kadhafi dit encore « qu’il n’a pas cru en la culpabilité des infirmières bulgares » accusées d’avoir inoculé le virus du sida a des enfants libyens. « £//es ont ma/heureusement servi de boucs émissaires. »
|
|
2007 |
Es lebe die Bombe ! (ARTE 16/03/2007)
< Vive la Bombe (F2005) (R. Jean-Pierre Sinapi) ,,Man hätte uns gewarnt, wenn es gefährlich wäre », will Lieutenant Philippe (Cyril Descours) sich und seine drei Männerberuhigen, als die Atomwolke in der Sahara über sie hinwegzieht. Vergeblich warten sie auf den Befehl zum Rückzug. Zurück im Lager beginnt ein Albtraum: Die jungen Soldaten werden sofort dekontaminiert und monatelang isoliert. Unterdessen feiert die französische Regierung den Aufstieg zur Atommacht… Unter dem Codenamen ,,Béryl » startete Frankreich ab 1. Mai 1962 in der Wüste Algeriens einen unterirdischen Atomtest, bei dem zahlreiche Soldaten radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Über Jahrzehnte lehnte das Militär jede Verantwortung ab. 2005 wurde einem erkrankten Ex-Soldaten erstmals eine Invalidenrente zugebilligt.
|
|
2007 |
R.V., L’Algérie volée, in : LB 01/06/2007
Derrière une timidité qui n’est qu’apparente, Bachir Hadjadj ne peut cacher une colère sourde et l’impuissance de son désespoir. Né en Algérie en 1937, il a vécu le vol de son pays et de ses terres par la colonisation française, puis le rapt de la démocratie par le régime étouffant de Houari Boumediène après l’indépendance. Engagé un temps dans le syndicalisme étudiant, condamné ensuite à la clandestinité, incapable de réaliser le rêve d’un engagement citoyen dans son propre pays, il s’est exilé en 1972 et, avec sa femme française, a refait sa vie en France. Un jour, sa fille lui a dit : « Je voudrais savoir d’où je viens ». Cette prière d’une jeune femme devenue « française jusqu’au bout des ongles » mais qui avait « l’impression de manquer d’une dimension » a donné naissance à un livre pas comme les autres au titre évident, « Les voleurs de rêves » (Albin Michel, 455 pp., env. 22 €). Non pas œuvre d’historien mais témoignage d’un homme qui a retrouvé cent cinquante années de la vie d’une famille, la sienne, remontant jusqu’à l’occupation turque, ce premier vol de l’Algérie. Une Algérie « à livre ouvert », écrit Jean Lacouture dans sa préface. Vous êtes aussi sévère pour le régime né de l’indépendance que pour la période de la colonisation. Cela surprend… Quand la France est arrivée en Algérie, elle a décrété que « liberté, égalité fraternité », ce n’était pas pour les Arabes. Pour les pays anciennement colonisés, l’indépendance est essentiellement la citoyenneté. Avec le colonisateur, il n’y a pas de citoyenneté, n y a deux mondes, celui qui domine, le citoyen, et celui qui est dominé, le sujet. À l’indépendance, les Algériens étaient censés devenir citoyen. Us sont restés sujets, ceux d’une société archaïque islamique.
Pourquoi cet échec de l’indépendance?
On ne peut pas devenir citoyen du jour au lendemain. Quand les Français sont partis, il n’y avait aucune graine civique dans la société algérienne. Aucun maire, aucun préfet, aucun cadre administratif. Indépendante, la société a été dominée par cet islam archaïque dans lequel elle s’était réfugiée pour résister à la colonisation et qui est apparu, alors, comme constituant les racines profondes du pays. À l’indépendance, il fallait sortir à tout prix de cet archaïsme. Or, le Front de libération national, le parti unique, a été le premier à instrumentaliser l’islam à des fins politiques. À interdire le tabac, l’alcool, le cinéma, avec des punitions physiques à la clé. C’était une armée d’analphabètes. Lorsqu’elle a quitté l’Algérie, la France n’a laissé que 18 pc d’Algériens sachant lire et écrire. Sous la colonisation, il n’y avait pas assez d’écoles primaires dont la construction dépendait des mairies aux mains des Français. Et l’enseignement n’était pas obligatoire pour les Algériens.
Votre livre est aussi empreint de désespoir. Vous avez quitté votre pays sans retour? Quand je suis parti, la vie était difficile physiquement et militer devenu dangereux. Tout acte civique ne pouvait être que l’applaudissement, la clandestinité ou l’illégalité. À l’école, mes enfants ne pouvaient apprendre que le Coran. J’ai préféré aller ailleurs pour leur faire apprendre Victor Hugo. Pour l’avenir, je ne suis pas optimiste. Le pays est sous la chape d’une oligarchie militaire qui n’est pas l’armée en tant que telle mais certains chefs de celle-ci qui profitent de la rente pétrolière et sont obligés de s’allier à des groupes islamistes. Cela peut durer longtemps . . .
R.V.
|
|
2011 |
in : Knack 19/01/2011
(p.9) De jeugdwerkloosheid bedraagt ruim 30 procent. Het waren vooral jongeren die aïs eersten op straat kwamen na de zelfverbranding van Mohamed Bouazizi op 17 december. Hun woede richtte zich niet alleen tegen de président maar ook tegen diens spilzieke vrouw Leila Trabelsi, ‘de koningin van Carthago’, en de maffiapraktijken van haar familieclan die de halve Tunesische économie controleerde.
Mensenrechten
Ben Ali probeerde het straatprotest in de kiem te smoren. Hij kreeg daarbij zelfs hulp aangeboden vanuit Parijs. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Michèle Alliot-Marie stelde op 11 januari, luttele dagen voor de val van Ben Ali, in de Assemblée Nationale nog voor ‘de knowhow van onze ordestrijdkrachten, die in de hele wereld wordt erkend, ter beschikking te stellen om de veiligheidssituatie in Tunesië te beheersen’. Dat voorstel, waar de Franse regering amper een week later niet graag aan herinnerd wil worden, zegt wel iets over de relatie van Frankrijk met zijn voormalige kolonies in Noord-Afrika. Frankrijk heeft de autoritaire régimes in Tunesië, Alge-rije en Marokko altijd gesteund omdat ze gezien werden aïs bondgenoten in de strijd tegen het islamitisch fundamentalisme, voorposten in de onontkoombaar geachte clash of civilizations.
‘Het is voor de Tunesische bevolking pijnlijk vast te stellen’, schrijft de politicoloog Sami Zemni, die aan de Gentse universiteit de onderzoeksgroep ‘Midden-Oosten en Noord-Afrika’ coordineert, in een blog opwww.deredactie.be, ‘dat Europa dat zo graag over démocratie en mensenrechten praat (en deze graag wil exporteren) niet veel verder komt dan wat vage vermaningen bij monde van de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid en Veiligheid Catherine Ashton. (…)
|

