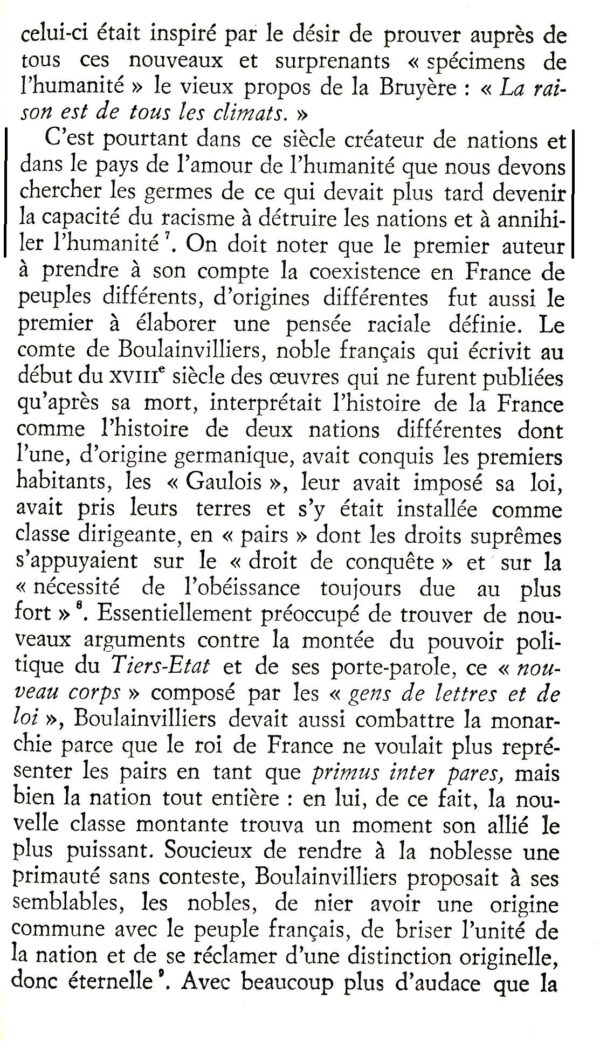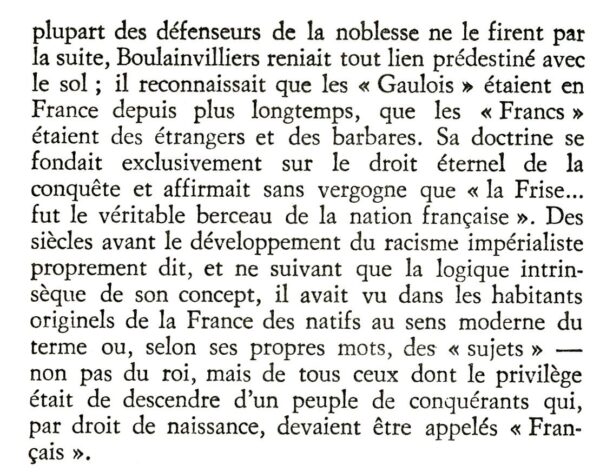Le racisme, fondement de l'impérialisme français
PLAN
1 Analyses
2 Documents
1 Analyses
|
Hannah Arendt, Sur l’antisémitisme, Calmann-Lévy, 1973
(p.63) “Diderot, le seul des philosophes français qui ne fut pas hostile aux Juifs (…)”
(p.110) “L’antisémitisme français, en outre, est plus ancien que ses homologues européens, de même que l’émancipation des Juifs remonte en France à la fin du 18e siècle. Les hommes des Lumières qui préparèrent la Révolution française méprisaient tout naturellement les Juifs: ils voyaient en eux les survivants du Moyen Age, les odieux agents financiers de l’aristocratie.”
|
|
Hannah Arendt, L’impérialisme, Fayard, 1982
(p.75) C’est “en ce siècle créateur de nations et dans la pays de l’amour de l’humanité que nous devons chercher les germes de ce qui devait plus tard devenir la capacité du racisme à détruire les nations et à annihiler l’humanité.” (p.79) “Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les fait est que ce sont les Français qui, avant les Allemands ou les Anglais, devaient insister sur cette idée fixe d’une supériorité germanique.”
|
|
Hannah Arendt, L’impérialisme, éd. Fayard, 1982
(p.20) L’IMPÉRIALISME
Qu’un Napoléon eût échoué à réaliser l’unité de l’Europe sous le drapeau français indiquait clairement que toute conquête menée par une nation conduisait soit à un éveil de la conscience nationale chez les peuples conquis, et donc à leur rébellion contre le conquérant, soit à la tyrannie. Et bien que la tyrannie, parce qu’elle n’a pas besoin du consentement, puisse régner avec succès sur des peuples étrangers, elle ne peut se maintenir au pouvoir qu’à condition de préalablement détruire les institutions nationales de son propre peuple. A la différence des Britanniques et de toutes les autres nations européennes, les Français ont réellement essayé, dans un passé récent, de combiner le jus et l’imperium, et de bâtir un empire dans la tradition de la Rome antique. Eux seuls ont au moins tenté de transformer le corps politique de la nation en une structure politique d’empire, ont cru que « la nation française étalt en marche… pour aller répandre les bienfaits de Ia civilisation française » ; ils ont eu le désir d’assimiler leurs colonies dans le corps national en traitant les peuples conquis « à la fois… en frères et… en sujets » – frères en tant qu’unis par les liens nés d’une civilisation française commune, et sujets dans le sens où ces peuples sont les disciples du rayonnement de la France. Ce qui se réalisa en partie lorsque des députés de couleur purent siéger au (p.21) Parlement français et que l’Algérie fut déclarée département. Cette entreprise audacieuse devait aboutir à une exploitation particulièrement brutale des colonies au nom de la nation. Au mépris de toutes les théories, l’Empire français était, en réalité construit en fonction de la défense nationale, et les colonies étaient considérées comme terres à soldats susceptibles de fournir une force noire capable de protéger les habitants de la France contre les ennemis de leur nation. La fameuse phrase prononcée par Poincaré en 1924: « La France n’est pas un pays de quarante millions d’habitants; c’est un pays de cent millions d’habitants», annonçait purement et simplement la découverte d’une «forme économique de chair à canon, produite selon des méthodes de fabrication en série». Quand, lors de la Conférence sur la paix de 1918, Clémenceau insistait sur le fait qu’il ne désirait rien d’autre qu’« un droit illimité à lever des troupes noires destinées à contribuer à la défense du territoire français en Europe si la France venait à être attaquée par 1’Allemagne», il ne protégeait pas la nation française contre une agression allemande, comme il nous a malheureusement été donné de l’apprendre, bien que son plan ait été mené à bien par l’Etat-Major général; mais il portait là un coup fatal à l’existence, jusque là encore concevable, d’un Empire français. Face à ce nationalisme aveugle et désespéré, les impérialistes britanniques qui acceptaient le compromis du système du mandat faisaient figure de gardiens de l’autodéterminatfon des peuples. Et cela, bien qu’ils eussent fait d’emblée un mauvais usage du système du mandat en pratiquant le « gouvernement indirect » , méthode qui permet à l’administrateur de gouverner un peuple « non pas directement mais par le biais de ses propres autorités locales et trîbales».
(p.74) 1 – UNE «RACE» D’ARISTOCRATES CONTRE UNE “NATION » DE CITOYENS Un intérêt sans cesse croissant envers les peuples les plus différents, les plus étranges, et même sauvages, a caractérisé la France du XVIIIe siècle. C’était l’époque où l’on admirait et copiait les peintures chinoises, où l’un des écrits les plus fameux du siècle s’appelait les Lettres persanes, et où les récits de voyage constituaient la lecture favorite de la société. On opposait l’honnêteté et la simplicité des peuples sauvages et non civilisés à la sophistication et à la frivolité de la culture. Bien avant que le XIXe siècle et son immense développement des moyens de transport eussent mis le monde non européen à la porte de tout citoyen moyen, la société française du XVIIIe siècle s’était efforcée de s’emparer spirituellement du contenu des cultures et des contrées qui s’étendaient loin au-delà des frontières de l’Europe. Un vaste enthousiasme pour les «nouveaux spécimens de l’humanité» (Herder) gonflait le coeur des héros de la Révolution qui venaient, après la nation française, libérer tous les peuples de toute couleur sous la bannière de la France.
(p.75) C’est pourtant dans ce siècle créateur de nations et dans le pays de l’amour de I’humanité que nous devons chercher les germes de ce qui devait pIus tard devenir la capacité du racisme à détruire les nations et à annihiler l’humanité. On doit noter que le premier à prendre à son compte la coexistence en France de peuples différents, d’origines différentes, fut aussi le premier à élaborer une pensée raciale définie. Le comte de Boulainvilliers, noble français qui écrivit au début du XVIIIe siècle des oeuvres qui ne furent pubIiées qu’après sa mort, interprétait l’histoire de la France comme l’histoire de deux nations différentes dont l’une, d’origine germanique, avait conquis les premiers habitants, les « Gaulois », leur avait imposé sa loi, avait pris leurs terres et s’y était installée comme classe dirigeante, en « pairs » dont les droits suprêmes s’appuyaient sur le « droit de conquête » et sur la « nécessité de l’obéissance toujours due au plus fort ». EssentieIIement préoccupé de trouver de nouveaux arguments contre la montée du pouvoir politique du Tiers-Etat et de ses porte-parole, ce «nouveau corps» composé par les « gens de lettres et de loi » , Boulainvilliers devait aussi combattre la monarchie parce que le roi de France ne voulait plus représenter les pairs en tant que primus inter pares, mais bien la nation tout entière : en lui, de ce fait, la nouvelle classe montante trouva un moment son allié le plus puissant. Soucieux de rendre à la noblesse une primauté sans conteste, Boulainvilliers proposait à ses semblables, les nobles, de nier avoir une origine commune avec le peuple français, de briser l’unité de la nation et de se réclamer d’une distinction originelle, donc éternelle. Avec beaucoup plus d’ audace que la (p.76) plupart des défenseurs de la noblesse ne le firent par la suite, Boulainvilliers reniait tout lien prédestiné avec le sol ; il reconnaissait que les « Gaulois » étaient en France depuis plus longtemps, que les « Francs » étaient des étrangers et des barbares. Sa doctrine se fondait exclusivement sur le droit éternel de la conquête et affirmait sans vergogne que «la Frise…fut le véritable berceau de la nation française ». Des siècles avant le développement du racisme impérialiste proprement dit, et ne suivant que la logique intrinsèque de son concept, il avait vu dans les habitants originels de la France des natifs au sens moderne du terme ou, selon ses propres mots, des « sujets » non pas du roi, mais de tous ceux dont le privilège était de descendre d’un peuple de conquérants qui, par droit de naissance, devaient être appelés « Français ». (p.76) La théorie de Boulainvilliers ne s’applique toutefois qu’aux peuples, non aux races; elle fonde le droit des peuples supérieurs sur une action historique, la (p.77) conquête, et non sur un fait physique – bien que l’action historique exerce déjà une influence sur les qualités naturelles des peuples conquis. S’il invente deux peuples différents au sein de la France, c’est pour s’opposer à la nouvelle idée nationale telle qu’elle était~présentée dans une certaine mesure par l’alliance de la monarchie absolue et du Tiers-Etat. (p.79) Il est assez étrange que depuis les premiers temps, où, à l’occasion de sa lutte de classe contre la bourgeoisie, la noblesse française découvrit qu’elle appartenait à une autre nation, qu’elle avait une autre origine généalogique et qu’elle avait des liens plus étroits avec une caste internationale qu’avec le sol de France, toutes les théories raciales françaises aient soutenu le germanisme, ou tout au moins la supériorité des peuples nordiques contre leurs propres compatriotes. Car si les hommes de la Révolution française s’identifiaient mentalement avec Rome, ce n’est pas parce qu’ils opposaient au “germanisme » de leur noblesse un « latinisme » du Tiers-Etat, mais parce qu’ils avaient le sentiment d’ être les héritiers spirituels de la République romaine. Cette revendication historique, dans sa différence par rapport à l’identification tribale de la noblesse, pourrait avoir été l’une des raisons qui ont empêché le « latinisme » de se développer en soi comme doctrine raciale. En tout cas, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait est que ce sont les Français qui, avant les Allemands ou les Anglais, devaient insister sur cette idée fixe d’une supériorité germanique. De la même manière, la naissance de la conscience de race allemande après la défaite prussienne de 1806, alors qu’elle était dirigée contre les Français, ne changea en rien le cours des idéologies raciales en France. Dans les années quarante du siècle dernier, Augustin Thierry adhérait encore à l’identification des classes et des races et (p.80) distinguait entre « noblesse germanique » et « bourgeoisie celte » , cependant que le comte de Rémusat, encore un noble, proclamait les origines germaniques de l’aristocratie européenne. Finalement, le comte de Gobineau développa une opinion déjà couramment admise parmi la noblesse française en une doctrine historique à part entière, affirmant avoir découvert la loi secrète de la chute des civilisations et promu l’histoire à la dignité d’une science naturelle. Avec lui, la pensée raciale achevait son premier cycle, pour en entamer un second dont les influences devaient se faire sentir jusqu’aux années 20 de notre siècle.
(p.80) II – L’UNITÉ DE RACE COMME SUBSTITUT A L’ÉMANCIPATION NATIONALE
En Allemagne, la pensée raciale ne s’est développée qu’après la déroute de la vieille armée prussienne devant Napoléon. Elle dut son essor aux patriotes prussiens et au romantisme politique bien plus qu’à la noblesse et à ses champions. A la différence du mouvement racial français qui visait à déclencher la guerre civile et à faire éclater la nation, la pensée raciale allemande fut inventée dans un effort visant à unir le peuple contre toute domination étrangère. Ses auteurs ne cherchaient pas d’alliés au-delà des frontières; ils voulaient éveiller dans le peuple la conscience d’une origine commune. En fait, cette attitude excluait la noblesse. (…) Comme la pensée raciale allemande allait de pair avec les vieilles tentatives déçues visant à unifier les innombrables Etats allemands, elle demeura à ses débuts si étroitement liée à des sentiments nationaux d’ordre plus général qu’il est assez malaisé de distinguer entre le simple nationalisme et un racisme avoué. D’inoffensifs sentiments nationaux s’exprimaient en des termes que nous savons aujourd’hui être racistes, si bien que même les historiens qui identifient le courant raciste allemand du XXe siècle avec le langage très particulier du nationalisme allemand ont curieusement été amenés à confondre le nazisme avec le nationalisme allemand, contribuant ainsi à sous-estimer le gigantesque succès international de la propagande hitlérienne. Ces circonstances particulières du nationalisme allemand changèrent seulement quand, après 1870, l’unification de la nation se fut effectivement réalisée et que le racisme allemand eut, de concert avec l’impérialisme allemand, atteint son plein développement. De ces débuts, un certain nombre de caractéristiques ont toutefois survécu, qui sont restées significatives au courant de pensée rociale spécifiquement allemand. A la différence des nobles français, les nobles prussiens avaient le sentiment que leurs intérêts étaient étroitement liés à la position de la monarchie absolue et, dès l’époque de Frédéric II en tout cas, ils cherchèrent à se faire reconnaître comme représentants légitimes de la nation tout entière. (p.88) C’est Haller qui, partant de cette évidence que les puissants dominent ceux qui sont privés de pouvoir, n’hésita pas à aller plus loin et à déclarer « loi naturelle » que les faibles doivent être dominés par les forts. Bien entendu, les nobles applaudirent avec enthousiasme en apprenant que leur usurpation du pouvoir non seulement était légale, mais encore obéissait aux lois naturelles, et c’est en fonction de ces définitions bourgeoises que, pendant tout le XIXe siècle, ils évitèrent les « mésalliances » avec un soin encore plus diligent que par le passé. Cette insistance sur une origine tribale commune comme condition essentielle de l’identité nationale, formulée par les nationalistes allemands pendant et après la guerre de 1814, et l’accent mis par les romantiques (p.89) sur la personnalité innée et la noblesse naturelle, ont intellectuellement préparé le terrain à la pensée raciale en Allemagne. L’une a donné naissance à la doctrine organique de l’histoire et de ses lois naturelles; de l’autre naquit à la fin du siècle ce pantin grotesque, le surhomme, dont la destinée naturelle est de gouverner le monde. Tant que ces courants cheminaient côte à côte, ils n’étaient rien de plus qu’un moyen temporaire d’échapper aux réalités politiques. Une fois amalgamés, ils constituèrent la base même du racisme en tant qu’idéologie à part entière. Ce n’est pourtant pas en Allemagne que le phénomène se produisit en premier lieu, mais en France, et il ne fut pas le fait des intellectuels de la classe moyenne, mais d’un noble aussi doué que frustré, le comte de Gobineau.
III – LA NOUVELLE CLE DE L’HISTOIRE
En 1853, le comte Arthur de Gobineau publia son Essai sur l’Inégalité des Races humaines, qui devait attendre quelque cinquante ans pour devenir, au tournant du siècle, une sorte d’ouvrage-modèle pour les théories raciales de l’histoire. La première phrase de cet ouvrage en quatre volumes – « La chute de la civilisation est le phénomène le plus frappant et, en même temps, le plus obscur de l’histoire” – révèle clairement l’intérêt fondamentalement neuf et moderne de son auteur, ce nouvel état d’esprit pessimiste qui imprègne son oeuvre et qui constitue une force idéologique capable de faire l’unité de tous les éléments et opinions contradictoires antérieurs.
(p.92) Lorsque Gobineau commença son oeuvre, à l’époque de Louis-Philippe, le roi bourgeois, le sort de la noblesse semblait réglé. La noblesse n’avait plus à craindre la victoire du Tiers-Etat, celle-ci était déjà accomplie; elle ne pouvait plus que se plaindre. (…) Il /= Gobineau/ était seulement un curieux mélange de noble frustré et d’intellectuel romantique, qui inventa le racisme pour ainsi dire par hasard: lorsqu’il s’aperçut qu’il ne pouvait plus se contenter des vieilles doctrines des deux peuples réunis au sein de la France et que, vu les circonstances nouvelles, il devait réviser le vieux principe selon lequel les meilleurs se trouvent nécessairement au sommet de la société. (…) (p.93) Petit à petit, il identifia la chute de sa caste avec la chute de la France, puis avec celle de la civilisation occidentale, et enfin… avec celle de l’humanité tout entière. Ainsi fit-il cette découverte – qui lui valut par la suite tant d’admirateurs parmi les écrivains et les biographes – que la chute des civilisations est due à une dégénerescence de la race, ce pourrissement étant causé par un sang mêlé, car dans tout mélange, la race inférieure est toujours dominante. (…) Il lui fallut près de cinquante ans pour devenir une gloire auprès de l’élite, et ses ouvrages durent attendre la Première Guerre mondiale et sa vague de philosophies de la mort pour jouir d’une réelle et large popularité. Ce que Gobineau cherchait en réalité dans la politique, c’était la définition et la création d’une « élite » qui remplacerait l’anstocratie. Au lieu de princes, il proposait une « race de princes », les Aryens, qui étaient en danger, disait-il, de se voir submergés par les classes inférieures non-aryennes du fait de la démocratie. Le concept de race permettait d’introduire les « personnalités innées » du romantisme allemand et de les définir comme les membres d’une aristocratie naturelle, destinée à régner sur tous les autres hommes. Si la race et le mélange des races sont les facteurs (p.94) déterminants de l’individu – et Gobineau n’affirmait pas l’existence de sangs « purs » -, rien n’empêche de prétendre que certaines supériorités physiques pourraient se développer en tout individu, quelle que soit sa présente position sociale, et que tout homme d’exception fait partie de ces « authentiques fils et survivants… des Mérovingiens “, qu’il est l’un de ces « fils de rois ». Grâce à la race, une « élite » allait se former qui pourrait revendiquer les vieilles prérogatives des familles féodales au seul fait qu’elle avait le sentiment d’être une noblesse ; la reconnaissance de l’idéologie de race allait en soi devenir la preuve formelle qu’un individu était de « bon sang » , que du « sang bleu » coulait dans ses veines et qu’une telle origine supérieure impliquait des droits supérieurs. D’un même événement politique, le déclin de la noblesse, notre Comte tirait donc deux conséquences contradictoires: la dégénérescence de la race humaine et la constitution d’une aristocratie nouvelle et naturelle.
(p.95) Taine lui-même croyait fermement au génie supérieur de la « nation germanique», et Ernest Renan a probablement été le premier à opposer les «Sémites » aux «Aryens» en une « division du genre humain » décisive, bien qu’il reconnût en la civilisation la grande force supérieure qui détruit les originalités locales aussi bien que les différences de race originelles.
(p.108) /Auguste Comte en France/ … celui-ci exprimait son espoir de voir une humanité unie, organisée, régénérée sous l’égide – la présidence – de la France.
|
Women and Slavery in the French Antilles, 1635–1848
BLACKS IN THE DIASPORA / Darlene Clark Hine, John McCluskey, Jr., and David Barry Gaspar, Women and Slavery in the French Antilles, 1635–1848 Bernard Moitt Indiana University Press This book is a publication of Indiana University Press 601 North Morton Street Bloomington, IN 47404-3797 USA http://iupress.indiana.edu Telephone orders 800-842-6796 Fax orders 812-855-7931 Orders by e-mail iuporder@indiana.edu © 2001 by Bernard Moitt All rights reserved 1. Women slaves—West Indies, French—History. 2. Women, Black—West Indies, French—History. I. Title. II. Series. For Cynthelia (Tia), Kojenwa, and Thandika Moitt, and to the memory of Mama (the late Pearl Agusta Moitt) Women and Slavery in the French Antilles,
1 Black Women and the Early BLACK WOMEN were present in the French Antilles beginning in the early decades of the seventeenth century, when the French occupied part of Saint Christopher. As French hegemony spread in the region in the 1630s, so did the number of black women, most of them slaves. (…) In 1669 Lieutenant Governor Jean-Charles de Baas of Martinique requested young men of fourteen years and young girls of ten from French hospitals for colonists to use as engagés for a period of four years.42 In 1681 Pouancay, governor of Saint-Domingue, wrote to the Minister of Marine and Colonies in Paris requesting 150 young women a year for three years, as they were considered necessary to attract settlers and promote the development of families. In response, the minister appealed to the general hospital in La Rochelle, whose administrators reportedly found young women there willing to emigrate. There were young, poor girls at several hospitals in France. Some were orphans and others were homeless juveniles.43 To this so-called “love trade” the state contributed 12 livres for each woman, and the hospital added a variety of gifts including sandals, amber necklaces, red skirts, stockings, and other items of clothing valued at 15–20 livres. This was supposedly voluntary migration, but the list of items given to the women makes coercion a distinct possibility. In any case, 29 of them were shipped to the governor of French Guiana on March 29, 1681, nine days after the women had signed contracts.44 In 1685 the hospital responded positively to additional demands from the state to provide women as wives for French settlers in Saint-Domingue. Authorities in that colony requested 50 young women at first, but later held out the hope that 100 could be recruited. How many of these the hospital was able to provide is not clear, but the need was certainly pressing in this case as the king offered 24 livres to each woman—twice the regular offering.45 These inducements did not entice enough people to migrate to the colonies, however. (…) Over the course of the Atlantic slave trade, the French colonies received well over a million and a half slaves, more than half of them going to Saint-Domingue. Not all of these were delivered by French slavers, even though the French sent out more than three thousand ships to Africa and began delivering slaves to their colonies soon after they were settled. The nature of record keeping in an often clandestine business, as well as the absence of data for some periods of the trade, have created huge gaps in the historical demography of the slave trade. The numbers game, as it is sometimes called, has therefore been the source of ongoing debate. In this debate, Robert Stein has posited that the eighteenth-century French slave trade was 21.4 percent higher than Philip Curtin estimated in his 1969 census of the Atlantic slave trade. This and other such responses have led to an upward revision of Curtin’s estimates. Even so, Paul Lovejoy has found Curtin’s projection of total imports “to have been remarkably accurate.” Lovejoy estimated that the number of slaves imported into the Americas from Africa was 9,778,500 and arrived at a global export figure of 9,913,000. Scholars will always be at variance over the volume of the slave trade, but besides demography, other factors such as geography, location, access to resources, gender, and labor regime had a bearing on the slave woman’s condition in the Caribbean, as later chapters demonstrate.5 (…)
DIVISION OF LABOR A somewhat awkward and imprecise hierarchy based on the occupations of the slaves was instituted on the plantations, and it catered to the psychological needs of both slaves and slaveowners. Commandeurs or slave drivers of the first gang, along with sugar boilers, specialist slaves, and some domestics, such as the housekeeper and the hospitalière (a health care provider), fell into the general category of “elite slaves” or “head people.” Most other slaves were designated as nègres or négresses de place—field slaves. Within this hierarchical division, plantation owners allocated most of the specialized tasks, predominantly artisanal, to men. Thus, as in Africa, slave men maintained their traditional spheres of influence and only they were coopers, carpenters, masons, and blacksmiths. But slaveowners also allotted to men certain nonspecialized tasks, such as driver of the first gang, sugar boiler, messenger, and coach driver. Thus the occupational hierarchy which characterized the plantation society strongly favored males. This hierarchy had other consequences besides economic ones for it reinforced male dominance in Caribbean societies.(…) Different standards were applied to the black woman, for even in the worst days of indentureship, the white woman was still seen as somewhat fragile and unsuited for hard labor. (…) Paradoxically, the French found it convenient to articulate the view that whites could not perform hard labor in the tropics, and promoted African slavery over European indentureship. Governor Houël of Guadeloupe subscribed to this view, as evidenced by a letter he wrote to the king of France in 1647, in which he complained that the few engagés who arrived in Guadeloupe were insufficient and lacked the resistance needed for sugar cultivation. Furthermore, they were incapable of adapting to the climate and the food, “such was their predisposition.” He hoped that the engagés would be supplemented or replaced by African slaves, whose labor he credited for the economic success of Barbados. And yet the classic stereotype of blacks as indolent liars and thieves was pervasive in Saint-Dominque by the eighteenth century.11 Governor Houël conceptualized the problem of labor in racial terms, for he implied that whites were incapable of performing hard labor in tropical climates. There is no scientific basis to support this view, and the heavy work that Europeans performed as engagés—clearing forests and establishing farms—should have been sufficient to dispel doubts about their physiological state. As we have seen, the bias toward African slave labor prevailed over white European indentured labor. As African slave labor displaced European indentured labor, sugar production became inextricably linked to slavery, with dire consequences for black women and men. From the outset, the sugar plantation was associated with hard, intensive labor and its success in Barbados left little doubt that African slave labor was the key. In 1698, after purchasing twelve slaves for 5,700 francs for the Fond Saint-Jacques Plantation in Martinique owned by his ecclesiastic order, proprietor Père Labat told his superior general that it was “absolutely necessary to have slaves unless we wish to discontinue the work of the sugar operations.” He assured his order that while the slaves would be used in other branches of labor, sugar production would not be jeopardized, as sugar was needed to pay for the slaves and to purchase salted meats and other food supplies for them. The exemption from taxes on slaves and other possessions that Louis XIV granted the Jesuits in 1651, in addition to the likely credit they received in this initial transaction, must have been an encouraging beginning. (…) As early as 1702, one observer, Monsieur de Galliffet, noted that “the majority of planters … worked their slaves beyond human endurance, all day and most of the night.”16 Around the same period, another observer, a Monsieur Deslandes, wrote that “colonists deal with their slaves with the utmost severity; they work them beyond their human endurance and ignore proper feeding and education.” Four decades later, in 1742, Monsieur Le Normand de Mézy, a planter and treasurer of Le Cap in the north of Saint-Domingue, wrote that “the condition of slaves in Saint-Domingue is one of working all day long except for a few hours break for lunch.” (…) Since technology was limited during this period, field slaves cleared and prepared the fields for cultivation using the basic hoe. They planted sugar cane cuttings, kept the fields free of weeds through regular weeding, and cut and transported sugar cane to the mill site, where they also worked in the manufacturing end of the sugar works. Women field slaves, in particular, distilled rum from molasses, a by-product of sugar. They also cultivated individual and collective garden plots, which provided food to sustain the slave force. Women marketed some of the produce grown on individual plots, thereby acquiring a personal source of income that gave them a measure of independence from the strict confines of the plantation. Women made up the majority of slaves in the field gangs, which varied in number according to need. Though a single, primary gang was the choice of some planters, on most plantations slaves were divided into two gangs and occasionally three. The first gang or grand atelier (great gang) consisted of the strongest male and female slaves above fourteen years of age, who performed the most arduous tasks. On the Bréda Plantation in the north of Saint-Domingue, slaves entered this gang at seventeen years, which suggests that there was variation from plantation to plantation. Less robust slaves, newly arrived slaves who had to be acclimatized, pregnant slaves, and nursing mothers made up the second gang, whose importance varied according to the agricultural calendar, the health of the slaves, and the interest of the planters. The third slave gang was made up of children (where numbers warranted) between the ages of eight and thirteen years, who worked under the supervision of an elderly female slave performing what were considered to be small tasks. (…) To quote Labat: (…) A woman slave belonging to the Jesuits was not as fortunate. In attempting to pass something to the woman on the other side of the mill, her shirt sleeves became caught in the cogs, and her arm, followed by the rest of her body was drawn into the machinery in an instant, before she could be helped. Only the head does not pass; it separates from the neck and falls on the side where the body entered. (…)
SEXUAL ABUSE Slave women also had limited means at their disposal to combat sexual abuse and to keep their families intact. Not all relations between slave women and males in authority can or should be construed as sexual abuse, but whether single or married, slave women were assaulted by males of all ethnicities in the French Antilles. We have no personal testimonies such as that presented by Thomas Thistlewood, a young English overseer in Jamaica in the mid-eighteenth century, who sexually exploited a host of slave women and recorded his daily activities (partly in Latin) in a journal. However, the significant number of mixed-race children who, along with their mixed-race mothers, acquired freedom in the French Antilles the 1830s and 1840s (see chapter 9) suggest sexual abuse. There were also slave women whose owners allowed them to work away from the plantations in establishments such as taverns in the port city of Saint-Pierre, Martinique, where prostitution was rife. (…)
6 Discipline and Physical Abuse IN ADDITION TO the low fertility rates and high infant mortality they experienced, slave women were subjected to severe physical punishment by slaveowners, male and female, other plantation personnel, and by slave drivers. Slaveowners and others in authority punished female slaves as harshly as they did male slaves, but slave women, being more directly in the line of confrontation with the slave system than men due to their subordinate position within the slave occupational hierarchy, were apt to be punished more frequently and, quite often, with more venom. Although there was “equality under the drivers’ whip,” as Beckles put it, gender played a role in punishment.1 Indeed, with few exceptions, those who administered punishment were males, black and white, and they may have perceived slave women as easier to discipline than men. Also, slave women, not men, were the object of jealous rages. Quite often, the punishment to which slave women, like men, were subjected amounted to sheer cruelty, as evidenced by the many dossiers in the French archives under the heading Sévices contre les esclaves (cruelty against slaves). But such treatment went unchecked and unpunished for most of the slavery period, in spite of the so-called “protective” clauses in the Code Noir and the innumerable amendments that were introduced after its promulgation. Thanks to slave women who initiated legal proceedings based on changes in the law in the 1830s and 1840s in particular, French authorities were forced to investigate cases of brutality against slaves that might otherwise have been ignored. Although the amendments to the law curtailed the disciplinary powers of slaveowners and gave more authority to colonial bureaucrats to rein them in, they neither nullified nor contravened the laws found in the Code Noir. WHIPPING Whipping was the most common form of discipline and physical abuse, and labor disputes were the most contentious issue between the slaves and the slave system that led to its use. Indeed, it is rare to find a French source on slavery that does not mention whipping. In the seventeenth century, Père Du Tertre quoted a proverb, albeit racist, that captures the relationship between whipping and blacks, as it was likely perceived at the time: “To look at a Native American askance is to beat him; to beat him is to kill him; to beat a black is to nourish him.” From Du Tertre’s time onward, this conception prevailed. So although flogging was common in Europe, it took on racial overtones in the Caribbean and became a panacea in dealing with slaves. At the outset of the Black Jacobins, for example, C.L.R. James used whipping to depict the relationship between slaves and slaveowners—the whip being the symbol of oppression. He wrote, “The stranger in San Domingo was awakened by the cracks of the whip, the stifled cries, and the heavy groans of the Negroes who saw the sun rise only to curse it for its renewal of their labours and their pains.” In reference to Saint-Domingue as well, Jean Fouchard indicated that “For the least infraction, the slave was whipped to satisfy the sadistic pleasure of the [slave] driver.” In a letter of April 1769, Bernardin de Saint-Pierre, a visitor, noted that slaves were frequently attached by the hands and feet to ladders and whipped until their skin was rent. “I have seen,” he wrote, “male and female slaves whipped daily for breaking a bit of earthenware or forgetting to close a door.” An observer and author of a historical work on Saint-Domingue also remarked that in the French Antilles, one spoke not in terms of “whipping” the slave but in terms of “trimming” the slave—a reference to mutilation. Similarly, France, a police superintendent in the French colonies in the 1840s, stated that whipping was tantamount to torture, “always excessive and barbarous, … with the potential of maiming the victim by assaulting his private parts or even killing him, if not instantly, as has already been the case, in due course, as is often the case.”3 In the eighteenth century, reports of slaves receiving fifty, a hundred, and even two hundred lashes surfaced. Some of these reports may well have been exaggerated, or may have failed to mention that whipping was sometimes administered in installments and not all at once. There is no doubt, however, that the disciplinary powers of slaveowners were real and excessive, and were backed by a Code Noir that was mostly gender neutral and set no limits on whipping. Breaches of the Code Noir were really breaches of a code of conduct, but they were treated as criminal offenses for the most part. Under Article 42 of the Code Noir, slaveowners were allowed to chain slaves and administer discretionary whippings with branches, cords, and cowhides, but they were forbidden to torture or mutilate them—actions for which the state could prosecute them and confiscate their slaves. However, mutilation and death were permitted in cases of marronnage and physical assault on whites that drew blood, but not assaults against people of color.4 Following complaints about the unlimited whipping of slaves, the Conseil Supérieur of Cayenne, French Guiana, limited the number of lashes a slave could receive in that colony to twenty-five in 1777.5 The council’s action was backed by a royal injunction, which suggests that this limit became standard throughout the French Antilles, but there was variation in the region. In Martinique a local ordinance of December 25, 1783, set the legal maximum number of strokes at twenty-nine, but fifty strokes were allowed for a short time after 1783.6 However, a royal ordinance of October 15, 1786, reinforced the 1783 ordinance and made it applicable to all the French colonies.7 Even though the legal limit remained twenty-nine strokes for some time prior to 1845, however, administrative correspondence suggests that colonial officials were uneasy with a fixed number, reasoning, quite correctly, that much harm could be done to slaves by a whipping that stayed within the official guidelines. In 1842, for example, the Procureur Général of French Guiana wrote to the governor of the colony to say that the vast majority of magistrates were in favor of a law under which a certain number of lashes would constitute “barbarous and inhumane punishment even when such punishment did not result in illness or incapacity to work.” The magistrates also believed that the determining factor should be the consequences of the whipping rather than the actual number of lashes. The Procureur Génèral indicated that magistrates were in need of clear guidelines on this issue, but it remained unresolved.8 By 1840 the Minister of Marine and Colonies in Paris considered proposals to abolish corporal punishment for female slaves, and to limit the number of strokes male slaves could receive to fifteen. Also, as a means of curbing their excesses, slaveowners would be required to record, within twenty-four hours of a disciplinary action, the offenses slaves committed, their age, sex, and occupation, as well as the punishment administered to them. Members of the Conseil des Délégues des Colonies, who commented on the proposals, raised concerns about how illiterate slaveowners in colonies such as French Guiana, where they were numerous, would follow the law. They expressed alarm at the prospect of the Minister imposing stiff fines and other penalties on slaveowners for the slightest infractions in record keeping in the French colonies, where slavery was “mild.” However, the proposals were adopted. Magistrates could pay surveillance visits to plantations to verify slave conditions under a law enacted on January 5, 1840. And a law enacted on September 16, 1841, limited prison terms of slaves to fifteen consecutive days on the plantation. Beyond that, power was transferred to the justice of the peace, who normally set prison terms in public jails and work terms on state farms.9 In 1845 these and other measures that sought to protect slaves (at least nominally) while safeguarding the rights of slaveowners were incorporated into what became known as the Mackau Law. Promulgated on July 18, the law limited the use of chains and the number of hours slaves could work, and authorized magistrates and colonial officials, including the Procureur Général, to pay surveillance visits to plantations to ascertain whether slaveowners were abiding by the regulations. The Mackau Law was sweeping in scope, but its effectiveness was another matter altogether. THE CODE NOIR AND THE TREATMENT OF In view of the changes in slave law down to the 1840s, it would be legitimate to ask what legal options were open to slaves who wished to redress their grievances. Their most difficult problem was lack of direct access to the courts. Article 44 of the Code Noir declared that slaves were chattel—the property of their owners. In theory, all that they possessed also belonged to their owners. And their offspring were slaves in perpetuity, the property of the slave woman’s owner. As chattel, slaves could not testify in criminal or civil matters, according to Articles 30 and 31 of the Code Noir. If they were ever required to testify (which they sometimes were), their testimony was to be used solely in aiding judges to evaluate their cases; however, the evidence they presented could also be disregarded. But Article 26 left an opening for slaves to lodge complaints of cruel treatment and deprivation against their owners with the Procureur Général, their legal guardian and chief representative of the Crown in the colonies, who had broad investigative powers and access to state funds. The existence of such provisions led Elsa Goveia to argue that, although the slaves in the French Antilles were private property, they did not cease to be a matter of public concern and that public interference in the management of slaves was taken for granted, at least until the expansion of slavery and the “development of a feeling of white solidarity.” However, one should not infer, as did Goveia, that slavery was more humane in the French colonies, for it was not. As Louis Sala-Molins has pointed out, slaves could complain, but their testimony was considered worthless. Besides, both slaveowners and the colonial administration were secure in the knowledge that Articles 30 and 31 would be scrupulously respected, while Article 26 was regarded as a mere “legislative distraction,” elevating the slave to the status of “subject” that was denied in the rest of the Code Noir. Another problem was that outcomes depended on the integrity of judicial officials and administrations, some of whom were slaveowners and had a vested interest in slavery. Not surprisingly, judicial rulings were uneven, spotty, and biased in favor of slaveowners. As a result, violations of the laws were rampant, although periodically some slaveowners were fined, banished from the colonies, deprived of owning slaves, and, less often, imprisoned. (…) Slaveowners regularly committed atrocities against their slaves. Pierre de Vassière cited a letter written by Gallifet in 1699 in which he mentioned the case of a colonist who shot a slave in Léogane, Saint-Domingue, and was fined 100 livres after eight months of investigation by a judge and the Procureur du Roi, a subordinate of the Procureur Général. Another colonist spurred an eleven-year-old slave girl to death and was fined 600 livres. The outcome of these cases caused de Vassière to conclude that judges were unwilling to go beyond imposing fines in response to slaveowners’ violations.11 In spite of royal ordinances of 1784 and 1785 that went beyond the Code Noir and gave slaves the legal right to denounce abuses committed by slaveowners and plantation administrators, the judiciary was reluctant to convict guilty slaveowners or hand down appropriate sentences. In some instances, the courts ignored strong, convincing, and condemnatory evidence collected from French administrators and slaves against slaveowners accused of cruelty to slaves, and dismissed the cases. The cases that came to light (only a minority did) involved cruelty to both male and female slaves, but females were disproportionately represented, and the range and nature of acts of cruelty against them were greater than in the case of male slaves. (…) Lest it appear that slaveowners in Saint-Domingue had a monopoly on brutality, the Sommabert case proves otherwise. On February 15, 1827, the Conseil Privé of Guadeloupe considered the case of a slaveowner and former artillery officer, François Rivière Sommabert of Moule. Sommabert had refused to reimburse Marie, a former slave who, at the request of authorities, cared for one of Sommabert’s slaves, Jean-Philippe, at a cost of 160 francs for a period of thirty-two days. Sommabert was also accused of murdering the slave woman Mélie, a fugitive who was caught on a neighboring plantation, and of other crimes against slaves including torture, assassination, confinement, and deprivation of food. Of all the heinous acts that Sommabert committed, his treatment of Mélie was the most horrendous, according to an administrative report. Sommabert beat her severely; then he attached her to the millworks and ordered all the slaves present to beat her with a stick. He then trampled her, jumped on her chest, punctured her stomach, and burnt her in hay up to her chest. After she died, Sommabert ordered that she be buried far away from the slave burial grounds. As this was not normal practice, it may be that Sommabert wished to conceal the evidence of wrongdoing while making an example of her. (…) This was a period when accounts of cruelty to slaves surfaced in antislavery publications such as the Anti-Slavery Reporter, a French newspaper. In an issue dated February 23, 1841, it noted that slaveowners had poisoned and mutilated slaves. It reported the eyewitness account given by one Favel Gourand, who said that six bulls, egged on by six whites, gored a slave to death on the plantation Marquise de Bellegrade in Martinique. Neither the authorities nor the judiciary endeavored to stop the incident, he claimed.22 In France the Minister of Marine and Colonies was aware of the criticisms leveled against slaveowners and the judicial system, but there was a tendency at this time for the Ministry to view the problem in terms of differences in interpretation of slave law. In a circular sent to colonial governors in November 1841, the Minister complained that slaveowners were out of hand and that unlimited detention and certain corrective measures they used to punish first offenses at marronnage were incompatible not only with the laws of morality and humanity but with a sound interpretation of the slave laws. “It was never understood,” he wrote, “that the master possessed, in any sense of the word, the person of the slave; it is solely the labor of the slave that has been allotted to him.” The Minister was aware of the laws in the Code Noir that gave slaveowners the right to chain slaves, but insisted that such measures were meant to deal with serious offenses that threatened the security of the plantation and not simple infractions. Given amendments that were introduced after 1685, the Minister held the opinion that the Code Noir regulation on discipline had been superseded. He believed that a laudable humanitarian sentiment had begun to take effect among “the great majority” of slaveowners, as evidenced by inspections showing that most cachots had been abandoned while others “were either destroyed spontaneously by slaveowners, or at the urging of the Procureurs du Roi and their deputies.” By adopting a broad interpretation of the slave laws and relying upon uncritical reports from magistrates who visited the plantations, the Ministry was somewhat out of touch with the actual situation of the slaves, however.23 Although attitudes toward the law among white colonists remained fairly uniform and the slaves’ recourse to the judiciary remained circumscribed, scholars should still proceed cautiously. Slaveowners resisted change, but they faced an increasingly determined and resilient slave population that was willing to test the limits of the slave system and profit from the cracks in white hegemony that became more evident in the 1830s and 1840s, when administrative officials began to monitor conditions on the plantations. For the slaves surveillance of plantations and “protection” by public officials did not come without a price. Word spread quickly in slave society and the fate of slaves who lodged complaints with the authorities was known, but they still persisted. In 1840 a group of six female and male slaves from Saint-Pierre, Martinique, lodged a complaint with the Procureur du Roi, after initial complaints to their female owner about the abuse they and other slaves suffered at the hands of their plantation overseer were disregarded. For their efforts, the slaves were imprisoned overnight. With their hands tied behind their backs, they were taken under police escort back to the plantation the following day, there to be whipped in front of the plantation gang.24 Similarly, Schoelcher related the case of a slave woman and her daughter from Moule, Guadeloupe, who complained about excessive whipping, which produced, in the woman’s case, cuts and welts that made mobility difficult. The medical report which he examined also showed that the woman received fifteen to twenty strokes and her daughter, twelve to fifteen. Thus the decline in the maximum number of strokes did not lead to a decline in the abuse of slaves. The persistent complaints lodged by slaves show that they were conscious of the intent of the law, however. (…) Not-guilty verdicts like that of the Jaham brothers and others likely brought on a sense of resignation among some colonial officials who appeared to have been sympathetic to the slaves’ plight. The manner in which the police superintendent France documented an incident that occurred in Martinique in July 1844 is evidence of this resignation. A nursing mother of twins, the female slave Adélaïde was caught napping while she watched the children of other slaves. For her negligence she was given the quatre piquets punishment, whipped with the rigoise, and thrown into the bullpen with her children. She escaped during the night, however, and made her way to Fort-Royal, where she sought help from the women of the Désouches family. The women were moved to pity at the sight of her wounds but took no active role in helping her. She then turned to the Procureur Général, who interrogated her, placed her in protective custody in prison, and arranged a visit to the doctor the next morning. In France’s view, however, it would only be a matter of two months or so before her wounds would heal and she would be forced “to return to the plantation of her oppressor.”40
France’s cynicism aside, and the vagaries of the slave system notwithstanding, it seems somewhat bizarre that Adélaïde would have been punished so severely for an offense that appeared to have caused no harm. It is not unusual for nursing mothers to be tired, and the fact that her owner could add two infant slaves to his property should have put her in a favorable position. To put her and her children at risk of being trampled by animals seems irrational to say the least. As if to nudge the judiciary into action, France wrote to the Procureur Général on June 31, 1845, to say that the continuous acts of violence committed against slaves by their owners were “reminiscent of torture during the Middle Ages that oppressed humanity.” In the same letter, he indicated that the slave woman Polixène, owned by Rampon Sainte-Claire of district Rivière-Salée, had just filed with him a complaint of barbarous treatment against her owner. She complained that Sainte-Claire subjected her to daily whippings, which accounted for the cuts on her buttocks, and to branding as a result of marronnage—a charge she rejected on the grounds of having to escape on account of inhumane treatment. France told the Procureur Général that he was taking the liberty of sending Polixène to him in the hope that he would authorize her to be examined and treated by a doctor. In a postscript likely designed to strengthen the slave’s hand, France indicated that Polixène was the mother of a free eight-year-old child, which qualified her under law for manumission. What followed was a series of written exchanges between France and the office of the Procureur Général which revealed that local authorities forced Polixène to return to the plantation of her owner, where she received a new round of whippings for having lodged a complaint with France. She was re-imprisoned for her own safety, but was made to return to her owner, who promised the Procureur Général that she would henceforth be treated humanely. As to the charge of marronnage, Sergeant Bedout told France that Sainte-Claire had accused Polixène of stealing a silver fork, which caused her to abscond. After two months at large, she was caught on the plantation Fleury and transported to her owner, who gave her the quatre-piquets punishment, whereby both her hands and feet were tied to a ladder and she was whipped. Even though it was later discovered that it was a child in Sainte-Claire’s household who had lost the fork, Sainte-Claire continued to regard Polixène as a rascal.41 Tensions between slave women and plantation personnel sometimes led to open confrontation, as was the case in 1845, when the slave woman Colombe clashed with Julien O’Neil, the économe of the plantation Lagrange in the district of Marigot, Martinique. The problem began on October 11 at about nine o’clock in the morning, when O’Neil followed Colombe into the plantation garden and accused her of being lazy. Swiftly and firmly, Colombe responded that she was a hard worker. Displeased with this retort, O’Neil struck her with a whip, which he carried on this occasion, along with a irontipped rod. Not content to remain silent in the face of authority, Colombe told O’Neil that he did not have the right to beat slaves in such a manner for nothing. So incensed was O’Neil at Colombe’s intransigence that he began to whip her. Colombe fought back. She seized his arm and attempted to wrestle the whip away from him. In the struggle that ensued, O’Neil attempted to free himself from Colombe’s grip, tearing his clothing in the process. In his fury, he struck her in the face with his iron-tipped rod, cutting her lower lip. He then ordered that she be arrested and placed in solitary confinement on the plantation. She was deprived of food until seven o’clock that evening. The following morning, de Compignan, the plantation overseer, ordered that she be given twenty-nine lashes. Her pleas that she was breast-feeding her fourmonth-old infant fell on deaf ears; her clothes were removed, and de Compignan’s order was carried out. Not content to leave it at that, de Compignan ordered that an iron ring be placed around her ankle and attached to a chain weighing four kilograms.42 The chain was meant to punish her and restrict her mobility, but it was no deterrent for Colombe, for it was in this state, two days later, that she left the plantation. Accompanied by Frédéric, a male slave who carried her infant in his arms, she headed for Saint-Pierre. But her chains gave her away. When interrogated en route, she could not produce the pass from her owner that slaves who were away from the plantation were required to possess. Slaves in this situation would be summarily returned to their owners, but Colombe refused to reveal her owner’s identity and was consequently imprisoned as a fugitive. It was from prison that she drew attention to her condition, and lodged a complaint with the Procureur Général of Saint-Pierre, who ordered that her chains be removed and an investigation be launched. O’Neil testified that he gave Colombe only one lash and that her lip wound was the result of a punch. Save for the slave driver, the other slaves who witnessed the fight contradicted O’Neil’s version of events. As for de Compignan, he insisted that he had acted within the boundaries of the law.43 Baffer, a substitute for the Procureur Général, blamed Colombe for responding to O’Neil in a tempestuous manner, but believed that it was the slave’s recognition of the illegality of O’Neil’s actions that caused her to fight back. He deplored the altercation that took place in the presence of the plantation slaves. Although he acknowledged de Compignan’s right to discipline slaves, he found his treatment of Colombe, “a weak woman and sucking infant’s mother,” excessive and revolting. He applied the Mackau Law of 1845 (which abolished the whip for women) to this case, and pronounced O’Neil and de Compignan guilty without attenuating circumstances. O’Neil was fined 101 francs, and de Compignan 150.44 In a judgment rendered in February 1846, the Cour Royale of Guadeloupe fined Crosnier, the gérant of the plantation O’Connor in the district of Capesterre, five hundred francs for a catalog of acts against male and female slaves, including whippings, extended detentions in the stocks, and torture by fire. Some of these acts highlight the fact that, as in the case of Marie-Claire of French Guiana, there was no consideration for the age of slave women, nor for motherhood. Among the charges Crosnier faced in 1846 was that of locking up the sixty-year-old slave woman Sophie in a naked state for three consecutive nights. Crosnier also ordered and participated in the quatre-piquets punishment of the elderly slave woman Clarisse. Upon Crosnier’s orders, Clarisse’s son, Martin, was one of four slaves who held down the naked slave while the slave driver administered the whipping.45 Five hundred francs was also the fine levied by the courts in Guadeloupe against Leprince of Pointe-Noire for working the elderly and sick slave woman Themie beyond endurance. In 1846, when the judgment was rendered and the judiciary sought to protect Themie, it was too late. She was taken to hospital in Basse-Terre, where she died two hours later.46 Similarly, the Cour Royale of Martinique fined Lehimas, manager of a sugar plantation in the district of Prêcheur, 500 francs for detaining slaves beyond the legal limit. Lehimas’s crimes were really more serious. Lehimas had promised the pregnant slave woman Jenny a whipping because he blamed her for the absence of her daughter, Rienette, a domestic in the service of the plantation household. So it must have been with some trepidation that Jenny, a mother of nine children, returned to the fields fifteen days after she delivered. Lehimas confronted her in the presence of the plantation gang and reminded her of her daughter’s continued absence. To stave off the whipping, Jenny sought the help of Desbordes, mayor of Prêcheur, who accompanied her back to the plantation and intervened on her behalf. But his efforts came to naught on this occasion, for that night Lehimas beat her about the head and face with his fist and had her placed in the stocks overnight. The next morning he gathered her children together and forced them to watch as he removed her clothing, had her tied to a ladder, and ordered the slave driver to administer a whipping. This was the experience that caused Jenny to file a complaint with the authorities, as a result of which Lehimas’s mistreatment of other slaves came to light. (…) In the last years of slavery, as an increasing number of cases revealed acts of cruelty against slaves by their owners, different branches of the law began to take firmer action, but the results remained fairly predictable. It was through the active intervention of the police in French Guiana, for example, that Gabriel Dernier was arrested for the attempted murder of Justine, a slave woman owned by his mother. In 1846 Dernier was charged with willfully firing shots at Justine and causing wounds to her buttocks and legs. The governor of French Guiana told the Minister of Marine and Colonies that two doctors, Roue Simon and Auguste Roue, confirmed that Justine was shot from a distance, but that the wounds were not serious. Nevertheless, he argued that the charges against Dernier were justified inasmuch as the shots “could have ended up in a more dangerous place, Dernier not having calculated the distance.” Although Dernier claimed that the gun went off accidentally, he must have been aiming in the direction of the slave since the shots were fired from a distance. The governor told the Minister that the case was proceeding but that he had to wait twenty days for a second medical report. He did not explain the purpose of the second report, but he promised to do his best to ensure that the well-being of the slaves was respected. Archival documents contain no evidence that the case was pursued to conclusion, demonstrating once again the legal system’s reluctance to convict slaveowners. (…) On May 6, 1802, General Richepance landed with 3,400 men at Pointe-à-Pitre, the capital of Guadeloupe, with orders from Napoléon to reestablish slavery.8 Having virtually no hope of winning in Saint-Domingue, Napoléon spared no effort in subduing Guadeloupe. On May 20, 1802, slavery and the slave trade were reimposed there. (…) On May 12, 1802, one of the major battles fought under the slave commander Palerme took place at Dolé, an important post in the hands of the rebels; white women and children, whom the slaves had rounded up on plantations, were being held there.12 Here at Dolé, the mixed-race slave woman Solitude, though pregnant, battled her way into history by participating in all the fighting. (…) It is believed that Ignace was killed along with 675 of his followers on May 25.24 Most of those taken prisoner were shot in Pointe-à-Pitre, 150 of them on October 27 alone. The women who accompanied Palerme fared little better. Routed by the French, Palerme’s people fled into the hills.25
Delgrès took his last stand on the extensive plantation Danglemont, where the battle of Matouba was fought on May 28, 1802. Unable to match the wellarmed French, Delgrès resolved to commit suicide and take as many French troops with him as possible by setting fire to barrels of gunpowder he distributed among his troops. Gunpowder was spread along the approaches to the main entrance of the plantation. Delgrès also placed gunpowder within firing range of his two defensive positions in the plantation Great House. According to Oruno Lara, the women “were even more enthusiastic about dying” than the men.26 After shouts of “Vivre libre ou mourir!” (liberty or death), Delgrès and about five hundred men, women, and children were killed when the gunpowder exploded. French casualties were put at four hundred. Some rebels escaped into the surrounding forest and became maroons, but the defeat of Delgrès brought organized resistance to an end. An arrête of July 16, 1802, reimposed slavery in Guadeloupe.27 (..) If we agree with Patterson that the Caribbean was a “theatre of European imperial horrors,” however, it is not far-fetched to suggest that women were not strangers to, or intimidated by, punishment and suffering. Thus Vanony-Frisch may well be right in stating that neither child care nor the unforeseen dangers which characterized marronnage deterred women.40 Advertisements in colonial newspapers and prison records provide startling revelations about female fugitives. Black and mixed-race females fled from their white, black, and mixed-race owners, chained and unchained, with and without their children. The race and sex of the slaveowner were immaterial in slave women’s decision to abscond. Also, neither pregnancy nor the age of their children seem to have prevented some women in the French Caribbean from fleeing, but women without children were more likely to flee. In 1788 one of the fugitives in the Petit-Bourg prison in Guadeloupe was the eighteen-year-old black woman Adélaïde, who was owned by Julienne, a free mixed-race woman from Pointe-à-Pitre. In the nineteenth century, several female fugitives advertised in the Gazette de la Martinique belonged to black and mixed-race owners as well. Such was the case of Émélie, a twenty-five-year-old Congolese, who in October 1803 was believed to be in Fort-de-France or Gros Morne with other Congolese, hiding from her mixed-race female owner, Rose. In 1804 Christine, a black slave woman, fled from her owner, Mathurine, a free black woman from the district of Trinité.41 (…) Notes Introduction 1. Barbara Bush, Slave Women in Caribbean Society 1650–1838 (Bloomington: Indiana University Press, 1990); Arlette Gautier, Les Soeurs de solitude: La Condition féminine dans l’esclavage aux Antilles du XVIIe au XIX siècle (Paris: Éditions caribéennes, 1985); Marrietta Morrissey, Slave Women in the New World: Gender Stratification in the Caribbean (Lawrence: University Press of Kansas, 1989). Also see Bridget Brereton’s review of Bush’s Slave Women in Journal of Caribbean History 24, no. 1 (1992): 115–20, and her review article, “Searching for the Invisible Woman,” in Slavery and Abolition 13, no. 2 (1992): 86–96. 2. See Lucille Mathurin-Mair, The Rebel Woman in the British West Indies (Kingston: Institute of Jamaica, 1975); Bridget Brereton, “Text, Testimony and Gender: An Examination of Some Texts by Women on the English-Speaking Caribbean from the 1770s to the 1920s,” in Engendering History: Caribbean Women in Historical Perspective, ed. Verene Shepherd et al., 63–93 (New York: St. Martin’s Press, 1995); Verene Shepherd, “Introduction,” in Women in Caribbean History, ed. Verene Shepherd, xvii–xx (Kingston: Ian Randle, 1999); Hilary Beckles, “Sex and Gender in the Historiography of Caribbean Slavery,” in Shepherd. Engendering History, 125–40. 3. For a detailed discussion on the meaning of gender, see Karen Anderson, Teaching Gender in U.S. History (Washington, D.C.: American Historical Association, 1997), 1–56. 4. Bernard Moitt, “Behind the Sugar Fortunes: Women, Labor and the Development of Caribbean Plantations during Slavery,” in African Continuities, ed. Simeon Chilungu and Sada Niang (Toronto: Terebi, 1989), 403–26; Bernard Moitt, “Women, Work and Resistance in the French Caribbean,” in Shepherd, Engendering History, 155–75; Hilary Beckles, Natural Rebels: A Social History of Enslaved Black Women in Barbados (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1989), 2, 25–54; Bush, Slave Women, 33–50. 5. Le Code Noir ou recueil des règlements rendus jusqu’à présent (Basse-Terre: Société d’histoire de la Guadeloupe, 1980), 33–34. 6. Morrissey, Slave Women, 4. 1. Black Women and the Early Development of the French Antilles 1. See Lucien Peytraud, L’Esclavage aux Antilles françaises avant 1789 (Paris: Hachette, 1879), 51; C. A. Banbuck, Histoire politique, économique et sociale de la Martinique sous l’Ancien Régime (1635–1789) (Paris: Librairie des sciences politiques et sociales, 1935), 24. 2. Jean-Baptiste (Père) Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les Français, 4 vols. (1671; reprint, Fort-de-France: Éditions des horizons caraïbes, 1973), 1:3–11. All translations from French are the author’s unless otherwise noted. 3. Du Tertre, Histoire, 1:3–15; Jacques Petit Jean Roget, “Saint-Christophe, première des isles françaises d’Amérique,” in Bulletin de la Société d’histoire de la Martinique, no. 24 (1981): 3–20. 4. Richard S. Dunn, Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624–1713, (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1972), 119. 5. Gordon K. Lewis, Main Currents in Caribbean Thought (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983), 64. 6. Ibid.; Peytraud, L’Esclavage, 20. 7. Clarence J. Mumford, The Black Ordeal of Slavery and Slave Trading in the French West Indies 1625–1713, 3 vols. (Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 1991), 2:362; Peytraud, L’Esclavage, 5; Banbuck, Histoire, 24. 8. Peytraud, L’Esclavage, 5. 9. Du Tertre, Histoire, 1:19; M. Philippe Barrey, Les Origines de la colonisation française aux Antilles (Le Havre: H. Micaux, 1918), 144; Dunn, Sugar and Slaves, 119. 10. Barrey, Origines, 154. 11. S. L. Mims, Colbert’s West India Policy (New Haven: Yale University Press, 1912), 45–46. 12. Mumford, Black Ordeal, 1:137. 13. Franklin W. Knight, The Caribbean: The Genesis of a Fragmented Nationalism (New York: Oxford University Press, 1990), 62; Peytraud, L’Esclavage, 4–7. 14. Knight. The Caribbean, 64. 15. Du Tertre, Histoire, 1:59; Peytraud, L’Esclavage, 8. 16. Barrey, Origines, 155. 17. Peytraud, L’Esclavage, 8–9; Banbuck, Histoire, 310; Mumford, Black Ordeal, 2:363. 18. Du Tertre, Histoire, 1:61. 19. Peytraud, L’Esclavage, 9. 20. Dunn, Sugar and Slaves, 71. 21. Philip D. Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Census (Madison: University of Wisconsin Press, 1969), 61. 22. Dunn, Sugar and Slaves, 127; Curtin, Atlantic, 59. 23. Dunn, Sugar and Slaves, 146. 24. Ibid., 124; Anne-Marie Bruleaux et al., Deux Siècles d’esclavage en Guyane française, 1652–1848 (Paris: L’Harmattan, 1986), 13–15; “Notice statistique sur la Guyane française,” in Notices statistiques sur les colonies françaises (Paris: Société d’études, 1843), 1–9; Du Tertre, Histoire, 3:2–4. 25. Du Tertre, Histoire, 1:66–72, 78–79, 104–105; Lucien Abénon, La Guadeloupe de 1671 à 1759, 2 vols. (Paris: L’Harmattan, 1987), 1:1, 16. 26. M. L. E. Moreau de Saint-Méry, Description de la partie française de l’isle Saint-Domingue, 3 vols. (Paris: Société d’histoire des colonies françaises, 1958), 1:45; Jacques Petit Jean Roget, “La Société d’habitation à la Martinique: Un Demi Siècle de formation, 1635–1685,” 2 vols. (Ph.D. diss., Université de Lille III, 1980), 2:1001. 27. Gabriel Debien, Les Engagés pour les Antilles (1634–1715) (Paris: Société de l’histoire des colonies françaises, 1952), 253. 28. Maurice Satineau, Histoire de la Guadeloupe sous l’Ancien Régime, 1635–1789 (Paris: Payot, 1928), 11, 116. 29. The worth of currencies used in the French Antilles during slavery is hard to estimate because value depended on the metallic content of coins and the level of demand for them, which was usually high. An additional difficulty is the lack of standardization in currency exchange before the law enacted on August 30, 1826, that made the French franc the predominant currency. During slavery, there were colonial currencies as well as currencies from France and from foreign countries, mainly Spain and Portugal. In the eighteenth century, the colonial livre tournois was worth about 20 sols; 1 sol was worth about 12 deniers or about 12 cents (U.S.). The expression “livre d’amende” was used when fines were imposed, hence “amende.” French currencies used in the colonies included coins such as the écu, made of gold and silver, and the sou, made of copper. Spanish doublons and escudos were popular, while the Portuguese moëdes enjoyed wide circulation. An écu was worth about 9 livres, a moëde about 66 livres. See Alain Buffon, Monnaie et crédit en économie coloniale: Contribution à l’histoire économique de Guadeloupe, 1635–1919 (Basse-Terre: Société d’histoire de la Guadeloupe, 1979), 47–66; E. Zay, Histoire monétaire des colonies françaises d’après les documents officials avec 278 figures (Paris: 1892), 44–45. 30. Archives Nationales (Paris) Colonies (hereafter AN Col.), C 8A 15 F347, November 20, 1704; David Barry Gaspar, Bondmen and Rebels: A Study of Master-Slave Relations in Antigua (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985), 183–84. 31. Gautier, Soeurs de solitude, 31–32. 32. Ibid., 20–25. 33. Bush, Slave Women, 8. 34. Liliane Chauleau, La Société à la Martinique au XVIIe siècle, 1635–1713 (Caen: Ozanne, 1966); Roget, Société; Abénon, Guadeloupe. 35. Chauleau, Société, 207. 36. Roget, Société, 2:1007. 37. Gaston-Martin, Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises (Paris: Presses universitaires de France, 1948), 112–13; Debien, “Les Engagés,” 257; Du Tertre, Histoire, 2:447; Banbuck, Histoire, 295. 38. Moreau de Saint-Méry, Description, 1:40, 47, 104; Roget, Société, 1:606–10. 39. Debien, “Les Engagés,” 175; Satineau, Histoire, 68. 40. Debien, “Les Engagés,” 181. 41. Gautier, Soeurs de solitude, 31–32. 42. Chauleau, Société, 98. These “hospitals” served more as institutions for the indigent than as health care establishments. 43. Banbuck, Histoire, 287–88; Peytraud, L’Esclavage, 196; Satineau, Histoire, 68. 44. Debien, “Les Engagés,” 181–83. 45. Ibid., 183. 46. Ibid. 47. Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le vent de 1625 à 1785, 6 vols. (Paris, 1785–1790), 1:434: “Ordonnance du roi, portant que le nombre des engagés sera à Saint-Domingue, égal à celui des Nègres, à peine de confiscation de l’excédent de ces derniers,” September 30, 1686; Peytraud, L’Esclavage, 14–15; Satineau, Histoire, 97. 48. Peytraud, L’Esclavage, 15. 49. Ibid.; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:581. 50. Satineau, Histoire, 78; Debien, “Les Engagés,” 241. 51. Satineau, Histoire, 70; see also Du Tertre, Histoire, 2:454–55. 52. Henri Bangou, La Guadeloupe, 3 vols. (Paris: L’Harmattan, 1987), 1:59; Chauleau, Société, 182. 53. Gabriel Debien, “Les Premières Femmes des colons des Antilles, 1635–1680,” in Revue de la Porte Océane, nos. 89–90 (1952): 8, 11–12. 54. Roget, Société, 2:958. 55. Ibid., 2:949. 56. Archives Départementales de la Martinique (Fort-de-France, Martinique) (hereafter A D-M, Martinique), série MI, 5mi. 89, “État nominatif et général des citoyens et les habitations de la Martinique, 1664–1764.”
57. Gautier, Soeurs de solitude, 71. 58. A D-M, “État nominatif et général des citoyens et les habitations de la Martinique, 1664–1764.” 59. Moreau de Saint-Méry, Description, 1:57. 60. Abénon, Guadeloupe, 1:30–31. 61. Abdoulaye Ly, La Compagnie du Sénégal (Paris: Présence africaine, 1968), 49. 62. Abénon, Guadeloupe, 1:31–32, 50. 63. Ibid., 1:55. 64. Ibid., 1:46–50. 65. Ibid., 1:32, 39–40. 66. AN Col., C 8A 10 F255, Copie d’une lettre écrite par le Gouverneur d’Antigue à M. D’Amblinom, October 6, 1698. 67. Bush, Slave Women, 13. 68. Peytraud, L’Esclavage, 196–97. 69. Debien, “Les Engagés,” 207. 70. Moreau de Saint-Méry, Description, 1:83–84. 71. Bush, Slave Women, 13. 72. Moreau de Saint-Méry, Description, 1:45; Satineau, Histoire, 95. 73. Peytraud, L’Esclavage, 16; Debien, “Les Engagés,” 254–55. 74. Debien, “Les Engagés,” 205. 75. Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:119: “Règlement de M. de Tracy, Lieutenant Général de l’Amérique, touchant les blasphémateurs et la police des Isles,” June 19, 1664; Satineau, Histoire, 74. 76. Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:180: “Ordonnance de M. de Baas, touchant les religionnaires, les juifs, les cabaretiers et les femmes de mauvaise vie,” August 1, 1669. 77. Debien, “Les Engagés,” 205–206. 78. AN Col., C 8A 9, F 73, March 11, 1695; Debien, “Les Engagés,” 207; Peytraud, L’Esclavage, 201. 79. Pierre Dessalles, Histoire des Antilles, 5 vols. (Paris: Libraire-Éditeur, 1847), 3:291; Orlando Patterson, Slavery and Social Death (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 215; Chauleau, Société, 191; Code Noir, 33–34. 80. Debien, “Les Engagés,” 251–55. 81. Kenneth Stampp, The Peculiar Institution (New York: Random House, 1984), 5. 2. The Atlantic Slave Trade, Black Women, and the Development of the Plantations 1. See, for example, John Thornton, “Sexual Demography: The Impact of the Slave Trade on Family Structure,” in Women and Slavery in Africa, ed. Claire C. Robertson and Martin A. Klein, 39–48 (Madison: University of Wisconsin Press, 1983); John Thornton, “The Demographic Effect of the Slave Trade on Western Africa, 1500–1850,” in African Historical Demography, ed. Christopher Fyfe and David McMaster, 2 vols. (Edinburgh: Centre of African Studies, University of Edinburgh, 1981), 2:691–720; John Thornton, “The Slave Trade in Eighteenth-Century Angola: Effects on Demographic Structures,” in Canadian Journal of African Studies 14 (1980): 417–27; Walter Rodney, West Africa and the Atlantic Slave Trade (Cambridge: Africa Research Group, 1974), 3–27; J. D. Page, “The Effect of the Export Slave Trade on African Populations,” in The Population Factor in African Studies: Proceedings of a Conference Organised by the African Studies Association of the United Kingdom, September 1972, ed. R. P. Moss and R. J. A. Rathbone, 15–23 (London: University of London Press, 1975); Patrick Manning, Slavery and African Life (New York: Cambridge University Press, 1990); J. E. Inikori, “Underpopulation in Nineteenth Century West Africa: The Role of the Export Slave Trade,” in Fyfe and McMaster, African Historical Demography, 2:283–313. 2. Du Tertre, Histoire, 3:179. 3. Mims, Colbert’s, 286–309; Mumford, Black Ordeal, 1:187; Ly, Compagnie, 53; Satineau, Histoire, 88–89. 4. Du Tertre, Histoire, 1:457–60. 5. Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Census (Madison: University of Wisconsin Press, 1969), 84–87; Robert Stein, The French Slave Trade in the Eighteenth Century (Madison: University of Wisconsin Press, 1979), xiv; Robert Louis Stein, “Measuring the French Slave Trade, 1713–1792/3,” Journal of African History 19, no. 4 (1978): 515–21; Paul E. Lovejoy, “The Volume of the Atlantic Slave Trade: A Synthesis,” Journal of African History 23 (1982): 473–77. A more recent review of the literature on the volume of the Atlantic trade is provided by Serge Daget, La Traite des Noirs (Rennes: Editions Ouest-France, 1990), 151–73. 6. Alfred Martineau and Louis-Philip May, Trois Siècles d’histoire antillaise: Martinique et Guadeloupe de 1635 à nos jours (Paris: Société d’histoire des colonies françaises, 1935), 120; Du Tertre, Histoire, 2:26; Chauleau, Société, 97–98. 7. Stein, French Slave Trade, 109. 8. AN Col. C8 1, Governor de Baas to Minister Colbert, June 25, 1670, cited in Mims, Colbert’s, 170. See also Mumford, Black Ordeal, 1:157–59. 9. AN Col., C 8A 3 F316, Blénac to Minister, June 18, 1684. 10. AN Col., C 8A 3 F278, Blénac to Minister, February 3, 1683. 11. AN Col., C8A 5 F425, Extrait de la recette et dépense faites aux iles de l’Amérique pendant l’année 1689, 1689; AN Col., C8A 5 F364, Relation de ce qui s’est passé à la prise de St. Eustache, May 1, 1689; AN Col., C 8A 5 F239, Copie d’une lettre écrite à M de Blénac et M. Dumaritz de St. Christophe, 1689; AN Col., C8A 5 F258, Blénac to Minister, November 12, 1689; AN Col., C 8A 5 F398, Compte que rendre M. Du Maitz de Goimpy de la recette et dépense faites suite à l’occasion de la prise de l’Île St. Eustache, December 6, 1689. 12. Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, 2 vols. (Paris: Société française d’histoire d’Outre-Mer, 1978–84); Mumford, Black Ordeal, 1:159, 180, 186; Mims, Colbert’s, 171; Chauleau, Société, 102. 13. AN Col. C8A 18 F58, Mémoire de Monsieur Gabaret, Lieutenant pour le Roi au gouvernement général des Isles de l’Amérique et gouverneur particulier de la Martinique, June 3, 1711; AN Col. C 8A 17 F123, Vaucresson au Ministre, July 22, 1709; AN Col. C 8A 19 F204, Phélypeaux au Ministre, August 12, 1713. 14. Abénon, Guadeloupe, 1:53; Satineau, Histoire, 90; Bruleaux et al., Deux siècles, 16–19; Gabriel Debien, Plantations et esclaves à Saint-Domingue (Dakar: Publications de la section d’histoire, Université de Dakar [now Université Cheikh Anta Diop], 1969), 49. 15. Jean-Baptiste Bourgeois, Opinion de Jean-Baptiste Bourgeois, habitant planteur de S. Domingue sur les moyens de rétablir les colonies (Paris, 1794), 11. 16. Alex Moreau de Jonnès, Recherches statistiques sur l’esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer (Paris, 1842), 17–29; Curtin, Atlantic, 19. 17. Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa (Washington, D.C.: Howard University Press, 1974), 105; Rodney, West Africa and the Atlantic Slave Trade, 13; K. G. Davies, The Royal African Company (New York: Atheneum, 1970), 300; “Description d’un navire négrier” (pamphlet found among unclassified papers, file 027, at the Bibliothèque des Frères de Saint-Louis de Gonzague, Port-au-Prince, Haiti), n.d., 4–8. 18. Herbert S. Klein, “African Women in the Atlantic Slave Trade,” in Robertson and Klein, Women and Slavery, 32.
19. Ibid., 29–30. 20. Ibid., 30. 21. Davies, Royal African Company, 299; Klein, “African Women,” 117. 22. Colin Palmer, Human Cargoes: The British Slave Trade to Spanish America 1700–1739 (Urbana: University of Illinois Press, 1981), 121–22. 23. Barry Higman, Slave Populations of the British Caribbean 1807–1834 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), 115–16. 24. Joseph E. Inikori, “Introduction,” in Forced Migration: The Impact of the Export Slave Trade on African Societies, ed. Joseph E. Inikori (New York: Africana Publishing Company, 1982), 23. 25. Paul E. Lovejoy, Transformations in Slavery (New York: Cambridge University Press, 1983), 62–63. 26. Curtin, Atlantic, 19; Stein, French Slave Trade, 74, 79–80. 27. David Geggus, “Sex Ratio, Age and Ethnicity in the Atlantic Slave Trade: Data from French Shipping and Plantation Records,” in Journal of African History 30 (1989): 25–26. 28. Philip Curtin, Economic Change in Precolonial Africa (Madison: University of Wisconsin Press, 1975), 155; John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400–1680 (New York: Cambridge University Press, 1992), 107; Lovejoy, Transformations, 159–83; Manning, Slavery and African Life, 142–47; Bernard Moitt, “Slavery and Emancipation in Senegal’s Peanut Basin: The Nineteenth and Twentieth Centuries,” International Journal of African Historical Studies 22, no. 1 (1989): 27–50. 29. Curtin, Atlantic, 169. 30. Labat, Histoire, 1:456; Roget, “Société,” 2:952. 31. Xavier Tanc, De l’esclavage aux colonies françaises et spécialement à la Guadeloupe (Paris, 1832), 14–15. 32. Victor Schoelcher, Des colonies françaises: Abolition immédiate de l’esclavage (1842; reprint, Basse-Terre: Société d’histoire de la Guadeloupe, 1976), 24. 33. Nicole Vanony-Frisch, “Les Esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales, 1770–1789,” Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, nos. 63–64 (1985): 91. 34. Ibid., 3–4, 78. 35. François Girod, Une Fortune coloniale sous l’Ancien Régime: La Famille Hecquet à Saint-Domingue, 1724–1796 (Paris: Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1970), 102–103. 36. Gabriel Debien, “Sucrerie Bréda de la Plaine-du-Nord (1785),” Notes d’histoire coloniale, no. 100 (1966): 26; Debien, Les Esclaves, 67. 37. David Patrick Geggus, Slavery, War and Revolution: The British Occupation of Saint-Domingue, 1793–1798 (London: Oxford University Press, 1982), 243, 291–92; Debien, Les Esclaves, 97. 38. Beckles, Natural Rebels, 19. 39. Michael Craton, Empire, Enslavement and Freedom in the Caribbean (Princeton: Markus Wiener, 1997), 207. 40. Curtin, Atlantic, 19. 3. Women and Labor: Slave Labor 1. Dunn, Sugar and Slaves, 226. 2. Du Tertre, Histoire, 2:488. 3. David Brion Davis, Slavery and Human Progress (New York: Oxford University Press, 1984), 42; Robin Blackburn, The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern 1492–1800 (New York: Verso, 1999), 64–76. 4. Roget, Société, 2:1120. 5. Antoine Métral, Histoire de l’expédition des Français à Saint-Domingue (Paris: Éditions Karthala, 1985), 14. 6. Jean-Baptiste (Père) Labat, Nouveau Voyage aux isles de l’Amérique, 6 vols. (Paris: Guillaume, 1722), 4:177; Lewis, Main Currents, 66. 7. Rose Price, “Pledges on Colonial Slavery, to Candidates for Seats in Parliament, Rightly Considered,” cited in Michael Craton and James Walvin, A Jamaican Plantation: The History of Worthy Park (Toronto: University of Toronto Press, 1970), 191; Stampp, The Peculiar Institution, 7; “Slavery No Oppression or, Some New Arguments and Opinions against the Idea of African Liberty” (London: Lowndes and Christie, n.d.), 12–14 (pamphlet found among unclassified papers, file 027, at the Bibliothèque des Frères de Saint-Louis de Gonzague, Port-au-Prince, Haiti). 8. Du Tertre, Histoire, 2:489. 9. Claire C. Robertson and Martin A. Klein, “Women’s Importance in African Slave Systems,” in Robertson and Klein, Women and Slavery, 3–11; Claude Meillassoux, “Female Slavery,” in Robertson and Klein, Women and Slavery, 49–56; Martin A. Klein, “Women and Slavery in the Western Sudan,” in Robertson and Klein, Women and Slavery, 72–77; Manning, Slavery and African Life, 22. 10. Du Tertre, Histoire, 2:446. 11. Gabriel Debien, “La Société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles: Les Engagés pour les Antilles (1634–1715),” Revue d’histoire des colonies, nos. 1–2 (Paris) (1952): 253. Bangou, La Guadeloupe, 1:56; Moreau de Saint-Méry, Description, 1:55 12. See Noel Deerr, A History of Sugar (London: Chapman and Hull, 1949–50); Chauleau, Société, 147; Labat, Nouveau Voyage, 4:110–13. 13. Higman, Slave Population and Economy, 1. 14. Code Noir, 32; Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire du Canaan (Paris: Presses universitaires de France, 1987), 102–103; Debien, Les Esclaves, 148. 15. Pierre de Vassière, Saint-Domingue: La Société et la vie créole sous l’Ancien Régime, 1629–1789 (Paris: Perrin, 1909), 175. 16. M. Deslandes, “Mémoire de M. Deslandes, faisant fonction d’intendant du 20 février, 1707,” cited in Pierre de Vassière, Saint-Domingue, 166. 17. Ibid. 18. Marcel Reible, “Les Esclaves et leurs travaux sur la sucrerie Lugé à Saint-Domingue, 1788–91,” Notes d’histoire coloniale, no. 173 (1976): 26. 19. Debien, Les Esclaves, 124, 135–36; Antoine Gisler, L’Esclavage aux Antilles françaises XVIe–XIXe siècles (Paris: Karthala, 1981), 35; Jacques Cauna, Au Temps des isles à sucre (Paris: Karthala, 1978), 116; Justin Girod-Chantrans, Voyage d’un Suisse dans différentes colonies d’Amérique (Paris: Neufchâtel, 1785), 130–31; Labat, Nouveau Voyage, 3:210; Du Tertre, Histoire, 2:480. 20. Satineau, Histoire, 130; Debien, Les Esclaves, 124, 135. 21. Dale Tomich, Slavery in the Circuit of Sugar (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990), 141; M. P. Lavollée, Notes sur les cultures et la production de la Martinique et de la Guadeloupe (Paris: Ministère de la Marine et des Colonies, 1841), 43–44. 22. Higman, Slave Populations, 162. 23. Dunn, Sugar and Slaves, 191. 24. Elsa Goveia, Slave Society in the British Leeward Islands at the End of the Eighteenth Century (New Haven: Yale University Press, 1965), 119.
25. Lavollée, Notes sur les Cultures, 47–48; Debien, Les Esclaves, 163; Satineau, Histoire, 132–34. 26. Tomich, Slavery, 142. 27. Debien, Les Esclaves, 137–38. 28. Ibid., 137. 29. Pelleprat, cited in Roget, Société, 2:1120. 30. Labat, Nouveau Voyage, 1:xxvii. 31. Girod-Chantrans, Voyage, 142. 32. Ibid., 130, 139. 33. Ibid., 131. 34. M. Poyen de Sainte-Marie, De l’exploitation des sucreries ou conseil d’un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies (Basse-Terre: Imprimerie de la République, 1792), 14. 35. Debien, “Sucrerie Bréda de la Plaine-du-Nord,” 26–32; Gabriel Debien, “Comptes, profits, esclaves et travaux de deux sucreries de Saint-Domingue, 1774–1778,” Notes d’histoire coloniale (Cairo), no. 6 (1945): 21. 36. Debien, Les Esclaves, 137. 37. Ibid., 138; Moitt, “Behind the Sugar Fortunes,” 412; Cauna, Au Temps des isles, 114. 38. ANSOM, Guadeloupe 107 (749), Bulletin des lois no. 1432, Saint-Claude, November 3, 1847. 39. Ibid. 40. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 87. 41. Michael Craton, Searching for the Invisible Man: Slaves and Plantation Life in Jamaica (Cambridge, Mass.: Harvard University Press), 146. 42. Hilary Beckles, Afro-Caribbean Women and Resistance in Barbados (London: Karnak, 1988), 17. 43. André Lacharière, De l’affranchissement des esclaves dans les colonies françaises (Paris: Eugène Renduel, 1836), 107. 44. Schoelcher, Des colonies françaises, 23–24. 45. Ibid., 23. 46. Debien, Les Esclaves, 158. 47. Debien, “Comptes,” 22. 48. Debien, Les Esclaves, 161. 49. Clive Thomas, Plantations, Peasants and State: A Study of the Mode of Sugar Production in Guyana (Los Angeles: Center for Afro-American Studies, 1984), 8. 50. Bush, Slave Women, 38. 51. Labat, Nouveau Voyage, 3:432. 52. Dunn, Sugar and Slaves, 195. 53. Labat, Nouveau Voyage, 3:175. 54. Tomich, Slavery, 220, 222. 55. Dunn, Sugar and Slaves, 194; Debien, Les Esclaves, 97. 56. Eugène-Edouard Boyer Peyreleau, Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe, 3 vols. (Paris: 1825), 1:281–83; Veront Satchell, “Early Use of Steam Power in the Jamaica Sugar Economy 1768–1810,” Transactions of the Newcomen Society 67 (1995/96): 222–30; Christian Schnakenbourg, Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe: La Crise du système esclavagiste (XIXe-XXe siècles) (Paris: L’Harmattan, 1980), 1:36; Labat, Nouveau Voyage, 3:224; Abénon, Guadeloupe, 2:103; Debien, Les Esclaves, 166. 57. Labat, Nouveau Voyage, 3:202–203. 58. Ibid. 59. Debien, Les Esclaves, 97; Labat, Nouveau Voyage, 3:432.
60. Labat, Nouveau Voyage, 3:206. 61. Ibid., 3:208. 62. Jean-Baptiste Rouvellat de Cussac, Situation des esclaves dans les colonies françaises (Paris: Pagnerre, 1845), 43; Debien, Les Esclaves, 112. 63. Gazette de la Guadeloupe, May 8, 1788, 78; May 22, 1788, 86; June 3, 1788, 110. 64. Labat, Nouveau Voyage, 3:209; Craton, Searching, 203; Matthew Gregory (Monk) Lewis, Journal of a West India Proprietor (London: John Murray, 1834), 86. 65. Gautier, Soeurs de solitude, 200–201. 66. Debien, “Sucrerie,” 36. 67. Labat, Nouveau Voyage, 3:221, 419–20; Victor Schoelcher, Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, 2 vols. (1847; reprint, Pointe-à-Pitre: Émile Désormeaux, 1973), 1:388. 68. See Gabriel Debien, “Destinées d’esclaves à la Martinique (1746–1778).” Bulletin de L’Institut français d’Afrique noire, series B, vol. 22, nos. 1–2 (Jan.–April 1960): 41. 69. Labat, Nouveau Voyage, 3:420. 70. Some estimated that the sale of rum accounted for 10 to 33 percent of a plantation’s revenues. See Robert Louis Stein, The French Sugar Business in the Eighteenth Century (Baton Rouge: Louisiana State University Press), 72. 71. Labat, Nouveau Voyage, 3:415–20. 72. Ibid., 3:442. See also, Debien, Les Esclaves, 184; Bruleaux et al., Deux Siècles, 36. 73. Debien, Les Esclaves, 184; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 5:393: Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, touchant les logements loués aux esclaves, et la vente du vin ou du tafia par les dits esclaves, June 20, 1772; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 6:700; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 5:804: Ordonnance des Administrateurs concernant le débit du tafia, December 10, 1777, and Ordonnance du Juge de Police de Saint-Marc touchant la vente du tafia, June 22, 1785. 74. Code Noir, 40–41; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:68: Ordonnance du Gouverneur de la Martinique, July 13, 1648; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:194: Arrêt du Conseil de la Martinique, April 14, 1670; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 2:70: Règlement du conseil de Léogane qui ordonne de planter des vivres pour la nourriture des Nègres, May 3, 1706; Debien, Les Esclaves, 18; Labat, Nouveau Voyage, 3:211; Labat, Nouveau Voyage, 4:185; Du Tertre, Histoire, 2:481; ANSOM, Guadeloupe 107 (753), July 30, 1818. 75. Debien, Les Esclaves, 179. 76. Rouvellat de Cussac, Situation, 34. 77. Tomich, Slavery, 253. 78. ANSOM, Guadeloupe 107 (753), circular of lieutenant governor, July 30, 1818; Debien, Les Esclaves, 156. 79. Du Tertre, Histoire, 2:481–85; Debien, Les Esclaves, 183. 80. Debien, Les Esclaves, 180; Moreau de Saint-Méry, Description, 1:207; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:180–82; August 1, 1669; Tomich, Slavery, 264; Rouvellat de Cussac, Situation, 15; Robert Olwell, “‘Loose, Idle and Disorderly’ Slave Women in the Eighteenth-Century Charleston Marketplace,” in More than Chattel: Black Women and Slavery in the Americas, ed. David Barry Gaspar and Darlene Clarke Hine (Bloomington: Indiana University Press, 1996), 97–110. 81. Monissey, Slave Women, 60–61. 4. Women and Labor: Domestic Labor 1. Moreau de Saint-Méry, Description, 1:33. 2. Cited in Jerome S. Handler, Frederick W. Lange, and Robert V. Riordan, Plantation Slavery in Barbados: An Archaeological and Historical Investigation (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978), 77. 3. Debien, Plantations, 123. 4. Norrece T. Jones, Jr., Born a Child of Freedom, Yet a Slave: Mechanisms of Control and Strategies of Resistance in Antebellum South Carolina (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1990), 29; Elizabeth Fox-Genovese, Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old South (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1988), 137–45; Pierre de Vassière, Saint-Domingue, 168. 5. Bernard Adolphe Granier de Cassagnac, Voyage aux Antilles françaises, anglaises, danoises, espagnoles; À Saint-Domingue et aux États-Unis d’Amérique, 2 vols. (Paris: Dauvin et Fontaine, 1842–44), 1:114–16. 6. Gazette de la Martinique, August 14, 1805. 7. Debien, Les Esclaves, 87; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 97; Moreau de Saint-Méry, Description, 1:59. 8. Debien, “Comptes,” 21; Debien, Les Esclaves, 137“38; David Geggus, “The Slaves of British-Occupied Saint-Domingue: An Analysis of the Workforces of 197 Absentee Plantations, 1796–1797,” Caribbean Studies 18, nos. 1–2 (April–July 1978): 31. 9. Labat, Nouveau Voyage, 3:416–17; Debien, “Destinées d’esclaves,” 24. 10. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 89–91. 11. Debien, Les Esclaves, 86. 12. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 79, 89. 13. ANSOM, Guadeloupe 107 (749), Ordonnance du Roi qui déclare libres deux cent dixhuit Noirs du Domaine colonial, Saint-Cloud, October 12, 1847. 14. Gautier, Soeurs de solitude, 204. 15. Debien, “Les Esclaves,” 343–47; Debien, Plantations, 50; Vanony-Frisch, Les Esclaves, 62–63. 16. Cauna, Au Temps des isles, 102–104; Frantz Tardo-Dino, Le Collier de servitude (Paris: Éditions caribéennes, 1985), 187; Morrissey, Slave Women, 108. 17. Girod, Une Fortune colonials, 106; Geneviève Leti, Santé et société esclavagiste à la Martinique (1802–1848) (Paris: L’Harmattan, 1998), 307; Debien, Les Esclaves, 103. 18. Gautier, Soeurs de solitude, 209. 19. Ibid., 208. 20. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 89. 21. Gabriel Debien, “Un Colon niortais à Saint-Domingue: Jean Barre de Saint-Venant (1737–1810),” Bulletin de la Société d’histoire de la Martinique, no. 19 (1977): 65. 22. Bush, Slave Women, 36, 141. 23. Richard Sheridan, Doctors and Slaves: A Medical Demographic History of Slavery in the British West Indies 1680–1834 (London: Cambridge University Press, 1985), 77–78. 24. Leti, Santé et société, 307. 25. Debien, “Un Colon niortais,” 67. 26. Labat, Nouveau Voyage, 3:431; Rouvellat de Cussac, Situation, 491. 27. Debien, Plantations, 127. 28. Leti, Santé et société, 318–49. 29. Debien, “Comptes,” 24–25. 30. Debien, Plantations, 126–27. 31. Reible, “Les Esclaves et leurs travaux,” 23; Debien, Plantations, 127. 32. Debien, Plantations, 127. 33. Ibid.
34. Ibid., 128. 35. Reible, “Les Esclaves et leurs travaux,” 23; Félix Patron, Des Noirs et leur situation dans les colonies françaises (Paris, 1831), 6. 36. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 92. 37. Ibid. 38. Gautier, Soeurs de solitude, 207; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 92. 39. Debien, Plantations, 124; Debien, Les Esclaves, 91. 40. Moreau de Saint-Méry, Description, 3:1219. 41. Labat, Nouveau Voyage, 3, 453; Debien, Plantations, 100; Moreau de Saint-Méry, Description, 1:62, 503. 42. See Journal officiel de la Martinique, April 16, 1834, 1; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 94; Gautier, Soeurs de solitude, 207. 43. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 92; Debien, Les Esclaves, 90. 44. Debien, Les Esclaves, 93; Debien, Plantations, 123–25; Debien, “Destinées d’esclaves,” 28. 45. ANSOM, Guadeloupe 107 (749). 46. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 95. 47. Rouvellat de Cussac, Situation, 44. 48. Labat, Nouveau Voyage, 3:446. 49. Debien, Les Esclaves, 24–25. 50. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 97. 51. Debien, Plantations, 124. 52. Debien, Les Esclaves, 124–25. 53. Debien, Plantations, 124. 54. Moreau de Saint-Méry, Description, 77. 55. Debien, “Destinées d’esclaves,” 28. 56. One aune was equivalent to 1.18–1.20 meters in 1840, when this ancient measure was suppressed. 57. Ann Geracimos, “A Mystery in Miniature: An Enigmatic Button Once Decorated the Uniform of Haitian Liberator Toussaint Louverture,” Smithsonian, January 2000, 20–21. 58. Debien, Les Esclaves, 90. 59. Gabriel Debien, Lettres de colons (Dakar: Publications de la Section d’histoire, Université de Dakar [now Université Cheikh Anta Diop], 1965), 57. 60. Debien, Lettres de colons, 69, 73, 167. 61. Ibid., 48. 62. Debien, Les Esclaves, 92. 63. Debien, Plantations, 123; Debien, “Destinées d’esclaves,” 25–31; Jean Fouchard, Les Marrons de la liberté (Paris: Éditions de l’école, 1972), 267. 64. Debien, “Destinée d’esclaves,” 25–26; Higman, Slave Population and Economy, 195. 65. See Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 1–3; Debien, Les Esclaves, 93; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 42; Girod, Une Fortune coloniale, 106; Gautier, Soeurs de solitude, 212–13. 66. Debien, “Destinée d’esclaves,” 26–27. 67. Debien, “Un Colon niortais,” 77. 68. Code Noir, 51. 69. Fouchard, Marrons, 374–75. 70. Gazette de la Martinique, October 7, 1803, 315; Gazette de la Martinique, June 15, 1803, 217; Gazette de la Martinique, September 2, 1806, 341; Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue, April 14, 1792, 574; Fouchard, Marrons, 375.
71. Gazette de la Martinique, June 5, 1804, 573. 72. Gautier, Soeurs de solitude, 205. 73. Labat, Nouveau Voyage, 3:437. 5. Marriage, Family Life, Reproduction, and Assault 1. Victor Schoelcher, De l’abolition de l’esclavage: Examen critique du préjugé contre la couleur des Africains et des sangs-mêlés (Paris: Pagnerre, 1840), 170–71. 2. Du Tertre, Histoire, 2:472. 3. Pierre Paul Castelli, De l’esclavage en général et de l’émancipation des Noirs (Paris, 1844), 128. 4. Dugoujon, Lettres sur l’esclavage dans les colonies françaises (Paris, 1845), 28. 5. Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:118: Règlement de M. de Tracy, lieutenant général de l’Amérique, touchant les blasphémateurs et la police des isles, June 19, 1664. 6. AN Col., C 8A 113 F 145, Saint-Pierre, January 10, 1806. 7. Gisler, L’Esclavage aux Antilles françaises, 179. 8. Code Noir, 34–35. 9. Orlando Patterson, The Sociology of Slavery (London: Granada Publishing, 1973), 159–66; Bush, Slave Women, 86, 98; Beckles, Natural Rebels, 115; Morrissey, Slave Women, 99; Gautier, Soeurs de solitude, 149. 10. AN Col., 113 F 143, “Le préfet colonial de la Martinique et dépandence à M. le curé de la paroisse,” December 27, 1805. 11. ANSOM, Fonds généralités, carton 630, dossier 2736, “Ordonnance du roi,” Paris, June 11, 1839. 12. ANSOM, Fonds généralités, carton 372, dossier 2197, July 18, 1845; ANSOM, Fonds généralités, carton 372, dossier 2197, Paris, November 30, 1847. 13. Moreau de Saint-Méry, Description, 1:57. 14. Lacharière, De l’affranchissement des esclaves, 122. 15. Castelli, De l’esclavage en général, 120. 16. Dugoujon, Lettres, 27. 17. ANSOM, Fonds généralités, carton 372, dossier 2197, February 18, 1846; Abolitionniste français, nos. 1–2 (Jan.–Feb. 1844): 46; Dugoujon, Lettres, 28–29; Labat, Nouveau Voyage, 4:186. 18. Jacques Adélaïde (Jacques Adélaïde-Merlande), “Demography and Names of Slaves of Le Moule, 1845 to May 1848,” Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, no. 22 (1974): 6; Raymond Boutin, “Les Esclaves du Moule au XIXe siècle (naissances, mariages et décès),” Bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe, nos. 75–78 (1988): 23–24. 19. Boutin, “Les Esclaves du Moule,” 23–24. 20. Adélaïde, “Demography and Names,” 67–68. 21. L’Abolitionniste français, nos. 1–2 (Jan.–Feb. 1844): 46; Du Tertre, Histoire, 2:471–72; Peytraud, L’Esclavage, 210–11. 22. Adélaïde, “Demography and Names,” 69–70; Boutin, “Esclaves du Moule,” 24. 23. Baron de Wimpffen, Voyage à Saint-Domingue pendant les années 1788, 1789 et 1790 (Paris, 1797), 33; Adélaïde, “Demography and Names,” 69; Boutin, “Esclaves du Moule,” 24; Patterson, Sociology of Slavery, 154. 24. Bernard David, Origines, 101–105; Notice statistique sur la Guyane française, 55–56. 25. ANSOM, Guadeloupe 107 (749), Ordonnance du Roi qui déclare libres deux cent dixhuit Noirs du Domaine colonial, Saint-Cloud, October 12, 1847. 26. Debien, Les Esclaves, 349.
27. Du Tertre, Histoire, 2:474–75. Du Tertre was referring to the African pagnes, a wrap-around skirt. 28. Du Tertre, Histoire, 2:476; Labat, Nouveau Voyage, 4:161. 29. Dessalles, Histoire, 3:373. 30. Labat, Nouveau Voyage, 4:187. 31. Abdoulaye Bara Diop, La Société wolof (Paris: Karthala, 1981), 47–107. 32. Debien, Les Esclaves, 347; Code Noir, 35–36. 33. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 59. 34. Adélaïde, “Demography and Names,” 69. 35. AN Col., C8 A 66, F 31, De Fénelon to M. le Duc, Fort-Royal, April 11, 1764; Joseph Romalet du Caillaud, Voyage à la Martinique fait en 1770–1773 (Paris, 1804), 113; Girod-Chantrans, Voyage, 145; Félix Patron, Des Noirs, 17. 36. Debien, Les Esclaves, 349. 37. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 68–70. 38. Debien, “La Sucrerie Bréda,” 34. 39. Debien, Les Esclaves, 347. 40. Ibid., 344–45; Gabriel Debien, Les Colons des Antilles et leur main d’oeuvre à la fin du XVIIIe siécle (Paris: Annales historiques de la Révolution française, 1955), 265; Bruleaux et al., Deux Siècles, 123. 41. ANSOM, Fonds généralités, carton 630, dossier 2736, June 1843; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 65; Debien, Les Colons, 265; Boutin, “Les Esclaves du Moule,” 19–21. 42. ANSOM, Martinique 33 281, “Note sur l’habitation de Hautmont, sise au quartier du Marigot, île de la Martinique,” undated. 43. ANSOM, C 8A 66, F31, Fort Royal, April 11, 1764. 44. Romalet, Voyage à la Martinique, 113; Boutin, “Esclaves du Moule,” 21–23. 45. Debien, Les Esclaves, 350. 46. Michael Craton and James Walvin, A Jamaican Plantation: The History of Worthy Park (Toronto: University of Toronto Press, 1970), 140; Craton, Searching for the Invisible Man, 88; Higman, Slave Populations, 349–50. 47. Debien, Les Esclaves, 130; Cauna, Au Temps des isles à sucre, 99; Stein, The French Sugar Business, 54. 48. Cauna, Au Temps des isles à sucre, 99. 49. Debien, Les Esclaves, 129–30; Debien, Plantations, 130. 50. Debien, Les Colons, 270. 51. Dazille, Observations sur le tétanos (Paris: Planche, 1788), 342–43. 52. Ibid. 53. Ibid., 56 54. Debien, Les Esclaves, 355. 55. Ibid., 130; Pierre de Vassière, Saint-Domingue, 253. 56. Romalet, Voyage, 114–15. 57. Dazille, Observations sur les maladies des nègres, leurs causes, leurs traitements et les moyens de les prévenir (Paris: Didot, 1776), 120, 225–26, 231, 274–75. 58. Dazille, Observations sur le tétanos, 212–14, 315–22. 59. Morrissey, Slave Women, 107–108. 60. Kenneth F. Kiple, The Caribbean Slave: A Biological History (London: Cambridge University Press, 1984), 120. 61. For an edited version of Thistlewood’s diary, see Douglas Hall, In Miserable Slavery: Thomas Thistlewood in Jamaica, 1750–1786 (London: Macmillan, 1989). See also Bernard Moitt, “In the Shadow of the Plantation: Women of Color and the Libres de Fait of Martinique and Guadeloupe” (unpublished paper). 62. Debien, Plantations, 30. 63. Debien, Les Esclaves, 126–27, 131. 64. Debien, Les Esclaves, 127–29. 6. Discipline and Physical Abuse: Slave Women and the Law 1. Beckles, Natural Rebels, 31. 2. Peytraud, L’Esclavage, 28. 3. Gisler, L’Esclavage aux Antilles françaises, 41–42; C. L. R. James, The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution (New York: Vintage, 1989), 9–10; Fouchard, Les Marrons de la liberté, 111; M. France, La Vérité et les faits ou l’esclavage à nu (Paris: Moreau, 1846), 7. 4. Gisler, L’Esclavage, 41; Code Noir, 45–49. 5. Bruleaux et al., Deux Siècles, 169. 6. Tomich, Slavery, 242. 7. Schoelcher, Colonies, 89. 8. ANSOM, Guyane 107 K7 (07), Procureur Général to Governor, May 19, 1842. 9. ANSOM, Fonds généralités, carton 192, dossier 1476, Rapport à M. le Ministre de la Marine et des Colonies, sur un projet d’ordonnance du roi, relative à l’emprisonnement disciplinaire des esclaves, June 29, 1841; ANSOM, Fonds généralités, carton 207, dossier 1514, September 16, 1841. 10. Bernard Moitt, “Transcending Linguistic and Cultural Frontiers in Caribbean Historiography: C. L. R. James, French Sources, and Slavery in San Domingo, in C. L. R. James: His Intellectual Legacies, ed. Selwyn R. Cudjoe and William E. Cain, 136–60 (Amherst: University of Massachusetts Press, 1995); Code Noir, 35, 41–44, 49; Sala-Molins, Le Code Noir, 142–43; Elsa Goveia, The West Indian Slave Laws of the Eighteenth Century (Bridgetown: Caribbean Universities Press, 1970), 38. 11. De Vassière, Saint-Domingue, 86. 12. AN Col., F3 90 41, March 13, 1788. See also James, Black Jacobins, 23; Carolyn Fick, The Making of Haiti: The Saint-Domingue Revolution from Below (Knoxville: University of Tennessee Press, 1990), 37–38; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions 3:674–75: Lettre à MM de Larnage et Maillart sur les mauvais traitements des maîtres pour leurs esclaves, July 15, 1741; Gisler, L’Esclavage, 108. 13. Peytraud, L’Esclavage, 328–29. 14. AN Col., F3, Fol. 149, Cayenne, June 16, 1760; Peytraud, L’Esclavage, 332. 15. AN Col., F3, Fol. 225, 1771; Gautier, Soeurs de solitude, 159. 16. AN Col. F3 90 41, March 13, 1788, Vincent de Marbois, Procureur du roi, au Ministre; James, Black Jacobins, 23; Fick, Making of Haiti, 37–38; Gisler, L’Esclavage, 119–20. 17. ANSOM, Guadeloupe 107 (748), February 15, 1827; ANSOM, Guadeloupe 107 (748), Paris, 1827; ANSOM, Guadeloupe 107 (748), Paris, December 25, 1827. 18. ANSOM, Guadeloupe 107 (748), Basse-Terre, February 6, 1828; ANSOM, Guadeloupe 107 (748), Paris, December 25, 1827; ANSOM, Guadeloupe 107 (748), Arrêt criminel, January 9, 1829. 19. Josette Fallope, Esclaves et citoyens: Les Noirs à la Guadeloupe au XIXe siècle dans les processus de résistance et d’intégration (1802–1910) (Basse-Terre: Société d’histoire de la Guadeloupe, 1992), 247–49; 286; Tomich, Slavery, 53–75; Schnakenbourg, Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe, 1:118–36.
20. Fallope, Esclaves et citoyens, 248; Gisler, L’Esclavage, 145–46; Gaston-Martin, Histoire, 272–79, 292. 21. David Northrup, Indentured Labor in the Age of Imperialism, 1834–1922 (New York: Cambridge University Press, 1995), 34; Tomich, Slavery, 62–64; Gaston-Martin, Histoire 264–71, 281–83; Fallope, Esclaves et citoyens, 248. 22. ANSOM, Fonds généralités, carton 192, dossier 1476, February 26, 1841. 23. ANSOM, Fonds généralités, carton 207, dossier 1514, November 12, 1841. 24. Gisler, L’Esclavage, 140. 25. Schoelcher, Colonies françaises, 90. 26. ANSOM, Guyane 107 K7 (7), Châtiments infligés à la née Marie-Claire de l’habitation Mondelice (Affaire Reine), 1840–1841; Arrêt rendu pour la chambre des mises en accusation de la Cour Royale de la Guyane française, séance à Cayenne, October 29, 1840; ANSOM, Guyane 107 K7 (7), Correspondence of Vidal de Lingendes, Cayenne, December 26, 1840. 27. ANSOM, Guyane 107, K 7 (7); “Châtiments infligés à la née Marie-Claire de l’habitation Mondelice (Affaire Reine), 1840–1841; ANSOM, Guyane, 107 K 7, December 26, 1840; ANSOM, Guyane 107, K 7 (7), Fort-Royal, February 19, 1841; ANSOM, Guyane 107 K 7 (7), Governor to Ministre de la Marine et des Colonies, Cayenne, November 16, 1840. 28. ANSOM, Guyane 107 K 7 (7); Arrêt qui déclare qu’il n’y a lieu à suivre [contre] le sieur Reine, Cayenne, November 3, 1840. A lieue was not a standard measurement, but appears to have been no less than 4,445 meters. 29. ANSOM, Guyane 107 K7 (7), Ministre de la Justice, Paris, December 14, 1841. 30. ANSOM, Guyane 107 K7, Procureur Général to Governor, May 19, 1842. 31. ANSOM, Martinique 33, 286, Fort-Royal, Governor to Minister, October 18, 1845. 32. ANSOM, Martinique 33 286, Governor to Minister, Fort-Royal, October 18, 1845. 33. ANSOM, Martinique 33, 286, November 13, 1845. 34. Gazette des Tribunaux, February 4, 1846, 330, found in ANSOM, Martinique 33, 286. 35. ANSOM, Martinique 33, 286, August 23, 1845, Copie d’une lettre adressée à M. le Procureur Général par le Procureur du Roi de Saint-Pierre, sous date du 23 août, 1845; ANSOM, Fonds généralités, carton 33, dossier 286, Fort Royal, November 13, 1848. 36. Gazette des Tribunaux, February 4, 1846, 330. 37. ANSOM, Martinique 33 286, Procureur du Roi of Saint-Pierre to Procureur Général, August 23, 1845. 38. ANSOM, Martinique 33, 286, Governor to Minister, Fort-Royal, January 10, 1846; Gisler, L’Esclavage, 50; Gazette des Tribunaux, February 4, 1846, 330. 39. Philip Schwarz, Slave Laws in Virginia (Athens: University of Georgia Press, 1999), 80–81. 40. France, La Vérité, 101. 41. Ibid., 166–67, 171–72. 42. ANSOM, Martinique 33, 285, Saint-Pierre, January 26, 1846. 43. Ibid. 44. Ibid. 45. Schoelcher, L’Histoire de l’esclavage, 1:326. 46. Ibid., 1:361–62. 47. Ibid., 1:387–88. 48. ANSOM, Guyane 107 K7 (16), Extrait du registre des procès-verbaux de délibérations du Conseil privé de la Guyane française, December 1847. 49. ANSOM, Guyane 107 k7 (15), Governor to Minister of Marine and Colonies, Cayenne, March 25, 1846; ANSOM, Guyane 107 K7 (15), March 23, 1846. 50. ANSOM, Martinique 42, 346 (1828–1847), Déportation des esclaves à Porto-Rico, Paris, February 28, 1828; Gaspar, Bondmen and Rebels, 35–37; Schwarz, Slave Laws of Virginia, 107. 51. ANSOM, Martinique 42, 346, Déportation des esclaves à Porto-Rico [sic], Paris. February 28, 1828; ANSOM, Martinique 42 348, Extrait du procès-verbal du Conseil privé, July 9, 1827. 52. Schwarz, Slave Laws of Virginia, 102. 53. ANSOM, Martinique 42, 346, Paris, February 28, 1828; ANSOM, Martinique 42, 348, Extrait du procès-verbal du Conseil privé, August 8, 1827; ANSOM, Martinique 42, 348, June 20, 1827; ANSOM, Martinique 42, 348, June 22, 1827; ANSOM, Martinique 42, 346, (no day or month), 1829. 54. ANSOM, Martinique 42, 350, Extrait du registre des procès-verbaux, 1838. 55. ANSOM, Fonds généralités, carton 631, dossier 2739, Rapport à son Excellence M. le Gouverneur pour le roi, December 24, 1828; ANSOM, Fonds généralités, carton 631, dossier 2739, Extrait du registre du Conseil privé, Guadeloupe, August 18, 1837; ANSOM, Fonds généralités, carton 192, dossier 1478, Ordonnance du roi concernant le régime disciplinaire des esclaves, Neuilly, June 4, 1846, 18. 56. AN Col., C 8A 36, F204, September 17, 1726; ANSOM, Fonds généralités, carton 192, dossier 1476, Circulaire relative au séjour des esclaves détenus dans les geôles et prisons, Pointeà-Pitre, December 30, 1819. 57. ANSOM, Fonds généralités, carton 630, dossier 2736, Extrait du registre des procèsverbaux de délibérations du Conseil privé de la Martinique, September 1828. 58. ANSOM, Fonds généralités, carton 630, dossier 2736, Extrait du registre des procèsverbaux des délibérations du Conseil privé de la Guadeloupe et dépendances, June 26, 1832. 59. A D-M, Martinique, Série U, Arrêts correctionnels (1832–1833); Police correctionnelle, audience publique du 5 mars, 1832. 60. Gilbert Pago, Les Femmes et la liquidation du système esclavagiste à la Martinique, 1848–1852 (Pointe-à-Pitre: Ibis Rouge Editions, 1998), 46. 7. Women and Resistance 1. A version of this chapter was published as “Slave Women and Resistance in the French Caribbean,” in More Than Chattel: Black Women and Slavery in the Americas, ed. David Barry Gaspar and Darlene Clark Hine (Bloomington: Indiana University Press, 1996), 239–258. I thank Indiana University Press for permission to use it here. 2. Simone Schwarz-Bart, The Bridge of Beyond, trans. Barbara Bray (Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1982). 3. Jacques Roumain, Masters of the Dew, trans. Langston Hughes and Mercer Cook (Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1947). 4. Aimé Césaire, The Tragedy of King Christophe, trans. Ralph Manheim (New York: Grove Press, 1969). 5. Antoine Métral, Histoire de l’insurrection des esclaves dans le nord de Saint-Domingue (Paris: F. Sceref, 1818), 60. 6. Jacques Adélaïde-Merlande, Delgrès ou la Guadeloupe en 1802 (Paris: Éditions Karthala, 1986) 5–10; André Nègre, La Rébellion de la Guadeloupe, 1801–1802 (Paris: Éditions caribéennes, 1987) 12–13. 7. Adélaïde-Merlande, Delgrès, 7. 8. Nègre, Rébellion, 114. 9. Oruno Lara, La Guadeloupe dans l’histoire (Paris: L’Harmattan, 1979), 126. 10. James, Black Jacobins, 315. 11. Métral, Histoire, 77.
12. Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 4 vols. (Basse-Terre: Éditions de diffusion de la culture antillaise, 1976), 3:311. 13. Lara, La Guadeloupe dans l’histoire, 138. 14. Métral, Histoire, 151. 15. Lacour, Histoire, 3:271. 16. Ibid., 3:275. 17. Ibid. 18. James, Black Jacobins, 361. See also Métral, Histoire, 180. 19. Métral, Histoire, 180. 20. Ibid., 43. 21. Ibid., 180. 22. Lacour, Histoire, 3:275. 23. Ibid., 3:291. 24. Martineau and May, Trois Siècles d’histoire antillaise, 218; Adélaïde-Merlande, Delgrès, 147. 25. Lacour, Histoire, 3:331. 26. Lara, Guadeloupe, 154. 27. Adélaïde-Merlande, Delgrès, 149; Lacour, Histoire, 3:325–54; Martineau and May, Trois Siècles, 218. 28. Lacour, Histoire, 3:311; Adélaïde-Merlande, Delgrès, 152; Gautier, Soeurs de solitude, 251. 29. Lacour, Histoire, 3:398–99; Lara, Guadeloupe, 174; Nègre, La Rébellion, 150–51. 30. ANSOM, Martinique 18, 162, Cour Royale de la Martinique: Acte d’accusation, April 5, 1831; ANSOM, Martinique 18, 161, Extrait du registre des procès verbaux, May 19, 1831; Maurice Nicolas, L’Affaire de la Grand’Anse (Fort-de-France: Théodore Marchand, 1960), 18–19. 31. ANSOM, Martinique 18, 159, Extrait du registre des procès verbaux des délibérations du Conseil privé de la Martinique, February 10, 1831; ANSOM, Martinique 18, 159, Extrait du registre des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé de la Martinique, May 19, 1831; Havre, April 8, 1831, 2; Havre, April 18, 1831, 3. See also Armand Nicolas, Histoire de la Martinique, 2 vols. (Paris: L’Harmattan, 1996), 1:343–48. 32. ANSOM, Martinique 18, 162, Cour Royale de la Martinique, April 5, 1831. 33. ANSOM, Martinique 18, 162, Governor to Minister, Fort-Royal, May 21, 1831. 34. Havre, July 18, 1831, 3; Le Courrier français, April 22, 1831, 3. 35. ANSOM, Martinique 8, 622, Copie d’une pétition faite à l’assemblée par M. Lalaurette de la Martinique au sujet des ses pertes lors des troubles du Prêcheur, Saint-Pierre, 1848; Bernard David, Les Origines de la population martiniquaise au fil des ans 1635–1902 (Fort-de-France: Société d’histoire de la Martinique, 1973), 105. 36. See Pierre Dessalles, La Vie d’un colon à la Martinique au XIXe siècle, 4 vols. (1986), 4:41–42; Armand Nicolas, La Révolution anti-esclavagiste de mai 1848 à la Martinique (Fort-de-France: 1967), 25–26. 37. Malenfant, Des colonies et particulièrement de Saint-Domingue (Paris, 1814), cited in Métral, Histoire, 40. 38. Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 134–35; Gaspar, Bondmen and Rebels, 181; Higman, Slave Populations of the British Caribbean, 389; Patterson, Sociology of Slavery, 260; Michael Craton, Testing the Chains: Resistance to Slavery in the British West Indies (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982), 61; Gautier, Soeurs de solitude, 236. 39. Meillassoux, “Female Slavery,” 49–65; Fatou Sow, “Femme africaine, emploi et division internationale du travail,” Présence africaine (Paris), no. 141 (1987): 199–205. 40. Gautier, Soeurs de solitude, 237; Patterson, Slavery and Social Death, 113; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 135; Fouchard, Marrons, 285.
41. Gazette de la Guadeloupe, December 4, 1788, 195; Gazette de la Martinique, October 28, 1803, 339; Gazette de la Martinique, September 4, 1804, 680. 42. Gazette de la Guadeloupe, December 4, 1788, 195; Gazette de la Martinique, October 28, 1803, 339; October 8, 1805, 194; November 1, 1805, 525; January 8, 1806, 44; March 19, 1806, 132; December 27, 1806, 472. 43. Joseph France, La Vérité et les faits ou l’esclavage à nu dans ses rapports avec les maîtres et les agents de l’autorité (Paris: Moreau, 1846), 98–99; Gautier, Soeurs de solitude, 159. 44. Bruleaux et al., Deux siècles, 91; Vanony-Frisch, “Les Esclaves,” 133–36; Gautier, Soeurs de solitude, 229–37; Gazette de la Guadeloupe, September 25, 1788, 162; July 31, 1817, 4; January 5, 1826, 1; Gazette de la Martinique, March 12, 1803, 73; May 17, 1806, 213; August 13, 1809, 322. 45. Gazette de la Martinique, August 2, 1803, 236; July 10, 1804, 611; June 26, 1805, 322; Gazette de la Guadeloupe, August 10, 1810, 6. 46. Fouchard, Marrons, 289; Gautier, Soeurs de solitude, 228–30; Gazette de la Martinique, July 15, 1803, 217; November 8, 1805, 536; May 10, 1806, 200; September 6, 1806, 374. 47. Du Tertre, Histoire, 3:179; Gabriel Debien, “Le Marronage aux Antilles françaises au XVIIIe siècle,” Caribbean Studies 6, no. 1 (1966): 4; Léo Elisabeth, “Résistance des esclaves aux XVIIe et XVIII siècles dans les colonies françaises d’Amérique, principalement aux Iles du vent,” in Les Abolitions de l’esclavage de L. F. Sonthonax à V. Schoelcher 1793, 1848, ed. Marcel Dorigny (Paris: UNESCO, 1995), 78; ANSOM, Fonds généralités, carton 631, dossier 2737, November 23, 1821; ANSOM, Fonds généralites, carton 631, dossier 2737, Circulaire, Basse-Terre, December 8, 1821; Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions, 1:136: Arrêt du consul de la Martinique touchant les nègres marrons, March 2, 1665. 48. Fouchard, Marrons, 550. 49. ANSOM, Guyane 129, P2 (08), Commandeur et administrateur de la Guyane française, September 2, 1822; ANSOM, Fonds généralités, carton 630, dossier 2737, n.d. 50. Code Noir, 47. 51. Fouchard, Marrons, 409; Gautier, Soeurs de solitude, 237; Gaspar, Bondmen and Rebels, 155; Gazette de la Martinique, July 5, 1803, 40. 52. AN Col., C 8A 33, F276, October 8, 1724; AN Col., C 8A 34, F89, June 18, 1725; Abénon, Guadeloupe, 2:66–67. 53. ANSOM, Martinique 33, 281, “Arrêt du Conseil supérieur de l’isle Martinique,” Fort-Royal, November 30, 1815. 54. Tanc, De l’esclavage aux colonies, 39. 55. ANSOM, Guyane 107, K7 (03), July 14, 1827. 56. See, for example, Lacour, Histoire, 3:120. 57. Gwendolyn Mildo Hall, Social Control in Slave Plantation Societies: A Comparison of Saint-Domingue and Cuba (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971), 69. 58. Lacour, Histoire, 3:120; Satineau, Histoire, 285; Debien, Plantations, 56, 61; Labat, Nouveau voyage, 4:198, 307. 59. Satineau, Histoire, 289. 60. Tardo-Dino, Le Collier de servitude, 234. 61. AN Col., C 8A 18 F297, May 24, 1712. 62. Abénon, Guadeloupe, 1:256. 63. Yvan Debbasch, Le Crime d’empoisonnement aux îles pendant la période esclavagiste,” Revue française d’histoire d’outre-mer 50 (1963): 146–47. 64. Satineau, Histoire, 289, cited in David, Les Origines, 82. 65. Satineau, Histoire, 289; Gabriel Debien, Les Esclaves, 400. 66. Satineau, Histoire, 289–90; Debien, Les Esclaves, 400; David, Les Origines, 82; AN Col., F3 88 210, “Mémoire sur les poisons qui règnent à St. Domingue,” 1762; AN Col., F3 88 210, “Observations sur l’ordonnance de MM. de Reynaud et de Brasseur, concernant les poisons.” 1780; ANSOM, Guyane 129 P2 (20), “Ordonnance contre l’empoisonnement des rivières,” March 5, 1818. 67. Cited in Abénon, Guadeloupe, 1:255 68. Debien, Les Esclaves, 401; Debbasch, “Le Crime d’empoisonnement,” 150. 69. Debien, Les Esclaves, 400–401. 70. Debien, Les Esclaves, 405, 408; Debien, Plantations, 63, 67. 71. Debbasch, “Le Crime d’empoisonnement,” 141–52; Poyen de Sainte-Méry, De l’exploitation des sucreries, 22. 72. David, Les Origines, 96. 73. AN Col., C 8A 18 F297, May 24, 1712; C 8A 32 F266, November 17, 1723; C 8A 36 F204, September 17, 1726. 74. Debien, Les Esclaves, 408. 75. Labat, Nouveau Voyage, 3:446–47. 76. Lacour, Histoire, 3:339–404; Adélaïde-Merlande, Delgrès, 162; Lara, Histoire, 170–72. 77. Métral, Histoire, 75. 78. AN Col., C 8A 18 F297, May 24, 1712; C 8A 112 F210, June 9, 1806; C 8A 114 F176, June 10, 1806. 79. ANSOM, Martinique 42 348, Report of the Directeur Général de l’Intérieur, August 4, 1827; ANSOM, Martinique 42 348, Directeur Général de l’Interieur to governor, Fort-Royal, June 22, 1827. 80. ANSOM, Guyane 129 P2 (11), Extrait du registre des procès-verbaux des délibérations du conseil privé de la Guyane française, July 14, 1831. 81. ANSOM, Guyane 129 P2 (11), Extrait du registre, July 14, 1831. 82. Unidentified and undated newspaper clipping (Cour d’Assises de Cayenne) found in ANSOM, Guyane 107 K7 (7), 1843; ANSOM, Guyane 107 K7 (11), Cour d’Assises de la Guyane française—Traitements barbares et inhumains exercés par un régisseur sur la personne de plusieurs esclaves, November 23, 1843. 83. AN Col., C8 A 18 F364, September 3, 1712; ANSOM, Guyane 107 K7 (15) Affaire Paguenaut, March 167, 1848; Tanc, De l’esclavage, 5–6. 84. Gabriel Debien and Françoise Thésée, Un Colon niortais à Saint-Domingue (Niort: Imbert-Nicolas, 1975), 123. 85. Ibid. 86. Gabriel Debien, “A Saint-Domingue avec deux jeunes économes de plantation, 1774–1788,” Notes d’histoire coloniale, no. 7 (1945): 3–19. 87. ANSOM, Fonds généralités, carton 207, dossier 1517, Extrait du registre de punitions infligées aux détenus du dit atelier pendant le mois de Janvier. 1848, January 27, 1848; Debien, Les Esclaves, 182. 88. ANSOM, Fonds généralités, carton 207, dossier 1516 (undated). 89. ANSOM, Guyane 107 K7 (7), Cayenne, June 12, 1843; ANSOM, Guyane 107 K7 (10), Cayenne, September 9, 1843; ANSOM, Guyane 107 K7 (10), January 16, 1844. 90. Yvan Debbasch, “Les Associations serviles à la Martinique au XIXe siècle,” in Études d’histoire du droit privé, ed. Pierre Petot (Paris: Éditions Montchrestien, 1959), 124; Jacques Adélaïde-Merlande, “Problématique d’une histoire de l’esclavage urbain: Guadeloupe, Guyane, Martinique (vers 1815–1848),” Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, nos. 65–66, 3–4 trimester (1985): 19–20. 91. Gautier, Soeurs de solitude, 223–24. 92. Bruleaux et al., Deux siècles, 185–86. 93. Debbasch, “Associations,” 125.
8. Women and Manumission 1. Ivan Debbasch, Couleur et liberté: Le Jeu de critère ethnique dans un ordre juridique esclavagiste, 2 vols. (Paris: Dalloz, 1967), 1:22–27. 2. Code Noir, 33–34, 51, 55. 3. See Baude, “L’Affranchissement,” 19–23; Debien, Les Esclaves, 377; Dessalles, Histoire, 3:416. 4. AN Col., C 8A 19 F80, Phélypeaux to Minister, April 6, 1713; AN Col., C 8A 20 F63, September 10, 1714; Mumford, Black Ordeal, 3:739–40; Léo Elisabeth, “Europe, Afrique, Nouveau Monde: Femmes d’antan aux origines de la femme créole,” Bulletin de la Société de la Martinique, no. 27 (1988–91), 81; Peytraud, L’Esclavage, 420; Edward Cox, Free Coloreds in the Slave Societies of St. Kitts and Grenada (Knoxville: University of Tennessee Press, 1984), 21. 5. AN Col., C 8A 18, F18, June 3, 1711; ANSOM, Fonds généralités, carton 666, dossier 2845, July 12, 1832; Bulletin des Actes Administratifs de la Martinique, 1st ser., vol. 4 (1832): 95. 6. Durand-Molard, ed., Code de la Martinique, 5 vols. (St. Pierre, 1807), 2:557. 7. Durand-Molard, Code de la Martinique, 2:558–59; Gazette officielle de la Martinique, July 5, 1803, 88. 8. Durand-Molard, Code de la Martinique, vol. 4, Ordonnance de MM. le Général et Intendant concernant les soit-disant libres et les libertés non-registrées, September 10, 1789; Géraud Lafleur, Saint-Claude: Histoire d’une commune de Guadeloupe (Paris: Karthala, 1993), 80. 9. Gazette de la Martinique, March 26, 1803, 91–93; “Arrêté qui donne la vérification des titres dont se trouvent porteurs les gens de couleur libres du 15 mars, 1803”; Bulletin des actes administratifs de la Martinique, 4 vols. (Saint-Pierre, 1829–32) 1st ser., vol. 4 (1832): 94–96. 10. ANSOM, Fonds généralités, carton 372, dossier 2191, 1847, 7. See also Augustin Cochin, L’Abolition de l’esclavage (1861; reprint, Fort-de-France: Désormeaux, 1979), 41. 11. Dessalles, Histoire, 5:39; Baude, L’Affranchissement, 94. 12. Fallope, Esclaves, 298. 13. Gazette de la Guadeloupe, July 20, 1832, 1; Peytraud, L’Esclavage, 418; Gautier, Soeurs de solitude, 170. 14. Lafleur, Saint-Claude, 75. 15. Ibid., 79. 16. Gautier, Soeurs de solitude, 175–77; Debien, Les Esclaves, 376–77. 17. John Garrigus, “Blue and Brown: Contraband Indigo and the Rise of a Free Colored Planter Class in French Saint-Domingue,” The Americas 50, no. 2 (October 1993): 257. 18. Debien, Les Colons, 275; Schoelcher, Colonies, 10; Josette Fallope, “Les Affranchissements d’esclaves à la Guadeloupe entre 1815 et 1848,” Annales de l’Université d’Abidjan, 1st ser., vol. 6 (1978): 10. 19. Debien, Les Esclaves, 385–86. 20. Ibid., 383. 21. Fallope, “Les Affranchissements,” 12–13. 22. Bulletin des actes administratifs de la Martinique, 1st ser., vol. 4 (1832): 137–50; Fallope, Esclaves, 290; Schoelcher, Colonies, 305–307. 23. Fallope, Esclaves, 296; Schoelcher, Colonies, 308; Moreau de Jonnès, Recherches, 17–22; Curtin, Atlantic, 78. 24. Journal officiel de la Martinique, April 19, 1834, 1; Gazette officielle de la Guadeloupe, January 5, 1832, 2; Notice statistique sur la Guyane française, 55–56; Moitt, “In the Shadow of the Plantation.” 25. Schoelcher, Histoire, 2:43.
26. Ibid., 2:46–52; L’Abolitionniste français, nos. 10–12 (October–December 1845): 649–52. 27. Ibid., 651; Gautier, Soeurs de solitude, 147. 28. Schoelcher, Histoire, 2:55–62. 29. Journal officiel de la Martinique, April 8, 1848, 1; Rouvellat de Cussac, Situation, 148–49; Victor Schoelcher, Les Magistrats des colonies depuis l’ordonnance du 18 juillet 1841 par Maxmillen Just (Paris: Pagnerre, 1847), 5–72. 30. ANSOM, Fonds généralités, carton 40, dossier 316, “Rapports, débats, correspondances diverses concernant les lois des 18 et 19 juillet, 1845, Paris, July 18, 1845; Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 1. 31. See “Compte rendu des lois des 18 et 19 juillet, 1845 sur le régime des esclaves, la création d’établissements agricoles par le travail libre,” Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 1; Journal officiel de la Martinique, May 15, 1847, 1; Journal officiel de la Martinique, May 12, 1847, 1; Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 1; Fallope, Esclaves, 292; Schoelcher, Histoire, 2:19–26. 32. Schoelcher, Histoire, 2:19. 33. ANSOM, Fonds généralités, carton 40, dossier 316, July 19, 1845; Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 2; Fallope, Esclaves, 293. 34. Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 2; Fallope, Esclaves, 293. 35. Journal officiel de la Martinique, February 9, 1848, 1; Journal officiel de la Martinique, April 14, 1847, 1; Journal officiel de la Martinique, March 6, 1847, 2; Fallope, Esclaves, 293; Baude, L’Affranchissement, 96. 36. Journal officiel de la Martinique, June 19, 1847, 2. 37. Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 1; Tomich, Slavery, 83. 38. Journal officiel de la Martinique, May 26, 1847, 3. 39. ANSOM, Fonds généralités, carton 372, dossier 2197, 1848, 4–16. Conclusion 1. Stampp, The Peculiar Institution, 34. 2. Jacqueline Jones, Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women, Work and the Family, from Slavery to the Present (New York: Vintage, 1986), 14. 3. Hilary Beckles, Centering Woman: Gender Discourses in Caribbean Slave Society (Princeton: Markus Wiener, 1999), 179. 4. Jones, Born a Child of Freedom, 11–36.
Bibliography PRIMARY SOURCES Barrey, M. Phillipe. Les Origines de la colonisation française aux Antilles. Le Havre: H. Micaux, 1918. Baude, Pierre. L’Affranchissement des esclaves aux Antilles françaises: Principalement à la Martinique du début de la colonisation à 1848. Fort-de-France (Martinique): Impr. du gouvernement, 1948. ______“Résistance des esclaves aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les colonies françaises d’Amérique, principalement aux Iles du vent.” In Les Abolitions de l’esclavage de L. F. Sonthonax à V. Schoelcher 1793, 1848, ed. Marcel Dorigny. Paris: UNESCO, 1995. Gaston-Martin. Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises. Paris: Presses universitaires de France, 1948. Girod, François. Une Fortune coloniale sous l’Ancien Régime: La Famille Hecquet à Saint-Domingue, 1724–1796. Paris: Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1970. Tanc, Xavier. De l’esclavage aux colonies françaises et spécialement à la Guadeloupe. Paris, 1832. BERNARD MOITT is an associate professor in the History Department at Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia. Previously, he taught at the University of Toronto and at Utica College of Syracuse University. Educated in Antigua (where he was born) and in Canada and the United States, he has published numerous articles and book chapters on aspects of francophone African and Caribbean history, with particular emphasis on gender and slavery.
|
|
The Haitian Revolution (1791-1804): A Different Route to Emancipation Copyright 2003 Prof. Jeremy Popkin, University of Kentucky (email: popkin@uky.edu)
Not for citation without permission (…) Even though France’s colonies looked small on the map, the three Caribbean colonies of Saint Domingue (today’s Republic of Haiti), Guadeloupe and Martinique contained almost as many slaves as the thirteen much larger American states (about 700,000). Saint Domingue was the richest European colony in the world. It was the main source of the sugar and coffee that had become indispensable to “civilized” life in Europe. (…) In October 1790, a free colored leader, Vincent Ogé, returned to Saint Domingue from France and led an armed uprising. He did not try to gain support among the slaves, and his movement was quickly crushed by the trained white troops on the island. Ogé and his followers were executed in a particularly cruel manner. When news of the executions reached France, the National Assembly blamed the colonists for their severity and passed a decree granting rights to a minority of the free colored population. The revolutionaries were beginning to move away from unswerving support for the whites in the colonies. (…)
Bibliography David Brion Davis, The Problem of Slavery in the Age of Revolution. A general history of early movements for abolition throughout the western world. Robin Blackburn. The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848. A general history of the events that led to emancipation in the New World (outside the US), emphasizing economic factors. C. L. R. James, The Black Jacobins. The best-known history of the Haitian Revolution in English, first published in 1938. James sees the Haitian Revolution as a black version of the revolution in France. Thomas Ott, The Haitian Revolution, 1789-1804. Ott’s account is especially strong on the military and diplomatic aspects of the Haitian Revolution. Carolyn Fick, The Making of Haiti: The Haitian Revolution from Below. The most recent study of the Haitian Revolution in English, Fick’s book stresses the role of the ordinary slaves in the movement’s success. David Geggus, Haitian Revolutionary Studies. Geggus is the leading historian of the Haitian Revolution in the United States today. This recently published volume includes essays on a number of aspects of the movement. John D. Garrigus, “White Jacobins/Black Jacobins: Bringing the Haitian and French Revolutions Together in the Classroom”. French Historical Studies 23 (2000), 259-75. An excellent bibliography of recent publications about the Haitian Revolution. Althea de Puech Parham, ed., My Odyssey: The first person account of a young white man from France who fought against the slave revolt. He gives some interesting descriptions of the black fighters. Madison Smartt Bell, All Souls’ Rising and Master of the Crossroads: a novel series by a contemporary American author that gives a dramatic and fairly accurate picture of the Haitian Revolution. Bell plans a third volume carrying the story down to the achievement of Haitian independence in 1804.
Du Tonkin à Alger, des « violences de détail »
Par Alain Ruscio « LA torture judiciaire, l’affreuse torture du Moyen Age, sévit non seulement à Madagascar, mais au Tonkin et au Soudan français. » Ce témoignage du député Paul Vigné d’Octon date de… 1900 (1). Preuve, si besoin est, que la torture n’a pas commencé avec le général Massu. Pas plus qu’elle ne s’est limitée à l’Afrique du Nord. Certes, durant la guerre d’Algérie, entre 1954-1955 et 1962, la torture a été crescendo un moyen massif de terreur, allant bien au-delà des rangs nationalistes ou « rebelles ». Mais si la focalisation du débat sur cette guerre à nulle autre pareille est largement justifiée, c’est l’ensemble de la colonisation qui doit être remis en question. La France officielle, de la monarchie de Juillet (1830) à la République de mai (1958) a organisé, suscité ou laissé se développer, selon les cas et selon les périodes, l’usage de la torture, de Hanoï à Nouméa, de Tananarive à Dakar, de Rabat à Tunis. Pour expliquer une telle généralisation, il faut revenir au coeur des mentalités coloniales (2). La conquête achevée, la « pacification » assurée, la France coloniale, imprégnée dans toutes ses fibres de sa « mission » (délivrer des territoires entiers du règne des ténèbres), est persuadée qu’elle est en train de réussir. Elle est fière de son bilan. Les « masses indigènes » lui sont, sans contestation possible, reconnaissantes. Elles profitent de la « paix française », qu’elles peuvent comparer aux misères et aux injustices du passé. Si, malgré tout, mouvements de protestation il y a, ils sont provoqués par des « meneurs » manipulés par « l’étranger » trouvant quelque intérêt suspect à menacer l’harmonie. Ces fauteurs de troubles ne représentent, par définition, qu’une infime minorité. La répression se transforme donc, non en une manifestation de brutalité contre un peuple, mais en acte d’autodéfense contre des éléments malsains, la lie (politique et sociale) de la population. La torture est fille naturelle de cet argumentaire : pour éviter que la lèpre n’attaque un organisme présumé sain, il faut isoler les germes menaçants, les extirper de l’organisme. En 1933, Albert de Pouvourville, grande plume « indochinoise », écrivain très connu des cercles coloniaux, écrit : « Il est évident qu’il ne sera jamais possible de rallier les nationalistes irréductibles. Il n’y a pas, en ce qui concerne cette catégorie d’individus, de réforme qui tienne (…). La seule politique à suivre à leur égard est celle de la répression impitoyable (…). Tout indigène qui se pare de l’étiquette révolutionnaire doit être hors la loi ; il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque à ce sujet. Il est heureusement certain que le nombre de ces irréductibles n’est pas élevé, quelques centaines au plus pour le Nord-Annam, mais ils sont très ardents. Ce nombre augmenterait très vite si, par une générosité mal calculée, nous commettions la faute de composer avec eux, de leur témoigner de l’indulgence (3). » Et comment faire, sinon utiliser d’emblée les méthodes les plus violentes pour isoler de tels germes ? Parlant ainsi, le colonisateur construit lui-même le piège dans lequel il va s’enfermer. Il met sur la réalité (une nation rebelle) un masque opaque (le grand mythe de la minorité agissante). Seulement voilà : cette « minorité » est de plus en plus nombreuse et de plus en plus agissante. Plus le mouvement national croît, plus le divorce entre discours colonial et réalité est criant. Petit à petit, l’habitude s’installe DÈS la période de la conquête, il n’est pas rare que l’on ait recours à des méthodes d’interrogatoire cruelles. Petit à petit, l’habitude de violenter les suspects, sous n’importe quel motif, s’installe. Comme l’écrit Alexis de Tocqueville, au tout début de l’occupation de l’Algérie : « Du moment où nous avons admis cette grande violence de la conquête, je crois que nous ne devons pas reculer devant les violences de détail qui sont absolument nécessaires pour la consolider (4). » « Détail », le mot sonne étrangement à nos oreilles… En Indochine, l’affrontement atteint un premier paroxysme. Dans les années 1930, les prisons débordent littéralement. Accompagnant Paul Reynaud, le ministre des colonies, Andrée Viollis, journaliste alors fort célèbre et peu suspecte d’extrémisme, rapporte de son voyage un livre explosif, Indochine S.O.S. (5). « Il y a, écrit-elle, des tortures qu’on peut appeler classiques : privation de nourriture avec ration réduite à 30 grammes de riz par jour, coups de rotin sur les chevilles, sur la plante des pieds, tenailles appliquées aux tempes pour faire jaillir les yeux des orbites, poteau auquel le patient est attaché par les bras et suspendu à quelques centimètres du sol, entonnoir à pétrole, presse de bois, épingles sous les ongles, privation d’eau, particulièrement douloureuse pour les torturés qui brûlent de fièvre. » « Classique », en effet. Mais il y a plus « moderne ». La torture à l’électricité est, déjà, formellement attestée : « Attacher un bout de fil de fer au bras ou à la jambe, introduire l’autre bout dans le sexe ; relier un fouet aux fils de fer entrelacés à un courant électrique ; attacher une des mains du prévenu par un fil métallique que l’on branche ensuite sur le circuit… » Et Andrée Viollis de préciser que ces pratiques sont devenues journalières dans certains commissariats. Ainsi, les « gégéneurs » d’Alger n’ont rien inventé. Dans les années 1930, sous les tropiques, à l’abri du drapeau français, toutes ces méthodes dégradantes existaient bel et bien. On se doute que les explosions nationalistes de l’après-seconde guerre mondiale vont accroître encore ces pratiques. Sétif 1945, Indochine 1946, Madagascar 1947… partout, le système colonial se fendille, partout la réponse est la même. La France de 1945, qui vient de se délivrer, avec l’aide de ses alliés, de l’oppression nazie, n’a pas compris que le droit des nations à disposer d’elles-mêmes pouvait être appliqué à son empire. Elle esquisse certes une politique de réformes, mais elle tient par-dessus tout à sa souveraineté. Face à la contestation nationale qui s’exprime de plus en plus fort, elle a recours aux vieux schémas d’explication. La machine s’est emballée. Après 1945, les dirigeants français, ne sachant plus où donner de la tête, entament une généralisation de la répression qui trouvera son apogée lors de la guerre d’Algérie. Le coup de pouce initial est donné par le politique ; le contrôle des acteurs est en permanence et jusqu’au bout assuré par le politique. C’est le cas à Madagascar. On connaît désormais le film des événements : la provocation de 1947 et ses suites, la répression de masse. Ce qui est moins connu, c’est la parodie de procès qui fut alors intentée aux dirigeants du Mouvement démocratique de rénovation malgache (MDRM). Lors des débats, Me Stibbe, leur principal défenseur avec Me Douzon, dénonça sans concessions la pratique fréquente de l’interrogatoire « musclé », de la torture, pour dire le mot, qui eut lieu pendant l’instruction. Il publia plus tard de nombreux témoignages et évoquait, dans un article d’Esprit, la généralisation de ces pratiques à l’ensemble de l’outre-mer… un an avant la guerre d’Algérie : « Dans les affaires politiques, et singulièrement dans les affaires coloniales, écrit-il, l’emploi de ces procédés, qui tend à devenir systématique, demeure ignoré d’une trop grande fraction de l’opinion publique (…). Depuis 1947, il n’est guère de grands procès politiques coloniaux, à Madagascar, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, où les accusés n’aient passé des aveux à la police et ne les aient rétractés ensuite en invoquant les plus horribles tortures (6). » On se doute que l’affrontement majeur de cette même époque, la guerre d’Indochine, accroissant le fossé entre les communautés, a été un nouveau pas en avant dans l’horreur. Avec une dimension nouvelle : dans ces sombres pratiques, la police a été supplantée par l’armée. Que la torture ait été utilisée lors de ce premier des deux grands conflits de décolonisation, il suffirait pour s’en convaincre de lire la « petite phrase », passée relativement inaperçue, du tout premier témoignage du général Massu, dans Le Monde : « Quand je suis arrivé en Algérie en 1955, je me souviens de l’avoir vu [Bigeard] en train d’interroger un malheureux avec la gégène (…). Je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que vous faites là ? » Il m’a répondu : « On faisait déjà cela en Indochine, on ne va pas s’arrêter ici ! » (7). » Première preuve, sous une plume autorisée, que la torture fut au minimum utilisée, et probablement banalisée, malgré les dénégations de quelques nostalgiques. Au vu et au su de tous, ou presque. « C’est comme ça partout » EN tout cas, l’opinion publique, par bribes, commence à être informée. Dès 1945, alors que les pratiques nazies sont encore présentes dans tous les esprits, la presse se fait l’écho des méthodes détestables de la reconquête. Le journaliste Georges Altman dénonce, dans Franc-Tireur, les « représailles sauvages que les défenseurs d’un certain ordre colonial exercent envers les hommes du Viet-minh ». Puis : « On n’aura point réduit l’énorme tache de sang qui couvrait l’Europe pour laisser – parce que c’est si loin – s’étaler la tache de sang en Indochine française (8). » En 1949 éclate une affaire qui fait grand bruit, avant d’être soigneusement étouffée. Jacques Chegaray, un journaliste de L’Aube, quotidien du Mouvement républicain populaire (MRP), est envoyé en Indochine. Ce qu’il rapporte est très loin de ce qu’attendaient ses patrons : horrifié, il a recueilli le témoignage de tortionnaires qui, tranquillement, lui ont décrit diverses méthodes. Son quotidien refuse (évidemment) de publier son article. Il se tourne alors vers Témoignage chrétien, qui titre, le 29 juillet 1949 : « A côté de la machine à écrire, le mobilier d’un poste comprend une machine à faire parler. Les tortures en Indochine. » La publication de son témoignage, premier d’une longue série, dont des articles du grand savant orientaliste Paul Mus, est le signal d’une vaste polémique en France. Donc, on pouvait savoir. Les Mémoires de certains « anciens d’Indo » – même si ce corps fait généralement bloc, encore actuellement, autour des valeurs qu’il défendait de 1945 à 1954 – en témoignent. On pense évidemment au général Jacques de Bollardière, qui rencontre la torture sur le sol vietnamien. Mais il la tient pour marginale, en tout cas non généralisée, ce qui explique son maintien au sein de l’armée (9). On retrouve maintes traces de ces pratiques également sous la plume de Jules Roy. Jeune lieutenant-colonel, et déjà écrivain célèbre, il est volontaire pour l’Indochine. Ses premiers écrits ne laissent planer aucun doute sur son acceptation de la croisade anti-Viet-minh au nom de la défense du « monde libre ». Mais ce qu’il voit en Indochine refroidit ses ardeurs : « Sur toutes les bases aériennes, à l’écart des pistes, étaient construites des cahutes qu’on évitait et d’où, la nuit, montaient des hurlements qu’on feignait de ne pas entendre. Sur la base de Tourane de mon camarade Marchal, où je disposais d’une certaine liberté de mouvement, on m’avait montré cela avec répugnance : les hommes de main des renseignements s’exerçaient là. Marchal me disait : « C’est comme ça partout, c’est obligé. » Pourquoi ? Comment ? Un jour, au cours d’une nouvelle opération, comme je parcourais la zone en Jeep, j’aperçus devant une pagode un troupeau de paysans accroupis sous la garde de soldats. Je demandai à l’officier qui m’accompagnait ce que c’était. « Rien. Des suspects. » Je demandai qu’on s’arrêtât. J’allai à la pagode, j’entrai : on amenait les files de Nha Que devant les tables où les spécialistes leur brisaient les couilles à la magnéto (10). » Il s’est passé moins de cent jours entre le Genève indochinois (20 juillet 1954) et le début de la guerre d’Algérie. Pas assez de temps pour que les « mauvaises habitudes » soient oubliées… Alain Ruscio.
LE MONDE DIPLOMATIQUE | juin 2001 | Pages 10 et 11 (1) Discours à la Chambre des députés, 19 novembre 1900. (2) Lire Le Credo de l’Homme blanc, Complexe, Bruxelles, 1996. (3) Griffes rouges sur l’Asie, Baudinière, Paris, 1933. (4) Lettre au général Lamoricière, 5 avril 1846, citée par André Jardin, Alexis de Tocqueville, Hachette, Paris, 1984. (5) Préface d’André Malraux, Gallimard, Paris, 1935. (6) « Le mécanisme de la répression politique », Esprit, septembre 1953. (7) 22 juin 2000. (8) 22 décembre 1945. (9) En mars 1957, il demandera à être relevé de son commandement en Algérie, pour protester contre la torture. (10) Mémoires barbares, Albin Michel, Paris, 1989. |
|
Chronique de la seconde guerre mondiale, éd. Chronique, 1990 Septembre 1941 – p.226
« Le Juif et la France » attire les foules Paris, septembre
Au palais Berlitz, l’exposition « Le Juif et la France » connaît depuis le 5 septembre un grand succès. Dénoncé comme l’ennemi juré de l’Europe, le Juif y est décrit à grand renfort d’affiches, de livres, de photographies, de statistiques. Les visiteurs doivent apprendre à reconnaître au premier regard son type physique caractéristique, ou prétendu tel. Le Juif est censé avoir le nez crochu, les yeux humides, l’allure négligée, des mimiques faciales particulières, Les organisateurs ont bénéficié des subventions de l’ambassade d’Allemagne et des conseils des « spécialistes scientifiques » de l’Institut d’ études des questions juives, que dirige un pseudo-ethnologue, le médecin suisse naturalisé français George Montandon. Ce dernier est l’auteur de divers opuscules racistes et antisémites, l’Ethnie française, Comment reconnaître le Juif, qui ne s’embarrassent pas de nuances. Un tel pot-pourri de documents ne peut que rassurer et conforter le « Français moyen » dans son antisémitisme, Un anti-sémitisme qui semble être devenu un devoir civique.
|
|
Jules Gritti, déraciner les racismes, SOS Editions, 1982
(p.208) DOSSIER IV
Des études raciales aux théories racistes
Nous avons noté (en introduction) comment la notion de « race » avait connu un glissement et un élargissement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : de la « lignée » (aristocratique) l’on est passé à la variété d’«espèce» animale ou humaine. Toutefois les théories du «sang pur» (Dossier 1) octroyaient déjà aux termes « race » et « racé » un sens biologique. Buffon est le témoin le plus représentatif du passage, avec les flottements: il emploie les termes d’«espèce», «race», «variété» tour à tour en les confondant et les distinguant. Sa pensée semble-t-il s’établit autour de l’idée d’une unique espèce humaine et d’une variété des races (du fait du climat). Ces « variétés d’espèces » (races) sont soumis à un inégal développement, le meilleur étant l’Européen. Le premier théoricien – méconnu – de la hiérarchie des races humaines, donc de la supériorité ou de l’infériorité naturelles des unes ou des autres est Victor Courtet (1813-1867) professeur de «science politique» à l’université de Montpellier. Celui-ci entend fonder la science politique sur une « science de l’homme» à partir des « lois pysiologiques ». En un temps où l’orientalisme fascine les chercheurs, il va expliquer le système des castes par les rapports entre physiologie et civilisation. En un temps où l’Histoire romantique et rationaliste recherche (p.209) les origines, il importe de retrouver les privilèges de la « race » gauloise. Généralisant le propos, Victor Courtet fonde les systèmes sociaux et les civilisations sur la « vie», sur la « force vitale» des races, sur leur degré de pureté (pour les races supérieures) ou de « mélange » (pour les inférieures). «Plus le type d’une race est beau plus la civilisation de cette race est avancée ; plus le type est laid, plus la race est imparfaite (…) Aux races des nègres que distinguent les traits les plus grossiers, l’esclavage, l’impuissance relative, enfin la barbarie». Ainsi l’esthétique et la biologie se commandent réciproquement. L’ironie de l’histoire est que victor Courtet, disciple de Saint-Simon, fut aussi un premier théoricien du développement, à savoir de la contribution des races « supérieures » – colonisatrices – pour tirer les « inférieures » de la barbarie. Le branle est donné. Avant le célèbre Comte de Gobineau une abondante littérature fait droit à ces thèmes de 1’inégalité des races : les unes «viriles», les autres «féminines» ; les unes «adultes», tes autres « enfantines», etc. Quinet par exempte dans Génie des religions dès 1843 travaille selon ces catégories. Sous divers noms : « physiologie sociale », « ethnographie», « anthropo!ogie», etc., la racio!ogie est fondée.
· Parallèlement aux U.S.A., à partir des années 1830, les Yankees (W.A.S.Ps) : Américains anglo-saxons protestants, pour résister au premier afflux d’immigrants européens, développent des théories nativistes, fondées sur la prédestination et la… naissance sur le sol américain ! Au demeurant des anthropologues anglo-saxons écrivent peu avant Gobineau ou en même temps que lui (sans subir son influence) sur le thème de l’inégalité des races. Disraëli, dans son roman (Coningby (1843)) n’hésite pas à distinguer race « supérieure » et race « inférieure». Le milieu du XIXe siècle s’avère particulièrement fécond tant pour les races humaines que pour la “lutte pour la vie» dans les espèces animales. · Arthur Gobineau passe encore aujourd’hui pour être le principal théoricien de l’inégalité des races humaines et par là même le fondateur du racisme. Nous avons signalé (en Dossier 1) comment il héritait de tout un courant aristocratique obsédé par la pureté du sang. Sans doute l’histoire lui a octroyé un excès d’indignité. Le chercheur tout à la fois sérieux, imaginatif, désabusé, un tantinet candide, a pour son malheur posthume connu une forte récupération par tout un courant de la culture germanique: Richard Wagner, Chamberlin et les théoriciens du nazisme.
Son ouvrage monumental : Essai sur l’inégalité des races humaines, paraît entre 1853 et 1855. Gobineau ne préconise pas vraiment la (p.210) “pureté » d’une race. Sa théorie repose sur 1a double loi (l’attraction et de répulsion entre races: elle travaille plutôt selon l’axe des bons ou des mauvais croisements et mélanges. Le bon croisement demeure discret, restreint ; il se fait à bon escient à la manière d’une homéopathie. La dégénérescence d’une race résulte aussi bien du refus de croisement que de l’excès de mélanges incontrôlés : une nation fonctionne comme un corps : un peuple dégénéré « n’a plus dans ses veines le même sang dont les alliages successifs ont graduellement modifié la valeur (…); il n’a pas conservé la même race que ses fondateurs ». En somme le mélange des races, à l’instar de la langue d’Esope, peut être la meilleure ou la pire des choses. Des populations cédant à la loi de « répulsion », refusant de se métisser avec d’autres, se sont par là-même procuré un sérieux handicap pour la « civilisation ». Signalons que, pour l’auteur, les juifs représentent un cas intéressant – grâce à un bon équilibre de la préservation et du mélange – de peuple « libre », « fort » et « intelligent » , (les épigones puis les théoriciens nazis ont évidemment omis de lire ces pages). Avec hésitation Gobineau adopte la classif’lcation répandue à son époque entre : noirs, jaunes et blancs. Mais il n’accorde à la couleur de la peau qu’une valeur relative pour différencier les populations. Il cherche l’explication des différences et des « inégalités » dans les rapports entre l’hérédité ethnique et les aptitudes civilisatrices. – Les noirs constitucnt la variété « la plus humble”, « au bas de l’échelle ». Mais ils disposent de grandes capacités artistiques (et les peuples conservent, celles-ci au prorata de leur sang noir…). – Les jaunes se caractérisent par leur raison pratique et le respect de la règle. – Les blancs ont en commun un le sens de l’honneur comme mobile d’action.
Parmi les hommes blancs, reprenant le vocabulaire biblique, Gobineau distingue les chamites, les sémites et les japhétides. Ces derniers, qui se nommcnt aussi arian, ont donné source aux civilisations les plus élevées : la Grèce, plutôt macédonienne, et surtout l’ Angleterre anglo-saxonne. – En vérité Gobineau n’a que peu d’estime pour la France et les pays germaniques : l’on est d’autant plus surpris par le succès du gobinisme outre-Rhin. En définitive, chez Gobineau se superposent deux lignes de jugement : – Il généralise ses louanges à l’adresse des blancs du rameau « arian ». – Mais venant sur le terrain des civilisations et formes de gouvernemcnt, il est critique pour la plupart des Européens…
En France Gobineau devait plutôt connaître des critiques à commencer par celles de son maître et ami Tocqueville : celui-ci montrait comment le christianisme ferment de progrès avait développé le principe et l’exigence égalitaires; il prévoyait des récupérations ultérieures de la (p.211) pensée de Gobineau à des fins de « tyrannie», jetant « l’abjection » sur les peuples prétendûment inférieurs. Mais entre 1870 et 1914 les idées de Gobineau connaissant une grande vogue outre-Rhin, Chamberlain (Huston Steward), d’origine britannique mais installé en Allemagne, sera le grand propagateur d’un gobinisme simplifié, déformé. Il agite le premier l’idée que le sang germanique, supérieur, doit se conserver en luttant contre les éléments étrangers notamment le catholicisme romain et le judaïsme. Un peuple qui se défait peut se refaire par « discipline de la race »: par endogamie, sélection, détermination et limitation des mélanges. Chamberlain reporte sur les Germains l’admiration que Gobineau éprouvait pour les «arians» : « moins un pays est germanique, moins il est civilisé» – « la lumière vient du Nord»… Signalons au passage qu’un français Vacher de Lapouge, à l’université de Montpellier, professe au début du xxe siècle sous le nom d’« anthropo-sociologie» un gobinisme simplifié en faisant intervenir l’idée d’un plus ou moins grand développement cranien, l’homme développé demeurant toujours «1′ Aryen». Le nazisme n’a plus qu’à recueillir des thèmes largement systématisés en Allemagne et bien vivaces en France. Mein Kampf de Hitler date de 1924 : le paroxysme hystérique supplante ce qui reste de recherche scientifique. “Le péché contre le sang », contre la pureté de race, est surtout le fait du juif peuple de la «saleté», de 1’«infamie», «bacille» qui « empoisonne les âmes»… La grande synthèse, si l’on peut dire, des apports ethnologiques et des frénésies mythiques sera l’oeuvre de Rosenberg : Le Mythe du XXe siècle (1930). Tout y passe y compris le mythe de l’Atlantide, centre nordique de la création, pour établir une histoire universelle fondée sur la supériorité raciale des aryens : une histoire menacée par le ferment juif, histoire où les noirs représentent le plus bon degré de l’échelle. La notion de race est-elle valide pour décrire et théoriser des difrérences biologiques, psychologiques et culturelles entre les populations humaines ? Une « raciologie » est-elle scientifiquement possible? D’aucuns le croient et l’on assiste même à une recrudescence des thèmes inégalitaires entre 1970 et 1980 à la faveur d’une science dite sociobiologie. Des auteurs prestidigitateurs publient en ce sens des travaux bardés d’un imposant appareil d’érudition biologique, génétique, psyeho-sociologique… Ils font abondamment état de tests pour établir le Q.I. («quotient d’intelligence») des populations; ils se réferent à la notion d’« héréditabilité » tout à la fois biologique et culturelle. Le pouvoir se distribue selon le « mérite génétique ». L’inégalité entre groupes sociaux ou groupes ethniques s’avère inévitable. L’opposition entre races «sélectionnées » et races « tardives » connaît donc un regain d’actualité.
(p. 212) Une première donnée, universelle demeure acquise: l’unité de l’espèce humaine en tant que communauté de gênes. Tout « homo sapiens » est susceptible de participer à la reproduction de l’unique espèce des hommes. Il n’y a pas d’échanges de gênes avec d’autres espèces animales. En rigueur de termes l’on ne devrait parler que d’une seule race humaine. Au pluriel le terme « races » peut rendre compte – de manière fort relative – de certains faits d’isolement biologique partiel dans la mesure où des groupes connaissent une plus haute fréquence d’inter-mariages en leur sein et ne croisent guère avec d’autres groupes.Il en résulte une fréquence relative de traits héréditaires superficiels: pigmentation de la peau, chevelure crépue ou lisse, yeux bridés ou non, etc. Toutefois lorsque l’on essaie d’établir des différences sur la base de données plus profondes, telles que les différences entre groupes sanguins l’on aboutit à des résultats surprenants sinon cocasses. Ainsi les Danois et les Espagnols connaissent sensiblement les mêmes proportions de groupes A, O et B, tandis que les Basques s’apparentent aux …arborigères de l’Est australien. En dernier ressort du point de vue biologique, cela n’a guère de sens d’opposer l’hérédité au milieu (géographique, social, culturel…) de développement. Les deux facteurs se combinent étroitement, à telle enseigne que les différenccs individuelles ou familiales comptent autant sinon plus que celles entre groupes.
Les nouvelles théories de la dite « sociobiologie » représentent une sorte de « néo-darwinisme ». Chaque individu serait porté par « stratégie sexuelle » à transmettre ses propres gênes en se reproduisant le plus possible et en aidant à la diffusion du « patrimoine » dans son propre milieu (l’homme étant le « conquérant” et la femme l’exécutante). A ce jeu les mieux armés triomphent car ils transmettent les «comportements» les plus efficaces. La sélection tend à uniformiser dans le groupe les caractères qui résistent le mieux, qui réussissent. Or les recherches scientifiques en génétique depuis les années 1955-1960 permettent d’évaluer de manière plus fine les effets de transmission de dizaines de milliers de gênes : elles aboutissent à retenir (plutôt que l’uniformité réussie) une grande variété entre sujets individuels à l’intérieur d’un groupe. Si bien que la valeur d’un groupe dépend non de sa capacité de sélection biologique mais bel et bien de sa variété, de sa richesse de différences, pour répondre efficacement au grand nombre de contraintes du milieu environnant. A la vision raciste, élitaire, de la pureté sélective s’oppose aujourd’hui l’étude fine et complexe de l’extraordinaire diversité au sein des groupes humains. Mieux vaut parler d’une riche orchestration des diversités que d’une sélection naturelle triant des caractères prétendûment privilégiés. L’humanité est faite de « programmes » variés.
(p.213) Du point de vue des méthodes en jeu, les théoriciens actuels de l’inégalité des races font preuve d’une sorte de confusion et d’hybridation: ils font le va-et-vient entre les notions d’origine et de disciplines différentes, les unes biologiques ou génétiques, les autres psychologiques, sociologiques et ce à la faveur des statistiques. Mais ils n’éclairent ni ne critiquent guère les instruments, notions et techniques dont ils se servent. Que signifie par exemple le terme « comportement » lequel pose plus de problèmes qu’il n’en résoud ? Nous pouvons reprendre la même question au sujet du fameux Q.l. (quotient d’intelligence) et de sa batterie de tests. Déjà l’établissement d’un test valable objectivement pour toutes les cultures humaines pose un sérieux problème. A bon droit Claude Levi-Strauss parle ici d’ethnocentrisme à savoir du préjugé qui privilégie le point de vue de la culture occidentale et son évolutionnisme historique. « Si le critère retenu avait été le degré d’aptitude à triompher des milieux géographiques les plus hostiles, il n’y a guère de doute que les eskimos d’une part, les bédouins de l’autre emporteraient la palme » A supposer ensuite que les tests du Q.l. aient une large portée – mettons même une portée universelle – les résultats dépendent de bien d’autres facteurs décisifs que de celui d’une prétendue hérédité raciale : l’éducation, le milieu social, la richesse ou la pauvreté, la familiarité avec les tests, le désir plus ou moins vif d’obtenir un bon résultat, l’affectivité, les rapports avec l’expérimentateur, etc. Une récente recherche de l’l.N.S.E.R.M. sur les résultats scolaires, conduite avec un maximum de rigueur, prouve que les réussites et les échecs dépendent du milieu familial et des conditions sociales non de l’hérédité ou patrimoine génétique : des enfants adoptés placés dans un milieu stimulant parviennent à rivaliser avec des « héritiers» naturels d’un milieu comparable… Sous tous les angles où l’on prenne la notion de « race» celle-ci s’avère de plus en plus incertaine, problématique, pour rendre compte des différences entre les populations humaines; utilisée pour l’inventaire – pour des inventaires fort divers et relatifs – des groupes, elle est de validité nulle pour un classement pertinent. Mais elle conserve une terrible portée mythique : « L’égalité ou l’inégalité des races posées hors de tout contexte sont des affirmations dénuées de sens empirique faute d’une norme universelle et à cause de l’extrême diversité, de l’incomparabilité et de l’incommcnsurabilité des aptitudes humaines. L’inégalité des chances individuelles et collectives est, en revanche, une réalité tragique et inexpiable. Elle cherche le plus souvent sa justification dans une inégalité prétendûment naturelle dont elle engendre elle-même non seulement les apparences mais hélas ! la réalité (…) L’inégalité raciale prend figure de fatalité (…). C’est pourquoi un tort fait à l’homme ne reste jamais limité. Il est total ».
|
|
Tshidimba Karin, Opération Sénégal / L’île de Gorée, un frisson sous le soleil, LB 27/05/2003
Lieu de mémoire de l’esclavage, inscrit au patrimoinde de l’UNESCO, l’île de Gorée était au large des côtes dakaroises, le carrefour africain du trafic des esclaves. Palpés comme du bétail, pesés et parfois engraissés, les esclaves étaient choisis en fonction de leurs aptitudes physiques. Ainsi des Yoruba, par exemple, choisis comme ‘étalons reproducteurs’ par les grands planteurs. (…) Avec 20 pc de ‘pertes’ durant le voyage et presque autant durant les premières années d’ ‘exil’, il s’agit là d’un des plus grands génocides qu’a connu l’humanité. Sur 20 millions d’hommes et de femmes qui ont transité par Gorée, six millions sont morts des suites des privations et des mauvais traitements. Principal centre de traite des Noirs de l’Afrique occidentale française (AOF) (…) Gorée compta jusqu’à 38 esclavageries à son ‘apogée’.
|
La torture pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) Le rôle de l’armée française hier et aujourd’huiPar Marianne Arens et Françoise Thull
L’armée française a systématiquement pratiqué l’assassinat et la torture sur ses adversaires. Un débat public à ce sujet est en cours en France depuis des mois. En novembre dernier, deux hauts responsables militaires français à la retraite ont révélé au quotidien Le Monde qu’ils avaient, torturé, maltraité et assassiné des membres du FLN (Front de libération nationale), le mouvement de libération algérien de l’époque, entre 1954 et 1962 lors de la guerre d’Algérie. Le général Jacques Massu, 92 ans, qui était en 1957 le chef des tristement célèbres « paras » (10e division de parachutistes) et son bras droit le général Paul Aussaresses, 82 ans, chargé des services de renseignement à Alger, ont confirmé que plus de 3 000 prisonniers qui avaient à l’époque été portés « disparus », avaient en réalité été exécutés. Aussaresses a reconnu la réalité, en 1957, de la torture et des exécutions sommaires dans les pratiques de la politique de guerre française. Il s’est vanté d’avoir employé des moyens qui sortaient des normes établies par les lois de la guerre ainsi que d’avoir ordonné à ses subordonnés de tuer. Il reconnait avoir lui-même procédé à 24 exécutions sommaires de membres du FLN. Et il ajouta » ne pas avoir à se repentir « . Le débat sur la torture fut relancé par la publication dans Le Monde du témoignage d’une ancienne victime de la torture: Louisetta Ighil Ahgiz, une jeune militante de 20 ans à l’époque, qui était tombée en septembre 1957 entre les mains des tortionnaires, et qui souffre aujourd’hui encore, à l’âge de 64 ans, des séquelles physiques et psychiques de la torture. Elle avait été capturée après être tombée avec son commando FLN dans une embuscade du général Massu. Elle avait été emmenée, grièvement blessée, à son quartier général. Là, elle fut sévèrement torturée, sans relâche, trois mois durant. Louisette précisa comment Massu ou bien le général Bigeard, quand ils venaient la voir, l’insultaient et l’humiliaient avant de donner l’ordre par gestes de la torturer. « C’est comme s’il existait un code muet établi » ajouta-t-elle. Elle ne doit sa survie qu’à un médecin militaire qui la découvrit fin décembre 1957. Il la fit transporter dans un hôpital où elle échappa à ses tortionnaires. C’est cet homme qu’elle voulait retrouver au moyen de son récit dans Le Monde pour pouvoir lui dire merci. Le récit de Louisetta Ighil Ahgiz fut à l’origine d’un flot de courriers de lecteurs et d’articles dans de nombreux médias français. Un autre ancien combattant du FLN, Noui M’Hidi Abdelkader, qui avait été lui-même arrêté à Paris en 1958 et incarcéré et torturé à Versailles, confirme par exemple que la torture avait également été pratiquée dans la capitale. Il est convaincu que les archives, qui n’ont toujours pas été ouvertes, recèlent les déclarations de milliers de victimes de la torture. La guerre d’Algérie 1954-1962 En 1954, la lutte pour l’indépendance de l’Algérie qui jusqu’alors ne faisait que couver, prit réellement l’ampleur d’une guerre. Peu de temps auparavant, l’armée française, après sa défaite historique à Dien Bien Phu, avait dû se retirer du Vietnam et avait transféré la majeure partie des troupes de la Légion étrangère en Algérie, sa plus importante et sa plus ancienne colonie. Alors que les attentats du mouvement de libération nationale FLN se multipliaient en 1954, le gouvernement français décida de ne céder en aucun cas l’Algérie qui était une colonie française depuis 1830. Pour la première fois les appelés du contingent furent envoyés dans une colonie et, dès le milieu de l’année 1956, on trouvait quelque 500 000 soldats français en terre algérienne. Durant cette période qui s’étendit jusqu’en 1962, 1,7 million de Français ont combattu en Algérie. 25 000 furent tués et 60 000 blessés, alors que du côté algérien plus d’un demi million de personnes trouvèrent la mort. En dépit de ces chiffres exorbitants, il fut pendant longtemps interdit d’utiliser officiellement le nom de » guerre » et l’on ne parlait que des « événements d’Algérie » ou d’opérations de maintien d’ordre dans les trois provinces algériennes. C’est seulement en octobre 1999 que l’Assemblée nationale accepta que ces événements soient désigner du nom de guerre d’Algérie. C’était un gouvernement social-démocrate, le gouvernement de Guy Mollet (SFIO), qui laissa à la force d’occupation les mains libres pour torturer: en juin 1956, avant la bataille d’Alger, l’Assemblée nationale accepta les propositions de Guy Mollet de suspendre la garantie des libertés individuelles et de permettre aux gendarmes, aux policiers et aux militaires stationnés en Algérie le droit de pratiquer des « interrogatoires poussés », d’introduire des « mesures d’urgence » ou d’appliquer des « traitements spéciaux ». « Ils [les responsables politiques de l’époque] nous laissaient faire ce que nous jugions nécessaire », confirme aujourd’hui Aussaresses, le général en retraite. Robert Lacoste, le ministre-résident de l’Algérie de l’époque, appartenait lui aussi au parti social-démocrate de la SFIO. Le social-démocrate François Mitterrand, le futur président de la République, déclarait devant le Parlement le 5 novembre 1954 en tant que ministre de l’Intérieur: « La rébellion algérienne ne peut trouver qu’une forme terminale: la guerre ». Il clama pathétiquement que l’Algérie est la France et que la Méditerranée sépare la France comme la Seine Paris. Devenu ministre de la Justice, il se prononça le 10 février 1957 contre le recours en grâce demandé pour le militant communiste Fernand Iveton qui fut condamné à mort et exécuté. La politique coloniale française bénéficia même du soutien des staliniens. En 1954 le Parti communiste, sous la direction de Jacques Duclos, vota pour le budget et en 1956, il vota pour les « pouvoirs spéciaux » du gouvernement alors que les rues de Paris étaient prises par les manifestants protestant contre la guerre d’Algérie. Les témoignages des victimes et les documents publiés récemment ne laissent aucun doute quant à la brutalité et à l’ampleur de la pratique systématique et à grande échelle de la torture, entre autres, le viol, le jet d’eau froide, le supplice de la baignoire remplie d’excréments et les électrochocs. Même l’arrière-pays, où l’électricité ne se rendait pas, ne fut épargné des électrochocs, administrés par la « gégène », la génératrice à pédale des postes de radio de campagne. Le commandement en Algérie se trouvait entre les mains d’un groupe de généraux de haut rang qui avaient, lors de la Deuxième guerre mondiale, quelques années plus tôt, participé sous Charles de Gaulle à la lutte contre l’Allemagne nazie. Alors qu’en 1959, de Gaulle, qui était devenu Président de la République en 1958, envisageait prudemment un référendum sur l’indépendance de l’Algérie, ces généraux organisèrent une tentative de putsch en avril 1961, sous le cri de guerre « Algérie française ». Après son échec, ils fondèrent l’OAS (Organisation armée secrète) qui devait commettre de nombreux attentats contre la population civile en Algérie et en France. Grâce à l’amnistie générale qui fut partie intégrante des accords d’Evian proclamant l’indépendance de l’Algérie en 1962, et d’une nouvelle amnistie survenue à la fin des années 1960, ces généraux ne furent, par la suite, jamais poursuivis par la justice ni pour leur tentative de putsch ni pour la pratique systématique de la torture. Quelques-uns de ces généraux, comme par exemple le général Marcel Bigeard, qui reçut après la guerre les plus hautes distinctions militaires, refusent jusqu’à ce jour le devoir de mémoire pour les crimes commis en Algérie. Bigeard, commandant en Algérie et ancien membre de l’OAS, est le porte-parole d’une fraction de nostalgiques qui nient publiquement tout acte de torture. En accord avec Jean-Marie Le Pen, le dirigeant d’extrême-droite Front national, Bigeard parle du « tissu de mensonges » qui, d’après lui, « veut détruire tout ce qui est encore propre en France ». Mis à part Bigeard, Le Pen et un certain nombre de vieux soudards de la guerre d’Algérie, qui avaient vivement polémiqué dans les pages du journal Le Figaro contre « l’offense à l’armée française », il y a également Philippe Séguin, le candidat gaulliste malheureux à la Mairie de Paris et adversaire à l’intégration de la France dans l’Union européenne, à s’exprimer de façon véhémente contre un débat sur la torture en Algérie. Charles Pasqua, l’ancien ministre de l’Intérieur gaulliste et qui appartient au parti anti-européen Rassemblement pour la France (RPF) condamna à l’Assemblée nationale, dans les termes les plus virulents une initiative lancée par le Parti communiste français (PCF) pour la création d’une commission d’enquête parlementaire. Débat d’arrière-plan Il y avait déjà eu de nombreux témoignages sur la pratique systématique de la torture en Algérie dans les années 1950. Avant le début de la guerre, en décembre 1951, le journal France-Observateur avait déjà fait état d’actes de torture en Algérie. En 1958, paraissait le livre « La Question » d’Henri Alleg et, en 1960, un groupe d’intellectuels avaient protesté contre la guerre en publiant le « Manifeste des 121 », dont les signataires furent entre autres, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Breton, Simone Signoret et Pierre Vidal-Naquet, un historien qui, dans son livre « La torture sous la République », devait, plus tard, dénoncer la torture comme la rupture avec la tradition libérale de la France. Et pourtant le sujet était resté tabou depuis l’amnistie de 1962. Quand l’hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné avait relaté, dans les années 1980, que Jean-Marie Le Pen (FN) avait participé activement à la torture en Algérie en tant que lieutenant parachutiste, le journal fut traduit en justice et perdit le procès en dernière instance. Depuis quelques mois seulement, il est possible de parler ouvertement du passé. De nouveaux témoignages sont enregistrés quotidiennement, venant en premier lieu, bien sûr, de victimes de torture qui n’ont reçu à ce jour aucune sorte d’indemnité, mais aussi d’anciens appelés du contingent qui ont dû vivre traumatisés, par ce qu’ils ont vécu en tant que jeune soldat en Algérie, quarante ans durant et sans avoir pu en parler. De plus, il y a les pieds-noirs qui ont dû quitter le pays et les Harkis, des Algériens qui ont combattu du côté de l’armée française, et qui ne peuvent ni retourner en Algérie ni trouver la reconnaissance en France. Les représentants ou les descendants de toutes ces couches se manifestent aujourd’hui partout où ils le peuvent pour se faire entendre. La plupart des journaux participent au débat; des films sont montrés et, en novembre dernier, un colloque, placé sous le patronage du président de la République, Jacques Chirac, fut organisé à la Sorbonne et auquel des historiens français et algériens prirent part. La question se pose, à savoir, quelle est la raison pour laquelle un sujet, qui fut occulté pendant près de quarante ans, provoque à présent un débat public d’une telle ampleur? Pourquoi, le gouvernement actuel accepte-t-il un tel débat alors que tous les gouvernements précédents l’avait réprimé par tous les moyens? Alors que par le passé l’armée française avait été à tout propos auréolée du mythe antifasciste de la Résistance, le gouvernement semble aujourd’hui plutôt enclin à se distancer de sa vieille garde. Il ne s’agit là en aucune façon d’une rupture de principe avec le passé mais d’un changement tout à fait objectif : ce n’est certainement pas par hasard que ce débat public va de pair avec la transformation du service national vers une armée professionnelle. L’un des défenseurs notables d’une action de devoir de mémoire est aujourd’hui précisément le ministre de la Défense, Alain Richard (Parti socialiste). Il déclara à l’Assemblée nationale que l’armée serait satisfaite « que la transparence soit faite sur ces questions » et il ajouta que « les règles d’action des militaires français exclueraient de telles pratiques de nos jours ». Alain Richard prononça son allocution programmatique sur la transformation de l’armée le 18 septembre 1997, soit à peine trois mois après l’entrée en fonction de Lionel Jospin (PS) comme Premier ministre. Il énonça le cadre historique motivant la décision de passer à une armée professionnelle: celle-ci ayant été prise après l’effondrement des États staliniens d’Europe de l’Est, à l’époque de la guerre du Golfe en 1991, c’est-à-dire à une époque où la guerre de l’OTAN contre l’Irak avait ouvert la lutte pour une nouvelle répartition globale et pour un contrôle des principales ressources de la planète. Et Richard d’ajouter que l’expérience de 1991 avait montré « que notre organisation militaire traditionnelle ne convenait pas à ces missions-là. Il a fallu à chaque fois prélever dans des unités existantes des éléments comportant certes des appelés mais à base de militaires professionnels dont la formation et le niveau d’entraînement répondaient mieux aux exigences du terrain. De même la complexité de nos armes, élément clé de supériorité, et de protection de nos soldats, a contribué à renforcer le rôle des professionnels. La réflexion alors s’est engagée et elle a abouti au choix de la professionnalisation des armées. » La guerre du Golfe avait surtout occasionné des coûts et des pertes pour la France sans pour autant entraîné d’avantages. Elle avait par contre révélé que les participants européens à la guerre avaient grand besoin de troupes nettement plus modernes et plus mobiles s’ils voulaient être de la partie avec les États-Unis. Mais, c’est avant tout la France qui, ayant perdu depuis longtemps son statut de puissance mondiale, et qui à elle seule n’est plus en mesure de réussir grand chose qui est tributaire de la création d’une force européenne commune. Ce qui explique qu’aucun parti politique n’ait, jusqu’à présent, contesté la professionnalisation de l’armée. Même si, à première vue, ce travail de mémoire du rôle de l’armée française paraît être de nature à compromettre la bourgeoisie, il n’en arrive pas moins à un moment tout à fait opportun. Celle-ci semble saisir l’occasion pour, d’une part, se distancer de ses vieux généraux qui s’acharnent à garder les formes archaïques de l’armée et, d’autre part, se défaire de toute une couche de politiciens gaullistes conservateurs pourfendeurs de l’intégration dans l’Union européenne et défenseurs de la souveraineté de la France. Le manque d’enthousiasme avec lequel le gouvernement pratique le jeu de la transparence se manifeste par le seul fait que Lionel Jospin tout en permettant à quelques historiens triés sur le volet d’accéder aux archives, en refuse cependant le libre accès au grand public: c’est ainsi que certains dossiers resteront fermés jusqu’en 2060.
|
Guerre d’Algérie : la justice reste à fairePARIS, 10 octobre 2000 (Libération)Des crimes tels que les massacres de Paris en octobre 1961 sont encore passibles des tribunaux. Le mutisme des politiques empêche l’indispensable travail de mémoire. Par MOHAMED KHANCHI ET FILALI OSMAN
Mohamed Khanchi est maître de conférences en sciences économiques à l’université Lumière Lyon-II. Filali Osman est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Institut d’études politiques de Lyon. Ce qui est vrai pour l’Afrique ne l’est pas moins pour le Chili de Pinochet ou les eaux de la Seine en octobre 1961 ensanglantées lors de la bataille de Paris. ublier l’histoire conduit indéfectiblement à la répéter. C’est sans nul doute cette réflexion qu’il convient d’avoir toujours à l’esprit si l’on ne veut plus que l’amnésie collective continue à être le fléau de l’humanité. A la fin du mois de juin, la presse française a exhumé, par le biais d’un témoignage, celui de Louisette Ighilahriz, des faits relatifs à la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, dont on peut se demander s’ils seront un jour passibles d’un tribunal pénal international ou des tribunaux français. A une semaine du 39e anniversaire de cette manifestation, la réaction devrait être à la hauteur de la gravité des faits. Des Français algériens furent massacrés par la police sévissant sous les ordres d’un préfet de police nommé Papon. Pour avoir mis en cause celui-ci, l’historien Jean-Luc Einaudi fut poursuivi vainement, pour diffamation, par Maurice Papon. Il a été en effet relaxé par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ainsi l’histoire de la France se rappelle à notre bon souvenir en passant de la bataille d’Alger à la bataille de Paris. Il aura fallu plus de trente-huit ans avant que le législateur ne désigne les événements d’Algérie par leur véritable nom. En effet, la loi du 18 octobre 1999 substitue à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », celle de « guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Une sale guerre… Encore… Mais nul n’en connaît de propre. Il aura fallu quarante-trois ans, les cris douloureux d’une femme, Louisette Ighilahriz, et deux généraux, Bigeard et Massu, pour que notre société se remémore une tragédie. L’ombre de la guerre d’Algérie et de la torture, perpétrée par et avec l’accord des plus hautes autorités de l’Etat français, entache une page de l’histoire de France, l’une des plus sombres sans doute. La visite du président Bouteflika n’aura été qu’un catalyseur. Serait-ce le début d’une réconciliation ? Oui, dans la mesure où la génération née après la fin de la guerre d’Algérie, plus particulièrement celle issue de l’immigration maghrébine, obtiendrait le droit à la mémoire. L’historien Benjamin Stora a très justement relevé que ce travail de mémoire se fera grâce à la passerelle que constitue notre génération, passerelle entre une Algérie meurtrie par une colonisation de cent trente-deux ans, un régime militaire qui tarde à s’effondrer et que n’a jamais mérité le peuple algérien, et des Français qui savent à quel point la passion dissimule une histoire d’amour inachevée, faute de respect de la dignité. Le pardon présuppose d’exorciser le mal… Massu et Bigeard, deux militaires au crépuscule de leur vie, mus par des mobiles différents, sont devenus, sans le savoir, les acteurs d’une pièce de théâtre. Il s’y rejoue une guerre qui a terminé un long – trop long – processus de décolonisation où l’enjeu était simplement celui du respect de la dignité humaine, celle pour laquelle 1 million et demi d’Algériens sont morts. Mais n’oublions pas, sous peine d’indécence et d’outrage à la mémoire, les morts de l’autre camp, nos frères aussi, victimes de l’histoire et d’une France qui croyait être investie d’une mission sacrée de civilisation à l’égard de tout un continent. Le général Massu a donc, sans le savoir, ouvert une brèche dans la forteresse de l’oubli en reconnaissant ce que tout le monde sait et que la presse dénonçait dès mars 1957 : l’armée française a torturé, recourant aux mêmes méthodes que celles dénoncées jusqu’ici comme étant imputables à des régimes dont l’horreur avait été exemplaire. Le général Massu souligne d’une part que les gouvernements successifs étaient parfaitement au courant des pratiques et, d’autre part, que le traitement inhumain et dégradant que subissait le genre humain en Algérie était justifié par l’exigence d’efficacité contre les actes qualifiés de « terroristes » lors, avant et après la bataille d’Alger. Tout juste confesse-t-il que « la torture n’est pas indispensable en temps de guerre, on pourrait très bien s’en passer » ou encore « quand je repense à l’Algérie, cela me désole, on aurait pu faire les choses autrement ». Etre désolé suffit-il à absoudre ? Certainement pas… En tout cas, pas du point de vue de ceux dont les aïeuls ont été torturés, tués par l’OAS ou noyés dans la Seine les 17 et 18 octobre 1961, sur ordre du préfet de police Papon. Bien sûr, mesurée à l’aune d’un relativisme absolu, l’âme de Massu est plus propice au rachat que celle d’un général Bigeard qui, dénoncé par Massu comme ayant été surpris en pleine séance de supplice à la gégène dès 1955, invoque la thèse du complot. Il indique à l’Est républicain avoir « fait un travail propre, avec (son) c[oe]ur ». La commune alsacienne de Trimbach, qui a baptisé en juillet l’une de ses rues du nom de Bigeard, a sans nul doute oublié que la République ne transcende pas les droits de l’homme. A l’heure de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la République ne doit pas honorer ceux qui prétendent l’avoir servie avec c[oe]ur et justifient encore la torture. Trimbach en est une illustration vivante. Pourquoi ne baptiserait-elle pas une rue « 17-Octobre-1961 » pour la mémoire de ses citoyens ? Ce qui est vrai pour l’Afrique ne l’est pas moins pour le Chili de Pinochet ou les eaux de la Seine en octobre 1961 ensanglantées de la bataille de Paris. Les crimes qui y ont été commis sont encore passibles de la justice des hommes. Le 17 octobre 1961 une manifestation de protestation d’Algériens (alors français) contre le couvre-feu qui leur était imposé déclencha plus de quinze mille arrestations et une violence policière meurtrière à l’occasion de laquelle des crimes contre l’humanité furent commis. On parle de plusieurs centaines de morts. Une enquête, confiée par le ministère de l’Intérieur à M. Dieudonné Mandelkern, conseiller d’Etat, a montré que des pièces essentielles en relation directe avec la bataille de Paris du 17 octobre 1961 ont disparu de la préfecture de police. Les archives de la préfecture de police sont encore frappées du sceau du secret alors que des documents du ministère de la Justice font état de soixante à quatre-vingts décès à l’origine de procédures d’instruction. Il est temps que la justice prenne le relais afin que la mémoire des oubliés du fleuve donne tout son sens à la phrase « plus jamais ». Mais que dire du silence de ceux qui nous gouvernent ? Il est frappant de noter que la classe politique fait preuve d’un mutisme rarement égalé depuis que le cri de douleur de Louisette nous rappelle que la forteresse de l’oubli est puissamment défendue, au point de priver toute une génération du droit à la mémoire. Le droit et la justice ont leur place dans ce processus de mémoire. Celle-ci requiert un travail d’enquête au terme duquel toute la lumière doit être faite sur ce qui constitue des crimes contre l’humanité, définis par notre droit comme impliquant, notamment, « la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ». Or, le droit qui consacre l’oubli à travers le principe de la prescription, ne le tolère plus pour ce type de crimes dominés par le principe de l’imprescriptibilité. Mais il est vrai que des lois et des traités d’amnistie viennent perturber ce droit à la justice, comme cela a été le cas pour les tortures infligées par des Français à des prisonniers du Viêt-minh et pour lesquelles la chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé en 1993 qu’ils étaient des crimes qui avaient été amnistiés par la loi du 30 juin 1966. Cela suffira-t-il à décourager ceux d’entre nous qui aspirent à la vérité ? Certainement pas ! Notre République ne doit pas honorer, fût-ce en baptisant les rues de ses villages, les acteurs volontaires de souffrances infligées à tout un peuple. Comme l’illustre la formule d’Albert Camus, souvent citée, à propos de la répression de Sétif en mai 1945, « persuadons-nous qu’en Afrique du Nord comme ailleurs, on ne sauvera rien de français sans sauver la justice ». Il est donc temps de s’atteler à cette rude bataille, celle de la mémoire, sans haine, sans amertume, sans sentiment de vengeance
|
|
France: une rue pour honorer les tortionnaires Par Didier Daeninckx Newsport, vendredi 7 juillet 2000 « Dernières Nouvelles d’Alsace », 02.07.2000. Inauguration de la rue « gégèneral Bigeard » le 1er juillet 2000 à Trimbach. Samedi premier juillet 2000, la commune alsacienne de Trimbach a inauguré, en sa présence, une rue du Général Bigeard. Celui-ci en a profité pour revendiquer la nécessité des exactions menées, sous ses ordres, par les parachutistes pendant la guerre d’Algérie. Le supplice de la gégène (la torture au moyen de la magnéto), devient dans sa bouche « une machine à passer les messages ». Un demi siècle après, il ne regrette pas les exécutions sommaires: « c’était fait d’une façon technique et la plus propre possible voilà ». A l’époque de ces meurtres, de ces violations massives des droits de l’individu, ceux qui comme Henri Alleg avec son livre La Question dénonçaient la torture étaient traînés devant les tribunaux. Aujourd’hui, ce sont les tortionnaires qui sont honorés. Bigeard, qui niait au moment des faits, avance aujourd’hui que la torture se pratiquait sous contrôle médical, que son supérieur le général Massu l’avait « essayé » en disant: « Allez, ça ne fait pas mal, je ne suis pas mort ». Un groupe d’enseignants de l’université de Strasbourg qui porte le nom de l’historien Marc Bloch, torturé par les nazis, rappelle la logique cumulative et contradictoire de la dénégation mise en lumière par Freud: « ce n’est pas vrai, d’ailleurs c’était nécessaire, et de toute façon ça ne fait pas mal », pour conclure: « ce serait comique, si ce n’était effrayant ». De nombreuses autres voix s’élèvent en Alsace pour exiger que soient déposées les plaques infâmantes. L’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance, le Parti Communiste, et l’Association des Travailleurs Maghrébins de France qui propose d’honorer, en lieu et place d’un promoteur de la torture, l’une de ses victimes (voir notre article « Torturés par Le Pen »). Le maire de Trimbach, qui se prétend sans étiquette, a répondu: « Je ne suis pas communiste et je ne laisserai pas dicter les noms des rues par les communistes ». Quelques heures plus tard, le général Bigeard était à Wissembourg, en compagnie du député RPR alsacien François Loos, pour commémorer les combats de la seconde guerre mondiale. Le général a sûrement évité de leur rappeler ce qu’il écrivait à ses paras partis en opération pour le réveillon du 24 décembre 1955: « Perdus en montagne, dans le froid, dans la pluie, vous faites inconsciemment de grandes choses. Cette opération, ajoutée aux autres, vous rendra forts, sains, aussi résistants que le cuir, aussi durs que l’acier ». C’est tout simplement que s’il avait copié ses méthodes, il avait aussi plagié l’auteur, Adolf Hitler, qui déclarait, lui, lors des Journées nationales de Nuremberg, en 1935: « Je vois le jeune Allemand de l’avenir sous les traits d’un être souple et svelte, rapide comme le lévrier, résistant comme le cuir, dur comme l’acier Krupp ». La plaque Bigeard? Je vous salis ma rue… ©www.amnistia.net |
|
Le Monde Diplomatique – juin 2001 Du Tonkin à Alger, des « violences de détail »
Par ALAIN RUSCIO« LA torture judiciaire, l’affreuse torture du Moyen Age, sévit non seulement à Madagascar, mais au Tonkin et au Soudan français. » Ce témoignage du député Paul Vigné d’Octon date de… 1900 (1). Preuve, si besoin est, que la torture n’a pas commencé avec le général Massu. Pas plus qu’elle ne s’est limitée à l’Afrique du Nord. Certes, durant la guerre d’Algérie, entre 1954-1955 et 1962, la torture a été crescendo un moyen massif de terreur, allant bien au-delà des rangs nationalistes ou « rebelles ». Mais si la focalisation du débat sur cette guerre à nulle autre pareille est largement justifiée, c’est l’ensemble de la colonisation qui doit être remis en question. La France officielle, de la monarchie de Juillet (1830) à la République de mai (1958) a organisé, suscité ou laissé se développer, selon les cas et selon les périodes, l’usage de la torture, de Hanoï à Nouméa, de Tananarive à Dakar, de Rabat à Tunis. Pour expliquer une telle généralisation, il faut revenir au coeur des mentalités coloniales (2). La conquête achevée, la « pacification » assurée, la France coloniale, imprégnée dans toutes ses fibres de sa « mission » (délivrer des territoires entiers du règne des ténèbres), est persuadée qu’elle est en train de réussir. Elle est fière de son bilan. Les « masses indigènes » lui sont, sans contestation possible, reconnaissantes. Elles profitent de la « paix française », qu’elles peuvent comparer aux misères et aux injustices du passé. Si, malgré tout, mouvements de protestation il y a, ils sont provoqués par des « meneurs » manipulés par « l’étranger » trouvant quelque intérêt suspect à menacer l’harmonie. Ces fauteurs de troubles ne représentent, par définition, qu’une infime minorité. La répression se transforme donc, non en une manifestation de brutalité contre un peuple, mais en acte d’autodéfense contre des éléments malsains, la lie (politique et sociale) de la population. La torture est fille naturelle de cet argumentaire : pour éviter que la lèpre n’attaque un organisme présumé sain, il faut isoler les germes menaçants, les extirper de l’organisme. En 1933, Albert de Pouvourville, grande plume « indochinoise », écrivain très connu des cercles coloniaux, écrit : « Il est évident qu’il ne sera jamais possible de rallier les nationalistes irréductibles. Il n’y a pas, en ce qui concerne cette catégorie d’individus, de réforme qui tienne (…). La seule politique à suivre à leur égard est celle de la répression impitoyable (…). Tout indigène qui se pare de l’étiquette révolutionnaire doit être hors la loi ; il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque à ce sujet. Il est heureusement certain que le nombre de ces irréductibles n’est pas élevé, quelques centaines au plus pour le Nord-Annam, mais ils sont très ardents. Ce nombre augmenterait très vite si, par une générosité mal calculée, nous commettions la faute de composer avec eux, de leur témoigner de l’indulgence (3). » Et comment faire, sinon utiliser d’emblée les méthodes les plus violentes pour isoler de tels germes ? Parlant ainsi, le colonisateur construit lui-même le piège dans lequel il va s’enfermer. Il met sur la réalité (une nation rebelle) un masque opaque (le grand mythe de la minorité agissante). Seulement voilà : cette « minorité » est de plus en plus nombreuse et de plus en plus agissante. Plus le mouvement national croît, plus le divorce entre discours colonial et réalité est criant. Petit à petit, l’habitude s’installeDÈS la période de la conquête, il n’est pas rare que l’on ait recours à des méthodes d’interrogatoire cruelles. Petit à petit, l’habitude de violenter les suspects, sous n’importe quel motif, s’installe. Comme l’écrit Alexis de Tocqueville, au tout début de l’occupation de l’Algérie : « Du moment où nous avons admis cette grande violence de la conquête, je crois que nous ne devons pas reculer devant les violences de détail qui sont absolument nécessaires pour la consolider (4). » « Détail », le mot sonne étrangement à nos oreilles… En Indochine, l’affrontement atteint un premier paroxysme. Dans les années 1930, les prisons débordent littéralement. Accompagnant Paul Reynaud, le ministre des colonies, Andrée Viollis, journaliste alors fort célèbre et peu suspecte d’extrémisme, rapporte de son voyage un livre explosif, Indochine S.O.S. (5). « Il y a, écrit-elle, des tortures qu’on peut appeler classiques : privation de nourriture avec ration réduite à 30 grammes de riz par jour, coups de rotin sur les chevilles, sur la plante des pieds, tenailles appliquées aux tempes pour faire jaillir les yeux des orbites, poteau auquel le patient est attaché par les bras et suspendu à quelques centimètres du sol, entonnoir à pétrole, presse de bois, épingles sous les ongles, privation d’eau, particulièrement douloureuse pour les torturés qui brûlent de fièvre. » « Classique », en effet. Mais il y a plus « moderne ». La torture à l’électricité est, déjà, formellement attestée : « Attacher un bout de fil de fer au bras ou à la jambe, introduire l’autre bout dans le sexe ; relier un fouet aux fils de fer entrelacés à un courant électrique ; attacher une des mains du prévenu par un fil métallique que l’on branche ensuite sur le circuit… » Et Andrée Viollis de préciser que ces pratiques sont devenues journalières dans certains commissariats. Ainsi, les « gégéneurs » d’Alger n’ont rien inventé. Dans les années 1930, sous les tropiques, à l’abri du drapeau français, toutes ces méthodes dégradantes existaient bel et bien. On se doute que les explosions nationalistes de l’après-seconde guerre mondiale vont accroître encore ces pratiques. Sétif 1945, Indochine 1946, Madagascar 1947… partout, le système colonial se fendille, partout la réponse est la même. La France de 1945, qui vient de se délivrer, avec l’aide de ses alliés, de l’oppression nazie, n’a pas compris que le droit des nations à disposer d’elles-mêmes pouvait être appliqué à son empire. Elle esquisse certes une politique de réformes, mais elle tient par-dessus tout à sa souveraineté. Face à la contestation nationale qui s’exprime de plus en plus fort, elle a recours aux vieux schémas d’explication. La machine s’est emballée. Après 1945, les dirigeants français, ne sachant plus où donner de la tête, entament une généralisation de la répression qui trouvera son apogée lors de la guerre d’Algérie. Le coup de pouce initial est donné par le politique ; le contrôle des acteurs est en permanence et jusqu’au bout assuré par le politique. C’est le cas à Madagascar. On connaît désormais le film des événements : la provocation de 1947 et ses suites, la répression de masse. Ce qui est moins connu, c’est la parodie de procès qui fut alors intentée aux dirigeants du Mouvement démocratique de rénovation malgache (MDRM). Lors des débats, Me Stibbe, leur principal défenseur avec Me Douzon, dénonça sans concessions la pratique fréquente de l’interrogatoire « musclé », de la torture, pour dire le mot, qui eut lieu pendant l’instruction. Il publia plus tard de nombreux témoignages et évoquait, dans un article d’Esprit, la généralisation de ces pratiques à l’ensemble de l’outre-mer… un an avant la guerre d’Algérie : « Dans les affaires politiques, et singulièrement dans les affaires coloniales, écrit-il, l’emploi de ces procédés, qui tend à devenir systématique, demeure ignoré d’une trop grande fraction de l’opinion publique (…). Depuis 1947, il n’est guère de grands procès politiques coloniaux, à Madagascar, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, où les accusés n’aient passé des aveux à la police et ne les aient rétractés ensuite en invoquant les plus horribles tortures (6). » On se doute que l’affrontement majeur de cette même époque, la guerre d’Indochine, accroissant le fossé entre les communautés, a été un nouveau pas en avant dans l’horreur. Avec une dimension nouvelle : dans ces sombres pratiques, la police a été supplantée par l’armée. Que la torture ait été utilisée lors de ce premier des deux grands conflits de décolonisation, il suffirait pour s’en convaincre de lire la « petite phrase », passée relativement inaperçue, du tout premier témoignage du général Massu, dans Le Monde : « Quand je suis arrivé en Algérie en 1955, je me souviens de l’avoir vu [Bigeard] en train d’interroger un malheureux avec la gégène (…). Je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que vous faites là ? » Il m’a répondu : « On faisait déjà cela en Indochine, on ne va pas s’arrêter ici ! » (7). » Première preuve, sous une plume autorisée, que la torture fut au minimum utilisée, et probablement banalisée, malgré les dénégations de quelques nostalgiques. Au vu et au su de tous, ou presque. « C’est comme ça partout »EN tout cas, l’opinion publique, par bribes, commence à être informée. Dès 1945, alors que les pratiques nazies sont encore présentes dans tous les esprits, la presse se fait l’écho des méthodes détestables de la reconquête. Le journaliste Georges Altman dénonce, dans Franc-Tireur, les « représailles sauvages que les défenseurs d’un certain ordre colonial exercent envers les hommes du Viet-minh ». Puis : « On n’aura point réduit l’énorme tache de sang qui couvrait l’Europe pour laisser – parce que c’est si loin – s’étaler la tache de sang en Indochine française (8). » En 1949 éclate une affaire qui fait grand bruit, avant d’être soigneusement étouffée. Jacques Chegaray, un journaliste de L’Aube, quotidien du Mouvement républicain populaire (MRP), est envoyé en Indochine. Ce qu’il rapporte est très loin de ce qu’attendaient ses patrons : horrifié, il a recueilli le témoignage de tortionnaires qui, tranquillement, lui ont décrit diverses méthodes. Son quotidien refuse (évidemment) de publier son article. Il se tourne alors vers Témoignage chrétien, qui titre, le 29 juillet 1949 : « A côté de la machine à écrire, le mobilier d’un poste comprend une machine à faire parler. Les tortures en Indochine. » La publication de son témoignage, premier d’une longue série, dont des articles du grand savant orientaliste Paul Mus, est le signal d’une vaste polémique en France. Donc, on pouvait savoir. Les Mémoires de certains « anciens d’Indo » – même si ce corps fait généralement bloc, encore actuellement, autour des valeurs qu’il défendait de 1945 à 1954 – en témoignent. On pense évidemment au général Jacques de Bollardière, qui rencontre la torture sur le sol vietnamien. Mais il la tient pour marginale, en tout cas non généralisée, ce qui explique son maintien au sein de l’armée (9). On retrouve maintes traces de ces pratiques également sous la plume de Jules Roy. Jeune lieutenant-colonel, et déjà écrivain célèbre, il est volontaire pour l’Indochine. Ses premiers écrits ne laissent planer aucun doute sur son acceptation de la croisade anti-Viet-minh au nom de la défense du « monde libre ». Mais ce qu’il voit en Indochine refroidit ses ardeurs : « Sur toutes les bases aériennes, à l’écart des pistes, étaient construites des cahutes qu’on évitait et d’où, la nuit, montaient des hurlements qu’on feignait de ne pas entendre. Sur la base de Tourane de mon camarade Marchal, où je disposais d’une certaine liberté de mouvement, on m’avait montré cela avec répugnance : les hommes de main des renseignements s’exerçaient là. Marchal me disait : « C’est comme ça partout, c’est obligé. » Pourquoi ? Comment ? Un jour, au cours d’une nouvelle opération, comme je parcourais la zone en Jeep, j’aperçus devant une pagode un troupeau de paysans accroupis sous la garde de soldats. Je demandai à l’officier qui m’accompagnait ce que c’était. « Rien. Des suspects. » Je demandai qu’on s’arrêtât. J’allai à la pagode, j’entrai : on amenait les files de Nha Que devant les tables où les spécialistes leur brisaient les couilles à la magnéto (10). » Il s’est passé moins de cent jours entre le Genève indochinois (20 juillet 1954) et le début de la guerre d’Algérie. Pas assez de temps pour que les « mauvaises habitudes » soient oubliées… (1) Discours à la Chambre des députés, 19 novembre 1900. (2) Lire Le Credo de l’Homme blanc, Complexe, Bruxelles, 1996. (3) Griffes rouges sur l’Asie, Baudinière, Paris, 1933. (4) Lettre au général Lamoricière, 5 avril 1846, citée par André Jardin, Alexis de Tocqueville, Hachette, Paris, 1984. (5) Préface d’André Malraux, Gallimard, Paris, 1935. (6) « Le mécanisme de la répression politique », Esprit, septembre 1953. (7) 22 juin 2000. (8) 22 décembre 1945. (9) En mars 1957, il demandera à être relevé de son commandement en Algérie, pour protester contre la torture. (10) Mémoires barbares, Albin Michel, Paris, 1989.
|
|
La question Rubrique Le journal Numéro 6
Tourné en 1977, le film de Laurent Heynemann, La Question, est projeté pour la première fois à Pau, au Mélies, vingt cinq ans plus tard dans le cadre du Joli mois de mai. Le débat avec le réalisateur qui a suivi la projection du 13 mai nous a permis de mesurer à quel point la guerre d’Algérie et les tortures pratiquées par les militaires ont été et restent encore un sujet tabou, un non-dit de l’histoire contemporaine française. Adapté du livre d’Henri Alleg, le film retrace le parcours de ce journaliste qui, pour avoir pris parti contre le colonialisme français et ses méthodes en Algérie, a été arrêté en 1957 et soumis à la torture. Directeur du journal Alger Républicain, seul journal à ouvrir ses colonnes aux préoccupations des Algériens, il passe en 1956 à la clandestinité pour échapper à son interpellation. Un an plus tard, il est arrêté avec son ami Maurice Audin, professeur de mathématiques, par les parachutistes français. Détenus arbitrairement et clandestinement au centre El-biar, casernement de ces militaires, ils sont interrogés et torturés pendant un mois dans le but de leur faire avouer les noms et adresses de leurs camarades. Ils ne parleront jamais. Gégène, coups, pendaison par les pieds, privation d’eau et de nourriture leur sont infligés régulièrement mais de façon plus “précautionneuse” qu’à des dizaines d’Algériens, un mort français est à éviter ! Cependant lors d’un de ces interrogatoires, M. Audin décède et sa mort est maquillée en un simulacre d’évasion. Le cynisme avec lequel les parachutistes transmettent la nouvelle à sa femme donne la mesure du sentiment d’impunité et du devoir accompli qui les anime. Plusieurs scènes du film montrent effectivement gradés et officiels français soit complices soit complètement impuissants. L’idée que la torture est une nécessité politique est très présente dans le clan colonialiste au pouvoir afin, d’une part, d’obtenir des renseignements, d’autre part, de terroriser la population. Henri Alleg est alors transféré dans une prison et officiellement accusé d’atteinte à la sûreté de l’état, ce qui lui vaudra une condamnation à dix ans d’emprisonnement lors de son procès. Après trois refoulements à Orly, son avocat peut enfin le rejoindre à Alger et dépose une plainte pour tortures. Diligentée par les services de l’armée, elle n’aboutira pas. L’avocat et son client décident alors de faire connaître les illégalités perpétrées par les militaires français par la publication du témoignage de ce dernier. Le livre, intitulé La Question, du nom de la torture légale abolie à la veille de la Révolution française, sort aux Editions de Minuit en février 1958, deux mois après la soutenance de la thèse de mathématiques in absentia de M. Audin à la Sorbonne, en présence d’un grand nombre d’intellectuels de l’époque. Bien que saisi un mois plus tard, le livre est lu par 200 000 personnes. Le scandale éclate. Transféré en France en 1961 comme témoin dans un procès, Henri Alleg s’évade avec la complicité de ses amis. En 1962, l’amnistie prononcée simultanément au cessez-le-feu en Algérie mettra fin à sa cavale et à sa condamnation mais aussi à toute possibilité de faire la lumière sur la torture pratiquée par les militaires français, sur les exécutions sommaires et la disparition de dizaines de civils algériens, sur la responsabilité du gouvernement français dans les “évènements” d’Algérie, à la possibilité pour Madame Audin de faire éclater la vérité sur la mort de son mari. A sa sortie, le film a été interdit au moins de 18 ans et le réalisateur, à sa demande d’explications, s’est entendu répondre que si le film avait dénoncé les actes commis par le F.L.N. il n’aurait pas subi cette censure. Des bombes sont déposées dans des salles qui diffusent le film, d’autres reçoivent des menaces d’attentats. Les enfants du directeur de la salle de Montpellier sont menacés de mort. A Pau, la présence d’une caserne de parachutistes commandé par un général tortionnaire en a empêché la diffusion à sa sortie. Une visite d’Henri Alleg à Pau est prévue pour la rentrée. Il aura, c’est certain, encore beaucoup de choses à nous apprendre. Elisabeth Guillot (AMD) analyse: 21/12/2000 Torture : travail de conscience par Jacques Cheminade Lorsque j’avais vingt ans, j’ai eu honte de mon pays. Français venant d’Amérique du Sud, la révélation de la pratique quotidienne et ordinaire de la torture à travers toute l’Algérie me fit voir un visage de la France que je croyais être celui de ses bourreaux. Plus bouleversante encore fut, pour ce jeune homme que j’étais, l’absence de réaction et d’indignation, officielle ou populaire, dans ce pays que je découvrais, comme si le gouvernement, l’opposition, la police, l’armée et la population s’étaient tous résignés à un « sale boulot », dans un climat de complicité veule. Il était pourtant facile de savoir : l’on pouvait lire Pierre-Henri Simon, La gangrène ou La question, entendre les récits des appelés du contingent mal à l’aise avec leur conscience, lire L’Express et France-Observateur et voir le général Pâris de la Bollardière sanctionné pour avoir brisé le pacte de silence ou Paul Teitgen démissionner en 1957. Me penchant alors avec angoisse et détermination sur l’histoire de mon pays, je découvris la dimension de sa flétrissure coloniale. D’abord je constatai qu’on avait torturé en Algérie bien avant l’insurrection de la Toussaint de 1954, ce qui faisait tomber la justification, elle-même inacceptable, par la nécessité d’obtenir du renseignement en période de guerre. Je découvris ensuite ce que nos livres d’histoire ne disaient pas : le 8 mai 1945 à Sétif, les massacres de Madagascar. J’appris que beaucoup de nos légionnaires, et notamment des sous-officiers, avaient débuté leur carrière militaire sous l’uniforme nazi avant d’être recrutés à la hâte pour la guerre d’Indochine. Et que là-bas, la torture et les exécutions sommaires étaient devenues pratique courante, contaminant à la fois, au sein de notre armée, ceux qui allaient se battre en Algérie de notre côté et de celui du FLN. Ma conclusion fut que la torture était le produit d’un système et non pas d’excès individuels imputables à des tortionnaires de tempérament. Ces pratiques n’étaient pas réservées à l’Algérie mais constituaient un mal inéluctable émanant de la conception même de l’Empire colonial français. Je tombai alors sur un texte prophétique de Tocqueville, datant je crois du début des années 1840, dans lequel il se demandait « où aboutirait cette cascade de violences et d’injustices, sinon à la révolte des indigènes et à la ruine des Européens ». Profondément démoralisé, je songeai alors, profitant d’une double nationalité franco-argentine, à faire mon service militaire à Buenos Aires, ou bien à repartir de France en exprimant mon refus sans chercher d’échappatoire. Cela m’apparut, cependant, comme une désertion inadmissible, une fuite devant une histoire qui m’avait pris à la gorge. Ce qui me fit me ressaisir et rester fut de mieux connaître, en France, à la fois le combat de ceux qui sauvèrent l’honneur et l’exemple de ce que Pierre Mendès-France, face aux calculs et aux calomnies, avait réussi en Tunisie et de ce que le maréchal Leclerc serait parvenu à réussir en Indochine si le pouvoir politique ne lui avait préféré l’amiral d’Argenlieu. De Gaulle, avec les imperfections et les compromissions d’un moment difficile, ainsi que l’incompréhension d’un entourage souvent défaillant, parvint enfin à extraire la France du bourbier colonial, tant en Algérie qu’en Afrique noire. Il laissa cependant en place les « réseaux Focart » et tout un affairisme néocolonial qui, de valise en valise et de régime en régime, crût, se multiplia et aboutit à créer la paralysie des institutions françaises d’aujourd’hui face à un mondialisme financier que le meilleur de notre tradition historique devrait cependant nous pousser à combattre. La gangrène politique est en effet un mal qui se propage lentement et inéluctablement, qu’on ne peut arrêter qu’en sortant le corps décomposé du placard. C’est pourquoi il est légitime que la question de la torture soit posée aujourd’hui, à condition qu’elle ne soit pas prétexte à des exercices de mauvaise conscience ou de fuite en arrière, mais d’épuration du passé pour donner sens à l’avenir. Il s’agit, en un mot, de délivrer la France d’une flétrissure qui, aujourd’hui encore, la diminue et l’empêche d’être elle-même. Il ne s’agit pas, entendons-nous bien, d’épurer le passé par peur de l’avenir mais pour mieux se battre dans l’avenir, il ne s’agit pas de se complaire dans une culpabilisation qui paralyse mais d’entreprendre un examen de conscience qui libère. Nous le devons d’abord à tous ceux que la politique coloniale française a outragés. Nous le devons ensuite à ceux qui combattirent dans notre camp et sur lesquels ne peut peser une mise en cause collective. Nous le devons enfin aux jeunes générations avides de connaître leur passé pour y trouver des points de repère. Le but est que les mémoires de la France et de l’Algérie ne soient pas des mémoires qui rentrent en guerre dès qu’elles se manifestent ou, pire encore, pratiquent un chantage autodestructeur aux crimes de l’autre. Il est aussi, chez nous, nécessaire que les quelque 10 millions d’hommes et de femmes aujourd’hui personnellement et directement concernés par ce qui s’est passé en Algérie – les soldats, le contingent français et leurs enfants, les harkis, les juifs d’Algérie et tous les musulmans algériens et leurs enfants beurs — puissent se concerter et s’entendre afin d’oeuvrer ensemble pour l’avenir. Enfin, il est indispensable aujourd’hui, pour notre identité future, de comprendre comment un pays civilisé et qui venait de subir les horreurs de l’occupation nazie, a pu lui-même tomber, par sa pratique coloniale, dans ce qu’il faut bien appeler la barbarie. Paul Thibaud, par rapport à ce défi, a très bien exprimé ce que devrait être notre tâche : « On se désidentifie au passé mauvais en envisageant, en entreprenant un avenir autre, et cette distance prise fait qu’on peut évoquer le mal parce qu’on est devenu capable d’en supporter le souvenir. » Robert Badinter nous dit de son côté : « La reconnaissance du passé, aussi tragique et douloureux soit-il, est indispensable pour l’avenir car aucune nation, pas plus qu’un être humain, ne peut durablement vivre dans le mensonge. » Concrètement, il ne s’agit pas de réclamer une repentance nationale ou de battre notre coulpe collective, mais que la France manifeste clairement sa volonté, aujourd’hui, de rompre tout lien avec son système colonial et néo-colonial. Il nous paraît étrange que, dans la France de 1956, lorsque Guy Mollet reçut les tomates d’Alger, la bonne conscience vis-à-vis de la colonisation ait été quasi totale. Aurons-nous, au contraire, le courage aujourd’hui de mener autre chose qu’une politique plus ou moins néo-coloniale, à l’échelle de l’Afrique noire et du monde ? Aurons-nous le courage d’affronter la forme que prend aujourd’hui le colonialisme financier dans le monde, ou continuerons-nous à nous y soumettre ? Là est la vraie question. En tous, cas, dans ce domaine, et où qu’il soit, François Mitterrand ne peut certainement pas être de bon conseil… Soulignons, en passant, que le tortionnaire Paul Aussaresses acquit son « expérience du renseignement » avec les colonisateurs britanniques, en Malaisie, puis fournit le témoignage de sa propre expérience en Indochine et en Algérie aux parachutistes américains, à Fort Bragg (Caroline du Nord) avant leur départ pour le Vietnam, au début des années soixante. Explorer et expliquer ce genre de « collaboration » est, aussi, une tâche à entreprendre pour nous libérer définitivement des liens qu’elle a noués. Oui, nous devons agit pour empêcher le retour de cette honte en créant les conditions politiques pour qu’elle ne puisse réapparaître. L’Etat doit décider de constituer une Commission de vérité et de réconciliation, compétente sur l’ensemble des crimes commis au nom de l’Empire français, composée entre autres de juristes, d’hommes de loi et de foi, d’hommes politiques et d’historiens. Ce geste est indispensable, car ces crimes, directement ou indirectement, ont été l’oeuvre du pouvoir politique. On ne peut donc simplement laisser aux historiens la tâche de les rechercher. On ne peut pas, non plus, envisager de solution pénale. Il reste à montrer, par la constitution de cette commission, que les pouvoirs d’aujourd’hui entendent rompre avec le passé colonial et néo-colonial de la France. Autrement, je jugerai toujours avec les yeux du jeune homme que je fus : aux actes. Car, inspiré par la mémoire, en ne cachant rien de ce qui s’est produit, c’est le parti de la vérité et de l’avenir que nous devons servir. Servant un grand projet, pour ne plus avoir honte.
|
|
Le Monde Diplomatique – March 1997
PAINFUL MEMORIES OF THE REVOLT OF 1947Deafening silence on a horrifying repressionby PHILIPPE LEYMARIE
« We used to say ‘bird’, and if the other person replied ‘fire’, they were friend. Anything else and they were foe and got killed »: this was Monja Jaona, one of the rebel chiefs, remembering. On the Saturday night of 29 March 1947, there had been surprise attacks on the Tristani police camp at Moramanga, which was on the railway line between Antananarivo and Tamatave, along with areas along the Bas-Faraony river and on the east coast town of Manakara. In spite of the element of surprise, the uprising failed elsewhere as the majority of the population did not follow suit. Father Jacques Tronchon, coordinator of the Episcopal Conference (whose book, « L’Insurrection malgache de 1947 », is still a seminal work), recalls that it took place during the rainy season, on the night of Palm Sunday. It was also fandroana time (the festival of bathing), a time for national commemoration of the era of the queens with its celebration of the mystique of fatherland, renewal, ancestor worship and traditional Malagasy values (1). France had been defeated by Germany and, no longer invincible, had to turn to its empire for support to join the Allies. General de Gaulle made a speech in Brazzaville pledging that union with France would bring citizenship rights for its peoples overseas: which did not stop the French army from carrying on with torture and massacres from Sétif to Haiphong (2). In Indochina, Ho Chi Min already felt « betrayed ». In Madagascar, all the settlers (irrespective of class) and some of the civil servants were worried about possible British or South African designs on the island and found the spectacular rise of the Democratic Movement for Malagasy Reform (MDRM) particularly hard to swallow. This movement, with its three Malagasy deputies, was both nationalistic and pacifist. Jacques Rabemananjara, the youngest of the three, remembers that the atmosphere was electric and everybody was spellbound by nostalgia for their country. Their aim was to become ever more French, without losing their Malagasy identity (3). The MDRM was led by « a decadent aristocracy of grand hovas » (4), as Paul Ramadier, the French socialist head of government, put it. In January 1947 it won the local elections and announced a council meeting for the coming April. There were two main secret societies at the time, both formed in the tide of the anti-colonialist movement: Panama (Malagasy National Patriots) and Jiny (named after a red bird which flutters from valley to valley). These intended to seize independence by force. With hindsight, however, they thought that they were prematurely drawn into battle since a group, under the control of the police had launched the signal for action, forcing them to follow suit. Most researchers now accept the theory of provocation, whether by the police or the settlers – or even the Anglo-Saxons. Jaona, Jiny’s founder in the south, is one of the few nationalist chiefs to acknowledge his responsibility in triggering what the settlers called the « rebellion » and what the Malagasies themselves were later to refer to as the « events ». He explains: « My ancestors were killed during the French occupation, shot by Senegalese firing squads. I had to fight to avenge my father. I was angry. I told myself: we went to France, fought the Germans, defended France, country of the French. Why aren’t we defending our own country? Let’s stand up and be counted. Let’s abolish forced labour. I called the people out on strike » (5). Two guerrilla zones were formed in the dense, mountainous forest of the east and then spread. A « railway battle » ensued with the collusion of some of the railway workers. Several « armies » were formed with their own « generals » and « war ministers »; and newly-demobilised soldiers led the rebels, as did many of the mpanjakas (traditional chiefs). An 18,000 strong French expeditionary force – subsequently increasing to 30,000 – landed in April. It took them a whole year to crush the nationalist guerrillas. Twenty-one months after the start of the insurrection, the last remaining rebels came out of the forest, starved and without arms, leaders or supplies. « They were trying to eliminate all the officers and you only needed a pair of trousers and shoes to be a suspect », recalls Gisèle Rabasahala, then secretary to the French lawyers of the MDRM (which subsequently took control of the committee responsible for the defence and rehabilitation of the prisoners. « It was a real bludgeoning », adds Father Tronchon; « They called it pacification once they’d flattened everything ». According to the General Staff reports, which Father Tronchon uses as the basis of his figures, the so-called pacification led to 89,000 deaths, not to mention torture, summary executions and villages forcibly evacuated and torched. At the National Assembly, the French high commissioner gave a more comprehensive estimate: 90,000-100,000 dead. Many Malagasies say the slaughter was even more extensive. The French were then perfecting new techniques of colonial warfare, particularly in terms of psychological action. Just as the French forces had tested some of their weaponry in Madagascar at the time of the 1895 conquest less than 20 years before the first world war – orchestrated by Generals Gallieni, Joffre and Lyautey, the future « victors of the Marne ». The rebels themselves were responsible for the deaths of 550 Europeans and of approximately 1,900 Malagasies. In fact, against the backdrop of the colonial war, an appalling civil war was played out in the first weeks between the nationalists and members of the Party of the Malagasy Disinherited (Padesm). This group was supported by the colonial authorities. It recruited chiefly among the mainty (blacks) and the descendants of slaves from the High Plateaux and among the inhabitants of coastal provinces. It accused the MDRM of having « fomented the rebellion in order to restore the former monarchy and the hova hegemony » (6). The three MPs from Madagascar were arrested. During their trial, Paris dismissed the charge of police provocation and retained the theory of an MDRM-organised plot: the members of parliament were sentenced to death (though later reprieved) and the movement was outlawed. In Madagascar, as in Indochina and Algeria, all contact with the nationalists was broken. Six years later came the fall of Dien Bien Phu in Indochina and the Toussaint rouge insurrection in Algeria. * Journalist (1) See Jacques Tronchon, « L’Insurrection malgache de 1947 », Karthala, Paris, 1986. The author compiled 140 testimonies and accounts and by luck had access to 22 bundles of secret archives in France. (2) See Yves Benot, « Massacres coloniaux, 1944-1950: la IVe République et la mise au pas des colonies françaises », La Découverte, Paris, 1994. (3) Extract from « L’Insurrection de l’île rouge, Madagascar 1947 », La Sept/Arte co-production, Point du jour, 1994 documentary by Danièle Rousselier and Corinne Godeau. (4) Like many politicians during French rule, Paul Ramadier confused the hovas, the bourgeoisie from the High Plateaux who held real power, with the andrianas, the nobility. An example of this was the deputy Ravohangy-Andrianavalona who was sentenced to death following the 1947 uprising. The French, particularly the socialists, tried to present themselves as the defenders of the « oppressed » Malagasies against their upper-class exploiters. This was the ideological justification for the French support for Padesm, initially an anti-nationalist movement and subsequently a model for President Philibert Tsiranana’s impending social democratic party, which allowed France to keep Madagascar in its fold during the First Malagasy Republic (1958-1972). (5) Monja Jaona, who died in 1994, fought unceasingly against « foreigners » in all forms from the 1930s onwards. He founded the Monima Party (Madagascar for the Malagasies) in 1958 and instigated a revolt in the south in March 1971. This was severely repressed by Philibert Tsiranana, the first president of the independent republic. He went on to support the Second Republic before fighting it. He was seriously wounded by the military in 1992 while leading a demonstration calling for a federalist constitution for the island. (6) See Lucile Rabearimanana, « Les événements de 1947 à Madagascar », Omaly Sy Anio, Arts Faculty review, University of Madagascar, 1988-2, Antananarivo. Translated by Judy Marchant
|
|
Le premier polytechnicien noir de France
Militaire Guadeloupéen (Pointe-à-Pître 1859-Paris 1930), Camille Morténol devait être le premier homme noir à entrer à l’école polytechnique et laissa dans l’histoire de France un brillant souvenir. Il fit ses études à Basse-Terre, chez les frères de Ploërmel et au collège diocésain récemment fondé par Mgr Lacarrière. C’est à Polytechnique qu’il devait être remarqué par le maréchal de Mac-Mahon, lequel, fidèle à la réputation de ses réparties d’une incroyable naïveté, lui aurait dit, en passant les élèves en revue : « C’est vous le Nègre ? Très bien, mon ami…Continuez ! »… Il continua en effet et, à sa sortie de l’école Polytechnique, opta pour la marine, navigua de 1882 à 1894, avant d’être envoyé à Madagascar où il participa à tous les combats, du 4 décembre 1894, date de la déclaration de guerre, au 3 juillet 1895. Chevalier de la Légion d’honneur, il n’assoira pas sa réputation seulement sur ses faits d’armes, puisqu’il participa à l’organisation de la colonie malgache, s’attirant ainsi la sympathie de Galliéni. De 1900 à 1902, il commanda la station locale du Congo français et, de 1907 à 1909, la flottille des torpilleurs des mers de Chine. Morténol sera à l’origine de bien des dispositions ( l’installation des célèbres projecteurs du mont Valérien par exemple) qui contribuèrent à sauver Paris. En 1921, il était fait commandeur de la Légion d’honneur. De l’aveu de l’un de ses chefs, un Amiral, il ne pouvait devenir un jour Général à cause de la couleur de sa peau. Il a aujourd’hui aussi des détracteurs qui voient en lui l’instrument du colonialisme français. Hors cadre de l’active dès 1917, il avait choisi de rester à Paris où il vécut entouré de gens de toutes races et de tous milieux qui tous lui vouaient une grande estime, avant de s’éteindre en 1930. CONCLUSION Cet homme qui fit preuve de beaucoup de zèle pour la France et qui a même participé à des massacres de noirs par les Français (par exemple à Madagascar), n’a pas été « récompensé » comme il aurait dû par la France dans laquelle il avait mis toute sa confiance. En effet, pour ce qu’il a fait et ce qu’il était, n’importe quel Blanc aurait terminé au grade de général. Morténol n’a obtenu que le premier grade des officiers supérieurs (c’est à dire le grade de Commandant). Nègre tu es, Nègre tu resteras !
|
|
Les parenthèses de l’Histoire : A la gloire des hŽros … Orléans, mars 1997
Les massacres ignorés de Madagascar
Cent mille morts, telle est l’évaluation du nombre des victimes de la répression franaise ˆ Madagascar en 1947 et 1948. Une sale guerre, ignorée en métropole, treize ans avant la proclamation de l’idŽpendance de « la grande ”le ». Il y a cinquante ans, la France rŽprimait l’insurrection Au soir du 29 mars 1947, commence la rŽvolte contre la prŽsence franaise. A Moramanga , sur la voie ferrŽe Tamatave-Tananarive, les insurgŽs attaquent des tirailleurs sŽnŽgalais, sans parvenir ˆ prendre leur camp. Quelques officiers sont tuŽs dans leur h™tel. Une autre action est engagŽe prs de Manakara contre des localitŽs o vivent des Franais, avec des succs limitŽs lˆ encore. Ces Žvnements suffisent ˆ entra”ner dans la lutte des masses rurales hostiles ˆ l’administration franaise et aux colons, tant il est vrai que, depuis la fin de la conqute en 1896, le sentiment national malgache est restŽ vivace. La Seconde Guerre mondiale a d’ailleurs, comme dans d’autres colonies, affaibli la domination de la mŽtropole. De Vichy, le pouvoir est passŽ aux Anglais, puis ˆ la France libre. Mais, si cette dernire a accordŽ quelques libertŽs, elle a imposŽ ˆ la population un effort de guerre jugŽ insupportable. Guerre coloniale
Au mŽcontentement dž aux rŽquisitions de main-d’oeuvre, ˆ la pŽnurie, ˆ la hausse des prix, s’ajoutent les frustrations d ‘anciens combattants malgaches rapatriŽs sans Žgards aprs de longues annŽes au service d’une France qu’ls jugent bien ingrate. Trouvant en ces soldats des cadres, la rŽvolte s’Žtend profitant de la faiblesse des effectifs militaires dans la colonie, 6 000 hommes tout au plus. Mais, ˆ la mi-avril, arrivent les premiers renforts, des parachutistes et des tirailleurs africains, soit 18 000 combattants. Le gouvernement Ramadier veut reprendre rapidement la situation en main. Opposant une armŽe moderne, dont les effectifs sont portŽs ˆ 30 000 hommes, ˆ des insurgŽs ŽquipŽs de sagaies, de machettes, de rares fusils, la guerre dure pourtant jusqu ‘ˆ la fin de 1948 et s’accompagne d’une rŽpression impitoyable. Elle frappe d’abord le MDRM (Mouvement dŽmocratique de la renovation malgache), parti lŽgal qui a trois dŽputŽs ˆ la Chambre Žlue en novembre 1946. Il veut l’indŽpendance par la voie nŽgociŽe. Hostile ˆ une rŽvolte dŽclenchŽe par des sociŽtŽs secrtes, le Panama (Patriotes nationalistes malgaches) et la Jina (nom d’un oiseau ) il a clairement mis en garde ses militants contre la lutte armŽe. Mais, pour le pouvoir politique franais, l’occasion d’Žcraser un parti nationaliste populaire est trop belle. Militants, Žlus du MDRM, sont pourchassŽs, torturŽs; malgrŽ leur immunitŽ parlementaire, les dŽputŽs Ravoahangy et Rabemananjara sont arrtŽs ˆ Tananarive ds le 12 avril. Le 6 juin, le troisime, Raseta, subit le mme sort ˆ la sortie du Palais Bourbon o la majoritŽ de ses collgues vient de voter la levŽe de son immunitŽ; seuls les dŽputŽs communistes et d’outre-mer s’y sont opposŽs. A Madagascar, les troupes franaises mnent une vŽritable guerre coloniale dont la presse mŽtropolitaine ne parle pratiquement pas. Les Franais restent dans l’ignorance de la reconqute et des atrocitŽs commises. Le bilan est particulirement lourd. 1.900 Malgaches ayant « collaborŽ avec les Franais » ont ŽtŽ tuŽs par les insurgŽs, ainsi que 500 militaires et colons Le nombre des indŽpendantistes morts est tout autre: combats, massacres, incendies de villages, tortures, famine, auraient fait pŽrir 100 000 personnes. Fin 1948, le gŽnŽral Garbey de l’Žtat-major franais parle de 86 000 victimes, mais en 1960, on annonce officiellement 11 342 morts!…
Des reprŽsailles « effroyables «
Plus Ždifiante que les chiffres est l’Žvocation des mŽthodes utilisŽes deux ans aprs la fin de la barbarie nazie. Un extrait d’article pourtant hostile aux insurgŽs, publiŽ dans France-Soir le 8 mai 1947 et lu ˆ la Chambre par le socialiste Lamine Gueye, ˆ la grande fureur de nombre de ses collgues, permet de se faire une idŽe : « Les rŽpresailles sont effrayantes. Des prisonniers malgaches sont chargŽs en avion et l‰chŽs vivants au-dessus des villages dissidents comme « bombes dŽmonstratives. A d’autres endroits, les rebelles, enfermŽs dans des cases, sont bržlŽs vifs ». « Les mŽthodes qui seront plus tard employŽes en AlgŽrie ont ŽtŽ utilisŽes », constate l’historien J.Planchais (1). Tout cela reste mal connu : un manuel de terminale sur deux ne fait pas la moindre allusion ˆ la rŽvolte malgache dans son chapitre sur la dŽcolonisation. Pourtant ce drame montre ˆ quel point la IV RŽpublique a eu du mal ˆ admettre l’Žmancipation des peuples de son empire colonial dŽguisŽ en « Union franaise ». Aux premires revendications indŽpendentistes, elle a toujours rŽpondu avec brutalitŽ. Craignant d’tre affaiblie par la perte de ses colonies, la France s’est alors abaissŽe d’avoir trop voulu les garder. Jean-Claude MUTEAU ,historien (1) L’Empire embrasŽ, Denš‘l Paris 1990
|
|
SEPTEMBRE 2000 17 octobre 61 : archéologie d’un silence (avant-propos)
Le 17 octobre 61, la Fédération de France du FLN appelle les Algériens de la région parisienne à manifester pacifiquement contre le couvre-feu instauré le 5 octobre par le préfet de police, Maurice Papon. 30.000 manifestants face à 7000 policiers, 12.000 arrestations, 3 morts selon le bilan officiel, plus de 300 selon le FLN. Plusieurs dizaines selon les rapports demandés par le gouvernement à la fin des années 90 : les missions Mandelkern (98) et Géronimi (99), ayant eu accès aux documents officiels, n’ont pu que constater qu’un nombre très important en avait disparu. Le gouvernement gaulliste mène une stratégie d’étouffement. C’est par le silence que Papon répond aux questions de Claude Bourdet à la séance du Conseil de Paris du 27 octobre 61. Roger Frey, ministre de l’intérieur et futur président du Conseil Constitutionnel, rejette une demande de commission d’enquête parlementaire, au motif que des informations judiciaires (toutes clôturées par des ordonnances de non-lieu) sont en cours. Les témoignages rassemblés par les éditions Maspero sont saisis chez le brocheur, avant le dépôt légal : ces livres n’existent tout simplement pas. Vérité-Liberté, Les Temps Modernes et Partisans sont saisis. Les projections d’Octobre à Paris de Jacques Panijel sont interdites ; un film réalisé par la Radio-Télévision Belge est déprogrammé, les pellicules disparaissent. La presse communiste (Libération et L’Humanité) fait état des violences policières, mais renonce à publier in extenso des témoignages, pour éviter la saisie. Le Monde et Le Figaro s’indignent des » violences à froid sur les manifestants arrêtés « , mais » comprennent les brutalités policières à chaud « . Quelques mois plus tard, le 8 février 62, neuf morts au métro Charonne lors d’une manifestation contre les attentats de l’OAS. Français ni musulmans ni d’Algérie, pour la plupart communistes et syndiqués, ils seront enterrés par près d’un demi-million de personnes. Sans doute auraient-ils été qualifiés d' » innocents » par ce Monsieur Barre qui eut Papon comme ministre du budget. Seul le représentant de la CFTC évoquera à l’enterrement les morts anonymes d’octobre. Pendant deux décennies ce sont les témoins, directs ou indirects, qui insisteront : Pierre Vidal-Naquet en 72 (La torture dans la République), Georges Mattei, membre des réseaux de soutien au FLN, l’un des rares Français auxquels la Fédération de France du FLN avait demandé d’être présents sur le parcours de la manifestation, qui réalise (avec Jean-Louis Péninou) un dossier dans Libération (le 17 octobre 80 puis le 17 octobre 81). Au milieu des années 80, avec l’échec de l’intégration à la SOS-Racisme, les jeunes issus de l’immigration questionnent leurs parents : s’en fait l’écho le dialogue entre Mohamed Hocine, fondateur du Comité contre la double peine, et son père, filmé dans Douce France, la saga du mouvement beur. En 91, de jeunes militants (Anne Tristan, Agnès Denis, Mehdi Lallaoui et le collectif Au nom de la mémoire) écrivent un livre puis réalisent un film, Le silence du fleuve. La même année paraît le premier ouvrage historique, La bataille de Paris de Jean-Luc Einaudi : n’étant pas historien » professionnel » il lui faudra attendre 99 pour obtenir l’accès à certaines archives. Sur la décolonisation sous la IVe république, on attend les documents historiques d’envergure : combien d’universités françaises possèdent une chaire d’histoire de la colonisation et de la décolonisation ? Les massacres d’octobre 61, comme ceux de l’ère coloniale récente (de Sétif et Madagascar à Ouvéa), sont des crimes qui ne sont pas nommés, pas plus que ne le sont leurs victimes, ceux que l’on désigne sous le sigle FMA ( » Français Musulmans d’Algérie « ) ou plus couramment comme crouilles, ratons, melons, bicots, parqués dans les bidonvilles ou dans des quartiers intra-muros quadrillés en permanence. Depuis le début de cette guerre sans nom maquillée en » pacification » et » opérations de maintien de l’ordre « , les gouvernements successifs (de la SFIO de Mollet et Mitterrand aux gaullistes) entretiennent le racisme policier, militaire et civil. Ratonnades, tortures, noyades, fusillades, pendaisons : ce qui se passe en cette fin d’octobre 61 se produit en métropole depuis 54. » Le 17 est un moment, un moment seulement, dans un temps où nous étions toujours niés » disent les Algériens interrogés trente ans plus tard par Anne Tristan. En Algérie, c’est le quotidien. Un état de droit en France cohabite avec un état d’exception dans les colonies, qui s’applique aussi en métropole à ces » citoyens de l’Union » qui sont moins citoyens que les autres ; et ce consensus républicain a besoin pour fonctionner de désigner un objet de peur et de rejet : » Consentir, dit Jacques Rancière, c’est d’abord sentir ensemble ce qu’on ne peut pas sentir. » Comme ceux qui, en ce moment, en s’appelant sans papiers, mettent à mal l’identification entre clandestins et suspects, les Algériens de 61, en manifestant dans les rues de Paris, revendiquent une visibilité qui leur est interdite. En avril 56 Maurice Laban, instituteur pied-noir, ancien des Brigades Internationales et membre du Parti Communiste Algérien, rejoint les maquisards algériens. Il est tué le 5 juin 56 dans un accrochage avec une compagnie française, en même temps que l’aspirant Maillot, qui avait déserté avec un stock d’armes. Après son expulsion du département de Constantine, il avait caché des documents dans des bouteilles enterrées dans le désert. Sa femme réussira à exhumer celles que le mouvement des sables n’a pas fait disparaître. |
|
Le Monde diplomatique MARS 1997 Pages 22 et 23 LA MÉMOIRE TROUBLÉE DE L’INSURRECTION ANTICOLONIALE DE 1947 Madagascar entre nationalisme et survie
MADAGASCAR va commémorer avec ferveur, à partir du 29 mars, le 50e anniversaire d’un soulèvement qui fut l’une des premières manifestations nationalistes dans l’empire français. La répression, avec près de 100 000 morts un des grands massacres coloniaux de l’après-guerre, sur lequel la France a étendu un voile de silence , a fauché toute une génération de cadres malgaches ; et accru le trouble d’une nation jadis fière et unie, mais défaite par les intrusions étrangères, et impuissante depuis à retrouver ses équilibres ancestraux. Et avec le retour, le 9 février dernier, de l’amiral Didier Ratsiraka à la tête de l’Etat, puis la désignation, le 21 février, d’un nouveau premier ministre, M. Pascal Rakotomavo, la politique risque de s’orienter dans une direction apparemment très éloignée des vieux idéaux nationalistes. Par PHILIPPE LEYMARIE
Aux marges de l’Afrique, mais proche de l’Asie par une partie de sa population, située dans une zone stratégique, entre le Cap et le Golfe, Madagascar, la grande île du sud-ouest de l’océan Indien, tour à tour social-démocrate (Ire République), nationaliste et révolutionnariste (IIe), puis libérale, populiste et chrétienne (IIIe), se veut aujourd’hui » humaniste et écologique » pour tenter, dans un quotidien obsédé par la survie, de sauver ce qui peut l’être. » Ce 29 mars 1947, se souvient M. Guy Razanamasy, ancien premier ministre, actuellement maire de la capitale, on projetait La Bataille du rail, le film de René Clément. » Involontaire et bientôt douloureuse ironie : les insurgés avaient commencé par couper des voies ferrées ; certains d’entre eux devaient périr ensuite dans des wagons, au fil d’une répression qui – sur trois ans – a pris l’allure d’une véritable guerre coloniale (lire l’article ci-dessous). » J’avais dix- huit ans. L’insurrection nous a fait comprendre que nous étions malgaches. C’était national, pas seulement merina « , insiste M. Guy Razanamasy, dont un oncle, lieutenant rallié aux rebelles, avait été exécuté. La revendication politique du Mouvement démocratique pour la rénovation malgache (MDRM), qui, à la faveur des premières élections dans ce qui était devenu l’Union française, avait réussi à faire élire ses députés, dépassait largement les limites des Hauts-Plateaux merinas et betsileos. De même, l’insurrection armée déclenchée par des sociétés secrètes a-t-elle eu pour cadre essentiel la côte est, avec sa forêt, ses voies stratégiques de chemin de fer, ses plantations coloniales. Pendant plusieurs décennies, il n’a plus été question, officiellement du moins, de la » rébellion « , comme l’appelaient les Français, ou du tabataba (les événements), comme disaient les Malgaches. Un drame vécu par beaucoup comme une saignée doublée d’un incompréhensible malheur. Il avait fallu attendre 1967 pour que le président Tsiranana, fondateur de la Ire République, décrète pour la première fois le 29 mars » journée de deuil » mêlant bourreaux et victimes, anticolonialistes et collaborateurs, dans un même regret silencieux, comme marqué par la faute et la malédiction. A la fin des années 70, l’anniversaire commence à être célébré dans la fierté et la reconnaissance, comme » une révolution certes manquée, mais préparant la voie aux luttes nationalistes qui devaient suivre (1) « . On écrit encore parfois à Mme Gisèle Rabesahala, secrétaire générale de l’AKFM-KDRSM et infatigable animatrice du Comité de solidarité de Madagascar, à l’en-tête de » Mme la Présidente des Evénements de 1947 « , puisqu’elle avait eu à coeur, comme ministre de la culture sous la IIe République » démocratique « , de faire rechercher les charniers, dresser dans tout le pays des obélisques et apposer des stèles commémoratives. Elle souhaite, maintenant que la plupart des acteurs sont âgés ou disparus, qu’on adopte une vue plus scientifique sur cette époque et que Paris ouvre ses archives, et surtout reconnaisse cette page peu glorieuse… » Il ne s’agit pas de se recouvrir la tête de cendres. Juste accepter les faits : c’était, en proportion, comme si à l’époque on avait tué un million de Français… Pourquoi les diplomates français, invités comme tous les autres depuis 1977, n’ont-ils jamais osé participer aux cérémonies d’anniversaire ? » Assumer le passéL’AMIRAL Didier Ratsiraka, qui vient d’être réélu à la tête de l’Etat, souhaite également un geste : » J’en parlerai à la mi-mars, à Paris, au président Chirac… » Recevant à Toamasina (ex-Tamatave), sa ville natale, au cours d’une tournée dans les régions du Nord-Est, partiellement dévastées par un cyclone, il affirme que son rôle est de » préparer psychologiquement les Malgaches et les Français » à assumer ce passé : » Entre la France et l’Allemagne, il y a eu deux guerres mondiales. Cela ne les empêche pas de marcher ensemble : des troupes allemandes ont bien défilé, ces dernières années, sur les Champs-Elysées ! Ici, il y a eu les exactions, les fusillades, la répression contre des nationalistes qui croyaient leur cause juste. Mais la colonisation aussi croyait en sa mission de civilisation. » Lors de son investiture, le 9 février dernier, le président Ratsiraka a annoncé que les 4 032 combattants et mutilés survivants de cette période vont bénéficier d’une pension régulière, et que le 50e anniversaire du soulèvement de 1947 sera célébré solennellement. Il reconnaît que, côté malgache aussi, ce » travail de deuil » n’avait pu être mené à bien sous la IIe République, qu’il avait fondée et dirigée entre 1975 et 1992 : » Le passé était trop sensible. » S’imposant toujours à la vue, à des dizaines de kilomètres à la ronde, la silhouette familière mais décharnée de l’ancien Palais de la Reine, avec ses quatre tours posées sur la plus haute colline de la capitale, en est le témoignage. Cet ensemble de bâtiments royaux, pour l’essentiel en bois, a en effet brûlé corps et biens le 6 novembre 1995, ne laissant qu’une massive enveloppe carrée de pierre donnant sur le vide, là où jusqu’à la fin du siècle dernier les souveraines merinas – l’ethnie dominante des Hauts-Plateaux malgaches, qui avait fini par assurer l’unité du pays, et constituer plus tard le principal foyer nationaliste – juraient, devant cour, diplomates étrangers, soldats et sujets, qu’elles ne concéderaient pas aux étrangers » le plus petit coin de terre, pas même la surface que couvre un grain de riz « . Le spectacle de ce brasier nocturne, considéré d’emblée comme d’origine criminelle mais toujours inexpliqué, qui anéantissait un lieu sacré, témoignage de la splendeur d’antan, avec ses palais, ses objets et ses sépultures royales, avait plongé la capitale dans le désespoir et l’angoisse. » C’était notre âme qui brûlait « , se rappelle un spectateur, tandis que se passaient de main en main les quelques palanquins, tableaux, vêtements, livres ou ustensiles royaux arrachés au feu par d’intrépides jeunes gens (2). Le drame renvoyait le pays à un passé glorieux et quasi mythique, mais aussi à ses vieux démons, alors qu’une fois de plus la mémoire de l’île partait en cendres (3). » On a voulu provoquer un début de guerre civile, estime le prêtre jésuite Rémy Ralibera, et jeter dans la rue des Tananariviens pourtant fatigués des émeutes en s’en prenant à ce qu’ils ont de plus profond, quelle que soit leur caste. » Un ancien ministre avait alors » appelé les Merinas à réagir « . Mais c’était oublier, selon le prêtre, rédacteur en chef du journal catholique La Kroan’i Madagasikara, que les originaires des provinces côtières vivent le plus souvent en parfaite harmonie avec les autres habitants de la capitale, dans les quartiers ou les églises, comme en témoignent les mariages mixtes ou la composition des conseils paroissiaux ou communaux. Et qu’une » chasse aux côtiers » dans la capitale aurait tôt fait d’entraîner des représailles contre les familles de fonctionnaires ou commerçants natifs des Hauts-Plateaux, nombreux à exercer à l’intérieur du pays… Condamnés à vivre ensemble LES fondements de l’unité sont pourtant évidents pour l’historien Ignace Rakoto, ministre de l’enseignement supérieur durant treize ans sous la IIe République : une langue unique, permettant aux dix-huit tribus de la Grande Ile de parler de l’essentiel avec les mêmes mots. Et une tradition institutionnelle commune, s’appuyant sur les kabary – des adresses au peuple, suivies de réponses et de concertations – et sur un pouvoir royal élu ou héréditaire, selon les régions. L’historien y voit un signe que les Malgaches, » prisonniers de leur île « , sont condamnés à vivre ensemble, malgré une diversité due à des apports successifs de population et aux difficultés de communication : des particularismes » qui ne sont pas des obstacles à l’unité, mais au contraire sa garantie « , avec des patrimoines qu’il convient de valoriser et non d’étouffer, en faisant entrer dans les faits une décentralisation qui n’a été réussie par aucune des Républiques. Le sens des » événements » de 1947 ? » Quand on voit l’état du pays après trente-sept ans d’indépendance, c’est inimaginable ! commente le général Ramakavelo, ministre de la défense sous la IIIe République. Les gens qui se sont battus à l’époque auront eu le temps de se retourner plusieurs fois dans leurs tombes… Cela en valait-il la peine ? » Pour ce militaire rompu à la politique et écrivain à ses heures, mieux vaut se projeter vers le passé lointain : » Madagascar avait sa place dans le monde entier, au siècle dernier. Il avait une cohésion. On était conscient de nos valeurs… Aujourd’hui, alors que toutes les ambassades vantent notre potentiel minier ou humain et que les touristes nous prétendent bénis des dieux, notre vita gasy (made in Madagascar) est une appellation péjorative, et ramatoa (synonyme, au siècle dernier, de lady ) désigne la bonne… » Il est vrai que le pays est à bout. L’Etat n’assure plus les fonctions essentielles : sécurité, transport, éducation, santé. L’espérance de vie atteint à peine cinquante ans. Les trois quarts de la population, selon un rapport secret de la FAO, sont sous- alimentés. Madagascar a régressé, en 1996, à la 150e place (sur 174) dans le classement des Nations unies sur le » développement humain durable « . Moins de la moitié des enfants sont scolarisés dans le primaire, moins d’un dixième dans le secondaire. Avions et navires militaires sont immobilisés. L’économie, abandonnée presque sans contrôle à l’initiative privée, fait la part belle aux trafics de zébus, vanille, or et saphirs, qui profitent de l' » archipellisation » du pays (4). Faute d’accord avec le FMI, l’Etat s’est lancé à la recherche de financements parallèles douteux, Madagascar devenant – après les Comores, Maurice et les Seychelles – une nouvelle cible des barons de la drogue. Dans la majorité des villages, il n’y a encore ni route, ni électricité, ni poste de radio. Le prix du riz, première denrée alimentaire, a explosé : » Madagascar est un des seuls pays où le rendement de la riziculture n’a pas augmenté en trente ans « , souligne M. Jean-Hervé Fraslin, expert en crédit agricole. La capitale, Antananarivo, avec ses 1 200 000 habitants – sur 14 millions dans le pays -, est un concentré des malheurs de l’île : développement anarchique, habitat insalubre, enfants des rues (20 000 sans-abri), embouteillages, eaux contaminées, pollution de dix à cent fois supérieure aux normes de l’OMS, sous-emploi (60 % des actifs, dont de nombreux diplômés), triomphe de l’informel, insécurité, malnutrition… (5) Et, bien sûr, des inégalités criantes, l’insolente opulence des 4 x 4 rutilants importés d’Asie côtoyant le petit monde des 2- chevaux et 4L éternellement rafistolées, témoignage décati de l’ancienne prospérité néocoloniale franco-malgache… Dans un tel contexte, estime le pasteur Joshua Rakotonirainy, secrétaire général du Conseil des Eglises chrétiennes (FFKM), une notion comme le nationalisme ne peut qu’avoir » disparu de l’horizon de l’homme moyen « . Plus grave : les références morales et culturelles, par exemple le fihavanana (solidarité), qui faisaient le ciment et la dignité de la société malgache, sont de plus en plus rejetées dans une île où les » richards » se donnent en exemple et investissent la classe politique, où des évangélistes d’andafy (outre-mer) font recette à grand renfort de moyens douteux, et où les sectes se multiplient (6). Les Eglises traditionnelles, au contraire, cèdent du terrain, après s’être brûlées au contact de la politique (7). Mais, sur fond de mondialisation galopante et après la signature, en novembre dernier, d’un accord avec le FMI, suivant quatre ans de rupture, existe-t-il un espoir de développement autocentré ? Le général Ramakavelo en doute, qui recense les abandons de souveraineté exigés par le Fonds monétaire international : les entreprises du secteur public privatisées au profit des étrangers ; les experts internationaux ou français à nouveau imposés dans les ministères ; les aides publiques qui transitent de plus en plus par des centaines d’ONG, plus ou moins sérieuses, faisant souvent le lit de l' » ingérence humanitaire » ; le libre accès à la propriété, pour les non-nationaux, et la libéralisation des visas (alors même que l’Europe se barricade et humilie les élites francophones) ; la politique du » ciel ouvert « , avec le débarquement des » Jumbo » de la compagnie française Corsair, qui menace l’existence même d’Air Madagascar, obligée de renoncer progressivement à ses dessertes de » service public » sur les contrées isolées de la Grande Île ; l’abandon du contrôle des changes et des prix. Le tout légalisé par huit projets de loi adoptés à la va-vite, par l’Assemblée, en août 1996. » La fierté nationale, l’insurrection de 1947 : tout cela est si loin… « , conclut le général. Retour à l’ajustement structurelLE président Didier Ratsiraka, rescapé d’une expérience malheureuse de » socialisme révolutionnaire « , rappelle que, dès 1983, il avait négocié » pied à pied « , lui, les premières facilités d’ajustement structurel avec le FMI. Il compte poursuivre, dans la ligne du » Document-cadre de politique économique » récemment préparé en collaboration avec les institutions de Bretton Woods, mais avec » quelques adaptations « , et surtout en ramenant la discipline : » On ne peut s’enrichir impunément sur le dos des autres « , lance-t-il, en faisant valoir que l’affairisme, au temps de » sa » IIe République, n’était que » pêché véniel « , à côté des trafics, coulages et autres scandales de la IIIe. Le chanteur Rossy, sacré pour la deuxième fois » meilleur artiste de l’année » par le principal quotidien de la capitale, et véritable » tombeur » de l’ancien président Albert Zafy, avec son tube Lera (C’est l’heure !), veut y croire lui aussi . » Je suis né avec l’indépendance, je suis un pur produit de la période socialiste « , dit cet originaire de la côte, âgé de trente-cinq ans et habitué des tournées internationales, dont l’enfance a été bercée par les défilés et spectacles politiques . » A l’école, on apprenait L’Enfant noi r, de Camara Laye, Emile Zola, la théologie de la libération, Mandela. Pour nous, 1947 avait un sens. Et on retenait du premier Ratsiraka qu’il avait su dire « Non » aux Vazahas (les Blancs) : on tient ça de lui (8). » Déçu – comme beaucoup de sa génération, et de la précédente – par l’expérience socialiste des années 80, Rossy avait entonné alors un chant anticorruption, baptisé L’Afrique est malade : une manière aussi, pour ce côtier, de revendiquer sa négritude, face à une haute société merina volontiers condescentante à l’égard des andevo (descendants d’esclaves) des plateaux, et plus encore à l’endroit des maintys (Noirs) de la côte. La France a cessé d’investir à Madagascar, estime M. David André Silamo, secrétaire général du Syndicat chrétien de Madagascar (Sekrima), laissant le champ libre aux Asiatiques, relayés sur place par la communauté karana (les Indo-Pakistanais), qui contrôle traditionnellement les circuits de commerce de proximité, même si elle fait les frais, périodiquement, de flambées d’hostilité populaire et subit les anathèmes nationalistes mais intéressés de la bourgeoisie » nationale ». » Pendant la colonisation, c’était tout pour les Français ; sous la Ire République, tout pour le Parti social-démocrate du président Tsiranana ; sous la IIe, tout pour l’Arema et la centrale coopérative Procoops du président Ratsiraka. Les gens n’ont pu penser à eux que depuis ces années 90 : il n’y a jamais eu autant de constructions, entreprises, trafics. L’idée de l’initiative individuelle a commencé à prendre, le goût du risque, de travailler sans l’Etat… et sans avoir peur de lui. Si le nouveau chef de l’Etat ne le comprend pas, ca va faire mal ! « , explique ce dirigeant pour qui l’action syndicale passe désormais par l’informel, le développement et l’esprit d’entreprise. Certains hommes d’affaires ont investi le champ politique : M. Heri-Zo Razafimahaleo, patron d’un groupe prospère, a créé le parti Leader. Il avoue n’avoir à proposer, en guise de programme, que ses propres succès ( » Vous allez réussir avec moi… « ), et comme méthode, celle du marketing ( » Je vends un produit… « ). Avec 15 % des voix, il avait créé la surprise lors du premier tour de l’élection présidentielle, avant de rallier au second le camp de M. Didier Ratsiraka. » Les Malgaches sont spéciaux, estime M. Jean-Aimé Rakotoarisoa, directeur de l’Institut de civilisations, à propos des chances de décollage et d’autonomie de l’île. C’est, par exemple, le seul pays du monde où la viande de porc, que l’on produit en un an, est plus chère que le boeuf… Ils ne comprennent rien au marché, ne travaillent qu’en fonction d’un besoin, évitent de paraître trop s’enrichir, mélangent les religions, colmatent toutes les brèches avec la solidarité familiale ou villageoise… » Selon lui, le courant est coupé depuis longtemps entre administration et population. » Avec ce nouveau départ, on va revenir dans le vent, redresser les équilibres, maîtriser l’inflation. Mais entre- temps, combien de cadavres ! En 1986-1987, déjà, la suppression des subventions sur les produits de première nécessité avait abouti à un génocide indirect : qui a compté les bébés mourant dans les dispensaires ou au fin fond des campagnes ? » » Dans le fond de Ratsiraka, on sent le nationalisme, même aujourd’hui « , se console Mme Gisèle Rabesahala, qui se prépare à exalter, à partir du 29 mars, l’épopée dramatique de ses compagnons lors de l’insurrection de 1947. » On ne peut penser à un redressement national sans tenir compte des traditions, de la culture. » La secrétaire générale du parti AKFM, héritier de 1947, n’est pas sûre que l’idée du nouveau chef de l’Etat – une » République humaniste et écologique « , pour tenter notamment de sauver une île qui » saigne « , perdant sa terre, sa faune, ses forêts (9) – puisse être aisément comprise de l’opinion. » Certes, conclut-elle à propos des chances de son pays de rester lui-même, il y a les fourches Caudines ; mais l’atout du nouveau président, c’est d’être capable de ne pas laisser imposer tout et n’importe quoi… « PHILIPPE LEYMARIE (1) Cf. Fulgence Fanony et Noël Jacques Gueunier, » Témoins de l’insurrection « , Foi et Justice, Antananarivo, 1997. (2) Trois d’entre eux ont péri dans les flammes. (3) Cf. Françoise Raison, » La mémoire en cendres de Madagascar « , Le Monde diplomatique, décembre 1995. Ces dernières années, l’hôtel de ville, des archives judiciaires, celles du ministère des finances, ainsi que plusieurs demeures de politiciens ont été détruits par les flammes, dans des conditions qui n’ont jamais été élucidées. Les manifestants, lors de rotaka (émeutes), ont souvent recouru au feu, notamment contre des commercants karana (indo-pakistanais). Les feux de brousse, pour renouveler les pâtures ou dégager des espaces de culture, qui sont une pratique courante bien qu’ils soient interdits ont, de tout temps, constitué des signes de mécontentement ou de résistance populaire. (4) Cf. Philippe Leymarie, » Longue patience à Madagascar « , Le Monde diplomatique, octobre 1995. (5) Selon une enquête réalisée dans le cadre du projet » Madio « , 62 % des habitants de la capitale seraient en dessous des 1 810 calories, considérées comme le seuil de subsistance. » Est-ce mieux en dehors de la capitale ? « , se demande l’hebdomadaire La Kroan’ i Madagasikara ? (6) Cinq cents associations évangéliques sont officiellement constituées ( Midi- Madagascar, 26 août 1996). La Vierge Marie serait apparue à des paysans, à une centaine de kilomètres de la capitale, en novembre 1990. Et plusieurs observateurs signalent une recrudescence des cultes traditionnels. (7) Cf. Sylvie Brieu, » La Grande Île sous l’influence des Églises « , Le Monde diplomatique, octobre 1995. (8) Le capitaine de frégate Didier Ratsiraka, attaché militaire à Paris, nommé ministre des affaires étrangères après les manifestations anti-françaises de 1972 et 1973, avait dénoncé les » accords d’esclavage » avec la France, et obtenu l’évacuation des bases militaires françaises de Tananarive et Diego-Suarez, alors commandées par le général Marcel Bigeard. De nouveaux accords de coopération, plus équilibrés, avaient été négociés, en dépit de l’hostilité de M. Michel Debré, alors minist des affaires étrangères. (9) L’expression a notamment été utilisée par les premiers astronautes américains, apercevant les torrents de boues rouges s’écoulant dans l’océan. Mais on parlait depuis le siècle dernier de l' » île rouge « .
Le silence coupable et persistant de l’ensemble des francais (a quelques exceptions pres) sur les crimes actuels et passes de la France en Afrique est la preuve d’une collaboration continue des francais, comparable a celle sous le regime de Vichy ! Pour commencer, des nouvelles de Survie : Billets d’Afrique numero 87, page 6 : « Crimes contre l’humanite « [Le processus de reparation envers les victimes de la Shoah s’inscrit dans] un processus specifique engage avec la reconnaissance tardive de la responsabilite de la France dans la persecution des juifs […] [La France doit] veiller a ce que d’autres moments sombres de [son] histoire fassent l’objet du meme effort [notamment la torture pendant la guerre d’Algerie] ». (Lionel JOSPIN, intervention du 4 novembre devant le Conseil representatif des institutions juives de France (Crif). Cite par Liberation, 06/11/2000. [Passant de 1940-45 a 1954-62, on finira bien par arriver aux crimes contre l’humanite durant la guerre d’independance du Cameroun (1957-70) et a la noria de crimes de la Francafrique. Encore un effort !] ». Le silence coupable et persistant de l’ensemble des francais (a quelques exceptions pres) sur les crimes actuels et passes de la France en Afrique est la preuve d’une collaboration continue des francais, comparable a celle sous le regime de Vichy ! Suite a vos premieres reactions : Je ne suis pas comme le Telethon ou le Sidaction (cf extraits de « Suite de l' »union fait la force »). Je ne me vente pas de donner mon argent a « une bonne cause » en participant a ces foires aux sentiments ! Je pense d’ailleurs qu’en general, la charite c’est pour mieux se flatter d’etre « genereux ». Mais comme on m’a insulte et reproche d’avoir soit disant « vendu » mon livre « Les bourreaux francais grimes en democrates » derriere mon message « Propagande du Festival Scoop Journalisme Angers contre Survie », j’estime avoir le droit et le devoir de PRECISER (pour ceux qui ne l’auraient pas devine) que mon livre me coute beaucoup de temps, d’argent (a moi, qui suis sans ressources) et surtout qu’il est gratuit ; ou bien (deuxieme possibilite) pour ceux qui le souhaitent, l’argent recolte par l’achat de mon livre (faites vos dons) sera integralement donne a Survie ! Je m’engage a cela, si vous le voulez ? Quant a mes propres dons, j’espere ne jamais avoir a vous en parler, car je veux etre fidele a l’esprit altruiste de Barbara ! Pour ceux qui rechignent a cette franche confession, une centaine de personnes peuvent temoigner du fait que je n’ai jamais vendu mon livre. Je l’ai toujours donne, a mes frais d’ailleurs ! Etant sans ressources, vous comprenez que meme en le vendant, mon combat ne perdrait pas totalement de son sens. Ce serait meme legitime et un moyen de financer la lutte pour l’Afrique ! Mais il est vrai que l’argent corromps absolument. Il est sale comme les pouvoirs incontroles ! C’est aussi pourquoi je milite pour le Revenu d’Existence Universel, evidemment finance autrement que par ceux qui nous dominent (sinon c’est un cercle vicieux : l’argent qui comble l’injustice venant de ceux qui la cree !). Et pas l’avatar capitaliste et pernicieux de ce Revenu d’Existence Universel, prone par Yoland Bresson au Monde Diplo, a L’Esprit frappeur, et a l’Association pour l’Instauration du Revenu d’Existence (AIRE)… Le vrai Revenu d’Existence Universel permettra d’eviter (un jour, je l’espere) l’hypocrisie d’une societe prostituee aux labeurs ; de rompre avec le clientelisme, la propriete sur le vivant, la propriete intellectuelle et artistique d’auteur ; de supprimer la misere… C’est seulement un des piliers de la lutte contre les dominants. Il y a beaucoup a faire ! Et deja de nouvelles reactions arrivent (peu d’etat d’ame malheureusement -comme les Vichystes, nous n’eprouvons aucun remord- mais de l’interet et des felicitations, merci). Les africains, 99 pourcents opprimes par la France, comptent sur la dissidence en France. Bien sur, certains sont a ce point inhumains qu’ils en font leur buisness, comme Michel Toko (que je nomme ici) de la defunte librairie « Le Bantu » a Rouen (cf extrait de « Document secret pour Survie sur les massacres du Cameroun »). Il n’y a rien de pire que de vouloir tirer de l’argent pour soi de la generosite des gens ou de la lutte contre les genocides ! Bien sur, moi-meme, je ne suis pas irreprochable. Vos critiques (methode scientifique) sont les bien venues. Et vous savez que je sais me mettre terriblement en cause lorsqu’il y a lieu (« vichyste des temps modernes » !). P.S : Je suis un peu maniaque, donc pour ceux qui n’ont pas eu la deuxieme version de mon message « Propagande du Festival du Scoop Journalisme Angers contre Survie », vous pouvez rajouter : « […] « Et c’est peut-etre une bonne investigation », QUOIQUE CERTAINEMENT PERIMEE ? […] « Qu’elle honte ! » ET VOUS, AVEZ VOUS CHOISIT DE FERMER LES YEUX SUR CES CRIMES ? SILENCES COUPABLES ! […] » Ci-dessous, l’extrait de : « Suite de l' »Union fait la force » C’est les meme (Claude Allegre, l’intelligentsia francaise…) qui se rejouissent, se felicitent ou participent au Telethon ou aux soirees contre le Sida, et qui, avec insolance et interet, bradent la Recherche , financee par le secteur public, aux marchands d’inegalite, les predateurs du prive (ou tyrannies privees). […] On peut meme se demander si ce n’est pas pour qu’existe le Telethon (cette foire de compassion) que l’Etat n’assure pas sa mission. […] A Rouen en decembre 1999, alors que des rafles au facies venaient d’avoir lieu (au centre commercial St Sever), les sans-papiers ont vu qu’ils n’etaient pas du meme monde. Aucune solidarite, le Telethon. Vraiment aucune. On s’est fait jeter tout simplement. Et on est meme passe pour des sauvageons ! Juste pour pouvoir parler 2 minutes, exposer la realite de la double peine, des reconduites aux frontieres… (voir message du MRAP sur les conditions indignes de detention, que je vous ai envoye precedement). Vive nos amis du Tele »con » ! ! ! […] » Ci-dessous, l’extrait de : « DOC SECRET SUR LES MASSACRES COMMIS PAR LA FRANCE AU CAMEROUN » « Faire suivre le plus possible ce message. Merci. CONFIRMATION DE L’EXISTENCE DES DOCUMENTS SECRETS SUR LES MASSACRES COMMIS PAR LA FRANCE AU CAMEROUN. Suite a mon message sur les massacres au Cameroun commis par la France (que je joints ci-dessous) un ami responsable d’Enda-Tiers Monde, neveu d’un ancien ministre du Senegal, et en contact sur Rouen avec le Collectif des Sans-papiers, me confirme l’existence de ces documents. Il a vu les documents detenus par la personne dont je parle plus bas. Par ailleurs, les editions Tahin-party m’ont motive leur interet pour ce sujet. Je leur ai donc communique comme a Survie toutes les infos. Et je me devais de prolonger mes recherches sur ces faits tres graves. J’espere trouver la reconnaissance de Survie… CES DOCUMENTS SECRETS ONT DE TRES FORTES CHANCES D’ETRE REELS. Une connaissance sur Rouen, m’a dit, a moi et a une des victimes rescapee du massacre commis au Cameroun entre 1957 et 1965 (celle-ci est en contacte avec SURVIE), qu’il avait en sa possession quelques photos jamais publiees sur ces evenements. Cette personne, je la trouve individuellement peu recommandable, mais ces documents me semblent tellement importants que je ne peux pas ne pas vous le signaler. Par securite, je ne devoilerai pas le nom de cette personne ici(pour me proteger egalement). J’espere que ces documents existent reellement. J’ai peur que cette personne veuille marchander pour sortir ces photos de la clandestinite. Je recontacte SURVIE en prive pour une information plus precise. Peut-etre ont-ils deja ete contacte par cette personne. Il lie SURVIE. Pour vous autres : Lire le livre « FRANCE AFRIQUE le crime continue » de F.X.Verschave, ed.tahin-party. P.14 est explique le massacre : « …Cette promotion de leaders amis a neanmoins ete contrariee : Au Cameroun, a cause d’un mouvement independantiste ancien et tres enracine, l’Union des peuples du Cameroun(UPC), animee par Ruben Um Nyobé. Dans ce pays, un massacre a eu lieu a partir de 1957 jusqu’en 1965, qui a fait peut-etre jusqu’a 400 000 morts, en tout cas au moins 200 000, avec une pratique systematique de la torture. Ce fut bien pire qu’a Setif, en 1945, ou à Madagascar. Cette histoire, pourtant, vous ne la connaissez pas, ni la quasi-totalite des Français : elle ne figure pas dans nos livres d’Histoire. Quarante ans apres, les Camerounais sont encore terrorises par ces evenements epouvantables. [Et l’etat psychologique de la dame que j’ai rencontre a Rouen me le confirme. Elle etait completement hysterique, poursuivit par les services secrets francais(c’est peut-etre vrai ?). Elle est tombee dans les pommes en apprenant que notre interlocuteur avait les photos du massacre qu’elle avait vecu !] Tous les leaders independantistes camerounais ont ete assassines, empoisonnes, toute une partie de la population de l’Ouest du Cameroun, la region bamileke (ou l’UPC connut son essor le plus considerable) a ete massacree. Le tout accompagne d’un discours raciste dont j’ai retrouve les traces : ce qui etait publie par l’armee francaise en 1960 sur les Bamileke, on le retrouve un tiers de siecle plus tard, pratiquement a l’identique, sur les Tutsis du Rwanda : les memes discours ont autorise les massacres de Bamileke et le genocide au Rwanda. Cette instrumentalisation du racisme, cette façon de dresser les ethnies les unes contre les autres, est une tres ancienne pratique coloniale : elle est deja explicite dans les ecrits du marechal Lyautey.(« S’il y a des moeurs et des coutumes a respecter, il y a aussi des haines et des rivalites qu’il faut demeler et utiliser a notre profit, en opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres ». Lyautey, cite par Daniel Tessue. »Polemique autour du probleme bamileke », La nouvelle Expression, 11 juillet 1995.) C’est une pratique permanente : n’oublions pas que les principales troupes françaises en Afrique, les regiments d' »infanterie de marine », sont les memes qu’on appelait autrefois « infanterie coloniale ». [Et j’ai soigne au CHU de Rouen un des soldats qui a tue pour la France, a Djibouti. Il avait fait la legion etrangere (les « entrainements » en Guyane, le lavage de cerveau…). Aucun remords d’avoir tue. Il n’etait a cette epoque la, « plus un homme », juste un « animal » selon son expression. Le celebre Lafesse aussi est alle a Djibouti. Lui aussi sait a quoi ça ressemble un soldat (les viols, bastonnades…). Le type que j’ai soigne a sympathise avec un ancien de la marine justement. C’est pour ca que j’en parle. Un type metisse, qui avait chope un virus lors de ces trajets entre l’Europe et l’Afrique, l’Amerique Centrale. il se retrouve aujourd’hui avec un anus artificiel. La condition de ces types est pitoyable. L’autre aussi a un anus artificiel. Jusqu’a 30 ans, ils ont un physique à la « Tyson », ensuite c’est la decomposition. Je n’ai pas vu de blessures de guerre, juste quelques cicatrices a droite a gauche. Ce devait etre les « reliquats » de l’intervention chirurgicale. Mais surtout ce qui m’a etonne, c’est qu’il sympathisait avec le type metisse, alors meme qu’il tenait des propos racistes (insupportables pour mes oreilles), contre les arabes, les noirs… ! Il avait retourne un cafe a Paris, juste parce qu’un arabe lui avait effleure la jambe. Le cafe etait detruit et l’arabe a l’hopital. Notre soldat, lui, a fait un mois de trou. Des histoires comme ca ils peuvent en raconter des centaines. Lui n’a pas voulu me parler de Djibouti. Les soldats n’en parlent apparement qu’entre eux, ou le garde a jamais au fond de leur memoire. Il faudrait pourtant reveler chacun des crimes commis par notre armee.] Depuis 1945, elles ont fait l’Indochine, l’Algérie, puis l’Afrique… Et malgre tout ce qui s’est passe, les massacres de Setif, de Madagascar, du Cameroun, la torture en Algerie, dans les colonies et neo-colonies, jamais ou presque il n’y a eu de sanction. Tout a ete couvert par l’amnistie, ou simplement par une impunite systematique. pourquoi les schemas et les habitudes changeraient-ils, puisqu’il n’y a jamais eu de condamnation ? Au Cameroun, le massacre des populations favorables a une reelle independance a permis de mettre en place Ahmadou Ahidjo, un « ami » de la France. » F.X.Verschave On peut egalement lire Mongo Beti, ancien prof. de francais au lycee Corneille de Rouen : « Main basse sur le Cameroun », « La France contre l’Afrique »… Il me semble d’apres SURVIE et autres que la situation actuelle du Cameroun est toujours la même, ou pire ? Foccart ou Mitterrand, par dela leur mort, sont malheureusement omnipresents… relayes par Chirac, Pasqua, Elf… Lisez SURVIE, vous verrez que la realite depasse la fiction. L’humanitaire est un pretexte a l’imperialisme. Exemples : = antidemocrature.org
|
|
http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/mada/decok.htm LA DECOLONISATION ACCEPTEE I L’AOF (l’Afrique occidentale française), L’AEF (l’Afrique équatoriale française) ET MADAGASCAR
la Constitution de la IV° république a institué l’Union française et l’AOF, l’AEF et Madagascar en fait partie depuis 1946. De ce fait toutes trois sont membres de plein droit de la République, tandis que le Togo et le Cameroun ont un statut d’associés. Tous ces pays sont représentés à l’Assemblée Nationale et au Conseil de la République, mais les structures administratives de la colonisation demeurent : L’AOF et l’AEF conservent à leur tête par un gouverneur général, le droit de vote est limité aux chefs de famille payant l’impôt et aux mères de deux enfants. Ces mesures, parmi d’autres, provoquent des réactions de l’élite indigène, et au référendum du 13 octobre 1946 dans les colonies une majorité de non s’exprime. Une révolte a lieu à Madagascar en mars 1947 ; elle est durement réprimée. C’est le déclenchement de la guerre d’Algérie qui accélère le processus d’émancipation. La première étape est la loi-cadre Deferre de Juin 1956 : des assemblées et des conseils de gouvernement compétents sont créés pour régler certains problèmes intéressant les territoires et le suffrage universel est instauré. Cela permet à des hommes comme Felix Houphouêt-Boigny en Côte d’Ivoire ou Léopold Senghor au Sénégal de fonder leurs propres partis et d’avoir une audience populaire plus large. L’exemple du Togo et du Cameroun, territoires sous tutelle de l’ONU, bénéficiant d’une large autonomie interne et la mise en place de la V° République, fournissent l’occasion de modifier la statut de l’Afrique noire. Au référendum du 28 septembre 1958, la Guinée En décembre 1959 le général de Gaulle reconnaît aux Etats membres le principe de la pleine souveraineté internationale et lance l’idée d’accords particuliers de coopération entre ces pays et la France. Tous les Etats africains proclament leur indépendance en 1960. L’AOF et l’AEF disparaissent, les pays émancipés voient dans les accords de coopération bilatérale avec la France l’occasion d’obtenir une aide à leur développement économique et à la formation de leurs futurs cadres. II La Tunisie et le Maroc Leur accession à l’indépendance se fera en 1956. Le Maroc : En avril 1947 à Tanger, le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef affirme sa volonté d’indépendance et tente de négocier directement avec le gouvernement français sans en informer le résident. Les réformes mises en place sont mal accueillies par les Européens et suscitent la méfiance de l’Istiqlal, parti indépendantiste le plus puissant du pays. Le sultan de son côté s’oppose au résident en refusant de signer les dahirs qu’il propose et bloque la machine gouvernementale. Des extrémistes ( « Présence Française » soutenus par une majorité d’Européens et quelques notables marocains), hostiles à l’indépendance du Maroc, dénoncent de plus en plus violemment le sultan, les nationalistes et quelques français libéraux. Des attentats, des grèves parfois sanglantes se succèdent alors. Le sultan est déposé en août 53 et exilé à Madagascar. Pendant l’été 1955 les attentats et les massacres s’intensifient, les Marocains et les nationalistes réclament le retour de leur souverain. Des négociations ont lieu et en novembre 1955, Sidi Mohammed Ben Youssef rejoint le Maroc. Le 2 Mars 1956 un accord est signé : il résilie le traité de protectorat de 1912 et reconnaît l’indépendance du Maroc. Une « interdépendance des deux pays dans les domaines où leurs intérêts sont communs (défense, relations extérieures, économie et culture) » est établie. Parallèlement un accord est conclu avec l’Espagne en avril 56. La Tunisie : Le parti Néo-Destour et son chef H Bourguiba, bénéficiant de l’appui de la ligue arabe et des sympathies de l’opinion internationale lancent, dès 1945, des actions qui visent l’obtention de l’indépendance. La France refuse d’écouter les revendications tunisienne et la situation s’envenime en 1952. Attentats, grèves et manifestations se succèdent, ils sont réprimés avec violence. Bourguiba est arrêté et placé en résidence surveillée jusqu’en 1954. Pierre Mendes France, président du Conseil, soucieux de régler le conflit et le considérant comme le seul interlocuteur valable le fait libérer, et négocie avec lui. En 1955 la France reconnaît l’autonomie interne de la Tunisie, puis son indépendance en 1956. Les accords du 20 Mars confèrent à la Tunisie (comme au Maroc) » l’indépendance dans une interdépendance librement consentie ». Ces nouveaux accords seront troublés par la guerre d’Algérie et la capture de l’avion marocain qui transportait les chefs historiques de l’insurrection algérienne (Ben Bella, Ait Ahmed et Khider) du Maroc en Tunisie.
La torture routinière de la République coloniale. par Alain Ruscio – Historien, auteur, notamment, de La Guerre française d’Indochine (1945-1954). Les sources de la connaissance, éditions Les Indes savantes, à paraître en 2001. article paru dans Manière de voir n°58 – juillet / août 2001 « LA TORTURE JUDICIAIRE, l’affreuse torture du Moyen Age, sévit non seulement à Madagascar, mais au Tonkin et au Soudan français. » Ce témoignage du député Paul Vigné d’Octon date de… 1900 (1). Preuve, si besoin est, que la torture n’a pas commencé avec le général Massu. Pas plus qu’elle ne s’est limitée à l’Afrique du Nord. Certes, durant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962, la torture a été crescendo un moyen massif de terreur, allant bien au-delà des rangs nationalistes ou « rebelles ». La focalisation du débat en cours sur cette guerre à nulle autre pareille est donc largement justifiée, mais c’est l’ensemble de la colonisation qui doit être remis en question. La France officielle, de la monarchie de Juillet (1830) à la république de Mai (1958), a organisé, suscité ou laissé faire, selon les cas et selon les périodes, l’usage de la torture, de Hanoï à Nouméa, de Tananarive à Dakar, de Rabat à Tunis. Pour expliquer une telle généralisation, il faut revenir au coeur des mentalités coloniales (2). La conquête achevée, la » pacification » assurée, la France coloniale, imprégnée dans toutes ses fibres de sa » mission » (délivrer des territoires entiers du règne des ténèbres), est persuadée qu’elle est en train de réussir. Elle est fière de son bilan. Les « masses indigènes » lui sont reconnaissantes. Elles profitent de la » paix française », qu’elles peuvent comparer aux misères et aux injustices du passé. Si, malgré tout, mouvements de protestation il y a, ils sont provoqués par des » meneurs » manipulés par » l’étranger » trouvant quelque trouble intérêt à menacer l’harmonie. Ces fauteurs de troubles ne représentent, par définition, qu’une infime minorité. La répression se transforme donc, non une manifestation de brutalité contre un peuple, mais un acte d’autodéfense contre des éléments malsains, la lie (politique et sociale) de la population. Isoler les germes menaçants LA TORTURE EST FILLE NATURELLE de cet argumentaire: pour éviter que la lèpre attaque un organisme présumé sain, il faut isoler les germes menaçants, les extirper de l’organisme. En 1933, Albert de Pouvourville, grande plume indochinoise, écrivain très connu des cercles coloniaux, écrit: » Il est évident qu’il ne sera jamais possible de rallier les nationalistes irréductibles. Il n’y a pas, en ce qui concerne cette catégorie d’individus, de réforme qui tienne (…). La seule politique à suivre à leur égard est celle de la répression impitoyable (…). Tout indigène qui se pare de l’étiquette révolutionnaire doit être hors la loi; il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque à ce sujet. Il est heureusement certain que le nombre de ces irréductibles n’est pas élevé, quelques centaines au plus pour le Nord-Annam, mais ils sont très ardents. Ce nombre augmenterait très vite si, par une générosité mal calculée, nous commettions la faute de composer avec eux, de leur témoigner de l’indulgence (3). » Et comment faire, sinon utiliser d’emblée les méthodes les plus violentes pour isoler de tels germes ? Parlant ainsi, le colonisateur construit lui-même le piège dans lequel il va s’enfermer. Il met sur la réalité (une nation rebelle) un masque opaque (le grand mythe de la minorité agissante). Seulement voilà : cette » minorité » est de plus en plus nombreuse et de plus en plus agissante. Plus le mouvement national croît, plus le divorce entre discours colonial et réalité est criant. Dès la période de la conquête, il n’est pas rare que l’on ait recours à des méthodes d’interrogatoires cruelles. Petit à petit, l’habitude de violenter les suspects, sous n’importe quel motif, s’installe. Comme l’écrit Alexis de Tocqueville, au tout début de l’occupation de l’Algérie: « Du moment où nous avons admis cette grande violence de la conquête, je crois que nous ne devons pas reculer devant les violences de détail qui sont absolument nécessaires pour la consolider (4). » Détail, le mot sonne étrangement à nos oreilles… En Indochine, l’affrontement atteint un premier paroxysme. Dans les années 1930, les prisons débordent. Accompagnant Paul Reynaud, le ministre des colonies, Andrée Viollis, journaliste alors fort célèbre et peu suspecte d’extrémisme, rapporte de son voyage un livre explosif, Indochine S.O.S. (5) « Il y a, écrit-elle, des tortures qu’on peut appeler classiques: privation de nourriture avec ration réduite à trente grammes de riz par jour; coups de rotin sur les chevilles, sur la plante des pieds, tenailles appliquées aux tempes pour faire jaillir les yeux des orbites, poteau auquel le patient est attaché par les bras et suspendu à quelques centimètres du sol, entonnoir à pétrole, presse de bois, épingles sous les ongles, privation d’eau, particulièrement douloureuse pour les torturés qui brûlent de fièvre. » « Classique », en effet. Mais il y a plus « moderne ». La torture à l’électricité est, déjà, formellement attestée: « Attacher un bout de fil de fer au bras ou à la jambe, introduire l’autre bout dans le sexe; relier un fouet aux fils de fer entrelacés à un courant électrique; attacher une des mains du prévenu par un fil métallique que l’on branche ensuite sur le circuit »… Et Andrée Viollis de préciser que ces pratiques sont devenues journalières dans certains commissariats. Ainsi, les « gégéneurs » d’Alger n’ont rien inventé. Dans les années 1930, sous les tropiques, à l’abri du drapeau français, toutes ces méthodes dégradantes existaient bel et bien… Les explosions nationalistes de l’après-seconde guerre mondiale vont accroître ces pratiques. Sétif 1945, Indochine 1946, Madagascar 1947… partout, le système colonial se fendille, partout la réponse est la même. La France de 1945, qui vient de se délivrer, avec l’aide de ses Alliés, de l’oppression nazie, n’a pas compris que le droit des nations à disposer d’elles-mêmes pouvait être appliqué à son empire. Elle esquisse certes une politique de réformes, mais elle tient, par-dessus tout, à sa souveraineté. Face à la contestation nationale qui s’exprime de plus en plus fort, elle a recours aux vieux schémas d’explication. La machine s’est emballée. Après 1945, les dirigeants français, ne sachant plus où donner de la tête, entament une généralisation de la répression qui trouvera son apogée lors de la guerre d’Algérie. Le coup de pouce initial est donné par le politique; le contrôle des acteurs est en permanence et jusqu’au bout assuré par le politique. C’est le cas à Madagascar. On connaît désormais le film des événements : la provocation de 1947 et ses suites, la répression de masse. Ce qui est moins connu, c’est la parodie de procès qui fut alors intenté aux dirigeants du Mouvement démocratique de rénovation malgache (MDRM). Lors des débats, Maître Stibbe, leur principal défenseur avec Maître Douzon, dénonça sans concessions la pratique fréquente de l’interrogatoire « musclé », de la torture pour dire le mot, qui eut lieu pendant l’instruction. Il publia plus tard de nombreux témoignages et évoquait, dans un article d’Esprit, la généralisation de ces pratiques à l’ensemble de l’outre-mer… un an avant la guerre d’Algérie : « Depuis 1947, il n’est guère de grands procès politiques coloniaux, à Madagascar, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, où les accusés n’aient passé des aveux à la police et ne les aient rétractés ensuite en invoquant les plus horribles tortures (6). » On se doute que l’affrontement majeur de cette même époque, la guerre d’Indochine, accroissant le fossé entre les communautés, a été un nouveau pas en avant dans l’horreur. Avec une dimension nouvelle : dans ces sombres pratiques, la police a été supplantée par l’armée. Que la torture ait été utilisée lors de ce premier des deux grands conflits de décolonisation, il suffirait pour s’en convaincre de lire la « petite phrase », passée relativement inaperçue, du tout premier témoignage du général Massu, dans Le Monde : « Quand je suis arrivé en Algérie en 1955, je me souviens de l’avoir vu (Bigeard) en train d’interroger un malheureux avec la gégène (…). Je lui ai dit: Mais qu’est-ce que vous faites là ? Il m’a répondu: On faisait déjà cela en Indochine, on ne va pas s’arrêter ici! (7). L’opinion publique, par bribes, commence à être informée. Dès 1945, alors que les pratiques nazies sont encore présentes dans tous les esprits, la presse se fait l’écho des méthodes détestables de la reconquête. Le journaliste Georges Altman dénonce, dans FrancTireur, les » représailles sauvages que les défenseurs d’un certain ordre colonial exercent envers les hommes du Viet Minh « . Puis: » On n’aura point réduit l’énorme tache de sang qui couvrait l’Europe pour laisser- parce que c’est si loin – s’étaler la tache de sang en Indochine française (8). « Une machine à faire parler » EN 1949 ÉCLATE UNE AFFAIRE qui fait grand bruit, avant d’être soigneusement étouffée. Jacques Chegaray, un journaliste de L’Aube, quotidien du Mouvement républicain populaire (MRP), est envoyé en Indochine. Ce qu’il rapporte est très loin de ce qu’attendaient ses patrons : horrifié, il a recueilli le témoignage de tortionnaires qui, tranquillement, lui ont décrit diverses méthodes. Son quotidien refuse (évidemment) de publier son article. Il se tourne alors vers Témoignage chrétien, qui titre, le 29 juillet 1949 : » A côté de la machine à écrire, le mobilier d’un poste comprend une machine à faire parler. Les tortures en Indochine. » La publication de son témoignage, premier d’une longue série, dont des articles du grand savant orientaliste Paul Mus, est le signal d’une vaste polémique en France. Donc, on pouvait savoir. Les Mémoires de certains » anciens d’Indo » en témoignent. On pense évidemment au général Jacques de Bollardière, qui rencontre la torture sur le sol vietnamien. Mais il la tient pour marginale, en tout cas non généralisée, ce qui explique son maintien au sein de l’armée (9). On retrouve maintes traces de ces pratiques également sous la plume de Jules Roy. Jeune lieutenant-colonel, et déjà écrivain célèbre, il est volontaire pour l’Indochine. Ses premiers écrits ne laissent planer aucun doute sur son acceptation de la croisade anti-Viet-Minh au nom de la défense du » monde libre « . Mais ce qu’il voit en Indochine refroidit ses ardeurs : » Sur toutes les bases aériennes, à l’écart des pistes, étaient construites des cahutes qu’on évitait et d’où, la nuit, montaient des hurlements qu’on feignait de ne pas entendre. Sur la base de Tourane de mon camarade Marchal où je disposais d’une certaine liberté de mouvement, on m’avait montré cela avec répugnance : les hommes de main des renseignements s’exerçaient là. Marchal me disait: « C’est comme ça partout, c’est obligé. Pourquoi ? Comment ? Un jour; au cours d’une nouvelle opération, comme je parcourais la zone en Jeep, j’aperçus devant une pagode un troupeau de paysans accroupis sous la garde de soldats. Je demandai à J’officier qui m’accompagnait ce que c’était. « Rien. Des suspects. Je demandai qu’on s’arrêtât. J’allai à la pagode, j’entrai: on amenait les files de Nha Que devant les tables où les spécialistes leur brisaient les couilles à la magnéto (10). » (1) Discours à la Chambre des députés, 19 novembre 1900 (2) Lire Le Credo de l ‘homme blanc, Complexe, Bruxelles, 1996 (3) Griffes rouges sur l’Asie, Baudinière, Paris, 1933 (4) Lettre au général Lamoricière, 5 avril 1846, citée par A Jardin, Alexis de Tocqueville, Hachette, Paris, 1984 (5) Préface d’André Malraux, Gallimard, Paris, 1935 (6) « Le mécanisme de la répression politique », Esprit, septembre 1953. (7) 22 juin 2000 (8) 22 décembre 1945 (9) En mars 1957, il demandera d’être relevé de son commandement en Algérie, pour protester contre la torture. (10) Mémoires barbares, Albin Michel, Paris, 1989.
|
|
SURVIE : Billets N°99 (janvier 2002) Publié le mardi 1er janvier, 2002 Continuités
Les impunités d’hier font les crimes d’aujourd’hui. Au procès du général Aussaresses pour apologie de crimes de guerre, le général Schmitt, ancien chef d’état-major des armées, est venu justifier la torture. Quand, à la barre, il se déclare prêt à recommencer les horreurs de la bataille d’Alger (qui firent école au Vietnam et en Amérique latine), l’on s’explique mieux les indulgences d’aujourd’hui pour la junte tortionnaire d’Alger. L’oubli des méthodes gestapistes installées au Cameroun pour y briser les indépendantistes, faire de ce pays une néocolonie d’Elf et une tirelire des réseaux françafricains, autorise les complaisances d’aujourd’hui – envers la fraude électorale, le détournement de l’aide et du budget, le saccage de la forêt. Ces méthodes policières furent transposées au Gabon, qui continue de vivre dans une terreur diffuse et de repaître la plupart des écuries politiques françaises. Le policier dictateur Ben Ali s’inscrit dans cette lignée : Jacques Chirac peut aller en Tunisie vanter son combat « exemplaire » contre le terrorisme, son « étonnant succès économique et social ». Ces pays-là, n’est-ce pas, ne sont toujours « pas mûrs » pour autre chose qu’une société de la chicotte ou du garde-chiourme. Ce fut au Tchad, sans doute, que furent envoyées les barbouzes françaises les plus sadiques – dès les années 70. Plusieurs dictateurs s’y sont succédé depuis, mais la police politique et la Sécurité présidentielle ont poursuivi leurs horreurs, avec la bénédiction française (et américaine) : si la Commission des droits de l’homme de l’ONU reste à l’écart du Tchad, c’est par le vœu constant de « la patrie des droits de l’homme ». Madagascar, où la répression coloniale fit après-guerre plus de cent mille morts, mérite-t-elle autre chose, pour les réseaux chiraquiens de l’Océan Indien, que la restauration à vie de l’ancien dictateur rouge Ratsiraka ? Il serait étonnant qu’ils n’aident pas ce dernier, comme le Togolais Eyadema ou le Tchadien Déby, à faire fi du désaveu exprimé lors du premier tour du scrutin présidentiel. En ces trois pays, le suffrage populaire a désigné une personnalité alternative. Mais depuis quand une élection a-t-elle quelque valeur en cette Afrique où « les massacres sont devenus la norme » (propos légué par François Mitterrand à la « mémoire meurtrie » de son fils Jean-Christophe) ? Les massacres ? D’abord les massacres coloniaux (1). Les guerres civiles ? D’abord celles provoquées, nourries ou réactivées pour le pétrole, comme en Angola ou au Congo-Brazzaville. La misère ? D’abord celle entretenue par des régimes comme le Maroc des amis Hassan II et Mohamed VI, dont le domaine « privé » capte une grosse part des ressources nationales – une sorte de pot-au-noir françafricain, réservoir de tous les trafics. « Les dictatures ne se sont jamais aussi bien portées dans le monde que depuis le 11 septembre », constate l’opposant tunisien Moncef Marzouki. La tournée de Jacques Chirac au Maghreb ? Encore une louche d’amnésie. Tant que l’opinion publique française se laissera droguer par la Françafrique, il n’y aura d’avenir qu’insupportable aux relations franco-africaines. 1. Cf. Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes, Le Serpent à Plumes, 1999 ; Jacques Morel, Calendrier des crimes de la France outre-mer, L’Esprit frappeur, 2001.
REFERENDUM AUX FRANCAIS : OUI / NON A LA FRANCAFRIQUE? En tant que citoyen responsable du monde, et au nom de l’assistance a personne en danger, vous etes sur cette liste de diffusion. Mon engagement est de ne pas encombrer votre e-mail. Si vous ne voulez plus recevoir de courrier, faites en la demande a matjules@voila.fr En reponse aux moyens faramineux de propagande utilises avec acharnement par l’imperialisme francais, auxquels vous participez tous (malgre vous ou avec votre soutien conscient ou inconscient), je vous adresse cet appel de resistance. REFERENDUM AUX FRANCAIS: OUI/NON A LA FRANCAFRIQUE? Attendu que, selon des observateurs serieux comme Survie, la France se soit rendue coupable des principaux crimes suivant, dans ses rapports privilegies de cooperation internationale: Dans la noria de crimes contre l’humanite retenons seulement: … Attendu que le niveau de vie des francais (par le biais des entreprises et de l’Etat) soit directement indexé sur le niveau d’exploitation des pays meurtris, se faisant, les francais sont complices d’abus debiens sociaux car ils sont payes avec de l’argent d’une origine plus que douteuse… Attendu la suppression dramatique de la sante, de l’education, de la culture et des droits et libertes fondamentales pour 99 pourcents des populations des pays sous dictature francaise, avec son corollaire une augmentation exponentielle des inegalites entre d’une part une caste nantie mise en place par la France (et a son service) et les populations decimees; et d’autre part entre vous francais, beneficiaires passifs des genocides et donc du pompage des rentes miniere, petroliere, forestiere… des terres africaines (infiniment plus vastes et plus riches que celles de l’Hexagone), et ces meme populations meurtries. Attendu egalement que la situation s’aggrave depuis 50 ans. Vous vous devez de vous prononcer pour ou contre la Francafrique, avec son corollaire: respectivement l’augmentation de votre niveau de vie ou la baisse de votre niveau de vie. On pourra ainsi apprecier le degre d’humanite des francais. Voyons si les francais mettent en pratique les principes de solidarite internationale dont l’imperialisme raciste francais s’est toujours reclame. Ce referendum est nominatif, car il engage la responsabilite de chaque francais. Il sera donc rendu public. Chacun appreciera ainsi l’attitude scandaleuse ou honorable des participants. Vous avez le pouvoir de legitimer democratiquement votre opposition aux massacres, ou votre soutien. OUI, JE ME PRONONCE POUR LA BAISSE DE MON NIVEAU DE VIE ET CONTRE LA FRANCAFRIQUE. NON, JE ME PRONONCE POUR L’AUGMENTATION DE MON NIVEAU DE VIE ET POUR LA FRANCAFRIQUE.
Les africains vous ecoutent. On saura si vous etes ouvertement pour ou contre les genocides. Surtout, les representants de notre democratie (politiciens, banquiers, chefs d’entreprise, actionnaires…) sauront si carte blanche leur est donnee d’intensifier les crimes contre l’humanite. Une faible participation montrerait le manque d’interet que vous portez aux victimes, ou a votre porte monnaie. On constatera que vous refusez d’apporter une reponse de fond a une question fondamentale, qui engage on ne peut plus votre responsabilite. Ce serait egalement trahir que le probleme gene. Mes messages sur lesquels des milliers de francais sont deja si preoccupes de se taire (lorsque je ne recois pas des insultes) revelent pour la plupart d’entre vous, un mepris de l’homme qui ferait palir Hitler, et un soutien constant aux genocides lorsqu’ils sont a votre interet! La justice ne serait pas scandaleusement bafouee chaque jour sans votre silence! *Bamilekes est un terme derivant d’une « logique » raciste et coloniale. *Tutsis est un terme derivant d’une « logique » raciste et coloniale. *Kongos est un terme derivant d’une « logique » raciste et coloniale. Les sites, journaux ou associations qui le souhaitent, peuvent reprendre ce referendum en me le signalant a matjules@voila.fr Pour plus d’information: – Mon livre « Les bourreaux francais grimes en democrates » disponible a mes frais sur simple demande a matjules@voila.fr Liens: – http://www.globenet.org/survie On pourrait a premiere vue dire: la France cache, depuis plus de 50 ans, au peuple francais, qu’elle tient l’Afrique sous sa dictature. Effectivement, les « independances » proclamees par la France de De Gaulle ou la « cooperation » consistent a sous-traiter le colonialisme a des dictateurs pour tromper l’opinion francaise et internationale.
Il n’y a donc rien a attendre de vous. Ce n’est pas avec ceux qui ont cree les problemes qu’il faut esperer les resoudre. Un exemple: De : Resco <(via Cicop > « 800 nouveaux soldats angolais prepositionnes a Dolisie (sud) En vue d’un bombardement […] contre les populations civiles congolaises des regions de la Bouenza, du Niari et du Pool au sud du pays, prevu d’ici le 15 fevrier 2001, le sanglant dictateur Sassou-Nguesso vient de prepositionner a Dolisie 800 soldats angolais fraichement debarques de Luanda, et armes jusqu’aux dents. Il veut absolument a nouveau faire degouliner […] le sang de paisibles populations. Le dictateur Sassou-Nguesso est vraiment pris de folie meurtriere. Qui va l’arreter ? Par mes interpellations indignees, j’entends juste contribuer a faire echec aux incroyables et incessantes impunites totales dont les francais beneficient lachement, concernant nos crimes repetes en Afrique, cela sans que les thuriferaires et moralistes de la democratie ne semblent sincerement s’en offusquer! Matjules. 10/02/2001. |
|
= http://www.africultures.com/revue_africultures/lecteurs/courriers/detail.asp?no=11
CARREFOUR 21 – janv.2001 **Ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu’il te fît, ni le bien que tu sais qu’il ne te ferait pas. **Historique de la françafrique en 5 dates (suite)
33 rue de l’Abbé Fremond D14 Angers 49100 France France
Colonialisme – Néo-colonialisme – ou la terreur exportée Contribution de Gérard Deneux suite aux articles parus dans les n°s 16 et 17 Pour se dédouaner de cette tache indélébile sur le blanc manteau de l’humanisme et du progrès, les bons esprits invoquent les Lumières et la Révolution de 1789. S’il est indéniable que Montesquieu, Rousseau ont condamné le racisme, proclamé avec d’autres que les Hommes naissent libres et égaux en vertu d’un droit naturel, il est tout aussi incontestable que la complexité du siècle des philosophes et ses conséquences ont été transformées en un conte édifiant , visant à assurer la supériorité de l’Occident. Cette période a été surtout marquée par un mouvement de désacralisation de l’autorité royale. Quant aux envolées lyriques sur l’égalité des droits, elle a fait l’objet de violations systématiques.
(…) L’homme universel des Lumières n’est en effet ni esclave, ni nègre, ni indien, ni femme, et consacre la supériorité indéfectible du genre masculin occidental. Les propos de Jules Ferry et de Renan, ces chantres de la République démocratique et du colonialisme, ne démentiront pas cette assertion. Ils produiront la version laïque de la » destinée manifeste » américaine. Dans son discours à la Chambre des députés le 28 juillet 1885, Jules Ferry assène » qu’il y a pour les races supérieures un droit parce qu’il y a un devoir pour elles…le devoir de civiliser les races inférieures » et Renan de s’indigner en apparence : » la conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure qui s’y établit pour y gouverner n’a rien de choquant …la régénération des races inférieures ou abâtardies par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’Humanité « . D’ailleurs, ajoute-t-il , pour éclairer les avancées scientifiques de son temps » la nature a fait une race d’ouvriers, c’est la race chinoise, d’une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment d’honneur …, une race de travailleurs de la terre, c ’est le nègre, une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne « . L’on ne peut mieux légitimer la domination raciste du monde avant les théories de Gobineau et du nazisme . Et la Gauche et la Droite républicaines de communier ensemble sur la hiérarchie des races ne se disputant que sur la question de savoir si cette certitude est immuable ou relative. Les fortes paroles sur la mission civilisatrice de l’Occident capitaliste et la présumée division internationale du travail se sont concrétisées au XIXème siècle. » En 1800, les puissances occidentales détenaient 35 % de la surface de la terre… En 1878, elles en possédaient 67 % : leur taux d’expansion avait donc été de 210 000 kms par an. En 1914, ce taux de croissance avait atteint le chiffre ahurissant de 620 000 kms par an et l’Europe détenait une superficie totale grandiose, environ 85 % de la superficie de la terre en colonies, protectorats, pays dépendants, dominions et commonwealth » (5). Cette domination coloniale, contrairement à ce que veulent faire croire les manuels scolaires, ne s’est pas réalisée sans » dommages « , sans le recours à la terreur et aux massacres de masse. Quelques exemples suffiront pour en montrer l’ampleur. En Algérie, au terme d’une » pacification » terroriste qui a duré un-demi siècle, la population autochtone évaluée en 1830 à 3 millions de personnes, n’était plus que 2,3 millions en 1856. Les » enfumades » furent critiquées par quelques rares députés en 1845, mais pour des raisons bien éloignées de l’humanisme civilisateur prôné en d’autres circonstances. Ils émettaient surtout des réserves parce que ces pratiques, qu’ils n’osaient qualifier de barbares, étaient susceptibles de nuire au moral des vaillants soldats conquérants et, qui plus est, de troubler l’image de la grandeur de la France à l’étranger. Mais au fait, en quoi consistait cette fameuse tactique guerrière que l’on n’osait évoquer en termes explicites ? Ce qui arriva en 1845, à la tribu de Ouled Riah, qui refusait la domination coloniale, permet de cerner le sort réservé à ceux qui n’acceptaient pas les apports de la civilisation occidentale. Pour échapper aux troupes françaises, cette tribu se réfugia dans les grottes avec ses troupeaux. Le colonel Pelissier fit dresser d’immenses bûchers à l’entrée des grottes, et, de cette manière, anéantit l’ennemi, par l’asphyxie » d’environ » un millier de personnes. On ne prit pas la peine de dénombrer les femmes et les enfants, ni les animaux, et l’histoire ne nous dit pas si le colonel fut décoré pour ce haut fait d’armes. (…) ceux qui, comme en France, se glorifient d’avoir libéré leur pays de l’occupation étrangère, vont faire preuve d’une » fascinante schizophrénie » en organisant, face aux mouvements de libération nationale, de sanglantes répressions. Les massacres commencent à Sétif en 1945, se poursuivent en 1947 à Madagascar et les milliers de morts d’Indochine et d’Algérie sont autant de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité. (…) Au delà des exactions, des morts, des mutilés et du recours à l’usage généralisé de la torture en Algérie, de 1954 à 1962, les viols (7) massifs de femmes, surtout dans les campagnes, étaient considérés comme le nécessaire au réconfort barbare de la soldatesque. » Cela faisait partie de nos avantages et était, en quelque sorte, considéré comme un dû « . Ces défoulements visaient, en fait, au delà des traumatismes, de la terreur et de l’horreur, la destruction psychologique de l’être laissé en vie. 9 femmes sur 10, interrogées par l’armée française, furent violées. (…) Comme le souligne, à sa manière, François Xavier Verschave (11), ces violences terroristes n’ont qu’un sens, maintenir la domination de puissances impériales. Comme il fallait se résigner à accorder l’indépendance des peuples, autant l’octroyer formellement pour maintenir la dépendance par corruption interposée des élites locales. A cet égard, le cas de la Françafrique est un cas d’école. Lorsqu’en 1960, De Gaulle, à grands renforts de gestes magnanimes, accorde l’indépendance aux colonies, il charge son ami Foccart et ses réseaux de maintenir la dépendance ! Dans l’ombre, commence dès lors, une ère nouvelle où les moyens illégaux, occultes, inavouables, secrets, sont utilisés pour sélectionner les chefs d’Etats africains, amis de la France, pour soutenir des dictatures corrompues, organiser assassinats et fraudes électorales. Lorsque les coups fourrés ne suffisent pas, on passe à la guerre non déclarée ( 100 000 civils massacrés au Cameroun, puis au Biafra, aux deux Congo, au Tchad …). Assurés de la protection de bases militaires françaises, les gardiens de l’ordre néo-colonial, surveillés par les services secrets de la métropole, organisent avec leur tuteur, le partage de la rente des matières premières et le pillage des richesses locales. Elf joue, à cet égard, un rôle majeur dans le dispositif, tout comme le franc CFA. Mais, à la raison d’Etat » foccartienne » va se substituer, dès la venue de Giscard d’Estaing au pouvoir, la mise en œuvre de réseaux concurrents. L’Etat UDR se délite, des filières privatisées vont s’affronter ; les frères et neveux de Giscard vont côtoyer les fils des Pasqua et Mitterrand. Les financements occultes des Partis et les enrichissements privés à bon compte en valent la peine, d’autant que les paradis fiscaux et autres sociétés-écrans facilitent la tâche de ces personnages. Rien d’étonnant, dès lors, que les représentants de l’Etat français s’entourent d’aéropages sulfureux ; Tarallo, Sirven, Michel Roussin, Bouygues, Dumez, Elf, Robert Feliciaggi, empereur des jeux, Etienne Léandri qui, collaborateur notoire de la Gestapo, s’est recyclé dans le SAC de son compatriote corse Charles Pasqua, avant de devenir marchand d’armes (Société Tradinco). Ce dernier est d’ailleurs devenu l’ami du milliardaire irako-britannique Nadhmi Auchi. Rien ne manque dans l’arsenal du racket et des coups tordus : trucage des marchés publics, pétrole gagé, filière du diamant. Ces voyous de haut vol alimentent et attisent les guerres, soutenant parfois et en même temps, des camps opposés (Angola, Congo Brazzaville…) à grands renforts de livraisons d’armes et de prêts de vrais-faux conseillers militaires. Cette » maffiafrique » est certainement plus dangereuse que les petits malfrats de banlieue … Mais, elle ne fait pas l’objet de l’attention des médias, et surtout, elle évolue dans des milieux nageant dans des eaux grasses. Pour illustration, il suffit d’évoquer le montant d’une des commissions touchée par l’affairiste proche de la DST et des services secrets russe et israélien, M. Arcadi Gaïdamak, puisqu’il s’agit de lui. Pour avoir facilité la livraison d’armes à l’Angola, après signature avec l’entreprise publique SIMPORTEX, il a pu empocher pour ses frais … 135 milliards de dollars . La République a de ces largesses … bien évidemment par le développement d’épidémies et la baisse générale des taux de scolarisation. (…) Gérard Deneux (1) voir » La grande désillusion » de Joseph E. Stiglitz, prix nobel d’économie, ex vice-Président de la Banque mondiale, qui a préféré démissionner » plutôt que d’être muselé « (2) Ignacio Ramonet dans le Monde Diplomatique – octobre 2001 – (3) voir » Capitalisme et économie-monde » Immanuel Wallerstein – Flammarion (4) les données qui suivent sont extraites de l’excellent livre de Sophie Bessis » L’Occident et les autres : histoire d’une suprématie » ed. La Découverte (5) Edward Saïd » Culture et impérialisme » Fayard – Le Monde Diplomatique – 6) pour plus de détails sur cette émigration massive, voir p. 52 de » L’Occident et les autres » de Sophie Bessis ainsi que, du même auteur » la dernière frontière – Les Tiers mondes et la tentation de l’Occident » ed. JC Lattès (7) les données et citations qui suivent sont extraites d’un article du Monde du 12.10.01 » Etat de Droit et République française « (9) les données sur la guerre du Vietnam sont tirées de l’article de Pierre Journaud » Retour sur la guerre chimique au Vietnam » in la revue » l’Histoire » n° 263 – mars 2002 – (10) discours sur le colonialisme Aimé Césare – ed. Présence africaine – 1955 – cité par Sophie Bessis (11) lire de cet auteur » Noir silence » et » l’envers de la dette –criminalité politique et économique au Congo-Brazza et en Angola » – ed. Agone (12) lire notamment, à ce sujet, les livres de Denis Robert » Révélations $ » et » La boîte noire » aux éditions les Arênes (13) lire de Jean-Christophe Ruffin » Le piège humanitaire » Hachette pluriel et de Rony Brauman » Humanitaire – le dilemme » Textuel (14) voir l’article écrit par Gérard Deneux à ce sujet et les références qu’il contient dans le bulletin n° 18 (15) voir » L’opinion, ça se travaille…les médias, l’OTAN et la guerre du Kosovo » Serge Halimi et Dominique Vidal – éd. Agone Contre-feux
|
|
= http://amd.belfort.free.fr/20colonialisme.htm
http://matjules.free.fr/docsecret.html
|
|
Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste, Gallimard 1989
(Etude sur les mécanismes de la transition de la gauche vers le fascisme.) (p.13)
(p.19) La France du nationalisme intégral, de la droite révolutionnaire, est le véritable berceau du fascisme. Nous l’avons déjà soutenu ailleurs, aussi n’en sera-t-il pas question ici. Mais la France, c’est aussi le berceau du révisionnisme révolutionnaire sorélien, composante première du fascisme. Lancé en France, le révisionnisme révolutionnaire se développe en Italie en force intellectuelle, politique et sociale. Alliés aux nationalistes et aux futuristes, les révisionnistes révolutionnaires italiens trouvent en été 1914 les troupes, les conditions et le chef qui leur permettent de transformer en force historique la longue incubation intellectuelle commencée au début du siècle. (…) Le fascisme ne saurait en aucune façon être identifié avec le nazisme. Certes, les deux idéologies, les deux (p.20) mouvements et les deux régimes possèdent des points communs. Ils peuvent souvent être tangents l’un à l’autre ou bien se recouper, mais ils diffèrent sur une question fondamentale : la pierre de touche du national-socialisme allemand est le déterminisme biologique. C’est le racisme dans son sens le plus extrême qui fait le fond du nazisme ; et la guerre aux Juifs, la guerre aux races inférieures, y joue un rôle plus prépondérant que la guerre au communisme. Des marxistes peuvent être convertis au national-socialisme – bon nombre d’entre eux l’ont effectivement été; de même, le national-socialisme peut signer des traités avec les communistes, échanger des ambassadeurs, voire coexister avec eux, ne serait-ce que temporairement Rien de tel pour ce qui est des Juifs. Les concernant, le seul « arrangement » possible est la destruction. Certes, le racisme n’est pas limité à l’Allemagne. À la fin du xixe siècle, le déterminisme biologique se développe aussi dans un pays comme la France; mais s’il constitue un élément de la montée de la droite révolutionnaire, le racisme, dans sa variante française, ne devient jamais à lui tout seul l’alpha et l’oméga d’une idéologie, d’un mouvement et d’un régime. De fait, le déterminisme racial n’est pas présent dans toutes les variétés de fascisme. Si Robert Brasillach professe un antisémitisme très proche de celui du nazisme, le Faisceau de Georges Valois en est totalement dépourvu. Et si certains fascistes italiens pratiquent un antisémitisme militant, les Juifs fascistes ne se comptent plus en Italie ; leur pourcentage au sein du mouvement est même très supérieur à ce qu’il est dans la population. On le sait, en Italie, les lois raciales ne seront promulguées qu’en 1938 et, durant les années de guerre, un Juif se sentira nettement moins en danger à Nice ou en Haute-Savoie, territoires occupés par les troupes italiennes, qu’à Marseille, régentée par la police de Vichy. (p.21) Le racisme n’est donc pas de ces conditions nécessaires à l’existence d’un fascisme; il contribue par contre à l’éclectisme fasciste. C’est pourquoi une théorie générale qui voudrait englober fascisme et nazisme , butera toujours sur cet aspect essentiel du problème. En fait, une telle théorie n’est pas possible. Certes, il existe des similarités, surtout pour ce qui est du caractère « totalitaire » des deux régimes, mais les différences ne sont pas moins significatives. Karl Bracher a bien vu l’importance cardinale de ces différences que l’ouvrage de Nolte – et c’est là sa principale faiblesse -a complètement ignorées « . Cette question clarifiée, revenons à notre conception du fascisme. Si l’idéologie fasciste ne peut être définie en termes d’une simple réponse au marxisme, sa naissance, par contre, représente le résultat direct d’une révision très spécifique du marxisme. Révision du marxisme et non pas variété de marxisme ou ombre portée du marxisme. L’objet de ce livre est d’étudier cette révision antimatérialiste et antirationaliste du marxisme. Il est indispensable d’insister sur cet aspect essentiel de la définition du fascisme. Car la cristallisation des concepts fondamentaux du fascisme, de la philosophie et de la mythologie fascistes, devient difficilement intelligible si l’on refuse de la percevoir aussi en fonction de cette révolte d’origine marxiste contre le matérialisme. Ce sont les soréliens de France et d’Ita- -, lie, théoriciens du syndicalisme révolutionnaire, qui lancent cette nouvelle et originale révision du marxisme : c’est en cela, précisément, que consiste leur contribution à la naissance de l’idéologie fasciste. En ce sens, la poussée du fascisme constitue une des faces de la révolution intellectuelle, scientifique et technologique qui emporte le continent européen à la charnière des 19e et 20e siècles.
(p.352) Mussolini explique la crise politique et sociale en Italie par la décadence bourgeoise, par l’incapacité de l’élite au pouvoir de gouverner le pays et de faire face à ses problèmes. Cette dégénérescence bourgeoise touche dans la même mesure le socialisme réformiste, qui ne cesse de descendre la pente. Comme tout révolutionnaire qui se respecte, Musso- lini s’estime marxiste. (p.353) en Marx « le plus grand théoricien du socialisme », et dans le marxisme « la doctrine scientifique de la révolution des classes n ». Mais ce jeune militant n’est pas lui-même un théoricien marxiste. Le marxisme lui parvient sous une forme révisée et digérée, d’abord par l’intermédiaire d’Arturo Labriola et de Leone, finalement par l’intermédiaire de Sorel. En même temps, d’autres influences se font jour dans ses écrits : celle de Rosa Luxemburg, notamment, mais aussi de Guesde et de Jaurès l2. Les idées exprimées par Mussolini sur toutes les questions clés du débat idéologique de l’époque ne diffèrent aucunement de celles mises en avant par nombre d’autres intellectuels socialistes, qu’il s’agisse de l’internationalisme, du militarisme, de la guerre, de la lutte des classes ou de la grève générale. Quelle que soit la définition que l’on donnerait aujourd’hui du marxisme auquel se rattache Mussolini au temps où il est membre du parti socialiste, il est incontestable que son approche de ces questions est d’abord déterminée par la théorie de la lutte des classes et par sa conviction que la révolution socialiste est en marche. Mussolini ne manque alors jamais de manifester son adhésion au mouvement socialiste international et à l’Internationale socialiste. À l’instar de n’importe quel autre militant socialiste, il soutient que le militarisme n’est qu’un des corollaires du capitalisme, et la guerre un des moyens dont se sert la bourgeoisie pour conserver le pouvoir et exploiter au maximum le prolétariat.
(p.405) Une seconde possibilité de déloger les fascistes s’offre deux ans plus tard. L’assassinat, le 10 juin 1924, du député socialiste Matteotti, dont le célèbre discours du 30 mai a été durement ressenti par les fascistes, ouvre une crise très grave. La force de caractère et le courage de Matteotti étaient légendaires. Son enlèvement au cœur même de la capitale provoque une énorme émotion. Les réactions jettent la panique dans l’entourage du chef du gouvernement et la révolte gronde jusque chez les ministres fascistes modérés. Une intervention des libéraux auprès du roi aurait sans doute suffi pour le décider à remplacer Mussolini, mais les amis de Giolitti sont alors encore trop bien disposés envers le fascisme pour exiger le départ de son chef. Cependant, c’est la position de Benedetto Croce, premier intellectuel du pays, et, vis-à-vis du monde extérieur, le représentant le plus célèbre de la culture italienne, qui est la plus significative. En ce moment critique, Croce estime que le fascisme, malgré tout, a fait beaucoup de bien, et qu’il ne serait nullement avisé de travailler à sa chute. Au contraire, pense Croce, il faut lui laisser le temps de parachever son évolution vers l’assagissement et la normalisation. Le 26 juin, le sénateur vote la confiance au gouvernement Mussolini 138. Cette main levée d’un des Européens les plus fameux de son temps en faveur de l’apprenti dictateur, au pouvoir depuis près de deux ans et responsable d’un crime odieux, à un moment où le régime (dont la véritable nature ne peut plus être ignorée) est particulièrement vulnérable, est révélatrice. Elle symbolise par excellence la problématique que représente le fascisme, aux quatre coins du continent, pour cette intelligentsia européenne si fine, si cultivée, mais dont la foi dans les vertus de la démocratie libérale s’est effondrée depuis fort longtemps.
|
Annales historiques de la Révolution française, Numéro 340, Comptes rendusPatrice Bret (http://ahrf.revues.org/document2025.html) Orientales I. Autour de l’expédition d’ÉgypteZusammenfassungHenry LAURENS, Orientales I. Autour de l’expédition d’Égypte, Paris, CNRS Éditions (Coll. Moyen-Orient), 2004, 306 p., ISBN 2-271-06193-8, 24 €. Quelques articles ont été légèrement remaniés. C’est le cas de celui sur « Le projet d’État juif en Palestine attribué à Bonaparte » (pp. 121-143), l’un des principaux de la deuxième partie (« Napoléon et l’Islam ») et un bel exemple de construction et de détournement de l’histoire à d’autres fins. Initialement publié dans la Revue d’études palestiniennes en 1989, il a été mis à jour à l’occasion d’une traduction en arabe et pour répondre à l’ouvrage de Jacques Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte (Fayard, 1992) qui tentait d’en infirmer les conclusions. Laurens a enquêté sur une éphémère rumeur qui parcourut l’Europe en 1799 pour être tirée de l’oubli un siècle plus tard et posée en fait établi par le mouvement sioniste autour de la Grande guerre, puis devenir, par contrecoup, un argument de l’historiographie arabe pour démontrer l’existence d’un complot occidental permanent des Croisades à nos jours. La thèse de l’existence de ce projet d’État juif repose sur quelques articles de l’époque et sur deux documents dont des traductions ont été mises au jour en 1940 par un juif autrichien : une proclamation de Bonaparte, datée de Jérusalem (où les Français ne sont pas allés…), et une lettre du grand rabbin de la ville sainte à cette époque. De fait, outre quelques vagues mentions dans Le Moniteur, un article de la Décade philosophique en avril 1798 (un mois avant l’embarquement à Toulon et un an avant la campagne de Syrie), « un certain LB. qui pourrait être Lucien Bonaparte lui-même » selon Laurens (selon M. Regaldo, il s’agit en fait de Joachim Le Breton, de l’Institut national), propose de régénérer l’Égypte et la Syrie en appelant en Palestine les juifs qui « ont participé aux lumières de l’Europe » et « accourront des quatre parties du monde, si on leur donne le signal ». Quant à la proclamation du général en chef et à la lettre du grand rabbin de Jérusalem appelant à combattre pour l’Éternel et pour Bonaparte, ce sont des faux, rédigés dans le milieu messianique juif frankiste, né autour de Jacob Frank (1726-1791) dans la région de Francfort, avec des ramifications en Bohême et jusqu’à Paris. Avec la destruction de l’ordre d’Ancien Régime, les guerres et l’expulsion du pape de Rome, puis l’expédition d’Égypte qui rend possible le retour en Palestine, la Terre sainte redevient un enjeu géopolitique. « La tourmente révolutionnaire en Europe a intensifié parallèlement les deux courants apocalyptiques protestant et juif en leur permettant de croire que la fin des temps était proche. […] Bonaparte, tout en accomplissant le programme révolutionnaire de régénération des peuples du monde, véritable fin de l’histoire pour les Idéologues de la Révolution finissante, se prenait pour le Mahdi des Musulmans. Pour les protestants anglais, il était l’Antéchrist, et pour les messianistes juifs, l’exécuteur de la volonté divine » (pp. 142-143).
Les autres articles de cette partie – dans laquelle les rapports de la Révolution française avec l’Islam et avec l’Empire ottoman ont toute leur place (pp. 67-85) – soulignent la cohérence de Bonaparte dans ses rapports avec l’Islam, ce qui n’exclut pas son opportunisme : « La reconnaissance de cette double dimension permet de dépasser le débat déjà ancien sur l’existence ou non d’un rêve oriental. » (p. 145). Sur le terrain, cet imaginaire et la rivalité des puissances européennes font émerger le Grand Jeu évoqué par Kipling, avec sa multiplicité de dimensions, politique, économique, culturelle, et la figure nouvelle de l’aventurier assis « entre deux cultures et surtout deux loyautés » (p. 168), depuis Lascaris, chevalier de Malte qui suit Bonaparte en Égypte après la prise de l’archipel, jusqu’à Lawrence d’Arabie (« Le chevalier de Lascaris et les origines du Grand Jeu » (pp. 167-183).
« La postérité de l’expédition d’Égypte », objet de la troisième partie, porte essentiellement sur la longue durée. Le mythe politique de l’expédition, en France et en Égypte, du XIXe siècle à nos jours, « informe plus sur l’état des relations entre les deux pays que de l’apport de l’expédition » (p. 205). La comparaison de deux articles rédigés en 1990 et en 1998 montre d’ailleurs la détérioration de la perception de l’Occident en Égypte dans la dernière décennie, probablement accrue depuis le 11 septembre 2001. Suivent un volet français et un volet égyptien. Ce dernier porte sur la modernisation accomplie par Muhammad Ali et ses successeurs (Élites et réforme dans l’Égypte du XIXe siècle », pp. 231-243) et sur « La naissance de la nation égyptienne » (pp. 245-251). Le premier concerne la politique française au Levant, jusqu’au projet de royaume arabe de Syrie (« Napoléon III et le Levant », pp. 255-265) – la suite se trouve dans les deux autres volumes. Retenons un document important retrouvé naguère par Laurens et publié par lui dans les Annales islamologiques en 1987. Second volet de la première mission de Sébastiani à Constantinople, destinée à ratifier les préliminaires de paix entre la France et la Porte, et de préparer le traité définitif, ce document donne toute la mesure et l’ambiguïté de la politique orientale du Premier Consul, pour ne pas dire son double jeu, un an après l’évacuation de l’Égypte (« L’Égypte en 1802 : un rapport inédit de Sébastiani », pp. 187-204).
Avec deux articles seulement, la dernière partie, « Race et histoire », pourrait être le parent pauvre de l’ouvrage. Il n’en est rien. Le mythe-histoire de la Raison, fondateur de l’expédition, s’accompagne de la genèse d’un autre mythe des origines, qui émerge en parallèle en puisant notamment dans le comparatisme linguistique, celui des aryens, qui crée une culture commune entre l’Inde et l’Europe, posant les fondements d’une ethnologie linguistique et la question de ses liens avec l’anthropologie physique. « Le mythe aryen, malgré tout son romantisme inquiétant, est le produit des méthodes mises au point par les Lumières finissantes », précise Henry Laurens (p. 284). Les hommes de la Révolution ne sont pas absents des premiers débats. Bailly postule l’existence « d’un peuple détruit et oublié qui a précédé et éclairé les plus anciens peuples connus », de l’Inde et la Chaldée (Lettres sur l’origine des sciences et sur celle des peuples de l’Asie, adressées à M. de Voltaire, 1777 ; Lettres sur l’Atlantide de Platon et sur l’origine des sciences, 1779). Rabaut de Saint-Étienne imagine un peuple original du Gange au Danube à l’écriture allégorique réduite par l’invention de l’alphabet au rang de mythologie (Lettres à Sylvain Bailly sur l’histoire primitive de la Grèce, 1787). Volney, enfin, importe du comparatisme linguistique allemand l’idée d’une « nation scythique » s’étendant par vagues successives des plaines du Gange aux îles britanniques (1818). « Ainsi, une nouvelle généalogie de l’Europe se dessine : la théorie germanique était l’apanage de l’aristocratie, l’indo-germanique ne la concerne plus seulement, elle porte sur l’ensemble des populations de l’Europe, une race en tant que telle qui va se poser en aristocratie par rapport au reste du monde et dont l’origine est à rechercher en Asie » (p. 288). Les Indo-Européens sont nés, suivis dès les années 1840 par les Sémites, « la seconde race nécessaire pour la compréhension historique de l’état du monde » (p. 289).
|
Léon Poliakov, Bréviaire de la haine, Le IIIe Reich et les Juifs, éd. Calmann-Lévy, 1951
(p.8) (Mauriac) Mais ce bréviaire a été écrit pour nous aussi Français, dont l’antisémitisme traditionnel a survécu à ces excès d’horreur dans lesquels Vichy a eu sa timide et ignoble part —r- pour nous surtout, catholiques français, qui devons certes à l’héroïsme et à la charité de tant d’évêques, de prêtres et de religieux à l’égard des Juifs traqués, d’avoir sauvé notre honneur, mais qui n’avons pas eu la consolation d’entendre le successeur du Galiléen, Simon-Pierre, condamner clairement, nettement et non par des allusions diplomatiques, la mise en croix de ces innombrables « frères du Seigneur ». Au vénérable cardinal Suhard qui a d’ailleurs tant fait dans l’ombre pour eux, je demandai un jour, pendant l’occupation : « Eminence, ordonnez-vous de prier pour les Juifs… », il leva les bras au ciel : nul doute que l’occupant n’ait eu des moyens de pression irrésistibles, et que le silence du pape et de la hiérarchie n’ait été un affreux devoir; il s’agissait d’éviter de pires malheurs. Il reste qu’un crime de cette envergure retombe pour une part non médiocre sur tous les témoins qui n’ont pas crié et quelles qu aient été les raisons de leur silence. (p.9) Surtout que ce livre ne nous désespère pas : il y a ceux qui ont tué mais il y a aussi ceux qui ont su mourir. Nous n’avions pas attendu Hitler et les nazis pour savoir que l’homme n’est pas né innocent et que le mal est en lui et que la nature est blessée. Mais un héros et un saint demeurent en germe au plus secret de nos misérables cœurs. Il dépend de nous que les martyrs n’aient pas été torturés en vain. Il dépend de nous de ne pas écarter cette multitude qui, bien loin de crier vengeance, nous crie inlassablement ce que le premier d’entre eux, le fils de David, nous a enseigné sur la montagne : « Bienheureux les doux car ils possèdent la terre. Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice… »
(p.35) Le jour même où le gouvernement hitlérien ordonnait le tamponnage des passeports des Juifs, le gouvernement polonais prescrivait à ses nationaux habitant à l’étranger un tamponnage d’un autre genre. Faute de faire revêtir leurs passeports par un cachet spécial apposé par les consulats, ils allaient être déchus de la nationalité polonaise. De leur côté, les consulats polonais avaient reçu l’instruction de ne pas renouveler les passeports des Juifs vivant à l’étranger depuis plus de cinq années. Plus de 20 000 Juifs polonais résidant en Allemagne depuis de longues années allaient se trouver apatrides du jour au lendemain. Cette fois-ci, la Gestapo le soulignait ironiquement, c’est sur la suggestion du ministère des Affaires étrangères que Himm-ler ordonna l’arrestation immédiate et l’expulsion de tous les Juifs polonais habitant en Allemagne. Dans la seule ville de Vienne, 3 135 Juifs furent arrêtés et envoyés en Pologne. Mais le gouvernement de Varsovie refusa de les laisser entrer en territoire polonais. C’est ainsi que dans la région de Zbonszyn, des milliers d’hommes, femmes et enfants, premières personnes déplacées de notre époque, durent camper de longues semaines dans un no maris land sur la frontière, par un froid rigoureux, en attendant que les gouvernements se missent d’accord sur leur sort.
(p.38) Le jour suivant, à une conférence convoquée par Gœring dont il sera question plus loin, Heydrich parle déjà de 7 500 magasins détruits. Les archives du camp de Buchenwald indiquent que ce seul camp recevait entre le 10 et le 13 novembre livraison de 10 454 Juifs, où ils étaient reçus et traités avec les sadiques raffinements d’usage, couchés en plein air hivernal, battus et torturés à longueur de journée, tandis qu’un haut-parleur proclamait : « Tout Juif qui veut se pendre est prié d’avoir l’amabilité de mettre un morceau de papier portant son nom dans sa bouche, afin que nous sachions de qui il s’agit. » Cette orgie dévastatrice n’émut pas outre mesure le peuple allemand, qui en était le témoin global. Elle se poursuivait devant une indifférence quasi générale. « La réaction du peuple allemand aux pogromes de l’automne 1938 montre jusqu’où Hitler l’a mené en cinq ans et jusqu’à quel point il l’a avili », écrivait Rauschning en 1939(18). Et Karl Jaspers observe : « Lorsqu’en novembre 1938 les synagogues brûlaient et que les Juifs étaient déportés pour la première fois… les généraux étaient présents; dans chaque ville, le commandant avait la possibilité d’intervenir… ils n’ont rien fait (19). »
(p.75) / Varsovie/ le jour du Vendredi Saint 1940 (…): c’est le jour où on disait dans les églises catholiques la messe dans laquelle il était question de la « perfidia judaïca » et où les fidèles tapaient du bâton, maudissant les ennemis du Seigneur. On voit comment les enseignements de l’Eglise catholique pouvaient contribuer, eux aussi, à l’acharnement des fidèles du Führer.
(p.82) L’impulsion est donnée par l’expulsion des Juifs d’Alsace-Lorraine, pratiquement terminée au début d’octobre 1940.
(p.84) Aux Pays-Bas et au Luxembourg, la situation est quelque peu différente, puisqu’il s’agit de « peuples de souche germanique », auxquels tôt ou tard on espère inculquer l’évangile raciste, après quoi ils seront incorporés dans les rangs de la Race des Maîtres — tandis qu’on a affaire en France (et en Belgique wallonne) à des sous-hommes quelque peu exotiques, de toute évidence dégénérés, mais à l’égard desquels on ressent confusément un complexe d’infériorité inavouable mais tenace. Politiquement, on aspire à les maintenir dans un état de division et de faiblesse, sien désintéressant pour le reste et les laissant cuire dans leur mauvais jus de sous-natalité biologique. Mais humainement on craint parfois de trop les choquer.
(p.85) L’antisémitisme de Vichy était le produit d’un croisement de la xénophobie si caractéristique d’une certaine bourgeoisie française avec une vieille doctrine antisémite traditionnellement réactionnaire et cléricale, qui prétendait puiser ses inspirations chez les docteurs de l’Eglise moyenâgeux, et se réclamait de la Somme de saint Thomas d’Aquin. Les Allemands n’imposent rien de force à Vichy : ils conseillent, « ils font des suggestions », allant même jusqu’à « laisser entrevoir aux Français l’abrogation des mesures allemandes, afin de stimuler leur initiative dans le domaine de la question juive (47) ». Vichy s’y prête de bonne grâce, et même — dans la mesure où la politique allemande était conforme à sa doctrine — avec un zèle convaincu. De cette politique, Pétain et Xavier Vallat (le premier commissaire général aux Questions juives) sont les protagonistes attitrés : Pétain prend même la précaution de se renseigner auprès du Saint-Siège sur l’opportunité des mesures vichyssoises, et la réponse très précise de son ambassadeur : « Jamais il ne m’avait rien été dit au Vatican qui supposât, de la part du Saint-Siège, une critique ou une désapprobation des actes législatifs et réglementaires dont il s’agitl » apaise sans doute définitivement sa conscience.
1. Rapport du 7 septembre 1941 de Léon Bérard, ambassadeur de France près du Saint-Siège, au maréchal Pétain, sur les « questions et difficultés que pouvaient soulever les mesures prises à l’égard des Juifs ». A propos de l’attitude du Vatican, voir pp. 433 et suiv.
(p.175) Jodl : « Rompre tous les ponts … afin d’exciter le peuple à une combativité plus forte encore… »
(p.206) Lors du procès des principaux membres des groupes, qui eut lieu à Nuremberg plusieurs années plus tard, leur attitude mit à jour l’étonnante confusion mentale régnant dans les cervelles nazies. Parmi les vingt-deux accusés, se trouvaient un professeur d’université, huit avocats, un chirurgien dentiste, un architecte, un expert d’art, et même un théologien, ancien pasteur1. Tous plaidèrent non coupables; aucun n’exprima le moindre regret; tout au plus se référaient-ils aux ordres reçus et aux dures nécessités de la guerre. Et cependant, lors de leur défense, ils se référaient aux mêmes valeurs de la civilisation occidentale qu’ils avaient, des années durant, foulées aux pieds : leurs témoins, leurs avocats, célébraient à l’envi leur honnêteté, leurs vertus familiales, leurs sentiments chrétiens, et même la douceur de leur caractère…
1. Biberstein-Szymanovski. Citons cette incroyable réplique de ce dernier, auquel le président du tribunal demandait si, en sa qualité d’ancien ecclésiastique, il n’estimait pas utile d’adresser des paroles de consolation, voire de confesser les Juifs immolés. « Monsieur le Président, on ne jette pas des perles devant les pourceaux. » (Audience du 21 novembre 1947.)
(p.278-279) Plusieurs psychiatres allemands de renom, tels que les professeurs Heyde, 1. L’association des médecins chargés d’administrer l’euthanasie portait le nom de « Reichsarbeitsgemeinschaft Heil-und Pflegeanstalten (Association du Reich, établissements thérapeuthiques et hospitaliers).
Nietzsche, Pfannmùller, apportèrent au T-4un concours actif et enthousiaste. Une autre autorité scientifique, le professeur Kranz, évaluait à un million le nombre d’Allemands dont « l’extirpation » lui paraissait souhaitable (280).
(p.315) Peut-être le lecteur trouvera-t-il tout de même quelque intérêt à jeter un regard dans la conscience de ces techniciens ? Voici un extrait du journal intime de l’un d’eux, un intellectuel celui-là, le médecin docteur Kremer : « 1.IX.1942. J’ai écrit à Berlin pour commander une ceinture en cuir et des bretelles. J’ai assisté l’après-midi à la désinfection d’un bloc avec du Cyclone B, afin de détruire les poux. « 2.IX.1942. Ce matin à trois heures, j’ai assisté pour la première fois à une action spéciale. En comparaison, l’enfer de Dante me paraît une comédie. Ce n’est pas pour rien qu’Auschwitz est appelé un camp d’extermination. « 5.IX.1942. J’ai assisté cet après-midi à une action spéciale appliquée à des détenues de camp féminin (Musulmanes *), les pires que j’aie jamais vues. Le docteur Thilo avait raison ce matin en me disant que nous nous trouvons dans l’anus du monde 2.
1. Ainsi qu’on le verra plus loin, on désignait à Auschwitz sous le terme de « Musulmans » les détenus arrivés au degré limite d’usure physique. 2. A cet endroit, le texte porte en latin : anus mundi.
(p.315) Ce soir vers huit heures j’ai assisté à une action spéciale de Hollandais. Tous les hommes tiennent à prendre part à ces actions, à cause des rations spéciales qu’ils touchent à cette occasion, consistant en 1/5 de litre de schnaps, 5 cigarettes, 100 grammes de saucisson et pain. « 6-7.IX.1942. Aujourd’hui, mardi, déjeuner excellent : soupe de tomates, un demi-poulet avec des pommes et du chou rouge, petits fours, une merveilleuse glace à la vanille. J’ai été présenté après déjeuner à 1… Parti à huit heures du soir pour une action spéciale, pour la quatrième fois… « 23.IX.1942. Assisté la nuit dernière aux sixième et septième actions spéciales. Le matin, l’Obergruppen-fiihrer Pohl est arrivé avec son état-major à la maison des Waffen-SS. La sentinelle près de la porte a été la première à me saluer. Le soir, à vingt heures, dîner dans la maison des chefs avec le général Pohl, un véritable banquet. Nous eûmes de la tarte aux pommes, servie à volonté, du bon café, une excellente bière et des gâteaux. « 7.X.1942. Assisté à la neuvième action spéciale. Etrangers et femmes. « 11.X.1942. Aujourd’hui dimanche, lièvre, une belle cuisse, pour déjeuner, avec du chou rouge et du pudding, le tout pour 1.25 RM. «12.X.1942. Inoculation contre le typhus. A la suite de quoi, état fébrile dans la soirée; ai assisté néanmoins à une action spéciale dans la nuit (1 600 personnes de Hollande). Scènes terribles près du dernier bunker. C’était la dixième action spéciale (348). »
1. Mot illisible.
(p.370) /Himmler/ Le culte du passé germanique était l’un de ses objets de préocuppation les plus graves. (p.371) (…) dans le Jutland une vieille Danoise, seule au monde, lui avait-on assuré, à connaître encore les méthodes de tricot en usage chez les anciens Vikings (395). En de pareilles questions, il ne lésinait ni avec le temps ni avec l’argent : dans tous les recoins de l’Europe occupée, dans la Russie à feu et à sang, et jusque dans le lointain Tibet, de coûteuses expéditions avaient mission de retrouver les traces des passages des tribus germaniques (396). Parmi d’autres indices, la couleur des cheveux et des yeux lui paraissait particulièrement convaincante dans cet ordre d’idées : et un récit nous montre Himmler, complimentant le Grand Mufti de Jérusalem pour ses yeux bleus, cette preuve formelle d’une ascendance nordique. (C’était leur première rencontre : au cours du thé qu’il offrit à quelques chefs SS à cette occasion, les convives furent unanimes à déplorer que l’aveugle Histoire, en permettant au xvii* siècle au Saint-Empire de triompher sur les Turcs, retarda d’autant l’écrasement définitif du christianisme enjuivé . )
(p.380-381) /L’Europa-Plan visant à déporter les Juifs à Madagascar/ Il est caractéristique que Himmler hésita longuement avant de donner à Wisliceny des instructions précises. Sa première réaction paraît avoir été favorable : il semble bien qu’une émigration massive d’enfants figurait parmi les premières mesures envisagées. Mais Eichmann, solidement installé dans sa position-clef, s’efforçait de son mieux à torpiller un accord de cette nature; il trouva un allié inattendu et influent en la personne du Grand Mufti de Jérusalem (réfugié en Allemagne depuis l’été 1941), qui veillait jalousement à ce qu’aucun Juif ne pût quitter vivant le continent européen. D’autres SS importants, en premier lieu Walter Schellenberg, le chef du service de renseignements de la SS, s’efforçaient d’influencer Himmler en sens contraire : pendant de longs mois, sa réponse définitive se fit attendre.
(p.386) D’autres négociations de cette espèce eurent lieu cependant, et furent menées à bien. Ainsi, celles relatives aux grands blessés de guerre, qui au cours des hostilités furent échangés à plusieurs reprises entre la Grande-Bretagne et le IIP Reich. Il en fut de même en ce qui concernait les internés civils. C’est que, et quelle qu’ait été la sauvagerie du conflit, certains grands accords internationaux, tels que la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, restèrent en vigueur tout au long des hostilités, sans jamais être dénoncés. Les Juifs des pays conquis n’étaient pas protégés par ces textes : ainsi que nous l’avons déjà noté, seuls ceux qui appartenaient à une nation belligérante ou neutre échappaient au sort commun. De cette manière, et « fondés en droit », les Allemands avaient beau jeu de refuser aux délégués de la Croix-Rouge internationale ou aux missions neutres l’accès des camps de concentration. Signalons à ce propos que lorsqu’en 1939, dès la déclaration de la guerre, le Comité de la Croix-Rouge proposa aux belligérants d’étendre aux populations civiles, « sans distinction de race, de confession ou d’opinions politiques », le bénéfice de la Convention de Genève, ce fut — par une très cruelle ironie — la Grande-Bretagne qui manifesta le plus de réticence à l’égard d’un projet que le IIIe Reich, à l’époque, « se déclarait prêt à discuter 1 » (Certes, eût-il même été accepté,
1. Par sa lettre circulaire du 4 septembre 1939, le Comité international de la Croix-Rouge proposait aux belligérants, entre autres, « …l’adoption anticipée et au moins provisoire, pour le seul conflit actuel et pour sa seule durée, des dispositions du projet de Convention sus-mentionné… » (II s’agissait du projet dit « de Tokio » étendant aux civils les bénéfices de la Convention de Genève.) Par lettre du 30 novembre 1939, le ministère des Affaires étrangères du Reich confirmait que, « du côté allemand, on estimait que le « projet de Tokio » pourrait servir de base à la conclusion d’un accord international sur le traitement et la protection des civils se trouvant en territoire ennemi ou occupé »… Le 23 novembre 1939, le gouvernement de la IIIe République écrivait : « Le gouvernement français reconnaît pleinement 1 intérêt… du projet dit de Tokio. Il estime, cependant, que le texte dont il s’agit nécessiterait encore une étude attentive… qui risquerait de demander un assez long délai et de retarder d autant la solution des problèmes… » Quant au gouvernement britannique, ce n’est que le 30 avril 1940 qu’il donnait une réponse à la lettre-circulaire, indiquant qu’il préférait avoir recours à un accord bilatéral avec le gouvernement du IIF Reich. (Cf. Comité international de la Croix-Rouge; documents sur l’activité du Comité en faveur des civils détenus dans les camps de concentration d’Allemagne, Genève, 1946.)
(p.387) un pareil texte n’aurait pas empêché les Nazis d’y passer outre : mais la question se serait trouvée placée sur un nouveau terrain, mettant à la disposition de la Croix-Rouge, des neutres et des Alliés de meilleurs moyens d’action. Le privilège dont bénéficièrent jusqu’à la fin les prisonniers de guerre juifs est à cet égard bien significatif.) Dès lors n’eût-il pas fallu, dans le camp allié, faire un puissant effort d’imagination, afin de tenter de mettre un terme à l’agonie des premières victimes désignées de l’ennemi ? Rien de pareil ne fut fait, ou trop peu et trop tard : un organisme spécialement créé dans ce but par le président Roosevelt, le « War Refugees Board », ne surgit qu’en 1944, et son activité fut ligotée jusqu’à la fin par de mesquines entraves administratives. Le gouvernement britannique poursuivait sa politique palestinienne (celle du « Livre Blanc » de 1939) avec une obstination implacable, et rejetait systématiquement dans la mer les quelques rares bateaux transportant des réfugiés échappés à l’enfer hitlérien. Des accusations sévères, venant parfois de bouches très autorisées, furent élevées à ce propos contre les chancelleries alliées, et un témoin tel que Henry Morgenthau, secrétaire au Trésor du cabinet américain, a pu parler de « combinaison
(p.388) satanique d’ambiguïté et de glaciale froideur britanniques, équivalant à une sentence de mort (418) ». Le même Morgenthau accusait, dans un document officiel, les hauts fonctionnaires du State Department : « 1° D’avoir entièrement échoué à empêcher l’extermination des Juifs dans l’Europe contrôlée par les Allemands. « 2° D’avoir camouflé leur mauvaise volonté par la constitution d’organisations factices, telles que les organisations intergouvernementales pour contrôler le problème des réfugiés. « f D’avoir supprimé pendant deux mois les rapports adressés au State Department sur les atrocités allemandes, après que la publication de rapports analogues eut intensifié la pression de l’opinion publique (419). » Quant à des moyens d’action plus puissants, telles de vastes mesures de représailles, que la suprématie aérienne des Alliés rendait possibles, ils ne furent jamais envisagés. Et le bombardement des usines de la mort — opération militairement facile, qui aurait déréglé le processus exterminatoire et qui aurait été grosse d’effets psychologiques — bien que maintes fois réclamé par les organisations juives, leur fut toujours refusé. Divers auteurs, des historiens juifs en particulier, en commentant la somme de toutes ces carences, ont ouvertement parlé d’antisémitisme systématique : une phrase terrible a été citée, venant de la bouche d’un homme d’Etat allié à l’époque où, au printemps 1944, des diplomates allemands avaient lancé le bruit d’un prochain refoulement massif des Juifs sur un territoire allié ou neutre l : « Mais où allons- 1. Il semble qu’il s’est agi d’une idée de Ribbentrop, née dans son esprit à l’époque où, à la veille du débarquement allié en Normandie, la propagande allemande se livrait à diverses manœuvres psychologiques.
(p.389) nous les mettre 1 ? » Sans doute un tel facteur peut-il expliquer maintes réticences; mais peut-être n’est-il pas nécessaire de chercher dans une hostilité consciente la raison essentielle de l’inactivité presque totale du monde en face du martyrologe juif. Plutôt s’agissait-il d’un état de choses établi; et l’absence de textes ou de conventions protégeant les Juifs ne faisait que consacrer leur faiblesse séculaire. Si leurs souffrances ne trouvaient pas d’écho, c’est que le monde prenait facilement son parti de leurs plaintes. Et ils n’avaient rien d’autre à jeter dans la balance. La situation d’un peuple sans patrie, dont l’impuissance même, à travers les âges, a toujours été comme une provocation au massacre, fut à la vérité la raison majeure d’une impunité de fait dont les Nazis se sentaient bien le bénéfice assuré. (…)
Cf. le rapport de Veesenmayer, ambassadeur allemand à Budapest, à son gouvernement, en date du 3 avril 1944 : « La réaction de la population de Budapest aux deux attaques aériennes amenait dans de nombreux milieux une recrudescence de l’antisémitisme. Hier, des tracts furent distribués, qui réclamaient la vie de cent Juifs pour chaque Hongrois tué… Je n’aurais aucun scrupule à faire fusiller dix Juifs judicieusement choisis pour chaque Hongrois tué… J’avais du reste l’impression que le gouvernement (hongrois) serait prêt à mettre à exécution pareille mesure, et de son propre chef. D’autre part, une telle action, si elle est engagée, doit être exécutée sans faiblesse. Pour tenir compte des propositions faites au Fiihrer par M. le ministre des Affaires étrangères, concernant la possibilité d’offrir tous les Juifs en cadeau à Churchill et à Roosevelt, je vous prie de bien vouloir me faire savoir si cette idée est toujours retenue, ou si je puis commencer avec lesdites représailles après la prochaine attaque. »
1. L’authenticité de cette phrase, dont les termes nous ont été confirmés par une source très autorisée, ne laisse la place au moindre doute. Son auteur était Lord Moyne, à l’époque ministre d’Etat britannique au Proche-Orient.
(p.391) LES GRANDS DESSEINS NAZIS
Nous allons sortir maintenant de l’atmosphère de haine pure, de la destruction comme fin en soi, et, quittant la démente ambiance des industries de la mort, entrer dans un domaine où les intentions et les actes des dirigeants nazis, aussi implacables, aussi féroces qu’ils aient été, revêtent à première vue un aspect moins déconcertant. Ils ne sont plus sans précédent : ils paraissent faire écho aux entreprises des grands conquérants à travers les âges, poussées en l’espèce, il est vrai, à leurs conséquences les plus extrêmes. Il s’agit du sort réservé par le IIIe Réich aux peuples asservis, aux races dites « inférieures » : projets qui, bien qu’ils ne dussent connaître leur plein accomplissement qu’après la victoire, étaient déjà mis à exécution avec une hâte fébrile, à mesure que l’emprise allemande s’étendait sur l’Europe. Si, dans l’eschatologie nazie, le Juif occupait la place de Satan, le non-germain en général, le « sous-homme », démuni de tout attribut sacré, était délibérément rangé parmi les catégories du monde animal, et considéré tout au mieux (suivant une définition courante) comme « une forme de transition entre l’animal et l’homme nordique ». A l’égard du Polo-lonais, du Tchèque ou du Français, le souffle de (p.392) haine paraît donc absent, qui aurait poussé à décréter l’extermination de cette bête de somme par ailleurs si utile, appelée à jouer son rôle dans l’édification du IIP Reich millénaire. Les mesures de persécution, en ce qui le concerne, sont motivées tout autrement. Il s’agit dans ce cas de considérations économiques et démographiques qui, s’insérant dans le cadre d’un plan impérialiste, visent à assurer la primauté permanente et certaine de la race germanique; il est question de courbes de natalité et d’indices de reproduction, de la prolifération menaçante des Slaves, de la saignée occasionnée par la guerre parmi les Allemands… Et cependant, partant d’un point de vue apparemment plus rationnel, et faisant appel à des techniques plus subtiles, les Nazis tendaient, ainsi qu’on le verra, au même but, celui de la suppression physique des autres peuples : le même terme de génocide s’y applique, même s’il s’est parfois agi en l’espèce d’un génocide « à retardement », plus insidieux et plus lent. Derrière les nuances de terminologie et de méthodes, on retrouve en fin de compte l’identité des faits; derrière les superstructures et les rationalisations, on retrouve le même déferlement homicide, et les mêmes fleuves de sang. Du coup, en embrassant l’ensemble, on aperçoit mieux la vraie signification de l’extermination totale des Juifs, signe avant-coureur d’holocaustes plus vastes et plus généralisés. En fait, une fois déclenchée la « solution finale », les barrières mentales sont rompues, et le précédent psychologique créé : éprouvés aussi de leur côté, les procédés techniques. Aussi bien, on aurait pu conclure, par un simple raisonnement inductif, qu’une entreprise aussi démente ne pouvait s’arrêter à mi-chemin, et que, si seulement la fortune des armes en eût laissé le temps aux Nazis, elle aurait, par la seule force de sa logique interne, happé d’autres peuples et d’autres races dans son engrenage implacable. Car « le racisme est comme la maladie de la rage : nul ne peut savoir d’avance sur qui l’adorateur (p.393) de son propre sang déchargera la fureur qui le tourmente 1 ».
Rien n’est aussi oiseux que la tentative de préfigurer des événements qui n’eurent jamais lieu, et l’hégémonie allemande sur l’Europe fut de trop courte durée pour que ces destins menaçants aient eu le temps de s’accomplir. Mais en cinq années de guerre, la courbe d’un génocide plus généralisé se dessinait avec assez de netteté déjà pour qu’on puisse, sans quitter le terrain de l’Histoire pure, évoquer également le sort des sous-hommes qui n’étaient pas nés Juifs. A leur égard, deux procédés sont appliqués simultanément, avec une ampleur variant suivant les régions géographiques : une extermination directe partielle, caractéristique surtout pour l’URSS, et un ensemble de mesures plus circonspectes, plus cauteleuses, en vue d’une extinction.
(p.426) Mais jusqu’aux organisations de résistance, ces conclusions furent loin d’être unanimement tirées dans les pays de l’Est. Nous avons déjà eu l’occasion de parler de l’attitude réticente des organisations clandestines polonaises à l’égard de ceux-là mêmes d’entre les Juifs qui s’efforçaient de combattre les armes à la main. Quant aux masses populaires (et contrairement aux prévisions exprimées en 1940 par le général Blaskowitz : « Très rapidement… les Polonais et les Juifs, appuyés par l’Eglise catholique, se coaliseront sur toute la ligne dans leur haine contre leurs bourreaux… » : cf. p. 25), leur attitude paraissait surtout faite d’indifférence — tandis que des minorités agissantes s’attachaient à recueillir les innombrables fruits que le pillage et les dénonciations pouvaient leur assurer. Il y eut certes aussi en sens contraire un certain nombre d’actes de dévouement et d’héroïsme individuels : mais la tendance dominante s’exprimait en complète apathie, résultante de réactions de peur et aussi de satisfaction inavouable. Cette apathie, qui ne faisait que répondre à l’antisémitisme traditionnel des Polonais, trouve son expression négative dans l’absence absolue de protestations ou manifestations collectives, telles que par exemple l’épiscopat de la très catholique Pologne les adressa à des reprises réitérées au gouverneur général Frank à d’autres sujets. (Lorsque, dans un de ces documents, son auteur mentionne le sort des Juifs, ce n’est que pour s’indigner de la dépravation morale suscitée chez les exécutants des massacres : «…Je ne vais pas m’étendre longuement sur un fait aussi affreux que l’utilisation de la jeunesse alcoolisée du service du travail pour l’extermination des Juifs. » Cette phrase d’une ambiguïté terrible est extraite d’une protestation adressée à Frank par Adam Sapieha, prince-archevêque de Cracovie) (468). Quelles qu’en aient été les profondes raisons historiques, quels qu’aient été aussi le nombre et la qualité des exceptions individuelles, les innombrables témoignages sont tellement concordants 1, que l’amère constatation ne peut être évitée : l’attitude populaire polonaise, en face de l’agonie des Juifs, ne se distinguait guère de l’attitude allemande. Et plus loin à l’Est, en Ukraine en particulier, pour laquelle nous ne disposons guère de témoignages directs, les dispositions populaires semblent avoir été du même ordre, du moins si l’on en croit les avis placides ou les sarcasmes fielleux dont abondent les archives nazies : « La population indigène, qui n’ignore rien du processus de la liquidation, le considère avec calme, en partie avec satisfaction, et la milice ukrainienne y prend part (469). » « La population de Crimée a une attitude antijuive, et dans des cas isolés remet elle-même des Juifs aux kommandos aux fins de liquidation. Les Starostas (maires) demandent à être autorisés à liquider eux-mêmes les Juifs (470). » Peut-être un jugement quelque peu plus nuancé pourrait-il être porté sur les autres pays de l’Est et du Sud-Est. Ce n’est pas que la population hongroise, par exemple, ait donné des preuves d’une vive émotion, lors de la déportation-éclair des Juifs de Hongrie 2,
1. Des dizaines d’ouvrages, des centaines de dépositions et récits de survivants, fournissaient un tableau d’une unanimité à peu près complète. Si nous n’apportons ni citations ni détails, c’est pour ne pas nous répéter, et aussi par manque de place. 2. On trouve dans un rapport soumis à Washington par l’« Office of Stratégie Services », et daté du 19 octobre 1944, une intéressante analyse des réactions hongroises aux déportations de Juifs. « La réaction générale de la population hongroise aux mesures antisémites du gouvernement est difficile à caractériser. D’une part il y a des preuves que de larges couches de l’intelligentsia hongroise et de la classe moyenne inférieure en particulier ont adhéré à la propagande antijuive.
(p.430-431) Insensiblement, on tend à se désolidariser du réprouvé, marqué du signe évident du châtiment et du malheur. (Ainsi voit-on les foules se porter au secours de l’homme poursuivi par la police; et s’écarter sur le passage du condamné qui sort de geôle; on ne se soucie guère de connaître son crime, les portes se ferment devant lui, il est relégué au ban de la société.) De sourdes hostilités ancestrales se ranimaient de la sorte, sur le fond d’une campagne de diffamation poursuivie sans relâche, insinuante et omniprésente, soulevant une attention interrogative jusqu’au sein de milieux traditionnellement indifférents ou réfractaires 1.
1. Voici, parmi tant d’autres, un document particulièrement caractéristique à cet égard. Il s’agit d’une supplique collective adressée, en 1941, au maréchal Pétain par la population de Tpurnon-d’Agenais, village perdu de Lot-et-Garonne, dont les habitants n’avaient sans doute de leur vie jamais aperçu de Juifs ! La pétition est revêtue de cent quatre-vingt-quinze signatures : « Nous soussignés, habitants de l’agglomération du chef-lieu de canton de Tournon-d’Agenais (Lot-et-Garonne) avons l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : « La population totale de notre petite cité est de 275 personnes et on nous annonce l’arrivée prochaine de 150 Juifs indésirables, qui devront habiter parmi nous en résidence assignée. Tout nous porte à croire que ce renseignement est exact, car on a déjà déposé de la literie et une certaine quantité de paille dans nos établissements publics. « Nous sommes tous, Monsieur le Maréchal, très fortement émus de cette perspective. L’invasion de 150 Juifs indésirables chez 275 Français au caractère paisible par excellence équivaut à une véritable colonisation et nous appréhendons de voir des étrangers grâce à leur nombre nous supplanter outrageusement. « Ce sont, nous a-t-on précisé, des indésirables que nous allons recevoir. Ils le sont au même titre pour tous les Français sans nul doute et ne sauraient l’être moins pour nous que pour les régions qui s’en débarrassent. « Cent cinquante indésirables peuvent à la rigueur passer presque inaperçus au milieu de plusieurs milliers d’habitants. Leur présence devient intolérable et dégénère en brimade, pour une population qui est moins du double qu’eux et se trouve astreinte de ce fait à une promiscuité pour ne pas dire à une cohabitation révoltante. « Fidèles à notre réputation d’hospitalité, nous avons accueilli de notre mieux des Sarrois, des Espagnols, puis des Français (p.432) « En outre, nous n’avons à Tournon ni eau, ni cabinets d’aisance. Nous n’avons pas non plus de marché pour notre approvisionnement et les trois petits restaurants qui s’y trouvent alimentent actuellement à grand-peine les quelques clients de passage qui s’y présentent occasionnellement. « Les questions d’hygiène et d’alimentation doivent certainement tenir une très grande place dans les préoccupations de votre administration; elles s’allient ici, d’une façon étroite et la plus intime, avec la question morale, ethnique et vraiment française. « Connaissant votre paternelle sollicitude à l’égard de tous nos intérêts, nous sommes sûrs. Monsieur le Maréchal, qu’il vous suffira de connaître la pénible et injuste perspective qui nous menace, pour que vous provoquiez des ordres susceptibles de nous en épargner la douloureuse réalisation. « Cependant nous nous rendons bien compte que des Juifs sont des humains comme nous, qui, un jour, sont obligés de trouver leur gîte quelque part. — Si, dans votre sagesse, vous estimez que le bien supérieur de l’Etat exige de nous le sacrifice de les supporter, nous nous résignerons, mais non sans une incommensurable amertume; en vous demandant s’il ne vous serait pas possible de nous atténuer ce pénible contact, en les logeant dans un camp séparé près d’une source, ou d’un petit ruisseau (il en existe dans notre commune) où toutes les questions de surveillance, d’hygiène et de ravitaillement pourraient être avantageusement résolues, pour les hôtes qui nous sont imposés par le malheur, aussi bien que pour nous-mêmes. « Dans cet espoir nous vous prions, Monsieur le Maréchal, de daigner agréer l’expression de notre sincère reconnaissance, avec l’assurance de notre respectueux dévouement. »
(p.433) Ainsi, et quelles qu’aient été les innombrables marques de bienveillance et de solidarité prodiguées au cours des années de vicissitudes, son sort d’éternel proscrit était durement rappelé au peuple d’Israël. De l’Italie à la Norvège, les réactions populaires dans les pays de l’Ouest furent-elles partout les mêmes ? Evaluer des comportements collectifs est une délicate entreprise; et ces événements sont trop récents encore, trop rapprochés de nous, pour faciliter les jugements définitifs. Mais si on se livre à une comparaison rapide, on croit apercevoir nettement que les petits peuples pacifiques, aux vieilles traditions démocratiques, furent ceux à réagir avec le plus de fermeté et d’unanimité. Ainsi les Pays-Bas, où les premières déportations, en février 1941, suscitèrent un émoi tel que, chose inconcevable sous la botte nazie, une grève générale de plusieurs jours se déclencha spontanément à Amsterdam; ou le Danemark, où les déportations furent déjouées avec la collaboration active de la population tout entière, où, nous l’avons vu, les Allemands n’osèrent pas imposer l’étoile jaune aux Juifs, à la suite de l’attitude du roi Christian X. (Rappelons aussi que dans la lointaine et petite Bulgarie, de vastes manifestations populaires eurent lieu lors des déportations, aux cris de : « Nous voulons que les Juifs reviennent ! ») Ainsi, ces faibles pays, que leur histoire même avait harmonieusement mis à l’abri des excès et tentations impérialistes, auront donné au monde une fois de plus la preuve de leur maturité et de leur équilibre.
(p.435) (p.434) A cet égard, un champ d’action particulièrement vaste s’ouvrait au monolithe de l’Eglise catholique, à laquelle étaient rattachées (l’URSS exceptée) plus des trois quarts des populations de l’ensemble des pays subjugués. En des temps révolus, au cours du Moyen Age, l’attitude du catholicisme envers les Juifs comportait deux aspects, et la doctrine officielle, telle qu’elle a été articulée par saint Thomas d’Aquin, tout en prescrivant d’une part de protéger la vie des Juifs, approuvait de l’autre toutes les mesures d’exactions et d’abaissement à leur égard. S’il est vrai que les papes et les princes de l’Eglise s’opposèrent maintes fois, au nom de la charité chrétienne, aux massacres des Juifs, il est également vrai que ses théologiens et ses penseurs acceptaient comme naturelle et salutaire leur condition particulière 1.
1. Voici comment saint Thomas d’Aquin résumait la doctrine générale, dans une réponse à la duchesse de Brabant, qui lui demandait « dans quelle mesure elle pouvait exercer des exactions contre les Juifs » : « …bien que, selon les lois, les Juifs sont « promus par leur propre faute à la servitude perpétuelle, et que les seigneurs peuvent considérer comme leurs tous leurs biens terrestres, compte tenu de cette réserve que l’indispensable à la vie ne leur soit pas retiré — (…) il semble que l’on doit s’en tenir à ne contraindre les Juifs à aucune servitude dont ils n’auraient pas fait l’objet les années passées, car c’est ce qui sort des usages qui trouble le plus les esprits. En vous conformant à de tels principes de modération, vous pouvez suivre les usages de vos prédécesseurs en ce qui concerne les exactions à exercer à l’égard des Juifs, à condition cependant que rien ne s’y oppose par ailleurs » (470 bis).
(p.436) Précurseur de l’étoile jaune, le port de la « rouelle » ne fut-il pas introduit en 1215 par le concile de Latran ? C’est que, face à l’Eglise Triomphante, un rôle particulier revenait à la Synagogue Voilée 1; les Juifs abaissés et humiliés étaient les témoins tangibles de la vérité de la Foi, de la grandeur et de la réalité des dogmes. Ainsi donc, une volonté soutenue d’abaissement d’une part, le principe de l’intangibilité des vies juives de l’autre, caractérisaient de tous temps l’action de l’Eglise catholique. Impossible compatibilité, sans cesse mise en question au cours de siècles de massacres, et dont il appartenait à notre âge de faire éclater les contradictions profondes ! Empressons-nous de dire tout de suite que, face à la terreur hitlérienne, les Eglises déployèrent sur le plan de l’action humanitaire immédiate une activité inlassable et inoubliable, avec l’approbation ou sous l’impulsion du Vatican. Nous manquons d’éléments pour parler des instructions précises communiquées par le Saint-Siège aux Eglises des différents pays : mais la concordance des efforts entrepris à l’heure des déportations établit que de telles démarches eurent lieu. Nous avons eu l’occasion de mentionner l’intervention du clergé slovaque 2, qui, ainsi que le précise le rapport allemand qui traite de cette question, agissait sous l’influencedu Saint-Siège. En Pologne, on trouve un écho d’une telle prise de position du Vatican dans les considérations développées en privé par Mgr Szepticki, métropolite de l’Eglise catholique
1. Opposition Eglise Triomphante-Synagogue Voilée; c’est le thème qu’on retrouve sur le fronton de mainte cathédrale, où l’Eglise est représentée sous les traits d’une jeune femme resplendissante, tandis qu’une autre figure, portant un bandeau sur les yeux, personnifie la Synagogue. 1. Cf. p. 245.
(p.436) uniate de Galicie ‘, suivant lesquelles « l’extermination des Juifs était inadmissible ». (Un des témoins de cet entretien confidentiel s’était empressé d’en faire part aux Allemands, en ajoutant : « II (le métropolite) formule les mêmes pensées que les évêques français, belges et hollandais, comme s’ils avaient tous reçu du Vatican des instructions identiques (471). ») Encore que dans les pays de l’Est, conformément en ceci à la mentalité ambiante, l’attitude du clergé fût infiniment moins combative qu’à l’Ouest, où nombre de prélats, en France, aux Pays-Bas et ailleurs, ne se contentant pas de démarches prudentes et diplomatiques, firent dire publiquement des prières pour les Juifs. — Dans ce même ordre d’idées, la série des cahiers de Témoignage chrétien, perpétuant dans la clandestinité la tradition d’un Charles Péguy, et barrant le chemin à la contagion raciste, sous l’exergue « France, prends garde de perdre ton âme », appartient certainement aux pages les plus belles de la Résistance française. — Ajoutons que, dans sa cité, le Saint Père en personne accordait aide et protection à des dizaines de Juifs romains : de même lorsque en octobre 1943 les Nazis imposèrent une contribution exorbitante à la communauté juive de Rome, il offrit quinze kilos d’or afin de parfaire la somme. Cette activité humanitaire du Vatican se poursuivait nécessairement d’une manière prudente et discrète. L’immensité des intérêts dont le Saint Père avait la charge, les puissants moyens de chantage dont disposaient les Nazis à l’échelle de l’Eglise universelle, contribuaient sans doute à l’empêcher de prononcer en personne cette protestation solennelle et publique qui, cependant, était ardemment attendue par les persécutés. Il est pénible de constater
1. L’Eglise catholique uniate (ruthénienne) est soumise à l’autorité suprême du Saint-Siège aussi inconditionnellement que les autres églises catholiques, dont elle ne se distingue que par quelques particularités de rite (liturgie en ancien slavon, etc.).
(p.437) que tout le long de la guerre, tandis que les usines de la mort tournaient tous fours allumés, la papauté gardait le silence : il faut toutefois reconnaître qu’ainsi que l’expérience l’a montré à l’échelle locale, des protestations publiques pouvaient être immédiatement suivies de sanctions impitoyables. (C’est ainsi qu’aux Pays-Bas, les Juifs convertis au catholicisme furent déportés en même temps que les autres, à la suite d’un mandement épiscopal rendu public dans les Eglises catholiques, tandis qu’un sursis fut accordé aux Juifs protestants, l’Eglise protestante s’étant abstenue de protester publiquement. Sursis, il est vrai, de peu de durée; quelques mois plus tard, ils partageaient le sort commun.) Qu’aurait été l’effet d’une condamnation solennelle prononcée par l’autorité suprême du catholicisme ? La portée de principe d’une attitude intransigeante en la matière aurait été immense : quant à ses conséquences pratiques immédiates et précises, tant pour les œuvres et institutions de l’Eglise catholique que pour les Juifs eux-mêmes, c’est une question sur laquelle il est plus hasardeux de se prononcer.
(p.439) (…) la promulgation, en juin 1941, du « Statut des Juifs » ne provoqua de la part de l’épiscopat français (malgré l’exemple qui lui avait été donné par l’Eglise réformée de France, sur ce point) aucune protestation spécifique. En outre, il existe un témoignage d’après lequel ce Statut n’aurait soulevé aucune réprobation au sein des milieux du gouvernement suprême de l’Eglise catholique. Léon Bérard, ambassadeur de l’,Etat français au Saint-Siège, fut en effet expressément chargé par le maréchal Pétain de s’assurer des dispotions romaines en la matière, et son rapport, qu’il mit plusieurs semaines à élaborer, précisait que le « statut » ne soulevait, du point de vue catholique romain, nulle critique ou réprobation. Après avoir mis en valeur le soin et la minutie avec lesquels il avait recueilli ses informations, et s’être couvert de l’autorité de saint Thomas d’Aquin, l’ambassadeur Bérard concluait : « Comme quelqu’un d’autorisé me l’a dit au Vatican, il ne nous sera intenté nulle querelle pour le statut des Juifs. Un double vœu cependant m’a été exprimé par les représentants du Saint-Siège, avec le désir visible qu’ils fussent soumis au Chef de l’Etat français : « 1° Qu’il ne soit ajouté à la loi sur les Juifs aucune disposition touchant au mariage. Là, nous irions au devant de difficultés d’ordre religieux… « 2″ Qu’il soit tenu compte, dans l’application de la loi, des préceptes de la justice et de la charité. Mes interlocuteurs m’ont paru viser surtout la liquidation des affaires où les Juifs possèdent des intérêts. « Veuillez m’excuser, Monsieur le Maréchal, de vous avoir si longuement écrit… »
Or, s’il est loisible de supposer que le diplomate de Vichy alla chercher ses informations auprès des prélats qu’il se savait favorables et qu’il les interpréta (p.440) de manière à incommoder le moins possible le maître qu’il servait, il n’en reste pas moins qu’un tel rapport aurait été impossible si son auteur avait eu à faire face à une désapprobation formelle et franche du pape… Il n’appartient pas à un auteur Israélite de se prononcer au sujet des dogmes séculaires d’une autre religion; mais devant l’immensité des conséquences, on ne peut s’empêcher d’être profondément troublé. Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de notre émoi. Nous n’admettons pas qu’il y eût, fût-ce une trace d’antisémitisme dans la pensée du pape. Si, contrairement à tant d’évêques français, il n’avait pas élevé la voix, c’est que sans doute sa juridiction s’étendait à l’ensemble de l’Europe, et qu’il avait à tenir compte non seulement des graves menaces suspendues au-dessus de l’Eglise, mais aussi de l’état d’esprit de ses fidèles dans tous les pays. Le penseur catholique Jacques Madaule a fait observer que « l’Eglise est une démocratie », « qu’il est à peu près impossible que le pape se prononce s’il n’y est poussé par une espèce de grand mouvement d’opinion qui vient de la masse et qui doit remonter des fidèles aux prêtres (472) ». On peut admettre que si le pape est resté inactif, c’est qu’il ne se sentait pas assuré de ce « grand mouvement d’opinion qui vient de la masse ». Mais il en découlerait alors — et c’est là que réside la gravité du problème — que le silence du Vatican ne faisait que refléter les dispositions profondes des masses catholiques d’Europe. On croit voir s’illuminer ainsi une essentielle toile de fond, et déceler à l’arrière-plan des séquences causales qui ont abouti au génocide, son ultime condition néces-. saire… Un catéchisme inculqué des siècles durant à tous les enfants chrétiens ne leur apprenait-il pas que les Juifs, meurtriers de Jésus sont damnables ? Une prière dite le Vendredi saint ne parlait-elle pas des « Juifs perfides » et de la « perfidie juive » ? Les prédicateurs, de l’Aigle de Meaux au curé du village, (p.441) ne les ont-ils pas qualifiés, de génération en génération, de « peuple monstrueux, sans feu ni lieu » ? Hâtons-nous de dire que de nos jours, l’Eglise catholique a commencé en ce domaine une révision radicale de son enseignement. Le clergé français, en particulier, semble avoir déclaré à l’antisémitisme un combat résolu; à Rome aussi, à l’heure où nous revisons la nouvelle édition de ce Bréviaire, des réformes semblent prochaines. Mais il a fallu Auschwitz pour que tout cela soit entrepris : et qui pourra jamais dire le rôle que de pareilles impressions de prime enfance, profondément gravées dans les esprits, ont pu jouer dans le déroulement des événements qui ont conduit à Auschwitz ? 1 Certes, le problème ne concerne pas les catholiques seuls, et s’étend à la chrétienté tout entière. Sans remonter au Moyen Age, il est utile de rappeler qu’il y a quelques décades à peine, des prédicateurs chrétiens d’Allemagne, d’Autriche et d’ailleurs, qu’ils s’appelassent Lùger, Stocker ou Mgr Jouin, étaient les principaux hérauts de l’antisémitisme européen. La graine ainsi semée a proliféré, et les fruits finalement recueillis auraient sans doute vivement surpris ces imprudents pasteurs. Ils étaient inconscients de ce que l’antisémitisme comporte de fondamentalement antichrétien; l’agressivité destructrice, ou, pour mieux dire, « destructivité », telle que l’exprime le génocide, restait encore bridée chez eux.
1. (Note de 1974). Ces lignes datent de l’année 1958. Depuis, au-delà des décisions historiques du concile Vatican II, il y a eu dans les pays occidentaux, et notamment en France, une révision si radicale de l’attitude catholique à l’égard des Juifs, que la mise à jour de ce livre m’aurait imposé une assez longue digression. J’ai donc préféré me satisfaire de ce bref rappel.
(p.443) Les pages qui précèdent ne sont qu une tentative pour démêler, parmi toute la multiplicité de facteurs qui ont abouti au génocide, ses causes majeures, proches pu lointaines. Rien ne serait plus éloigné de notre but que de faire méconnaître la généreuse activité déployée sur le plan local par le clergé des pays de l’Ouest, et en France en particulier. Ce n’est qu’en haut de l’échelle que le mutisme obstiné du Vatican trouve sa contrepartie dans la prudente réserve d’un cardinal Suhard, archevêque de Paris, et d’autres hauts dignitaires (tandis que les archevêques de Lyon et de Toulouse ainsi que nombre d’évêques font entendre leurs protestations). Le bas clergé, par contre, et les ordres monastiques, rivalisaient de hardiesse et d’ardeur, et furent les principaux animateurs des efforts entrepris pour le sauvetage des Juifs. Des dizaines de prêtres et d’humbles moines payèrent de leur vie leur dévouement. Dans cette œuvre d’amour humaine, on croit retrouver l’empreinte de la pureté intransigeante et de l’élan des premiers martyrs chrétiens…
Réactions juives.
Plus de trois années après la fin de la guerre, les misérables survivants juifs de l’enfer concentrationnaire végétaient encore en Allemagne, derrière les enceintes des camps pour « personnes déplacées ». Aucun pays ne voulait les accueillir; la Palestine juive, dont les habitants leur tendaient les bras, était gardée par les croiseurs anglais. Allaient-ils se morfondre indéfiniment dans le pays même de leur agonie ? Il fallut la naissance de l’Etat d’Israël pour mettre un terme au drame.
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.308) /L’esclavage/ L’Afrique le connaissait bien avant l’arrivée du premier Blanc. La Bible ne s’en émeut guère, (p.309) bien au contraire elle le codifie. Grèce, Rome, pour ne parler que des mondes dont nous nous sentons les héritiers, ont dû leur prospérité au travail servile. Comme on l’a mentionné déjà, et malgré ce que l’on a pu croire, il a survécu sous cette forme tout droit venue de l’Antiquité pendant très longtemps. En Italie, durant la Renaissance, la plupart des grandes familles, comme leurs ancêtres romains, possèdent des esclaves – souvent blancs, d’ailleurs. Dans . Une histoire de l’esclavage1, Christian Delacampagne rapporte que le dernier acte d’affranchissement d’un individu dans ce qui est aujourd’hui la France a été trouvé dans le Roussillon et date de 1612. Pourtant, depuis un noble édit de Louis X le Hutin, le royaume se targuait de rendre sa liberté à tous les asservis qui y poseraient le pied. C’est ce qui explique en partie, notons-le par parenthèse, pourquoi les Noirs furent si rares dans l’Hexagone durant l’Ancien Régime : les négociants ne voulaient pas être contraints si bêtement d’avoir à les relâcher. Le monde musulman fut, lui aussi, un énorme consommateur d’esclaves. On a parlé de l’infâme trafic qui ravagea l’Ouest de l’Afrique. Pendant près de mille ans, les marchands arabes s’entendirent à en saigner la moitié est. Les routes passent par Zanzibar, où les bateaux viennent chercher les cargaisons qui iront alimenter les marchés des grands ports de la péninsule Arabique, ou coupent à travers le Sahara pour remonter jusqu’au Caire, ou au Maghreb. Olivier Pétré-Grenouilleau donne des descriptions de cette « traite transsaharienne » dont l’horreur n’a rien à envier à sa jumelle transatlantique : 3 000 kilomètres à pied, en longue caravane, avec un peu d’eau et une poignée de maïs pour seul viatique. Il existe aussi, dans l’islam, de très nombreux esclaves blancs. On ‘ ne peut oublier la terreur que causèrent durant trois siècles (XVIe, XVIIe et XVIIIe) les raids lancés par les « Barbaresques », comme on les appelait, ces pirates partis des régences ottomanes de Tunis ou d’Alger pour rafler tous les malheureux qui avaient le tort de se trouver sur les côtes européennes de la Méditerranée. Un historien 1 – Le Livre de poche, 2002.
(p.312) américain, Robert Davis1, estime à un million le nombre de victimes de ces razzias, que l’on vendait aux locaux ou que l’on envoyait pourrir dans d’anciens établissements de bains – qui nous ont laissé leur nom de bagnes – en attendant leur hypothétique rachat par leurs familles européennes ou par des confréries chrétiennes entièrement dévolues à cette tâche. L’Empire ottoman avait même systématisé le recours à l’esclavage de chrétiens pour en faire la base de son administration. Tous les ans, selon une pratique appelée le devchirme (la récolte, en turc), des soldats envoyés par le sultan parcouraient les villages chrétiens de l’Empire – par exemple les Balkans, ou encore le pourtour de la mer Noire – pour enlever ou, au mieux, acheter les enfants qui leur semblaient les plus beaux. Amenés à Istanbul, convertis, éduqués, ils étaient destinés à former l’armée d’élite du souverain : les janissaires. Le principe était brutal et simple : en coupant les enfants de leur religion et de leur famille, on était sûr d’en faire des serviteurs d’une loyauté absolue. Tout leur était permis alors, et on en a vu qui montèrent très haut. De nombreux grands vizirs, les Premiers ministres de l’empire, étaient d’anciens esclaves. Par un procédé similaire à celui des janissaires, l’Egypte avait ses mamelouks. Ils régnèrent sur le pays pendant des siècles, jusqu’à leur défaite devant les armées de Bonaparte, à la fin du XVIIIe.
1 – Esclaves chrétiens, maîtres musulmans, « Babel », Acte Sud, 2007.
(p.313) Hélas, ce qui a été arraché par les Noirs est vite repris par les Blancs. En 1802, Bonaparte rétablit l’esclavage. Je sais, les défenseurs de l’Empereur trouveront la phrase inexacte, et argueront que les choses sont plus complexes : après avoir signé la paix avec les Anglais, le Premier Consul se contente, dans les possessions qu’il récupère, comme la Martinique, d’avaliser une situation existante. Les colons n’y avaient jamais voulu abandonner l’esclavage. Notons tout de même ces détails : quand il s’agit d’une position défendue par les planteurs, Napoléon leur donne raison. Quand en même temps à Saint-Domingue la révolte d’anciens esclaves continue, il envoie la troupe – un de ses plus grands désastres militaires, d’ailleurs, qui aboutira à l’indépendance d’une partie de l’île et à la création de la république d’Haïti. Toujours est-il que, grâce à cette loi de Bonaparte, il faut attendre encore quarante-six ans et 1848 pour qu’on en ait enfin fini avec l’esclavage en France. On voit à quel point notre pays tenait à l’abolition : il a fallu s’y reprendre à deux fois pour la rendre effective.
(p.314) Au-dessus de tous les autres, on trouve enfin le vrai grand argument pour défendre l’esclavage : Dieu. Sans doute les chrétiens seront-ils horrifiés de l’apprendre, c’est avant tout en son nom que l’on se débarrassa de tout scrupule pour asservir, durant trois siècles, des millions d’êtres humains. Aujourd’hui, il nous semble évident à tous, chrétiens ou non, que la parole du Christ, véhiculée par le Nouveau Testament, ne peut qu’aller à l’encontre d’une telle déshumanisation. Bossuet, derrière saint Thomas d’Aquin, tenait le raisonnement inverse : dans quelques-unes de ses épîtres, saint Paul prêche aux esclaves d’accepter leur statut puisque la seule vraie libération n’est pas de ce monde, elle vient après la mort. C’est bien la preuve que le grand saint, et donc Celui au nom de qui il parle, accepte l’esclavage. Pour les pieux esprits du XVIIe siècle, une seule chose compte : il faut baptiser tous ces sauvages, c’est ainsi que nous les sauverons ; pour le reste, on peut bien faire d’eux ce que l’on veut. Voilà aussi le sens du Code noir, voilà pourquoi il insiste tant sur les questions religieuses. Ce n’est pas le moindre des paradoxes qu’il soulève : ce texte nous apparaît, à raison, comme une abomination. Il est (p.315) probable qu’en le signant, Louis XIV comme ses contemporains étaient certains de faire œuvre d’humanité : ne sommes-nous pas admirables envers ces pauvres Noirs, en les enlevant à leur monde sauvage, nous les avons sortis des ténèbres du paganisme pour les amener à la lumière du Christ ? Faut-il, pour autant, faire le procès du christianisme ? Certainement pas sur ce sujet. D’autres chrétiens eurent des positions diamétralement opposées à celle-ci. Dès le XVIe siècle, Paul III, pape, parlant pour les Indiens mais précisant que son texte concernait « toutes les nations », avait clairement condamné l’esclavage, comme inspiré par Satan. N’oublions pas enfin que la plupart des grands mouvements abolitionnistes, tout particulièrement en Angleterre, et plus tard aux Etats-Unis, furent menés par des chrétiens convaincus. |
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.427) L’Algérie, après une longue « pacification » (…) est devenue une colonie de peuplement, comme le sera la Nouvelle-Calédonie (…).
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.433) Le récit de Gide est moins isolé qu’on ne le croît, d’ailleurs. L’histoire coloniale est émaillée de scandales qui bouleversent la métropole, quand elle les apprend. Dès les premiers temps de la « pacification de l’Algérie », quelques généraux français, prétextant les horreurs dont se rendent coupables les Arabes, en inventent d’autres : par trois fois, durant l’été 1845, ils allument des feux devant les grottes où se sont réfugiés des villageois pour les asphyxier. La nouvelle des « enfumades » indigne Paris, provoque des incidents à la Chambre et, selon le très rigoureux Dictionnaire de la France coloniale, suscite des pétitions jusque dans les écoles. En 1898-1899, deux officiers français, Voulet et Chanoine, à la / tête d’un millier d’hommes, dirigent une « mission » au Tchad et, peut-être pris de folie, répandent terreur et barbarie partout où ils passent, massacrant des populations, brûlant les villages. Alerté, Paris finit par envoyer un colonel constater ce qui se passe. Il est abattu par les deux déments alors qu’il approche de la colonne. La presse s’empare de l’affaire, il est vrai que le scandale est énorme : détruire des villages, c’est une chose, mais tirer sur un officier français… Congo, Gallimard, 1927.
(p.434) En 1903, en Oubangui-Chari (l’actuelle République centrafricaine), deux petits fonctionnaires coloniaux, cherchant un moyen, diront-ils, de « méduser les indigènes pour qu’ils se tiennent tranquilles », se saisissent de l’un d’entre eux et le font sauter vivant à la dynamite. Nous sommes le 14 juillet. La date était mal choisie. La nouvelle déclenche en France un tel tollé que le gouvernement décide de dépêcher sur place le vieux Brazza, celui-là même qui avait conquis la région vingt ans auparavant pour lui apporter les bienfaits du progrès. Il sera tellement atterré de ce qu’il y découvrira qu’il mourra sur le bateau du retour. L’étonnant est que rien de tout cela ne pousse quiconque à ce qui nous semble aujourd’hui évident : remettre en cause le système lui-même.
Une pure domination raciste (…) Toutes les conquêtes coloniales, nous rappelle La République coloniale^, ont été initiées sous des prétextes humanitaires : il s’agit toujours de sauver des peuples d’affreux despotes ou de les arracher à des pratiques horribles. L’esclavage en est une. Deux mois après qu’il a obtenu la 1 – Coécrit par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Françoise Vergés, Hachette littératures, 2006.
(p.435) soumission de Madagascar, le général Gallieni le fait abolir et reçoit pour cela une magnifique médaille de la grande société antiesclavagiste de Paris. Quelques semaines plus tard, il introduit dans la Grande Ile le « travail forcé » : l’organisation d’épouvantables corvées auxquelles sont soumis de force, et sans contrepartie de salaire, les « indigènes ». L’histoire se répétera partout. Partout, la République arrive avec la Déclaration des droits de l’homme en bandoulière, partout, elle se hâte bien vite de rappeler que, dans les faits, il faudra attendre pour les mettre en œuvre. Dans toutes les colonies règne à partir des années 1880 le « Code de l’indigénat », qui crée un statut particulier pour les habitants des pays soumis. Les colons sont des citoyens de plein droit, les gens qu’ils viennent dominer, non. Ils ne bénéficieront jamais d’aucune des libertés dont la France se proclame la championne, m les droits politiques, ni le droit de réunion, ni les droits syndicaux : ils deviennent des parias dans leur propre pays. (…)En 1871, nous explique encore La République coloniale, le 7 Parlement prévoit de donner aux colons d’Algérie 100 000 hectares de terres. Il ne dit pas un mot des gens qui y vivaient jusqu’alors, sauf pour mentionner les punitions prévues pour ceux qui résiste- ) raient aux spoliations.
(p.436) En Algérie, jusqu’en 1958, on vote selon un « double collège » qui dénote une conception très particulière de l’équité électorale : la , voix d’un « Français » vaut celle de 7 « musulmans ». Tout un symbole.
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.455) /L’affaire Dreyfus/ En quelques années, l’antisémitisme, hier encore dans les marges, devient une opinion proclamée avec une fierté impensable aujourd’hui : il y a des livres antisémites, des chansons antisémites, des candidats antisémites aux élections. L’Église, soucieuse de reconquérir un plus vaste public, a lancé grâce aux Assomption-nistes un nouveau grand journal, La Croix. Il sera sous titré « le journal le plus anti-juif de France ». Et jamais ni lui ni aucun des titres plus populaires qui vont pêcher dans les mêmes eaux ne lésineront à se servir d’une explication du monde qui nous semble délirante, et qui, précisément, est d’autant plus redoutable qu’elle l’est. Qu’il se produise n’importe quel scandale politico-financier – la IIIe République en connaît d’innombrables -, la presse antisémite déclenche un jeu qu’elle ne perd jamais. S’il se trouve à quelque niveau de l’affaire un protagoniste qu’elle estime juif, elle oublie évidemment qu’il y en a vingt à côté qui ne le sont pas : une fois de plus, « ils » sont coupables ! Si aucun n’apparaît, c’est encore plus évident : « ils » adorent le secret, si « ils » n’apparaissent pas, c’est bien la preuve qu’« ils » y sont encore. (p.456) Le capitaine est français, on pourrait même dire qu’il l’est doublement, puisqu’il appartient à une de ces familles qui ont choisi de quitter l’Alsace après 1871 pour ne pas devenir allemandes; il est d’un patriotisme sans faille, chauvin, souvent buté comme le sont la plupart des militaires à l’époque. Pour les antisémites, il est juif, il n’y a donc pas à chercher plus loin. Dès l’arrestation, le journal de Drumont s’enflamme et l’accable. Bien plus tard, quand les preuves de l’innocence s’accumulent, Maurice Barrés, le chef des nationalistes, ne se démonte aucunement. Il écrit : « Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. »
Xénophobie
À la haine des Juifs, dans ces dernières décennies du XIXe siècle, s’en ajoute une autre, moins frontale dans l’Affaire, mais tout aussi présente : celle de l’étranger. La xénophobie est une maladie ancienne et commune à de nombreux peuples. À cette époque, elle aussi prend une forme plus moderne – celle que nous connaissons toujours -, la haine du travailleur immigré. Eux non plus ne sont pas une nouveauté dans le pays. Sous la monarchie de Juillet, puis sous le Second Empire, d’innombrables Allemands, fuyant la pauvreté, sont venus se placer dans les grandes villes, en particulier comme tailleurs, domestiques ou bonnes. La plupart d’entre eux ont fui avec les débuts de la guerre de 1870, ou se sont sentis obligés de changer leur nom, ou de mentir sur leur origine. Dans le Sud-Ouest, on compte depuis longtemps de nombreux Espagnols. Sur la frontière des Alpes, des Suisses. Les nécessités de l’économie et la faiblesse de la démographie amplifient ce mouvement et conduisent, dans les années 1880, aune grande vague d’immigration comparable à celles que l’on verra dans les années 1920 ou après la Seconde Guerre mondiale. La France compte alors plus d’un million d’étrangers, nous rappelle l’Histoire des étrangers et de l’immigration 1. Les deux populations les plus nombreuses
1 – Sous la direction d’Yves Lequin, op. cit.
(p.457) sont les Belges dans la France du Nord et les Italiens dans celle du Sud. Les bases du ressentiment à leur égard sont économiques : on en veut à ces concurrents qui prennent les emplois et font chuter les salaires en acceptant de travailler à n’importe quelle condition. Les formes qu’il prend sont brutales. Les Italiens, tout particulièrement, en sont victimes. Dans les journaux, dans une partie de l’opinion publique, ils sont toujours écrasés sous d’éternels stéréotypes. Les macaronis sont des criminels en puissance, des pouilleux sans feu ni lieu, des bagarreurs toujours prêts à sortir le couteau, à qui, en outre, les milieux ouvriers plutôt déchristianisés reprochent leur bigoterie et leur soumission aux prêtres : en argot, on les appelle les christos. On notera au passage que les préjugés contre les immigrés du XXe puis du XXIe n’ont guère changé, à un détail près : on continue toujours de leur reprocher leur religion, mais le plus souvent ce n’est pas la même. Parfois les tensions explosent. Les circonstances sont diverses. En 1881, la France et l’Italie s’opposent car elles veulent toutes deux mettre la main sur la Tunisie : le débarquement des troupes françaises à Marseille fournit le prétexte de manifestations anti-italiennes, qui dégénèrent en violences contre les Italiens de la ville – vingt blessés, trois morts. D’autres débordements auront lieu en 1894 quand Sadi Carnot, le président de la République, sera assas- , sine par un anarchiste italien. Les plus graves se sont produites un an seulement auparavant, au mois d’août 1893, à Aiguës-Mortes : un véritable pogrom d’une sauvagerie inouïe est organisé contre les ouvriers italiens, dont huit seront assassinés et cinquante blessés. Les responsables seront jugés quelques mois plus tard et acquittés.
|
2 Documents
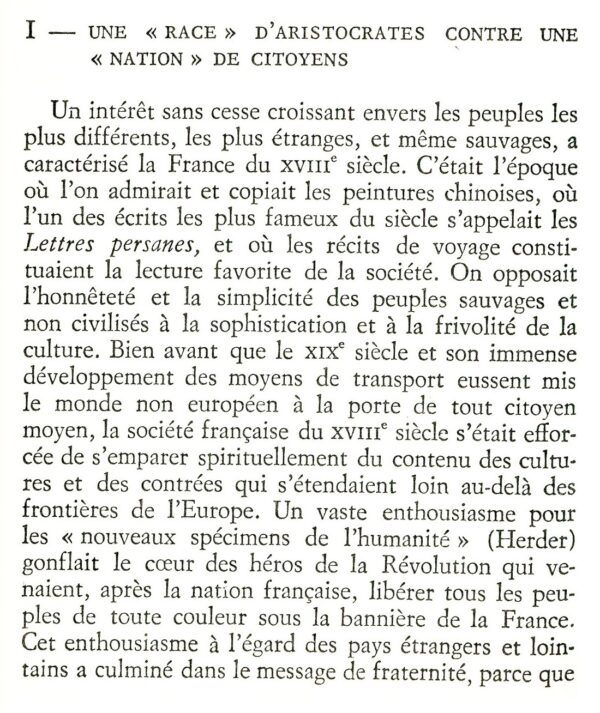
Fin du 18e siècle en France: les germes de la capacité du racisme à détruire les nations et à annihiler l'humanité (Hannah Arendt)
(Hannah Arendt, in: L’impérialisme, éd. Fayard, 1982, p.74-76)