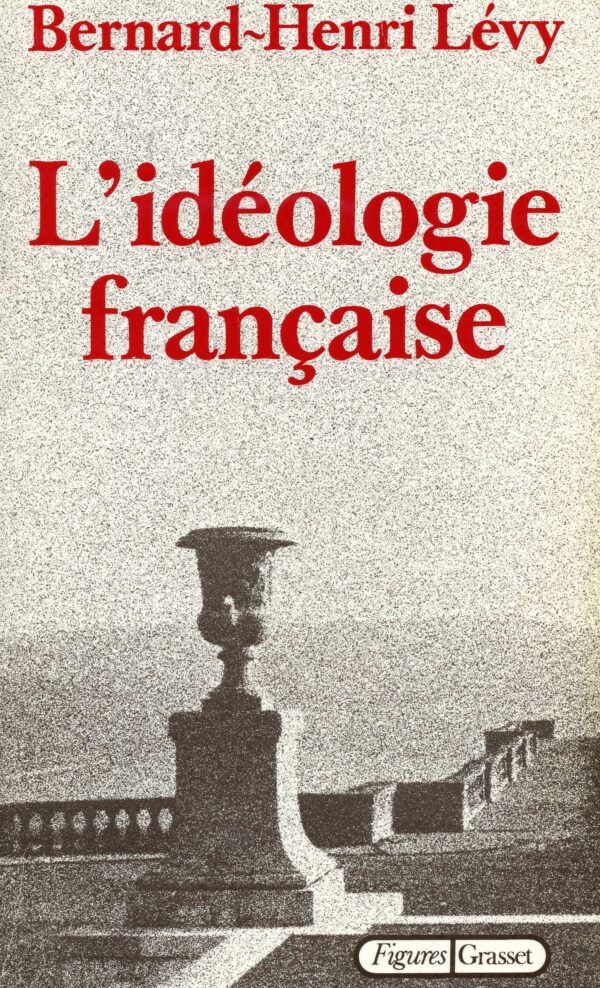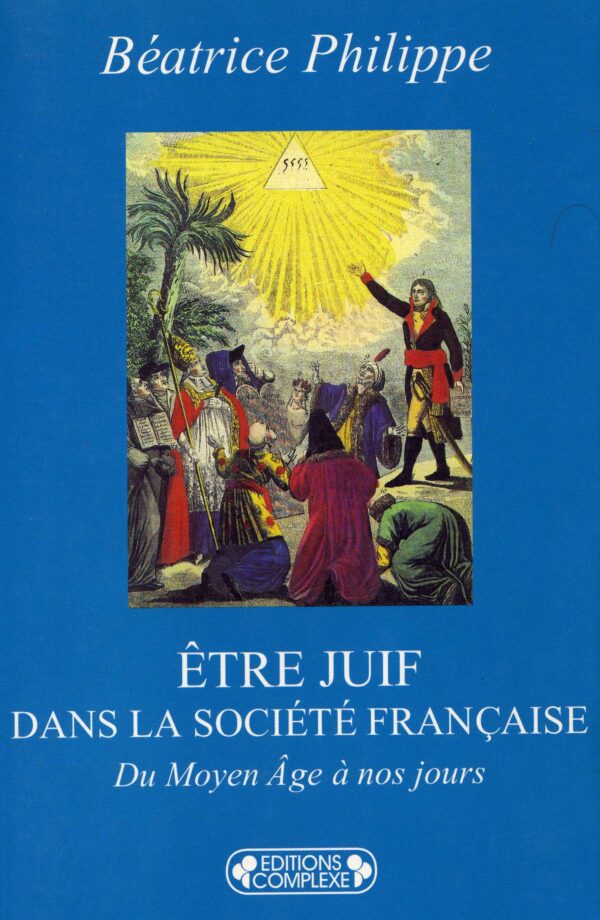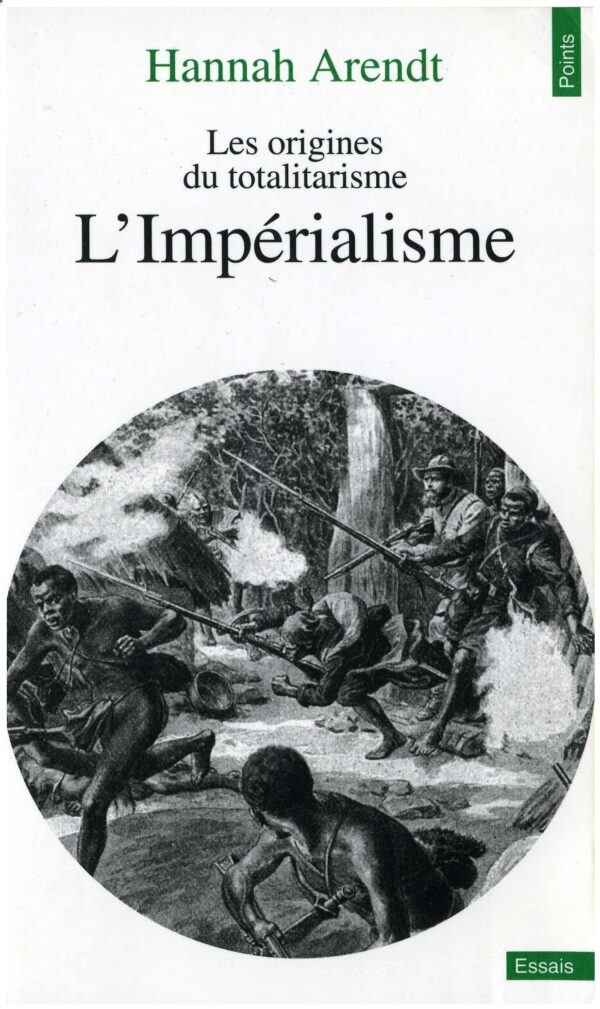La réalité politique de la France: généralités
PLAN
1 Analyses
2 La judéophobie en France, ancrée dans les mentalités
3 Documents
4 Couvertures de livres consultés
1 Analyses
|
1979 |
Pierri Zind, Elsass Lothringen, Alsace Lorraine, 1870-1940, 1979
(p.473) Dr Karl Roos: “Qu’y a-t-il d’ ailleurs d’anti-français à dire de simples vérités et à signaler de simples faits sans un mot de haine ou d’excitation? La vérité peut-elle être en elle-même anti-française?”
|
|
1980s |
Ludo Baeten, Het jacobinisme of de wrange nasleep van de Franse bezetting, in: DELTA, p.13-15
In 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk ingelijfd op grond van het jacobijnse principe « la langue est la nation toute entière ». In de zuidelijke provincies van België werden Romaanse talen en/of dialecten gesproken, terwijl in de noordelijke de adel en de hogere burgerij reeds sterk verfranst waren.
Onze gewesten, die tot dan toe ieder hun eigen identiteit hadden bewaard, werden in een unitair dwangbuis gedwongen. Er werd een politiek van uniformisatie doorgevoerd, terwijl de elite aan een ware hersenspoel ing werd onderworpen.
De Franse opvatting van de politieke maatschappij werd doorgedrukt en verdrong het eigen staatkundig denken zoals zich dat hier in de loop der eeuwen had ontwikkeld. De Nederlanden werden van hun historische wortels afgesneden. De geestelijke overwoekering door Franse denkbeelden en mythen bleek nog rampzaliger dan de militaire bezetting en de politieke aanhechting. De gevolgen hiervan doen zich nog steeds voelen.
In 1815 werd de eenheid van de Nederlanden hersteld. Koning Willem, waarvan de verdiensten steeds meer worden gewaardeerd, was ten zeerste begaan met de ontwikkeling van de op vele gebieden achteropgeraakte Zuidelijke Nederlanden. Jammer genoeg was ook hij opgezet met het Franse politieke denken, wat overigens in de kaart speelde van een bepaald « verlicht despotisme »- Hij koos zijn medewerkers vooral onder oudgedienden van het Franse bestuur. Hij gaf geen of te weinig gehoor aan degenen die hem voorhielden wat meer rekening te houden met de eigen politieke tradities. Was hij hierop ingegaan en had hij een meer gedecentraliseerd bestuur in acht genomen, dan hadden de Brusselse rellen van 1830 wellicht nooit aanleiding gegeven tot een afscheidingsbeweging waardoor Vlaanderen, Brabant en Limburg andermaal werden verhapstukt. De diepere oorzaak van de scheiding moet worden gezocht in de weigering een nochtans opvallende verscheidenheid te erkennen en in de verwerping van een gezond particularisme, eigen aan ‘s lands tradities. Dank zij het staatsmanschap van Thorbecke kwam in Nederland daarin verandering in de jaren 1848-1851, amper twintig jaar na de Belgische afscheiding. Aan gemeenten en provincies werd toen een ruime zelfstandigheid toegekend, zodat Nederland een gedecentraliseerde unitaire staat werd. Deze decentralisatie heeft de politieke samenhang van Nederland eerder versterkt dan verzwakt. Bij gebrek aan visie volhardden de grondleggers van de nieuwe Belgische staat echter in de jacobijnse vergissing. Andermaal werd de staatsconstructie naar Frans model op een unitaire leest geschoeid. Ook werd de verfransingpolitiek weer opgenomen. Door een verbeten Vlaamse weerstand mislukte de poging tot taalkundige homogeneïsatie. Zelfs vanuit een louter Belgisch standpunt moet het welslagen van de Vlaamse Beweging als een winstpunt worden beschouwd. Zij heeft in de Zuidelijke Nederlanden de verscheidenheid van taal gevrijwaard en daardoor een grotere openheid van het land in vele richtingen.
Het anderhalve eeuw volgehouden unitaire regime heeft echter frustratiegevoelens gewekt, die een federalistische verstandhouding ten zeerste bemoeilijken. Op zijn beurt mondde dit centralisme uit op een streven naar de vestiging van twee tegengestelde « volksgemeenschappen », waarin « le mal français » welig bleef voortwoekeren.
In het al oververkavelde Noordwest Europa wordt er door een kortzichtige oligarchie aangestuurd op de vestiging van twee nieuwe verkrampte natiestaatjes, al dan niet samengehouden door een impotente Statenbond waar de beslissingen genomen volgens de onnozele regel van de consensus. Zonder wortels in het verleden bieden deze wangedrochten geen uitzicht op de toekomst. Ook wekken zij bij de bevolking niet het minste enthousiasme- Niettegenstaande twee eeuwenlang volgehouden centralisme blijft het volksaanvoelen verschillen in Limburg en West-Vlaanderen, in Luxemburg en in Luik.
Afgebakend door de onwezenlijke Belgische grenzen met Nederland in het Noorden en het Oosten, met Frankrijk in het Westen en door een filologische grens in het Zuiden is « Vlaanderen » een artefact, een kunstmatig product van een politiek onvermogen.
Zonder ernstig rekening te houden met de nieuwe internationale context trachten argeloze politici idealen van vijftig jaar geleden, onrijpe jeugddromen uit een tijd « toen alles anders was » te verwezenlijken. Zij zeggen wel dat het nationalisme voorbijgestreefd is, maar in een laatste stuiptrekking van deze dwanggedachte geven zij het land een structuur die het belet zijn beste troeven uit te spelen. Het is « een catastrofale en historische vergissing » zegde Herman van Rompuy ooit…
Op grond van een willekeurig natiebegrip wordt een ruimere natuurlijke samenhang verbroken. Het streven naar Vlaamse nationale uniformiteit diept de kloven uit, niet alleen met de Romaanse gewesten, maar ook met de aanpalende Brabantse en Limburgse provincies in Nederland en met Nederland in het algemeen.
Het nationalisme, als tegenhanger van het federalisme, activeert de spiraal van de ontwrichting, het ondermijnt de bereidheid tot samenwerking. Het leidt de landen en gewesten van de Gouden Delta verder af van hun functie als Europees kerngebied. « Vlaanderen » wordt in een positie van isolement gedreven. De gevolgen ervan zijn nu al merkbaar Onze kleine landen worden een gemakkelijke prooi voor de drijverijen van de grote gieren van de Europese politiek. Het nationalisme van de kleine volken dient altijd het imperialisme der groten.
Het is duidelijk dat, ook binnen een Verenigd Europa, de landen en gewesten van de Delta moeten leren samenwerken en samengaan voor de verdediging van voor de hand liggende gemeenschappelijke belangen en voor de vrijwaring van een gemeenschappelijke Europese functie. Men mag zich geen illusies maken, de gewezen grootmachten koesteren nog steeds het idee van een soort Directorium der groten. Zolang Europa niet beschikt over een evenwichtige klassieke federale staatsregeling blijft de grootste waakzaamheid geboden. |
|
1981 |
André Hella, LES FRANCAIS SONT-ILS DONC CARTESIENS?, VA 06/08/1981
Depuis Descartes, les Français passent pour des gens épris de logique et de clarté. En dialecte liégeois, il existe une vieille expression où « être clair » se dit » être (nous traduisons) français » . En de multiples circonstances toutefois, nos grands voisins nous déroutent par leurs contradictions, et d’autant plus que d’instinct nous les considérons comme nos maîtres à penser et nos professeurs de culture. Ils s’affirment de parfaits démocrates, au point de nous faire presque croire qu’ils ont inventé la démocratie, Mais ils n’en finissent pas d’apparaître comme des monarchistes camouflés, frustrés, refoulés, Ils sont prompts en effet à vitupérer la domination des partis et à rêver de « l’homme providentiel « , qui imposerait enfin aux politiciens bavards et combinards la loi de l’intérêt général. Depuis le premier Empire jusqu’à Mitterrand, en passant par le Prince-Président, le général Boulanger, Clémenceau, Pétain et de Gaulle, s’observe un vaste courant d’opinion favorable à une forte personnalité capable de surmonter les querelles partisanes et de vaincre le » chaos ». Les Français aiment de se proclamer la nation des droits de l’homme et la patrie du genre humain. Et en effet ils sont accueillants aux étrangers et aux réfugiés politiques (surtout quand ils ont les sympathies du pouvoir en place). C’ est pourtant la France qui au XIXe siècle et jusqu’au dernières années de l’entre-deux-guerres a connu le plus d’écrivains racistes ou xénophobes: Gobineau, Drumont, Céline, et bien d’autres. Il faut croire qu’il en reste quelque chose dans le réflexe profond du Français moyen qui, comme ses ancêtres les Gaulois, est très ouvert, très généreux et très hospitalier vis-à-vis des étrangers, mais en se réservant le droit incontestable de se croire supérieur aux amerloques, aux fridolins, aux polacks, aux macaronis, aux youpins, aux métèques, aux macaques, aux rastaquouères et aux bougnoules. Malgré les » histoires belges « , les Français ne nous décernent aucune des gracieusetés du genre. Pourquoi ? Peut-être parce que nous leur sommes trop proches et qu’on ne blague jamais aussi férocement qu’à la table de famille, surtout à l’adresse des cousins les plus crétins et les plus demeurés. Quant aux cousins très doués et qui sont arrivés, comme dans toutes les familles encore une fois, on s’en honore publiquement. C’est une règle commune à laquelle les Français se conforment quand ils s’annexent Henri Michaux, Félicien Marceau, Crommelynck, Georges Simenon, Françoise Mallet-Joris, Jacques Brel, Régine, ou Annie Cordy. Ces Belges ne sont plus Belges : ils deviennent des » écrivains et artistes français nés en Belgique « . Et le tour est joué. A l’égard des Américains, les attitudes des Français pataugent dans les inconséquences les plus déconcertantes. Ils disent et répètent que la civilisation américaine est un très grand danger pour le génie latin, mais leur manière de mener cette croisade de l’esprit revient finalement à s’américaniser comme à plaisir. Leur langue – dont ils vantent très justement (sic) la subtile et précise élégance – ils sont en train de la dénaturer par une masse de vocables anglo-saxons souvent obscurs (sic) ou inutiles (sic). Bien plus, ou bien pis, ils se convertissent chaque jour davan tage aux modes de vie américains en adoptant pêle-mêle , les gratte-ciel, la » série noire « , les centrales nucléaires, les juke-boxes, le strip-tease, les drugstores, les blue- jeans, et nous en passons. La psychanalyse elle-même, qu’en bons cartésiens ils avaient toujours rejetée pour son manque de rationalité, ils en sont devenus des adeptes fervents après qu’elle fut passée d’Europe aux U.S.A. Sur le plan politique, ils trouvent que les Américains sont des naïfs, de » grand enfants « , mais par ailleurs ils les trouvent intéressés, cyniques, et blâment leur » interventionnisme » ou même leur » impérialisme », S’ils sont au Vietnam ou ailleurs, ils leur reprochent de se mêler de ce qui ne les regarde pas, mais lorsqu’ils tardaient à intervenir dans les deux guerres mondiales, chaque Français répétait : » Bon Dieu, qu’est-ce qu’ils attendent ! ils se fichent bien de nous ! » A peine d’ailleurs les soldats d’Eisenhower avaient-il refoulé les Allemands au-delà du Rhin qu’on lisait sur les murs : » Américains, go home ! « , On ne sait jamais si les Français sont de vrais » atlantistes « , tant ils y mettent d’hésitations et de réserves, Au fond, ce qu’ils voudraient, c’est demeurer neutres tout en bénéficiant de l’aide inconditionnelle des Américains. En somme, ce qu’ils souhaiteraient, c’est recevoir tous les avantages d’un accord militaire sans devoir en subir les inconvénients ; c’ est pouvoir s’ affIrmer indépendants à l’égard des Soviétiques et des Américains, tout en se réjouissant en leur for intérieur de la puissance américaine pour sauvegarder leurs libertés et d’abord celle d’être à leur aise antiaméricains ! Avec raison, ils sont fiers de leurs fastes et de leur histoire militaire, mais par ailleurs, ils sont antimilitaristes, Depuis Courteline et son » Train de 8 h 47 », se sont multipliés les vaudevilles et les films , inspirés du comique troupier, où l’officier est nécessairement un noblion prétentieux, l’adjudant une brute gueularde et le deuxième classe un péquenot. Ces clichés burlesques ne sont évidemment guère compatibles avec le chevalier Bayard, Jeanne d’ Arc, Turenne, Napoléon et l’épopée de la Légion étrangère. Il est tout de même difficile d’imaginer que la bataille de Verdun a été gagnée par des bidasses. Gendarmes et policiers ne sont point à meilleure enseigne. Pour les Français, ce sont les » flics » (en Belgique, si vous les traitez de ce vocable, vous êtes poursuivi pour outrage). Il n’aime pas les « flics », mais il exige d’eux non seulement qu’ils lui assurent sa sécurité, mais encore qu’ils y mettent les formes. S’ils ne découvrent pas un dangereux criminel, » à quoi servent-ils ? « . Et s’ils le découvrent, ils ne faut surtout pas qu’ils tirent les premiers, sinon ils sont coupables de » bavures ». Ils doivent arrêter, mais après avoir couru obligatoirement le risque de se faire tuer.
La Révolution de 1789, les Français la placent volontiers au centre de leur patrimoine national; seulement, depuis lors, ils ne cessent de la refaire, comme si ses objectifs demeuraient toujours à atteindre. Depuis près de deux siècles, après l’ expérience de deux. Monarchies, de deux Empires et de cinq Républiques, ils n’arrivent point à s’accorder unanimement sur un régime institutionnel. Le mythe de la Révolution est si profondément ancré dans leurs esprits et dans leurs coeurs qu’une bonne partie d’entre eux croient dans leur Parti communiste – qui est le plus stalinien d’Europe – le véritable héritier de 1789 et espèrent d’un totalitarisme rouge la réalisation enfin achevée des valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Le plus contradictoire, c’est qu’en fait, les Français n’aiment pas le changement. Ils sont révolutionnaires en paroles, et conservateurs en actes, ils sont prompts aux chambardements dans l’abstrait, et rétifs aux réformes dans le concret. Ils reconnaissent qu’il faut » faire l’Europe « , mais il faut d’abord que » La France reste la France ». Ils reconnaissent que les jacobins ont fait la part trop belle à Paris, qu’ils y ont trop concentré les divers, pouvoirs, que la décentralisation est dès lors nécessaire et même urgente, mais c’est à la suite d’un référendum sur la décentralisation que de Gaulle a dû quitter l’Elysée.
|
|
1981 |
B.-H. Lévy, L’ idéologie française, 1981
(p.9) “Il est l’ heure, enfin, de regarder la France en face.” (p.133) “(…) car je crois, effectivement, qu’ il y a eu, un demi-siècle avant Vichy, un national-socialisme à la française. Mieux: que la France: la patrie des droits de l’ homme de nouveau (sic), est, en un sens, la propre patrie du national-socialisme en général.”
|
|
1981 |
Raymond Aron, Le spectateur engagé, éd. Julliard, 1981
(p.184) “En tant que sociologue, ou en tant que politiste comme l’on dit, j’avais réfléchi sur les modes de gouvernement possibles de nos sociétés industrielles et pensé que le danger par excellence, le mal par excellence, c’était le régime totalitaire. Or, à mes yeux, de toute évidence, le régime stalinien était le régime totalitaire parfait, accompli. On ne pouvait pas faire mieux dans ce genre, et aujourd’hui, tout le monde ou presque est d’ accord.
J-L M. Vous avez dit aussi que les intellectuels français choisissaient ce totalitarisme pour se consoler un peu de la perte du prestige politique de la France. R.A. Oui.
|
|
1985 |
Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Complexe, BXL, 1985, p.268
Maurice Barrès: “Il faut enseigner la vérité française, celle qui est le plus utile à la nation.”
|
|
1986 |
A. Wickham, S. Coignard, La Nomenklatura française, éd. Belfond, 1986
Elle n’ existe pas que dans l’ancienne URSS.
(p.14) L’économie française est à peine moins centralisée que celle de l’URSS. ‘En effet, l’on peut ajouter au poids du secteur public – qui réalisait en 1984 plus de la moitié des investissements et englobait l’essentiel des très grandes entreprises – le fait que ses principaux dirigeants soient tous nommés, chez nous, par le pouvoir politique -, une situation qui trouve ses origines dans les nationalisations opérées en 1981 et surtout en 1945 et dans les multiples prises de participation effectuées depuis un demi-siècle par l’ Etat …’ et en tout cas, “plus que n’importe quel autre pays occidental.” “L’autonomie de gestion est une autre affaire, sur laquelle il ne sera pas utile de s’interroger.” “Les analogies dans les systèmes de nomination?” (cf p. 14) (cf pp.14-15) Le caractère fortement héréditaire de nos classes dirigeantes. (pp. 16-17) La concentration de la majorité des pouvoirs dans les mains d’ une petite minorité, aggravée depuis une quizaine d’ années par une politisation croissante.
(p.18) “La France a décidément bien du mal à enterrer son passé: comment ne pas voir dans le rituels et les fastes dont aime à s’ entourer le monarque élu la réplique troublante des fêtes du Roi-Soleil ou des “lilts de jsutice” de Louis XV?” (/ les logements: pp.260-261 sv. / les logemen,ts souvent somptueux des présidents des Conseils généraux suite à la décentalisation (p.352) / + le personnel à leur service)
(p.18) la ‘non-responsabilité’ de nos grands décideurs, qui, souvent sortis de l’ ENA – une école de ‘généralistes’ – , se sentent investis d’ une mission qui les incite à s’ éloigner progressivement de leur domaine de compétence.
|
|
1989 |
Guy Héraud, la situation juridique de l’ euskera en pays basque français, in: Europa Ethnica, 3-4, 89, pp. 144-149
(p.149) “Comparé à ce qui se passe dans les Etats étrangers, le système français reste fondamentalement négateur du fait minoritaire, mettant en avant la philosophie jacobine de la démocratie individualiste “une et indivisible”.”
|
|
1989 |
R.V., Ces drôles de Français, LB 15/03/1989
(John Ardagh, journaliste brit., dans: Cces drôles de Français, éd. Belfond, 512 p.) “Les Français y apparaissent nageant dans les paradoxes. Avides de modernité mais foncièrement conservateurs. passionnés de Minitel, mais comptant en anciens francs. Se réclamant de Descartes, mais agissant de manière irrationnelle. Inscrivant l’ égalité sur leur fronton, mais multipliant castes et privilèges.”
|
|
1989 |
Théodore Louis, Cannes 89 ou le 42e parallèle, LB 20/05/1989
(a pris la parole: le cinéaste français René Vautier) “En France, la vraie démocratie n’existe pas. Il est impossible de dire dans un film que des Algériens ont été torturés”
|
|
1991 |
Dominique De Montvallon, Chirac divise l’opposition et comble la majorité, LB 22/06/1991
“Ses déclarations sur l’ immigration contribuent à alourdir le climat politique.” Il a proclamé à Orléans, devant une assemblée de sympathisants, qu’ il y avait “overdose” et que beaucoup de Français devenaient, non sans raisons, “fous” (à cause du “bruit” et des … “odeurs” de certains de leurs voisins d’ immeubles).”
|
|
1992 |
J-Claude Broché, faut-il laver “La Marseillaise” de son sang impur?, LS 30/01/1992
Croisade de l’abbé Pierre en faveur de cette suppression.
|
|
1992 |
Paul Touvier va échapper à la justice, LB 14/04/1992
Non-lieu en faveur de l’ ancien chef des renseignements de la Milice française.
|
|
1992 |
Valérie Duponchelle, André Glucksmann: “Un révisionnisme juridique”, Le Figaro, 17/04/1992 (à propos du verdict au procès de Touvier)
“Pour le philosophe, l’arrêt de la chambre d’accusation est critiquable car il ne reconnaît pas aux actes antisémites de la collaboration la notion de crimes contre l’humanité.” (A.G.) “C’est un révisionnisme juridique: il consiste à dire que les crimes contre l’humanité n’affectent pas les collabos, les miliciens, les tortionnaires, les exécuteurs de juifs, dès lors qu ils ne sont pas allemands.”
|
|
1993 |
Dominique Moïse, Associate Director of the French Institute for International Relations, Where the king is naked … but still in power until 1995, The European, 25/02/1993
Frenchmen realise their influence in the world is a lot less than it used to be.
|
|
2000 |
Jean-François Revel, La grande parade / Essai sur la survie de l’utopie socialiste, éd. Plon 2000
(p.16) N’oublions jamais en effet qu’en Europe comme en Amérique latine, la certitude d’être de gauche repose sur un critère très simple, à la portée de n’importe quel arriéré mental : être, en toutes circonstances, d’office, quoi qu’il arrive et de quoi qu’il s’agisse, antiaméricain. On peut être, on est même fréquemment (p.17) un arriéré mental en politique tout en étant fort intelligent dans d’autres domaines. Parmi d’innombrables exemples, l’auteur dramatique anglais Harold Pinter explique1 l’intervention de l’Otan contre la Serbie en avril 1999 par le fait que, selon lui, les États-Unis n’ont, en politique internationale, qu’un seul principe : « Baise mon cul ou je t’assomme. » Avoir du talent au théâtre n’empêche pas, chez le même individu, la débilité profonde et la nauséabonde vulgarité dans les diatribes politiques. C’est l’un des mystères de la politique que sa capacité à provoquer la brusque dégradation de maintes personnalités par ailleurs brillantes. Comment réagirait Pinter si un critique dramatique se permettait de tomber aussi bas dans l’imbécillité injurieuse en « commentant » une de ses pièces ?
(p.88) CHAPITRE SIXIEME PANIQUE CHEZ LES NÉGATIONNISTES Les négationnistes pronazis ne sont qu’une poignée. Les négationnistes procommunistes sont légion. En France, une loi (loi Gayssot, du nom du député communiste qui l’a rédigée et qui, cela se comprend, n’a vu les crimes contre l’humanité que de l’oeil droit) prévoit des sanctions contre les mensonges des premiers. Les seconds peuvent impunément nier la criminalité de leur camp préféré. Je parle non seulement de camp politique, au singulier, mais aussi de camps de concentration au pluriel : le goulag soviétique de jadis et le laogaï chinois d’aujourd’hui, celui-ci en pleine activité, avec en prime ses milliers d’exécutions sommaires chaque année. Ce ne sont d’ailleurs là que les principaux exemplaires d’un genre d’établissements consubstantiel à tout régime communiste. On conçoit donc qu’habitués à cette inégalité de traitement, les négationnistes procommunistes aient été frappés de stupeur lors de la publication du Livre noir, qui établit solidement deux vérités : le communisme fut toujours, est toujours intrinsèquement criminogène ; et, en cela, il ne se distingue en rien du nazisme.
(p.110) Les véritables principes du socialisme n’ont pas été violés par Staline ou Mao quand ils ont pratiqué leurs génocides : ces principes ont été, au contraire, appliqués par eux avec un scrupule exemplaire et une parfaite fidélité à la lettre et à l’esprit de la doctrine. C’est ce que montre avec précision George Watson1. Dans l’hagiographie moderne, toute une partie essentielle de la théorie socialiste a été refoulée. Ses pères fondateurs, à commencer par Marx lui-même, ont très tôt cessé d’être étudiés de façon exhaustive par les croyants mêmes qui se réclamaient d’eux sans arrêt. Leurs œuvres, de nos jours, semblent jouir du rare privilège d’être comprises de tout le monde sans que personne les ait jamais complètement lues, même pas leurs adversaires, ordinairement rendus incurieux par la peur des représailles. Dans sa majeure partie, l’histoire est un réarrangement et un tri, donc une censure. Et l’histoire des idées n’échappe pas à cette loi. L’étude non expurgée des textes nous révèle par exemple, écrit Watson, que « le génocide est une théorie propre au
1. George Watson, La Littérature oubliée du socialisme, Nil Éditions, 1999. Traduit de l’anglais par Hugues de Giorgis. Édition originale : The Lost Literature of Socialism, The Lutterworth Press, Cambridge, 1998. George Watson est professeur à St. John’s Collège, Cambridge. Plusieurs passages de ce chapitre sont tirés de la préface que j’ai rédigée pour la traduction française de l’ouvrage de Watson.
(p.111) socialisme ». Engels, en 1849, appelait à l’extermination des Hongrois, soulevés contre l’Autriche. Il donne à la revue dirigée par son ami Karl Marx, la Neue Rheinische Zeitung, un article retentissant dont Staline recommandera la lecture en 1924 dans ses Fondements du léninisme. Engels y conseille de faire disparaître, outre les Hongrois, également les Serbes et autres peuples slaves, puis les Basques, les Bretons et les Écossais. Dans Révolution et Contre-Révolution en Allemagne, publié en 1852 dans la même revue, Marx lui-même se demande comment on va se débarrasser de « ces peuplades moribondes, les Bohémiens, les Carinthiens, les Dalmates, etc. ». La race compte beaucoup, pour Marx et Engels. Celui-ci écrit en 1894 à un de ses correspondants, W. Borgius : « Pour nous, les conditions économiques déterminent tous les phénomènes historiques, mais la race elle-même est une donnée économique… » C’est sur ce principe que s’appuyait Engels, toujours dans la Neue Reinische Zeitung (15-16 février 1849) pour dénier aux Slaves toute capacité d’accéder à la civilisation. « En dehors des Polonais, écrit-il, des Russes et peut-être des Slaves de Turquie, aucune nation slave n’a d’avenir, car il manque à tous les autres Slaves les bases historiques, géographiques, politiques et industrielles qui sont nécessaires à l’indépendance et à la capacité d’exister. Des nations qui n’ont jamais eu leur propre histoire, qui ont à peine atteint le degré le plus bas, de la civilisation… ne sont pas capables de vie et ne peuvent jamais atteindre la moindre indépendance. » Certes Engels attribue une part de l’« infériorité » slave aux données historiques. Mais il considère que l’amélioration de ces données est rendue impossible par le facteur racial. Imaginons le tollé que s’attirerait aujourd’hui un « penseur » qui s’aviserait de formuler le même diagnostic sur les Africains ! Selon les fondateurs du socialisme, la supériorité raciale des Blancs est une vérité « scientifique ». Dans ses notes préparatoires à VAnti-Duhring, l’évangile de la philosophie marxiste de la science, Engels écrit : « Si, par exemple, dans nos pays, les axiomes mathématiques sont parfaitement (p.112) évidents pour un enfant de huit ans, sans nul besoin de recourir à l’expérimentation, ce n’est que la conséquence de « l’hérédité accumulée ». Il serait au contraire très difficile de les enseigner à un bochiman ou à un nègre d’Australie. » Au vingtième siècle encore, des intellectuels socialistes, grands admirateurs de l’Union soviétique, tels H.G. Wells et Bernard Shaw, revendiquent le droit pour le socialisme de liquider physiquement et massivement les classes sociales qui font obstacle à la Révolution ou qui la retardent. En 1933, dans le périodique The Listener, Bernard Shaw, faisant preuve d’un bel esprit d’anticipation, presse même les chimistes, afin d’accélérer l’épuration des ennemis du socialisme, « de découvrir un gaz humanitaire qui cause une mort instantanée et sans douleur, en somme un gaz policé — mortel évidemment — mais humain, dénué de cruauté ». On s’en souvient, lors de son procès à Jérusalem en 1962, le bourreau nazi Adolf Eichmann invoqua pour sa défense le caractère « humanitaire » du zyklon B, qui servit à gazer les Juifs lors de la Shoah. Le nazisme et le communisme ont pour trait commun de viser à une métamorphose, à une rédemption « totales » de la société, voire de l’humanité. Ils se sentent, de ce fait, le droit d’anéantir tous les groupes raciaux ou sociaux qui sont censés faire obstacle, fût-ce involontairement et inconsciemment — en jargon marxiste « objectivement » — à cette entreprise sacrée de salut collectif. Si le nazisme et le communisme ont commis l’un et l’autre des génocides comparables par leur étendue sinon par leurs prétextes idéologiques, ce n’est donc point à cause d’une quelconque convergence contre nature ou coïncidence fortuite dues à des comportements aberrants. C’est au contraire à partir de principes identiques, profondément ancrés dans leurs convictions respectives et dans leur mode de fonctionnement. Le socialisme n’est pas plus ou pas moins « de gauche » que le nazisme. Si on l’ignore trop souvent, c’est, comme le dit Rémy de Gourmont, qu’« une erreur tombée dans le domaine public n’en sort jamais. Les opinions se transmettent héréditairement ; cela finit par faire l’histoire ». (p.113) Si toute une tradition socialiste datant du dix-neuvième siècle a préconisé les méthodes qui seront plus tard celles d’Hitler comme celles de Lénine, Staline et Mao, la réciproque est vraie : Hitler s’est toujours considéré comme un socialiste. Il explique à Otto Wagener que ses désaccords avec les communistes « sont moins idéologiques que tactiques! ». L’ennui avec les politiciens de Weimar, déclare-t-il au même Wagener, « c’est qu’ils n’ont jamais lu Marx ». Aux fades réformistes de la social-démocratie, il préfère les communistes. Et l’on sait que ceux-ci le payèrent largement de retour, en votant pour lui en 1933. Ce qui l’oppose aux bolcheviques, dit-il encore, c’est surtout la question raciale. En quoi il se trompait : l’Union soviétique a toujours été antisémite. Disons que la « question juive » (malgré le pamphlet de Marx publié sous ce titre contre les Juifs) n’était pas, pour les Soviétiques, comme pour Hitler, au premier rang des priorités. Pour tout le reste, la « croisade antibolchevique » d’Hitler fut très largement une façade, qui masquait une connivence avec Staline bien antérieure, on le sait maintenant, au pacte germano-soviétique de 1939. Car, ne l’oublions pas, tout comme, d’ailleurs, le fascisme italien, le national-socialisme allemand se voyait et se pensait, à l’instar du bolchevisme, comme une révolution, et une révolution antibourgeoise. « Nazi » est l’abréviation de « Parti national socialiste des travailleurs allemands ». Dans son État omnipotent2 Ludwig von Mises, l’un des grands économistes viennois émigrés à cause du nazisme, s’amuse à rapprocher les dix mesures d’urgence préconisées par Marx dans le Manifeste communiste (1847) avec le programme économique d’Hitler. « Huit sur dix de ces points, note ironiquement von Mises, ont été exécutés par les nazis avec un radicalisme qui eût enchanté Marx. »
1. Otto Wagener, Hitler aus nachster nahe : Aufzeichnungen eines Vertrauten, 1929-1939, Francfort, 1978. 2. 1944. Et 1947 pour la traduction française. Livre rédigé aux États-Unis pendant la guerre et dont le titre original est The Omnipotent Government, The Rise of thé Total State and thé Total War. J’ai déjà signalé cette observation de von Mises dans mon livre La Connaissance inutile, 1988, Grasset et Hachette-Pluriel.
(p.114) En 1944 également, Friedrich Hayek, dans sa Route de la servitude1, consacre un chapitre aux «Racines socialistes du nazisme ». Il note que les nazis « ne s’opposaient pas aux éléments socialistes du marxisme, mais à ses éléments libéraux, à l’internationalisme et à la démocratie. » Par une juste intuition, les nazis avaient saisi qu’il n’est pas de socialisme complet sans totalitarisme politique.
(p.116) Car tous les régimes totalitaires ont en commun d’être des idéocraties : des dictatures de l’idée. Le communisme repose sur le marxisme-léninisme et la « pensée Mao ». Le national-socialisme repose sur le critère de la race. La distinction que j’ai établie plus haut entre le totalitarisme direct, qui annonce d’emblée en clair ce qu’il veut accomplir, tel le nazisme, et le totalitarisme médiatisé par l’utopie, qui annonce le contraire de ce qu’il va faire, tel le communisme, devient donc secondaire, puisque le résultat, pour ceux qui les subissent, est le même dans les deux cas. Le trait fondamental, dans les deux systèmes, est que les dirigeants, convaincus de détenir la vérité absolue et de commander le déroulement de l’histoire, pour toute l’humanité, se sentent le droit de détruire les dissidents, réels ou potentiels, les races, classes, catégories professionnelles ou culturelles, qui leur paraissent entraver, ou pouvoir un jour entraver, l’exécution du dessein suprême. C’est pourquoi vouloir distinguer entre les totalitarismes, leur attribuer des mérites différents en fonction des écarts de leurs superstructures idéologiques respectives au lieu de constater l’identité de leurs comportements effectifs, est bien étrange, de la part de « socialistes » qui devraient avoir mieux lu Marx. On ne juge pas, disait-il, une société d’après l’idéologie qui lui sert de prétexte, pas plus qu’on ne juge une personne d’après l’opinion qu’elle a d’elle-même. En bon connaisseur, Adolf Hitler sut, parmi les premiers, saisir les affinités du communisme et du national-socialisme. Car il n’ignorait pas qu’on doit juger une politique à ses actes et à ses méthodes, non d’après les fanfreluches oratoires ou les pompons philosophiques qui l’entourent. Il déclare à Hermann Rauschning, qui le rapporte dans Hitler m’a dit : «Je ne suis pas seulement le vainqueur du marxisme…. j’en suis le réalisateur. «J’ai beaucoup appris du marxisme, et je ne songe pas à m’en cacher….. Ce qui m’a intéressé et instruit chez les (p.117) marxistes, ce sont leurs méthodes. J’ai tout bonnement pris au sérieux ce qu’avaient envisagé timidement ces âmes de petits boutiquiers et de dactylos. Tout le national-socialisme est contenu là-dedans. Regardez-y de près : les sociétés ouvrières de gymnastique, les cellules d’entreprises, les cortèges massifs, les brochures de propagande rédigées spécialement pour la compréhension des masses. Tous ces nouveaux moyens de la lutte politique ont été presque entièrement inventés par les marxistes. Je n’ai eu qu’à m’en emparer et à les développer et je me suis ainsi procuré l’instrument dont nous avions besoin… »
L’idéocratie déborde largement la censure exercée par les dictatures ordinaires. Ces dernières exercent une censure principalement politique ou sur ce qui peut avoir des incidences politiques. Il arrive d’ailleurs aux démocraties de le faire également, comme on l’a vu en France pendant la guerre d’Algérie, sous la Quatrième République comme sous la Cinquième. L’idéocratie, elle, veut beaucoup plus. Elle veut supprimer, et elle en a besoin pour survivre, toute pensée opposée ou extérieure à la pensée officielle, non seulement en politique ou en économie, mais dans tous les domaines : la philosophie, les arts, la littérature et même la science. La philosophie, de toute évidence, ne saurait être pour un totalitaire que le marxisme-léninisme, la « pensée Mao » ou la doctrine de Mein Kampf. L’art nazi se substitue à l’art « dégénéré », et, parallèlement, le « réalisme socialiste » des communistes entend tordre le cou à l’art « bourgeois ». Le pari le plus risqué de l’idéocratie, et qui en étale bien la déraison, porte toutefois sur la science, à laquelle elle refuse toute autonomie. On se souvient de l’affaire Lyssenko en Union soviétique. Ce charlatan, de 1935 à 1964, anéantit la biologie dans son pays, congédia toute la science moderne, de Mendel à Morgan, l’accusant de « déviation fasciste de la génétique », ou encore « trotskiste-boukhariniste de la génétique ». La biologie contemporaine commettait en effet à ses yeux le péché de contredire le matérialisme dialectique, d’être incompatible avec la dialectique (p.118) de la nature selon Engels, lequel, nous l’avons vu, affirmait encore, dans l’Anti-Duhring, vingt ans après la publication de L’Origine des espèces de Darwin, sa croyance dans l’hérédité des caractères acquis. Soutenu, ou, plutôt, fabriqué par les dirigeants soviétiques, Lyssenko devint président de l’Académie des Sciences de l’URSS. Il en fit exclure les biologistes authentiques, quand il ne les fit pas déporter et fusiller. Tous les manuels scolaires, toutes les encyclopédies, tous les cours des universités furent expurgés au profit du lyssenkisme. Ce qui eut en outre des conséquences catastrophiques pour l’agriculture soviétique, déjà fort mal en point après la collectivisa-tion stalinienne des terres. La bureaucratie imposa en effet dans tous les kolkhozes l’« agrobiologie » lyssenkiste, proscrivant les engrais, adoptant le « blé fourchu » des… pharaons, ce qui fit tomber de moitié les rendements. On proscrivit les hybridations, puisque, pérorait Lyssenko, il était notoire qu’une espèce se transformait spontanément en une autre et qu’il n’était point besoin de croisements. Ses folles élucubra-tions portèrent le coup de grâce à une production déjà stérilisée par l’absurdité du socialisme agraire. Elles rendirent irréversibles la famine chronique, ou la « disette contrôlée » (disait Michel Heller), qui accompagna l’Union soviétique jusqu’à sa tombe. (…)
Le critère extra-scientifique de la vérité scientifique chez les nazis découle du même schéma mental, à cette différence près (p.119) que, chez eux, ce critère est la race au lieu d’être la classe. Mais les deux démarches sont intellectuellement identiques, dans la mesure où elles nient la spécificité de la connaissance comme telle, au bénéfice de la suprématie de l’idéologie.
(p.122) Cette association délirante entre judéité, individualisme et capitalisme motive les éructations antisémites de Karl Marx, dans son essai Sur la question juive (1843). Essai trop peu lu, mais qu’Hitler, lui, avait lu avec attention. Il a presque littéralement plagié les passages de Marx où celui-ci vomit contre les Juifs des invectives furibondes, telles que celle-ci : « Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, la cupidité (Eigennutz). Quel est le culte profane du Juif ? Le trafic. Quel est son dieu ? L’argent. » Et Marx enchaîne en incitant à voir dans le communisme « l’organisation de la société qui ferait disparaître les conditions du trafic et aurait rendu le Juif impossible ». Dans le genre appel au meurtre, il est difficile de faire plus entraînant.
(p.123) D’où la conception de l’État qui est commune à Lénine et à Hitler. Dans La Révolution prolétarienne et le renégat Kautzky, Lénine écrit : « L’État est aux mains de la classe dominante, une machine destinée à écraser la résistance de ses adversaires de classe. Sur ce point, la dictature du prolétariat ne se distingue en rien, quant au fond, de la dictature de toute autre classe. » Et, plus loin dans le même livre : « La dictature est un pouvoir qui s’appuie directement sur la violence et n’est lié par aucune loi. La dictature révolutionnaire du prolétariat est un pouvoir conquis et maintenu par la violence, que le prolétariat exerce sur la bourgeoisie, pouvoir qui n’est lié par aucune loi. » Si l’on veut bien se reporter au second volume de Mein Kampf, on y verra que, dans le chapitre consacré à l’État, Hitler s’exprime à ce sujet en des termes presque identiques. La « dictature du peuple allemand » y remplace celle du prolétariat. Mais, si l’on tient compte des multiples diatribes anticapitalistes du Führer, les deux concepts ne sont pas très éloignés l’un de l’autre. Tout système politique totalitaire établit invariablement un mécanisme répressif visant à éliminer (p.124) non seulement la dissidence politique mais toute différence entre les comportements individuels. La société se sait inconciliable avec la ‘variété’.
(p.143) C’est ainsi qu’en 1990, l’Unesco organise une célébration de la « mémoire » d’Hô Chi Minh à l’occasion du centenaire de la naissance du dictateur. Tous les thèmes de cette commémoration reproduisent sans examen les mensonges de l’antique (p.144) propagande communiste provietnamienne des années soixante et le mythe de Hô Chi Minh qui avait été fabriqué jadis à coups de dissimulation et d’inventions des « organes ». Le sigle Unesco signifie « Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ». Si l’Unesco servait la science, elle aurait convoqué d’authentiques historiens, qui n’auraient pu que mettre à mal la légende forgée pour transfigurer Hô Chi Minh. Si elle servait l’éducation, elle ne se serait pas mise au service d’un bourrage de crâne totalitaire. Si elle servait la culture, au lieu de la censure, elle n’aurait pas verrouillé ce colloque pour en bannir toute fausse note « viscérale anticommuniste ». Peu convaincu par cette « mémoire » sauce Unesco, Olivier Todd, un des meilleurs connaisseurs au monde des questions du Vietnam, où il fut de longues années envoyé spécial et même prisonnier du Viet-cong, consacre avant l’événement au « mythe Hô Chi Minh », une étude où il déplore « l’extraordinaire naïveté flagorneuse de nombreux publicistes et diplomates, preuve des manipulations politiques au sein de l’Unesco. Cette organisation internationale, émanation de l’ONU, s’apprête à célébrer en Hô Chi Minh un « grand homme d’Etat », un « homme de culture », un « illustre libérateur » de son peuple. La communauté internationale est invitée à subventionner l’héroïsation et la mythi-fication de « l’Oncle » communiste, et ce, l’année qui suit le passage du communisme mondial aux poubelles de l’Histoire1. »
1. Olivier Todd, « Le mythe Hô Chi Minh » dans Hô Chi Minh, l’homme et son héritage. Ouvrage collectif, Duông Moï, La Voie nouvelle, Paris, 1990. Repris dans Commentaire n » 50, été 1990.
(p.155) Rappeler que Castro a fait fusiller 17 000 personnes dans un pays de 10 millions d’habitants et Pinochet 3 197 dans une pays de 15 millions d’habitants permet de comparer une terreur à l’autre, sans excuser aucune des deux.
(p.157) (…) la gauche française persiste dans son attitude protectrice envers le stalinisme cubain. Elle veille à sauvegarder l’immunité dont jouit Castro. Je serais presque tenté de dire : avant, au moins elle mentait ! Maintenant, elle reconnaît que le régime cas-triste repose entièrement sur les violations les plus extrêmes des droits de l’homme et pourtant elle ne lui retire pas sa solidarité. C’est presque pire. Tous les gens de gauche ne souscrivent pas aux propos de Mme Danielle Mitterrand : « Cuba représente le summum de ce que le socialisme peut réaliser », phrase qui constitue la condamnation la plus accablante du socialisme jamais énoncée. Mais tous — et la droite aussi — n’en confirment pas moins de plus belle leur attachement à ce principe (déjà respecté dans les cas des anciens chefs Khmers rouges et d’Erich Honecker) : même quand on sait tout des forfaits d’un bourreau totalitaire « de gauche », il doit rester exempt des peines et même du blâme que l’on doit infliger par « devoir de mémoire » aux bourreaux totalitaires « de droite ».
(p.158) Tous ceux qui ont voyagé en RDA pendant les quinze dernières années de son existence étaient édifiés par l’état de délabrement du pays : immeubles tombant en miettes au point qu’on tendait des cordes le long des trottoirs pour empêcher les piétons d’y marcher, de peur qu’ils ne reçoivent quelque moellon sur la tête ; infrastructures déplorables ; industrie inadaptée, travaillant avec des machines datant des années vingt, et qui crachait du haut de ses cheminées antiques une pollution noirâtre et poisseuse. Ce cataclysme socialiste fut d’ailleurs attribué par la gauche, aussitôt après la réunification allemande, à… l’irruption de l’économie de marché ! N’oublions pas qu’entre 1990 et 1998 ont été transférés aux Lander de l’Est 1 370 milliards de marks, soit, par an, un tiers du budget annuel de la France ! A cet argent public s’ajoutent les investissements privés. Malgré ce flot de capitaux, les Lander de l’Est, tout en ayant considérablement progressé, n’ont pas, en 1999, rattrapé le niveau de vie de l’ex-Allemagne de l’Ouest, tant le socialisme est difficile à guérir.
(p.162) Les nazis avaient rétabli l’esclavage en temps de guerre, dans des camps de travail où les esclaves étaient des déportés provenant des pays vaincus. Les communistes ont fait mieux : ils ont partout réduit en esclavage une part substantielle de leur propre population, et ce en temps de paix, au service d’une économie « normale », si l’on ose dire. Cet aspect souvent ignoré tend à prouver que, si improductive qu’elle soit, l’économie socialiste réelle le serait encore davantage sans le recours à la main-d’œuvre servile.
(p.167) /Mao/
Quant à l’examen multilatéral des textes complets, il révèle que Mao n’est pas un théoricien ou du moins pas un inventeur. Les rares écrits théoriques, « À propos de la pratique », « À propos de la contradiction », se bornent à vulgariser et à simplifier le Matérialisme et Empiriocriticisme de Lénine. Ce sont, d’ailleurs, comme tous ses textes, des écrits de circonstance, de combat, destinés à véhiculer une pression politique précise sur telle tendance concrète au sein ou en dehors du PC chinois. En fait, l’idéologie léniniste-staliniste, adoptée une fois pour toutes, n’est jamais en tant que telle repensée par Mao. Quand il fait apparemment de l’idéologie, c’est, en réalité, de la tactique.
(p.168) Dans le discours où il parle des Cent Fleurs, intitulé « De la juste solution des contradictions au sein du peuple » (1957), comme dans des textes plus anciens : « De la dictature démocratique populaire » (1949) ou « Contre le style stéréotypé dans le Parti » (1942), ce raisonnement, toujours le même, est celui-ci : la discussion est libre au sein du Parti ; mais, dans la pratique, les objections contre le Parti proviennent de deux sources : des adversaires de la Révolution, et ceux-là ne doivent pas avoir le droit de s’exprimer, et des partisans sincères de la Révolution, et ceux-ci ne sont jamais réellement en désaccord avec le Parti. Donc, les méthodes autoritaires sont du « centralisme démocratique », tout à fait légitime, et, dans le peuple, « la liberté est corrélative à la discipline ». (…)
En art et en littérature aussi, les Cent Fleurs peuvent intellectuellement s’épanouir, mais comme il importe de ne pas laisser se mêler les « herbes vénéneuses » aux « fleurs odorantes », Mao en revient vite à un dirigisme culturel identique à celui de Jdanov. L’idée d’« armée culturelle » est très ancienne chez Mao. Là encore, il n’innove pas : la culture est toujours le reflet de la réalité politique et sociale. Une fois accomplie la révolution économique, il faut donc aligner sur elle la culture. Cette vue est entièrement conforme au léninisme militant, sans la moindre variante personnelle. Entendons-nous : je ne porte ici aucun jugement politique sur la Chine, et je suis peut-être « chinois », qui sait ? Mais l’étude des textes oblige à dire que, philosophiquement, il n’y a pas de « version chinoise » du marxisme, il n’y pas de maoïsmel.
1. Le Petit Livre rouge. Citations du président Mao Tsé-toung. Seuil, 190 pages. Écrits choisis en trois volumes, par Mao Tsé-toung. Maspero, chaque volume 190 pages.
(p.177) Le communisme conserve sa supériorité morale. On le sent à des symptômes parfois anecdotiques, presque puérils. Quand fut réédité, en janvier 1999, le premier album d’Hergé, épuisé depuis soixante-dix ans, Tintin au pays des Soviets, on le décrivit dans plusieurs articles comme une charge outrée et excessive. Or c’est au contraire une peinture étonnamment exacte, pour l’essentiel, et qui dénote, à cette époque lointaine, chez le jeune auteur « une prodigieuse intuition », ainsi que le signale Emmanuel Le Roy Ladurie répondant à un questionnaire dans Le Figarol. Mais le même Figaro ne semble pas d’accord avec l’historien, puisqu’il juge que la vision d’Hergé « souffre certainement, avec le recul du temps, de manichéisme ». Vous avez bien lu : avec le recul du temps. Ce
1. 6 janvier 1999. Répondent également au questionnaire Alain Besançon, Pierre Daix, qui abondent dans le même sens et Alain Krivine, secrétaire général de la Ligue communiste révolutionnaire (trotskiste), qui déplore pour sa part que L’Humanité se soit livrée à « un mea culpa affligeant ».
(p.178) qui signifie : les connaissances acquises depuis 1929 et plus particulièrement depuis 1989 sur le communisme, tel qu’il fut réellement, doivent nous inciter à l’apprécier de façon plus positive qu’à ses débuts, quand l’illusion pouvait être excusable, vu que l’ignorance était soigneusement entretenue. En somme, si je comprends bien, plus l’information est disponible sur le communisme, moins défavorable est le jour sous lequel nous devons le voir. Dans un commentaire sur la même réédition, la station de radio France-Info (10 janvier 1999), nous assure que Tintin au pays des Soviets était « une charge idéologique au parfum aujourd’hui suranné» (je souligne). Conclusion : ce n’était pas l’adulation du communisme qui était idéologique, c’était d’y être réfractaire. Et, surtout, les événements survenus depuis la Grande Terreur des années trente jusqu’à l’invasion de l’Afghanistan, en passant par le complot des blouses blanches et les répressions de Budapest ou de Prague, le Grand Bond en avant, la Révolution culturelle et les Khmers rouges nous invitent clairement à nous départir par rapport au communisme d’une sévérité que l’histoire objective envoie de toute évidence au rancart.
Beaucoup de commentateurs n’ont pas manqué d’insinuer qu’Hergé avait peu d’autorité en la matière puisqu’il s’est « mal conduit » sous l’Occupation. Mais je pose la question : va-t-on prétendre qu’une condamnation du nazisme dégage « un parfum suranné » quand elle émane de la bouche d’un ex-stalinien ? Non, car la question de fond n’est pas celle du parcours politique du juge. Elle est de savoir si oui ou non, le nazisme par lui-même a été monstrueux. Le stalinien qui le dit a, sur ce point-là, raison, tout stalinien qu’il soit. Alors, pourquoi y a-t-il un interdit en sens inverse ? Parce que, je l’ai dit, le communisme conserve sa supériorité morale. Ou, plus exactement, parce qu’on s’acharne, au prix de mille mensonges et dissimulations, à entretenir la tromperie de cette supériorité. Devant cette histoire écrite à l’envers, on doit pardonner (p.179) beaucoup aux journalistes lorsqu’ils se laissent glisser dans le sens de la pente. Car les désinformations qui les abusent trouvent souvent leur origine chez des historiens malhonnêtes. Trop d’entre eux persévèrent, avec une vigilance inaltérable, dans leur défense de la forteresse du mensonge communiste. Ainsi l’auteur du tout récent livre de la collection « Que sais-je ? » sur Le Goulag! trouve le moyen d’épargner Lénine, dont Staline aurait « trahi » l’héritage. Vieille lune mille fois réfutée, mirage faussement salvateur, que la recherche de ces dernières années a dissipé sans équivoque. Néanmoins, pour notre plaisantin, Staline serait en réalité l’héritier… du tsarisme, et non du léninisme !
Les camps soviétiques datent de Lénine lui-même, c’est bien établi, et les prisonniers politiques tsaristes, si répressif que fût le régime impérial, ne se montaient qu’à une part infime de ce qu’allaient être les gigantesques masses concentrationnaires communistes. Tout en cherchant à faire passer Staline pour le seul responsable du goulag, notre homme déverse sa bile sur Soljénitsyne, sur Jacques Rossi (à qui l’on doit Le Manuel du Goulag, déjà cité) et sur Nicolas Werth (auteur de la partie sur l’URSS dans Le Livre noir), récusant le témoignage des deux premiers et contestant les capacités d’historien du troisième.
1. Jean-Jacques Marie, Le Goulag, PUF, 1999. Voir sur ce livre le compte rendu de Pierre Rigoulot paru dans le n° 12 (été 1999) des Cahiers d’Histoire sociale.
(p.181) Le révisionnisme procommuniste s’avère /donc/ être de bon aloi.
(p.182) L’Ethiopie du Parti unique emplit tous les critères du classicisme communiste le plus pur. Que les tartufes assermentés ne prennent pas la tangente habituelle en gémissant qu’on n’avait pas affaire à du « vrai » communisme. La « révolution » éthiopienne engendra en Afrique la copie certifiée conforme du prototype lénino-staliniste de l’URSS, laquelle, d’ailleurs, lui accorda son estampille, lui octroya des crédits et lui envoya ses troupes pour la protéger, en l’espèce des troupes cubaines, avec de surcroît le concours d’agents de la police politique est-allemande, l’incomparable Stasi. La junte des chefs éthiopiens, le « Derg », se proclame sans tarder héritière de la « grande révolution d’Octobre », et le prouve en fusillant, dès son arrivée au pouvoir, toutes les élites qui n’appartenaient (p.183) pas à ses rangs ou n’obéissaient pas à ses ordres, encore que, comme dans toutes les « révolutions », la servilité totale ne fût même pas une garantie de vie sauve. Suit la procession des réformes bien connues : collectivisation des terres — dans un pays où 87 % de la population se compose de paysans — nationalisation des industries, des banques et des assurances. Comme prévu — ou prévisible — et comme en URSS, en Chine, à Cuba, en Corée du Nord, etc., les effets immanquables suivent : sous-production agricole, famine, encore aggravées par les déplacements forcés de populations, autre classique de la maison. La faillite précoce oblige à inventer des coupables, des saboteurs, des traîtres puisqu’on ne saurait envisager que le socialisme soit par lui-même mauvais et que ses dirigeants ne soient pas infaillibles. Et, comme d’habitude, le pouvoir totalitaire trouve les canailles responsables du désastre parmi les affamés et non parmi les affameurs, parmi les victimes et non parmi les chefs. Déprimante monotonie d’un scénario universel dont les avocats du socialisme s’acharnent à présenter chaque nouvel exemplaire comme une « exception » — et encore aujourd’hui maints historiens ! Dix mille assassinats politiques dans la seule capitale en 1978 ; massacre des Juifs éthiopiens, les Falachas, en 1979. Mais ce n’est pas de l’antisémitisme, puisque le Derg est de gauche.
Et les enfants d’abord ! En 1977, le secrétaire général suédois du Save thé Children Fund relate, dans un rapport, avoir été témoin de l’exposition de petites victimes torturées sur les trottoirs d’Addis-Abeba. « Un millier d’enfants ont été massacrés à Addis-Abeba et leurs corps, gisant dans les rues, sont la proie des hyènes errantes. On peut voir entassés les corps d’enfants assassinés, pour la plupart âgés de onze à treize ans, sur le bas-côté de la route lorsqu’on quitte Addis Abeba ‘. »
1 Cité par Yves Santamaria, dans le chapitre du Livre noir consacré aux afro-communismes : Ethiopie, Angola, Mozambique.
(p.189) L’écart de traitement entre les deux totalitarismes du siècle se décèle également à une foule d’autres petits détails. Ainsi les opérations mani pulite en Italie, et « haro sur l’argent sale des partis » en France ont, ô miracle, contourné avec soin les seuls partis communistes, ou, du moins, s’en sont occupées avec autant de douceur que de lenteur. Pourtant leurs escroqueries ont été percées à jour, qu’il s’agisse des « coopératives rouges » en Italie ou des « bureaux d’étude » fictifs, simples machines à blanchir l’argent volé, du PCF. S’y ajoutaient les sociétés écrans, officiellement vouées au commerce avec l’URSS, façon indirecte pour celle-ci de rétribuer les PC de l’Ouest. Sans parler des sommes directement mais clandestinement envoyées par Moscou, jusqu’en 1990, devises non déclarées, tantôt en espèces, tantôt en Suisse (pour le PCI) et (p.190) relevant, pour le moins, du délit de fraude fiscale, et peut-être en outre de celui d’inféodation stipendiée à une puissance étrangère. Chaque fois que de nouveaux documents sont venus confirmer l’ampleur de ce trafic illégal, documents souvent corroborés, après la chute de l’URSS, par des indiscrétions de personnalités soviétiques ou est-allemandes, on était frappé par la somnolente équanimité des médias et la consciencieuse immobilité de la magistrature. Ces pratiques de pillage des entreprises avaient été décrites et bien établies dès les années soixante-dixl. Pourtant ce n’est qu’en octobre 1996 qu’un secrétaire national du PCF, en l’occurrence Robert Hue, a été mis en examen pour « recel de trafic d’influence ». L’instruction s’engloutit dans les profondeurs d’un bienveillant oubli jusqu’au 18 août 1999, date à laquelle le bruit se répandit que le parquet de Paris avait décidé de requérir le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. Hue et du trésorier du PC2. Fausse alerte. On apprenait l’après-midi même le démenti du parquet : « Les réquisitions sont en train d’être rédigées. Nous démentons les informations faisant état de ces réquisitions. Il est trop tôt pour affirmer que nous allons requérir dans tel ou tel sens. Les réquisitions ne seront prises que pendant la première semaine de septembre. » Elles le furent finalement fin octobre. Parfois, l’inégalité du traitement dont sont l’objet les héritiers lointains ou proches de l’un et l’autre totalitarismes suscite des comportements si dérisoires qu’ils frisent le grotesque. En 1994, la coalition Forza Italia, Ligue du Nord et Alliance nationale gagne les élections en Italie. Silvio Berlusconi devient président du Conseil et prend comme ministre de l’Agriculture un des dirigeants d’Alliance nationale, qui, comme on sait, est issue du renouvellement de l’ancien MSI néo-fasciste mais s’est métamorphosée en se
1. Voir notamment Jean Montaldo, Les Finances du PCF, Albin Michel, 1977. 2. Le Parisien-Aujourd’hui : « Robert Hue menacé de correctionnelle », 18 août 1999. Cet article est malicieusement placé dans les « faits divers » et non dans la politique.
(p.191) démarquant du passé et en abjurant le mussolinisme. Plusieurs vieux fascistes membres de feu le MSI claquent la porte. Malgré cette transformation démocratique, plusieurs dirigeants européens réunis à Bruxelles refusent de serrer la main au nouveau ministre italien de l’Agriculture. Or les dirigeants actuels de l’Alliance nationale n’ont ni l’intention ni les moyens de restaurer la dictature fasciste. Ils ont au contraire rompu avec l’héritage mussolinien et provoqué le départ des nostalgiques du fascisme historique. Ils se sont toujours hermétiquement coupés tant du Front national français que des Republikaners allemands ou de Haider en Autriche. Si le Parti communiste italien redevient fréquentable et digne du pouvoir parce qu’il s’est rebaptisé Parti démocratique de la gauche en abjurant le communisme, pourquoi n’en irait-il pas de même pour l’Alliance nationale, qui, elle aussi, a changé d’étiquette et abjuré le fascisme ? Tant que durera cette dissymétrie dans le traitement réservé aux convertis de gauche et aux convertis de droite, parler de justice ou de morale et de progrès démocratique ne sera qu’imposture. Le drapeau des droits de l’homme claquera haut dans le vide. De notre temps plus que jamais, ce n’est pas la politique qui a été moralisée, c’est la morale qui a été politisée.
(p.192) Dès que pointe la plus petite vérité menaçant de profanation les icônes communistes, les pitbulls de l’orthodoxie déchirent en lambeaux le porteur de la mauvaise nouvelle. On s’étonne que des universitaires souvent de haut niveau quand ils travaillent sans passion ne soient pas plus habiles dans la polémique quand leurs passions entrent en jeu. On les voit tomber dans des pratiques avilissantes, indignes d’eux : fausses citations, textes amputés ou sciemment retournés, injures pires que celles que les communistes lancèrent à Kravtchenko, le dissident qui avait commis le sacrilège d’écrire J’ai choisi la liberté, il y a un demi-siècle. On trouvera une anthologie de ces exploits de la haute intelligentsia dans L’Histoire interdite de Thierry Wolton2. J’y renvoie.
1. 18 novembre 1997. 2. Jean-Claude Lattes, 1998.
(p.227) (…) c’est le roi Victor-Emmanuel qui, en 1943, signifie à Mussolini son congé et le démet de son poste de chef du gouvernement. Qui, au moment où se dessinait l’effondrement militaire de l’Allemagne, aurait pu occuper encore une position constitutionnelle qui lui eût permis en vertu de la loi d’en faire autant vis-à-vis d’Hitler ?
Quant aux lois antijuives de 1938, plusieurs historiens italiens ont récemment contesté qu’elles fussent imputables seulement à un opportunisme lié à l’alliance avec Hitler. Ils ont cherché des sources enracinées dans le passé italien. Sans doute y en a-t-il, mais Pierre Milza, étudiant les textes, ne manque pas de constater que, dans la mesure, au demeurant très faible, où ont été esquissées des théories antijuives en Italie, à la fin du dix-neuvième siècle ou au début du vingtième, elles furent empruntées principalement… à la littérature antisémite française, fort luxuriante à cette époque. Dans la pratique, le peuple italien est l’un des moins antisémites du monde et les lois raciales de Mussolini n’entraînèrent aucune destruction massive. Malgré ces lois, en effet, l’Italie fut le pays d’Europe où le pourcentage de la population juive tuée fut le plus basl. Là encore, en matière d’homicide, un abîme sépare le fascisme mussolinien de la haute productivité du nazisme et du communisme. Ces deux derniers régimes appartiennent à la même galaxie criminelle. Le fascisme appartient à une autre, qui n’est pas la galaxie démocratique, bien sûr, mais qui n’est pas non plus la galaxie totalitaire. Si l’on n’a pas encore rétabli les véritables frontières entre tous ces régimes, c’est qu’il y a eu dénazification après 1945, mais qu’il n’y a pas eu décommunisation après 1989.
1. Voir L.S. Dawidowicz, The War against thé ]ews 1933-1945. Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 480. Cité par Emmanuel Todd, Le Destin des immigrés, 1994, Seuil, p. 273. Voir aussi Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, 1961, rééd. 1972.
(p.228) Malgré les efforts de dissimulation et d’escamotage déployés par les contorsion-nistes du distinguo procommuniste, la grande menace inédite qui a pesé sur l’humanité au vingtième siècle est venue du communisme et du nazisme, successivement ou simultanément. Ces deux régimes seuls, et pour des raisons identiques, méritent d’être qualifiés de « totalitaires ». Le terme « fascisme » est donc impropre pour désigner autre chose que la dictature mussolinienne et ses répliques, latino-américaines par exemple.
(p.230) Il y a un noyau central, commun au fascisme, au nazisme et au communisme : c’est la haine du libéralisme.
(p.232) (…) on répond souvent que les partis communistes ont au moins été, dans les pays capitalistes, des forces revendicatives qui par les « luttes » ont contraint les Etats bourgeois à
1. Cité par Nicolas Werth dans Le Livre noir du communisme, première partie : « Un État contre son peuple », chapitre 4.
(p.233) étendre chez eux les droits des travailleurs. Cela aussi est faux. Disons-le derechef : les plus fondamentaux de ces droits, relatifs au syndicalisme et à la grève, furent instaurés dans les nations industrielles avant la guerre de 1914 et la naissance des partis communistes. Quant à la protection sociale — santé, famille, retraites, indemnités de chômage, congés payés etc. — elle fut mise en place à peu près au même moment, soit entre les deux guerres, soit après 1945, dans les pays où les partis communistes étaient inexistants ou négligeables (Suède, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne) et dans ceux où ils étaient forts (France ou Italie). Elle fut due aussi souvent à des gouvernements conservateurs qu’à des gouvernements sociaux-démocrates. C’est un démocrate réformiste, Franklin Roosevelt, qui créa aux États-Unis le système des retraites et le Welfare, prodigieusement étendu, trente ans plus tard, par Kennedy et Johnson. C’est un libéral, Lord Beveridge, qui, en Grande-Bretagne, élabora, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le futur système britannique de protection sociale, que les travaillistes n’acceptèrent qu’à contrecœur, craignant qu’il n’endorme les ardeurs révolutionnaires du prolétariat1. En France, la politisation de la centrale syndicale CGT, devenue en 1947 un simple appendice du PCF, fit s’effondrer à la fois le taux de syndicalisation des salariés et l’efficacité du syndicalisme.
1. Beveridge avait, dès 1911, déjà sous un gouvernement Churchill, fait adopter les premières mesures d’indemnisation du chômage.
(p.243) On se prend parfois à se demander si le goût le plus profond d’une assez grande quantité d’intellectuels ne serait pas le goût de l’esclavage. D’où leur propension et leur adresse à reconstituer, au sein même des civilisations libres, une sorte de totalitarisme informel. En l’absence de toute dictature politique externe, ils reproduisent en laboratoire, in vitro, dans leurs rapports les uns avec les autres, les effets d’une dictature fantôme, dont ils rêvent, avec ses condamnations, ses exclusions, ses excommunications, ses diffamations, convergeant vers le vieux procès en sorcellerie pour « fascisme », intenté à tout individu qui renâcle aux vénérations et exécrations imposées. Bien entendu, dans chaque étouffoir de la liberté de l’esprit, la tyrannie est mutuelle.
(p.250) Certaines réactions irraisonnées, moutonnières et quotidiennes sont plus révélatrices des mentalités que les querelles des économistes. Ainsi, au matin du 5 octobre 1999, dans une collision entre deux trains, à Paddington, dans la banlieue de Londres, environ trente voyageurs sont tués et plusieurs centaines blessés. Aussitôt bruissent en France sur toutes les ondes, toute la journée, les mêmes commentaires : depuis la privatisation des chemins de fer britanniques, les nouvelles compagnies propriétaires ou concessionnaires, mues par la seule recherche du profit, ont économisé sur les dépenses consacrées à la sécurité, notamment dans les infrastructures et la signalisation. Conclusion qui va de soi : les victimes de l’accident ont été assassinées par le libéralisme. Si c’est vrai, alors les cent vingt-deux personnes tuées dans l’accident ferroviaire de Harrow en 1952 furent assassinées
1. Tiré d’un roman policier de Manuel Vazquez Montalban qui, paraît-il, vaut mieux que sa dégradation télévisuelle.
(p.251) par le socialisme, puisque les British Railways étaient alors nationalisés. En France, en pleine gare de Lyon, le 27 juin 1988, un train percute un convoi arrêté : cinquante-six tués et trente-deux blessés, victimes évidentes, par conséquent, de la nationalisation des chemins de fer français en 1937, donc assassinées par le Front populaire. Le 16 juin 1972, la voûte du tunnel de Vierzy, dans l’Aisne, s’effondre sur deux trains : cent huit morts. Là non plus, l’entretien des structures ne paraît pas avoir été d’une perfection éblouissante, tout étatisée que fût la compagnie qui en était chargée.
Après quelques heures d’enquête à Paddington, il s’avéra que le conducteur de l’un des trains avait négligé deux feux jaunes qui lui enjoignaient de ralentir et grillé un feu rouge qui lui enjoignait de s’arrêter. L’erreur humaine, semble-t-il, et non l’appât du gain, expliquait le drame. Que nenni ! rétorquèrent aussitôt les antilibéraux, car le train fautif n’était pas équipé d’un système de freinage automatique se déclenchant dès qu’un conducteur passe par inadvertance un signal rouge. Sans doute, mais dans l’accident de la gare de Lyon, ce système, s’il existait, ne semble pas avoir beaucoup servi non plus pour pallier l’erreur du conducteur français. Pas davantage le 2 avril 1990 en gare d’Austerlitz à Paris, lorsqu’un train défonça un butoir, traversa le quai et s’engouffra dans la buvette. S’agissant d’infrastructures, la vétusté des passages à niveau français, mal signalés et pourvus de barrières fragiles ne s’abaissant qu’à la dernière seconde, cause chaque année entre cinquante et cent morts, et plus souvent autour de quatre-vingts, d’ailleurs, que de cinquante. L’infaillibilité du « service public à la française », en l’occurrence, ne saute pas absolument aux yeux. Ce sont là des faits et des comparaisons qui, naturellement, ne vinrent même pas à l’esprit des antilibéraux. Ajoutons à ces quelques rappels que les chemins de fer britanniques, même du temps où ils appartenaient à l’État, étaient réputés dans toute l’Europe pour leur médiocre fonctionnement. Enfin, leur privatisation ne s’est achevée qu’en 1997 ! (p.252) Comment la déficience des infrastructures et du matériel roulant se serait-elle produite de façon aussi soudaine et rapide en moins de deux ans ? En réalité, British Railways a légué aux compagnies privées un réseau et des machines profondément dégradés, qui mettaient en péril la sécurité depuis plusieurs décennies. La mise en accusation du libéralisme dans cette tragédie relève plus de l’idée fixe que du raisonnement.
Que l’on me comprenne bien. Je l’ai souvent écrit dans ces pages : il ne faut pas considérer le libéralisme comme l’envers du socialisme, c’est-à-dire comme une recette mirobolante qui garantirait des solutions parfaites, quoique par des moyens opposés à ceux des socialistes. Une société privée est très capable de faire courir des dangers à ses clients par recherche du profit. C’est à l’État de l’en empêcher, et cette vigilance fait partie de son véritable rôle, que précisément, d’ailleurs, le plus souvent il ne joue pas. Mais la négligence, l’incurie, l’incompétence ou la corruption ne font pas courir de moindres risques aux usagers des transports nationalisés. Il faut pousser l’obsession antilibérale jusqu’à l’aveuglement complet pour prétendre ou sous-entendre qu’il n’y aurait jamais eu d’accident que dans les transports privés… Les trente morts dus à la collision entre deux trains de la Compagnie nationale norvégienne, le 4 janvier 2000, furent-ils victimes du libéralisme ?
Il en va de même pour les automobiles. Les Renault, à l’époque où cette société avait l’Etat pour actionnaire unique, n’étaient ni plus ni moins sûres que les Peugeot, les Citroën, les Fiat ou les Mercedes, fabriquées par des sociétés privées. Elles l’étaient même plutôt moins, puisque la Renault « Dau-phine », par exemple, devint vite célèbre pour sa facilité à se retourner sur le toit. Etant donné que Renault nationalisée avait en permanence un compte d’exploitation déficitaire, les voitures sorties de ses ateliers, n’étant source d’aucun profit, au contraire, auraient dû, si l’on suit la logique antilibérale, ne provoquer jamais aucun accident dû à des défaillances dans la mécanique ou l’aérodynamisme.
(p.253) Je viens de donner deux exemples illustrant l’omniprésence d’un fonds presque inconscient de culture antilibérale, qui jaillit comme un cri du cœur en toute occasion et qui est d’autant plus étonnant qu’il persiste à l’encontre de toute l’expérience historique du vingtième siècle et même de la pratique actuelle de la quasi-totalité des pays. La pratique diverge de la théorie et de la sensibilité. L’instinct tient compte, plus que l’intelligence, des enseignements du passé. L’antilibéral est un mage qui se proclame capable de marcher sur les flots mais qui prend grand soin de réclamer un bateau avant de prendre la mer. Comment expliquer ce mystère ?
Une première cause en est cette inertie de la pensée que j’ai appelée la « rémanence idéologiquel ». Une idéologie peut survivre longtemps aux réalités politiques et sociales qu’elle accompagnait. On trouvait encore en France, à la fin des années trente, cent cinquante ans après la Révolution, un remuant courant royaliste, avec de nombreux partisans de la monarchie absolue et non pas même constitutionnelle. Sans prendre part directement à la vie politique au Parlement ou au gouvernement, ce courant exerçait sur la société française une influence notable, tant par sa presse que par les auteurs de talent qui propageaient ses idées hostiles à la République. Malgré l’irréalisme de son programme de restauration monarchique, cette école de pensée jouait dans le débat public et la vie culturelle un rôle qui n’avait rien de marginal.
1. Voir La Connaissance inutile (1988) et Le Regain démocratique (1992).
(p.256) Homme de gauche, et il l’a prouvé en payant le prix fort, idole vénérée par les socialistes français au vingtième siècle, Zola était néanmoins assez intelligent pour comprendre que toute société est inégalitaire.
(p.266) Le plus piquant est que l’Etat, quand il veut corriger — lisez : escamoter — ses erreurs économiques, les aggrave. Il peut se comparer à une ambulance qui, appelée sur les lieux d’un accident de la route, foncerait dans le tas et tuerait les derniers survivants. Pour masquer, autant que faire se pouvait, le trou creusé au Lyonnais par sa sottise et sa canaillerie, l’État crée, en 1995, un comité baptisé Consortium de réalisation (CDR), chargé de « réaliser » au mieux les créances douteuses de la banque. Prouesse : le CDR a augmenté les pertes d’au moins cent milliards1 ! C’est la droite, alors au pouvoir, qui, désirant, avec son dévouement habituel, effacer les fautes et les escroqueries de la gauche, inventa cette burlesque « pompe à phynances ».
1 Voir les détails dans le mensuel Capital, n° 94, juillet 1999.
(p.268) L’élévation meurtrière de la fiscalité en France ne sert principalement ni à créer des emplois ni à soulager ceux qui n’en ont pas, ni à la productivité ni à la solidarité. Elle sert avant tout à combler les trous creusés par les gaspillages et l’incompétence d’un État qui refuse de réformer sa gestion, comme le refusent les collectivités locales, caractérisées, elles aussi, par les folies dépensières et le mépris des contribuables.
(p.269) Tout individu qui accepte de s’anéantir devant le Parti se voit garantir en échange un emploi. Sans doute cet emploi est-il très médiocrement payé (en moyenne l’équivalent de dix dollars par mois, soixante francs, en 1999 à Cuba, par exemple) ; et c’est bien pourquoi, en échange, très peu de travail est exigé. L’emploi presque sans travail et presque sans salaire est garanti à vie. D’où la plaisanterie mille fois entendue par les voyageurs de jadis en URSS : « Ils font semblant de nous payer, nous faisons semblant de travailler. » Orlov, chercheur scientifique lui-même, cite des cas où des collaborateurs scientifiques sont demeurés des mois absents de leur laboratoire ou bien ont fourni des résultats truqués, sans faire l’objet de la moindre sanction. En effet, les promotions découlent de la fidélité idéologique plus que de la compétence professionnelle. « L’affectation de travailleurs à des fonctions ne correspondant pas à leur qualification mais donnant droit à une rémunération supérieure, l’exagération des travaux exécutés dans le calcul des primes » sont des gratifications courantes, mais qui ne s’octroient qu’aux citoyens loyaux. Cette servilité politique sans restriction implique pour celui qui s’y plie le sacrifice de sa liberté et de sa dignité. Mais l’existence qu’elle lui procure n’est pas dénuée de confort psychique. On peut comprendre qu’une population élevée depuis plusieurs générations dans cette médiocrité douillette et docile supporte mal d’être brutale-
1. Op. cit.
(p.270) ment plongée dans les eaux tourbillonnantes de la société de concurrence et de responsabilité. Quand on écoute certains ressortissants des sociétés anciennement communistes d’Europe centrale, on se rend compte qu’ils escomptaient de la démocratisation et de la libéralisation de leur pays qu’elles maintiennent le droit à l’emploi à vie dans l’inefficacité tout en leur octroyant le niveau de vie de la Californie ou de la Suisse. L’idée ne les effleure pas qu’à partir du moment où existe un choix entre une automobile de mauvaise qualité « Trabant », fabriquée en Allemagne de l’Est, et une meilleure voiture fabriquée à l’Ouest pour le même prix, les clients, à commencer par les Allemands de l’Est eux-mêmes, achèteront la deuxième. Ainsi, à bref délai, les usines Trabant devront fermer — ce qui s’est effectivement passé.
(p.280) L’erreur de la gauche archaïque est de méconnaître que la libéralisation ne contraint pas à l’abandon des programmes sociaux. Elle oblige, il est vrai, à mieux les gérer. Pour les socialistes français, le critère d’une bonne politique sociale, c’est l’importance de la dépense, pas l’intelligence avec laquelle elle est faite. Le résultat est secondaire.
(p.280) Les Pays-Bas, la Suède (qui était quasiment en faillite en 1994) ont réussi à libéraliser leurs économies un peu à la manière de la Nouvelle-Zélande et sans renoncer pour autant à leurs budgets sociaux, mais en les gérant mieux. Et, surtout, en libéralisant fortement la production. La Suède s’est lancée dans la concurrence et l’entreprise. Elle aussi a privatisé les industries, les télécommunications, l’énergie, les banques et les transports
1 Le 26 février 1985, le dollar atteint le cours record de 10,61 francs. Il était à environ 5,50 francs en 1981. Mais, naturellement, si le franc est tombé de moitié, c’est la faute… des Américains.
(p.303) L’intolérance d’un groupuscule d’intellectuels, lorsqu’il sert de modèle, finit par imprégner ce qu’on pourrait appeler le bas clergé de l’intelligentsia. Ainsi, en 1997, une documentaliste du lycée Edmond-Rostand à Saint-Ouen-l’Aumône, soutenue par un « collectif d’enseignants », ce qui est alarmant, expurge la bibliothèque dudit lycée. Elle en retire des ouvrages d’auteurs considérés par elle comme d’« extrême droite », fascistes, entre autres ceux de deux éminents écrivains et historiens, Marc Fumaroli et Jean Tulard. Pis : le tribunal de Pontoise débouta les auteurs censurés, qui avaient porté plainte pour atteinte à la réputation. Il allégua « qu’on ne saurait considérer que Mme Chaïkhaoui a commis une faute en établissant une liste de titres qu’elle jugeait dangereux»1. En quoi Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, de Fumaroli, ou le Napoléon de Tulard sont-ils dangereux, de quel point de vue et pour qui ? En vertu de quelle légitimité, de quel mandat et de quelle compétence Mme Chaïkhaoui est-elle qualifiée pour se prononcer sur le « danger » d’une œuvre de l’esprit et pour la censurer ? A-t-on rétabli l’Inquisition ? Acte injustifiable et déshonorant. 1 Voir à ce sujet mon article « L’index au xxe siècle », dans mon recueil Fin du siècle des ombres, Fayard, 1999, p. 585.
(p.304) En revanche, lorsqu’en 1995, le maire du Front national d’Orange avait entrepris de rétablir lui aussi l’« équilibre idéologique » dans la bibliothèque municipale, qui comptait, selon lui, trop d’ouvrages de gauche, la presque totalité de la presse fut fondée à comparer ce sectarisme avec les autodafés de livres sous Hitler. Mais lorsque l’autodafé vient de la gauche, même s’il repose de surcroît sur une inculture crasse et une ignorance flagrante des auteurs censurés, l’Éducation nationale et l’Autorité judiciaire lui donnent leur bénédiction. Nous vivons dans un pays où un simple employé peut expurger une bibliothèque en se bornant à imputer, contre toute vraisemblance, aux épurés des sympathies fascistes ou racistes et pourquoi pas ? la responsabilité de l’holocauste. Nos élites réprouvent la censure et la délation calomnieuse lorsqu’elles viennent du Front national, rarement quand elles émanent d’une autre source idéologique. L’idéologue, quant à lui, ne perçoit le totalitarisme que chez ses adversaires, jamais en lui-même puisqu’il est sûr de détenir la Vérité absolue et le monopole du Bien. Les intellectuels flics et calomniateurs ont proliféré ces dernières années plus encore à gauche qu’à l’extrême droite. Or, quand elles atteignent le stade du sectarisme persécuteur, la droite et la gauche cessent de se distinguer pour fusionner au sein d’une même réalité, le totalitarisme intellectuel. Les principes dont elles se réclament respectivement l’une et l’autre n’ont plus aucun intérêt. Ils s’effacent devant l’identité des comportements, qui les rend indiscernables.
1. 18 septembre 1998. R. Redeker appartient à la rédaction des Temps modernes, dont, comme on sait, Claude Lanzmann est le directeur.
(p.307) Ce populisme, qui se réduit à l’affirmation sans cesse réitérée de ce que son « élite » aux abois souhaite qu’on lui dise, tend, ne l’oublions pas, vers ce but éternel et primordial : rétablir la croyance selon laquelle le marxisme reste juste et le communisme n’était pas mauvais, en tout cas moins que ne l’est le capitalisme. D’où le zèle que déploie, par exemple, Le Monde diplomatiquel pour assurer la diffusion en français de l’ouvrage du marxiste anglais Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes (1914-1941), impavide négationniste s’il en fut, qui va jusqu’à refuser d’admettre, aujourd’hui, que les Soviétiques soient les auteurs du massacre de Katyn, bien que Mikhaïl Gorbatchev lui-même l’ait reconnu en 1990 et que plusieurs documents sortis des archives de Moscou l’aient confirmé depuis lors.
1. Voir le résumé de l’« affaire Hobsbawm » dans Le Monde, 28 octobre 1999.
(p.308) Depuis la fin de l’Empire soviétique, il en subsiste au fond un seul, c’est l’antiaméricanisme. Prenez la France, pays auquel je me réfère volontiers parce qu’il est le laboratoire paradigmatique de la résistance aux enseignements de la catastrophe communiste. Si vous enlevez l’antiaméricanisme, à droite comme à gauche, il ne reste rien de la pensée politique française. Enfin, ne lésinons pas, il en reste peut-être, mettons (p.309) trois ou quatre pour cent, du moins dans les milieux qui occupent le devant de l’éphémère.
La mondialisation, par exemple, est rarement analysée en tant que telle, pas plus que les fonctions de l’Organisation mondiale du commerce. L’une et l’autre font peur. Pourquoi ? Parce qu’ils sont devenus synonymes d’hyperpuissance américaine1. Si vous objectez que la mondialisation des échanges ne profite pas unilatéralement aux États-Unis, lesquels achètent plus qu’ils ne vendent à l’étranger, sans quoi leur balance du commerce extérieur ne serait pas en déficit chronique ; ou si vous avancez que l’OMC n’est pas foncièrement néfaste aux Européens ou aux Asiatiques, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi tant de pays qui n’en sont pas encore membres (la Chine, par exemple, dont l’entrée a finalement été décidée en novembre 1999) font des pieds et des mains pour s’y faire admettre, alors vous haranguez des sourds. Car vous vous placez sur le terrain des considérations rationnelles alors que votre auditoire campe sur celui des idées fixes obsessionnelles. Vous ne gagnerez rien à lui mettre sous les yeux des éléments réels de réflexion, sinon de vous faire traiter de valet des Américains. Pourtant, l’OMC a tranché en faveur de l’Union européenne plus de la moitié des différends qui l’opposaient aux États-Unis et a souvent condamné ceux-ci pour subventions déguisées. Loin d’être la foire d’empoigne du laissez-passer, l’OMC a été au contraire créée afin de rendre loyale la concurrence dans les échanges mondiaux.
La haine des États-Unis s’alimente à deux sources distinctes mais souvent convergentes : les États-Unis sont l’unique superpuissance, depuis la fin de la guerre froide ; les États-Unis sont le principal champ d’action et centre d’expansion du diable libéral. Les deux thèmes d’exécration se rejoignent, puisque c’est précisément à cause de son « hyperpuissance » que l’Amérique répand la peste libérale sur l’ensemble de la planète. D’où le cataclysme vitupéré sous le nom de mondialisation.
1. Voir le sondage paru dans Les Échos, 2 novembre 1999.
(p.310) Si l’on prend au pied de la lettre ce réquisitoire, il en ressort que le remède aux maux qu’il dénonce serait que chaque pays mette ou remette en place une économie étatisée et, d’autre part, se ferme hermétiquement aux échanges internationaux, y compris et surtout dans le domaine culturel. Nous retrouvons donc là, dans une version post-marxiste, l’autarcie économique et culturelle voulue par Adolf Hitler.
En politique internationale, les États-Unis sont plus détestés et désapprouvés, même par leurs propres alliés, depuis la fin de la guerre froide qu’ils ne l’étaient durant celle-ci par les partisans avoués ou inavoués du communisme. C’est au point que l’Amérique soulève la réprobation parfois la plus haineuse, même quand elle prend des initiatives qui sont dans l’intérêt évident de ses alliés autant que d’elle-même, et qu’elle est seule à pouvoir prendre. Ainsi, durant l’hiver 1997-1998, l’annonce par Bill Clinton d’une éventuelle intervention militaire en Irak, pour forcer Saddam Hussein à respecter ses engagements de 1991, fit monter de plusieurs degrés le sentiment hostile envers les États-Unis. Seul le gouvernement britannique prit position en leur faveur.
Le problème était pourtant clair. Depuis plusieurs années, Saddam refusait d’anéantir ses stocks d’armes de destruction massive, empêchait les inspecteurs des Nations unies de les contrôler, violant ainsi l’une des principales conditions acceptées par lui lors de la paix consécutive à sa défaite de 1991. Étant donné ce dont le personnage est capable, on ne pouvait nier la menace pour la sécurité internationale que représentait l’accumulation entre ses mains d’armes chimiques et biologiques. Mais, là encore, le principal scandale que trouvait à dénoncer une large part de l’opinion internationale, c’était l’embargo infligé à l’Irak. Comme si le vrai coupable des privations subies de ce fait par le peuple irakien n’était pas Saddam lui-même, qui avait ruiné son pays en se lançant dans une guerre contre l’Iran en 1981, puis contre le Koweït en 1990, enfin en entravant l’exécution des résolutions de l’ONU sur ses armements. Le soutien que, par haine des États-Unis, (p.311) les censeurs de l’embargo apporteraient ainsi à un dictateur sanguinaire venait aussi bien de l’extrême droite que de l’extrême gauche (Front national et Parti communiste en France) ou des socialistes de gauche (l’hebdomadaire The New States-man en Grande-Bretagne ou Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur, en France), et de la Russie autant que d’une partie de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un commun dénominateur antiaméricain plus que d’un choix idéologique ou stratégique cohérent.
Beaucoup de pays, dont la France, ne niaient pas la menace représentée par les armements irakiens, mais déclaraient préférer à l’intervention militaire la « solution diplomatique ». Or la solution diplomatique était, précisément, rejetée depuis sept ans par Saddam, qui avait tant de fois mis à la porte les représentants de l’ONU ! Quant à la Russie, elle clama que l’usage de la force contre Saddam mettrait en péril ses propres « intérêts vitaux ». On ne voit pas en quoi. La vérité est que la Russie ne perd pas une occasion de manifester sa rancœur de ne plus être la deuxième superpuissance mondiale, ce qu’elle était ou croyait être du temps de l’Union soviétique. Mais l’Union soviétique est morte de ses propres vices, dont la Russie subit encore les conséquences. Il y a eu dans le passé des empires et des puissances d’échelle internationale, avant les Etats-Unis de cette fin du vingtième siècle. Mais il n’y en avait jamais eu aucun qui atteignît à une prépondérance planétaire. C’est ce que souligne Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller à la Sécurité du président Jimmy Carter, dans son livre, Le Grand Échiquier1. Pour mériter le titre de superpuissance mondiale, un pays doit occuper le premier rang dans quatre domaines : économique, technologique, militaire et culturel. L’Amérique est actuellement le seul pays — et le premier dans l’histoire — qui remplisse ces quatre conditions à la fois.
1 Trad. fr., Bayard éditions, 1997.
(p.313) Car la prépondérance de l’Amérique est venue, sans doute, de ses qualités propres, mais aussi des fautes commises par les autres, en particulier par l’Europe. Récemment encore, la France a reproché aux États-Unis de vouloir lui ravir son influence en Afrique. Or, la France porte une accablante responsabilité dans la genèse du génocide rwandais de 1994 et dans la décomposition du Zaïre qui a suivi. Elle s’est donc discréditée toute seule, et c’est ce discrédit qui a creusé le vide rempli ensuite par une présence croissante des États-Unis. (…) (p.314) La superpuissance américaine résulte pour une part seulement de la volonté et de la créativité des Américains. Pour une autre part, elle est due aux défaillances cumulées du reste du monde : la faillite du communisme, le suicide de l’Afrique débilitée par les guerres, les dictatures et la corruption, les divisions européennes, les retards démocratiques de l’Amérique latine et surtout de l’Asie. À l’occasion de l’intervention de l’Otan au Kosovo la haine antiaméricaine s’est haussée encore d’un cran. Dans la guerre du Golfe, on pouvait plaider que, derrière une apparente croisade en faveur de la paix, se cachait la défense d’intérêts pétroliers. On négligeait ainsi, d’ailleurs, ce fait que les Européens sont beaucoup plus dépendants du pétrole du Moyen-Orient que ne le sont les États-Unis. Mais au Kosovo, même avec la pire foi du monde, on ne voit pas quel égoïsme américain pouvait dicter cette intervention dans une région sans grandes ressources ni grande capacité importatrice et où l’instabilité politique, le chaos ethnique, les crimes contre la population faisaient courir un grave danger à l’équilibre de l’Europe, mais aucun à celui des États-Unis.
Au cours du processus de mobilisation de l’Otan, ce sont plutôt les Américains qui ont eu le sentiment d’être entraînés dans cette expédition par les Européens, et plus particulièrement par la France, après l’échec de la conférence de Rambouillet. Ame de cette conférence, en février 1999, Paris avait déployé tous ses efforts et engagé tout son prestige pour convaincre la Serbie d’accepter un compromis au sujet du Kosovo. Si le refus des Serbes ne leur avait valu ensuite (p.315) aucune sanction, c’est l’Europe, et en premier lieu la France, qui auraient ainsi donné le spectacle d’une pitoyable impuissance, au demeurant réelle. La participation américaine à l’opération militaire de l’Otan eut pour fonction à la fois de la pallier et de la masquer. Sur neuf cents avions engagés, six cents étaient américains, ainsi que la quasi-totalité des satellites d’observation1. Car les crédits que les États-Unis à eux seuls consacrent à l’équipement et à la recherche militaires sont deux fois plus élevés que ceux des quinze pays de l’Union européenne ; et, en matière de défense spatiale, dix fois plus. Si la volonté d’agir au Kosovo fut européenne, les moyens, dans leur majorité, furent et ne pouvaient être qu’américains. De surcroît, la barbarie qu’il s’agissait d’éradiquer résultait de plusieurs siècles d’absurdités d’une facture inimitablement européenne dont la moindre n’était pas la dernière en date : avoir toléré le maintien à Belgrade, après la décomposition du titisme, d’un dictateur communiste reconverti en nationaliste intégral. Mais, puisqu’il fallait comme d’ordinaire imputer aux Américains les fautes européennes, cette constellation d’antécédents historiques presque millénaires et de facteurs contemporains visibles et notoires fut recouverte du voile de l’ignorance volontaire par de copieuses cohortes intellectuelles et politiques en Europe. À la connaissance on substitua une construction imaginaire selon laquelle les exterminations interethniques au Kosovo étaient une invention américaine destinée à servir de prétexte aux États-Unis pour, en intervenant, mettre la main sur l’Otan et asservir définitivement l’Union européenne. Pascal Bruckner a dressé un inventaire édifiant de ce sottisier2. (…)
1. Pierre Beylau, « Défense : l’impuissance européenne », Le Point, 14 mai 1999. 2. Pascal Bruckner, « Pourquoi cette rage antiaméricaine ? », « Point de vue » publié dans Le Monde, 1 avril 1999. Et « L’Amérique diabolisée », entretien paru dans Politique internationale, n° 84, été 1999.
(p.316) La convergence entre l’extrême droite et l’extrême gauche frôle ici l’identité de vues. Jean-Marie Le Pen est indiscernable de Régis Debray et de quelques autres quand il écrit dans l’organe du Front national, National Hebdo2 : « Le spectacle de l’Europe (et de la France !) à la botte de Clinton dans cette guerre de lâches et de barbares moralisants est écœurant, ignoble, insupportable. J’ai été pour les Croates et contre Milosevic. Aujourd’hui, je suis pour la Serbie nationaliste, contre la dictature que les Américains imposent. »
Pour Didier Motchane, du Mouvement des citoyens (gauche socialiste), le but secret des Américains était d’attiser l’hostilité entre la Russie et l’Union européenne. Pour Bruno Mégret, de l’extrême droite (Mouvement national), il était de créer un précédent dont pourraient s’autoriser un jour les Maghrébins, bientôt majoritaires dans le sud de la France,
1. Le Monde, 1″ avril 1999. 2. 22 avril 1999.
(p.317) pour exiger un référendum sur l’indépendance de la Provence, voire son rattachement à l’Algérie. Pour Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire de gauche Marianne, le même calcul pervers tendait à inciter à la même démarche les Alsaciens, s’il leur venait à l’esprit de vouloir redevenir Allemands. En cas de refus du gouvernement français, l’Oncle Sam se sentirait alors en droit de bombarder Paris, tout comme il a bombardé Belgrade en 1999. Jean Baudrillard confie de son côté à Libérationl sa version de l’événement : le dessein réel de l’Amérique est selon lui d’aider Milosevic à se débarrasser des Kosovars ! Allez comprendre… C’est d’ailleurs également l’Amérique, affirme Baudrillard, qui a provoqué la crise financière de 1997 au Japon et dans les autres pays d’Asie. Ni ces pays ni le Japon n’ont donc la moindre responsabilité propre dans leurs malheurs boursiers. Pas plus que les Européens dans la genèse de l’inextricable écheveau des haines balkaniques. La conscience morale de ces philosophes n’est pas effleurée par l’hypothèse que l’Union européenne aurait été déshonorée si elle avait laissé se poursuivre, au cœur de son continent, la boucherie du Kosovo. Il est vrai que, selon eux, le projet global de Washington est de « barrer la route à la démocratie mondiale en lente émergence2 ». Le nettoyage ethnique du Kosovo était donc « une démocratie en lente émergence ? » Avec ce passe-partout en main, plus n’est besoin de se casser la tête à étudier les relations internationales ou même à s’en informer. Comme le souligne judicieusement Jean-Louis Margolin3, «la lecture du monde est alors simple : Washington est toujours coupable, forcément coupable ; ses adversaires sont toujours des victimes, forcément victimes ». J’ajouterai : ses alliés aussi ! Toujours coupable, c’est bien le mot. Si les Américains renâclent à s’engager dans une opération humanitaire, ils sont stigmatisés pour leur peu d’empressement à secourir les affamés et les persécutés. S’ils
1. 29 avril 1999. 2. Denis Duclos, Le Monde, 22 avril 1999. 3. Le Monde, 29 mai 1999.
(p.318) s’y engagent, ils sont accusés de comploter contre le reste de la planète (…) C’est nous surtout, Européens, qui nous adonnons à cette projection sur les États-Unis des causes de nos propres erreurs. L’« unilatéralisme » américain que dénonce le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, Hubert Védrine, n’est souvent que l’envers de notre indécision ou de nos mauvaises décisions. Pour la France, se figurer tenir tête à cet « unilatéralisme » en tapant du pied pour imposer la vente de nos bananes antillaises au-dessus du prix (p.319) du marché ou pour protéger outrageusement Saddam Hussein est dérisoire. De même, l’obséquiosité avec laquelle la France a reçu le président chinois en octobre 1999 découlerait, a-t-on dit, d’un « grand dessein » consistant à promouvoir le géant chinois pour contrebalancer le géant américain. Ainsi, la France, en août 1999, est allée jusqu’à dénoncer comme « déstabilisant pour la Chine » le projet américain d’installer des boucliers antimissiles aux Etats-Unis et dans certains pays d’Extrême-Orient. Nous reconnaissons là un vieux canasson de la propagande pro-soviétique de jadis, selon laquelle c’était la défense occidentale qui constituait la seule menace pour la paix car elle semait l’angoisse au Kremlin.
(p.322) Les deux pilotes de la réunification furent d’abord, naturellement, le président soviétique et le chancelier ouest-allemand. Mais il leur fallait une garantie internationale et un soutien extérieur, pour le cas où une partie des responsables soviétiques et notamment des généraux auraient décidé de s’opposer à Gorbatchev et d’intervenir militairement pour prolonger par la force l’existence de la RDA. Cette garantie internationale et ce soutien extérieur, ce furent les États-Unis qui les leur apportèrent. Le président américain, George Bush, par des signaux dénués d’ambiguïté, fit comprendre aux éventuels va-t-en-guerre de Moscou qu’une reprise de l’opération « Printemps de Prague » en RDA se heurterait, cette fois-ci, à une riposte américaine. N’ayant saisi ni l’importance ni la signification des événements qui arrachèrent l’Europe centrale au communisme, et n’y ayant joué aucun rôle positif, les Européens occidentaux n’ont aucun droit de déplorer l’« hyperpuissance » américaine, laquelle provient de ce que l’Amérique a dû combler leur propre vide politique et intellectuel, dans des circonstances où, (p.323) cependant, c’étaient les intérêts vitaux de l’Europe, une fois de plus, qui étaient en jeu.
Appartenir à l’Europe, être l’allié de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, ne fut d’aucun secours à Helmut Kohi en 1989 et en 1990 dans la conduite de l’opération la plus risquée, la plus lourde de conséquences de l’histoire récente de son pays. En revanche, être l’allié des États-Unis lui permit de mener la réunification à bien dans la paix tout en parachevant la décommunisation de l’Europe centrale. En outre, George Bush sut s’abstenir de tout triomphalisme susceptible d’irriter les opposants soviétiques à la politique de Gorbatchev. Le président américain refusa, en particulier, de suivre l’avis de ses conseillers, qui l’incitaient à se rendre à Berlin au lendemain de la chute du Mur. Il eut la décence de respecter la résonance purement allemande des retrouvailles des deux populations. Il ne fut pas du spectacle, mais il avait été du combat. L’Europe en avait été absente. Voilà pourquoi ni Jacques Chirac, ni Tony Blair, ni Massimo D’Alema n’assistèrent à la commémoration du 9 novembre 1999 au Bundes-tag, dans Berlin réunifiée. L’antiaméricanisme onirique provient de deux origines distinctes, qui se rejoignent dans leurs résultats. La première est le nationalisme blessé des anciennes grandes puissances européennes. La deuxième est l’hostilité à la société libérale chez les anciens partisans du communisme, y compris ceux qui, sans approuver les sanguinaires totalitarismes soviétiques, chinois ou autres, avaient fait le pari que le communisme pourrait un jour se démocratiser et s’humaniser.
Le nationalisme blessé ne date pas de la fin de la guerre froide. Il apparaît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Son plus brillant et catégorique porte-parole fut le général de Gaulle. « L’Europe occidentale est devenue, même sans s’en apercevoir, un protectorat des Américains », confie-t-il en 1963 à Alain Peyrefitte1. Pour le premier président de la
1. Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, op. cit., tome II, dont sont extraites également les citations qui vont suivre.
(p.324) Cinquième République, il existe une équivalence entre la relation de Washington avec l’Europe occidentale et celle de Moscou avec l’Europe centrale et orientale. « Les décisions se prennent de plus en plus aux États-Unis… C’est comme dans le monde communiste, où les pays satellites se sont habitués à ce que les décisions se prennent à Moscou. » Malheureusement les Européens de l’Ouest, hormis la France, « se ruent à Washington pour y prendre leurs ordres ». « Les Allemands se font les boys des Américains. » D’ailleurs, déjà pendant la guerre, « Churchill piquait une lèche éhontée à Roosevelt ». « Les Américains ne se souciaient pas plus de délivrer la France que les Russes de libérer la Pologne. » De Gaulle développera publiquement cette thèse dans sa conférence de presse du 16 mai 1967 : les États-Unis ont traité la France après 1945 exactement comme l’URSS a traité la Pologne ou la Hongrie. Rien ne l’en fait démordre. En 1964, le président Johnson adresse aux Départements d’État et de la Défense un mémorandum leur disant qu’il n’approuvera aucun plan de défense qui n’ait au préalable été discuté avec la France. De Gaulle déclare alors à Peyrefitte : «Johnson cherche à noyer le poisson. » S’il n’avait pas prescrit de consulter la France, Johnson aurait assurément montré par-là son « hégémonisme ». Quand il proclame au contraire la liberté de choix française et la volonté américaine de n’adopter aucun plan sans l’accord de Paris, alors c’est qu’il désire « noyer le poisson ». Le dispositif mental que nous connaissons est bien en place : les États-Unis ont toujours tort.
Chez le nationaliste, donc, la pensée tourne dans le labyrinthe passionnel de l’orgueil blessé. Même dans la science et la technologie, le retard de son propre pays ne provient pas, selon lui, de ce qu’il a fait fausse route, ou d’une inaptitude — pour des raisons, par exemple, de raideur étatique — à voir et à prendre la direction de l’avenir. Si un autre pays saisit avant lui les occasions de progrès, ce ne saurait être que par malveillance et appétit de domination. L’intelligence n’y est pour rien, ni le système économique. Ainsi, en 1997, (p.325) Jacques Toubon, alors ministre français de la Justice, déclare à l’hebdomadaire américain US News and World Report que « l’usage dominant de la langue anglaise sur l’internet est une nouvelle forme de colonialisme ». Bien entendu, la cécité technologique d’une France crispée sur son Minitel national n’a joué aucun rôle dans cette triste situation. En 1997, nous avions dix fois moins d’ordinateurs reliés à l’internet que les Etats-Unis, deux fois moins que l’Allemagne et arrivions même derrière le Mexique et la Pologne ! Mais la faute en est toujours à l’autre, qui a eu le front de voir plus clair plus tôt que nous et dont la souplesse libérale a permis l’initiative des créateurs privés. En France, la bureaucratisation d’une recherche confite dans le CNRS, la distribution de l’argent public à des chercheurs stériles, mais amis du pouvoir, n’est-ce pas un boulet ? Dans un texte de 1999, intitulé Pour l’exemption culturelle, Jean Cluzel, président du Comité français pour l’audiovisuel, persiste dans la voie protectionniste et peureuse. Il écrit : « Face à l’irruption fracassante des nouvelles technologies de la communication, au service de la culture dominante américaine, la souveraineté culturelle française est fortement menacée. » Irruption fracassante ? Pour quelles raisons ? Est-elle tombée du ciel ? Le remède ? Etudier les causes de cette irruption ? Que non pas ! Il faut instaurer des quotas, subventionner nos films et feuilletons télévisés, revendiquer l’universelle francophonie, tout en laissant la langue française se dégrader dans nos écoles et sur nos ondes.
Toute interprétation délirante par laquelle le moi blessé impute ses propres échecs à autrui est intrinsèquement contradictoire. Celle-là ne manque pas à la règle. En effet, les Français haïssent les Etats-Unis, mais, si quelqu’un proteste contre les américanismes inutiles qui envahissent le parler des médias de masse, on traite aussitôt le récriminateur de vieux ringard, de puriste étriqué et de pion ridiculement accroché au passé. Nous réussissons ce tour de force de conjuguer l’impérialisme francophonique et le hara-kiri langagier. Nous voulons imposer (p.324) au monde une langue que nous parlons nous-mêmes de plus en plus mal, et que nous méprisons donc, délibérément. La contradiction règne avec le même brio au cœur de l’antiaméricanisme de la gauche. Mais le sien est idéologique plus que nationaliste. Dans les cas aigus, il est souvent les deux à la fois. Lorsque Noël Manière, député vert, et Olivier Warin, journaliste télévisuel pour Arte, intitulent un livre commun Non, merci, Oncle Sam1, cela ne peut signifier qu’une chose, à la lumière de l’histoire et non de l’illusion : ces deux auteurs auraient préféré voir l’Europe hitlérienne ou stalinienne plutôt qu’influencée par les États-Unis. Cependant l’Amérique est exécrée à gauche surtout parce qu’elle est le repaire du libéralisme. Or, le libéralisme, quand on gratte un peu, cela continue pour les socialistes à être le fascisme. L’ul-tragauche procède ouvertement à cette assimilation. Et il ne faut pas pousser très loin un interlocuteur de la gauche « modérée » pour qu’il y vienne aussi, trahissant le fond de sa pensée. Combien de fois, dans les pages qui précèdent, n’avons-nous pas rencontré, chez les orateurs qui ne donnaient par ailleurs aucun signe d’aliénation, l’expression « libéralisme totalitaire » et autres équivalents ? L’inférence naturelle de ce verdict devrait donc être de préconiser la restauration de la société communiste, le retour aux racines du socialisme, l’abolition de la liberté d’entreprendre et de la liberté des échanges. Et c’est là qu’est la contradiction. Car, vu le bilan du communisme, et même celui du social-étatisme à la française des années quatre-vingt, aujourd’hui trop bien connus, la gauche recule devant cette conclusion, encore qu’une proportion substantielle de ses prédicateurs les plus ardents la couvent du regard. Mais, comme un tel programme ne peut donner lieu désormais à aucune politique concrètement menée par un gouvernement responsable quel qu’il soit, ce sont surtout les intellectuels de gauche qui, fidèles à leur mission historique, n’ont pas manqué cette occasion trop belle de s’en faire les hérauts.
1. Ramsay, 1999.
(p.327) Ainsi Günter Grass, dans un roman paru en 1995, Ein mettes Feld (« Une longue histoire ») chante rétrospectivement les charmes berceurs de la République démocratique d’Allemagne, réservant toute sa sévérité à l’Allemagne de l’Ouest. La réunification allemande ne fut rien d’autre à ses yeux qu’une « colonisation » (nous avons déjà rencontré ce terme dans ce contexte) de l’Est par l’Ouest et donc une invasion de l’Est par le « capitalisme impérialiste ». Il aurait fallu faire l’inverse, dit-il, se servir de la RDA comme du soleil à partir duquel le socialisme aurait rayonné sur l’ensemble de l’Allemagne. Façon de parachever la beauté de la démonstration, le héros du roman de Grass est un personnage que vous et moi considérerions naïvement comme infect et nauséabond, puisqu’il a passé sa vie à espionner ses concitoyens et à les moucharder, en servant d’abord la Gestapo, ensuite la Stasi. Mais Grass le juge, quant à lui, tout à fait respectable, dans la mesure où cet homme a toujours servi un État antilibéral et s’est inspiré des antiques vertus de l’esprit prussien ! Tels sont la sûreté de vues historiques et les critères de moralité du prix Nobel de littérature 1999 ‘. Ils sont logiques dans la perspective d’une « résistance » à l’influence américaine, puisque les deux seules productions politiques originales de l’Europe au vingtième siècle, les seules qui ne doivent rien à la pensée « anglo-saxonne » sont le nazisme et le communisme. Restons donc fidèles aux traditions du terroir !
1. Voir le compte rendu plus détaillé de ce roman par Rosé-Marie Mercillon, < La nostalgie de Gunter Grass », Commentaire, n » 72, hiver 1995-1996.
(p.329) LA HAINE DU PROGRES
L’opération qui absorbe le plus l’énergie de la gauche internationale, en cette fin du vingtième siècle, et pour probablement plusieurs années encore au début du siècle suivant, a ainsi pour but d’empêcher que soit traitée ou même posée la question de sa participation active ou de son adhésion passive, selon les cas, au totalitarisme communiste. Tout en feignant de répudier le socialisme totalitaire, ce qu’elle ne fait qu’à contrecœur et du bout des lèvres, la gauche refuse d’examiner, sur le fond, la validité du socialisme en tant que tel, de tout socialisme, de peur d’avoir à découvrir ou, plutôt, à reconnaître explicitement que son essence même est totalitaire. Les partis socialistes, dans les régimes de liberté, sont démocratiques dans la proportion même où ils sont moins socialistes.
(p.330) Le bruit assourdissant et quotidien de l’orchestration du « devoir de mémoire » à l’égard de ce passé déjà lointain semble en partie destiné à épauler le droit à l’amnésie et à l’autoamnistie des partisans du premier totalitarisme, lequel a sévi plus tôt, plus longuement, beaucoup plus tard et sévit encore par endroits sur de vastes étendues géographiques et un peu partout dans bien des esprits. Ces partisans couvrent ainsi la voix de ceux qui voudraient l’évoquer et ils expliquent au besoin cette honteuse insistance à parler du communisme par une sournoise complicité rétrospective avec le nazisme.
(p.331) Le communisme est, pour la gauche, comme un membre fantôme, un bras ou une jambe disparus, mais que l’amputé continue à sentir comme s’il était encore présent. Et si l’on a vu disparaître le communisme en tant qu’idéologie globale, façonnant tous les aspects de la vie humaine dans les pays où il était implanté et destinée à régir un jour la totalité de la planète, cela ne signifie pas qu’il ait cessé de contrôler des pans entiers de nos sociétés et de nos cultures. C’est ce que Roland Hureaux, dans Les Hauteurs béantes de l’Europe2, appelle « l’idéologie en pièces détachées ». L’idéologie n’est pas nécessairement un bloc, observe-t-il. « Des phénomènes de nature idéologique peuvent être à l’œuvre dans tel ou tel secteur de la vie politique, administrative ou sociale sans que l’on soit pour autant dans une société totalitaire. »
Un bon échantillon de ces idéologies en pièces détachées est fourni par le courant d’émotions négatives suscité par la mondialisation des échanges. La guérilla urbaine qui se déchaîna en novembre-décembre 1999 à Seattle contre l’Organisation mondiale du commerce, plus enragée encore que celle de Genève en 1998, incarne bien la survivance de la folie totalitaire. On n’ose même plus dire, devant une telle dégradation, « idéologie » totalitaire. L’idéologie, en effet, préserve au moins les apparences de la
1. Éditions F X. de Guibert, 1999.
(p.332) rationalité. A Seattle, le spectacle était donné par des primitifs de la pseudo-révolution. Ils braillaient des protestations et revendications d’une part hors de propos, sans rapport avec l’objet réel de la réunion ministérielle de l’OMC, d’autre part hétéroclites et incompatibles entre elles. Hors de propos parce que l’OMC, loin de prôner la liberté sans frein ni contrôle du commerce international, a été créée en vue de l’organiser, de le réglementer, de le soumettre à un code qui respecte le fonctionnement du marché tout en l’encadrant de règles de droit. Les manifestants s’en prenaient donc à un adversaire imaginaire : la mondialisation « sauvage ». Elle se révéla l’être bien moins qu’eux-mêmes et à vrai dire l’être si peu que ce fut le protectionnisme, gavé de subventions, auquel s’accrochèrent certains grands partenaires de la négociation, qui provoqua au contraire l’échec de la conférence. Un autre reproche gauchiste, celui fait aux pays riches de vouloir imposer le libre-échange, en particulier la libre circulation des capitaux, aux pays moins développés pour exploiter la main-d’œuvre locale, ses bas salaires et l’insuffisance de sa protection sociale, se révéla être un autre de ces fruits de la pensée communiste qui survivent sous forme de paranoïa. En effet, ce furent les pays en voie de développement qui, à Seattle, refusèrent de s’engager à adopter des mesures sociales, le salaire minimal garanti ou l’interdiction du travail des enfants. Ils arguèrent que les riches voulaient, en leur imposant ces mesures, réduire leur compétitivité, due à leur faibles coûts de production, prometteurs d’un décollage économique et donc d’une élévation ultérieure de leur niveau de vie. Contrairement aux préjugés des gauchistes, c’étaient les pays les moins développés, en l’occurrence, qui réclamaient le libéralisme « sauvage » et les pays capitalistes avancés qui, grevés d’un coût élevé du travail, demandaient une harmonisation sociale parce qu’ils redoutent la concurrence des pays moins avancés. C’est aux moins riches que la liberté du commerce profite le plus, parce que ce sont eux qui ont, dans certains secteurs importants, les produits les plus (p.333) compétitifs. Et ce sont les plus riches, avec leurs prix de revient élevés, qui, dans ces mêmes secteurs, craignent le plus la mondialisation. Au vu des divisions qui, à propos de la mondialisation commerciale, opposent aussi bien les pays riches entre eux que l’ensemble des pays riches à l’ensemble des pays moins avancés, on constate que l’idée fixe selon laquelle régnerait partout une « pensée unique » libérale n’existe que dans l’imagination de ceux qui en sont hantés. De même, au rebours des slogans écologistes, fort bruyants eux aussi chez les casseurs de Seattle, ce ne sont pas les multinationales, issues des grandes puissances industrielles, qui rechignent le plus à la protection de l’environnement, ce sont les pays les moins développés. Ils font valoir qu’au cours d’une première phase au moins leur industrialisation, pour prendre son essor, doit, comme le fit jadis celle des riches actuels, laisser provisoirement au second plan les préoccupations relatives à l’environnement. Argument également formulé par les pêcheurs de crevettes d’Inde ou d’Indonésie, auxquels les écolos de Seattle entendaient faire interdire l’emploi de certains filets capturant aussi les tortues, espèce menacée. Quel spectacle comique, ces braillards bien nourris des grandes universités américaines s’efforçant de priver de leur gagne-pain les travailleurs de la mer peinant aux antipodes ! Pourquoi nos écolos ne s’en prennent-ils pas plutôt à la pêche européenne, à la sauvagerie protégée avec laquelle, persistant à employer des filets aux mailles étroites qui tuent les poissons non encore adultes, elle extermine les réserves de nos mers ? Il est vrai qu’aller affronter les marins pêcheurs de Lorient ou de La Corogne ne va pas sans risques. Et charrier des pancartes vengeresses contre la liberté du commerce, dans une ville comme Seattle, où quatre salariés sur cinq, à cause de Microsoft ou de Boeing, travaillent pour l’exportation, ne va pas sans ridicule.
Autre détail amusant : les mêmes énergumènes qui manifestent par la violence leur hostilité à la liberté du commerce militent, avec une égale ardeur, en faveur de la levée de l’embargo (p.334) qui frappe le commerce entre les États-Unis et Cuba. Pourquoi le libre-échange, incarnation diabolique du capitalisme mondial, devient-il soudain un bienfait quand il s’agit de le faire jouer au profit de Cuba ou de l’Irak de Saddam Hussein ? Bizarre ! Si la liberté du commerce international est à leur yeux un tel fléau, ne conviendrait-il pas de faire l’inverse et d’étendre l’embargo à tous les pays ?
On ne saurait expliquer ce tissu de contradictions affichées collectivement par des gens qui, pris chacun isolément, sont sans doute d’une intelligence tout à fait normale, sans l’envoûtement par le spectre regretté du communisme, qui a conditionné et conditionnera encore longtemps certains sentiments et comportements politiques. Selon ces résidus communistes, le capitalisme demeure le mal absolu et le seul moyen de le combattre est la révolution — même si le socialisme est mort et si la « révolution » ne consiste plus guère qu’à briser des vitrines, éventuellement en pillant un peu ce qu’il y a derrière.
Ce simplisme confortable dispense de tout effort intellectuel. L’idéologie, c’est ce qui pense à votre place. Supprimez-la, vous en êtes réduit à étudier la complexité de l’économie libre et de la démocratie, ces deux ennemis jurés de la « révolution ». L’ennui est que ces bribes idéologiques et les mimes révolutionnaires qu’elles inspirent servent de paravent à la défense d’intérêts corporatistes bien précis. Derrière la cohue des braillards incohérents s’engouffraient à Seattle les vieux groupes de pression protectionnistes des syndicats agricoles et industriels des pays riches qui, eux, savaient fort bien ce qu’ils voulaient : le maintien de leurs subventions, de leurs privilèges, des aides à l’exportation, sous le prétexte en apparence généreux de lutter contre « le marché générateur d’inégalités ». Les cris de joie de la révolte « citoyenne! », proclamée telle
1. Ce terme est, depuis quelques années, employé adjectivement dans le sens de l’adjectif « civique », qui existait déjà et n’avait pas besoin d’un doublet incorrect. Civique : « propre au bon citoyen » (Grand Robert, 1985) ; « qui concerne les citoyens, qui appartient à un bon citoyen » (Littré) ; « qui concerne le citoyen comme membre de la cité » (Académie française).
par elle-même, des ONG, de l’ultragauche anticapitaliste, des écologistes, de tous les troupeaux hostiles au libre-échange, qui se sont attribué la gloire du fiasco de la conférence de Seattle, ce triomphe bruyant est un véritable festival d’incohérences. Répétons-le, ce qui a provoqué l’échec de Seattle n’est pas du tout l’« ultralibéralisme » supposé de l’Union européenne et des États-Unis, mais au contraire leur protectionnisme excessif, notamment dans le domaine de l’agriculture, protectionnisme générateur de ressentiments dans les pays émergents, en développement ou dits « du groupe de Cairns », qui sont ou voudraient être gros exportateurs de produits agricoles. Le vainqueur, à Seattle, ce fut le protectionnisme des riches, n’en déplaise aux obsédés qui stigmatisent leur libéralisme. Là où les pays en voie de développement ont marqué un point, c’est en refusant les clauses sociales et écologiques que l’OMC souhaitait leur faire accepter. En les soutenant, la gauche applaudit par conséquent le travail des enfants, les salaires de misère, la pollution, l’esclavage dans les camps de travail chinois, vietnamiens ou cubains. Rarement la nature intrinsèquement contradictoire de l’idéologie se sera manifestée avec une aussi béate fatuité.
Nous saisissons là sur le vif une autre propriété de la pensée idéologique, outre son ignorance délibérée des faits et son culte des incohérences : sa capacité à engendrer, sous des mots d’ordre progressistes, le contraire de ses buts affichés. Elle prétend et croit travailler à la construction d’un monde égalitaire et elle fabrique de l’inégalité. Une autre de ces inversions de sens entre les intentions et les résultats a été accomplie par la politique française de l’Éducation depuis trente ans. Elle aussi est un bon exemple d’une idéologie totalitaire s’appropriant un secteur de la vie nationale au sein d’une société par ailleurs libre. Le 20 septembre 1997, je publie dans Le Point un modeste éditorial intitulé «Le naufrage de l’École»1. Modeste parce
1. Repris dans mon recueil Fin du siècle des ombres, op. cit., p. 589.
(p.336) que je n’y développais, je l’avoue, rien de bien original, tant fusaient depuis des années de toutes parts les lamentations sur la baisse constante du niveau des élèves, sur les progrès de l’illettrisme, de la violence et de ce que l’on appelle par pudeur l’« échec scolaire », apparemment une sorte de catastrophe naturelle ne dépendant en aucune façon des méthodes suivies ou imposées par les responsables de notre enseignement public. Dès le lendemain, je reçois une lettre à en-tête du ministère de l’Education nationale, signée d’un nommé Claude Thélot, « directeur de l’évaluation et de la prospective ». Tout en me servant ironiquement du « Monsieur l’Académicien » et du « Cher Maître », cet important personnage daignait me notifier que mon éditorial était d’une rare indigence intellectuelle et, pour tout dire, « navrant ». Obligeant, le magnanime directeur se tenait à ma disposition pour me fournir sur l’école les lumières élémentaires dont j’étais visiblement dépourvu.
Or voilà que, dès la semaine suivante, la presse rend public un rapport de cette même Direction de l’évaluation et de la prospective. Il en ressort, entre autres atrocités, que 35 % des élèves entrant en sixième ne comprennent pas réellement ce qu’ils lisent et que 9 % ne savent même pas déchiffrer les lettres ‘. Au vu de cet accablant constat, largement diffusé, je me posai aussitôt la question de savoir si par hasard il était tombé sous les yeux de M. Claude Thélot. Celui-ci ne serait-il pas ce qu’on appelle en anglais un self confessed idiot, un sot qui se proclame lui-même être tel, puisque la Direction de l’évaluation, au sommet de laquelle il trône, corroborait mon article ? Ou alors un paresseux qui n’avait même pas pris la peine de lire les études réalisées par ses propres services ? J’écartai ces deux hypothèses pour me rallier en fin de compte à l’explica-
1. Voir dans Le Point du 27 septembre 1997 l’article où Luc Ferry, lui-même président du Conseil national des programmes, expose, analyse et commente longuement ce rapport. Voir aussi, dans le même numéro, l’éditorial de Claude Imbert sur le sujet.
(p.337) tion que l’arrogant aveuglement de M. Thélot était dû à la toute-puissance de l’idéologie, qui s’était emparée de son cerveau et de toute sa pensée. De même qu’un apparatchik était jadis incapable fût-ce d’envisager que l’improductivité de l’agriculture soviétique pût provenir du système même de la collectivisation, ainsi les bureaucrates du ministère de l’Education nationale ne peuvent pas concevoir que l’écroulement de l’école puisse être dû au traitement idéologique qu’ils lui infligent depuis trente ans. Pour un idéologue, obtenir durant des décennies le résultat contraire à celui qu’il recherchait au départ ne prouve jamais que ses principes soient faux ou sa méthode mauvaise. Nous saisissons-la sur le vif ce phénomène fréquent d’un « segment totalitaire » au sein d’une société par ailleurs démocratique1. De nombreux tronçons idéologiques, aujourd’hui surtout de filiation communiste, continuent ainsi de flotter ça et là de par le monde, alors même que disparaît le communisme comme entité politique et comme projet global. Comment et pourquoi ont pu apparaître, comment et pourquoi peuvent se perpétuer, en quelque sorte à titre posthume, ces trois caractéristiques souvent évoquées dans ces pages, des idéologies totalitaires et plus particulièrement de l’idéologie communiste : l’ignorance volontaire des faits ; la capacité à vivre dans la contradiction par rapport à ses propres principes ; le refus d’analyser les causes des échecs ? On ne peut entrevoir de réponse à ces question si l’on exclut une réponse paradoxale : la haine socialiste pour le progrès2.
1. Voir Liliane Lurçat, La Destruction de l’enseignement élémentaire. Éditions F.-X. de Guibert, 1998. À l’occasion du Salon de l’Éducation, organisé par le ministère gour la première fois en novembre 1999 (il est plus facile d’organiser un Salon de l’Education que l’éducation), Mme Ségolène Royal, ministre chargée de l’Enseignement scolaire, « déclare la guerre à l’illettrisme » (journal du dimanche, 28 novembre 1999). Si elle lui déclare la guerre, c’est donc qu’il existe, n’en déplaise à M. Thélot. Pis : grâce à une enquête de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, rendue publique fin novembre 1999, nous apprenions qu’une proportion croissante des élèves admis en sixième non seulement ne savent pas lire mais ne sont même plus capables de parler ! 2. Sur les rapports ambigus de la gauche avec l’idée et la réalité du progrès au cours des deux siècles écoulés, Jacques Julliard a en préparation un ouvrage à paraître chez Gallimard. Je me borne ici à quelques notations.
(p.338) Nous avons vu au chapitre treizième comment les théoriciens du Parti communiste et ceux de l’ultragauche marxiste condamnent en bloc tous les moyens modernes de communication comme étant des « marchandises » fabriquées par des « industries culturelles ». Ces prétendus progrès n’auraient pour but selon eux que le profit capitaliste et l’asservissement des foules. L’édition, la télévision, la radio, le journalisme, l’internet, pourquoi pas l’imprimerie ? n’auraient ainsi jamais été des instruments de diffusion du savoir et des moyens de libération des esprits. Ils n’auraient au contraire servi qu’à tromper et à embrigader. Ce qu’il faut se rappeler, c’est que cette excommunication de la modernité, du progrès scientifique et technologique et de l’élargissement du libre choix culturel plonge ses racines dans les origines de la gauche contemporaine et, de façon éclatante, dans l’œuvre de l’un de ses principaux pères fondateurs : Jean-Jacques Rousseau. Nul ne l’a mieux vu et mieux dit que Bertrand de Jouvenel dans son Essai sur la politique de Rousseau1, sinon, bien longtemps avant lui, mais cursivement, Benjamin Constant dans De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Le texte qui a rendu Rousseau instantanément célèbre est, chacun le sait mais rares sont ceux qui en tirent les conclusions appropriées, un manifeste virulent contre le progrès scientifique et technique, facteur, selon lui, de régression dans la mesure où il nous éloigne de l’état de nature. Ce texte va donc à l’encontre de toute la philosophie des Lumières, selon laquelle l’avancement de la connaissance rationnelle, de la science et de ses applications pratiques favorise l’amélioration des conditions de vie des humains. L’hostilité que les philosophes du dix-huitième siècle, notamment Voltaire, vouèrent rapidement à Rousseau ne découle pas seulement d’animosités personnelles, comme on le répète sans trop d’examen : elle a pour cause une profonde divergence
1. 1947. Repris en Introduction de l’édition du Contrat social dans la collection Pluriel, 1978.
(p.339) doctrinale. Au rebours du courant majeur de son temps, Rousseau considère la civilisation comme nocive et dégradante pour l’homme. Il vante sans cesse les petites communautés rurales, il prône le retour au mode de vie ancestral, celui de paysans éparpillés dans la campagne en hameaux de deux ou trois familles. L’objet de son exécration, c’est la ville. Après le tremblement de terre de Lisbonne, il clame hautement que ce séisme n’aurait pas fait autant de victimes… s’il n’y avait pas eu d’habitants à Lisbonne, c’est-à-dire si Lisbonne n’avait jamais été bâtie. L’ennemi, à tous points de vue, c’est la cité. Elle est corruptrice et, de plus, expose les humains à des catastrophes qui ne les frapperaient pas s’ils continuaient à vivre dans des cavernes ou des huttes. Ainsi, l’humanité se porterait beaucoup mieux, culturellement et physiquement, si elle n’avait jamais construit ni Athènes, ni Rome, ni Alexandrie, ni Ispahan, ni Fez, ni Londres, ni Séville, ni Paris, ni Vienne, ni Florence, ni Venise, ni New York, ni Saint-Pétersbourg. Une fois de plus, les visions passéistes et le protectionnisme champêtre d’une certaine gauche, celle d’où est issu le totalitarisme, coïncident avec les thèmes de l’extrême droite traditionaliste, adepte du « retour aux sources ». Cette convergence se retrouve jusque dans les débats les plus brûlants de la dernière année du vingtième siècle : certains réquisitoires contre l’« ultralibéralisme » et la « mondialisation impérialiste » étaient à ce point identiques sous des plumes communistes ou ultragauchistes et sous des plumes « souverainistes » de droite qu’on aurait pu intervertir les signatures sans trahir le moins du monde la pensée des auteursl.
Dans sa logique hostile à la civilisation, tenue pour corruptrice, Rousseau est l’inventeur du totalitarisme culturel. La
1. C’est le cas de deux articles parus le même jour, 8 décembre 1999 : l’un dans Le Monde, de Charles Pasqua, président du Rassemblement pour la France (droite gaulliste) et intitulé « La mondialisation n’est pas inéluctable » ; l’autre d’Alain Kri-vine et Pierre Rousset, tous deux membres de la Ligue communiste révolutionnaire, intitulé « Encore un effort, camarades ! » et publié dans Libération. Ces deux « Libres opinions » sont exquisément interchangeables.
(p.340) Lettre à d’Alembert sur les spectacles préfigure le jdanovisme « réaliste-socialiste » du temps de Staline et les œuvres « révolutionnaires » de l’Opéra de Pékin du temps où c’était Mme Mao Tsé-toung qui le dirigeait. Pour Rousseau, comme pour les autorités ecclésiastiques les plus sévères des dix-septième et dix-huitième siècles, le théâtre est source de dégradation des mœurs. Il incite au vice en dépeignant les passions et pousse à l’indiscipline en stimulant la controverse. Les seules représentations qui soient à son goût sont celles de pièces de patronage, de ces saynètes édifiantes que l’on improvise quelquefois dans les cantons suisses, les soirs de vendanges. Si Jean-Jacques s’était appliqué à lui-même l’esthétique de Rousseau, il se serait interdit d’écrire les Confessions et aurait ainsi privé la littérature française d’un chef-d’œuvre. Quant aux institutions politiques, Le Contrat social garantit la démocratie exactement de la même manière que la constitution stalinienne de 1937 en Union soviétique. Partant du principe que l’autorité de leur État émane de la «volonté générale » du « peuple tout entier », nos deux juristes stipulent que plus aucune manifestation de liberté individuelle ne doit être tolérée postérieurement à l’acte constitutionnel fondateur. C’est dans Le Contrat social que s’exprime, avant la lettre, la théorie du «centralisme démocratique» ou de la « dictature du prolétariat » (dans un autre vocabulaire, bien sûr). Du reste, il est un symptôme qui ne trompe pas : Rousseau exalte toujours Sparte au détriment d’Athènes. Au dix-huitième siècle et jusqu’à Maurice Barrés, c’était presque un code, un signe de ralliement des adversaires du pluralisme et de la liberté. Benjamin Constant relève bien ce penchant pour le permanent camp de rééducation Spartiate, cher à la fois au redoutable abbé de Mably, l’un des plus inflexibles précurseurs de la pensée totalitaire, et au bien intentionné Jean Jacques : « Sparte, qui réunissait des formes républicaines au même asservissement des individus, excitait dans l’esprit de ce philosophe un enthousiasme plus vif encore. Ce vaste couvent lui paraissait l’idéal d’une parfaite république. Il avait (p.341) pour Athènes un profond mépris, et il aurait dit volontiers de cette nation, la première de la Grèce, ce qu’un académicien grand seigneur disait de l’Académie française : « Quel épouvantable despotisme ! Tout le monde y fait ce qu’il veut. » » Comme le note avec ironie Bertrand de Jouvenel, Rousseau a été loué depuis deux siècles en tant que précurseur d’idées en complète opposition avec celles qui avaient été vraiment les siennes. Il préférait « les champs plutôt que la ville, l’agriculture plutôt que le commerce, la simplicité plutôt que le luxe, la stabilité des mœurs plutôt que les nouveautés, l’égalité des citoyens dans une économie simple plutôt que leur inégalité dans une économie complexe et… par-dessus tout, le traditionalisme plutôt que le progrès ». Mais en ce sens, s’il ne fut pas, contrairement à la légende, un fondateur intellectuel de la démocratie libérale, il le fut bel et bien de la gauche totalitaire.
À l’instar de Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Engels, dans sa célèbre Situation des classes laborieuses en Angleterre, publiée en 1845, dépeint l’industrialisation et l’urbanisation avant tout comme des facteurs de destruction des valeurs morales traditionnelles, notamment familiales. Dans les nouvelles cités industrielles, les femmes sont, dit-il, amenées à travailler hors du foyer. Elle ne peuvent donc remplir le rôle qui leur a été dévolu par la nature : « veiller sur les enfants, faire le ménage et préparer les repas ». Pis : si le mari est au chômage, c’est à lui qu’incombé cette tâche. Horreur ! « Dans la seule ville de Manchester, des centaines d’hommes sont ainsi condamnés à des travaux ménagers. On comprend aisément l’indignation justifiée d’ouvriers transformés en eunuques. Les relations familiales sont inversées1. » Le mari est privé de sa virilité, cependant que l’épouse, livrée à elle-même dans la grande ville, s’expose à toutes les tentations. Il n’échappera pas au lecteur que nous n’avons pas précisément affaire là, dans le sermon du révérend Engels, à un programme annonciateur de la libération de la femme.
1. Chapitre septième.
(p.342) Les sociétés créées par le « socialisme réel » furent de fait les plus archaïques que l’humanité ait connues depuis des millénaires. Ce « retour à Sparte » caractérise d’ailleurs toutes les utopies. Les sociétés socialistes sont oligarchiques. La minorité dirigeante y assigne à chaque individu sa place dans le système productif et son lieu de résidence, puisqu’il y est interdit de voyager librement, même dans le pays, sans une autorisation, matérialisée par le « passeport intérieur ». La doctrine officielle doit pénétrer dans chaque esprit et constituer sa seule nourriture intellectuelle. L’art même n’existe qu’à des fins édifiantes et doit se borner à exalter avec la plus hilarante niaiserie une société nageant dans le bonheur socialiste et à refléter l’extase de la reconnaissance admirative du peuple envers le tyran suprême. La population est, bien entendu, coupée de tout contact avec l’étranger, qu’il s’agisse d’information ou de culture, isolement qui réalise le rêve de protectionnisme culturel cher à certains intellectuels et artistes français depuis qu’ils se sentent menacés par le « danger » de la mondialisation culturelle. Ils dénoncent en celle-ci un risque d’uniformisation de la culture. Comme si l’uniformité culturelle n’était pas, au contraire, de façon éclatante la marque des sociétés closes, au sens où Karl Popper et Henri Bergson ont employé cet adjectif ! Et comme si la diversité n’était pas, tout au long de l’histoire, le fruit naturel de la multiplication des échanges culturels ! C’est dans les sociétés du socialisme réel que des camps de rééducation ont pour fonction de remettre dans le droit chemin de la « pensée unique » tous les citoyens qui osent cultiver une quelconque différence. Cette même rééducation a en outre l’avantage de fournir une main-d’œuvre d’un coût négligeable. Encore en l’an 2000, plus d’un tiers de la main-d’œuvre chinoise est constituée d’esclaves. Point d’étonnement à ce que les produits qu’ils fabriquent ainsi presque gratuitement parviennent sur les marchés internationaux à des prix « imbattables ». Et qu’on ne vienne pas dire qu’il s’agit-là d’un méfait du libéralisme : le libéralisme suppose la démocratie, avec les lois sociales qui en découlent.
(p.343) Il paraît incroyable qu’il puisse y avoir encore aujourd’hui des gens assez nombreux qu’habité la nostalgie de ce type de société, soit en totalité, soit en « pièces détachées ». Et pourtant c’est un fait. La longue tradition, échelonnée sur deux millénaires et demi, des œuvres des utopistes, étonnamment semblables, jusque dans les moindres détails, dans leurs prescriptions en vue de construire la Cité idéale, atteste une vérité : la tentation totalitaire, sous le masque du démon du Bien, est une constante de l’esprit humain. Elle y a toujours été et y sera toujours en conflit avec l’aspiration à la liberté.
|
|
2001 |
Joëlle Meskens, Les ratés du génie français, LS 24/02/2001
C’était autrefois une marque de savoir-faire. « Made in France » rimait avec excellence (sic). Mais (…) la belle machinerie de l’ingénierie républicaine n’en finit plus de se gripper. Plus que cela se veut grand et plus cela capote. Ainsi, depuis sa construction, le porte-avions « Charles-de-Gaulle » accumule les avaries. L’hôpital « Pompidou » devait abriter dans le 15e arrondissement de Paris le nec pus ultra de la technologie dans un pays où l’on attend des mois pour passer une résonance magnétique ou des semaines pour passer un scanner. La poisse. Une épidémie de légionellose a sévi parmi les premiers hospitalisés. Deux décès. La méchante bactérie se cachait dans les circuits hydrauliques. Résultat : privés de douche, les malades ! (…) Cela vous flanque une mauvaise réputation, d’autant que l’on avait déjà glosé sur l’étroitesse de l’une de ses rampes d’accès de l’hôpital (un camion de pompiers n’y passerait pas !) et sur les défaillances du système informatique… Ce devait être la bibliothèque du futur, la bibliothèque « François Mitterrand ». Las ! (…) Les chercheurs se plaignent de ne pas voir la lumière du jour. Le système de consultation entièrement informatisé n’est toujours pas rodé. Excédés d’attendre des temps interminables un chariot, qui parfois n’arrive pas, même des téméraires ont fini par baisser les bras.
|
|
2003 |
Manfred Weber-Labardière, Frankreich / Im Jammertal, FOCUS 46/2003, S. 226-227
Bis der Hitzesommer kam. 15000 meist alte Menschen starben an den Folgen der Hitzewelle. Zum Teil, weil viele Familien in den Urlaub fuhren und ihre Angehörigen unversorgt zurückließen. Vor allem aber weil das staatliche Gesundheitssystem – gern als « das beste der Welt » gelobt – versagte, Der präsident stellte sich zunächst taub, der Premier war nicht auf dem Laufenden, der Gesundheitsminister log. Und nach der Rentrée, dem Ende der großen Ferien, waren aus den stolzen Galliern Jammerlappen geworden. Gejammert wird auf allen Kanälen: Talk-Shows und ein halbes Dutzend Bücher beschäftigen sich mit dem Niedergang. In » Le Monde » beleuchten prominente Gastkommentatoren das Sujet, – und das Blatt » Le Parisien » fragt bang: » Wie geht es den Franzosen? » (…)
(S.227) Schon bei der letzten Präsidentschaftswahl gaben 35 Prozent der Franzosen in der ersten Runde Rechts- oder Linksradikalen ihre Stimme. (…)
Absurd auch eine andere Dienstanweisung. Diplomaten sollen in ihrer Muttersprache parlieren, selbst wenn das Gegenüber kein Französisch spricht, der Franzose aber die Sprache des anderen. Fazit der « Arroganz »-Abhandlung: Würden sich die Franzosen weniger auf plustern, könnten sie ihre Energie für effizienteres Arbeiten verwenden. » Der Export mit Verlust ist zur französischen Spezialität geworden » , schreiben Gubert und sein Kollege und nennen Beispiele: Nach dem Golfkrieg verkauften die Franzosen 450 Leclerc-Panzer nach Saudi-Arabien. In ihrer Begeisterung über die französische Überlegenheit vergaßen die Unterhändler jedoch, das Kleingedruckte zu lesen: Reparatur und Wartung müssen die Franzosen bezahlen – mittlerweile 1,2 Milliarden Euro.
Niedergangsprophet Baverez haut in die gleiche Kerbe, Selbst das wirtschaftslahme Deutschland taugt zum Vorbild: Die Tarifhoheit der Sozialpartner, die Universitäten, ja sogar die Wirtschaftspolitik des Nachbarn sei besser. Die eigene Regierung hingegen verdient – laut Baverez – ihren Namen nicht: » Sie führt das Land nicht, sondern arbeitet wie eine psychologische Beratungsstelle, » Niedergang wittert der Neoliberale selbst in der Armee : » 60 Prozent der Flugzeuge und 50 Prozent der Flotte sind wegen mangelhafter Wartung nicht einsatzbereit; wir könnten nicht einmal das französische Festland verteidigen. » Der atomgetriebene Flugzeugträger » Charles de Gaulle » drei Milliarden Euro teuer, sollte Frankreichs Großmachtsanspruch manifestieren. Der Haken: Die gigantische Schiffsschraube funktioniert bis heute nicht korrekt. « Arroganz ist immer schädlich », meinen dazu die Autoren Gubert und Saint-Martin, » aber wenn man nicht die notwendigen Mittel hat, ist sie schlicht lächerlich. »
|
|
2005 |
Le général de Gaulle, le plus respecté des Français, LB 06/04/2005
Il a été élu « plus grand Français de tous les temps » parmi 100 personnalités. (Malgré qu’il fut pratiquement un dictateur.)
|
2 La judéophobie en France, ancrée dans les mentalités
Extraits de:
Pierre-André Taguieff, La judéophobie des Modernes, Des Lumières au Jihad Mondial, éd. Odile Jacob, 2008
(p.10) Ce qui était au cœur de l’antisémitisme au sens strict du terme, c’était le refus de la présence des Juifs au sein de la nation ; ce qui fonde l’antisionisme radical, c’est le refus de reconnaître aux Juifs le droit de se vouloir une nation, de se constituer en nation. Le Juif est donc passé du statut répulsif de l’Asiatique inquiétant à celui de l’Occidental arrogant, en même temps que, de menace universelle pour toute nation, le peuple juif devenait la nation menaçant la paix universelle. La haine des Juifs va désormais de pair avec la haine de l’Occident – qu’on peut désigner par le néologisme « hespérophobie ». C’est ainsi que la judéophobie et l’hespérophobie se sont entrecroisées.
(p.10) Pour saisir la nouveauté de la configuration antijuive en cours d’émergence, il faut aussi considérer de près un phénomène géostratégique et culturel qui était imprévisible encore dans les années 1970, avant la révolution khomeyniste en Iran et le lancement dujihad contre l’occupation soviétique en Afghanistan : la guerre déclarée aux « judéo-croisés » par l’islamisme radical, sur la base fantasmatique d’un « complot américano-sioniste » contre l’islam et les musulmans. Cette désignation du « judéo-croisé » en tant qu’ennemi absolu a valeur d’indice : elle met en évidence une transformation décisive de l’image des Juifs dans la mythologie antijuive contemporaine, dont le champ de diffusion, loin de se réduire à celui de l’islamisme jihadiste, ne cesse de s’élargir par les effets conjugués de la contestation « altermondialiste » et d’une nouvelle vague de tiers-mondisme centré sur un antiaméricanisme diabolisateur. L’islamisation de la cause palestinienne et de la lutte « antisioniste », dont témoigne la création du Hamas à la fin des années 1980, s’est intégrée dans la vision jihadiste du combat mondial contre les Juifs et les « Croisés ». C’est dans le cadre de cette nouvelle configuration que l’amalgame polémique « judéo-croisés » prend tout son sens. L’occidentalisation des Juifs a atteint son intensité polémique maximale dans leur américanisation, laquelle constitue aujourd’hui le plus puissant mode de délégitimation idéologico-politique. Cette transformation de la cible ou de la figure de l’ennemi absolu a produit une transformation de l’antisionisme radical, pour marquer l’apparition d’un nouveau régime de judéophobie, qu’on peut qualifier de « postantisémite ». Ces représentations se sont banalisées en s’intégrant dans le nouveau système des injures politiques : pour disqualifier l’homme politique nommé X, on va le traiter de « X l’Américain », « X l’Israélien » ou « X le sioniste ». Ce livre a d’abord pour objet d’explorer cette nouvelle configuration antijuive centrée sur la hantise de « l’alliance américano-sioniste », d’en identifier les principaux éléments, d’en analyser les conditions d’émergence et d’en évaluer la capacité de diffusion, pour l’inscrire à sa place dans la longue histoire non linéaire des formes de judéophobie.
(p.11)
Une transformation des stéréotypes négatifs accompagne la sécularisation de la haine antijuive : on passe du Juif usurier (Shylock) au Juif financier (Rothschild). Les antijuifs modernes peuvent alors dénoncer la menace qui, incarnée par la « nation juive », est censée peser sur tous les peuples : une double menace d’exploitation et de domination. Pour être acceptables, les Juifs doivent cesser d’être juifs.
En deuxième lieu, le processus de « biologisation » et plus précisément de « racialisation » du discours antijuif, impliquant la substitution d’une légitimation scientifique à la traditionnelle légitimation religieuse portée par le christianisme. C’est ainsi que s’est constitué dans nombre de nations européennes, des années 1850 aux années 1870, l’antisémitisme stricto sensu, sur la base de la « doctrine des races » qui, après une période marquée par la référence à l’anthropologie physique, s’est reconfigurée en s’intégrant dans l’idéologie évolutionniste ou, plus exactement, dans l’idéologie scientifique devenue dominante au cours du dernier tiers du XIXe siècle, l’évolutionnisme social, couramment – et incorrectement -appelé « darwinisme social ». À la thèse de l’inégalité des races, qui formait le noyau de la vision racialiste du monde, s’ajoute la thèse, propre à l’évolutionnisme social/racial, selon laquelle la lutte des races est le moteur de l’Histoire. La lutte des races va en fait se réduire, dans l’espace culturel européen, à la guerre entre « Sémites » et « Aryens ». Raciologiquement traitée, la « question juive » a désormais pour contenu l’ensemble des problèmes suscités par l’existence, dans les pays européens, d’une « race » posée à la fois comme inférieure et nuisible, ou parasitaire, en lutte pour sa survie par tous les moyens. La racialisation du Juif implique autant son infériorisation, exprimée par divers amalgames polémiques (le Juif « négroïde » ou « asiate »), que sa pathologisation (le Juif-bacille) ou sa cri-minalisation (le Juif « criminel héréditaire »). Mais surtout, la vision raciste du Juif consiste à le définir comme irrémédiablement étranger aux « races de l’Europe ». Le Juif est érigé en étranger absolu et par nature. Dès lors, ni l’abandon du judaïsme, ni la conversion au christianisme, ni l’accès à la citoyenneté nationale ne sauraient transformer sa nature. Si les théoriciens de l’antisémitisme se réclament d’une façon militante du matérialisme « scientifique » ou du positivisme, leurs écrits alimentent, dès les années 1879-1881 en Allemagne, de puissants mouvements nationalistes s’appuyant sur un dispositif de propagande bien défini, qui sloganise à la fois la peur de l’invasion et la hantise de la souillure. En mélangeant prétentions scientifiques et intellectualisation des passions xénophobes centrées sur la présence en Europe de la prétendue « race juive » comme un « corps étranger » menaçant de ruiner les nations d’accueil, l’antisémitisme devient un programme politique au cours des vingt dernières années du XIXe siècle. Dans la perspective du nationalisme fondé sur le racisme, les solutions de la « question juive » se réduisent à deux : l’expulsion totale et l’extermination physique.
En troisième lieu, la lente constitution, à partir de la période postrévolutionnaire, d’une vision conspirationniste de la marche de l’Histoire, (p.12) dont le moteur supposé serait le « complot judéo-maçonnique », premier modèle d’une série de complots permettant de construire le Juif comme figure de l’ennemi absolu, d’autant plus dangereux qu’il est censé être invisible. Dans le conspirationnisme antijuif, c’est la diabolisation qui prévaut. On trouve, dans l’expression polémique « le péril juif», devenue slogan à la fin du XIXe siècle, une synthèse de toutes ces « raisons » de se sentir menacé par les Juifs.
On trouvera enfin, dans le présent ouvrage, une tentative de réduire l’ensemble bariolé des représentations négatives et des thèmes d’accusation visant les Juifs, accumulés depuis le monde antique (Egypte, Grèce, Rome), à un petit nombre de récits, qu’on peut concevoir comme des mythes. Il s’agit de mythes répulsifs concernant le peuple juif essentialisé et, partant, déshistoricisé (« le Juif »), de récits d’accusation permettant de déshumaniser les Juifs de diverses façons : animalisation, démonisation, pathologisation et criminalisation. Étudiés dans leur mode de formation et dans leurs multiples fonctionnements, ces mythes antijuifs sont au nombre de six, que nous analyserons successivement : « haine du genre humain » (ou xénophobie généralisée1) ; déicide ; meurtre et cannibalisme rituels ; usure et domination financière ; complot mondial ; racisme.
Ce livre se propose donc d’offrir à la fois les résultats d’une recherche conduite depuis plusieurs années sur les formes modernes et contemporaines de la judéophobie, sur leurs origines et leurs évolutions, une discussion critique des travaux sur les mythes et les croyances judéophobes, privilégiant autant les phénomènes de récurrence des récits d’accusation que leurs métamorphoses, un diagnostic de la dynamique actuelle de la judéo-phobie dans le monde, liée à la diffusion de l’antisionisme radical, et une analyse aussi distanciée que possible de la situation de l’Europe face à la vague antijuive nourrie par la propagande islamiste, où le cas français constitue un exemple privilégié.
Le sens d’un amalgame : « américano-sionisme »
(p.15) Les trois grands processus de la » modernisation occidentale, la sécularisation, la rationalisation et l’individualisation, se heurtent partout dans le monde soit à de fortes résistances, soit à une totale indifférence. Ce sont les États-Unis qui constituent la cible principale de ce discours anti-occidental, à l’intérieur et à l’extérieur du monde occidental : l’antiaméricanisme est le principal vecteur de la haine de l’Occident2. Encore faut-il préciser que l’objet de la haine est ici l’Occident moderne, c’est-à-dire, aux yeux d’un penseur radicalement antimoderne comme René Guenon, la seule civilisation qui soit dépourvue d’une « base traditionnelle3 », la seule qui ait rompu avec ses propres traditions pour « ne rien envisager en dehors du domaine scientifique et rationnel4 » et réduire les fins dernières à l’objectif de la maîtrise croissante de la nature par la science et la technique, condition d’une « supériorité matérielle » incontestable5, à vrai dire étroitement liée au capitalisme. C’est de l’Occident moderne que l’Amérique est le visage à la fois détesté et jalousé par ses ennemis. Mais l’antiaméricanisme ne fonctionne pas seul. Depuis environ un demi-siècle, il fait couple avec ce qu’il est convenu d’appeler confusément l’« antisionisme », au sein d’une seule et même vision polémique du monde, dont l’idéologie soviétique aura constitué le modèle, aujourd’hui oublié, recouvert par ses multiples imitations et réminiscences6. L’expression « antisionisme » est en effet équivoque, dans la mesure où la question n’est pas de contester le « sionisme », ni de critiquer la politique de tel ou tel gouvernement israélien : elle est de définir les moyens permettant d’éradiquer l’État d’Israël, objectif final de l’« antisionisme » au sens fort du terme. C’est pourquoi, afin d’éviter de nourrir l’ambiguïté, j’emploierai l’expression « antisionisme radical » ou « absolu » pour désigner ce programme d’éradication
CHAPITRE 1 L’islamisme et ses ennemis Juifs et « Croisés »
(p.17) La représentation du « sionisme » la plus répandue dans le monde arabo-musulman apparaît dans un manuel scolaire saoudien sous la formulation suivante : « Le sionisme (…) constitue l’appareil exécutif officiel du judaïsme mondial1. » Si le « sionisme » est le bras armé du « judaïsme mondial », alors ce dernier peut être imaginé comme une organisation d’extension planétaire dont l’idéologie est celle qui oriente les pratiques « sionistes ». Or le « sionisme », précise un autre manuel scolaire saoudien, est « un phénomène de nationalisme raciste et agressif qui prend le caractère du colonialisme européen, lequel est [un type] d’impérialisme occidental2 ». Ainsi défini, le « sionisme » n’est guère qu’une manifestation historique de la nature transhistorique des Juifs : « Les Juifs sont la méchanceté dans son essence même3. »
Dans la vulgate anti-occidentale devenue planétaire, l’antiamérica-nisme est inséparable de l’antisionisme radical, composante principale de la nouvelle vision judéophobe qui s’est constituée durant le dernier demi-siècle. Cette vulgate est l’héritière de l’utopie révolutionnaire, dont elle constitue la plus récente figure historique, succédant au communisme stalinien. Elle lui doit son vocabulaire mimmaliste, ses clichés et ses slogans. En Europe, ces deux visions polémiques jumelles, l’antiaméricanisme et l’antisionisme radical, sont dotées d’une haute respectabilité idéologico-politique tout en faisant l’objet de théorisations qui occupent une bonne partie du temps de travail des journalistes, des essayistes et des spécialistes de sciences sociales. L’intellectualisation de ces passions politiques dominantes semble aller de pair avec leur forte acceptabilité culturelle4. Mais on peut en outre leur reconnaître une dimension fonctionnelle, dans le cadre du processus de construction imaginaire de l’identité européenne. Le politologue américain Andrei Markovits formule cette hypothèse : « Personne ne sait ce que veut dire être européen. On ne voit pas très bien ce qu’un Grec et un Suédois ont de commun. Mais ce qui est important, c’est qu’ils ont en commun de ne pas être américains. Aucune identité ne s’est jamais construite sans une contre-identité forte. L’antiaméricanisme permet aux Européens de se fabriquer une identité jusque-là inexistante mais indispensable si l’on veut que le projet européen aboutisse5. » L’antisionisme et l’antiaméricanisme, positions qu’on trouve distribuées dans tout le spectre idéologico-politique (du centre aux extrêmes), permettent donc aux Européens de se fabriquer polémiquement une identité collective. C’est pourquoi il est vain de s’y opposer par des discours moralisants. Face à un tel mixte d’intérêts et de passions, la seule arme efficace est un autre mixte d’intérêts et de passions, qui ne peut se fonder que sur la défense de l’unité
(p.18) et de l’identité de l’Occident, face à ceux qui le désignent en tant qu’ennemi. Comme le rappelait naguère Levinas après bien d’autres penseurs, « Occident signifie liberté de l’esprit6 ». Mais la liberté de l’esprit n’est pas un fait social, un phénomène sociologiquement observable. Elle n’a rien d’une donnée élémentaire de l’existence occidentale. Elle constitue un appel et représente une tâche. L’identité occidentale peut se réduire à cet idéal. Lui seul vaut qu’on le défende à tout prix.
(p.18) Cette synthèse qu’est l’islamisme articule l’utopisme messianique des mouvements révolutionnaires, (p.19) qu’incarnent des leaders charismatiques, avec le culte de la tradition préa-lablement idéologisée11 et l’exaltation d’un passé héroïque tout imaginaire, pour faire surgir un nouveau totalitarisme. Dans les années 1960, le politologue américain Manfred Halpern décrivait déjà ce qu’il appelait les « mouvements totalitaires néo-islamiques12 ». Après la Révolution islamique en Iran, un certain nombre de spécialistes ont analysé dans une perspective comparative le totalitarisme nazi et le nouveau totalitarisme qu’est l’islamisme, en tant que mouvement, idéologie et régime13. Outre les analogies fonctionnelles qui peuvent être relevées, on peut s’attacher à l’analyse historique des filiations idéologiques entre l’antisémitisme national-socialiste et la judéophobie des théoriciens islamistes comme des différents courants du national-islamisme, qui ont fabriqué à la fois l’idéologie jihadiste et l’antisionisme radical contemporains14. Dans une autre perspective, l’islamisme a été suggestivement caractérisé comme un « traditionalisme révolutionnaire15 », oxymore s’il en est, puisque combinant l’autorité traditionnelle et le pouvoir charismatique, l’idéal de stabilité fondé sur le double principe de l’hérédité et de l’héritage et la propension au changement perpétuel ou à l’accomplissement des fins dernières. Encore faut-il ne pas négliger une dimension fondamentale des totalitarismes du XXe siècle, qu’on retrouve dans l’islamisme radical : la définition et la mise en œuvre d’un programme de « purification » du genre humain. Les terribles purificateurs, bolcheviks, nazis ou islamistes, conçoivent leur combat comme un travail infini d’épuration et de nettoyage, visant à éliminer les éléments jugés « nuisibles », « criminels », « impurs » ou « impies »16.
(…)
Comme l’a montré Gilles Kepel, dans la doctrine des Frères musulmans, telle qu’elle a été présentée notamment dans le mensuel égyptien Al-Da’wa (1976-1981) (p.20) qui s’adressait à un large public2« , les nombreux ennemis de l’islam peuvent être ramenés à quatre types principaux, chacun incarnant un principe du mal : la « juiverie », la « Croisade » (recouvrant approximativement l’Occident chrétien « impérialiste »), le « communisme » et la « laïcité ». Mais l’ennemi principal est la « juiverie » ou le Juif (yahud), figure diabolique qu’il faut combattre sans merci, comme le montre un article intitulé « Les Juifs », paru dans le supplément pour enfants du magazine islamiste en octobre 1980 : « Frère lionceau musulman ! T’es-tu déjà un jour demandé pourquoi Dieu a maudit les Juifs dans Son Livre (…) ? (…) Qu’un homme mente et soit dans l’erreur, passe, mais qu’un peuple édifie sa société sur le mensonge, voilà en quoi se sont spécialisés les seuls fils d’Israël ! (…) Tels sont les Juifs, mon Frère lionceau musulman, tes ennemis et les ennemis de Dieu (…). Telle est leur disposition naturelle, la doctrine corrompue dont ils sont familiers (…). Ils n’ont jamais cessé de comploter contre leur principal ennemi, les Musulmans. Dans l’un de leurs livres [les Protocoles des Sages de Sion], ils disent : « Nous les Juifs, nous sommes les maîtres du monde, ses corrupteurs, ceux qui fomentent les séditions, ses bourreaux ! » Ils ne t’aiment pas, toi, lionceau musulman, toi qui révères Dieu, l’islam, et le prophète Mahomet (…). Lionceau musulman, anéantis leur existence, à ceux qui veulent assujettir l’humanité entière pour la faire servir leurs desseins sataniques21. »
(…)
Encore faut-il ne pas oublier les régimes despotiques qui se réclament d’une manière ou d’une autre de l’islam, en instrumentalisant systématiquement les passions religieuses ainsi que les réflexes xénophobes. Revenant sur les travaux préparatoires dans lesquels il s’était engagé en vue de rédiger son roman, Le Village de l’Allemand, paru en janvier 200824, le grand romancier algérien Boualem Sansal, lui-même victime du « régime national-islamiste » algérien et témoin scrupuleux de la montée en puissance de l’islamisme, esquisse avec rigueur une comparaison entre le régime nazi et les dictatures islarno-nationalistes contemporaines, où l’on (p.21) retrouve bien des traits classiques du totalitarisme hitlérien : « En avançant dans mes recherches sur l’Allemagne nazie et la Shoah, j’avais de plus en plus le sentiment d’une similitude entre le nazisme et l’ordre qui prévaut en Algérie et dans beaucoup de pays musulmans et arabes. On retrouve les mêmes ingrédients et on sait combien ils sont puissants. (…) Les ingrédients sont les mêmes ici et là : parti unique, militarisation du pays, lavage de cerveau, falsification de l’histoire, exaltation de la race, vision manichéenne du monde, tendance à la victimisation, affirmation constante de l’existence d’un complot contre la nation (Israël, l’Amérique et la France sont tour à tour sollicités par le pouvoir algérien quand il est aux abois, et parfois, le voisin marocain), xénophobie, racisme et antisémitisme érigés en dogmes, culte du héros et du martyr, glorification du Guide suprême, omniprésence de la police et de ses indics, discours enflammés, organisations de masses disciplinées, grands rassemblements, matraquage religieux, propagande incessante, généralisation d’une langue de bois mortelle pour la pensée, projets pharaoniques qui exaltent le sentiment de puissance (exemple : la troisième plus grande mosquée du monde que Bouteflika va construire à Alger alors que le pays compte déjà plus de minarets que d’écoles), agression verbale contre les autres pays à propos de tout et de rien, vieux mythes remis à la mode du jour… Fortes de cela, les dictatures des pays arabes et musulmans se tiennent bien et ne font que forcir25. »
libre, le démocrate, l’homosexuel, etc.
(p.25) Illustrons notre propos par les activités de propagande d’un personnage désormais bien connu, Roger Garaudy (né en 1913), intellectuel engagé qui n’a cessé de mettre son statut de « philosophe » au service de causes totalitaires, du communisme à l’islam politique « révolutionnaire », et marie désormais la judéophobie à l’hespérophobie47. Garaudy donc, retrouvant les accents tiers-mondistes de sa période stalinienne, dans un long pamphlet intitulé Le Terrorisme occidental, se félicite de ce que les (p.26) États-Unis rencontrent « de plus en plus de résistance (…) dans leur entreprise de « mondialisation », c’est-à-dire de colonisation étendue à l’échelle mondiale et au profit d’un seul colonialiste48. » Marginalisé en France depuis la parution de son pamphlet négationniste, Les Mythes fondateurs de la politique israélienne, à la fin de 199549, l’ex-stalinien converti à l’islam est désormais fêté comme un maître à penser dans le monde musulman, qu’il a largement initié aux formules élémentaires du négationnisme5« . Il y incarne l’intellectuel occidental parfait pour les ennemis de l’Occident se réclamant de l’islam : outre sa conversion montrant qu’il a choisi « la religion naturelle de l’homme51 », il fait profession de dénoncer les États-Unis et Israël, et offre à ceux qui veulent détruire Israël un semblant d’arme absolue, la réduction du génocide nazi des Juifs d’Europe à un « mensonge de propagande » qui aurait notamment légitimé la création de l’État d’Israël. Lorsque le dangereux illuminé qu’est le président iranien Mahmoud Ahmadinejad dénonce le « mythe du massacre des Juifs52 » et en conclut que l’État d’Israël, n’ayant pas « droit à l’existence53 », doit être « rayé de la surface de la terre » – selon l’expression de l’ayatollah Ruhollah Khomeyni54 -, il se montre bon disciple de Garaudy.
Les plus radicaux des ennemis de l’occidentalisation ou, si l’on préfère, de l’« occidentalisme », idéologues islamistes ou, en France tout particulièrement5-^, théoriciens du néo-tiers-mondisme – qu’ils soient proches des milieux « altermondialistes » ou des néo-communistes, ou qu’ils appartiennent à la mouvance « Nouvelle droite56 » -, imaginent l’occidentalisation comme une américanisation. Il faut ici souligner le fait que la France, alors qu’elle n’a jamais été en guerre avec les Etats-Unis, est peut-être le pays occidental où « l’antiaméricanisme a été, et demeure, le plus vif », comme l’a noté Michel Winock57. Une étude portant sur les manuels scolaires français des années 2000 montre qu’ils diffusent massivement les éléments d’une vision du monde antiaméricaine, par laquelle tous les malheurs du monde sont attribués aux agissements criminels, « impérialistes » ou simplement irresponsables de la « puissance américaine58 ». Opinion dominante d’hier et d’aujourd’hui, l’antiaméricanisme risque ainsi d’être « la « bien-pensance » de demain59 ». Il faut s’interroger sur un autre paradoxe tragique. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la puissance hégémonique est incarnée par une société qui défend la liberté, c’est-à-dire qui se soucie du respect et de la protection des droits individuels. Or c’est précisément cette société, la nation américaine, qui fait l’objet d’une haine universelle, et donne une figure à l’objet de la haine.
(p.29) En novembre 2004, Chavez a rencontré en Iran • Ahmadinejad, lorsque ce dernier était maire de Téhéran. Après l’arrivée au pouvoir, en juin 2005, du démagogue islamiste, Chavez a été l’un des premiers chefs d’État à le soutenir. Le fait que Ahmadinejad ait appelé à la destruction de l’État d’Israël (« rayer Israël de la carte78 ») tout en dénonçant « le mythe de l’Holocauste » n’a nullement gêné le chef national-populiste vénézuélien79. En 2006 et 2007, les deux présidents ont pris des positions communes sur un certain nombre d’enjeux géopolitiques. Nombreux sont les intellectuels occidentaux d’extrême gauche qui se montrent fascinés par le président Hugo Chavez, militaire putschiste et démagogue autoritaire, ami de Saddam Hussein et de Fidel Castro, ses modèles historiques, et ses maîtres en matière de rhétorique antiaméricaine. Ces intellectuels saisis par la haine de soi répètent à l’envi le slogan du « déclin de l’Amérique », mécaniquement lancé toutes les fois que les États-Unis traversent une crise, alors même ^qu’une analyse froide des faits montre le dynamisme incomparable des États-Unis dans la plupart des domaines, de l’économie à la recherche scientifique, et que les experts les plus autorisés, tel Bruno Tertrais, pensent « qu’aucun pays ne sera en mesure de contester la prééminence américaine avant plusieurs décennies80 ». Au discours « antiimpérialiste » de la « résistance » à « l’oppression » s’ajoute, dans la rhétorique tiers-mondiste du président-démagogue, l’utopie communiste des « lendemains qui chantent », après la « libération ». En visite à Damas, chez son « ami » le dictateur Bachar al-Assad, Chavez a déclaré le 30 août 2006 que le Venezuela et la Syrie allaient « construire un nouveau monde libéré de la domination américaine ». Vision enthousiasmante de l’avenir aux yeux des intellectuels, d’extrême gauche et d’extrême droite, fermement décidés à « résister » à « l’empire américain », en faisant tout pour précipiter sa « chute », jugée fatale par un certain nombre d’intellectuels-prophètes. Le citoyen français Dieudonné M’Bala M’Bala, connu pour sa -dénonciation litanique de « l’axe américano-sioniste81 », a également rencontré le président Chavez à Damas, le 30 août 2006, occasion d’« échanger leur émotion face aux destructions opérées par Tsahal au Liban ». Au cours de l’été 2007, la coopération nucléaire secrète entre la Syrie et la Corée du Nord a été rendue publique82. Elle s’ajoute à l’aide militaire fournie par l’Iran, dont bénéficie également le Hezbollah libanais.
(p.30) Le multiculturalisme, ou le cheval de Troie de l’islamisme
II faut s’interroger sur un paradoxe dont les conséquences géopolitiques peuvent être considérables : un pourcentage significatif des populations de culture musulmane installées dans les pays occidentaux se montre hostile à la civilisation occidentale et manifeste une certaine empathie à l’égard des milieux jihadistes. C’est dans les pays qui ont institutionnalisé le multiculturalisme, donc inscrit dans la loi le principe du respect inconditionnel (p.31) des « identités culturelles », que l’opinion musulmane s’aligne le plus sur les positions islamistes. Les promoteurs de l’idée d’une « citoyenneté post-nationale » ont par ailleurs fortement contribué à légitimer le multiculturalisme comme forme de « politique de la reconnaissance ». La version la plus radicale du multiculturalisme est illustrée par la politique néerlandaise de « pilarisation », présentée comme un moyen de garantir la tolérance à l’égard des religions, en accordant un système éducatif séparé, des services sociaux distincts, des médias et des syndicats différents aux catholiques, aux protestants et aux communautés sécularisées. Jusqu’au début des années 2000, les gouvernements néerlandais successifs ont fait leur la doctrine selon laquelle le meilleur moyen de favoriser l’intégration des populations issues de l’immigration était d’encourager les immigrés à « maintenir leur propre culture85 ». Ils ont facilité ce « maintien » des identités culturelles d’origine par tout un arsenal de politiques de redistribution visant les « minorités culturelles » reconnues86. Même si la question de savoir si les musulmans constituent un « pilier » séparé est restée controversée, c’est un fait que les Pays-Bas se sont montrés plus volontaristes que d’autres pays pour accorder aux musulmans des écoles distinctes87. Le choc provoqué par l’assassinat du leader politique Pim Fortuyn (6 mai 2002)88, suivi par celui du cinéaste Théo Van Gogh (1er novembre 2004)89, l’un et l’autre engagés dans un combat contre ce qu’ils pensaient être « l’islamisation » de leur pays, a fait prendre conscience aux Néerlandais des limites et surtout des effets pervers du multiculturalisme, terrain privilégié pour la propagande islamiste.
La Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Canada sont parmi les pays -occidentaux les plus touchés par une islamisation fondamentaliste intense. Le multiculturalisme modéré existant en Grande-Bretagne a été défini en 1966, non sans un certain angélisme, par Roy Jenkins, alors secrétaire du Home Office, comme « la diversité culturelle, couplée à l’égalité des chances, dans une atmosphère de tolérance mutuelle90 ». Après les attentats islamistes de Londres (juillet 2005), les Britanniques ont à leur tour pris conscience des dangers présentés par le multiculturalisme à l’époque du terrorisme jihadiste global. L’angélisme différentialiste ne devrait plus être à l’ordre du jour. Dans une étude d’une exceptionnelle lucidité, « Atmosphère suffocante dans le Londonistan », publiée en juin 2006, le politologue Ernst Hillebrand montre non seulement que le multiculturalisme britannique a totalement échoué, mais encore qu’il a favorisé l’emprise islamiste sur les musulmans vivant en Grande-Bretagne. Le constat est saisissant : « 40 % des musulmans vivant en Grande-Bretagne souhaitent -l’application de la Chari’a dans certaines parties du pays. 32 % pensent que les musulmans devraient s’engager pour mettre fin à la civilisation occidentale, « décadente et amorale ». 20 % disent comprendre les motivations des responsables des attentats du métro de Londres le 7 juillet 2005. Dans le même temps, seuls 17 % des non-musulmans pensent que musulmans et non-musulmans peuvent vivre ensemble pacifiquement de façon durable. Et un quart de l’électorat peut s’imaginer votant un jour pour un parti d’extrême droite ; bienvenue en Grande-Bretagne, dans une société qualifiée par le British Council de « riche d’une grande diversité, ouverte,
(p.32) multiculturelle ». Alors que les autorités persistent à diffuser des messages glorieux, les attentats de Londres ont crûment révélé une réalité qui n’avait pu échapper, auparavant déjà, à tout observateur attentif: le vaste échec du multiculturalisme britannique, du moins en ce qui concerne l’intégration des musulmans91. »
Les défenseurs d’un multiculturalisme institutionnel, lorsqu’ils professent un relativisme culturel radical, sont le plus souvent des ennemis déclarés de l’Occident, dénoncé comme incarnation d’un judéo-christianisme qui, par son intolérance et son « impérialisme », serait une machine à détruire les « cultures ». Comme l’a justement remarqué Élie Barnavi, « le multiculturalisme est un leurre », qui continue cependant de séduire nombre d’intellectuels et d’homme politiques en Europe. Le multiculturalisme se fonde implicitement sur un essentialisme culturel qui mine les fondements de tout ordre politique : « On ne bâtit pas une société digne de ce nom, ce qui implique une langue dans laquelle on puisse se comprendre, un minimum de culture commune, une mesure de mémoire partagée, en enfermant les gens dans leur propre langue, leur propre culture et leur propre mémoire92. » Le multiculturalisme institutionnel, c’est-à-dire le multicommunautarisme, revient à transformer le droit à la différence en un devoir d’appartenance ordonné à une identité d’origine supposée et imposée93. La conséquence de ce culte de la diversité culturelle est la fragmentation conflictuelle de l’espace public, l’individualisation négative, la généralisation normative des ségrégations, l’accroissement de la défiance entre les groupes séparés et, pour finir, la destruction de la vie civique, mettant en danger le régime démocratique.
Cette pathologie sociale peut être analysée sur la base du modèle d’intelligibilité construit par Robert Putnam dans les années 1990 et mis à l’épreuve au cours des années 2000, selon lequel le « capital social », soit « les réseaux qui relient entre eux les membres d’une société et les normes de réciprocité et de confiance qui en découlent94 », tend à décliner lorsque s’accroît la diversité ethnique et culturelle. Putnam a étudié ce qu’il appelle la « diversité ethnique » aux États-Unis en référence aux quatre groupes retenus par le recensement nord-américain : les Hispaniques, les Blancs non hispaniques, les Noirs non hispaniques et les Asiatiques. Ces catégories dites « ethniques » ou « raciales » sont, en fait, tout autant culturelles. Dans un article retentissant publié en juin 200795, le sociologue et politiste en arrive à formuler un certain nombre de conclusions inattendues de la part d’un « progressiste », et qu’on peut réduire à quatre thèses : 1° plus la diversité ethnique grandit, plus la confiance entre les individus s’affaiblit ; 2° dans les communautés les plus diversifiées, les individus ont moins confiance en leurs voisins ; 3° dans ces mêmes communautés, non seulement la confiance interethnique est plus faible qu’ailleurs, mais la confiance intra-ethnique l’est aussi ; 4° la diversité ethnique conduit à l’anomie et à l’isolement social. Il va de soi que de telles conclusions, établies à partir d’une enquête conduite d’une manière exemplairement scientifique sur un échantillon d’environ 30 000 individus, ne peuvent qu’affoler les adeptes du « politiquement correct » en matière d’immigration (célébrée comme une « richesse ») et les partisans du multiculturalisme (p.33) (présenté comme la voie unique vers le nouvel avenir radieux). Il reste à étudier d’une façon comparative d’autres sociétés démocratiques travaillées par les effets négatifs d’un excès de diversité interne, qu’il s’agisse des Pays-Bas, de la Belgique, des pays Scandinaves, de l’Allemagne ou de la Grande-Bretagne, sans oublier certains pays d’Europe méditerranéenne. L’horizon ainsi dessiné est plutôt sombre : si les thèses de Putnam sont fondées, universalisables et ainsi dotées d’une valeur prévisionnelle, alors le surgissement de sociétés multiraciales et multiculturelles que favorise l’ouverture démocratique aura pour conséquences majeures le déclin de l’engagement civique et le délitement du lien social, remplacés par la défiance ou l’indifférence. Trop de diversité, en provoquant l’érosion de la confiance, tuerait la tolérance et ruinerait la solidarité sociale comme l’esprit civique. Dès lors, l’offre islamiste, centrée sur l’identité et la solidarité de groupe, deviendrait particulièrement attractive aux yeux des « communautés » diverses de culture musulmane. C’est dans ce contexte convulsif qui s’annonce que les réseaux islamistes risquent de prendre leur essor en tout territoire situé hors de la « demeure de l’islam » (dar aï-islam}.
Les Juifs, ennemis sataniques, et leurs alliés
L’offensive islamiste contre l’Occident, qu’elle se limite à la pénétration culturelle accompagnée de pression politique ou qu’elle consiste à pratiquer le Jihad sur le mode des attentats terroristes, se caractérise par la place centrale qu’elle accorde, et ce de façon explicite, à la lutte contre les juifs, imaginés comme les « maîtres du monde », et des maîtres foncièrement illégitimes, stigmatisés comme « sataniques ». C’est pourquoi, lorsqu’on se propose d’analyser la réalité de l’anti-occidentalisme contemporain, on est d’emblée frappé par l’importance des thématiques antijuives inscrites dans le discours qui le porte. La haine de l’Occident semble même n’être qu’une extension de la haine des Juifs. Comme si les ennemis de l’Occident postulaient que l’Occident judéo-chrétien qu’ils haïssent était avant tout un Occident juif ou « enjuivé » (pour user d’un qualificatif mis en circulation par le vieil antisémitisme). On est ainsi conduit à étudier l’occidentalophobie militante d’aujourd’hui comme une forme de judéo-phobie mythiquement élargie, comme une judéophobie généralisée à toutes les figures de l’ennemi, à commencer par les « infidèles », catégorie incluant, pour les théoriciens de l’islamisme radical, les « peuples du Livre », Juifs et chrétiens. Ce qui caractérise la mouvance jihadiste internationale incarnée par Al-Qaida, dont Oussama Ben Laden est devenu la figure tutélaire, c’est le primat qu’elle accorde au Jihad et les interprétations ou les justifications que ses leaders en donnent96. L’épître d’Al-Qaida intitulée « Qui est l’ennemi et par qui commencer ? » est fort explicite sur la question. La première catégorie d’ennemis distinguée, regroupant les ennemis « les plus dangereux », donc à combattre prioritairement, est ainsi (p.34) décrite : « – Les Juifs (et il ne faut pas faire une distinction entre les Juifs et les Sionistes ni entre les Juifs de Palestine et les Juifs de l’étranger).
– Les Chrétiens d’Occident qui dirigent la nouvelle croisade, c’est-à-dire l’Amérique et l’Europe occidentale (les protestants et les catholiques).
– Les Chrétiens d’Orient qu’ils soient arabes ou russes (orthodoxes), ainsi que les Indiens, les polythéistes et les chiites97. »
Parallèlement, la judéophobie de tradition occidentale a subi elle-même des transformations significatives, dansée nouveau contexte géopolitique instauré par la création, en 1948, de l’État d’Israël et le refus arabo-musulman de son existence, marqué par une série de guerres toutes gagnées par Israël, condition impérative de sa survie98, mais nourrissant en même temps un ressentiment de masse stimulé par la propagande de dirigeants politiques aussi incompétents que démagogues. Ces victoires successives d’Israël ont été exploitées par tous les ennemis d’Israël comme la marque d’une « arrogance » innée et d’une tendance naturelle à l’« impérialisme ». L’antisionisme d’obédience nationaliste a joué sur le sentiment d’« humiliation » ou celui de la fierté blessée, largement partagé dans la culture arabo-musulmane, nourrissant ainsi un fort ressentiment contre « les sionistes ». Corrélativement, les vaincus du monde arabo-musulman ont été (et sont) globalement présentés comme des « victimes », représentation polémique que leur discours de propagande a renforcée en mettant en scène la figure du Palestinien opprimé et spolié, censée incarner l’Arabe-victime face à l’ennemi satanique, « le Sioniste » ou « le Juif ». Les idéologues des pays arabes ont su instrumentaliser ce statut victimaire pour justifier les carences de leurs dirigeants et donner une explication mythique des malheurs de leurs peuples. Instrument privilégié de manipulation de l’opinion, l’antisionisme est ainsi devenu, pour les dirigeants des pays arabo-musulmans, un indispensable moyen de gouverner. Encore faut-il tenir compte de la montée, au cours des années 1990 et 2000, d’un anti-occidentalisme alimenté par la présentation systématique de la politique étrangère américaine comme brutalement « impérialiste » et grossièrement irresponsable. Or le couplage qui s’est opéré entre l’antisionisme et l’anti-occidentalisme a provoqué une transformation de l’image négative de l’entité mythique qu’on pourrait baptiser le « Juif-Sioniste ».
Au cours des cinquante dernières années du XXe siècle, le mythe répulsif visant le peuple juif s’est en effet métamorphosé sur la base d’une inversion de son image : de « race maudite » et corruptrice venue d’Orient, « le Juif » s’est transformé en « entité sioniste » incarnant l’Occident impérialiste. La rhétorique de combat de l’islamisme radical est ici un bon témoin, notamment dans sa variante chiite à l’iranienne : la dénonciation diabolisante du « Grand Satan » (les États-Unis, ou l’Amérique) va de pair avec celle du « Petit Satan » (Israël). Du côté sunnite, les idéologues islamistes ne sont pas en reste en matière de satanisation. L’Égyptien Abdul Halim Mahmoud, directeur de l’Académie de recherche islamique, affirmait dans un ouvrage sur le Jihad paru en 1974 : « Allah ordonne aux musulmans de combattre les amis de Satan où qu’ils se trouvent. Parmi les amis de Satan – en fait, parmi les principaux amis de Satan à notre époque — se trouvent les Juifs99. » Si « le Juif» incarne toujours la figure de Satan (p.35) – emprunt à l’antijudaïsme chrétien -, ce n’est plus en tant que « Sémite », mais en tant que suppôt de l’Occident perçu comme ennemi de l’islam et des musulmans. Le peuple juif, dans l’imaginaire antijuif hégémonique, s’est ainsi occidentalisé, au point de se confondre soit avec l’un des rameaux de la « race blanche » dominatrice et arrogante, soit avec la pointe avancée de l’Occident chrétien, et perçu en conséquence comme judéo-chrétien. En s’occidentalisant, le peuple juif s’est « désémitisé » aux yeux des plus puissants de ses nouveaux ennemis. Et il s’est en même temps « sionisé », selon le postulat : « Tous les Juifs soutiennent Israël100. » Bref, le type négatif du «Juif» a été reconstruit de manière à ce qu’il représente un modèle réduit de tout ce qui est rejeté et détesté dans l’Occident. C’est pourquoi les chrétiens d’Orient, après les Juifs orientaux, sont chassés des terres d’islam » ». On évalue à environ 900 000 le nombre des Juifs expulsés de diverses manières (massacres compris) des pays arabo-musulmans dans lesquels ils étaient pourtant installés depuis longtemps, y abandonnant tous leurs biens. Sous la pression islamiste, le commandement coranique s’est réalisé par un nettoyage ethno-religieux qui s’est accéléré après la création de l’État d’Israël : « Combattez (…) ceux qui, parmi les gens du Livre, ne pratiquent pas la vraie religion. » En publiant au début des années 1950 son livre intitulé Notre combat contre les Juifs – ouvrage de référence pour la plupart des mouvements islamistes -, l’idéologue fondamentaliste égyptien Sayyid Qutb (1906-1966) désignait clairement l’ennemi, sans l’habiller du vocabulaire antisioniste ou antiimpérialiste102. Dans son pamphlet, supposant qu’il y a une « conspiration judéo-chrétienne contre l’Islam », Qutb affirme que, face à « ceux qui ont usurpé la souveraineté d’Allah sur la terre », l’islam doit procéder « à leur destruction afin de libérer les hommes de leur pouvoir », et ajoute que « le combat libérateur du Jihad ne prendra pas fin tant que la religion d’Allah ne sera pas la seule103 ». Qutb est l’idéologue islamiste qui a placé le Jihad au cœur de l’islam en même temps qu’il désignait l’Amérique et les Juifs comme les ennemis à combattre prioritairement104. Dans la vision islamiste radicale, Juifs et chrétiens font l’objet d’une seule et même haine, visant les Occidentaux dénoncés comme pervertis et pervertisseurs. Mais le pire des Occidentaux, c’est désormais «le Juif» ou «le sioniste». Dans le monde judéo-chrétien satanisé par les islamistes et leurs alliés comme camp des « judéo-croisés » ou des « américano-sionistes », les Juifs représentent à la fois une avant-garde visible (Israël) et une puissance manipulatrice occulte, les « maîtres du monde », qui, dit-on, « dirigent l’Amérique », voire la « politique mondiale ». L’antisionisme radical va de pair avec l’antiaméricanisme, et celui-ci n’est qu’une synecdoque d’un anti-occidentalisme rabique. Telle est la grande transformation qui s’est produite au cours du dernier demi-siècle dans la représentation du Juif : le peuple juif a été désorientalisé ou désémitisé, pour être radicalement occidentalisé.
(p.36) Les nouveaux judéophobes ne sont pas antijuifs comme Drumont ou Maurras, Fritsch ou Dùhring, Goebbels ou Hitler ont pu l’être. Ils le sont autrement. Ils expriment leur haine des Juifs avec d’autres mots (mais pas toujours), reformulent les vieux thèmes d’accusation, font jouer des représentations nouvelles (notamment autour d’Israël et du sionisme), donnent de nouveaux récits de légitimation de leurs passions négatives, prônent des « solutions » inédites, et en général refusent avec vigueur de se dire « antisémites », voire prétendent lutter contre « le racisme et l’antisémitisme ». Ce qui n’est pas dépourvu d’une certaine logique, au moins d’ordre sémantique, dès lors que les Juifs ne sont plus perçus comme des « Sémites », et que des idéologues néo-communistes ou tiers-mondistes prétendent que le « nouvel antisémitisme » vise principalement les Arabes, en tant qu’immigrés ou en tant que musulmans – et, au Proche-Orient, en tant que Palestiniens. Certains théoriciens d’extrême gauche offrent un modèle sensiblement différent, en appelant confusément « nouvel antisémitisme » un système d’exclusion dont les deux « composantes » faisant couple seraient l’arabophobie (et/ou l’islamophobie109) et la judéophobie (ou l’« antijudaïsme »)1!0. Si le « politiquement correct » d’extrême gauche est ainsi scrupuleusement respecté, c’est sur la base d’une falsification des (p.37) faits, d’autant plus pernicieuse qu’elle n’est pas toujours volontaire ni même consciente. Quoi qu’il en soit, grâce à cette opération, la tâche des antiracistes institutionnels se simplifie et le slogan de la « solidarité dans les luttes » s’applique aisément : soit sous la figure « Juifs et Arabes un seul combat », soit sous cette autre : « Juifs et musulmans un seul et même ennemi. » La déréalisation des conflits (judéo-arabe et judéo-musulman) atteint ici des sommets, mais l’important est ailleurs, dans le gain symbolique obtenu : l’internationalisme prolétarien se survit dans la fiction de la solidarité des « victimes du racisme » ou du prétendu « nouvel antisémitisme » à double cible. La symbolique révolutionnaire est sauve. C’est dans cet espace du politiquement correct d’extrême gauche, centré sur la défense inconditionnelle de certaines catégories victimaires (Palestiniens, immigrés d’origine extra-européenne, « sans-papiers », musulmans, etc.), que prend son vrai sens l’usage polémique du mot « islamophobie » qui, au contraire du mot « arabophobie », permet de construire une ceinture de sécurité autour de tout ce qui concerne l’islam. « Islamophobie » fonctionne comme une catégorie d’amalgame, d’une part en effaçant les limites entre les comportements exclusionnaires visant respectivement les musulmans en général, les Arabo-musulmans et les immigrés d’origine maghrébine (ou turque, pakistanaise, etc.) de confession musulmane, d’autre part en mélangeant ce qui est de l’ordre du légitime examen critique d’une culture religieuse et ce qui relève de la volonté de stigmatiser, de discriminer, d’exclure. En accusant mécaniquement d’islamophobie toute personne procédant à un examen critique de l’islam, de ses dogmes comme de ses dérives politiques, un pseudo-antiracisme confond volontairement la critique avec le blasphème, et, tout en lançant des campagnes médiatiques contre « l’islamophobie », propose de légiférer afin d’interdire cette dernière sous peine de sanctions pénales. La dénonciation de « l’islamophobie » est une machine de guerre culturelle.
Dans la construction de leur code culturel refondu, c’est-à-dire dans l’élaboration de leur nouveau langage antijuif, les judéophobes contemporains ont bâti sur la base de la démonisation du « sionisme » et d’Israël. Diaboliser la « race juive » ou « sémitique » comme étrangère et dangereuse n’est plus de saison. Il faut désormais construire les « sionistes » en tant que criminels contre l’humanité ou « racistes ». L’antijuif de notre temps ne s’affirme plus « raciste », il dénonce au contraire « le racisme » comme il condamne « l’islamophobie » et, en stigmatisant les « sionistes » en tant que « racistes », il s’affirme « antiraciste » et « pro-palestinien ». Les antijuifs ont retrouvé le chemin de la bonne conscience. Une page psycho-historique est tournée, celle de l’après-guerre, qui aura duré presque un demi-siècle. Chez les Européens non juifs, le « devoir de mémoire » n’est plus porté par la mauvaise conscience née du sens d’une terrible responsabilité historique. Seuls demeurent les rituels des commémorations officielles. Dans les nouvelles générations, malgré les efforts de nombreux enseignants, il ne reste plus rien du sentiment de culpabilité ni de la mauvaise conscience provoqués par le génocide nazi des Juifs d’Europe. Le processus de dissociation de la mémoire et de l’histoire était assurément inévitable. Mais ses conséquences sont imprévisibles. Cet évanouissement de la culpabilité ne conclut pas nécessairement à la judéophobie à visage serein, mais il lui ouvre la voie, la rend de nouveau possible.
(p.41) La haine de soi se développe suivant deux orientations : d’une part, l’identification avec le groupe majoritaire, ce qui définit le conformisme social, et, d’autre part, l’identification avec l’agresseur ou l’ennemi, faisant surgir le type du « traître » ou du «collaborateur». Le cas du «Juif non juif» (voire anti-juif) américain Noam Chomsky ou celui du Français anti-occidental Roger Garaudy sont exemplaires d’un telle dérive. Le premier, qui a professionnalisé depuis les années 1960 la dénonciation des méfaits de « l’impérialisme américain » (devenu récemment « l’empire américain »), s’est lancé dans le combat idéologique radical contre Israël et s’est montré complaisant à l’égard du pape du négationnisme, Robert Faurisson132. Le second, après s’être construit une image d’humaniste sans frontières, s’est converti d’abord à l’islam, lancé ensuite dans la propagande « antisioniste », pour finir par faire cause commune avec les milieux négationnistes, accueilli comme un prophète en Iran comme dans le monde arabo-islamique.
(p.43) Le 12 septembre 2007, Al-Qaida a mis à prix la tête du caricaturiste suédois coupable d’avoir dessiné le prophète Mahomet avec un corps de chien quelques semaines auparavant. Abou Omar al-Bagdadi, le chef d’Al-Qaida en Irak, a offert 100 000 dollars pour l’assassinat de Lars Vilks, ainsi que 50 000 dollars supplémentaires « s’il est égorgé comme un agneau ». Ce que les islamistes, leurs alliés et leurs sympathisants appellent l’« islamo-phobie », ou la « diffamation religieuse », semble être devenu le péché suprême, la faute impardonnable. Des militants et des intellectuels engagés leur emboîtent le pas, et affirment que l’« islamophobie » représente la principale ou la plus dangereuse forme de « racisme ». C’est là une stratégie d’intimidation dont la mise en œuvre a commencé avec la fatwa proclamée le 14 février 1989 par l’ayatollah Khomeyni contre l’écrivain Salman Rushdie, coupable à la fois d’être l’auteur des Versets sataniques (1988), livre jugé « blasphématoire » envers l’islam, et d’être un apostat141. L’écrivain et les éditeurs du livre censé être « opposé à l’islam, au Prophète et au Coran » furent ainsi condamnés à mort par le dictateur intégriste : « J’appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu’ils se trouvent, afin que personne n’insulte les saintetés islamiques. » Pour les islamistes, le péché d’« islamophobie » mérite la mort. Les agitateurs islamistes (p.44) en prennent prétexte pour provoquer des incidents ou des émeutes, lesquelles font des morts et des blessés. Ce sont là autant d’avertissements lancés aux Occidentaux, et plus particulièrement aux Européens, plus perméables à l’islamisation que les Américains. De l’affaire Rushdie à l’affaire des caricatures danoises (février 2006), sans oublier la campagne contre Benoît XVI (septembre 2006)’42, un même message est lancé aux Occidentaux : « Vous n’êtes plus libres de dire ce que vous pensez de l’islam, du Prophète et du Coran. » Voilà qui doit nous conduire à une interrogation portant à la fois sur la lutte contre « le racisme » et sur la défense des droits de l’homme, ou plus exactement sur leurs défenseurs et les positions prises par ces derniers.
Voyage au centre du kadhafîsme : analyse d’un cas
Il est parfois bon de faire un détour par des contrées peu accueillantes, telle la Libye islamo-nationaliste, et, plutôt que d’admirer le décor, d’en explorer l’envers. Ce pourra être ici l’occasion de dresser un bilan de la défense des droits d’homme à la libyenne et d’explorer brièvement la nébuleuse « antisioniste » dans laquelle révolutionnaires communistes, gauchistes, nationalistes arabes, nazis et islamistes se donnent la main. Au pouvoir en Libye depuis 1969 à la suite d’un coup d’État, le colonel Mouammar Kadhafi, « le Guide éclairé », au terme supposé d’une longue carrière de soutien polymorphe au terrorisme international, semble être devenu respectable, après un abandon opportuniste, en décembre 2003, de son programme d’armes de destruction massive, devenu contre-productif. Les familles des victimes des divers attentats organisés par les services de la dictature kadhafienne ont été indemnisées, et, en mai 2006, la Libye a été retirée de la liste américaine des États soutenant le terrorisme143. Si l’ancien paria de la communauté internationale a fini par y être intégré, c’est grâce à l’argent du pétrole et aux contrats qu’il est censé assurer’44, mais aussi grâce à un savoir monnayable sur le terrorisme international. L’abandon affiché d’un programme nucléaire devenu encombrant et dangereux pour la survie de son régime est emblématique du tournant tactico-stratégique opéré par le « Guide de la Révolution » dans le nouveau contexte international créé par le 11 septembre 2001, l’intervention militaire américaine en Irak (2003) et la hausse du prix du brut145. Le régime kadhafien n’en reste pas moins une dictature militaro-policière où, en matière de droits de l’homme, l’emprisonnement des opposants rivalise avec l’usage de la torture. Il convient de rappeler que, dans l’affaire des infirmières bulgares et du médecin palestinien, accusés sans preuves et incarcérés dans des conditions terrifiantes durant huit ans avant d’être libérés à la suite d’un odieux marchandage, les autorités (p.45) libyennes n’ont pas hésité à recourir à la torture146. On oublie un peu vite la campagne lancée par Kadhafi dans le monde arabo-musulman au début des années 2000, qui consistait à présenter lesdites infirmières « étrangères » comme des agents du Mossad et de la CIA ayant accompli leur mission criminelle d’injecter le virus du sida à des enfants libyens de la ville de Benghazi sous prétexte de les immuniser. Dans cette accusation délirante d’empoisonnement d’enfants musulmans par un commando « américano-sioniste », le stratège cynique ne faisait qu’un avec le tenant de la pensée magique, s’inspirant des vieilles accusations médiévales d’empoisonnement des puits, sans parler d’une célèbre tentative d’empoisonnement du Prophète par l’une de ses épouses, juive bien entendu147. En outre, parmi les prisonniers politiques, on compte de nombreux « disparus », ainsi que le soulignent diverses organisations de défense des droits de l’homme depuis des années148. Bref, ce n’est un secret pour personne que le régime libyen bafoue les libertés fondamentales.
Or, ne se contentant ni de la puissance financière, ni du pouvoir absolu dans son pays, ni même d’être l’auteur de la Troisième Théorie Universelle (exposée dans Le Livre vert)149, le leader suprême de la « Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste », trahissant sa mégalomanie sans bornes, a créé en 1988-1989, avec son ami Jean Ziegler, sociologue suisse d’extrême gauche, le prix Kadhafi des droits de l’homme. L’expression résonne aussi étrangement qu’un prix Staline de la liberté ou qu’un prix Hitler de l’égalité et de la fraternité. Parmi les lauréats récents du prix Kadhafi, on remarque avec grand intérêt, mais sans surprise, les personnalités prestigieuses suivantes : Louis Farrakhan (1996), Fidel Castro (1998), Roger Garaudy (2002, avec d’autres), Hugo Châvez (2004) et Mahathir Mohamad (2005). En tant qu’intellectuel engagé, mais aussi en tant que « rapporteur spécial » ou « expert » dans certaines instances des Nations unies chargées des droits de l’homme150, le néomarxiste et « humaniste » Jean Ziegler, ami genevois de Tariq Ramadan et de Roger Garaudy – autres « humanistes » -, est souvent intervenu dans l’espace public, toujours dans un sens anti-occidental, tiers-mondiste et « antisioniste ». Au milieu des années 1970, Ziegler a ainsi formulé sa thèse fondamentale sur ce qui menace le genre humain : « Le système impérialiste mondial est (…) le mal absolu concret. Il domine et ravage aujourd’hui les trois quarts de l’humanité151. » Nulle trace d’antitotalitarisme ne risque d’être découverte chez cet universitaire engagé dans l’anti-impérialisme gnostique, pour qui le communisme reste une utopie aussi nécessaire qu’attractive, ce qui ne l’empêche nullement de se laisser fasciner par des dictateurs islamo-nationalistes, et de collaborer avec eux. On le rencontre par exemple au « conseil scientifique » de la revue Nord-Sud XXI, dirigée par un grand ami d’Hugo Châvez, Ahmed Ben Bella, qui, depuis les années 1950 durant lesquelles il était sous l’influence des milieux nassériens et de certains nationalistes arabes pro-nazis152, milite pour la destruction de l’État d’Israël153. Pour retracer fidèlement l’itinéraire « rouge- brun-vert » de Ben Bella, il faudrait faire plus qu’évoquer les relations entre ce dernier et le banquier suisse nazi François Genoud, ami du « Grand Mufti » de Jérusalem depuis 1936 et ennemi inconditionnel du « sionisme mondial ».
/ Genoud / Admirateur lui-même de Nasser, qu’il appréciait particulièrement pour sa lutte contre ‘le sionisme’ largement organisée par d’anciens nazis réfugiés en Egypte, (…)
(p.50) Pour mieux situer le régime kadhafiste, il faut rappeler d’abord que son Guide suprême a toujours refusé, à l’instar de l’Iran et de la Syrie, de reconnaître l’existence de l’État d’Israël, contre lequel la Libye est toujours officiellement en guerre. Son soutien polymorphe à la cause palestinienne n’était que l’expression la plus visible d’un antisionisme radical faisant feu de tout bois. Comme le roi Fayçal d’Arabie Saoudite, le colonel Kadhafi était connu pour offrir des exemplaires des Protocoles des Sages de Sion à ses hôtes de marque, et ce, dans la langue qu’ils étaient à même de comprendre183. Kadhafi a résumé sa position sur les Juifs et Israël dans un discours prononcé en décembre 1980 : « Le retour des Juifs en Palestine, la formation d’une nouvelle société impérialiste et raciste ne représente qu’un prétexte qui a entraîné le problème actuel du Moyen-Orient, qui mènera, sans doute, à une troisième guerre mondiale184. » II faut rappeler ensuite que le dictateur libyen continue de nier le génocide au Darfour, en suggérant qu’il s’agit pour l’essentiel d’une invention occidentale, ou d’une exagération confinant au mensonge de propagande. Quant au comportement de « l’homme » Kadhafi, célébré comme le « libérateur des femmes185 », le témoignage de la journaliste Memona Hintermann, victime en 1984 d’une tentative de viol de la part du « Frère Guide » menaçant de la « flinguer », montre qu’il s’apparente à celui du voyou ordinaire186. Dans un discours prononcé le 12 décembre 2007 à Paris, sur le thème « la situation des femmes dans le monde », le « Frère Guide » a dénoncé sans vergogne la « condition tragique » dans laquelle se trouvait selon lui « la femme européenne, obligée de faire parfois un travail dont elle ne veut pas ». Et de proposer ses services : «Je voudrais sauver la femme européenne qui se débat187. » On reconnaît là une variation sur le thème unique du discours kadhafien face à l’Europe : si seule la conversion à la « vraie religion », l’islam, peut sauver les Européens, seul le « Guide de la Révolution » peut sauver les Européennes. Parmi les thuriféraires présents, Mme Beyala s’est particulièrement distinguée par son commentaire : « II admire les femmes, il les a libérées et promues188. » C’est la jeune secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme, Rama Yade, qui a sauvé l’honneur de la France en déclarant dans une interview parue le jour de l’arrivée du dictateur, coïncidant avec la Journée internationale des Droits de l’Homme : « Le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n’est pas un paillasson sur lequel un dirigeant, terroriste ou non, peut venir s’essuyer les pieds du sang de ses forfaits189. » Mais, plus généralement, il convient de se demander si la méthode des échanges commerciaux, accompagnés de leçons en matière de droits de l’homme, avec les dictatures a des chances d’inciter ces dernières au respect des libertés fondamentales, ou si elle ne risque pas bien plutôt de leur fournir une légitimation démocratique, coupant l’herbe sous le pied à toute opposition (p.51) interne. Le romancier algérien Boualem Sansal, qui connaît de l’intérieur le fonctionnement des dictatures arabo-musulmanes, souligne les raisons de se montrer sceptique à l’égard des stratégies de coopération avec des régimes despotiques, en particulier avec celui de Kadhafi, ce « richissime bandit » : « Avec des régimes comme ceux de Bouteflika et Kadhafi, les démocraties occidentales ne peuvent pas grand-chose. Tout ce qu’elles diront et feront sera retourné contre elles et contre nous. Nos leaders sont de redoutables tennismen. Ils connaissent tous les coups pour détruire les balles en vol. Comme d’habitude, ils se dresseront sur leurs ergots et crieront : ingérence, colonialisme, néocolonialisme, impérialisme, atteinte à nos valeurs islamiques, lobby juif, etc. La menace terroriste ne les gêne pas plus que ça. En tout cas, ils veulent la gérer selon leurs vues et leurs besoins tactiques, loin du regard étranger. « Le terrorisme reste à définir », disait Kadhafi en Espagne. Bouteflika avait dit une chose similaire. La menace terroriste est pour eux pain bénit, elle leur permet de maintenir la société sous étroite surveillance et [de] ridiculiser ses prétentions démocratiques, toujours présentées comme susurrées par l’Occident dans le but d’affaiblir nos valeurs nationales190. »
Un certain angélisme régnant dans les diplomaties occidentales empêche de prendre la mesure de l’anti-occidentalisme, toujours mêlé d’« antisionisme », que les régimes despotiques instrumentalisent cyniquement pour se protéger de toutes les critiques internes et externes. Pour se faire une idée de la conception très particulière des « droits de l’homme » que partagent les autocrates comme Kadhafi et les idéologues néo-tiers-mondistes comme Ziegler, il suffit de rappeler le déchaînement de haine contre Israël et l’Occident qui a marqué la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, organisée à Durban du 31 août au 8 septembre 200l191. Les rapports préparatoires en vue d’une nouvelle conférence mondiale contre le racisme, prévue pour 2009, font craindre que Durban 2 soit pire que Durban l192, dont on sait qu’elle s’était transformée en meeting antijuif international, centré sur la dénonciation du « sionisme » comme « racisme ». D’autant que la Libye, devenue en janvier 2008 l’un des dix membres provisoires du Conseil de sécurité de l’ONU, est chargée de préparer la conférence de Durban 2. La Libye a été élue en effet à la présidence de cette conférence, Cuba en occupant la vice-présidence ainsi que la charge de rapporteur. Deux dictatures sont ainsi chargées de diriger les travaux d’une conférence mondiale contre le racisme : tel est le paradoxe tragi-comique de ce dernier avatar de l’antiracisme onusien. Le parti pris clairement anti-israélien de Durban 2 a été dévoilé par le fait que d’importantes réunions préparatoires ont été convoquées pendant les grandes fêtes juives, Pessah et Yom Kip-pour, ce qui doit empêcher les représentants israéliens d’y participer.
(p.64) Israël est ici clairement désigné comme « la tête de pont » du « Monde Oppresseur », c’est-à-dire de l’Occident judéo-chrétien, dans sa lutte à mort contre l’islam. Pour comprendre la tonalité guerrière d’un tel discours, il faut remonter à la source, l’enseignement de l’ayatollah Ruhollah Khomeyni qui, dans un texte datant de 1942, affirmait clairement que l’islam n’était pas une religion de pacifistes, et précisait ainsi son propos: «L’Islam veut conquérir le monde entier. (…) Ceux qui ne connaissent rien à l’Islam prétendent que l’Islam désapprouve la guerre. Ceux qui disent cela sont sans cervelle. L’Islam dit : tuez les incroyants (…). L’Islam dit : le bien n’existe que grâce à l’épée et dans l’ombre de l’épée62 ! » Après la Révolution islamique en Iran, Khomeyni prononce un discours à l’école théologique de Feyzigeh, le 24 août 1979, où il réaffirme sa thèse : « L’Islam a grandi dans le sang. (…) Le grand prophète de l’Islam tenait dans une main le Coran et dans l’autre l’épée63. »
(p.65) Le président-démagogue vénézuélien Hugo Châvez, le 20 septembre 2006, avait déjà donné l’exemple en brandissant, lors de son discours enflammé à l’Assemblée générale de l’ONU, l’un des pamphlets antiaméricains de Chomsky, Hegemony or Survival : America’s Quest for Global Dominant, en ajoutant : « Les Américains devraient lire ce livre plutôt que de regarder Supermanm ». Superman, ou ce détestable « héros juif ».
(p.69) L’islamisation ou la guerre
Le simplisme manichéen est ce qui rassemble les frères ennemis de l’islamisme radical : les wahhabites-salafistes et les chiites khomeynistes. Mais on aurait tort de négliger la part prise par les dirigeants politiques dans cette propagande islamo-centrique. Même le « laïque » Saddam Hussein avait intégré l’invocation d’Allah dans ses discours guerriers, au début des années 1990. Les pires dictateurs, de la Syrie à la Libye, recourent à la démagogie religieuse et se présentent comme des combattants de l’islam. C’est ainsi que le colonel-dictateur Kadhafi, dans un discours diffusé sur Al-Jazira le 10 avril 2006, annonce la victoire prochaine de l’islam en Europe, première étape de la marche inéluctable de l’Histoire vers l’islamisation du monde :
« II y a cinquante millions de musulmans en Europe. Des signes indiquent qu’Allah va faire triompher l’islam en Europe – sans sabres, sans fusils, sans conquête militaire. Les cinquante millions de musulmans d’Europe en feront un continent musulman en l’espace de quelques décennies. (…) Allah mobilise la nation musulmane de Turquie et l’ajoute à l’Union européenne. (…) Ce qui fait cinquante millions de musulmans en plus. Ça fera cent millions de musulmans en Europe. L’Albanie, qui est un pays musulman, fait déjà partie de l’Union européenne. (…) La Bosnie, qui est un pays musulman, fait déjà partie de l’Union européenne. Cinquante pour cent de ses citoyens sont musulmans. (…) L’Europe est dans de beaux draps, ainsi (p.70) que l’Amérique. Car ils vont devoir accepter de devenir islamiques et suivre le cours de l’histoire, ou bien déclarer la guerre aux musulmans74. »
(p.70) Et le président iranien de s’indigner devant le non-respect de la liberté d’expression dans certains pays occidentaux : « II y a actuellement quelques professeurs européens qui se trouvent en prison parce qu’ils ont écrit sur l’Holocauste et qu’ils mettent en avant un autre point de vue75. » Dans son discours du 25 septembre 2007 devant la 62e Assemblée générale des Nations unies, Ahmadinejad, en défenseur des libertés d’opinion et d’expression, reviendra sur la question : « Si des savants et des historiens donnent leur avis ou s’ils défendent des thèses différentes, ils sont jugés et emprisonnés. » Le recours à ce registre négationniste est inséparable, chez Ahmadinejad comme chez la plupart des leaders islamistes, d’un antisio nisme (p.71) radical, niant le droit à l’existence d’Israël, et d’un antiaméricanisme de facture anti-impérialiste.
(…) Les interventions du président iranien en Occident sont des formations de compromis, qui demandent à être interprétées, voire décryptées. Pour ce faire, il convient de les conforter avec les discours visant directement l’opinion iranienne intérieure, tels que le discours du 26 octobre 2005 prononcé à Téhéran devant 4 000 étudiants islamistes ou celui du 14 décembre 2005, prononcé lors d’un rassemblement dans la province du Sistan-Baloutchistan (sud-ouest de l’Iran) et retransmis en direct par la télévision d’État. Dans ce dernier discours, le président iranien dénonce une nouvelle fois le « mythe du massacre des Juifs » et propose de créer un État juif en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore en Alaska :
« Ils [les Occidentaux] ont inventé le mythe du massacre des Juifs et le placent au-dessus de Dieu, des religions et des prophètes. Si quelqu’un dans leurs pays met en cause Dieu, on ne lui dit rien, mais si quelqu’un nie le mythe du massacre des Juifs, les haut-parleurs sionistes et les gouvernements à la solde du sionisme commencent à vociférer. (…) Si vous dites vrai quand vous dites que vous avez massacré et brûlé six millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale (…), si vous avez commis ce massacre [ajoute-t-il à l’adresse des Occidentaux], pourquoi ce sont les Palestiniens qui doivent en payer le prix ? Pourquoi, sous prétexte de ce massacre, êtes-vous venus [vous, les Juifs] au cœur de la Palestine et du monde islamique? (…) Pourquoi avoir créé un régime sioniste factice ? (…) Notre proposition [aux Occidentaux] est celle-là : donnez un morceau de votre terre en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Alaska pour qu’ils [les Juifs] créent leur État. »
Ces déclarations négationnistes et « antisionistes » réitérées ont été précédées par des défilés militaires au cours desquels l’on pouvait voir sur les missiles des banderoles portant un message dénué d’ambiguïté : « Mort à Israël76. » On peut lire dans ces déclarations provocatrices l’expression (p.72) d’une double volonté de rupture et d’affrontement que la République islamique est la seule aujourd’hui, parmi les pays musulmans, à pouvoir assumer. L’Iran, l’un des premiers pays producteurs de pétrole, est en effet une puissance financière doublée d’une puissance militaire. Aux dires de certains spécialistes de géopolitique, l’Iran, à la fin de 2007, a considérablement avancé vers la maîtrise totale de l’enrichissement de l’uranium, technique indispensable pour la fabrication de l’arme atomique, prévue quant à elle au plus tard pour 201077. Les déclarations du président Ahma-dinejad montrent que l’Iran – ou plus exactement une partie de l’establishment iranien – ambitionne de prendre la tête dujihad contre l’Amérique et Israël. C’est pourquoi la dramatisation des enjeux, qui implique de ne pas condamner à l’avance une action militaire contre la dictature islamiste à l’iranienne, constitue la moins mauvaise des conduites tactico-stratégiques. La crédibilité des puissances opposées à la nucléarisation militaire de l’Iran est à ce prix. Les véritables amis de la paix ne sauraient être des rêveurs pacifistes, qui refusent de considérer la réalité des rapports de forces et de la confrontation des puissances. Le refus de voir l’ennemi est la pire des attitudes. Le vrai courage est de reconnaître la menace, et de désigner l’ennemi. Les vrais pacifiques, aujourd’hui comme hier, se montrent responsables en préparant la guerre, pour avoir une chance de pouvoir l’éviter. Le 24 septembre 2007, le président français Nicolas Sarkozy, à la tribune des Nations unies, a ramené au vrai débat, en rappelant que « tous les experts de toutes les parties du monde sont d’accord pour dire que [les Iraniens] travaillent sur l’arme nucléaire militaire ». Si l’on peut poser en principe que l’Iran, comme toute nation, a « droit à l’énergie nucléaire à des fins civiles », il va de soi que la dictature islamiste qui s’y est installée par la force et s’y maintient par la répression ne fait pas partie de la communauté des États de droit. Dès lors, la suspicion à son endroit est légitime, en particulier sur le dossier nucléaire. C’est pourquoi le président français peut légitimement affirmer qu’« en laissant l’Iran se doter de l’arme nucléaire, nous ferions courir un risque inacceptable à la stabilité de la région et du monde », et rappeler l’évidence qu’« il n’y aura pas de paix dans le monde si la communauté internationale n’a pas une volonté farouche de lutter contre le terrorisme » ou si elle « fait preuve de faiblesse face à la prolifération des armements nucléaires78 ».
(p.74) (…) l’islam, disons YOumma, ne recouvre plus, et ce, depuis plusieurs siècles, une civilisation. Ainsi que le rappelle Hamid Zanaz, « cette civilisation s’est arrêtée au XIIe siècle » : « Les musulmans n’ont pas attendu le colonialisme pour sombrer dans le chaos. Ils y étaient confortablement installés depuis le quinzième siècle87. » Or « la plupart des penseurs et des hommes politiques musulmans influents au XXe siècle ont justifié l’arriération culturelle, économique et politique en avançant la théorie du colonialisme et du complot judéo-chrétien88 », alors même qu’il est historiquement établi que la décadence a précédé le colonialisme tout en lui ouvrant la voie8y. L’islam a perdu depuis longtemps son identité civilisationnelle. Aujourd’hui, le monde musulman, devenu « une des banlieues du monde moderne », n’a plus d’autre identité qu’une opposition religieusement cimentée à l’Occident, objet d’un profond ressentiment, et certainement d’une « inquiétude mêlée d’envie911 ». S’il y a affrontement mondial, c’est entre la civilisation occidentale mondialisée – qu’il faut se garder d’idéaliser pour autant – et l’ensemble bariolé de ses ennemis, islamistes ou non, qui ne sauraient incarner une « civilisation ». Il n’empêche que ce sont les islamistes radicaux qui incitent à la guerre totale contre la civilisation occidentale.
(p.78) L’angélisme consiste ici à oublier le fait qu’alors même que nous refusons de désigner l’ennemi, c’est l’ennemi qui nous désigne. Nous pouvons alors nous résigner ou faire face. Mais pour affronter l’ennemi, il faut d’abord avoir le courage de le reconnaître, ensuite avoir suffisamment de confiance en soi pour prendre des décisions risquées. Dans son bel essai sur « les religions meurtrières », l’historien israélien Élie Barnavi n’hésite pas à lancer avec lucidité : « Une civilisation qui perd confiance en elle-même jusqu’à perdre le goût de se défendre entame sa décadence104. »
(p.79) La mythologisation négative des Juifs est loin d’être le fait des seuls islamistes révolutionnaires ou jihadistes, ce qui pose le redoutable problème de la force de diffusion ou de « contamination » de leurs thèmes105. Il convient sur ce point de lire le témoignage saisissant de Ayaan Hirsi Ali, jeune femme d’origine somalienne élevée dans la religion musulmane, réfugiée aux Pays-Bas où elle est devenue député. Après avoir collaboré à un film sur l’islam, Submission, réalisé par Théo Van Gogh, assassiné par un jeune musulman fanatique qui jugeait ce film « blasphématoire106 », cette musulmane insoumise, lucide et courageuse a été elle-même condamnée à mort par les islamistes, puis a dû subir une campagne politico-médiatique de dénigrement, ce qui l’a conduite à choisir l’exil pour une deuxième fois, et à partir aux États-Unis. Elle décrit sans fard l’endoctrinement pratiqué dans les milieux musulmans qu’elle a traversés ou observés : « La haine irrationnelle des Juifs et le dégoût des infidèles sont enseignés dans certaines écoles coraniques, répétés quotidiennement dans les mosquées. Et cela ne s’arrête pas là. Dans les livres, les articles et les cassettes, dans les médias, les Juifs sont représentés comme les artisans du Mal. J’ai moi-même expérimenté à quoi cet endoctrinement pouvait aboutir. Lorsque j’ai vu un Juif pour la première fois, je fus étonnée de ne voir qu’un homme normal, fait de chair et de sang107. »
Quant aux belles âmes affairées à minimiser la menace islamiste en en faisant une forme pathologique et ultra-minoritaire dans le monde musulman, et en s’indignant bruyamment des thèses de Samuel Hun-tington sur le « choc des civilisations », elles devraient méditer ces fortes et claires paroles de Wafa Sultan, psychologue arabo-américaine née en Syrie, au cours d’une interview diffusée par Al-Jazira le 21 février 2006 : « Ce sont les Musulmans qui ont déclenché le choc des civilisations [clash of dvilizations]. Le Prophète de l’Islam a déclaré: « J’ai reçu l’ordre de combattre ceux qui ne croient pas en Allah et en son Messager108. » En divisant la population entre Musulmans et non-Musulmans et en appelant à combattre les autres jusqu’à ce qu’ils adoptent leurs propres croyances, les Musulmans ont ouvert le conflit et déclenché la guerre. Les ouvrages et programmes islamiques regorgent d’appels au takjîr [« excommunication »] et au combat contre les Infidèles. (…) Seuls les musulmans défendent leurs croyances en brûlant des églises, en tuant, en détruisant des ambassades. Cette façon de faire ne donnera aucun fruit. Les musulmans doivent se demander ce qu’ils peuvent faire pour l’humanité avant d’exiger que l’humanité les respecte109. »
De son côté, l’écrivain Hamid Zanaz dresse un état des lieux sans complaisance du monde musulman : « À l’aube de ce troisième millénaire, la modernité n’a pas encore conquis les territoires de l’islam. La femme demeure toujours ennemie d’Allah et l’enfer, c’est toujours la laïcité. La terreur théologique règne davantage sur les esprits et les corps110. »
(p.86) Il s’ensuit qu’on ne saurait considérer que « l’antisémitisme » est fixé à droite plutôt qu’à gauche, qu’il est lié à la pensée réactionnaire plutôt qu’à la pensée progressiste, qu’il s’articule mieux avec la foi chrétienne qu’avec l’agnosticisme ou l’athéisme. Du point de vue de l’universalisme individualiste de type libéral, le peuple juif, survivance d’un passé tribal jugé dépassé, doit disparaître comme tel, et ce, au nom de la modernité ou du progrès, voire de la lutte contre la superstition et le fanatisme. Pour les traditionalistes, oscillant entre pensée réactionnaire et pensée conservatrice, les Juifs sont le symbole même de la modernité destructrice des ordres naturels, et, partant, leur « influence » est à combattre à tout prix. Les Juifs, dans le monde moderne, sont ainsi attaqués par les pôles idéologiques opposés. D’où l’ambiguïté de la figure du Juif aux yeux de ses ennemis : trop archaïque pour être supportable, trop moderne pour être tolérable.
(p.87)
C’est un fait historique que, dans le sillage de Voltaire et du baron d’Holbach, une judéophobie « progressiste » s’est constituée en se réclamant des idéaux des Lumières, puis de ceux de la Révolution française. Voilà qui nous interdit de nous montrer naïfs : l’universalisme des Lumières ne constitue pas l’arme absolue contre les passions antijuives.
CH 3 Le mouvement voltairien ou la juudéophobie des Lumières
(p.89) Partons de l’hypothèse formulée par Norman Cohn, reprise et reformulée par Robert I. Moore : « L’identification des Juifs comme ennemis particuliers du Christ, et par conséquent des chrétiens, a été la trame centrale, la trame la plus cruelle de l’antisémitisme européen1. » Cette hypothèse peut être réinterprétée dans une perspective généalogique, aboutissant à souligner l’importance de l’héritage moderne des stéréotypes antijuifs d’origine christiano-médiévale, voire à poser une continuité entre l’antijudaïsme chrétien et l’antisémitisme moderne, en faisant éventuellement appel au concept de sécularisation. On conçoit dès lors les formes modernes de la judéophobie comme les produits d’une sécularisation de l’antijudaïsme christiano-médiéval2. Ce paradigme explicatif, qui a montré sa fécondité, se heurte cependant à un certain nombre de faits historiques, qui concernent pour l’essentiel la judéophobie des Modernes, qui apparaît non seulement déchristianisée, mais encore constitutivement antichrétienne. Face à l’antijudaïsme de l’Église, à la fois originel et dominant, ce qu’il est convenu d’appeler l’antisémitisme des Lumières fait en effet figure d’exception ou de fait polémique. L’antijudaïsme s’y mêle à un virulent antichristianisme, lui-même lié à une critique radicale des croyances religieuses au nom de la Raison. Et il est difficile de distinguer, dans les écrits de la plupart des « philosophes » des Lumières, la visée proprement antijuive de la polémique anticléricale non moins que de la critique antireligieuse. Au siècle des Lumières, notamment chez Voltaire et le baron d’Holbach, la critique radicale des « superstitions » religieuses et du « fanatisme » qu’elles sont censées nourrir s’applique au judaïsme comme au christianisme3, et s’étend à l’islam4. C’est ainsi que se forme l’anti-judéo-christianisme moderne, qu’on peut aussi caractériser comme un « antisémitisme antichrétien5 », configuration judéophobe que les partisans du matérialisme scientiste, à la fois anticléricaux et athées militants, développeront dans la seconde moitié du siècle suivant, notamment dans une perspective socialiste, non sans intégrer des représentations racialistes6. Fadieï Lovsky voit dans « l’antisémitisme antichrétien de l’époque de Voltaire » la première figure historique de ce qu’il appelle « l’antisémitisme rationaliste », qu’il fait suivre de deux autres, qui ne cesseront d’interférer : tout d’abord, « l’antisémitisme social de l’école de Toussenel », lequel se réclame autant de Voltaire que de Fourier, et va se développer dans divers courants socialistes jusqu’à la fin du XIXe siècle7 ; ensuite, « l’antisémitisme pseudo-scientifique » lié à « l’apparition du mythe racial », centré sur l’opposition entre « Sémites » et « Aryens », « Indo-Européens » ou « Indo-Germains8 ». En se développant, la mythologie aryano-sémitique finira par se retourner contre les positions du rationalisme critique qui l’avaient rendue possible.
(p.90) Au commencement étaient Voltaire et d’Holbach
(…) Dans l’introduction de son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756), Voltaire esquisse une histoire du peuple juif où il ne cache pas ses appréciations ironiques et méprisantes sur cette « nation » :
« Il n’est pas bien étonnant que les peuples voisins se réunissent contre les Juifs, qui, dans l’esprit des peuples aveuglés, ne pouvaient passer que pour des brigands exécrables, et non pour les instruments sacrés de la vengeance divine et du futur salut du genre humain. (…) Ainsi les Juifs furent presque toujours subjugués ou esclaves. (…) Il y eut, du temps de Trajan, un tremblement de terre qui engloutit les plus belles villes de la Syrie. Les Juifs crurent que c’était le signal de la colère de Dieu contre les Romains. Ils se rassemblèrent, ils s’armèrent en Afrique et Chypre : une telle fureur les anima, qu’ils dévorèrent les membres des Romains égorgés par eux ; mais bientôt tous les coupables moururent dans les supplices. Ce qui restait fut animé de la même rage sous Adrien, quand Barchochébas, se disant leur messie, se mit à leur tête. Ce fanatisme fut étouffé dans des torrents de sang. Il est étonnant qu’il reste encore des Juifs. (…) Jamais les Juifs n’eurent aucun pays en propre, depuis Vespasien, excepté quelques bourgades dans les déserts de l’Arabie Heureuse, vers la mer Rouge. Mahomet fut d’abord obligé de les ménager ; mais à la fin il détruisit la petite domination qu’ils avaient établie au nord de La Mecque. C’est depuis Mahomet qu’ils ont cessé réellement de composer un corps de peuple. En suivant simplement le fil historique de la petite (p.91) nation juive, on voit qu’elle ne pouvait avoir une autre fin. Elle se vante elle-même d’être sortie d’Egypte comme une horde de voleurs, emportant tout ce qu’elle avait emprunté des Égyptiens : elle fait gloire de n’avoir jamais épargné ni la vieillesse, ni le sexe, ni l’enfance, dans les villages et dans les bourgs dont elle a pu s’emparer. Elle ose étaler une haine irréconciliable contre toutes les autres nations ; elle se révolte contre tous ses maîtres. Toujours superstitieuse, toujours avide du bien d’autrui, toujours barbare, rampante dans le malheur, et insolente dans la prospérité. Voilà ce que furent les Juifs aux yeux des Grecs et des Romains qui purent lire leurs livres ; mais, aux yeux des chrétiens éclairés par la foi, ils ont été nos précurseurs, ils nous ont préparé la voie, ils ont été les hérauts de la Providence. (…) Si Dieu avait exaucé toutes les prières de son peuple, il ne serait resté que des Juifs sur la terre, car ils détestaient toutes les nations, ils en étaient détestés ; et, en demandant sans cesse que Dieu exterminât tous ceux qu’ils haïssaient, ils semblaient demander la ruine de la terre entière15. »
Certains historiens des idées ont cru pouvoir expliquer la judéo-phobie virulente de Voltaire comme une conséquence de son antichristianisme radical : en s’attaquant à la Bible et aux anciens Hébreux16, qu’il lui est arrivé de présenter comme issus d’un groupe de lépreux expulsés d’Egypte (thème largement diffusé dans l’Antiquité17), Voltaire aurait visé en réalité le christianisme, dérivé du judaïsme18. Les Juifs auraient été pour lui coupables d’avoir fait à l’humanité ce cadeau empoisonné : le Christ. Comme l’a suggéré Jacques Maritain, dans cet antijudaïsme moderne qui s’affirme « au nom de la raison », puis « au nom de la race », il y a une profonde christophobie19. La judéophobie de Voltaire et de ses contemporains « philosophes » n’aurait été qu’une forme d’antichristianisme, un « chemin détourné20 » pour combattre l’Église. Thèse hautement discutable21, car les Juifs sont aussi visés en tant que tels par Voltaire, qui les caractérise comme « le plus abominable peuple de la terre22 ». Les Juifs, selon Voltaire (faisant parler un rabbin fictif), ne sont qu’un « peuple barbare, superstitieux, ignorant, absurde23 ». Dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire n’hésite pas à reprendre à son compte l’accusation de « molochisme » visant les Juifs, qui auraient selon lui régulièrement pratiqué des sacrifices d’enfants : « Cette vallée [du fils d’Hinnom, le haut lieu de Topheth] est un lieu affreux où il n’y a que des cailloux. C’est dans cette solitude horrible que les Juifs immolèrent leurs enfants à leur Dieu qu’ils appelaient alors Moloch. (…) Des doctes prétendent que c’était le seigneur du feu et que pour cette raison ils brûlaient leurs enfants dans le creux de l’idole même. C’était une grande statue de cuivre, aussi hideuse que les Juifs la pouvaient faire. Ils faisaient rougir cette statue à un grand feu, et ils jetaient leurs petits enfants dans le ventre de ce Dieu, comme nos cuisinières jettent des écrevisses vivantes dans l’eau bouillante de leurs chaudières24. »
(p.95) La judéophobie des Lumières a vraisemblablement été alimentée par les vues négatives de Spinoza sur le judaïsme, comme l’a suggéré Léon Poliakov. Le fait qu’un grand penseur rationaliste d’origine juive ait pu lancer des attaques aussi violentes contre la religion juive constituait, pour les « philosophes » du xvIIIe siècle, un argument puissant en faveur de la thèse que le judaïsme n’était « qu’une superstition grossière, et que le vieux Jéhovah n’était qu’un Dieu de haine49 ». Dans le Traité théologico-politique, en particulier, Spinoza attribue au peuple juif une haine aussi intense que spécifique visant les autres peuples, et croit pouvoir en expliquer l’apparition et la routinisation : « L’amour des Hébreux pour la patrie n’était donc pas un simple amour, c’était une piété, et cette piété comme cette haine des autres nations, le culte quotidien les échauffait et alimentait de telle sorte qu’elles durent devenir la nature même des Hébreux. Leur culte quotidien en effet n’était pas seulement entièrement différent des autres, ce qui les séparait du reste des hommes, il leur était absolument contraire. A l’égard de l’étranger, tous les jours couvert d’opprobre, dut naître dans leurs ârnes une haine l’emportant en fixité sur tout autre sentiment, une haine née de la dévotion, de la piété, crue elle-même pieuse ; ce qu’il y a de plus fort, de plus irréductible50. »
En outre, Spinoza explique la persistance du peuple juif, en tant que peuple diasporique et sans État, par une réaction circulaire entre son exclusivisme (son auto-ségrégation) et la « haine universelle » que ce dernier provoquerait contre lui. Bref, la haine antijuive est définie comme la principale condition de la permanence de l’identité juive : « Quant à leur longue durée à l’état de nation dispersée et ne formant plus un État, elle n’a rien du tout de surprenant, les Juifs ayant vécu à part de toutes les nations de façon à s’attirer la haine universelle et cela non seulement par l’observation de rites extérieurs opposés à ceux des autres nations, mais par le signe de la circoncision auquel ils restent religieusement attachés. Que la haine des nations soit très propre à assurer la conservation des Juifs, c’est d’ailleurs ce qu’a montré l’expérience51. »
On peut tirer des diatribes spinozistes la conclusion que « le peuple juif» est « grossièrement ignorant et fondamentalement pervers non seulement depuis la Crucifixion mais de tout temps52 ». C’est là essentialiser le peuple juif, le considérer comme une entité collective transhistorique, un « type humain » fixe et immuable, bref, comme une « race » déterminée par des caractères héréditairesVÀ la conception universaliste de l’unité du genre humain, défendue par l’Eglise, peut commencer de se substituer une conception pluraliste ou différentialiste des « races humaines », parfois pensées comme de quasi-espèces séparées. La vision polygéniste, chassant ou affaiblissant les croyances
monogénistes, viendra renforcer l’évidence racia-liste. Dans la foulée, la « question juive » sera posée comme une question raciale, impliquant un enchaînement du type : « race juive » – « cerveau juif» – « esprit juif » — « idées juives ». Mais on est là bien loin de Spinoza.
Il faut distinguer deux thèses qui vont circuler entre des penseurs très différents : d’une part, la thèse selon laquelle le judaïsme est « depuis longtemps une religion morte », comme l’affirme Schleiermacher en 179953, et, d’autre part, la thèse selon laquelle le judaïsme n’est pas une religion,
(p.96) soutenue notamment par Kant. C’est ainsi que l’historien des idées peut, en analysant les distorsions et les réinterprétations, « reconstituer la filière qui, de Spinoza, mène à Herder, Fichte et Hegel, et aussi à Schleiermacher et à Harnack54 ». Mais il ne faut pas oublier Voltaire, ni Kant, ni Renan (et Lassen). Tous ces grands auteurs, par les positions qu’ils ont prises contre les Juifs, le judaïsme ou le « sémitisme », ont rendu possibles les formes modernes de la judéophobie, quelles qu’aient été les déformations et les distorsions, volontaires ou non, dont leur pensée fit l’objet55. Si l’on suit une telle orientation, la responsabilité des philosophes dans la formation de l’antisémitisme en tant que forme moderne de judéophobie, culminant dans le racisme antijuif, apparaît immense.
(p.98) L’antisémitisme révolutionnaire et antichrétien issu des Lumières a essaimé tout au long du XIXe siècle, formant des synthèses avec d’autres configurations idéologiques, dont les multiples variétés de l’anticapitalisme ou du socialisme ne sont pas les moindres71. C’est pourquoi l’on ne saurait postuler un ordre simple de succession entre la judéophobie « libérale » et « rationaliste » des Lumières et la judéophobie socialiste ou anarchiste du XIXe siècle. Ce qui est observable, du moins par l’historien des idéologies politiques, c’est une grande diversité de chevauchements et de syncré-tismes. Il reste que, à considérer l’ordre chronologique d’apparition des idéologèmes et des argumentations typiques, une nouvelle forme de judéophobie, centrée sur la dénonciation du capitalisme ou du système commercial/financier, prend corps dans les années 1830-1850 : cette nouvelle idéologisation de la haine antijuive, fondée sur la crainte que le pouvoir de l’argent n’assure aux Juifs une domination sans limites, Bernard Lazare la baptisera « antisémitisme économique72 ».
En langue française, c’est le célèbre réformateur et penseur utopiste Charles Fourier (1772-1837) qui est le grand précurseur en la matière73. Sa haine intellectualisée des Juifs constitue l’envers du « génie » que nombre d’auteurs, de Proudhon à André Breton74, en passant par Engels et Jaurès, ont cru pouvoir lui reconnaître75. Il est l’incarnation même du « socialisme utopique », auquel Engels reconnaissait des « germes de pensée géniale76 ». En 1901, Jaurès ne cachait pas l’admiration qu’il lui portait : « Fourier était un homme d’un admirable génie. Lui seul avait eu la force de concevoir la possibilité d’un ordre nouveau77. » Dans ses Entretiens [1952], Breton affirmait qu’on trouve chez Fourier « la plus grande œuvre constructive qui ait jamais été élaborée à partir du désir sans contrainte78 ». D’où l’image ultérieure d’un Fourier prophète de la « libération sexuelle », largement diffusée dans la foulée de mai 196879. Or celui que Proudhon célébrait comme un « génie exclusif, indiscipliné, solitaire, mais doué d’un sens moral profond80 », ce « rêveur phénoménal » a dans ses écrits, dès lors qu’il traitait du rôle des Juifs, exprimé « l’esprit petit-bourgeois le plus routinier81 ». Divagations d’un « caissier en délire », selon le mot de Flaubert.
(p.101) Si Proudhon se montre souvent virulent dans les diatribes antijuives parsemées dans ses textes publiés de son vivant, il se déchaîne dans ses Carnets, qui font partie de ses œuvres posthumes107. On y rencontre cet écho de l’accusation voltairienne : « Les Juifs, race insociable, obstinée, infernale. Premiers auteurs de cette superstition malfaisante, appelée catholicisme, dans laquelle l’élément juif furieux, intolérant, l’emporte toujours sur les autres éléments grecs, latins, barbares, etc., et fit longtemps les supplices du genre humain108. » On peut donc affirmer, d’une façon générale, (p.102) que la judéophobie a pris une forme « économique » au cours du XIXe siècle dans les milieux socialistes et anarchistes (mais aussi dans le traditionalisme catholique), formant une synthèse idéologique persistante avec l’anticapitalisme. Le sordide usurier médiéval se transforme en banquier juif triomphant, donnant à l’époque qui commence son esprit propre : surgissement de l’anti-ploutocratisme.
C’est dans ce contexte que naît le « mythe Rothschild », mythe de la domination financière absolue qui se traduit par la dénonciation des Juifs en tant que « rois de l’époque109 », selon l’expression lancée en 1845 par le fouriériste Toussenel, que reprendra en 1886 le socialiste national-populiste Otto Bockel, dénonciateur professionnel du « capital exploiteur et parasitaire », pour titrer l’un de ses pamphlets antisémites : Die Juden-Kônige Unserer Zeit]W. L’époque étant supposée dominée par la puissance de l’argent, l’évidence idéologique est que l’argent accumulé par les Juifs, comme par un « instinct » spécifique, leur garantit l’exercice du pouvoir réel111. Le 5 septembre 1846, dans The Northern Star, Friedrich Engels signe un article où il donne cette significative interprétation (et appréciation) du succès du pamphlet de Georges Dairnvaell (Histoire édifiante et curieuse de Rothschild I », roi des Juifs) : « The success of this pamphlet (it has now gone through some twenty éditions) shows how much this was an attack in thé right direction112. » [Le succès de ce pamphlet (il en est aujourd’hui à une vingtaine d’édition) montre combien l’attaque portée frappait dans la bonne direction.] Pour l’éminent compagnon d’armes de Karl Marx, en 1846, pour le militant et le théoricien communiste, dénoncer Rothschild comme « le roi des Juifs » et « le chef des agioteurs », ou reprocher avec virulence aux Juifs « leur âpreté, leur insolence d’esclaves d’hier », « leur inextinguible besoin de fortune et de puissance113 », c’est viser et frapper « dans la bonne direction » ! Cette évaluation positive de la judéophobie anticapitaliste traversera tout le XIXe siècle et se transmettra au XXe dans les milieux révolutionnaires.
(p.108) En France, du côté de la gauche non socialiste, par exemple chez le démocrate Michelet, on rencontre à la même époque un usage semblable de l’argumentation universaliste contre le peuple juif, accusé d’avoir péché contre le genre humain en s’enfermant jalousement dans sa particularité. Le peuple juif « est toujours resté lui, fort et borné, indestructible et humilié, ennemi du genre humain et son esclave éternel », affirme Michelet, avant de prononcer ce qui ressemble bien à une malédiction : « Malheur à l’individualité obstinée, qui veut être à soi seule, et refuse d’entrer dans la communauté du monde156. » Pour Michelet, les Juifs ne sont pas seulement les « rois de l’époque », il les voit désormais « au trône du monde », grâce une ténacité sans pareille et à la richesse accumulée : « Patients, indestructibles, ils ont vaincu par la durée. Ils ont résolu le problème de volatiliser la richesse ; affranchis par la lettre de change, ils sont maintenant libres, ils sont maîtres ; de soufflets en soufflets, les voilà au trône du monde157. » Le démocrate Michelet rejoint ici le socialiste Fourier mais aussi le contre-révolutionnaire Bonald et tous les conservateurs affolés par les effets de l’émancipation des Juifs : dans le monde moderne où l’argent est roi, le Juif est le maître, ou risque fort de le devenir.
Il paraît encore aujourd’hui difficile de lire l’essai du jeune Marx sur la « question juive » sans verres teintés de rosé euphémisant, même lorsque le théoricien anticapitaliste brosse un portrait répulsif du « Juif réel », distingué du «Juif du Sabbat », qu’on s’attendrait à trouver dans un pamphlet antijuif de l’époque158. Rappelons quelques passages de l’essai du jeune Marx qu’il semble impossible, même en les contextualisant comme il se doit, de ne pas interpréter comme judéophobes, visant à la fois le judaïsme comme religion, la judéité (l’identité juive) et la judaïcité (le peuple juif). On y trouve notamment l’esquisse d’une théorie de la « judaïsation » du monde moderne en tant que capitaliste, comme si « le dieu jaloux d’Israël », l’argent, s’était historiquement réalisé dans la « société bourgeoise » :
« Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l’utilité personnelle. Quel est le culte profane du Juif? Le trafic. Quel est son Dieu profane ? L’argent. (…) Une organisation de la société qui supprimerait les conditions préalables du trafic, et donc la possibilité du trafic, aurait rendu le Juif impossible. (…) Nous reconnaissons donc dans le judaïsme un élément antisocial actuel et général, qui a été porté jusqu’à son niveau présent par l’évolution historique, à laquelle les Juifs ont collaboré avec zèle sous ce rapport détestable (…). Par lui et sans lui [le Juif], l’argent est devenu une puissance mondiale et l’esprit pratique juif l’esprit pratique des peuples chrétiens. Les Juifs se sont émancipés, dans la mesure où les chrétiens sont devenus des Juifs. (…) L’argent est le dieu jaloux d’Israël, devant lequel aucun autre dieu n’a le droit de subsister. Le judaïsme atteint son apogée avec l’achèvement de la société bourgeoise. (…) L’essence véritable du Juif s’est réalisée et sécularisée universellement dans la société bourgeoise (…)159. »
Le capitalisme est ainsi interprété par Marx comme le judaïsme historiquement réalisé. C’est cette thèse qui a conduit un certain nombre d’historiens, à l’instar d’Edmund Silberner, à soutenir que l’essai du jeune (p.109) Marx constituait « la source de la tradition antisémite dans le socialisme moderne160 ». Ce texte peut par ailleurs être considéré comme la face visible de l’iceberg. La correspondance privée de Marx est en effet par- -semée de propos antijuifs ironiques, sarcastiques ou méprisants, incluant divers clichés et stéréotypes antisémites (« le petit Juif… », « le Youpin /Jüdel/ X… », « les Youpins », etc.)161. On peut y voir une confirmation de l’hypothèse selon laquelle, au-delà de ses textes de jeunesse, la haine de soi, chez Marx, s’est transformée en un mélange de haine et de mépris pour les Juifs162. Donnons-en quelques illustrations : « Le Juif Steinthal, au sourire mielleux…» (1857); «Le maudit Juif de Vienne [Max Friedlânder]… » (1859) ; «L’auteur, ce cochon de journaliste berlinois, est un Juif du nom de Meier… » (1860) ; Marx qualifie de «Juif» son médecin parce qu’il est pressé de se faire payer (1854) ; le banquier Bamberger fait selon lui partie « de la synagogue boursière de Paris », Fould est un «Juif de bourse », Oppenheim est « le Juif Sùss d’Egypte ». Le traitement réservé à Ferdinand Lassalle (1825-1864), grand leader du socialisme allemand, « ami » et compagnon de luttes de Marx – qui le déteste -, montre que ce dernier, loin de s’en tenir à une judéophobie politico-économique, pense selon des catégories racialistes, comme le montre ce passage d’une lettre à Engels datée du 30 juillet 1862 : « II est maintenant parfaitement évident à mes yeux que la forme de sa tête et [la texture de] ses cheveux montrent qu’il descend des Nègres qui se sont joints à la troupe de Moïse, lors de l’exode d’Egypte – à moins que sa mère ou sa grand-mère du côté paternel n’aient eu des relations avec un Nègre163. » Ailleurs, Marx dit du « petit Juif» Lassalle, de « ce négro-juif de Lassalle164 », qu’il surnomme parfois « le Youpin Braun » ou « notre Youpin Braun » (lettre à Engels du 25 février 1859), qu’il est « le plus barbare ^e tous les youpins de Pologne ». Supposant que l’exode des Juifs hors d’Egypte « n’est rien d’autre que l’histoire (…) de l’expulsion hors d’Egypte du peuple des lépreux dont un prêtre égyptien du nom de Moïse prit la tête » (lettre à Engels du 10 mai 1861), Marx en infère que « Lazare, le lépreux, est (…) le prototype du Juif, et donc aussi Lazare-Lassalle165 ». Après une visite que Lassalle lui a rendue à Londres, Marx écrit dans une -lettre datée du 30 juillet 1862 : « Eh bien, cette combinaison de judaïsme et de germanisme avec la substance négroïde donne nécessairement naissance à un produit étrange. L’indiscrétion de cet individu est elle aussi négroïde166. » Ces attaques clairement racistes sont d’autant plus abjectes que Lassalle, sur la demande de Marx, était intervenu en 1861 auprès du gouvernement prussien pour que ce dernier recouvre sa nationalité prussienne. Paradoxe qu’on peut dire tragique ou comique, Lassalle, issu d’une famille juive orthodoxe, ne cachait pas lui-même sa vive hostilité envers les Juifs : «Je n’aime pas du tout les Juifs, même je les déteste généralement167. » Autre déclaration de Lassalle, non dénuée d’humour : «Je hais les Juifs et je hais les journalistes ; malheureusement je suis l’un et l’autre168. » Marx et Lassalle haïssaient l’un et l’autre les Juifs, mais pas d’une seule voix.
Les propos judéophobes de Marx peuvent cependant être relativisés au regard des tirades négrophobes, gallophobes, polonophobes et russophobes (p.110) qui émaillent sa correspondance privée, où l’on trouve également nombre de poncifs nationalistes sur la supériorité culturelle des Allemands par rapport à l’« arriération » russe et à la « superficialité » française169. On ne saurait pour autant, chez ce représentant éminent de la pensée allemande, mettre simplement au compte d’une forte propension à la xénophobie sa critique radicale du judaïsme et de tout ce qui est juif. Ce qui empêche de placer sur le même plan, chez Marx, judéophobie et russo-phobie, par exemple, c’est sa théorisation, dans une perspective critique, des rapports entre judaïsme et capitalisme. Car si la critique du judaïsme apparaît, chez Marx, inséparable de la critique du capitalisme, qui est au centre de sa pensée, il s’ensuit que son antijudaïsme est également central. Ce qui permet de relativiser la judéophobie de Marx, c’est plus simplement le fait qu’il la partage avec la grande majorité de ses contemporains, à commencer par ceux qui se proposent de « transformer le monde ». Il y a là une constante idéologique de la posture révolutionnaire : en finir avec « le vieux monde », c’est commencer par en finir avec le judaïsme, ou plus précisément, avec « l’esprit juif » supposé être celui du capitalisme.
On pourrait multiplier les citations de déclarations judéophobes dues à des auteurs ou à des leaders socialistes ou révolutionnaires, d’origine juive ou non, à l’époque de Fourier, de Toussenel, de Bauer, de Marx et de Proudhon. Tous partent de la « question juive » (Judenfmgé) dont ils dramatisent les enjeux170. La haine des Juifs serait-elle une implication logique de l’engagement socialiste/révolutionnaire au xixe siècle ? L’une de ses présuppositions psychologiques ? L’un de ses thèmes les plus mobilisateurs ? Ces questions gênantes s’imposent aujourd’hui.
(p.116) En conclusion de son Discours d’ouverture des cours de langues hébraïque, chaldaïque et syriaque au Collège de France, prononcé le 21 février 1862, Ernest Renan affirme avec l’autorité du savant qu’il est : « Dans tous les ordres, le progrès pour les peuples indo-européens consistera à s’éloigner de plus en plus de l’esprit sémitique209. » Vingt ans plus tard, en 1882, alors qu’une puissante vague antijuive balaie l’Europe, le programme de Gellion-Ganglar reste le même que celui de Renan : la « désémitisation » de l’Europe. Telle est la conclusion de son essai : « Le sémitisme doctrinal constitue le vrai, le seul péril social pour l’Europe, pour l’humanité. C’est le loup dans la bergerie : il faut l’en faire sortir210. » Le libre-penseur antisémite reste raisonnablement optimiste, à considérer l’« état actuel de la race sémitique », tout en exprimant sa hantise d’un métissage physique et culturel entre Sémites et Aryens : « Tout démontre la dégénération et la décadence croissantes de la race sémitique. Cette race a fait au monde le peu de bien qu’il était en elle de lui faire, et l’on n’a plus rien à espérer d’elle. Mais on a encore tout à craindre de l’infiltration de son sang et de ses doctrines dans les populations et les civilisations d’essence aryane. Il faut donc veiller et combattre, et reprendre le cri de Caton l’Ancien : « Et insuper censeo delendam esse Carthaginem. » Ce que l’on peut traduire par cet autre cri de Voltaire : « Écrasons l’infâme211 ! » »
C’est au nom de l’esprit des Lumières et du Progrès, sous l’égide de Voltaire, qu’est lancé cet appel à la vigilance contre le « sang » et l’« esprit » sémitiques. Mêlant le combat anticlérical et antireligieux à la lutte antijuive, Gellion-Danglar est loin d’être le seul « intellectuel » de gauche à raisonner ainsi.
(p.118) Autour de l’affaire Dreyfus : la gauche équivoque
En France, l’extrême gauche révolutionnaire a explicitement été antijuive tout au long du XIXe siècle – de Fourier et Toussenel à Blanqui224, Tridon225, Chirac, Regnard, Malon et Hamon, en passant par Proudhon226 -, sauf durant les quelques années où, sous la houlette de Jean (p.119) Jaurès, Lucien Herr, Bernard Lazare, Zola et Péguy, elle a choisi le camp dreyfusard227. Michel Winock rappelle que Jaurès lui-même, dans deux articles publiés les 1er et 8 mai 1895 dans La Dépèche de Toulouse, expliquait que « sous la forme un peu étroite de l’antisémitisme se propage en Algérie un véritable esprit révolutionnaire228 », et que le grand leader socialiste n’hésitait pas, à la veille de l’affaire Dreyfus, à « reprendre à son compte les arguments du lobby antisémite contre « la puissance juive22y » ». Pour les socialistes, le Juif, c’est toujours alors « l’usurier », métamorphosé en banquier ou en capitaliste. C’est seulement avec l’article publié par Emile Zola le 16 mai 1896 dans Le Figaro, « Pour les Juifs », que commencent à se dénouer les liens de connivence, voire de complicité, entre les milieux socialistes et les antisémites230. Mais il faut attendre la publication du «J’accuse» de Zola dans L’Aurore, le 13janvier 1898, pour que la plupart des socialistes (Jaurès compris) en finissent, ou plus exactement commencent à en finir avec leurs hésitations231. Car, quelques jours plus tard, le 20 janvier 1898, est rendu public un manifeste signé par 32 députés socialistes, dont l’argumentation exprime clairement l’antisémitisme « social » diffus de l’époque : « Les capitalistes juifs, après tous les scandales qui les ont discrédités, ont besoin, pour garder leur part de butin, de se réhabiliter un peu. S’ils pouvaient démontrer, à propos d’un des leurs, qu’il y a eu erreur judiciaire, ils chercheraient (…), d’accord avec leurs alliés opportunistes, la réhabilitation indirecte de tout le groupe judaïsant et panamiste [c’est-à-dire compromis dans le scandale financier du canal de Panama]. Ils voudraient laver à cette fontaine toutes les souillures d’Israël232. »
Plus significativement encore, Jaurès n’hésite pas à publier dans La Petite République, le 13 décembre 1898, un article où, sur le mode d’une critique compréhensive de Drumont se voulant habile, il reprend à son compte certains des thèmes de l’antisémitisme socialiste et varie pesamment sur les méfaits de la finance juive : « Si M. Drumont avait eu la clairvoyance qu’il s’attribue tous les matins, il se serait borné à dénoncer dans l’action juive un cas particulièrement aigu de l’action capitaliste. Comme Marx, qu’il citait l’autre jour à contresens, il aurait montré que la conception sociale des Juifs, fondée sur l’idée du trafic, était en parfaite harmonie avec les mécanismes du capital. Et il aurait pu ajouter sans excès, que les Juifs, habitués par des spéculations séculaires à la pratique de la solidarité et façonnés dès longtemps au maniement de la richesse mobilière, exerçaient dans notre société une action démesurée et redoutable. Ce socialisme nuancé d’antisémitisme n’aurait guère soulevé d’objections chez les esprits libres233. »
Alors même que les socialistes sont censés avoir totalement désavoué l’antisémitisme des milieux antidreyfusards, le socialiste emblématique qu’est Jaurès fait des concessions telles à l’adversaire présumé (Drumont) qu’il paraît s’aligner sur les positions antijuives. Cet article ne peut en effet que légitimer l’association du Juif et du « trafic », et renforcer le stéréotype du Juif financier malfaisant. Bref, on peut considérer comme établi que, «jusqu’en 1898, l’antisémitisme n’est perçu par l’ensemble de la gauche – et particulièrement par les socialistes – ni comme un opprobre ni (p.120) comme une menace sérieuse234 ». C’est seulement après le ralliement des milieux socialistes à la cause dreyfusarde que les passions judéophobes paraîtront se fixer exclusivement à droite, du côté des vaincus de « l’Affaire ». Mais ce déplacement idéologique a souffert de nombreuses exceptions, la plus notable étant celle que représenta le penseur révolutionnaire qu’a été le grand théoricien de la grève générale, Georges Sorel235. Dans un article intitulé très académiquement « Les aspects juridiques du socialisme », paru dans la Revue socialiste en octobre 1900, Sorel confie à son public militant ses réflexions singulières sur l’antisémitisme, alors que l’affaire Dreyfus est encore dans toutes les têtes : « L’antisémitisme fournit aux âmes ingénues et dénuées de toute connaissance économique un moyen facile pour se rendre compte du mécanisme du capitalisme moderne (…) ; tout le mal provient des vices d’une race, agissant en vertu de tendances ataviques ; rien n’est plus simple que cela : et cette simplicité est la raison même de la force de la doctrine. Mais il manque à l’antisémitisme une véritable dogmatique (…)236. »
Si, pour Sorel écrivant en 1900, les antisémites doivent s’efforcer de progresser en matière doctrinale, à partir des premiers mois de 1906, Sorel bascule lui-même dans la haine affichée pour les Juifs, amalgamant, dans sa polémique contre Jaurès, «Juifs » et « jauressistes » (« Les Juifs de L’Humanité »), dénonçant « les grands Youpins » qui soutiennent le journal L’Humanité, imaginant une campagne du « parti juif » contre lui, ironisant sur les « youpins » et les « circoncis », s’indignant de ce que « Péguy a une clientèle de 300 Juifs qu’il ne veut pas trop froisser », félicitant les royalistes de l’Action française qui « ne veulent pas se laisser faire par les Juifs237 ». Vers la fin de l’année 1911, la judéophobie de Sorel se radicalise, comme le montre son article de janvier 1912 sur Urbain Gohier, exdreyfusard lui-même devenu un antijuif virulent et déclaré en 1906, lorsqu’il publie son pamphlet La Terreur juive. Manifestement d’accord avec la vision judéophobe de Gohier, mais recourant prudemment à une question rhétorique, Sorel s’interroge avec une naïveté feinte : « Urbain Gohier a-t-il donc tort de soutenir que les Français doivent défendre leur État, leurs mœurs et les idées contre les envahisseurs juifs qui veulent tout dominer, comme les Américains défendent leur marché du travail contre les envahisseurs asiatiques238 ? »
C’est dans sa polémique contre les intellectuels juifs dreyfusards, tel Joseph Reinach, que Sorel se laisse emporter par la haine, allant jusqu’à justifier l’antisémitisme comme une réaction « nécessaire » au comportement des « Intellectuels juifs » qui « se prennent pour des petits Messies » et prétendent que les Juifs ont toujours joué un rôle révolutionnaire (thèse commune à Joseph Reinach et à Bernard Lazare), provoquant ainsi des « colères légitimes » : « Les Juifs agiraient en personnes sages s’ils repoussaient franchement la fantastique philosophie de l’histoire dont Joseph Reinach s’est fait le garant ; car en adoptant une doctrine aussi absurde pour éclairer leur conduite, ils rendent un certain antisémitisme nécessaire. Nul ne songerait chez nous à regarder les Juifs comme des ennemis du pays, si ceux-ci consentaient à vivre en simples citoyens exerçant un (p.121) métier honorable quelconque, s’occupant de leurs œuvres religieuses, coopérant à la culture générale dans la mesure du possible239. »
La relative fixation des passions antijuives à droite pendant « l’Affaire » -sera en réalité une simple parenthèse historique, comme le montre la flambée de haine antijuive qui, au cours des années 1930 et jusque sous l’Occupation (combien de socialistes pacifistes sont-ils devenus des colla-borationnistes enthousiastes !), touchera les gauches – organisations syndicales comprises – autant que les droites. Par ailleurs, la gauche et l’extrême gauche ont fourni un grand nombre de transfuges à l’extrême droite, transfuges dont l’antisémitisme n’a rien à envier à celui qu’ils pouvaient trouver dans le champ d’influence de d’Action française. Il convient de n’oublier ni l’ex-communiste Doriot ni l’ex-socialiste Déat. Ni l’ex-communiste George Montandon, devenu à la fin des années 1930 l’un des plus virulents dénonciateurs de « l’ethnie juive », qu’il appelle en 1939 « l’ethnie putain240 ». Ni l’ex-radical Henri Labroue, qui finit par obtenir la chaire d’histoire du judaïsme en Sorbonne, créée par le gouvernement de Pierre Laval le 6 novembre 1942241. Ni bien sûr le « pacifiste » Céline, qu’on situe au début des années 1930 dans la filiation de Zola et d’un certain populisme de gauche242. C’est ainsi qu’il sera d’ailleurs encore perçu sous l’Occupation. L’essayiste pro-nazi Louis Thomas, dans un livre de combat publié en 1942, Les Raisons de l’antijudaïsme, où il se propose d’expliquer pourquoi il faut se réjouir de ce que, « dans la Nouvelle Europe en train de se construire par le fer et par le feu, il n’y aura pas de place pour les Juifs243 », dédie son pamphlet à Céline en termes mi-populistes mi-misérabilistes : « À Louis-Ferdinand Céline qui a vigoureusement dénoncé les Juifs parce que, médecin des pauvres, il les a vus très malheureux sous la domination des Yids qui s’étaient emparés de la France244. » Céline, ennemi des Juifs, est donc du côté du peuple, du côté des pauvres.
Il suffit de considérer comment certains socialistes belges se comportent face à la « question juive » pour relativiser l’accalmie française. Le juriste et homme politique Edmond Picard (1830-1921), l’un des leaders du Parti ouvrier belge, qu’il ne quittera qu’en 1906, et l’un des principaux doctrinaires de l’antisémitisme à base raciale dans les années 1890, se présente volontiers comme un disciple de l’antidreyfusard et anti-socialiste Gustave Le Bon, en même temps que de Toussenel, Proudhon, Tridon, Broca et Gobineau (!). Ce dirigeant socialiste commence sa carrière d’idéologue antisémite en publiant en 1892 un livre-manifeste : Synthèse de l’antisémitisme. La Bible et le Coran. Les Hymnes védiques. L’art arabe. Les Juifs au Maroc245. Il ne cache pas qu’il voit dans l’émancipation des Juifs l’origine du «péril juif» qu’il dénonce, un péril qu’il décrit comme le grand effet pervers de la Révoluton française : « Cette invasion sémite formidable date à peine de 1789 et des réformes réalisées par la Révolution dans le sens de l’égalité et de la fraternité. Les Juifs étaient, jusqu’alors, des serfs. Imbus de préjugés humanitaires, convaincus surtout de l’équivalence des races, renouvelant ainsi, sous une autre forme, la fable religieuse du couple adamique, les hommes de cette grande époque ont détaché les fers de ces prisonniers et leur ont ouvert les portes. Ceux-ci sont en passe de devenir nos maîtres246. »
(p.124) Suite soviétique
L’antisémitisme de gauche a été « déracialisé » dans l’idéologie marxiste-léniniste. Mais la transmission des stéréotypes antijuifs de l’anti-capitalisme révolutionnaire n’en a guère souffert. Face à la judéophobie expressément raciste du IIIe Reich, les idéologues soviétiques pouvaient, à la condition de tenir un discours « antiraciste » intransigeant, réactiver l’imaginaire antijuif de la tradition révolutionnaire et dénoncer, en tant que « réactionnaires », les « cosmopolites » et les « sionistes ». Dans un régime totalitaire dont les éditions d’État s’intitulaient « Éditions du Progrès », la haine des Juifs et ses instrumentalisations politiques prenaient nécessairement une couleur « progressiste ». Il suffisait de dénoncer l’ennemi comme « réactionnaire263 ». Relayé par les communistes (en France comme ailleurs) – surtout depuis les années 1960 -, l’« antisionisme » soviétique était indissociable, dans la langue de bois, d’un anticapitalisme révolutionnaire et d’un anti-impérialisme radical. La tactique rhétorique utilisée par les Soviétiques consistait à dénoncer à la fois « l’antisémitisme » et « le sionisme », au nom d’une position « progressiste ». Ce mode indirect de stigmatisation des Juifs est devenu un lieu commun du discours de gauche, qu’il soit communiste ou non. Il est souvent couplé avec un autre argument fallacieux, également mis en circulation par la propagande soviétique : la thèse que « l’antisémitisme » serait provoqué par le comportement intolérable des « sionistes », accompagnée de la suggestion que ces derniers tireraient profit, à divers^ égards, de « l’antisémitisme » qu’ils ins-trumentaliseraient cyniquement. À la fin d’un libelle antiaméricain publié en 1985 à Moscou, on pouvait lire : « L’antisémitisme, sous toutes ses formes et manifestations, est alimenté pour une grande part par la politique provocatrice des sionistes eux-mêmes264. »
(…)
Les attaques contre le « sionisme » se multiplient à partir du début des années 1960 en URSS, mais c’est surtout après la guerre des Six-Jours (5-10 juin 1967) que la propagande antisioniste se déchaîne, en URSS comme en Pologne ou en Tchécoslovaquie. En Pologne, les Protocoles des Sages de Sion font leur réapparition en 1968, dans un contexte où le
(p.125) «complot sioniste» est consensuellement dénoncé266. Le 5juillet 1967, devant les élèves des écoles militaires assemblés au Kremlin, Leonid Brejnev déclare, pratiquant la reductio ad Hitlerum vis-à-vis d’Israël : « Les agresseurs israéliens se conduisent comme les pires des bandits. Il semble qu’ils veuillent, par les atrocités qu’ils commettent contre la population arabe, imiter les crimes des envahisseurs hitlériens267. » louri Ivanov publie à Moscou, au début de 1969, un pamphlet qui devient aussitôt un best-seller dans le genre : Attention : Sionisme !, où il dénonce « l’alliance sioniste internationale » qui « fait la liaison, joue le rôle d’intermédiaire secret entre les/forces les plus réactionnaires des États impérialistes, en premier lieu les États-Unis (…), et les militaristes israéliens268». En janvier 1969, un article intitulé « Qui servent les « Prophètes » du sionisme ? » explicite l’assimilation d’Israël à l’Allemagne nazie : « Le peuple juif n’a jamais été comme les autres peuples (…). Si on remplace le mot « peuple » par ceux de « race aryenne », on pourrait aisément, à la place du titre de « président de l’Organisation sioniste mondiale », celui de Nahum Goldmann, écrire « le Fùhrer Adolf Hitler ». Et il n’y a rien de surprenant à cela. Le sionisme et le fascisme sont tous les deux fondés sur un nationalisme éhonté, un chauvinisme bourgeois qui affirme, dans son propre intérêt, les « droits » spéciaux d’une seule nation en violant les droits des autres nations : leur exploitation économique, leur persécution politique et parfois même leur extermination physique (génocide)269. »
Une fois fermée la longue parenthèse de l’« antisionisme » soviétique, ses héritiers se proposent, au début du xxf siècle, d’en finir avec la « mondialisation libérale » et d’en découdre avec « l’axe américano-sioniste », censé représenter les « nouveaux maîtres du monde ». La vieille histoire n’a pas fini d’être racontée.
CH 4 Le moment racialiste / nationaliste
(p.127) Vers le milieu du XIXe siècle, les passions judéophobes commencent à subir une nouvelle forme d’intellectualisation sur la base d’un discours supposé scientifique : le discours sur les races humaines. Dès les années 1850 et 1860, une nouvelle image négative du Juif commence à être construite avec les matériaux fournis par l’anthropologie physique, la mythologie comparée et – surtout – la philologie historique qui, dans une perspective comparative, a mis en évidence la distinction fondamentale entre la famille des langues indo-européennes et celle des langues sémitiques. Une fois l’amalgame fait entre la langue, la mentalité (« l’esprit »), la culture et la « race », les « Sémites » deviennent une variété de l’espèce humaine, distinguée des « Indo-Européens », voire opposée à ces derniers. Les Juifs, en tant que « Sémites », prennent la figure d’une « race » étrangère, étrange et menaçante pour les peuples européens, les descendants supposés de la « race indo-européenne » ou « aryenne ». Pour l’essentiel, les Juifs-Sémites sont accusés d’être, par leur nature même, un « ferment actif de décomposition nationale », selon l’expression forgée par Theodor Mommsen, sortie de son contexte (l’histoire du monde romain antique) et intégrée dans leurs stocks de formules figées par la plupart des idéologues antisémites allemands1. L’accusation de « haine du genre humain » est réinterprétée dans le cadre d’une conceptualité naturaliste, et l’accent mis sur la dimension pathologique de « l’élément sémitique ». Pour les idéologues antisémites des années 1870 et 1880, la nature des Juifs est telle qu’ils ne peuvent qu’être des « corps étrangers » au sein de toutes les nations, des éléments parasitaires, désorganisateurs et destructeurs2.
(p.128) (…) dans les années 1870-1900, la nouvelle judéophobie racialisée est descendue dans l’arène politique pour se lier au nationalisme ethnique et xénophobe, au point de repasser de gauche à droite – plus exactement, des milieux socialistes aux milieux nationalistes antidémocratiques4.
La « racialisation » de la « question juive » accompagne la « racialisa-tion » de la question nationale. Dans ce dernier cas, le terrain a été préparé par la prépondérance de la vision identitaire de la nation qui, dans l’Allemagne des années 1870 et 1880, a fini par prévaloir contre sa dimension volontariste – le « plébiscite de tous les jours » évoqué par Renan dans sa fameuse conférence du 11 mars 1882: «Qu’est-ce qu’une nation?» Même chez les idéologues nationalistes qui, tel l’historien Heinrich von Treitschke (1834-1896), sont demeurés imperméables aux conceptions racistes, la vision identitaire, du national est exclusive, jusqu’à être opposée explicitement à une vision volontariste, celle-ci serait-elle modérée. En 1870, définissant le point de vue « allemand » sur la question nationale, Treitschke affirme ainsi à propos des « Alsaciens-Lorrains » : « Nous voulons leur restituer leur véritable identité [ihr eigenes Selbst] contre leur volonté5. » C’est pourquoi Treitschke soutiendra neuf ans plus tard, en novembre 1879, la thèse selon laquelle « il n’y a pas de place sur le sol allemand pour une double nationalité6 », et ira jusqu’à demander aux Juifs devenus citoyens allemands de « devenir, intérieurement aussi, des Allemands7 ». Cette exigence d’homogénéité psycho-culturelle, fondement doctrinal de la vision identitaire de la nation, va être interprétée dans un sens ethno-racial par d’autres idéologues nationalistes reprenant à leur compte certains éléments de la « théorie des races » élaborée par des auteurs comme Theodor Fritsch, Wilhelm Marr ou Eugen Dùhring, et ce, dans une perspective « volkisch » conférant à l’antisémitisme la place centrale. Dès lors, la défense de la « pureté de la race », fondée sur la hantise de la « souillure du sang »^par le métissage entre Juifs et Allemands, devient l’impératif catégorique. À cet égard, on rappellera que, parmi les « Dix commandements de l’autodéfense légale » énoncés par Fritsch en 1887 dans son Catéchisme des antisémites, on en trouve deux qui visent expressément à préserver la pureté raciale : « Tu garderas ton sang pur. Considère comme un crime de souiller la noble lignée aryenne de ton peuple en la mêlant à celle des Juifs. Car tu dois savoir que le sang juif est éternel, impose son empreinte sur le corps et sur l’âme depuis les générations les plus reculées. Tu n’auras pas de relations sociales avec le Juif. (…) »
(p.130) (…) chez Marr, l’on rencontre une variante de la thèse très répandue chez les premiers théoriciens de l’antisémitisme politique racialiste en Allemagne (H. Naudh [pseudonyme de Johannes Nordmann], Eugen Dùhring, Adolf Wahrmund, Friedrich Lange, Theodor Fritsch), thèse selon laquelle l’antisémitisme n’implique pas seulement le rejet des Juifs et du judaïsme, mais aussi un combat contre le christianisme (plus particulièrement le catholicisme) et le monothéisme en général, voire la volonté d’en finir avec la religion17. Les origines intellectuelles de set antisémitisme antichrétien sont à chercher dans la critique antireligieuse de Voltaire, de Ludwig Feuerbach et de Bruno Bauer, comme l’a parfaitement aperçu en 1862 l’auteur d’un essai polémique contre Marr, Der Christenspiegel von Anti-Marr, l’historien et théologien Moritz Freystadt18.
Dans les vingt dernières années du XIXe siècle se constitue donc, principalement en France et en Allemagne, une conception antijuive du monde explicite fondée sur deux thèmes principaux : d’une part, l’idée raciste par excellence, selon laquelle les Juifs sont à jamais inassimilables, en raison de leurs caractéristiques biologiques (ou « raciales ») et psychoculturelles supposées permanentes – des caractéristiques négatives – ; d’autre part, le thème d’accusation conspirationniste, les Juifs étant accusés de vouloir dominer le monde, à travers manipulations de l’opinion, complots criminels et bouleversements révolutionnaires, sur fond de domination financière plus ou moins occulte. Un irréductible étranger et un incorrigible conquérant, un envahisseur et un comploteur dangereux : tel est le Juif construit comme type absolument négatif et comme mythe répulsif à la fin du xixe siècle, dont le discours du nouveau nationalisme paradoxal, conservateur-traditionaliste et révolutionnaire-populiste, le tout légitimé par le vocabulaire pseudo-scientifique de la « théorie des races », va s’emparer en France au cours de l’affaire Dreyfus19. L’emploi du mot « antisémitisme », désignant strictement le « racisme dirigé contre les Juifs » (assimilés abusivement à la prétendue « race sémitique »), n’est pertinent que pour caractériser le discours judéophobe à base racialiste qui domine (p.131) en Europe de l’Ouest des vingt ou trente dernières années du XIXe siècle au milieu du XXe siècle (plus précisément jusqu’en 1945).
Le cas Dühring
Le socialiste non orthodoxe Karl Eugen Dühring (1833-1921), dans son pamphlet publié en 1880, Die Judenfmge aïs Racen-, Sitten- und Cultur-frage (« La Question juive en tant que question de races, de mœurs et de culture20 »), qui s’imagine poser enfin d’une façon rationnelle, en positiviste et en « matérialiste », la vieille « question juive » sur la base de la « théorie des races », ne découvre dans ce qu’il appelle la « race juive » que les traits négatifs retenus par les judéophobes pré-racistes : l’orgueil, la volonté de domination et la haine du genre humain. Duhring affirme ainsi dans son livre le plus célèbre : « L’égoïsme d’élection, le sentiment de supériorité sur les autres peuples et le tort qui leur fut fait – en un mot, l’inhumanité, oui, l’hostilité contre tout le reste du genre humain -, voilà tout ce qui a ici [dans l’Ancien Testament] son point de départ et qui se perpétue depuis des millénaires21. »
(p.135) Le vieux thème d’accusation visant les Juifs comme « ennemis du genre humain », thème déjà présent dans la judéophobie préchrétienne, a donc été réinventé sur des bases racialistes dans la modernité, avec un supplément de paradoxisme diabolique, théorisé par Dùhring : le Juif comme type racial ou ethno-racial absolument distinct de tous les autres, étranger absolu qui serait par nature l’ennemi de toutes les races humaines, est imaginé comme un ennemi voué, en dépit de son extranéité raciale, à « pénétrer » ou à « infiltrer » les autres « races » ou les autres peuples, afin de les réduire à des moyens de satisfaire ses seuls intérêts ou de réaliser à leurs dépens ses propres fins. Le Juif, tel que le voit l’antisémite ? Le plus extérieur et le plus intérieur des ennemis. C’est cette figure répulsive qui va être placée au centre du discours nationaliste instruit par les doctrines raciales. En Allemagne, lorsque la première Union des étudiants allemands voit le jour, l’un de ses dirigeants, Erich von Schramm déclare lors de l’assemblée constitutive de ladite Union, réunie à Berlin le 9 décembre 1880 : sa mission essentielle est « de réunir durablement (…) tous les étudiants réellement allemands », de « se battre pour se libérer des esprits étrangers qui, par leur activité maligne, ont déformé le caractère allemand de la communauté universitaire », de « se défendre contre la race étrangère qui transforme notre patrie allemande en une vaste bourse51 ». La « judaï-sation » est vue par les nationalistes, rencontrant sur ce point les socialistes, comme une « rothschildisation » de la société. C’est ce qui explique le succès immédiat de la formule lancée à l’automne 1879 par l’historien et journaliste Heinrich von Treitschke : « Les Juifs sont notre malheur52. »
(p.139)
C’est dans ce contexte de forte mobilisation antisémite que se crée notamment l’Union pour l’extirpation des Juifs (Verein zur Ausrottung der Juderi), et qu’environ 265 000 Allemands – adultes de sexe masculin — signent la pétition nationale lancée durant l’été 1880, avec le soutien de Marr, par le wagnérien antisémite Bernhard Forster (1843-1889) – le beau-frère de Nietzsche, qui le méprise -, réclamant la mise en quarantaine des Juifs89. Cette pétition, demandant notamment l’arrêt de l’immigration juive et l’exclusion des Juifs des fonctions gouvernementales et de certaines fonctions publiques, notamment de la magistrature et de l’enseignement, comporte un texte introductif qui en détermine la raison d’être90. Ce texte, qui offre une courte synthèse des thèmes antijuifs de l’époque et prend la valeur d’un manifeste du mouvement antisémite des années 1879-1880, commence par identifier les Juifs comme une menace pour la nation allemande, tout en postulant un strict déterminisme racial des aptitudes particulières des Juifs :
« Les patriotes appartenant à toutes les classes et à tous les partis sont depuis longtemps alarmés par l’emprise croissante de la partie juive de la population. Les espoirs autrefois entretenus de voir les éléments sémites se fondre avec les éléments germaniques se sont montrés illusoires, malgré l’émancipation complète accordée aux Juifs. Cette fois il ne s’agit plus d’assimiler les droits des Juifs aux nôtres, mais d’empêcher la diminution de nos prérogatives nationales, par suite de la prépondérance grandissante du judaïsme. Cette
(p.140) prépondérance grandissante a sa source dans les qualités raciales des juifs, qualités que la nation allemande ne peut ni ne veut acquérir, car elles auraient pour elle des effets pernicieux. Le danger est manifeste et a déjà été aperçu par beaucoup. L’idéal germanique de chevalerie, d’honnêteté, de vraie religiosité, est en train de pâlir, de céder la place à l’idéal juif qui n’est qu’un trompe-l’œil. »
(…)
Le 13 avril 1881, les initiateurs de la pétition, dont l’objectif est de mettre en question d’une façon radicale l’émancipation des Juifs, déposent à la chancellerie les quelque vingt volumes de signatures recueillies. Bismarck leur fait délivrer un accusé de réception, et enterre le document, en politique avisé91.
(p.142)
En Autriche, à la même époque, le Parti chrétien-social du démagogue catholique Karl Lueger (1844-1910) exploite de la même manière l’antisémitisme à des fins politiques, et ce, d’une façon particulièrement efficace, puisque Lueger finit par être élu triomphalement maire de Vienne en 1897, sur la base d’un programme explicitement antijuif102. Chez ce virtuose de la démagogie doublé d’un tacticien habile, l’antisémitisme est surtout instrumental : il lui permet de canaliser contre un ennemi identifiable les inquiétudes, voire les angoisses des masses. Il n’hésite pas à exploiter les rumeurs populaires concernant notamment les méfaits sexuels des Juifs, à l’instar d’une publication antisémite proche de lui, le Deutsches Volksblatt, qui sera lu assidûment par le jeune Hitler lors de son séjour à Vienne103. On y trouve des récits de crimes commis par des Juifs et dont les victimes sont inévitablement chrétiennes : « Le Juif qui torturait la gouvernante chrétienne employée par sa famille parce qu’elle avait giflé son fils lorsque celui-ci la traitait de « sale truie » ; la maquerelle [juive] qui attirait jeunes filles et femmes mariées vers le vice, après avoir été mêlée à une affaire de chantage dans laquelle elle avait utilisé sa propre fille comme appât ; le vieux QuifJ vicieux attaqué à juste titre par une employée chrétienne à laquelle il avait fait des avances malhonnêtes104. » C’est à Lueger qu’on attribue la fameuse boutade que reprendra plus tard Hermann Goering : « Qui est juif, c’est moi qui le décide. » Son nationalisme populiste peut être illustré par la formule qu’il emploie le plus fréquemment : « II faut aider les petits105 ! » II est vrai que, dans les rangs de son parti, l’antisémitisme est souvent compris comme un combat racial, ainsi qu’en témoigne cette déclaration faite lors d’un débat à la Chambre (p.143) par Emst Schneider, le plus fidèle lieutenant de Lueger : « La question juive est une question raciale, une question de sang. » Et Schneider d’ajouter sur le mode de la boutade, dévoilant ses rêves d’extermination : «Je ne vais pas me lancer dans un débat sur le baptême des Juifs, mais m’en tiendrai à ceci : s’il me fallait baptiser des Juifs, j’aurais recours à la méthode de saint Jean, en la perfectionnant toutefois légèrement. Il leur maintenait la tête sous l’eau du baptême : je ferais, quant à moi, durer l’immersion cinq bonnes minutes106. » Dans Mein Kampf, Hitler exprimera son admiration pour Lueger, « le dernier grand Allemand sorti des rangs du peuple », ce « réformateur de génie1« 7 », qui lui a appris en effet comment utiliser l’antisémitisme en tant qu’instrument politique. Lueger, qui a compris « l’importance des masses108 », aura parfaitement incarné l’antisémitisme populiste et anticapitaliste de son époque. C’est lui qui, vraisemblablement, a créé le premier parti populaire transclassiste. Toutefois, selon Hitler, Lueger a péché par naïveté en ouvrant aux Juifs la voie de la conversion pour leur permettre d’échapper à leur sort109, et a en outre toujours refusé d’adhérer explicitement aux dogmes du racisme antijuif. C’est pourquoi, au regard d’Hitler, l’antisémitisme de Lueger n’est qu’un « pseudo-antisémitisme110 ».
C’est chez le grand rival de Lueger, le pangermaniste Georg Heinrich Ritter von Schoenerer (1842-1921)111, qu’Hitler trouve les principaux éléments de sa cojiception biologisante et raciste du monde, comme l’a montré l’historien Robert Wistrich112. En 1882, Schoenerer et ses partisans formulent le « Programme de Linz », où le pangermanisme se combine avec un programme réformiste d’inspiration à la fois socialiste et néo-romantique, exploitant des thèmes antimodernes (dénonciation de la société industrielle, etc.). Sous l’influence de Duhring, et prenant acte du fait que l’antisémitisme est populaire en Autriche, Schoenerer recentre son programme sur une nouvelle clause : « La liquidation de l’influence juive de tous les secteurs de la vie publique est indispensable si l’on veut mener à bien les réformes envisagées. » II présente des motions antisémites au Reichsrat et, en 1887, s’engage en faveur d’une loi visant à restreindre l’immigration des Juifs d’Europe orientale en Autriche113. À la fois démagogue et fanatique antijuif, Schoenerer récuse la voie de l’assimilation des Juifs par la conversion au christianisme avec des slogans racistes du type : « La religion importe peu, c’est dans le sang que se trouve la cochonnerie114. » Au contraire de l’antisémitisme de Lueger, moyen de propagande plutôt que vision du monde, l’antisémitisme de Schoenerer est idéologiquement élaboré, et ce, explicitement, sur des bases raciales115. On peut caractériser sa doctrine comme la combinaison d’un ethno-nationalisme allemand appelant à protéger le « sang allemand », d’un antisémitisme s’inspirant des théories raciales de son époque et d’un anti-slavisme radical116. Avant Hitler, Schoenerer, qui reconnaît Duhring comme son maître, est certainement « l’antisémite le plus virulent et le plus systématique » jamais produit par l’Autriche117. L’historien lan Kershaw suppose que « c’est dans le climat nationaliste de Linz que Hitler a assimilé le credo de Schoenerer118 ». À Vienne, ensuite, où il s’est installé en février 1908, le jeune Hitler se présente comme un disciple et un (p.144) admirateur de Schoenerer, dont il a fait suspendre au-dessus de son lit deux formules encadrées : « La cathédrale de la Germanie sera construite sans l’aide de Juda et de Rome. Heil ! », dit l’une, tandis que l’autre prétend exprimer le désir des Allemands d’Autriche d’être rattachés à la mère-patrie »9. Dans Mein Kampfm, Hitler procédera à une analyse comparée des mérites respectifs de Lueger et de Schoenerer, lequel est selon lui « un penseur meilleur et plus profond dans les problèmes de principe121 », car, ajoute-t-il, le pangermanisme repose sur « une juste compréhension du problème des races et non sur des conceptions religieuses122 ».
L’influence de Treitschke, mêlant dans son argumentation nationaliste des thèmes antijuifs, anglophobes et darwinistes sociaux, mais étrangère au racisme biologisant, a été considérable dans le développement du nationalisme allemand et la naissance du pangermanisme123. Dans les années 1880 et 1890, son éloge de la guerre et sa théorisation de la politique de puissance, conformes à « l’esprit prussien », deviennent des lieux communs du discours pangermaniste124. De la formule de Treitschke, « Les Juifs sont notre malheur », le célèbre idéologue du pangermanisme Heinrich Class (1868-1953) dira plus tard : « Elle s’implanta dans mon corps et dans mon âme quand j’eus vingt ans » et « exerça une influence décisive sur mon action politique ultérieure125 ». Lorsque l’avocat Heinrich Class, en 1908, accède à la présidence de la Ligue pangermaniste (All-deutscher Verband), celle-ci devient ouvertement antisémite et interdit aux Juifs d’en devenir membres126. Lorsqu’il se donnera pour tâche de combattre pour le « salut de l’âme du peuple allemand », Class se montrera encore un bon disciple de Treitschke.
À bien des égards, n’étant pas un extrémiste mais un « libéral », Treitschke est l’universitaire qui a contribué avec le plus d’efficacité à conférer un « prestige intellectuel » à l’antisémitisme127. Dans une lettre à Treitschke datée du 27 novembre 1895, Houston Stewart Chamberlain exprime le jugement flatteur que portent sur lui tous les adorateurs du Deutschtum, en particulier les milieux pangermanistes, à savoir : « L’homme dont j’ai tant appris sur l’individualité et le caractère germaniques et qui m’apparaît comme un modèle aussi parfait qu’authentique du « Germain »128. » Après avoir rendu hommage à Treitschke, Heinrich Class, incarnation du nationalisme impérialiste et militariste allemand, reconnaît dans son célèbre pamphlet publié en 1912 sous le pseudonyme de Daniel Frymann, Wenn ich der Kaiser wär (« Si j’étais l’Empereur »), l’influence sur son évolution intellectuelle et politique de Lagarde, de Gobineau et de Chamberlain, dont les œuvres l’ont nourri : « À la fin de ce siècle, je m’y plongeai, et je ne sais de ces trois grands hommes lequel m’a apporté le plus de profit129. » Le projet de Class étant de créer la Grande Allemagne, il faut, pour le réaliser, remplir deux conditions préalables. D’abord, rallier les travailleurs à l’idée pangermaniste, et, pour ce faire, créer un « véritable parti ouvrier allemand », étranger à la thèse «juive » de la lutte des classes, mais résolument anticapitaliste, centré sur le combat contre le « capital financier international ». Ensuite, désigner clairement l’ennemi : le Juif. D’où la détermination de la tâche à accomplir, une « déjudaïsation » généralisée : « Le retour à la santé de notre vie nationale et le maintien de cette (p.145) santé recouvrée ne sont possibles qu’à la condition que l’influence juive dans toutes ses dimensions – culturelle, morale, politique et économique -soit complètement éliminée ou bien réduite à un niveau supportable, où elle serait inoffensive. » Les mesures préconisées par Class en 1912, allant de la censure de la presse à une législation antijuive, constitueront une source d’inspiration pour les rédacteurs du programme de la NSDAP : « Tous les postes administratifs, sur le plan national, étatique, ou municipal, rétribués ou honoraires sont fermés aux Juifs. Les Juifs ne sont pas admis à servir dans l’armée ou la marine. Les Juifs n’ont pas le droit de vote. Les professions d’homme de loi et d’enseignant leur sont interdites, comme aussi la direction des théâtres. Les journaux où travaillent des Juifs doivent le faire savoir ; les journaux qui se disent « allemands » ne peuvent être la propriété des Juifs ni avoir des directeurs ou des collaborateurs juifs. Les banques qui ne sont pas des affaires purement personnelles n’ont pas le droit d’avoir des directeurs juifs. À l’avenir, la propriété rurale ne pourra appartenir à des Juifs ni être hypothéquée par eux. En échange de la protection dont bénéficient les Juifs en tant qu’étrangers, ils devront payer deux fois plus d’impôts que les Allemands’3« . » (…)
L’antisémitisme à la française :
Edouard Drumont contre « la France juive
En France, Edouard Drumont est le premier en date des antisémites de profession qui structure sa doctrine antijuive sur la base de l’opposition manichéenne entre Juifs et Aryens. On sait qu’il s’impose avec la publication, en 1886, du best-seller de l’antisémitisme nationaliste, plébéien et traditionaliste catholique, La France juive (114 éditions en un an!), qui commence par un long développement sur « le Juif», qu’on peut considérer comme une exposition systématique du point de vue raciste sur la « question juive », ou plus exactement le « péril juif33 ». Drumont affirme clairement sa thèse racialiste : « La question religieuse même ne joue qu’un rôle secondaire à côté de la question de race qui prime toutes les autres134. » C’est La France juive qui lance et véhicule aussitôt la vulgate antijuive qui s’est constituée en France depuis le début des années 1880, (p.146) sous le label « antisémitisme135 ». En lui conférant une dimension populiste, et en l’autonomisant par rapport à la propagande de l’Église ou aux mobilisations socialistes, Drumont fait de l’antisémitisme un phénomène à la fois politique et culturel où le nationalisme ethno-racial trouve ses premiers outils symboliques et son impulsion initiale. L’historien Paul Airiau remarque justement que « sans Drumont, l’antisémitisme catholique serait vraisemblablement demeuré marginal136 ». Mais Drumont offre également la première synthèse de tous les courants de la judéophobie de son temps. Notons au passage que La France juive, qu’on peut considérer comme le manifeste, en langue française, de l’antisémitisme politique moderne au sens strict, précède d’une année le Catéchisme des antisémites de l’idéologue vôlkisch Theodor Fritsch, son homologue allemand, lui aussi soucieux d’intégrer dans une doctrine unitaire les diverses thématiques antijuives137.
(p.147) Le royaliste et antisémite Roger Lambelin, publiciste proche de l’Action française connu pour avoir réalisé en 1921 l’une des premières éditions françaises des Protocoles des Sages de Sion148, pose à la fin de son pamphlet paru en 1928 sous le titre Le Péril juif ‘— Les Victoires d’Israël, dans le chapitre conclusif intitulé « Israël dominera-t-il le monde ? », la question de la réaction d’autodéfense des nations se sentant menacées par le «péril juif», saisi dans toutes ses dimensions : économique, sociale, politique et culturelle. Le «péril juif» est fantasmé par Lambelin comme invasion, infiltration et contamination. Il faut donc, pour ce défenseur du monde chrétien en péril, se défendre contre les Juifs à plusieurs titres, selon que ces derniers sont perçus comme des étrangers indésirables ou des intrus, des ennemis redoutables ou des corrupteurs du corps social et de l’esprit public. L’antisémite militant esquisse un programme antisémite global ordonné à deux principes fondamentaux : la ségrégation stricte et la discrimination systématique. Extrayons quelques propositions de ce programme, comportant un volet national et un volet international :
« II serait prudent d’empêcher les Juifs d’être officiers, fonctionnaires, députés ou sénateurs, membres des corps enseignants, etc. (…) En dehors des devoirs nationaux (…), n’y aurait-il pas des ententes à établir entre les peuples désireux de conserver leur indépendance politique, économique ? Il faut assurément que ces peuples possèdent des gouvernements forts et conçoivent à peu près de la même façon les nécessités qui s’imposent d’écarter les indésirables, de se défendre contre de redoutables invasions spirituelles et matérielles. (…) Il ne s’agirait nullement de tractations d’ordre politique, mais simplement de s’efforcer d’organiser une défense en commun contre des périls également redoutables pour tous les pays. N’organise-t-on pas entre nations des défenses contre certaines maladies contagieuses? (…) Que l’on commence, chacun dans sa sphère, par relever le mur moral qui, pendant tant d’années, sépara du Juif les chrétiens et les mahométans. Avant d’interdire aux Flébreux d’être officiers ou fonctionnaires publics (…), commençons par nous conformer aux instructions si sages des Papes d’autrefois. Évitons d’entretenir avec eux des relations quelconques, de les introduire dans nos familles. Ne donnons pas notre clientèle à des grands magasins, à des comptoirs d’alimentation dont les dirigeants ou les capitaux sont juifs. (…) Qu’en aucune circonstance ils [les chrétiens] ne les associent à leurs affaires149 ! »
(p.148) Lambelin termine l’exposé de son programme d’action par l’énoncé de quelques mesures à prendre contre la « judaïsation » culturelle de la France, qui revienne à un boycottage systématique de tout ce qui est d’origine ou d’inspiration juive :
« Et comme les plus petites choses ont leur importance, évitez d’aller au théâtre entendre des œuvres juives ; évitez et conseillez à vos amis d’éviter la lecture de romans juifs et d’inspiration juive, même si ces romans ont bénéficié de prix ou de récompenses académiques ; n’allez pas admirer les films hébraïques présentés dans les plus luxueux cinémas. Soyez logiques avec vous-mêmes si vous avez conscience du péril juif5« . »
Après cette série de conseils illustrant de façon frappante l’antisémitisme culturel des milieux traditio-nationalistes catholiques151, Lambelin légitime son propos en se référant à l’autorité incontestée qu’est, depuis la fin du XIXe siècle, le marquis de La Tour du Pin La Charce, idéologue catholique, nationaliste et contre-révolutionnaire qui fut un compagnon d’armes d’Albert de Mun :
« Ayez toujours devant les yeux le mot qu’aimait à répéter le colonel de La Tour du Pin, l’un des plus grands sociologues de notre temps : « Les Juifs sont des étrangers et des étrangers dangereux. » S’il plaît à Dieu, ces modestes efforts individuels, suivis d’efforts nationaux et internationaux auront un effet utile et permettront de mettre définitivement un terme à ces victoires d’Israël, si menaçantes, si formidables et encore si mal connues152. »
Dans un texte célèbre daté du 16 octobre 1898, « La question juive et la révolution sociale », le légitimiste René de La Tour du Pin résumait en effet son programme d’« émancipation » par l’énoncé de trois points : « I. Ne traiter les Juifs que comme des étrangers, et des étrangers dangereux ; IL Reconnaître et abjurer toutes les erreurs philosophiques, politiques et économiques dont ils nous ont empoisonnés ; III. Reconstituer dans l’ordre économique comme dans l’ordre politique les organes de la vie propre, qui nous rendaient indépendants d’eux et maîtres chez nous153. »
(p.152) Du début du XIXe siècle au début du XXe, la judéophobie conspirationniste, par exemple, s’est largement nourrie de faux antijuifs ou anti-judéo-maçonniques, le premier en date étant vraisemblablement la prétendue lettre du capitaine Jean-Baptiste Simonini que l’abbé Barruel, célèbre idéologue de la Contre-Révolution et de l’anti-maçonnisme, disait avoir reçue de Florence en août 18066. Après avoir circulé tout au long du XIXe siècle, la prétendue lettre de Simonini (personnage fictif) sera publiée en juillet 1878 par la revue catholique traditionaliste Le Contemporain, puis régulièrement utilisée par les propagandistes antijuifs. Le contenu de cette lettre peut se résumer par l’affirmation, sur le mode de la révélation d’un secret inavouable, que les Juifs sont à l’origine de toutes les « sociétés secrètes » ou e« sectes » antichrétiennes et à la tête de toutes les conspirations contre l’Église et contre la monarchie. Donc que les Juifs, à travers leur instrument privilégié qu’est la franc-maçonnerie, sont responsables des révolutions. Son importance tient à ce que l’on y rencontre pour la première fois, d’une façon explicite, le thème de la direction juive de la franc-maçonnerie, qui constituera le noyau dur de la propagande anti-judéo-maçonnique soutenue, voire orchestrée par l’Église au cours du dernier tiers du XIXe siècle.
La « lettre de Simonini » est un faux et constitue l’un des premiers textes précurseurs des Protocoles des Sages de Sion, le plus célèbre des faux antijuifs modernes7 qui, publié pour la première fois en Russie en 1903, commencera son tour du monde à partir de 1920, une fois traduit en allemand, en anglais, en polonais, en hongrois et en français. Les Protocoles véhiculent le thème typiquement conspirationniste du « Programme de la conquête du monde par les Juifs », pour reprendre le titre de la première publication en Russie dans le journal d’extrême droite Znamia (« Le Drapeau »), fin août/début septembre 1903, du faux, présenté par son traducteur comme étant les « Protocoles des séances de l’union mondiale des francs-maçons et des Sages de Sion8 ». Mais cette attribution des Protocoles aux «judéo-maçons » est aussitôt concurrencée par l’attribution du document aux « sionistes ». Dès les premières publications du faux en Russie, entre 1903 et 1906, le « sionisme » est fictionné comme un projet secret de domination du monde, révélé notamment par les Protocoles. Il est ainsi transformé en un puissant mythe répulsif dont l’expression aujourd’hui courante de « sionisme mondial » représente le dernier avatar. Éditeur, en 1905, de la version complète la plus diffusée des Protocoles, le mystique et écrivain religieux orthodoxe Serge Alexandrovitch Nilus (1862-1929) finit par se rallier à la thèse de l’origine sioniste du document « révélateur ». Dans la dernière édition, publiée en janvier 1917, de son livre contenant les Protocoles, sous le nouveau titre // est tout près, à la porte… L’Antéchrist approche et le règne du Diable sur terre est proche, Nilus attribue clairement le « document » aux dirigeants du sionisme : « Ces Protocoles ne sont rien d’autre qu’un plan stratégique pour conquérir le monde et le placer sous (p.153) le joug d’Israël, (…) un plan élaboré par les dirigeants du peuple juif (…), finalement présenté au Conseil des Sages par le « Prince de l’Exil », Théodore Herzl, lors du premier Congrès sioniste (.. .)9. »
(…)
II faut également mentionner, parmi les plus diffusés de ces faux qui serviront de modèles aux Protocoles, le fameux « Discours du Rabbin » (diffusé en Russie dès 1872), ainsi que la pseudo-Lettre des Juifs d’Arles et la pseudo-Réponse des Juifs de Constantinople, faux fabriqués à la fin du XVIe siècle, mais dont l’exploitation antijuive systématique ne sera lancée qu’en 1882, dans le cadre d’une vision antimoderne à tendance apocalyptique12, par le chanoine Emmanuel Chabauty, dans son pamphlet titré Les Juifs, nos maîtres ! Documents et développements nouveaux sur la question juive^. Commençons par le « Discours du Rabbin14 ». En 1872 est traduit en russe, et publié à Saint-Pétersbourg sous la forme d’un document révélateur, un chapitre extrait du roman de Hermann Goedsche (sous le pseudonyme de Sir John Retcliffe), Biarritz (Berlin, 1868), chapitre intitulé : « Dans le cimetière juif de Prague ». Publié séparément comme s’il s’agissait de la narration d’une réunion tenue effectivement, ce texte, « Le cimetière juif de Prague et l’assemblée des douze tribus d’Israël », décrit une assemblée nocturne ressemblant fort à une cérémonie occulte, durant laquelle les représentants des douze tribus d’Israël exposent les divers aspects d’un plan de conquête du monde, ainsi que le confirme le Grand Rabbin. À bien des égards, cette scène s’inspire de la réunion maçonnique imaginée par Alexandre Dumas dans son roman Joseph Balsamo (1849), où est relatée la rencontre, le 6 mai 1770, entre Cagliostro, chef des Supérieurs Inconnus, et d’autres Illuminés15. Le complot des Illuminés vise à (p.154) placer la France des Lumières et de la Révolution future à la tête de l’humanité, grâce aux efforts conjugués de trois cents frères représentant chacun dix mille associés, soit trois millions d’affiliés ayant juré « obéissance et service16 ». Par une série de transformations, le complot de Cagliostro et des Illuminés deviendra le complot juif mondial. On trouve dans l’extrait du roman de Goedsche la plupart des thèmes des Protocoles des Sages de Sion, qui paraissent n’en constituer qu’une version développée :
« Nos pères ont légué aux élus d’Israël le devoir de se réunir, au moins une fois chaque siècle, autour de la tombe du grand maître Caleb, saint rabbin Syméon-ben-Ihuda, dont la science livre, aux élus de chaque génération, le pouvoir sur toute la terre et l’autorité sur tous les descendants d’Israël. Voilà déjà dix-huit siècles que dure la guerre du peuple d’Israël avec cette puissance qui avait été promise à Abraham, mais qui lui avait été ravie par la Croix. Foulé aux pieds, humilié par ses ennemis, sans cesse sous la menace de la mort, de la persécution, de rapts et de viols de toute espèce, le peuple d’Israël pourtant n’a point succombé ; et, s’il s’est dispersé sur toute la surface de la terre, c’est que toute la terre doit lui appartenir. (…) Lors donc que nous nous serons rendus les uniques possesseurs de tout l’or de la terre, la vraie puissance passera entre nos mains, et alors s’accompliront les promesses qui ont été faites à Abraham. (…) Si l’Or est la première puissance de ce monde, la seconde est sans contredit la Presse. (…) Il faut, autant que possible, entretenir le prolétariat, le soumettre à ceux qui ont le maniement de l’argent. Par ce moyen, nous soulèverons les masses, quand nous le voudrons ; nous les pousserons aux bouleversements, aux révolutions, et chacune de ces catastrophes avance d’un grand pas nos intérêts intimes et nous rapproche rapidement de notre unique but : celui de régner sur la terre, comme cela a été promis à notre père Abraham17. »
(p.155) L’autre faux significatif d’avant l’ère des Protocoles, la pseudocorrespondance des Juifs d’Arles et de Constantinople26, est exploité en 1882 par le chanoine Emmanuel Chabauty, dans Les Juifs, nos maîtres !, ouvrage d’inspiration apocalyptique où il s’efforce d’établir que Satan, à travers le complot judéo-maçonnique qui explique la multiplication des révolutions, prépare le triomphe de l’Antéchrist juif et la domination mondiale des Juifs27. Chabauty commence par reproduire un document qu’il donne pour une preuve de sa thèse : il s’agit de deux lettres datées de 1489 – trois ans donc avant l’expulsion des Juifs d’Espagne, en 1492 -, l’une envoyée par les Juifs d’Arles (ou d’Espagne, selon une première version) aux Juifs de Constantinople, l’autre envoyée par ces derniers en réponse aux questions posées par leurs coreligionnaires d’Arles (ou (p.156) d’Espagne)28. Dans une première version (mentionnant les Juifs d’Espagne), ces lettres ont été publiées en 1583 à Paris, par un certain Julian Medrano, en espagnol, dans un recueil d’anecdotes plaisantes29. Elles ont été ensuite publiées dans une seconde version (mentionnant les Juifs d’Arles), en français, dans l’ouvrage d’un certain Jean-Baptiste Bouis, prêtre d’Arles, La Royalle Couronne des Roys d’Arles, paru en 16403« . Prenons la version française, utilisée par Chabauty. Les Juifs d’Arles s’inquiétant de la conduite à tenir face à l’injonction du roi de France leur demandant de se convertir ou de partir, de choisir donc entre le baptême et l’expulsion, le prince des Juifs de Constantinople (qui signe « Ussuff», c’est-à-dire Joseph31) leur conseille de ne pas quitter le pays d’accueil et de s’y convertir afin de pouvoir, par diverses ruses, en devenir un jour les maîtres, étape sur la route menant à la domination du monde. C’est donc dans la prétendue « Réponse des Juifs de Constantinople » qu’un anti-judéo-maçon convaincu comme Chabauty pouvait voir une preuve irrécusable de l’existence d’un projet juif de domination du monde. Ce prétendu projet comporte une énumération de conseils tactico-stratégiques : par des ruses ou des minicomplots, il s’agit de ruiner les chrétiens, de les tuer, de détruire leur religion, afin d’éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à la conquête juive du monde.
(…)
Cent vingt ans plus tard, l’interprétation démonisante de la révolution bolchevique, au moment où les Protocoles s’imposent comme la grille permettant de décrypter la marche du monde, s’est modelée sur cette lecture conspirationniste de la Révolution française, qui a fait tradition au XIXe siècle, non sans fusionner avec la vision du complot juif international33. En février 1920, alors que les Protocoles viennent tout juste d’être traduits en anglais, Winston Churchill, alors ministre de la Guerre, reprend à son compte la vision conspirationniste de la Révolution bolchevique diffusée par les émigrés russes antisémites, anti-maçons et antibolcheviks : « Ce mouvement parmi les Juifs n’est pas nouveau. Depuis l’époque de Spartacus Weishaupt34, en passant par celle de Karl Marx, (p.157) pour en arriver maintenant à celle de Trotski (Russie), Bêla Kuhn (Hongrie), Rosa Luxemburg (Allemagne) et Emma Goldman (États-Unis), cette conspiration mondiale pour anéantir la civilisation et pour reconstruire la société sur la base de l’arrêt du développement, d’une méchanceté envieuse et d’une impossible égalité n’a fait que s’étendre régulièrement. Comme l’a si bien montré un auteur moderne, Mrs. Webster, elle a joué un rôle clairement perceptible dans la tragédie de la Révolution française. Elle a été le ressort de tous les mouvements subversifs au cours du XIXe siècle (.. .)35. »
(p.157) Henry Ford, entrepreneur d’antisémitisme
En 1920, aux États-Unis, l’industriel et milliardaire Henry Ford (1863-1947), conseillé par son bras droit Ernest G. Liebold, décide de financer la diffusion des principaux thèmes d’accusation antijuifs s’inspirant des Protocoles, et utilise pour ce faire les services d’antisémites russes ou allemands : l’avocat Boris Brasol (ancien membre dirigeant des Centuries noires)38, August Mùller ou Nathalie de Bogory, auxquels vont s’ajouter le comte A. I. Cherep-Spiridovitch, ami de Brasol39, et Pacquita de Chichmarev, dite Leslie Fry, chargée par Ford de chercher partout dans le (p.158) monde des preuves de l’authenticité des Protocoles4« . De novembre 1920 à mai 1922, Ford publie sous le titre générique : The International Jew (sans nom d’auteur sur la couverture), en quatre tomes, une sélection d’articles parus à partir du 22 mai 1920 (et jusqu’en janvier 1922), sous sa direction et celle de son rédacteur en chef William J. Cameron, dans son hebdomadaire à forte diffusion (300 000 exemplaires), The Dearborn Independen^, distribué à l’échelle nationale par les concessionnaires automobiles Ford42. Le tirage du premier volume du Juif international, paru en novembre 1920, est considérable : un demi-million d’exemplaires43. Il est significativement sous-titré : The World’s Foremost Problem (« Le principal problème mondial »). Mais l’objectif que Ford et ses collaborateurs se sont donné en publiant en volume séparé cette collection d’articles, c’est d’américaniser le système d’accusations véhiculé par les Protocoles, c’est-à-dire, pour l’essentiel, d’acclimater le mythe du complot juif, en illustrant les « thèses » des Protocoles par des exemples tirés de la vie politique, économique et culturelle américaine.
(p.159) Sous l’influence de son secrétaire personnel et éminence grise, Ernest G. Liebold, antisémite fanatique59, Ford s’est vite convaincu de F authenticité des Protocoles, depuis que le « document », introduit aux États-Unis par Boris Brasol, puis traduit en américain par Nathalie de Bogory pour les services secrets américains, lui a été transmis en 191960. En 1922, dans son autobiographie intitulée Ma vie et mon œuvre, Ford s’efforce de justifier la publication dans son hebdomadaire de cette longue série d’articles contre les Juifs : « Certains courants d’influence ont été observés, dans ce pays, qui ont causé une détérioration marquée de notre littérature, de nos divertissements, de notre conduite sociale ; le travail s’est départi du sens profond qu’il avait autrefois ; on constate partout une chute des principes moraux. Le fait que ces influences prennent toutes leur origine au sein d’une même entité raciale est à prendre en sérieuse considération (…). Notre livre ne prétend pas avoir dit le dernier mot sur les Juifs en Amérique. Il ne fait que relater leur impact présent dans ce pays. Il suffit que les gens apprennent à identifier l’origine et la nature des influences qui (p.160) évoluent autour d’eux. Que le peuple américain comprenne une bonne fois qu’il n’y a pas de dégénérescence naturelle, mais une subversion préméditée qui nous meurtrit : dès lors, il sera sauf. »
Faire connaître les Protocoles et révéler leur contenu, c’est pour Ford lutter contre les Juifs, selon un principe simple : on ne peut lutter efficacement contre des ennemis cachés, redoutables manipulateurs occultes, qu’en dévoilant leurs secrets. Dans Le Juif international, cette vision du combat « culturel » contre les Juifs est sans cesse affirmée : « Le Programme juif échoue dès lors qu’il a été perçu et identifié62. » Attribués à Ford, propriétaire internationalement célèbre de l’hebdomadaire The Dear-born Independent, les articles publiés sous le titre The International Jew sont en réalité dus à Cameron, Brasol et Millier. L’ouvrage, dans une version abrégée en deux volumes, est rapidement traduit en allemand et publié en 1921-1922 par les soins de Theodor Fritsch (1852-1933), le « Vieux Maître de l’antisémitisme » allemand63, fondateur et directeur d’une maison d’édition spécialisée en littérature « volkisch » et antisémite (Hammer-Verlag)64. Ce recueil d’articles sera lu et apprécié par Hitler lui-même, qui parle de Ford en termes élogieux à ses partisans et a accroché un portrait de lui sur un mur de son bureau, au quartier général du parti nazi à Munich. Hitler se vantera également du soutien financier que Ford lui aurait accordé65. Le 8 mars 1923, apprenant que Ford pourrait se présenter à l’élection présidentielle américaine, il fait cette déclaration au correspondant du Chicago Tribune en Allemagne : « J’aimerais pouvoir lui envoyer quelques-unes de mes troupes de choc à Chicago et dans d’autres grandes villes américaines pour aider à son élection. Pour nous, Heinrich [sic] Ford est le chef du jeune mouvement fasciste aux États-Unis (…). Nous venons de traduire et de publier ses articles antijuifs. Des millions d’exemplaires de ce livre vont circuler dans toute l’Allemagne66. » Ce même correspondant du Chicago Tribune précise que l’organisation nazie à Munich envoie les livres de M. Ford « par camions entiers67 ». Les nazis ne peuvent que se montrer enthousiastes à la lecture des certains passages du Juif international qui les concernent directement, par exemple : « La principale source de la maladie du corps national allemand (…), c’est l’influence des Juifs », ou encore : « II n’y a pas dans le monde de contraste plus fort que celui entre la pure race germanique et la pure race sémite68. » Entre 1921 et 1924, la plupart des dirigeants nazis lisent la traduction allemande du Juif International, Alfred Rosenberg et Joseph Goebbels en tête. Le témoignage de Baldur von Schirach (1907-1974), le leader de la Hitler-jugend, est particulièrement éclairant sur la réception allemande du pamphlet antijuif. Lors du procès de Nuremberg, Baldur von Schirach déclarera en effet être devenu un antisémite convaincu dès l’âge de dix-sept ans, après avoir lu Le Juif international : « Le livre antisémite décisif que j’ai lu à cette époque, et le livre qui a influencé mes camarades, est celui de Henry Ford, The International Jew. Je l’ai lu et je suis devenu antisémite69. » Plus que les écrits de Houston Stewart Chamberlain ou d’Adolf Bartels, qui l’ont aussi passionné, c’est le recueil d’articles signé Ford qui le convertit à la vision antisémite du monde : « Vous ne pouvez pas imaginer l’influence qu’a eue ce livre sur la pensée de la jeunesse allemande. La (p.161) jeune génération était éperdue d’admiration devant ce symbole du succès et de la prospérité que représentait Henry Ford, et s’il disait que les Juifs étaient coupables, eh bien, naturellement, on le croyait70. » On ne peut mieux caractériser l’effet de légitimation lié au nom même de Ford, qui pourtant n’a guère été que le commanditaire de cet instrument textuel de propagande antijuive.
Soumis à diverses pressions, mais surtout soucieux d’assurer, avec sa bonne réputation, la vente de ses automobiles71, Ford reniera publiquement ses convictions antisémites le 30 juin 1927, en s’engageant notamment à retirer The International Jew de la vente72. Hitler restera cependant un admirateur déclaré de Ford. En 1931, à un journaliste du Détroit News qui lui demandait ce que signifiait pour lui le portrait du magnat américain de l’automobile accroché au mur, Hitler déclare : « Je considère Henry Ford comme mon inspirateur73. » En dépit des engagements pris en juin 1927, Ford ne refusera pas de recevoir, le 30 juillet 1938, pour son soixante-quinzième anniversaire, la grande croix de l’Ordre suprême de l’Aigle allemand, la plus haute décoration décernée par le Troisième Reich à un étranger, dévoilant ainsi les ambiguïtés de ses attitudes vis-à-vis des Juifs ainsi que ses bonnes relations avec les nazis, avec lesquels il fait d’excellentes affaires74. C’est sous une forme abrégée, en un volume (constitué d’un choix d’articles pris dans les quatre volumes de l’édition originale), que l’ouvrage attribué à Ford va être traduit dans nombre de langues européennes et massivement diffusé. Sa traduction en arabe est venue renforcer la propagande « antisioniste » déjà nourrie par les Protocoles et les pamphlets antitalmudiques. Il est resté, au début du XXIe siècle, l’un des principaux véhicules textuels du mythe du complot juif mondial.
Le mythe du complot juif mondial s’inscrit assurément dans une série historique de « mégacomplots » ou complots mondiaux, qui commence avec l’invention, au début du XVIIe siècle, du complot jésuite, et se poursuit, au cours du XVIIIe siècle, par celle du complot maçonnique, qui se métamorphosera en un complot judéo-maçonnique au XIXe siècle. Cependant, en dépit de nombre d’analogies et d’homologies fonctionnelles, les grandes visions conspirationnistes présentent chacune des spécificités, de forme et de contenu. Le mythe du complot jésuite, par exemple, tel qu’il est véhiculé par le faux intitulé Monita sécréta Societatisjesu75, ne fonctionne pas depuis le XVIIe siècle comme celui du complot maçonnique devenu fonctionnel à la fin du XVIIIe (après la Révolution française), et ce dernier, bien que des synthèses anti-judéo-maçonniques se soient multipliées depuis le début du XIXe siècle, ne fonctionne pas en tout point comme celui du complot juif, métamorphosé en « complot sioniste » dans les années 1960 et 1970. Les mêmes remarques valent en ce qui concerne le complot bolchevique et le complot ploutocratique (celui qui est attribué aux « capitalistes apatrides » ou aux « banquiers internationaux »), même si les deux mégacomplots ont pu être intégrés, notamment dans la propagande nationale-socialiste, dans un seul et même supermégacomplot – par jumelage des complots respectivement judéo-bolchevique et judéo-ploutocratique (ou capitaliste).
(p.162) Le complot juif intranational
ou la légende des « deux cents familles »
La langue complotiste est la langue commune des extrêmes, ou la vulgate partagée par les extrémismes politiques de tous bords. Elle est également celle des démagogues, qui tiennent leur puissance de séduction d’une dénonciation indéfiniment répétée des responsables occultes des maux subis par tel ou tel groupe humain, ces responsables étant présentés comme tout-puissants et foncièrement méchants. Il convient cependant de distinguer la thématique du complot mondial ou international de celle du complot intranational, dont les matériaux symboliques varient avec les cultures nationales. Illustrons notre propos : la première thématique, celle des mégacomplots, est illustrée par les Protocoles des Sages de Sion, best-seller et long-seller de la littérature conspirationniste mondiale, alors que la seconde thématique, celle du complot intranational, trouve ses traductions idéologiques, en France, dans la théorie maurrassienne des « Quatre États confédérés » ou dans la dénonciation des « deux cents familles76 ». L’appel au « pays réel » contre le « pays légal », ou à la France française, nationale-catholique, contre les « Maîtres de la France » ou les « Maîtres du Système77 », a fait l’objet, au début du XXe siècle (en 1904 exactement), d’une théorisation due à Charles Maurras. Le maître à penser de l’Action française a baptisé l’oligarchie ou la conjonction d’oligarchies censée conspirer pour dominer et exploiter la « vraie France » les « Quatre États confédérés » : le Juif, le protestant, le franc-maçon, le métèque78 – dont l’équivalent approximatif serait aujourd’hui l’immigré jugé indésirable. C’est en référence à cette construction idéologique, parfois réactualisée par l’adjonction de « l’appareil communiste79 », que s’opère depuis plus d’un siècle, dans les milieux nationalistes français, la dénonciation de « l’Anti-France80 ».
Mais la vision du complot intranational n’a nullement été monopolisée par l’extrême droite. Au XXe siècle, les démagogues conspiration-nistes, de droite comme de gauche, révolutionnaires ou conservateurs, ont ainsi ressassé un thème d’accusation devenu célèbre : celui des « deux cents familles ». En France, dans les années 1930, par exemple, ce thème forme un lieu commun de la rhétorique complotiste, dont on trouve une version communiste et une version fascisante ou nazifiante. Commençons par rappeler comment, dans la langue de bois communiste, au milieu même des années 1960, le thème des « deux cents familles » supposées responsables des malheurs de la France est toujours intégré dans le refrain national-progressiste psalmodié par les leaders communistes, Maurice Thorez en tête. Ce fidèle stalinien, dans son discours de clôture du XVIIe Congrès du PCF tenu à Paris, du 14 au 17 mai 1964, déclare ainsi : « Au long de toutes ces années, le peuple de France a de plus en plus reconnu dans notre Parti le porteur de ses espoirs. Dès notre (p.163) VHP Congrès, en 1936, pour assurer l’avenir du pays, nous appelions à l’union de la nation française contre les deux cents familles qui l’exploitaient. Les communistes dénonçaient et combattaient ceux qui compromettaient le patrimoine national et poussaient le pays à la décadence. Ils rendaient au peuple la Marseillaise et le drapeau tricolore81. »
Revenons brièvement aux années 1930. Lors de la campagne électorale de 1936, Maurice Thorez fustige au micro de Radio-Paris, le 17 avril, « ces deux cents familles qui dominent l’économie et la politique de la France » et qui sont « responsables de la crise et des souffrances qu’elle provoque », mais il n’oublie pas de dénoncer en même temps « les maîtres du pouvoir financier » qui « sont demeurés immuables, incarnant la domination constante du capital82 ». Cet appel dit de la « main tendue » illustre le tournant « nationaliste »/jacobin du PCF, dont le discours de propagande varie sur l’« union du peuple de France » : « Et maintenant, nous travaillons à l’union du peuple de France contre les deux cents familles et leurs mercenaires. Nous travaillons à la véritable réconciliation du peuple de France83. » Tel est le discours anticapitaliste de gauche, lorsqu’il mêle vision complotiste et lyrisme national-patriotique, pour dénoncer la nouvelle « féodalité » mise en place par le capitalisme financier.
Du côté de l’extrême droite fascisante, on dénonce tout autant les « deux cents familles », en les « judaïsant » explicitement. Le 1er avril 1936, La Libre Parole, désormais dirigée par l’antisémite et anti-maçon Henry Coston (1910-2001), titre « Les 200 tribus nous poussent à la guerre84 » -manière de traduire le slogan de l’époque : « Les Juifs veulent la guerre. » La même année, dans une maison d’édition liée au PCF, Augustin Hamon commence la publication d’une somme en trois volumes : Les Maîtres de la France, dont le premier tome a pour sous-tire : La Féodalité financière dans les banquet. L’ouvrage est aussitôt lu et apprécié autant à gauche que dans les milieux anti-judéo-maçonniques. Quelques mois plus tard, Henry Coston, dans sa brochure intitulée Les 200 familles, celles dont on ne parle pas ou les deux cents tribus qui détiennent le pouvoir économique et politique de la France^, commence par citer l’ouvrage d’Augustin Hamon dans un développement introductif sur la « banque juive ». Augustin Hamon, qui se voulait à la fois anarchiste et socialiste, faisait partie, dans les années 1930, de l’opposition de gauche au sein de la SFIO, après une longue carrière d’idéologue conspirationniste, commencée en 1889 avec la publication de son pamphlet, L’Agonie d’une société*1. Dans son livre anti-ploutocratique de 1936, il dénonce ce qu’il appelle, après Toussenel, « la féodalité financière », dont l’emprise s’exercerait dans tous les secteurs de la société française. Et il réserve un traitement particulier, dans son chapitre consacré à « la Haute Banque », aux Rothschild, incarnation d’une puissance financière dénoncée comme un « État dans l’État » : « Toute l’économie française, agriculture, industrie, commerce banque, services concédés est contrôlée par eux soit seuls, soit le plus souvent en coparticipation avec les autres grands banquiers (…). Ceux-ci sont les maîtres économiques du pays aussi bien que les maîtres de sa politique intérieure et extérieure. C’est conjointement que tous ces puissants financiers exercent leur (p.164) pouvoir. Mais de tous, les Rothschild nous apparaissent comme les plus puissants88. »
Dénonciateur des « familles » qui ont fait et font toujours le malheur de la France, Hamon se permet cependant d’en réviser le nombre : « C’est par une vue superficielle des choses que la voix publique a fixé à deux cents familles le nombre de celles qui ont remplacé le roi d’antan. Ce nombre est moindre ou plus élevé, selon que l’on considère les maîtres seuls ou l’ensemble de leurs agents d’exécution. (…) Le nombre des maîtres seuls (…) est de l’ordre d’une centaine de personnes au plus89. » L’influence de Toussenel était déjà très marquée dans son pamphlet de 1889, où il dénonçait « la main puissante, celle de la Haute Finance », qui « tire à sa guise la ficelle de tous ces pantins », les hommes politiques90, et où il fulminait contre « les youddis », ces « maîtres du monde » qui « occupent les hautes fonctions, celles qui donnent des honneurs, de l’argent et de la prépondérance », et laissent « les places où il faut travailler » aux « immondes chrétiens91 ». Nous avons plus haut souligné le fait qu’alors que son maître Fourier s’était contenté de parsemer ses ouvrages de pointes antijuives, Toussenel avait publié en 1845 l’une des premières synthèses antijuives d’orientation anticapitaliste et révolutionnaire : Les Juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière2. Redécouvert une première fois après sa mort (1885) à l’époque de La France juive, dont le succès de librairie favorisera la réédition de son livre (1886), Toussenel continuera d’être une référence commune à tous les courants antijuifs, dans les années 1930 comme sous le régime de Vichy. Les milieux d’extrême droite, y compris les admirateurs de l’Allemagne nazie, rendront gloire à sa mémoire. Le collaborationniste Louis Thomas (1885-1962) lui consacre en 1941 un ouvrage hagiographique, le premier d’une série intitulée « Les précurseurs » : Alphonse Toussenel, socialiste national antisémite (1803-Î885). Sa thèse est aussi opportuniste que simpliste : « Un Toussenel (…) est à la fois socialiste et antisémite. Et il n’est antijuif, en somme, que parce qu’il voit dans les Juifs les pires oppresseurs du peuple. Ce qui est, on l’avouera, exactement l’attitude d’Adolf Hitler dans Mein Kampf4. » Le même Louis Thomas publiera quelques mois plus tard un autre ouvrage sur un autre « maître » ou « précurseur » du « racisme français » (catégorie incluant l’antisémitisme) : Arthur de Gobineau, inventeur du racisme (1816-1882)95. Toussenel est cité par la plupart des ouvrages antisémites publiés sous l’occupation allemande96. Proudhon n’est pas pour autant oublié. En mai 1941, dans la série « Les précurseurs », le romancier et critique littéraire Henri Bachelin publie un essai apologétique intitulé P.-J. Proudhon, socialiste national (1809-1865)97, manière de rappeler que le socialisme français est étranger au marxisme, au faux socialisme «juif». Pierre démenti, le chef du Parti français national-communiste fondé en 1934 (devenu en août 1940 le Parti français national-collectiviste), définissant dans un article publié en janvier 1944 sa « position devant le Juif», conclut ainsi : « De plus en plus, en France, l’impudence et l’avidité du Juif suscitent la révolte. De cette révolte, le Parti français national-collectiviste s’est fait l’expression depuis 193498. Il est le seul parti en France qui ait eu le courage de prendre nettement position à ce sujet. Il (p.165) suit en cela les grands socialistes que furent Fourier, Toussenel, Clovis Hugues, de Mores et tant d’autres ». »
(p.166) Depuis le milieu des années 1990, les « nouveaux maîtres du monde » ont remplacé à la fois les « deux cent familles » et la « dynastie des Rothschild » : les pseudo-explications du malheur des hommes par le complot des puissants ont été repeintes aux couleurs de la mondialisation dite libérale. Désormais, le modèle du complot international prévaut : la cible est le prétendu « gouvernement mondial » diabolisé en tant que « gouvernement secret ». On peut voir une illustration de gauche ou d’extrême gauche de ce modèle conspirationniste dans l’essai polémique de Jean Ziegler Les Nouveaux Maîtres du monde et ceux qui leur résistent, paru en 2002109. Selon l’intellectuel tiers-mondiste proche des milieux « alter-mondialistes », les « nouveaux maîtres du monde » sont « les seigneurs du capital financier mondialisé ». Désignés sans fard, les détestables « maîtres » visés sont les Américains inévitablement « impérialistes » et leurs alliés « sionistes ». Nombre de déclarations incendiaires du président vénézuélien Hugo Chavez et de son ami le président iranien Mahmoud Ahmadinejad vont dans le même sens, accusant les « États-Uniens » et les « sionistes » d’être responsables de tous les malheurs du monde. Il n’y a là rien de nouveau. On trouvait une version d’extrême droite de la même vision complotiste et anti-ploutocratique dans un ouvrage d’Henry Coston, La Fortune anonyme et vagabonde, publié en 1984110. La formule dont Coston a fait le titre de son livre est extraite d’un célèbre discours du duc d’Orléans à San Remo, le 16 février 1899. Elle constitue, chez ce publiciste qui a été un professionnel de la judéophobie de 1929-1930 à sa mort (2001), une métaphore du pouvoir juif international. Persistance du mythe répulsif du « Juif Rothschild », dont la judéophobie anticapitaliste ne cessera de se nourrir. La dénonciation des « oligarchies financières internationales » ne date donc pas de la fin du XXe siècle.
(p.169) Au début de son important essai paru en 1955, Antisémitisme et mystère d’Israël, Fadieï Lovsky reconnaît le caractère mal formé du mot : « Antisémitisme : le mot porte en lui, d’abord, une valeur raciste doublement regrettable ; il ne reflète qu’un seul des aspects historiques d’une réalité vingt-cinq fois séculaire ; il semble envelopper dans la même réprobation les Arabes aussi bien que les Juifs : le Grand Mufti de Jérusalem aurait demandé à Rosenberg de renoncer à un terme injurieux pour certains Sémites, tout en accentuant la persécution contre les Juifs114. » Comme bien d’autres auteurs, Lovsky se résout, en invoquant l’usage, à continuer d’employer ce mot qu’il juge pourtant « mauvais » : « Mais, malgré les excellentes raisons, historiques et bibliques, de ne pas confondre l’élection d’Israël avec la vocation de Sem, il faut bien s’incliner devant les mots du langage courant115. » Cette prescription, pour être sage le plus souvent, ne l’est pas toujours. En 1882, trois ans après l’apparition du mot « Antisemitismus » en langue allemande, forgé par un antisémite militant et aussitôt utilisé comme auto-désignation par les milieux antijuifs, un terme mieux formé (ou plutôt moins mal formé) que le mot « antisémitisme » surgit : le néologisme « judéophobie ». Il est dû à l’inventivité lexicale de Léo Pinsker (1821-1891), qui l’introduit dans son essai intitulé Autoémancipation, où le médecin soucieux de l’avenir du peuple juif s’applique à réfléchir sur le sens des pogroms de 1881 en Russie et définit le projet sioniste116. Dans mes travaux sur les configurations antijuives, j’ai emprunté ce néologisme bien formé à Léo Pinsker, sans pour autant suivre ce dernier dans la définition d’inspiration naïvement psychopathologique qu’il en donne.
3e PARTIE
Racialisation du Juif et biologisation de la « question juive »
(p.175) (…) comment rendre compte du fait que la judéophobie, sous toutes ses formes, puisse se définir dans l’Histoire comme « la haine la plus longue », selon la formule de Robert Wistrich2 ?
(…) En d’autres termes, un récit mythique dure tant qu’il répond à une demande sociale. On est ainsi conduit à formuler l’hypothèse que la force symbolique des récits judéophobes vient de ce qu’ils contribuent à fournir des repères et des horizons de sens aux groupes dans lesquels ils font l’objet de croyances. Les récits antijuifs, aussi mensongers ou chimériques soient-ils, sont dotés d’une fonction ou d’une utilité sociale. Ils s’inscrivent dans telle ou telle vision du monde, ils permettent de structurer des oppositions aussi fondamentales que « ami/ennemi », « proche/étranger », « bien/mal », « bon/mauvais ». D’où une autre démarche susceptible d’être suivie par l’historien ou l’anthropologue des croyances : reconstituer et distinguer les grands récits dans lesquels les Juifs sont construits comme des êtres à part et intrinsèquement dangereux.
(p.177) (p.177) Bref, quelle est la cause diabolique dont dérivent toutes les figures du Mal dans l’Histoire ? La réponse judéophobe est en un sens fort simple : le Juif incarne la causalité diabolique111.
Mais pourquoi donc le Juif ? A cette question il existe une multitude de réponses, à vrai dire toutes insatisfaisantes. Ces réponses oscillent entre trois types d’explications : 1° par la nature spécifique des Juifs (une explication essentialiste avancée surtout par les antijuifs, mais aussi par des auteurs juifs, tel le premier Bernard Lazare, en 1894″) ; 2° par les caractéristiques des sociétés d’accueil hostiles aux Juifs ; 3° par l’interaction entre les comportements du peuple juif et ceux des sociétés où ils ont fait ou font l’objet de sentiments hostiles et de discriminations12. Dans cette dernière perspective, la judéophobie apparaît soit comme une forme particulière de xénophobie, soit comme inséparable d’une configuration xénophobe. On connaît la thèse soutenue par Hannah Arendt : « Le seul antisémitisme durable en France, celui qui survécut à l’antisémitisme social et aux attitudes de mépris des intellectuels anticléricaux, fut lié à une xénophobie générale. Après la Première Guerre mondiale en particulier, les Juifs étrangers devinrent le stéréotype de tous les étrangers13. » Plus précisément, en France, c’est au cours de la grande vague xénophobe des années 1930, centrée sur le rejet de l’immigration, que les Juifs ont joué le rôle des étrangers menaçants par excellence, stigmatisés à travers les métaphores de l’invasion, de la conquête et de la colonisation du pays14. ^ Mais les Juifs ont tout autant été fantasmes comme les plus étrangers des étrangers indésirables lors de la vague xénophobe qui, aux États-Unis, a abouti à l’adoption des lois « restrictionnistes » entre 1921 et 1924b. Dans son fameux manifeste raciste intitulé Le Déclin de la grande race, où il J déplore la disparition progressive des représentants de la « race nordique16 », ‘ remplacés par des types raciaux jugés inférieurs17, Madison Grant caractérise les Juifs comme les plus redoutables des envahisseurs : « L’homme de vieille souche est remplacé dans beaucoup de districts ruraux par des étrangers, tout comme il est aujourd’hui littéralement chassé des rues de New York par les essaims de Juifs polonais. Ces immigrants adoptent le langage de l’Américain d’origine, portent son costume, lui volent son nom et commencent à prendre ses femmes. (…) New York est en train de devenir une cloaca gentium, qui produira de nombreux hybrides de type étonnant et des horreurs ethniques que les futurs anthropologues ne pourront pas débrouiller18. »
(p.179) Aryens et Sémites : inégalité et lutte des races
Au début de son Histoire générale des langues sémitiques, rédigée en 1847 mais publiée seulement en 1855, Ernest Renan, qu’on ne saurait considérer comme un théoricien antijuif, apporte néanmoins, sans le vouloir, sa pierre argumentative à la configuration « antisémite » naissante, en postulant au nom de la science l’infériorité générale et l’imper-fectibilité de la « race sémitique » (incarnée selon lui par les anciens Hébreux et les Arabes) par rapport à la « race indo-européenne », quant à elle perfectible :
« (…) Je suis donc le premier à reconnaître que la race sémitique, comparée à la race indo-européenne, représente réellement une combinaison inférieure de la nature humaine. (…) La race sémitique se reconnaît presque uniquement à des caractères négatifs : elle n’a ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni arts plastiques, ni vie civile (…). En toute chose, on le voit, la race sémitique nous apparaît comme une race incomplète par sa simplicité même. Elle est, si j’ose le dire, à la famille indoeuropéenne ce que la grisaille est à la peinture, ce que le plain-chant est à la musique moderne ; elle manque de cette variété, de cette largeur, de cette surabondance de vie qui est la condition de la perfectibilité’. »
(p.180) Mais Renan, qui ne cache pas ses préférences ethno-raciales, ne dissimule pas non plus ses espérances résumables par ce qu’on pourrait appeler la « désémitisation » de l’esprit européen, notamment dans son discours d’ouverture prononcé au Collège de France le 21 février 1862, « De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation » :
« Quant à l’avenir, Messieurs, j’y vois de plus en plus le triomphe du génie indo-européen. (…) À l’heure qu’il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c’est la destruction de la chose sémitique. (…) L’Europe conquerra le monde et y répandra sa religion, qui est le droit, la liberté, le respect des hommes, cette croyance qu’il y a quelque chose de divin au sein de l’humanité. Dans tous les ordres, le progrès pour les peuples indo-européens consistera à s’éloigner de plus en plus de l’esprit sémitique. Notre religion deviendra de moins en moins juive (…). En morale, nous poursuivrons des délicatesses inconnues aux âpres natures de la Vieille Alliance (…). En politique, nous concilierons deux choses que les peuples sémitiques ont toujours ignorées : la liberté et la forte organisation de l’Etat. (…) En tout, nous poursuivrons la nuance, la finesse au lieu du dogmatisme, le relatif au lieu de l’absolu. Voilà, suivant moi, l’avenir, si l’avenir est au progrès2. »
(…)
Bien entendu, pour Renan, la « destruction de la chose sémitique » n’implique en aucune manière la destruction physique des Juifs, ni même du judaïsme, celui-ci étant pour ainsi dire jeté dans les « poubelles de l’Histoire ». Il reste que les antisémites radicaux qui définiront un programme de « déjudaïsation » (Entjudung) des sociétés modernes pourront se réclamer de Renan, de ce Renan du moins, tant ce dernier a varié dans ses opinions sur la question8.
(p.181)
L’avalanche de négations par laquelle Renan définit la « race sémitique » fera école au point de se transformer en un leitmotiv du discours antisémite des années 1880 et 1890. Les écrits du jeune Renan sont ainsi une source d’inspiration, et vraisemblablement de légitimation, pour les socialistes révolutionnaires blanquistes, comme le montre l’ouvrage J posthume du communard Gustave Tridon, Du molochisme juif9, ou encore l’essai polémique du docteur Albert Regnard, Aryens et Sémites. Le bilan du judaïsme et du christianisme. Mais c’est l’écrivain et journaliste catholique Edouard Drumont qui, dans son best-seller La France juive (1886), donne le ton, en citant précisément des extraits de l’Histoire générale de Renan11, avant de se référer élogieusement à Gustave Tridon12.
(p.182) Les analyses du jeune Renan concernant les « peuples de race sémitique » ont aussi inspiré le grand vulgarisateur du racisme évolutionniste Gustave Le Bon dans sa caractérisation des Juifs comme incarnation de « l’âme simpliste des Sémites » : « Les Juifs n’ont possédé ni arts, ni sciences, ni industrie, ni rien de ce qui constitue une civilisation. Ils n’ont jamais apporté la plus faible contribution à l’édification des connaissances humaines22. » À l’époque de l’affaire Dreyfus, Maurice Barrés s’est montré également, sur ce point, un disciple de Renan et de Soury23, dont il cite volontiers les remarques d’inspiration renanienne, telle celle-ci : « Le sémitisme a dit dans le monde : Je crois, tandis que l’Aryen dit : Je sais, et fonde la science, le sémitisme a toujours mis un obstacle à la science24. »
À la fin de son étude parue en 1855, Renan propose une classification hiérarchique des races qui se seraient succédé sur l’ancien continent : 1° « races inférieures » ; 2° « races civilisées dans le sens matériel » ; 3° « races civilisées dans le sens intellectuel, moral et religieux, Ariens et Sémites ». Cette classification lui permet de nuancer son propos sur l’inégalité entre race indo-européenne et race sémitique : « Si la race indoeuropéenne n’était pas apparue dans le monde, il est clair que le plus haut degré du développement humain eût été quelque chose d’analogue à la société arabe ou juive : la philosophie, le grand art, la haute réflexion, la vie politique eussent été à peine représentés. Si, outre la race indoeuropéenne, la race sémitique n’était pas apparue, l’Egypte et la Chine fussent restées à la tête de l’humanité : le sentiment moral, les idées religieuses épurées, la poésie, l’instinct de l’infini eussent presque entièrement fait défaut25. »
(p.184) Dans ses réflexions critiques sur les thèses de Bauer, publiées en février 1844 sous le titre « À propos de la question juive41 », le jeune Marx reprend à son compte certaines des accusations lancées par Bauer, mais en les réinterprétant dans le cadre de sa théorie « révolutionnaire » et anticapitaliste désignant « l’argent » comme « le dieu jaloux d’Israël » et supposant que « le dieu des Juifs s’est sécularisé et est devenu le dieu mondial42 ». Il y réaffirme notamment avec virulence la thèse de l’infécondité culturelle des Juifs dans tous les domaines : « Ce qui est contenu sous une forme abstraite dans la religion juive, le mépris de la théorie, de l’art, de l’histoire, de l’homme considéré comme son propre but, c’est le point de vue réel et conscient, la vertu de l’homme d’argent. (…) La nationalité chimérique du Juif est la nationalité du commerçant, de l’homme d’argent. La loi sans fondement ni raison n’est que la caricature religieuse de la moralité et du droit sans fondement ni raison, des rites purement formels, dont s’entoure le monde de l’égoïsme43. »
(p.187) Dans la Chanson de Roland, l’armée de Charlemagne affronte des soldats éthiopiens issus de cette « race maudite qui est plus noire que l’encre ».
(p.189) Voltaire, traitant des peuples qui vivent encore comme des animaux et « dont la physionomie est aussi sauvage que les mœurs », assure que « les Nègres sont des êtres presque aussi sauvages, aussi laids que les singes. », ajoutant ailleurs que « c’est par là que les Nègres sont les esclaves des autres hommes ».
(p.190) L’ethnocentrisme, attitude universelle, ne saurait être confondu avec le racisme, construction historique.
(p.191) Il convient de souligner que le théoricien racialiste Gobineau était étranger aux courants antijuifs de son temps, et que son œuvre imprimée ne contient pas de passages exprimant une haine particulière visant les Juifs. Ce qu’on trouve dans l’Essai, c’est au contraire un éloge des Juifs qui se termine ainsi : « Et dans ce misérable coin du monde, que furent les (p.192) Juifs ? Je le répète, un peuple habile en tout ce qu’il entreprit, un peuple libre, un peuple fort, un peuple intelligent, et qui, avant de perdre bravement, les armes à la main, le titre de nation indépendante, avait fourni au monde presque autant de docteurs que de marchands »11. » Un passage d’un texte inédit de Gobineau, Ethnographie de la France, rédigé vers le milieu des années 1870102, montre cependant que Gobineau finit par se laisser imprégner par les clichés antisémites de son temps. Il y soutient notamment la thèse d’une incompatibilité entre la « race occidentale » (germanique) et la « race orientale » (les Juifs) en Alsace-Lorraine et affirme comme une vérité de fait qu’« en dépit des institutions et des lois le Juif demeure un objet agressif et un être déplaisant, partout où son originalité propre est en contact avec une autre originalité1« 3 ».
(p.194) C’est néanmoins sur le principe racialiste affirmé par Disraeli que l’esprit dogmatique qu’est Knox fonde sa caractérisation des Juifs comme des parasites stériles, dénués de toute faculté créatrice et inaptes au travail, voués à ne vivre que par la ruse. Knox enchaîne ainsi les stéréotypes négatifs : « Mais où sont les paysans juifs, et les ouvriers juifs ? Le Juif ne peut-il pas cultiver la terre ? Pourquoi n’aime-il pas travailler de ses mains ? Le véritable Juif n’a pas d’oreille pour la musique, ni d’amour pour la science ou la littérature ; il n’invente rien ; il ne se livre à aucune recherche ; la théorie de Coningsby, appliquée au Juif avéré et cruel, n’est pas simplement une fable, elle est absolument démentie par toute l’Histoire123. » Poliakov a justement souligné la nouveauté de cette argumentation antijuive, tenant à ce que Knox « attribuait uniquement à leur race le parasitisme et la stérilité culturelle des Hébreux, défauts qu’il faisait remonter à la plus haute antiquité124 ». Dans ce discours racialiste où les Juifs sont globalement infériorisés, on peut distinguer deux registres métaphoriques, sur lesquels est confectionnée une multiplicité d’amalgames polémiques : celui du Juif-Noir et celui du Juif-Asiatique.
(p.200) À la fin des années 1930, le docteur Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline, a largement contribué à rendre populaires ces caractéristiques à visée infériorisante du Juif, que le raciologue George Montandon, de son côté, s’efforce de présenter comme scientifiquement établies173. C’est à partir du milieu des années 1930 que le docteur George Montandon (1879-1944), professeur à l’École d’anthropologie de Paris depuis 1931, glisse vers un antisémitisme de plus en plus ordurier, qui le conduira à se rapprocher, en 1938, du propagandiste pro-nazi Henri-Robert Petit et de Céline, qui cite avec admiration « ce très irréprochable savant » et conseille vivement de le lire pour s’instruire sur la « question juive174 ». Selon Céline, Montandon fait partie de ces « judéologues » qui, «possèdent leur science à fond, sur le bout des doigts, les rudiments, l’Histoire des Juifs, du complot juif depuis l’Ethnologie, la Biologie du Juif», et dont les « travaux sont célèbres, incontestés, fondamentaux175 ». En mars 1941, Montandon lance, avec son disciple Gérard Mauger, une « revue mensuelle de doctrine ethno-raciale et de vulgarisation scientifique » : L’Ethnie française, où les textes antijuifs sont surreprésentés. A la fin de son Histoire de l’antisémitisme, publiée en 1942, l’ancien compagnon d’armes de Drumont, Jean Drault, désormais instruit sur les caractères « négroïdes » ou « mongolo-négroïdes » du Juif, écrit à propos de ce dernier : « Sa mentalité de négroïde, si bien observée par Céline, le rendra toujours docile aux ordres de son rabbin talmudique, comme le primitif de la forêt équatoriale qui tremble devant son sorcier nègre176. » L’ouvrage de Jean Drault lui vaudra une lettre de Céline, publiée dans Le Réveil du peuple du 1er mai 1942 : « Votre ouvrage devrait être au programme des écoles, obligatoire. Les droits et les devoirs de l’Aryen, tout y est. Peut-être vous trouverais-je encore bien indulgent pour la chrétienté, que je mets sur le même plan que la juiverie, tel est mon extrémisme (…). Votre livre est une somme177. »
Dans son premier pamphlet paru en décembre 1937, Bagatelles pour un massacre, Céline, traitant de la « musique moderne », c’est-à-dire de la musique « judéo-négroïde » qu’est pour lui le jazz, affirme que « le sémite, nègre en réalité, n’est qu’une perpétuelle brute en tam-tam178 », puis dénonce: «La musique moderne n’est qu’un tam-tam en transition… C’est le nègre juif qui nous tâte pour savoir à quel point nous sommes dégénérés et pourris, notre sensibilité aryenne négrifiée179… » Mais il n’est point de dénonciation sans prophétie de malheur : « Le nègre juif est en train de faire dégringoler l’Aryen dans le communisme et l’art robot, à la mentalité de parfaits esclaves pour Juifs. (Le Juif est un nègre, la race (p.201)
sémite n’existe pas, c’est une invention de franc-maçon, le Juif n’est que le produit d’un croisement de nègres et de barbares asiates.)180 » Dans L’Ecole des cadavres, en 1938, Céline donne cette définition polémique des Juifs comme métis dangereux : « Les Juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides loupés, tiraillés qui doivent disparaître’81. » L’africanisation du « Juif négroïde » est l’un des thèmes récurrents du pamphlet : « Le Juif négroïde bousilleur, parasite tintamarrant, crétino-virulent parodiste, s’est toujours démontré foutrement incapable de civiliser le plus minime canton de ses propres pouilleries syriaques182. » Et de dénoncer la guerre conduite par les «judéo-négroïdes» contre la race aryenne : r « Juifs négroïdes contre Blancs. Rien de plus, rien de moins. Depuis l’Egypte, même ritournelle183. » Le Juif est perçu par Céline comme une puissance de métissage, dont le projet racialement destructeur est de réaliser le « méli-mélo racial à toute force » : « En somme, la réalisation d’un gigantesque cancer mondial, composé de toutes nos viandes pour la jouissance, la vengeance, la prédominance du juif. Lui, le bâtard, l’hybride le plus répugnant du monde prendrait à force de nous saloper, en comparaison, une petite allure intégrale, authentique, précieuse, raffinée184. » Quelle est pour Céline la « grande entreprise juive » ? La réponse tient en une phrase : « L’Asservissement total des goyes par pollutions systématiques, salopages forcenés, hybridations à toute berzingue, enculeries négroïdes massives185.
Dans une autre perspective, l’essentiaiisation biologisante du Juif apparaît comme une nouvelle élaboration de la xénophobie ciblée, à forte charge symbolique, visant les Juifs. À l’âge du nationalisme dont l’idéal moteur est la réalisation de l’homogénéité de la population nationale, le principal effet pratique de la racialisation revient à réduire l’éventail des « solutions » possibles de la « question juive » : elle permet notamment de récuser, au nom de la science, les voies de la ségrégation (le Juif étant par nature conquérant, il ne saurait respecter sa stricte condition ghettoïque) et de l’assimilation (le Juif étant par nature inassimilable), voire celle de la conversion (le Juif, par nature inconvertible, est toujours un faux converti). Il ne reste plus que les voies de l’expulsion et de l’extermination. Lors du premier meeting du Comité antijuif de France, organisé à la salle Wagram le 11 mai 1937, son président, l’agitateur antisémite Louis Darquier (dit « Darquier de Pellepoix »), indique aux militants antijuifs conviés la voie à suivre avant que la guerre n’éclate : « II faut, de toute urgence, résoudre la question juive : que les Juifs soient expulsés ou qu’ils soient massacrés186 ! » C’est au croisement de ces deux « solutions » qu’on rencontre Céline qui, en 1938, présente avec sa virulence propre son programme biopolitique de « nettoyage » : « Racisme d’abord ! Racisme avant tout ! (…) Désinfection ! Nettoyage ! Une seule race en France : l’Aryenne ! (…) Les Juifs, hybrides afro-asiatiques, quart, demi nègres et proches orientaux, fornica-teurs déchaînés, n’ont rien à faire dans ce pays. Ils doivent foutre le camp. (…) Les Juifs sont ici pour notre malheur. (…) Ce sont les Juifs qui ont coulé l’Espagne par métissage. Ils nous font subir le même traitement. (…) Nous nous débarrasserons des Juifs, ou bien nous crèverons des Juifs, par guerres, hybridations burlesques, négrifications mortelles. (…)
(p.212) Dans un article paru en octobre 1881 dans Le Gaulois, Maupassant, décrivant à coups de stéréotypes répulsifs ce qu’il aurait vu des Juifs dans les régions du Sud algérien, ne cache pas qu’il « comprend » qu’on puisse les massacrer, d’abord en raison de leur laideur repoussante et de leur rapacité : « Dès qu’on avance dans le sud, la race juive se révèle sous un aspect hideux qui fait comprendre la haine féroce de certains peuples contre ces gens, et même les massacres récents. (…) Nous nous indignons violemment quand nous apprenons que les habitants de quelque petite ville inconnue et lointaine ont égorgé et noyé quejques centaines d’enfants d’Israël. Je ne m’étonne plus aujourd’hui (…). À Bou-Saada, on les voit, accroupis en des tanières immondes, bouffis de graisse, sordides et guettant l’Arabe comme une araignée guette la mouche. (…) Les chefs, Caïds, Aghas ou Bach’agas, tombent également dans les griffes de ces rapaces qui sont le fléau, la plaie saignante de notre colonie, le grand obstacle à la civilisation et au bien-être de l’Arabe247. » Maupassant insiste particulièrement sur le pouvoir conféré par l’usure : « Le Juif est maître de tout le sud de l’Algérie. Il n’est guère d’Arabes, en effet, qui n’aient une dette, car l’Arabe n’aime pas rendre. Il préfère renouveler son billet à cent ou deux cents pour cent. (…) Le Juif, d’ailleurs, dans tout le Sud, ne pratique guère que l’usure par tous les moyens aussi déloyaux que possible248. » L’écrivain supposé éclairé, défenseur du progrès ainsi que de « l’action civilisatrice » des peuples censés être les plus avancés sur l’échelle de la civilisation, en arrive à « comprendre » les réactions antijuives, voire à justifier implicitement les pogroms, reprenant à son compte, sans examen critique, les métaphores animalières les plus attendues de l’antisémitisme militant, de l’« araignée » au « rapace249 ».
(p.215) Prenons un autre exemple, dans la littérature fasciste à la française, d’une caractérisation négative du Juif où la dimension esthétique est dominante. En avril 1937, dans Le Franciste, organe du fasciste français Marcel Bucard, on peut lire cette description du «Juif errant » : « Qui n’a vu dans les rues de Paris cette silhouette caractéristique ? Il marche à pas menus, il trottine (…). Sa démarche est celle d’un rat. (…) Le grand jour l’effraye, le rend timide, mais dès que l’ombre descend, il se sent devenir arrogant. (…) Combien en trouvons-nous, (…) le poil noir, frisottant, mal semé, l’œil recouvert par un sourcil broussailleux, protégé par un verre de myope, afin d’éviter de vous regarder en face, la peau grasse et jaune, court, épais et trapu, la main molle, froide, grasse et humide, vivant de l’offre des clients18. » Les innombrables et répétitives descriptions d’inspiration physiognomonique qui, dans les portraits antijuifs des Juifs, recourent à l’animalisation de ces derniers, visent tout autant à provoquer chez le lecteur un « réflexe de répulsion », ainsi que le note l’historien Ralph Schor19. Dans son pamphlet contre Léon Bum, illustration supposée du « type juif », le pamphlétaire Laurent Viguier bestialise sa cible en oscillant entre l’image du chameau et celle du singe : « Le front et le menton fuient en laissant le nez en avant-garde. (…) On dirait que tous les organes ont été attachés à des ficelles et tirés d’un coup derrière la tête. Il en résulte les types lièvre, gazelle, chameau. (…) Les oreilles sont, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, extrêmement mal faites, énormes, épaisses, en feuilles de chou, avec tendance à être décollées de la tête et perpendiculaires au plan des joues comme des oreilles de singe20. »
(p.216)
En outre, en raison des nombreuses maladies qu’ils transportent avec eux, les Juifs encombrent les hôpitaux français. C’est là un thème ressassé dans la littérature pamphlétaire des années 1930. En 1939, dans Pleins Pouvoirs, Jean Giraudoux dénonce cette «horde (…) que sa constitution physique, précaire et anormale, amène par milliers dans nos hôpitaux qu’elle encombre26 ». Aux yeux de Céline, qui semble à cet égard s’être mis à l’école de l’antisémitisme allemand qui, de Dühring à Streicher, varie inlassablement sur le thème, le Juif ne peut vivre qu’en parasite (p.217) destructeur, sur le mode du « virus » ou du « bacille », termes employés en concurrence avec la métaphore polémique du « pou27 ». Assimilé à un germe pathogène ou à un insecte parasitaire, il incarne une formidable puissance d’« infection », terme médical qui vient tout naturellement sous la plume du médecin hygiéniste. Mais Darquier de Pellepoix l’a précédé en la matière, qui écrit en juin 1937 dans son bulletin L’Antijuif : « On ne combat la maladie qu’en s’attaquant au microbe. L’élément de désintégration, l’élément de division, le microbe, c’est le JUIF28. » Céline affectionne tout autant la métaphore polémique du « microbe » ou du germe infectieux, et joue à comparer «juif» et « microbe » : « On veut se débarrasser du juif, ou on ne veut pas s’en débarrasser. (…) Le chirurgien fait-il une distinction entre les bons et les mauvais microbes ? (…). Tout est mystérieux dans le microbe comme tout est mystérieux dans le juif. Un tel microbe si gentil, un tel juif si louable hier, sera demain la rage, la damnation, l’infernal fléau. (…) Saprophytes inoffensifs, juifs inoffensifs, germes semi-virulents, virulents seront demain virulissimes, foudroyants. Ce sont les mêmes juifs, les mêmes microbes, à divers moments de leur histoire, c’est tout29. » Définissant en quelques lignes cette opposition axiologique fondamentale (santé/morbidité), Céline écrit à Milton Hindus le 23 août 1947 : «Je suis païen par mon adoration absolue pour la beauté physique, pour la santé -Je hais la maladie, la pénitence, le morbide – grec à cet égard totalement -J’adule l’enfance saine -je m’en Pâme -je tomberai facilement éperdument amoureux -je dis amoureux – d’une petite fille de 4 ans en pleine grâce et beauté blonde et santé30. » II ajoute qu’il ressent « l’appel irrésistible de la jeunesse (même l’extrême jeunesse – saine et joyeuse)31 ». La beauté se définit comme l’éclat de la santé alliée à la jeunesse. A sa manière, Céline articule l’antisémitisme et le philhellénisme.
(p.221) À la fin des années 1870, Wagner se déclare partisan d’« interdire les fêtes juives (…) et les prétentieuses synagogues66». Peu après que le démagogue antisémite Adolf Stocker a lancé à Berlin, le 19 septembre 1879, ses attaques contre les Juifs et leur « arrogance », Cosima Wagner note dans son Journal, le 17 octobre : «Je suis en train de lire un très bon discours du pasteur Stocker sur le judaïsme. Richard est partisan d’une expulsion complète. Nous constatons en riant que son article sur les Juifs semble bien avoir été à l’origine de ce combat67. » Dans une lettre adressée le 16 janvier 1881 au nouvel ami français du couple, Gobineau, dont Cosima et Richard lisent les écrits avec passion depuis l’automne 1880, Cosima confie à son correspondant: «Je vois l’Allemagne comme le monde romain « pourrie d’éléments sémitiques » et tout moniale que je sois, cela me contrarie et je voudrais me démener68. » Ce sentiment d’une invasion ou d’une infiltration juive – ou « sémitique », dans le langage pseudo-savant de l’époque – est partagé par les époux Wagner. Partisan de l’expulsion des Juifs, Wagner se heurte cependant à un obstacle : si en effet, comme il le pense, la «judaïsation » de la vie moderne est accomplie, s’il est vrai que « le Juif est en nous » – ainsi que l’afErmera le wagnérien Chamberlain -, alors il est trop tard pour réagir avec efficacité.
(p.222) Wagner peut être considéré comme l’un des grands représentants de l’« antisémitisme révolutionnaire » en Allemagne72.
(…)Wagner a laissé en héritage aux Allemands une vision antijuive parfaitement définie dans une lettre qu’il adressa le 22 novembre 1881 à Louis II de Bavière : «Je tiens la race juive pour l’ennemie-née de la pure humanité et de tout ce qu’il y a de noble en elle. Il est certain, en particulier, que cette race sera notre perte à nous autres Allemands, et je suis peut-être le dernier Allemand qui, comme artiste, aura su tenir tête au judaïsme déjà omnipotent75. »
(p.223) Avant même son séjour à Vienne (où il s’installe en février 1908), le jeune Hitler est un adepte du culte wagnérien79. Et, comme on sait, l’apothéose du wagné-risme comme vision esthétique et antisémite du monde aura lieu sous le Troisième Reich80.
Chez les idéologues antisémites allemands de la fin du XIXe siècle, le ‘ programme de déjudaïsation comporte un volet politique minimal : priver les Juifs de leurs droits civiques. Les plus radicaux proposent l’expulsion de tous les Juifs, non sans laisser entendre, comme l’antisémite antichrétien Dùhring, qu’ils pourraient être éliminés physiquement31. Dùhring affirme en effet que « le massacre et l’extermination » (Ertötung und Ausrottung) sont le seul moyen de détruire le judaïsme (Judentum)82. En 1901, dans la cinquième édition refondue de son livre sur la « question juive », ce socialiste anti-marxiste exige « l’anéantissement [ Vernichtung] de la nation juive83 ». Il suppose que seules « la terreur et la force brute » peuvent venir à bout des Juifs, ces « étrangers parasites84 ». Dans l’édition posthume du même ouvrage (corrigé en 1920), il affirme en guise de conclusion qu’il « n’y a pas de place sur la Terre pour les Juifs85 ».
Fin mars 1944, avec l’aval du Führer, Alfred Rosenberg rencontre Hans Frank à Cracovie, en vue d’organiser un congrès antijuif international. Parmi les invités, outre les dignitaires et les universitaires nazis (Joachim von Ribbentrop, Joseph Goebbels, Hans F. K. Günther, Walter Gross, etc.), sont pressentis le Grand Mufti de Jérusalem86, Vidkun Quisling, Giovanni Preziosi87, René Martial88, Alexis Carrel, Léon Degrelle, Louis-Ferdinand Céline et John Amery (lequel, identifié comme étant « un quart juif», sera rayé de la liste). À la mi-juin, Hitler décide d’annuler ce congrès, jugé inopportun compte tenu de la situation sur le front89. Mais le raciologue Günther a déjà rédigé sa communication, qu’il a significativement intitulée « L’invasion des Juifs dans la vie culturelle des nations ». À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une atmosphère apocalyptique, l’antisémitisme culturel dont Richard Wagner a été le prophète dès le milieu du XIXe siècle est toujours à l’ordre du jour chez ses héritiers nationaux-socialistes: la hantise de la « judaïsation » (Verjudung) de la culture est restée profondément enracinée dans les mentalités.
(p.225) / Le cas Hitler/
Dans ses diatribes sur le « parasitisme » culturel des Juifs, Hitler se montre un disciple attentif de Wagner. Il est difficile de ne pas percevoir un écho de ces diatribes hitlériennes dans tel ou tel passage du premier des pamphlets de Céline, Bagatelles pour un massacre : « Le Juif ne s’assimile jamais, il singe, salope et déteste. Il ne peut se livrer qu’à un mimétisme grossier (. .). Le Juif nègre, métissé, dégénéré, en s’efforçant à l’art européen, mutile, massacre et n’ajoute rien104. »
(p.250) Haine du genre humain et déicide
Aux origines de la déshumanisation des Juifs
Commençons par le premier grand thème judéophobe, présent dans l’Antiquité préchrétienne (en Egypte, en Grèce, à Rome), qui surgit en tant que forme spécifique de xénophobie visant les Juifs : l’accusation de haine pour les autres peuples, donc de xénophobie indistincte ou généralisée, que le christianisme transformera pour l’essentiel en accusation de déicide, impliquant une haine de Dieu qui ne peut être inspirée que par le Diable4. Ennemis des hommes, ennemis de Dieu : c’est sur la base de ces deux représentations qui s’entrecroisent que va s’opérer la déshumanisation polémique du peuple juif. La transformation de l’accusation de peuple xénophobe en celle de « peuple déicide » illustre le passage de l’ordre du préjugé à celui de la construction mythique, centrée sur la diabolisation des Juifs en tant que Juifs, ouvrant sur un monde imaginaire où les Juifs sont réinventés comme des êtres malfaisants à tous égards.
Norman Cohn, à l’instar de Gavin Langmuir, voit dans la diabolisation et la substitution d’un monde chimérique au monde réel le propre de la judéophobie occidentale, et en désigne le christianisme comme le premier moteur et la fabrique originelle5. Ecrire l’histoire de la judéophobie en Occident, c’est dès lors commencer par reconstituer la genèse de la démonologie créée par l’Église dans son combat contre la Synagogue : « À travers tout l’Occident, l’image traditionnelle du Juif a été celle d’un être mystérieux, doté de pouvoirs troublants et sinistres. Cette vue remonte aux premiers siècles de notre ère, à l’époque où l’Église et la Synagogue se disputaient les prosélytes dans le monde hellénistique, et tentaient même de recruter des adeptes l’une chez l’autre. C’est pour pousser les chrétiens judaïsants d’Antioche à une rupture définitive avec la religion mère que saint Jean Chrysostome qualifiait la Synagogue de « temple de démons, (…) caverne des diables, (…) abîme et lieu de perdition », et traitait les Juifs d’assassins et destructeurs, possédés par l’esprit malin. (…) De plus, les Juifs furent apparentés avec le personnage redoutable qu’était l’Antéchrist, « le fils de la perdition », dont le règne tyrannique, d’après (p.251) saint Paul et l’Apocalypse, doit précéder le deuxième avènement du Christ6. »
(p.251) « Haine du genre humain » : l’accusation de « misoxénie » dans le monde antique
On reste dans l’ordre du préjugé xénophobe lorsque les Juifs sont accusés, comme dans l’Egypte ancienne, de montrer une forte cohésion interne ou une influence abusive, voire un étrange « séparatisme » (amixia) qui, impliqué en réalité par le « mode de vie et de pensée prescrit par la Thorah8 », représente un comportement religieux incompréhensible, à propos duquel on fabule et médit volontiers. C’est le cas lorsque ce mode de stigmatisation apparaît par exemple à Rome en octobre 59 avant J.-C. chez Cicéron (106-43 av. J.-C.) plaidant pro Flacco, en faveur du propréteur d’Asie, Lucius Valerius Flaccus, accusé notamment d’avoir confisqué « l’or juif» envoyé tous les ans au Temple de Jérusalem par les Juifs de sa province. Or les Juifs font partie du nombre des accusateurs, ce qui leur vaut d’être pris à partie sans ménagement par l’avocat Cicéron, qui suppose que tout le monde sait « combien leur troupe est nombreuse, combien ils se tiennent entre eux, combien ils sont puissants dans les assemblées ». C’est là suggérer qu’il est difficile de résister à l’influence des (p.252) Juifs, qui agissent dans les assemblées publiques en tant que « foule » (turbd) formant un groupe de pression. Mais Cicéron présente en outre l’exportation de l’or en Asie comme une « superstition barbare » (barbara super-stitio), s’opposant aux valeurs de Rome, donc à la vraie « religion » (religiof. Et le grand orateur de souligner que Flaccus devrait être loué d’avoir su «résister à une superstition barbare (barbame superstitioni resistere) (…), mépriser, dans l’intérêt de la République, cette multitude de Juifs si souvent turbulente dans nos assemblées10 ». C’est aussi comme agités et turbulents, et à ce titre redoutés, que les Juifs apparaissent à Suétone, au temps de Claude11. D’une façon générale, ainsi que le note Jules Isaac, les Romains reprochent surtout aux Juifs d’être un « peuple séditieux, agité, fanatique », mais en même temps, dans l’Empire romain, après la religion romaine, la seule religion licita, autorisée officiellement, est la religion juive12.
Le thème de la solidarité interne du peuple juif relève de la xénophobie antique, sans prendre une dimension mythique, et, à ce titre, il est comparable aux ethnotypes négatifs visant d’autres peuples13. Mais il est parfois jumelé avec l’accusation de haine, qui se prête tout particulièrement à une mythologisation : la « misanthropie » juive est alors construite comme une haine de groupe, la haine d’un groupe humain particulier contre tous les autres groupes humains14. Et une haine qui singularise ce groupe qui seul la porte en lui et la manifeste. Il importe de remarquer que si le « séparatisme » judaïque relève en partie de constats empiriques, la « haine du genre humain » est le produit d’une inférence à visée malveillante. Elle relève de l’intellectualisation des passions dominantes, et représente le premier des grands thèmes d’accusation identifiables dans ce qu’on pourrait appeler, à la suite de Louis H. Feldman, mais en évitant le terme ici impropre d’« antisémitisme », la judéophobie « intellectuelle », distincte de la judéophobie « gouvernementale » et de la judéophobie « populaire15 ». Comme le montre un examen de la littérature hellénistique sur la question, le comportement religieux des Juifs, qui est de l’ordre de l’observable, devient, en raison de « l’ignorance absolue des réalités du judaïsme16 », un phénomène incompréhensible, sauf à l’attribuer à une hostilité envers tous les peuples qui tiendrait à la nature même des Juifs. C’est ainsi que les médisances et les accusations calomnieuses contre les Juifs vont se multiplier, oscillant entre deux groupes de griefs : d’une part, le « séparatisme » et la misanthropie (plus ou moins confondue avec une xénophobie généralisée) et, d’autre part, l’athéisme, l’impiété et la superstition. En Grèce, au début du Ier siècle avant notre ère, avec le philosophe Posidonios d’Apamée (l’un des maîtres de Cicéron) ou le rhéteur Apollonios Molon17, et deux siècles plus tard à Rome, chez Tacite ou Juvénal18, le judaïsme est dénoncé comme une superstitio qu’il est facile d’opposer à la vraie religio 19. Le mépris prévaut chez Juvénal, qui dépeint les Juifs comme des miséreux conduits pour vivre à mendier ou à dire la bonne aventure : « Pour quelque menue monnaie, les Juifs vendent toutes les chimères qu’on voudra2« . » La réaction ethnocentrique observable chez les Grecs face aux Juifs résistant à l’hellénisation, on la retrouve également à Rome, comme le note Carlos Lévy : « Le comportement religieux des (p.253) Juifs, leur respect pour la Loi est également confondu avec la crainte excessive et ridicule qui caractérise la superstition. Expression même d’un mépris philosophique, cette assimilation témoigne de la facilité avec laquelle les intellectuels grecs et latins réduisaient aux catégories de leur psychologie une conduite qu’ils ne comprenaient pas21. »
À en croire la rumeur qui court dans l’Antiquité préchrétienne, les Juifs seraient mus par la « haine du genre humain » (odium humani generis, formule attestée notamment chez Tacite22), et, en tant que tels, ils seraient identifiables comme des – comme les — ennemis du genre humain. Ce thème se traduit par divers stéréotypes négatifs : les Juifs insociables par nature, étrangers, orgueilleux et méprisants, attachés à leurs « superstitions », vivant à part, solidaires entre eux et hostiles à tous les peuples. Soulignons le paradoxe : la judéophobie antique, comme forme spécifique de xénophobie, consiste à accuser les Juifs de xénophobie. Mais cette xénophobie attribuée aux Juifs n’est pas ordinaire : elle est censée faire partie de l’essence du peuple juif3. L essentialisation ouvre la voie à la mythologisation qui sera le propre de l’antijudaïsme chrétien. Ce qu’il faut souligner, c’est que la question religieuse, dans le monde préchrétien, est déjà déterminante. Le grammairien et historien Apion, Grec ou Gréco-Égyptien d’Alexandrie, contemporain de Jésus, de Philon et de l’empereur Tibère qui l’a surnommé « Cymbalum mundi » (quelque chose comme « tam-tam de l’Univers »), est un auteur dont la judéophobie est particulièrement virulente, recourant à plusieurs thèmes d’accusation ainsi énu-mérés par Jules Isaac : « L’infamie des origines juives – les Juifs seraient des lépreux chassés d’Egypte ; la perversité d’hommes qui professent — soi-disant d’après les enseignements de Moïse – la haine du genre humain ; la monstruosité d’une religion qui méprise les dieux et s’adonne aux plus honteuses pratiques : adoration d’une tête d’âne en or, meurtre rituel d’un Grec secrètement capturé et engraissé à cet effet24. »
Accusés d’être motivés par une étrange « haine implacable » (hostile odium) à l’endroit de tous les autres peuples, et d’être les seuls dans ce cas, les Juifs peuvent être caractérisés négativement par leur misanthropie (misanthropia), leur exceptionnelle xénophobie ou, pour parler comme Théodore Reinach, leur misoxénie singulière. Pour être précis, il faudrait dissocier l’accusation de xénophobie ou de misoxénie, c’est-à-dire de « haine des étrangers », liée au caractère « national » du peuple juif25, de celle de misanthropie, soit le fait de « haïr tout le monde26 », où l’on verrait aujourd’hui l’expression d’un pessimisme anthropologique radical. Mais cette distinction sémantique n’est pas respectée dans la littérature gréco-romaine traitant négativement des Juifs, d’où l’apparition d’une misanthropie paradoxale, car sélective, attribuée aux seuls Juifs. Peter Schafer l’a fort clairement caractérisée, en en soulignant l’importance rhétorique : « L’accusation de xénophobie, d’asociabilité et de misanthropie dirigée contre les Juifs était une arme très puissante dans le monde gréco-romain. C’est vrai en particulier pour la misanthropie, qui revêtait deux caractéristiques très particulières et très dévastatrices : elle était dirigée contre les Juifs, non point en tant qu’individus, mais d’abord et avant tout en tant que nation ; et elle était entendue non comme une haine de tout
(p.254) le genre humain, incluant leur propre espèce, mais comme une haine du genre humain, à l’exception de leur propre espèce. Dans ce sens, elle est exprimée, pour la première fois, vers 300 avant l’ère chrétienne (…), à l’intérieur du milieu culturel de l’Egypte grecque et marque, évidemment, d’une teinte spécifiquement grecque une tradition originellement égyptienne (le récit de l’expulsion)27. »
Cette accusation enveloppe le vieux grief d’auto-ségrégation ou de « séparatisme », dont témoigne le discours tenu devant le roi de Perse Assuérus (identifié à Xerxès Ier) par son ministre Haman, l’ennemi par excellence du peuple juif: « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, vivant à part parmi les autres peuples ; ces gens ont des lois différentes de celles de tous les peuples et n’observent point les lois du roi. Il n’est pas de l’intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu’on écrive l’ordre de les faire périr28. » II y a là l’un des plus anciens témoignages du reproche fait aux Juifs de refuser l’intégration dans les autres nations. L’accusation moderne d’inassimilabi-lité y trouve sa lointaine origine. Dans le monde hellénistique, la politique d’hellénisation à outrance menée par Antiochus (ou Antiochos) IV Épiphane, « le premier grand persécuteur des Juifs devant l’histoire29 », représente un moment révélateur du surgissement d’une haine assimilatrice qui, au nom de l’impératif de « civilisation », ne cessera de se manifester au cours de l’ère chrétienne. Cet épisode est connu notamment par les Livres des Maccabées et par les écrits de Flavius Josèphe30. On apprend par le I » Livre des Maccabées que « le roi Antiochos publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu’un seul peuple et que chacun abandonnât sa loi particulière31 ». Tacite fera ce commentaire : « Tant que l’Orient fut au pouvoir des Assyriens, des Mèdes et des Perses, les Juifs étaient les plus méprisés des peuples esclaves. Sous la domination des Macédoniens, le roi Antiochus entreprit de détruire leurs superstitions et de leur donner les mœurs grecques pour réformer ce peuple exécrable. Mais la guerre qu’il dut faire aux Parthes interrompit son projet32. » Face à la résistance des Juifs qui refusent de se « paganiser », c’est-à-dire de se « civiliser » en vivant « selon les coutumes des Grecs33 », Antiochus IV ordonne des pillages, des profanations et des massacres. Jules Isaac voit dans cet épisode, qui a lieu en 168 avant l’ère chrétienne, « la première grande persécution religieuse que l’Histoire connaisse, dont le judaïsme se trouva être la victime, et l’hellénisme l’ordonnateur34 ». Il importe de noter que la religion a été la « cause première » du conflit entre Grecs et Judéens, même si elle n’en est pas la seule (la cupidité et le ressentiment, chez Antiochus IV, jouent un rôle non négligeable)35. Dans la perspective d’une anthropologie historique, cette persécution antijuive prend la valeur d’un paradigme : au nom d’une certaine forme d’universalisme naïvement ethnocentrique, liée à l’exercice d’une puissance impériale et à la conviction de représenter la « civilisation » face à la « barbarie », une minorité refusant de se « normaliser » peut être la victime de violences sans limites.
(…)
(p.255) En affirmant que les Juifs sont les xénophobes et les misanthropes par excellence, et qu’ils le sont en quelque sorte par nature, thèse d’origine gréco-égyptienne formulée d’une façon paradigmatique par un propagandiste comme Apion, un certain nombre d’auteurs égyptiens, grecs et latins ont fondé vers le début du IIIe siècle av. J.-C. ce qu’on pourrait appeler la tradition antijuive. Telle est la thèse soutenue avec des arguments convaincants par Peter Scha’fer : « Si l’accusation de xénophobie-misanthropie est le noyau de F « antisémitisme », on peut faire remonter son émergence dans l’histoire au début du IIIe siècle av. J.-C. (Manéthon et probablement Hécatée) au plus tard, avec certaines racines dans la tradition plus ancienne de l’Egypte37. »
(p.256) La récurrence du thème polémique central, celui de la haine xénophobe ou de la misoxénie, peut être abondamment illustrée, et par des textes des meilleurs auteurs de l’Europe moderne. Pour Voltaire, par exemple, la haine des Juifs pour le reste de l’humanité, « leur horreur pour le reste des hommes55 », se manifeste de la façon la plus simple par leur refus de manger à la même table que les autres56. Voltaire se montre ici un bon élève de Tacite, dont il faut rappeler le passage célèbre des Histoires concernant les Juifs : « Ils ont entre eux un attachement obstiné, une commisération active, qui contraste avec la haine implacable qu’ils portent au reste des hommes. Jamais ils ne mangent, jamais ils ne couchent avec des étrangers, et cette race, quoique très portée à la débauche, s’abstient de tout commerce avec les femmes étrangères57. » Voltaire, dans la XXVe lettre de ses Lettres philosophiques, publiées en 1734, s’en fait l’écho pour la première fois, avec la virulence qu’il réserve à certains sujets : « [Les Juifs] étaient haïs, non parce qu’ils ne croyaient qu’un Dieu, mais parce qu’ils haïssaient ridiculement les autres nations, parce que c’étaient des barbares qui massacraient sans pitié leurs ennemis vaincus, parce que ce vil peuple, superstitieux, ignorant, privé des arts, privé du commerce, méprisait les peuples les plus policés58. » En 1756, traitant de « l’état des Juifs en Europe » dans son Essai sur les mœurs, Voltaire résume ainsi sa vision globalement négative des Juifs : « Vous êtes frappés de cette haine et de ce mépris que toutes les nations ont toujours eus pour les Juifs : c’est la suite inévitable de leur législation ; il fallait, ou qu’ils subjuguassent tout, ou qu’ils fussent écrasés. Il leur fut ordonné d’avoir les nations en horreur, et de se croire souillés s’ils avaient mangé dans un plat qui eût appartenu à un homme d’une autre loi. Ils appelaient les nations vingt à trente bourgades, leurs voisines, qu’ils voulaient exterminer, et ils crurent qu’il fallait
n’avoir rien de commun avec elles. Quand leurs yeux furent un peu ouverts par d’autres nations victorieuses, qui leur apprirent que le monde était plus grand qu’ils ne croyaient, ils se trouvèrent, par leur loi même, ennemis naturels de ces nations, et enfin du genre humain59. » La vieille accusation de haine du genre humain est réitérée en 1767 dans l’opuscule intitulé La Défense de mon onde, lorsque Voltaire, après avoir affirmé qu’« on trouverait plus de cent passages [dans l’Ancien Testament] qui indiquent cette horreur pour tous les peuples qu’ils connaissaient », conclut : « II est donc constant que leur loi les rendait nécessairement les ennemis du genre humain6« . » En 1769, dans l’article «Juifs » de son Dictionnaire philosophique, Voltaire réaffirme ainsi la vieille accusation : « Vous ne trouverez en eux [les Juifs] qu’un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent61. »
(p.258) Intrinsèquement criminalisé par la responsabilité collective qu’on lui prête, le peuple juif est condamné pour son crime et par là même diabo-lisé. La diabolisation du Juif est inscrite ainsi dans le plus ancien héritage culturel de l’Europe chrétienne. Elle peut trouver sa justification théologique dans l’un des Évangiles. Jean (8, 42-44) fait dire au Christ, s’adressant aux Pharisiens : « Si Dieu était votre père, vous m’aimeriez. (…) Vous avez, vous, le diable pour père et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. Celui-là était homicide dès le commencement (…)72. » Dans l’Apocalyse, à deux reprises (2, 9 et 3, 9), sont pris à partie « ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan ». On retrouvera l’expression « synagogue de Satan » dans les titres de nombreux pamphlets antijuifs73. La conviction que les Juifs et Satan ont une commune nature est ainsi attestée dans l’Écriture, de tradition chrétienne74. Par cet argument, il s’agit pour les Pères de l’Église de justifier la rupture avec le judaïsme, afin de purger le christianisme de toute influence juive. À la fin du IVe siècle, dans ses Homélies contre les Juifs75, Saint Jean Chrysostome (344-407), prêtre d’Antioche puis patriarche de Constantinople, exprime sans détours cette conviction : « Les démons habitent (…) dans les âmes des Juifs (…), et ceux d’aujourd’hui sont pires que les premiers ; et il ne faut pas s’en étonner. Autrefois, en effet, ils manquaient de piété envers les prophètes ; mais aujourd’hui, c’est contre le Maître même des prophètes qu’ils lancent leurs outrages76. » Et ce « maître de l’imprécation antijuive77 » de reprendre la métaphore polémique de l’Apocalyse : « Non seulement la synagogue, mais l’âme elle-même du Juif est la citadelle du diable78. » Dans ses attaques contre « la synagogue », la virulence de Jean Chrysostome est extrême, visant à déshumaniser et à démoniser les Juifs : « La synagogue n’est pas seulement un lupanar et un théâtre mais aussi un repaire de brigands, une tanière de bêtes sauvages (…) – pas seulement une tanière de bêtes sauvages mais de bêtes impures. (…) Si Dieu l’a abandonné, cet endroit est devenu la résidence des démons79. » Cette éloquence dans la dénonciation, on la retrouve dans une série de questions rhétoriques par lesquelles Jean Chrysostome, prenant les prophètes juifs à témoin, construit l’image d’un peuple à la fois méprisable et haïssable, qui devait finir par être le meurtrier du Christ : « Quelle sorte de crime n’ont-ils pas perpétré ? Tous les prophètes n’ont-ils pas consacré à leur accusation de nombreux et longs discours ? Quelle tragédie, quelle sorte de crime n’ont-ils pas cachée par leurs meurtres impurs ? Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons ; ils ont ignoré la nature, oublié les douleurs de l’enfantement, foulé aux pieds l’éducation des enfants, renversé et précipité les lois du sang ; ils sont devenus plus cruels que toutes les bêtes sauvages. (…) Eux, sans aucune nécessité, ont égorgé leur progéniture de leurs propres mains pour honorer les ennemis de notre vie, les funestes démons. Qu’est-ce qui pourrait nous frapper davantage, leur impiété ou leur inhumaine cruauté ?
(p.259)
Qu’ils sacrifièrent leurs fils ou qu’ils les sacrifièrent aux démons ? A moins que dans leur impudicité, ils n’aient surpassé l’excessive lascivité des animaux ? (…) Que vous dire d’autre ? Rapines, cupidité, abandon des pauvres, larcins, trafics ? Une journée entière ne suffirait pas pour en faire le récit* ». »
II s’agit avant tout pour Jean Chrysostome de pousser les judaïsants, attachés à certaines pratiques juives, à rompre leurs derniers liens avec le judaïsme81. Un passage de Grégoire de Nysse (332-394) illustre tout autant la virulence des diatribes antijuives des Pères de l’Église : « Meurtriers du Seigneur, assassins des prophètes, rebelles et haineux envers Dieu, ils outragent la Loi, résistent à la grâce, répudient la foi de leurs pères. Comparses du diable, race de vipères, délateurs, calomniateurs, obscurcis du cerveau, levain pharisaïque, sanhédrin de démons, maudits exécrables, lapideurs, ennemis de tout ce qui est beau82… » Derrière cette pluie d’insultes, on entrevoit l’antijudaïsme religieux au sens strict, tel qu’il s’est constitué dans Je christianisme des premiers siècles, autour de ^ l’antagonisme entre l’Église et la Synagogue, et auquel les Pères de l’Église ont donné une forme théologique hautement élaborée, notamment à travers leurs écrits de mission et de polémique antijuive83. Dans cette guerre culturelle entre la religion-mère et la religion-fille, dont l’Église sort victorieuse au IVe siècle, l’antijudaïsme doctrinal en formation s’accompagne d’un immense travail de rationalisation d’ordre théologique visant à justifier la criminalisation, la bestialisation et la diabolisation des Juifs, et donnant lieu à un « enseignement théologique du mépris » (Jules Isaac) qui prend l’allure d’un endoctrinement. Ce « système d’avilissement » progressivement mis en place par l’Église84 est la grande nouveauté de l’antijudaïsme chrétien par rapport à la judéophobie païenne. Une fois institutionnalisé, il a permis la diffusion dans la société médiévale d’un certain nombre de stéréotypes antijuifs dont les Européens modernes, chrétiens ou déchristianisés, ont recueilli l’héritage85. Quoi qu’il en soit, comme le note Gavin Langmuir, l’accusation de déicide « resta le principal stéréotype xénophobe jusqu’en 1096, et, à cette date, elle fut la seule justification donnée aux massacres de la première croisade86 ».
Marcel Simon a fort bien défendu la double thèse de la nouveauté spéculative et du caractère fondateur de l’antijudaïsme chrétien : « Une différence fondamentale sépare (…) l’antisémitisme païen et l’antisémitisme chrétien. Le second revêt, du fait qu’il est entretenu par l’Église, un caractère officiel, systématique et cohérent qui a toujours fait défaut au premier. Il est au service d’une théologie, et est nourri par elle ; il puise ses arguments beaucoup moins dans la constatation de faits précis, ou même dans les affirmations plus ou moins fondées de la malveillance populaire, que dans une certaine exégèse des écrits bibliques interprétés, en fonction de la mort du Christ, comme un long réquisitoire contre le peuple élu. À la différence de l’antisémitisme païen, qui traduit le plus souvent une réaction spontanée, exceptionnellement dirigée et organisée, il poursuit un but précis : rendre les Juifs odieux, maintenir l’aversion qu’ils inspirent à certains éléments de la population, la communiquer à ceux qui professent à leur égard des dispositions plus bienveillantes87. » Dans cette perspective, c’est l’Église qui porte la responsabilité de la diffusion (p.260) et de l’entretien incessant de la haine contre les Juifs. Telle la thèse de Jules Isaac, pour qui l’enseignement chrétien est « la source première et permanente de l’antisémitisme, comme la source puissante, séculaire, sur laquelle toutes les autres variétés de l’antisémitisme » sont « venues en quelque sorte se greffer88 ».
La représentation du Juif comme ennemi absolu, disons « l’Ennemi », a circulé hors des frontières de l’antijudaïsme chrétien après avoir été sécularisée au XVIIIe siècle par Voltaire et le baron d’Holbach, puis réinscrite par les théoriciens socialistes et révolutionnaires, au XIXe siècle, dans la vision anti-ploutocratique du monde. Il en va ainsi lorsque Fourier stigmatise le peuple juif comme « le véritable peuple de l’enfer » et Toussenel comme « le peuple de Satan ». Un ennemi absolu ne peut qu’être un rejeton du principe absolument négatif, Satan. La traduction racialiste du stéréotype peut être illustrée par cette phrase placée par Henri Faugeras en épigraphe de son pamphlet paru en 1943, Les Juifs peuple de proie : « Le peuple juif est l’ennemi héréditaire de tous les peuples89. »
L’antijudaïsme religieux et « ethnique9 » » du Coran fait écho à ces accusations : les Juifs « sont devenus le parti de Satan : ils sont perdus91 », et l’avenir auquel ils sont promis est sans perspective de rachat : « Pour eux, c’est la honte en ce monde, et dans l’autre monde c’est un terrible châtiment92. » Les Juifs sont maudits : « Nous les avons maudits parce qu’ils ont rompu leur alliance avec Nous, parce qu’ils ont été incrédules, parce qu’ils ont tué sans droit les Prophètes93. » Au déicide s’ajoute le pro-phéticide, thème d’accusation réactivé au XXe siècle par l’idéologue islamiste Sayyid Qutb94. Il est souvent repris dans les prêches : aux premiers temps de l’hégire, les Juifs auraient tenté d’empoisonner le Prophète par l’une de ses épouses d’origine juive. Le « parrain » du fondamentalisme islamique, théoricien du Jihad contre les Juifs et de la judéophobie apocalyptique dont Al-Qaida a recueilli l’héritage95, dénonce ainsi les Juifs comme des êtres intrinsèquement pervers, haineux et criminels : « Le Coran a beaucoup parlé des Juifs et a mis en évidence leur méchanceté. Partout où les Juifs ont demeuré ils ont commis des abominations sans précédent. De la part de telles créatures, qui tuent, massacrent et diffamen’ les prophètes, on ne peut attendre que des bains de sang et toutes les méthodes répugnantes par lesquelles ils accomplissent leurs machinations96. » Pour l’idéologue islamiste, la haine de l’islam portée par les Juifs ne se distingue pas de la haine du genre humain, s’il est vrai que l’humanité véritable est représentée par les musulmans, ou incarnée par la Communauté musulmane (Oumma) : « La Communauté musulmane continue de souffrir des mêmes machinations et de la même duplicité juives qui ont déconcerté les premiers musulmans. (…) Les Juifs continuent, par leur méchanceté et leur duplicité, à éloigner cette Communauté de sa Religion et à la rendre étrangère à son Coran. (…) Tous ceux qui éloignent cette Communauté de sa Religion et de son Coran ne peuvent être que des agents juifs, qu’ils agissent sciemment ou non97. »
La dernière phrase de cet extrait de l’opuscule programmatique de Qutb est très significative : elle illustre un procédé rhétorique qu’on rencontre souvent dans le discours polémique, et qui consiste en un élargissement (p.261) de la cible de la stigmatisation. Elle revient par exemple à passer de l’énoncé « tous les Juifs sont des criminels » à l’énoncé « tous les criminels sont des Juifs ». Dans la phrase de Qutb, on glisse de « tous les Juifs sont des anti-musulmans » à « tous les anti-musulmans sont des Juifs » (ou des « agents juifs »). Lors du quatrième congrès de l’Académie de recherches islamiques, organisé à l’Université al-Azhar du Caire en septembre 1968, la plupart des théologiens arabes réunis présentent les Juifs à la fois comme des « ennemis de Dieu » et des « ennemis de l’humanité98 ». Un an après la guerre du Kippour, en 1974, Abdul Halim Mahmoud, directeur de l’Académie de recherche islamique, affirme dans un livre intitulé Jihad et victoire : « Allah ordonne aux musulmans de combattre les amis de Satan où qu’ils se trouvent. Parmi les amis de Satan – en fait, parmi les principaux amis de Satan à notre époque – se trouvent les Juifs ». »
L’interprétation malveillante, à la lumière de l’accusation de déicide, du thème de l’élection divine aura permis aux polémistes chrétiens d’ajouter au stock de stéréotypes hérité de la judéophobie antique celui de « l’orgueil juif », source de mépris et de haine pour les non-Juifs, réinterprété au XXe siècle comme un « orgueil racial »10 », réinvesti enfin dans la vulgate antisioniste contemporaine, où les « sionistes » sont accusés d’« arrogance », de « racisme », d’« impérialisme », etc. » ». Mais l’accusation de déicide, même en Europe, est loin d’avoir disparu au début du XXIe siècle. C’est ce que montre l’enquête réalisée en 2005 par le groupe Taylor Nelson Sofres (TNS), sous la direction scientifique de l’institut First International Resources, sur les « attitudes envers les Juifs dans onze pays européens », rendue publique le 7 juin 2005, dans le cadre de laquelle l’affirmation « Les Juifs sont responsables de la mort du Christ » a été soumise aux personnes interrogées. Deux ans plus tard, en 2007, une seconde enquête du même type est réalisée par le groupe TNS »12. L’analyse des réponses des personnes se déclarant en 2005 « tout à fait » et « plus ou moins d’accord » avec cette affirmation montre que les deux nations dont les citoyens sont les moins enclins à accuser les Juifs de déicide sont l’Allemagne (13 %) et la France (14 %), se distinguant nettement en cela de la Pologne (39 %) et de la Hongrie (26 %). Entre ces deux pôles se trouvent tous les autres pays : de la Suisse (17 %) au Royaume-Uni (22 %), en passant par l’Italie et les Pays-Bas (18 %), l’Espagne (19 %), l’Autriche et la Belgique (20 %). Ce critère présente, en outre, l’avantage de mettre en évidence un facteur culturel déterminant : le degré variable de déchristianisation des pays concernés.
L’enquête de 2005 permet donc d’établir qu’en moyenne 21 % des personnes interrogées à cette date continuent de blâmer les Juifs d’être responsables de la mort du Christ. Il faut souligner le fait que la diffusion dans l’opinion européenne de cette accusation typiquement chrétienne est moindre que celle des accusations visant le « trop de pouvoir » des Juifs « dans le monde des affaires » (31 % en moyenne) ou « sur les marchés financiers internationaux » (33 %), ou que celle concernant la plus grande loyauté des Juifs envers Israël qu’envers la nation d’appartenance (42 %). La seconde enquête réalisée en 2007 dans les mêmes onze pays européens montre que, sur l’accusation de déicide, l’opinion européenne est restée (p.262) globalement stable (autour de 20 %), avec cependant de fortes fluctuations nationales : baisse de 28 % au Royaume-Uni et progression de 30 % en Hongrie, de 25 % en Autriche et de 21 % en Italie. Dans le même temps, de 2005 à 2007, l’addition des réponses positives aux quatre autres questions posées atteste qu’en Europe le taux global de judéophobie est passé de 37 % en 2005 à 43 % en 20071« 3. Ce n’est plus le thème chrétien du «Juif déicide» qui est au centre de la judéophobie «populaire» ou « d’opinion » en Europe, ce sont les thèmes du pouvoir financier et de la déloyauté à l’égard de la nation d’appartenance qui désormais prévalent. Le vieil argument de la « double allégeance » entame ainsi un nouveau cycle de vie, l’attachement exclusif à l’Etat d’Israël remplaçant l’obéissance aveugle aux commandements du Talmud.
(p.263) Prémisses païennes
On connaît le principal motif de l’accusation de « crime rituel », forgée par l’antijudaïsme chrétien médiéval à partir du XIIe siècle : l’affirmation qu’existé une coutume juive consistant à sacrifier chaque année, à la veille de la Pâque juive (Pessali), un chrétien, un enfant de préférence, pour en recueillir le sang, qui doit servir à fabriquer la matza, le pain azyme consommé pendant la fête de Pâque, commémorant l’exode d’Egypte1« 4. L’accusation de meurtre rituel est cependant déjà présente dans l’Antiquité grecque et romaine, sous des formes différentes. À en croire Flavius Josèphe (Contre Apion, II, 8), le grammairien Apion (première moitié du Ier siècle après J.-C.), dans son Histoire d’Egypte (IIIe livre), aurait accusé les Juifs de pratiquer des meurtres rituels dont les victimes étaient des Grecs: «Les Juifs (…) s’emparaient d’un voyageur grec, l’engraissaient pendant une année, puis, au bout de ce temps, le conduisaient dans une forêt où ils l’immolaient ; son corps était sacrifié suivant les rites prescrits, et les Juifs, goûtant de ses entrailles, juraient, en sacrifiant le Grec, de rester les ennemis des Grecs ; ensuite ils jetaient dans un fossé les restes de leur victime105. » L’historien Damocrite, avant Apion, affirme que « tous les sept ans ils [les Juifs] capturaient un étranger, l’amenaient [dans leur temple], et l’immolaient en coupant ses chairs en petits morceaux »16 ». On trouve également ce récit d’accusation chez le célèbre rhéteur Apollonios Molon, né à Alexandrie puis établi à Rhodes, au début du Ier siècle avant J.-C.107. La rumeur de crime rituel chez les Juifs a été vraisemblablement notée pour la première fois, ou fabriquée pour justifier la profanation et le pillage du temple par Antiochus IV Épiphane en 168′ »8, par l’historien Posidonios au IIe siècle avant J.-C. On peut supposer que la rumeur exprimait la haine qu’éprouvaient les Grecs à l’égard des Juifs, en particulier à Alexandrie109. Cecil Roth, en 1933, voyait dans le type d’accusation lancé par Apion et d’autres le premier stade de l’accusation de crime rituel, fondé sur le raisonnement suivant : puisque les Juifs sont les ennemis du genre humain, ils sont tout à fait capables de commettre de tels crimes110. Au cours du IIe siècle après J.-C., des accusations analogues seront portées par les Romains contre les chrétiens, les victimes supposées étant des enfants : à l’accusation de cannibalisme rituel s’ajoutera celle d’infanticide rituel111.
(p.264) Réinvention chrétienne du crime rituel et fabrique d’« enfants martyrs »
Dans la légende une fois fixée dans le contexte du christianisme médiéval, vers le milieu du XIIe siècle, un cérémonial sacrificiel est censé être respecté par les meurtriers : avant d’être tué, l’enfant est d’abord torturé, puis coiffé d’une couronne d’épines et crucifié, et enfin vidé de son sang. Le « crime rituel » par excellence, tel qu’il est devenu objet de croyance dans la seconde moitié du XIIe siècle, c’est donc l’infanticide rituel112. Mais ce thème d’accusation ne peut se comprendre qu’en étant référé à un meurtre prototypique : la crucifixion de Jésus113. La mise à mort de l’enfant chrétien est fictionnée comme « répétition ritualisée du crime primordial de la crucifixion114», elle constitue une parodie criminelle. L’accusation présuppose corrélativement la croyance que le sang chrétien est de la même nature que le sang du Christ115. Si, dans sa version canonique, la légende fixe à la veille de la Pâque juive le moment du crime rituel, d’autres versions de la légende mentionnent la fête juive de Pourim116, voire Yom Kippour – absurdité s’il en est, puisque les Juifs doivent jeûner le jour du Grand Pardon. Quoi qu’il en soit, outre les éventuels procès pour crime rituel qui aboutissent souvent à la condamnation à mort des Juifs accusés, la plupart des accusations sont accompagnées ou suivies d’émeutes populaires ou de pogroms, lesquelles servent de prétexte à des mesures d’expulsion. Enfin, on doit rappeler une dernière composante de la version canonique de l’accusation : à la suite de la découverte du corps de l’enfant martyrisé, la nouvelle se répand que des miracles se produisent, prouvant la sainteté de l’enfant « martyr ».
Le mythe dérivé du meurtre rituel d’enfants chrétiens, images de Jésus, suivi de l’acte de consommer le sang recueilli, s’est donc constitué par fusion de deux mythes originellement distincts : d’une part, la fiction selon laquelle les Juifs déicides viseraient ainsi, comme en transperçant les hosties (supposées saigner), à rejouer la crucifixion de Jésus (meurtre rituel de référence), et, d’autre part, les récits fabuleux, fondés sur des rumeurs, prétendant expliquer les infanticides par la volonté des Juifs de boire le sang chrétien pour ses vertus curatives ou son pouvoir magique117, ou encore de voler les organes — le cœur et les yeux — des humains assassinés, jeunes de préférence, afin de les consommer de diverses manières. Telle est l’accusation dite « Blood Libel» ou « Blutbeschuldigungns », accusation relevant du registre des « assertions chimériques119 », en ce qu’elle est non seulement privée de toute base empirique, mais encore expressément contraire aux enseignements de l’Ancien Testament interdisant la consommation du sang sous quelque forme que ce soit12« . L’accusation de cannibalisme rituel apparaît pour la première fois en Allemagne, en décembre 1235, quand les Juifs de la ville de Fulda sont accusés d’avoir tué cinq enfants chrétiens non seulement pour recueillir leur sang en vue du rituel alimentaire de la Pâque juive, mais aussi pour manger le cœur de leurs jeunes victimes121. Le stéréotype du Juif cannibale va s’intégrer dans le mythe du meurtre rituel chez les Juifs comme l’une de ses principales composantes, (p.265) s’ajoutant ou se substituant au meurtre par crucifixion. Ce mythe s’est donc constitué du milieu du XIIe siècle au milieu du XIIIe. Le principe de l’accusation est simple : en toute disparition d’enfant chrétien, comme en tout assassinat inexpliqué d’un chrétien, on tend à voir un crime rituel juif. À travers des accusations fantastiques telles que le meurtre rituel, l’empoisonnement des puits, la diffusion de la peste noire et la profanation d’hosties consacrées122, les Juifs sont construits comme des créatures de Satan, conception qui bénéficie d’une justification théologique fondée sur l’idée qu’« après la venue du Messie, les rites juifs représentent non plus le culte de Dieu, mais celui du Diable123 ».
L’attribution aux Juifs de pratiques criminelles a été renforcée par l’interprétation malveillante du Talmud comme recueil de préceptes immoraux et antichrétiens, censés avoir été dictés par le diable. La découverte du Talmud par le monde chrétien, aux XIIe et XIIIe siècles, est à l’origine d’une nouvelle vague d’attitudes et de littérature antijuives : la preuve serait fournie par les textes talmudiques que les Juifs, serviteurs de Mammon, sont les « ennemis du Christ ». Voilà qui met à mal la thèse théologique, d’origine augustinienne, définissant le peuple juif comme « peuple témoin », porteur de l’Ancien Testament. Le IVe concile œcuménique du Latran (1215) est le premier à considérer les Juifs comme un groupe devant être isolé au sein de la chrétienté et à édicter plusieurs mesures dans ce sens. Mais il a été précédé, aux XIe et XIIe siècles, par des attaques contre des communautés juives locales en France (dès 1010-1012, à Limoges) et en Espagne, précédant elles-mêmes les massacres de 1096 perpétrés dans plusieurs villes rhénanes, sur le trajet de la première croisade, et les persécutions dont les Juifs d’Angleterre sont les victimes en 1189-1190. Les Juifs, à la suite de diverses spoliations (emprunts forcés, confiscations), sont expulsés de France par Philippe Auguste en 1182, puis autorisés à revenir en 1198, mais pour y être soumis à de multiples traités entre le roi et ses princes, destinés à « augmenter le plus possible l’exploitation des Juifs et leur dépendance vis-à-vis de la protection arbitraire et capricieuse de leurs seigneurs124 ». Les Chroniques de saint Denis expliquent ainsi l’expulsion des Juifs du royaume de France par Philippe Auguste : « Après que le Roi fut couronné, il vint à Paris. Lors commanda à faire une besogne qu’il avait conçue longtemps avant en son cœur, car il avait ouï dire maintes fois aux enfants qui étaient nourris avec lui au Palais, que les Juifs qui étaient à Paris prenaient un chrétien le jour du Grand Vendredi (…) et le menaient en leurs grottes sous terre et (…) le tourmentaient, le crucifiaient et en dernier lieu l’étranglaient (…). Et cette chose avaient-ils fait maintes fois au temps de son père, et avaient été convaincus du fait et ars [brûlés]125. »
(p.267) Sur la base des résultats de l’enquête, Frédéric II rejettera l’accusation et promulguera sa Bulle d’or en juillet 1236, sauvant ainsi – provisoirement — les Juifs138. En France, on relève l’accusation lancée contre les Juifs de Valréas, dans le Vaucluse (1247), après la disparition d’une petite fille de deux ans à la veille de la Pâque juive : les Juifs avouent sous la torture, ce qui vaut aux hommes d’être castrés et aux femmes d’avoir les seins coupés, tous étant dépouillés de leurs biens139. Onze ans plus tôt, à Narbonne, en 1236, une accusation de meurtre rituel avait provoqué une émeute antijuive à laquelle l’intervention du comte mit heureusement fin140. Les positions prises par l’Église sont loin d’aller dans le sens des accusateurs. La bulle de 1247 du pape Innocent IV interdit les procès pour crime rituel en raison des abus judiciaires et des violences commises à l’égard des Juifs. Dans sa bulle du 7 octobre 1272, le pape Grégoire X se prononcera à son tour contre les accusations de crime rituel portées contre les Juifs141.
(p.268) Parmi les affaires de crile rituel qui ont lieu à la fin du XVe siècle, deux auront eu des
conséquences considérables. Tout d’abord, l’affaire concernant Simon de Trente, ville italienne située près de la frontière autrichienne. Le dimanche de Pâque 1475, le cadavre d’un petit garçon chrétien est découvert dans la cave d’une famille juive de Trente. L’enfant, âgé d’environ deux ans, se prénomme Simon, et aurait été enlevé puis assassiné rituellement par un groupe de vingt-trois Juifs de la ville, dix-huit hommes et cinq femmes, qui auraient recueilli son sang pour l’utiliser lors de rites religieux. Arrêtés, les accusés juifs sont soumis à la torture. Les hommes juifs finissent par avouer ce que les magistrats voulaient leur faire dire. Après un procès expéditif, huit d’entre eux sont exécutés à la fin de juin 1475, un autre se suicide en prison. Mais le pape Sixte IV intervient, suspend le procès et nomme le dominicain Baptista Dei Giudici, évêque de Vintimille, commissaire apostolique chargé d’enquêter sur l’affaire. L’enquêteur se montre sceptique devant les preuves extorquées sous la torture, mais il se heurte à l’évêque du lieu, le prince Johannes von Hinderbach. L’« enfant martyr » est devenu entretemps l’objet d’un culte populaire, avec les encouragements du prince-évêque Hinderbach. Ce dernier, prenant de vitesse l’enquêteur, ordonne la reprise du procès en octobre 1475, ce qui vaut à six autres hommes juifs d’être exécutés en janvier 1476. Après avoir, en avril 1476, sévèrement tancé Hinderbach, Sixte IV finit deux ans plus tard, le 20 juin 1478, par se ranger aux conclusions de la commission de cardinaux qu’il a nommée, contraint de reconnaître que le procès a respecté les règles de procédure. Il n’en interdit pas moins explicitement aux chrétiens de tuer ou de mutiler les Juifs, de leur extorquer de l’argent ou de les empêcher de pratiquer leur culte. Simon de Trente sera canonisé par le pape Sixte V en 1588bo. Les actes de sa canonisation rapportent que «les Juifs, après le dernier soupir de leur innocente victime, se mirent tous à danser et à chanter autour de lui : « Voilà comment nous avons traité Jésus, le Dieu des chrétiens ; puissent tous nos ennemis être ainsi confondus à jamais151. » » À Trente, on a commémoré le « martyre » du petit Simon jusqu’à la publication par le Vatican, en 1965, de Nostra Aetate]52.
Il faut mentionner ensuite l’affaire concernant l’enfant de La Guardia, appelé parfois Cristôbal de Tolède, qui, âgé de quatre ans, aurait été assassiné rituellement en 1487, selon les Inquisiteurs de Tolède lançant leur accusation en 1490, par des Juifs et des conversas. L’enfant, enlevé à Tolède, aurait été martyrisé dans une grotte de La Guardia : après l’avoir crucifié, les Juifs auraient fini par l’égorger, lui auraient arraché le cœur et auraient tenté de mêler le cœur et le sang de l’enfant à une hostie volée pour rendre fous, à distance, les Inquisiteurs de Tolède. L’histoire a vraisemblablement été forgée de toutes pièces par les accusateurs, car aucun (p.269) enfant n’a jamais disparu dans La Guardia ni dans Tolède : l’enfant de La Guardia n’a jamais existé153. Les Juifs et les conversas, après une parodie de procès (l’accusation reposant sur les aveux extorqués à un artisan en état d’ivresse et soumis à la question), seront brûlés vifs au cours d’un autodafé public, le 16 novembre 149l154. La population se déchaîne dans le sens voulu par les Inquisiteurs : à Avila et à La Guardia, les quartiers juifs sont saccagés, et les troubles gagnent presque toutes les agglomérations des royaumes155. Cette affaire fournit un prétexte de plus à Isabelle et Ferdinand pour signer, l’année suivante, l’édit ordonnant l’expulsion des Juifs d’Espagne (31 mars 1492)156. Le schéma général des affaires de crime rituel est ici parfaitement illustré : l’accusation de crime rituel provoque des violences populaires contre les Juifs, ces derniers sont jugés et exécutés, mais les violences antijuives ne cessent pas pour autant, et fournissent un prétexte pour prendre des mesures d’expulsion après avoir mis en condition la population157. Le Saint Enfant de La Guardia sera canonisé en 1805 par le pap^e Pie VII.
À la fin du XVF siècle, en Pologne, les accusations de crime rituel sont largement diffusées par la brochure du curé J. A. Mojecki intitulée Les Atrocités juives, qui fait l’objet de nombreuses rééditions158, nourrissant au cours de la première moitié du XVIIe siècle une intense propagande antijuive. Les accusations de crime rituel, avec ou sans procès, se multiplient à partir de 1694. En 1698, après l’assassinat d’une fillette à Sando-mierz, le responsable de la synagogue, Alexandre Berek, est accusé de meurtre rituel, condamné à mort et exécuté. Dans la même ville, en 1710, le jeune J. Krasnowksi, âgé de huit ans et demi, est assassiné, ce qui vaut à la communauté juive locale d’être accusée du meurtre. À la suite d’un long procès, le roi prend, le 28 avril 1712, un décret d’expulsion des Juifs de Sandomierz. L’usage de la torture, à laquelle sont ordinairement soumis les accusés de crime rituel, sera aboli par Stanislas Auguste Poniatowski en 1776159. En 1669 a lieu en France, à Metz, l’affaire Raphaël Lévy, accusé d’avoir enlevé le 25 septembre puis torturé à mort un enfant chrétien âgé de trois ans. Sur la base de faux témoignages, Raphaël Lévy sera condamné à être brûlé vif, sentence exécutée le 17 janvier 1670160. En 1690, un Juif de Bialystok, nommé Shutko, est accusé d’avoir enlevé, torturé et saigné à mort, près de Grodno, le jeune chrétien Gavriil Belostokski, âgé de six ans, qui fera l’objet d’un culte et sera canonisé en 1820. Dans les années 2000, en Biélorussie, le 20 mai de chaque année, une prière dénonçant la « bestialité » des Juifs est encore prononcée à la mémoire de « l’enfant martyr », « tué par les Yids ». Le jour de la prière «pour saint Gavriil » est inscrit dans le calendrier orthodoxe biélorusse161.
En Russie, dans les provinces polonaises, les Juifs sont accusés de crime rituel en 1772, 1793 et 1795. Les accusations ne cesseront pas en Russie au cours du XIXe siècle162. On peut aussi relever l’affaire de Peer, en Hongrie (1791). Sans compter les nombreuses accusations de crime rituel contre les Juifs de la Confédération polono-lituanienne : selon l’historien Daniel Tollet, il y en a eu plus d’une centaine entre le concile de Trente au XVIe siècle et le Troisième Partage de la Pologne en 1795153. Par ailleurs, dans l’Empire ottoman, du XVe au XIXe siècle, des accusations de (p.270) crime rituel sont lancées régulièrement par des chrétiens orthodoxes grecs, occasionnant des troubles durant la fête de Pâque164. Au XIXe siècle, ces accusations calomnieuses sont suivies de pogroms, par exemple à Smyrne (1872) ou à Constantinople (1874). Au début du XIXe siècle, des accusations provenant de milieux chrétiens autochtones sont attestées à Alep (1810), Beyrouth (1824), Antioche (1826, 1828), Hama (1829), Tripoli (1834)165. Après l’affaire de Damas en 1840, on peut citer encore, d’après Bernard Lewis, les accusations lancées à Alep (1850, 1875), Damas (1848, 1890), Beyrouth (1862, 1874), Dayr-al-Qamar (1847), Jérusalem (1847), Le Caire (1844, 1890, 1901-1902), Mansourah (1877), Alexandrie (1870, 1882, 1901-1902), Port-Saïd (1903, 1908), Damanhur (1871, 1873, 1877, 1892), Constantinople (1870, 1874), Bùyùkdere (1864), Kuzguncuk (1866), Eyub (1868), Andrinople (1872), Smyrne (1872, 1874), etc.166.
Si la croyance au crime rituel est réactivée au XIXe siècle, elle l’est surtout à partir de l’affaire de Damas qui, en 1840, déchaîne les passions non seulement au Proche-Orient, mais aussi dans nombre de pays occidentaux. L’affaire de Damas, précédée de peu par la rumeur de Rhodes qui n’a guère laissé de traces, est immédiatement reconnue comme exemplaire par les milieux antijuifs, en ce qu’elle paraît manifester à la fois les tendances criminelles et la puissance de corruption et de manipulation des Juifs, accusés d’avoir utilisé leur « or » pour empêcher la condamnation de leurs congénères coupables d’assassinat rituel167. Ces affaires seront suivies, en Europe, tout d’abord par l’affaire retentissante de Tisza-Eszlâr en Hongrie (1882-1883), qui vaut à quinze Juifs, accusés d’avoir assassiné rituellement la jeune chrétienne Eszter Solymosi, âgée de quatorze ans – disparue le 1er avril 1882, peu avant la Pâque juive -, de passer dix-sept mois en prison, avant d’être déclarés innocents au terme de leur procès, le 3 août 1883′68. Ce verdict provoque une vague de pogroms en Hongrie. Viennent ensuite l’affaire de Breslau (1888)’69, celle de Xanten en Rhénanie (1891), l’affaire Léopold Hilsner (ou affaire de Polna) en Bohème (1899-1900) – durant laquelle s’affirme la haute figure de Thomas G. Masaryk™ -, suivie par celle de Konitz en Prusse occidentale (1900-190l)171. En Russie, c’est l’affaire Beïliss qui, de juillet 1911 à août 1915, va mobiliser à la fois les antisémites professionnels et les défenseurs des Juifs injustement accusés. Comme l’affaire de Damas, elle fait surgir un mouvement international de solidarité débordant l’action militante des Juifs émancipés d’Europe venant au secours des Juifs vivant dans des pays où, ne bénéficiant pas de l’égalité des droits, ils sont victimes de persécutions. Si l’affaire Beïliss paraît prendre la relève de l’affaire Dreyfus dans la médiatisation internationale, c’est parce qu’elle est fondée sur le même motif, celui d’une injustice flagrante faisant scandale : un Juif innocent accusé en raison du seul fait qu’il est juif. Juif, donc « traître », « criminel rituel », etc. Nous y reviendrons plus loin, en nous intéressant particulièrement aux arguments des accusateurs. (…)
(p.271) Il faut enfin rappeler qu’après la Deuxième Guerre mondiale, l’accusation d’infanticide rituel a ressurgi en Pologne, d’abord à Cracovie, pendant l’été 1945, puis à Kielce l’année suivante, pour donner lieu, le 4 juillet 1946, à un pogrom contre les survivants de l’extermination nazie, qui avaient osé demander à leurs voisins non juifs de leur restituer leurs terres et leurs biens (42 morts, environ 100 blessés)175. Durant l’été 1946, les Juifs étaient en Pologne dans une situation d’insécurité maximale : dans les trains, les individus qui semblaient être juifs étaient massacrés176.
Luther et Eisenmenger, médiateurs et refondateurs
(…) Au milieu du XVIe siècle, les imprécations de Martin Luther, notamment dans son libelle Sur les Juifs et leurs mensonges (1543)177, qui comporte la proposition d’expulser les Juifs, relancent la polémique antijuive dans le nouveau contexte de la modernité naissante. Dans cette synthèse virulente de la judéophobie médiévale, Luther accuse les Juifs d’être des empoisonneurs, des meurtriers rituels, des usuriers sans scrupule, des parasites de la société chrétienne178. Ce pamphlet antijuif ne fait pas qu’exprimer une haine sans limites, il est aussi un appel au meurtre : « Les Juifs sont des brutes, leurs synagogues sont des étables à porcs, il faut les incendier, car Moïse le ferait s’il revenait au monde. Ils traînent dans la boue les paroles divines, ils vivent de mal et de rapines, ce sont des bêtes mauvaises qu’il faudrait chasser comme des chiens enragés179. » Dans ses « propos de table », Luther, après avoir affirmé que « les Juifs ont leurs pratiques de sorcellerie », dénonce ces derniers comme des criminels par nature : « II est impossible d’empêcher un serpent de piquer. De même il est impossible à un Juif d’abandonner son désir de tuer et d’assassiner des chrétiens dès
(p.272) qu’il le peut180. » Le grand réformateur Luther s’avère un conservateur et un transmetteur de tradition quant à l’image démonisante des Juifs, qu’il ne fait guère qu’emprunter à l’antijudaïsme de l’Église181. Mais l’influence de ses écrits contre les Juifs sera aussi considérable que durable, jusqu’au Troisième Reich. En 1933, quelques mois après l’arrivée au pouvoir des nazis, le 450e anniversaire de la naissance de Luther sera célébré avec faste, à la fois par les Églises protestantes et par la NSDAP. Le Gauleiter Erich Koch n’hésitera pas à comparer Hitler et Luther, affirmant que les nazis combattent dans l’esprit de Luther182. (…)
L’affaire de Damas (1840) et ses suites
Ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire de Damas », qui relance les accusations de meurtre rituel au milieu du XIXe siècle, renvoie à une accusation mensongère de crime rituel visant des Juifs vivant en Syrie, après la disparition, le 5 février 1840, d’un capucin français d’origine sarde, le père Thomas, avec son serviteur189. Selon la rumeur publique, les Juifs l’auraient égorgé pour utiliser son sang lors de leur Pâque, et ce, dans un contexte marqué par la diffusion à Damas d’un libelle affirmant que le Talmud ordonne l’assassinat d’enfants chrétiens. De nombreux Juifs sont arrêtés etv torturés. L’un d’entre eux, un barbier, passe aux aveux sous la torture. À la suite d’une peudo-enquête conduite par deux personnages
(p.273) sans scrupule, le gouverneur égyptien Cherif Pacha et le consul français Ratti-Menton, sept dirigeants de la communauté juive de Damas sont inculpés de meurtre. Deux d’entre eux meurent sous la torture sans avoir reconnu une quelconque participation à l’assassinat du père Thomas. Certains autres confessent tous les crimes que leurs accusateurs leur imputent. Pour justifier son action, Ratti-Menton lance une vaste campagne de presse dirigée non seulement contre les Juifs de Damas, mais aussi contre les Juifs du monde entier. Cette internationalisation de la propagande antijuive ne tarde pas à provoquer des réactions d’indignation dans divers pays et une contre-enquête qui met en évidence le caractère arbitraire des accusations et l’usage systématique de la torture pour extorquer des aveux.
L’initiative de la contre-attaque vient de la Grande-Bretagne, dès le mois de juin 1840. Puis d’autres pays occidentaux, dont les Etats-Unis, s’alignent sur les positions fermes prises par le gouvernement britannique. C’est seulement au terme d’une campagne internationale de protestation conduite par l’Anglais Sir Moses Montefiore et le Français Adolphe Crémieux, mouvement de solidarité accompagné d’une contre-enquête, que les accusés seront libérés et que, par un firman du 6 novembre 1840, le jeune sultan Abd al-Majid condamnera solennellement la légende du meurtre rituel : « (…) Après un examen approfondi des livres religieux des hébreux, il a été démontré qu’il est absolument défendu aux Juifs de faire usage non seulement du sang humain mais même du sang d’animaux (…). Les charges portées contre eux et leur culte ne sont que pures calomnies. (…) Nous ne pouvons permettre que la nation juive (dont l’innocence dans le crime qui lui est imputé a été reconnue) soit vexée et tourmentée sur des accusations qui n’ont aucun fondement de vérité190. »
Mais l’affaire de Damas va inspirer une nouvelle génération d’idéologues antijuifs, convaincus que son issue était la preuve de la puissance juive191.
En France, trois auteurs catholiques influents vont intégrer l’accusation de crime rituel dans leur arsenal judéophobe. Le premier est le publi-ciste et voyageur Achille Laurent, qui publie en 1846 un ouvrage intitulé Relation historique des affaires de Syrie depuis 1840 jusqu’en 1842, dont le deuxième volume contient de nombreux documents sur l’affaire de Damas. Dans cet ouvrage est dénoncé avec virulence le Talmud de Baby-lone, « code religieux des Juifs modernes, bien différent de celui des anciens Juifs » : le Talmud est notamment caractérisé par « les principes de haine qu’il contient pour tous les hommes qui ne font point partie de ce qu’il nomme le peuple de Dieu192 ». La thèse d’Achille Laurent est que « les Juifs se servent effectivement de sang humain dans quelques-unes de leurs pratiques religieuses193 ». Le deuxième auteur catholique intransigeant est le journaliste Louis Rupert, qui collabore à L’Univers de Louis Veuillot lorsqu’il fait paraître en 1859 L’Église et la Synagoguem. Rupert donne le récit détaillé de plusieurs crimes rituels, dont celui-ci, enchaînant les clichés et les stéréotypes narratifs du genre (proche du conte d’épouvanté), sur la base d’une source plus que douteuse et unique :
(p.274) « En 1454, deux Juifs surprirent un enfant chrétien sur les terres ae Louis d’Almanca, dans le royaume de CastiHe ; l’ayant conduit à l’écart dans la campagne, ils le firent mourir, coupèrent ensuite son corps par le milieu et lui arrachèrent le cœur, puis enterrèrent le cadavre à la hâte et partirent. Des chiens qui rôdaient par là furent attirés par l’odeur : ils grattèrent le sol et en retirèrent le corps de l’enfant, qu’ils commencèrent à dévorer ; l’un d’eux s’éloignait emportant un bras dont il avait fait sa proie lorsqu’il fut rencontré par des bergers, et c’est ainsi que l’on découvrit la mort de ce pauvre enfant que ses parents cherchaient en vain depuis plusieurs jours. Pendant ce temps-là, les Juifs, qui avaient convoqué secrètement leurs coreligionnaires, brûlaient le cœur, et en jetaient les cendres dans du vin qu’ils buvaient ensemble dans leur réunion. Tels furent les faits constatés par les enquêtes, et dont la certitude parut complètement acquise au gouverneur et à l’évêque. L’affaire ayant été portée au tribunal royal, les sommes considérables dépensées alors par les Juifs, comme à l’ordinaire, firent durer si bien les procédures, que l’auteur contemporain auquel nous devons ce récit ne put voir la fin du procès195. »
Le troisième auteur catholique français à avoir joué sur la question le rôle d’un propagandiste n’est autre que le théoricien traditionaliste Roger Gougenot des Mousseaux, auteur d’une célèbre somme d’inspiration apocalyptique parue en 1869: Le Juif, le judaïsme et la juddisation des peuples chrétiensm, où sont dénoncés « l’assassinat talmudique197 », « l’anthropophagie sacrée » et les « homicides sacrés » commis par les Juifs, en particulier les « Juifs talmudisants », qui « immolent des chrétiens, et recueillent leur sang avec une avidité scrupuleuse198 ».
Mais cette thèse est loin d’appartenir en propre aux milieux catholiques intransigeants du milieu du XIXe siècle199. En Allemagne, Georg Friedrich Daumer (1800-1875), poète et théologien, publiciste antichrétien radical qui fait alors partie de la mouvance des « Jeunes Hégéliens » (ou « hégéliens de gauche »), dénonce avec virulence, dans une lettre adressée à son ami Ludwig Feuerbach en avril 1842, le « cannibalisme dans le Talmud » et la consommation de sang humain lors de la fête de Pourim200, tout en suggérant que Jésus faisait lui-même partie d’une secte juive qui pratiquait le meurtre rituel201. À l’instar de Friedrich Wilhelm Ghillany (1807-1876), auteur lui-même d’un livre paru en 1842 sur « les sacrifices humains chez les Hébreux de l’antiquité202 », Daumer soutient la thèse que le dieu juif Jehovah n’est autre que Moloch. Bref, le judaïsme, pratiqué par ses fanatiques, serait un molochisme, un culte fondé sur des sacrifices humains. Et l’héritage de ce culte barbare se retrouverait dans le christianisme. L’une des principales sources de Daumer n’est autre que l’ouvrage célèbre de l’orientaliste Eisenmenger, Le Judaïsme dévoilé (Entdektes Judenthum), paru en 1700203. En 1842, Georg F. Daumer publie aussi un ouvrage qui se veut historique et critique sur « le culte du feu et du Moloch chez les anciens Hébreux »204, ouvrage qui s’ouvre significativement sur le récit de l’affaire de Damas, présentée comme une nouvelle preuve du crime rituel chez les Juifs205. La thèse de Daumer et de Ghillany, que Feuerbach et le jeune Marx prennent très au sérieux, sera reprise et développée en France par le blan-quiste et communard Gustave Tridon, dans son livre intitulé Du molochisme (p.275) juif. Études critiques et philosophiques™. Dans La France juive, après avoir cité élogieusement Daumer et Ghillany, Drumont note : « Le livre de Gustave Tridon, le Molochisme juif, met bien en relief également cette lutte soutenue par les Prophètes contre le culte de Moloch personnifié, soit par le taureau, soit par le veau d’or207. » La thèse « historique » de Drumont est que, « par une sorte de phénomène de régression, le Juif du Moyen Âge, tombé dans la dégradation, en revint à ses erreurs primitives, vcéda à l’impulsion première de la race, retourna au sacrifice humain208 ». À l’époque médiévale, selon Drumont, tandis que le Talmud devient le fondement de la nouvelle Loi des Juifs, « ce qu’on adore dans le ghetto, ce n’est pas le dieu de Moïse, c’est l’affreux Moloch phénicien auquel il faut, comme victimes humaines, des enfants et des vierges209 ». Les publicistes nazis se réfèrent, eux aussi, volontiers à Daumer et à Ghillany. Dans son livre consacré au crime rituel juif, Derjudische Ritualmord, paru en 1943 avec une préface de Johann von Leers, l’historien nazi Hellmut Schramm cite notamment Eisenmenger, Ghillany, Achille Laurent et Gougenot des Mousseaux210.
La nouvelle vague anti-talmudique : Rohling et son héritage
C’est avec la publication à Munster, en 1871, de la brève compilation du chanoine et théologien catholique autrichien August Rohling, Der Talmudjude, que commence en Europe la deuxième vague de pamphlets antijuifs dénonçant le crime rituel, rapporté aux sataniques enseignements du Talmud211. L’ouvrage, confectionné lui aussi sur le modèle du Judaïsme dévoilé d’Eisenmenger, est aussitôt traduit dans plusieurs langues et soutenu par la presse catholique dans toute l’Europe212. Richard Wagner, entre autres, en est un lecteur admiratif213. C’est en Belgique que paraît, en 1888, la première traduction française du pamphlet de Rohling, sous le titre Le Juif-talmudiste214. La seconde traduction du pamphlet en langue française paraît en 1889 à Paris, sous le titre Le Juif selon le Talmud, avec une préface d’Edouard Drumont215. La presse des Assomptionnistes (La Croix, Le Pèlerin), qui avait auparavant déjà donné dans l’anti-talmudisme, y puise de nouveaux arguments, d’apparence plus savants, imaginant y trouver en outre les preuves que le meurtre rituel fait l’objet d’un impératif talmudique216. Lorsqu’à la veille de la Pâque juive, le 1er avril 1882, dans le village hongrois de Tisza-Eszlâr, une jeune fille chrétienne disparaît, La Bonne Presse ne manque pas de dénoncer un meurtre rituel perpétré par des rabbins fanatiques, en l’inscrivant dans la longue série des « crimes rituels juifs » prétendument commis depuis le Moyen Age en vertu d’une obligation religieuse217. On assure aux lecteurs catholiques que «le Talmud (…) recommande, en termes précis, de mêler au pain sans levain du sang chrétien218 ». Si la police locale inculpe bien les membres d’une famille juive, le procès qui s’ensuit montre les lacunes de l’enquête et les prévenus sont relaxés. Mais le père Bailly récuse le verdict en l’attribuant à une opération de corruption : si « l’évidence du crime commis par certains Juifs, au nom de cérémonies rituelles, à Tïsza-Eszlâr, n’a pas été atténuée par le dénouement », c’est parce que l’or juif aurait payé l’acquittement219.
(p.279) /années 1930/ (…)la grande vague antijuive qui s’étend en Europe. C’est en référence au pamphlet de Rohling qu’un certain François Le Français (sic) publie en décembre 1938 dans la revue Le Pilori, dirigée par Henri-Robert Petit, un article intitulé « La race haineuse, sadique et criminelle », où le lecteur épouvanté apprend que « les Juifs sont friands de spectacles de sang et de mort », et, plus précisément, que « les lentes agonies leur procurent toujours une sorte de jouissance malsaine244 ». Cette cruauté serait, chez les Juifs, conforme aux leçons du Talmud, c’est-à-dire à la véritable loi juive : « De toutes les lois qui régirent les nations, celle des Juifs fut la plus méprisable, la plus barbare, la moins digne d’un peuple policé. Elle constitue un recul sur toutes les civilisations anciennes, même les moins évoluées ; elle trahit les mœurs impudiques et sauvages d’un groupe humain inaméliorable, en marge de l’Humanité. Et c’est ce groupe-là qui a conçu, contre tous les autres peuples étrangers à sa race, une haine dont rien ne peut donner une idée sinon la lecture du Talmud245. »
(p.279) L’antisémitisme russe au début du xxe siècle : l’affaire Befliss
Le XXe siècle de la Russie antisémite commence par l’épouvantable pogrom de Kichinev (Bessarabie) qui a lieu durant le week-end de Pâques (6-7 avril 1903) et dont le prétexte, saisi par les organisateurs du massacre, est la découverte du cadavre d’un jeune garçon, présenté par les agitateurs antisémites locaux, dont le pogromchtchik Pavolachi Krouchevan, comme la victime d’un crime rituel. Le bilan des violences est très lourd : 49 morts, 495 blessés, un grand nombre de viols, environ 1 500 ateliers et boutiques dévastés et détruits, 20 % de la population juive sans abri, soit deux mille familles247. L’itinéraire du journaliste et agitateur antijuif Pavolachi A. Krouchevan (1860-1909), l’un des meneurs et des propagandistes les plus actifs dans les milieux pogromistes, a valeur d’exemple. Au moment du pogrom, Krouchevan est le directeur du journal Znamia (« Le Drapeau ») lancé à Saint-Pétersbourg en février 1903, où il a publié le fameux faux intitulé « Discours du Rabbin », destiné à mobiliser contre les Juifs. C’est aussi Krouchevan qui, le premier, publiera les Protocoles des Sages de Sion, en feuilleton, dans Znamia, du 28 août au 7 septembre 1903 (« ancien style » ; en fait, du 10 au 20 septembre 1903), comme pour justifier après coup le pogrom. Krouchevan, qui s’est établi en 1894 à Kichinev, y a fondé le journal antisémite Bessarabets en 1896, où il publie une série d’articles accusant les Juifs de commettre des meurtres rituels. L’agitateur antijuif deviendra ensuite un membre actif des Centuries noires, organisation nationaliste, traditionaliste et antisémite n’hésitant pas à recourir à la violence. En novembre 1905, il sera l’un des fondateurs de l’Union du Peuple russe, dont de nombreux membres, au cours des années 1920, rejoindront le mouvement nazi. Il finira par être élu député à la Douma en 1907. On évalue à environ sept cents le nombre des pogroms organisés par les Centuries noires de la fin octobre 1905 aux derniers mois de 1906.
(p.289) L’itinéraire de Johann von Leers (1902-1965) est riche d’enseignements sur les relations entre les spécialistes nazis de la « question juive » et les milieux arabo-musulmans antijuifs31« . Après des études de droit et de langues (russe, polonais, hongrois, hollandais, anglais, français, espagnol, japonais) qui lui permettent de travailler pour le ministère des Affaires étrangères dès 1928311, Johann von Leers se rallie en août 1929 au national-socialisme312. Il devient sans tarder le rédacteur en chef de la revue nazie Wille und Weg, lancée en 1931. La première livraison de cette revue raciste s’ouvre sur un article de Joseph Goebbels, dont il devient l’un des protégés313. Cet officier SS acquiert rapidement la réputation d’être à la fois un spécialiste de la « question juive » et un propagandiste efficace qui, à la demande de Goebbels, met ses talents au service du parti nazi. Engagé dans le Mouvement allemand de la Foi (Deutsche Glaubens-bewegung), fondé par l’indianiste et historien des religions Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962), mais placé sous le patronage de Himmler, il se propose de « libérer l’Allemagne de l’impérialisme du judéo-christianisme », et de créer une nouvelle religion païenne, qui serait purement germanique314. Il fréquente à cette époque le raciologue Hans F. K. Gùnther et le comte Ernst zu Reventlow (1869-1943), vice-président du Mouvement allemand de la Foi. Il publie dans diverses revues racistes, qu’il s’agisse de la revue de Richard Walther Darré, Odal. Monatsschrift fur Élut und Boderf1^, d’une revue qu’il lance lui-même en 1933, Nordische Welt. Zeitschrift der Gesellschaft fur Germanische Ur- und Vorgeschichte (Leipzig), de la revue mensuelle d’Alfred Rosenberg, Der Weltkampf (« Le Combat mondial »), ou du mensuel du parti nazi, Nationalsozialistische Monatshefte^6. En avril 1938, avec l’appui d’Alfred Rosenberg, il est nommé professeur à l’Université Friedrich-Schiller, à léna. Il est censé y enseigner « l’histoire juridique, économique et politique sur des bases raciales317 ». Doctrinaire « völkisch », mais surtout antisémite fanatique, Johann von Leers publie nombre de ses ouvrages antijuifs, fondés sur
une conception raciste et conspirationniste du monde, aux éditions de Theodor Fritsch (longtemps appelées Hammer-Verlag), spécialisées dans la propagande antisémite. Il dédie son ignoble album de photos paru en 1933, Juden sehen dich an (« Les Juifs vous regardent »), au « vaillant, fidèle et inébranlable Julius Streicher318 ». On y peut voir des photos de Juifs célèbres, Albert Einstein, Emil Ludwig ou Lion Feuchtwanger, sous la légende « Pas encore pendus ! ». C’est également en 1933 qu’il publie son pamphlet antijuif 14 Jahre Judenrepublik (« 14 années de république juive ») – visant la République de Weimar —, ainsi qu’une brochure contenant le fameux faux antijuif qu’est le « Discours du Rabbin », extrait du roman d’Hermann Goedsche, Biarritz (1868)319. Leers sera un propagandiste prolifique, qui publiera vingt-sept livres de 1933 à 194532« .
(p.290) Heinrich Himmler, en compagnie de Walther Darré et de l’occultiste Karl-Maria Wiligut, rencontre pour la première fois Herman Wirth, philologue nazi adepte du mythe aryen et théoricien de la civilisation « nordique » primordiale, qui deviendra en 1935 le premier président de l’institut prétendument scientifique créé par Himmler, î’Ahnenerbe (« Héritage des ancêtres »)321. Johann von Leers expose la conception nazie orthodoxe d’une histoire raciologique dans un livre publié à Leipzig en 1934 : Geschichte auf rassischer Gmndlage (« Histoire sur un fondement raciste »). En 1936, il publie à Munich un essai pour justifier la législation nazie contre les Juifs, Blut und Rasse in der Gesetzgebung (« Sang et race dans la législation »)322. La même année, il rencontre à Berlin le « Grand Mufti » de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini (1895-1974), dont il devient l’ami. Professeur d’université et officier SS, il travaille aussi pour le ministère de la Propagande, sous la direction de Goebbels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est l’un des idéologues nazis qui s’efforcent de diffuser la thèse, chère au « Grand Mufti », selon laquelle les Juifs sont les ennemis communs de l’islam et de l’Allemagne nazie323. C’est dans cette perspective qu’il publie en décembre 1942, dans la revue Die Judenfmge, un article intitulé « Judentum und Islam aïs Gegensatze » (« Le judaïsme et l’islam en tant qu’opposés »), où, en propagandiste zélé, il fait cet éloge immodéré de l’antijudaïsme islamique : « L’hostilité de Mahomet envers les Juifs a eu une conséquence : les Juifs d’Orient ont été totalement paralysés. Leur assise a été détruite. Le judaïsme oriental n’a pas réellement participé à l’extraordinaire montée en puissance du judaïsme européen au cours des deux derniers siècles. Repoussés dans la saleté des ruelles du mellah, les Juifs ont mené là une vie misérable. Ils ont vécu sous une loi spéciale, celle d’une minorité protégée, qui, contrairement à ce qui s’est passé en Europe, ne leur permettait pas de pratiquer l’usure ni même le trafic de marchandises volées (…). Si le reste du monde avait adopté une politique semblable, nous n’aurions pas de question juive \Judenfrage]. (…) En tant que religion, l’islam a rendu un service éternel au monde : il a empêché la conquête menaçante de l’Arabie par les Juifs. Il a vaincu, grâce à une religion pure, le monstrueux enseignement de Jéhovah. C’est ce qui a ouvert à de nombreux peuples la voie vers une culture supérieure324. »
(…) (p.291) Après la Seconde Guerre mondiale, Leers, qui tente de fuir l’Allemagne, sera arrêté et placé dans un camp d’internement, où il restera dix-huit mois. Une dure épreuve pour un représentant de la « race des Seigneurs », qui parlera longtemps avec amertume de « ces longs mois où la fine fleur du national-socialisme était à la merci des nègres et des pourceaux hébraïques derrière les barbelés332 ». Une fois libéré, Leers, sous une fausse identité, réussit finalement, grâce à une filière d’évasion passant par l’Autriche et l’Italie, à gagner l’Argentine de Perón, terre d’accueil pour les réfugiés nazis, où il devient vite un ami intime du dictateur. Il continue d’y exercer des activités de propagandiste antijuif, notamment en tant que rédacteur en chef de la revue nazie de Buenos Aires Der Weg (« La Voie »), fondée en 1947 par Eberhard Fritsch333. Il collabore également, sous divers pseudonymes (Dr Hans A. Euler, K. Neubert), à la revue néonazie Nation Europa, fondée en janvier 1951 par Karl-Heinz Priester (ancien officier Waffen-SS) et Hermann Ehrhardt (ancien officier SS), quelques mois avant le « Congrès national européen » de Malmo (mai 1951), qui conduit à la création du Mouvement social européen (MSE), organisme de liaison international dirigé par un comité exécutif où figurent notamment Maurice Bardèche, Per Engdahl et Karl-Heinz Priester334. En Argentine, Leers établit en particulier des contacts avec Adolf Eichmann, Martin Bormann, Hans-Ulrich Rudel (l’as de la Luftwaffe) et le secrétaire privé de Goebbels, Wilfried von Oven335. Dans ses Mémoires, Martin Bormann évoque avec nostalgie les réunions amicales entre anciens nazis en Argentine péroniste, où Leers, qu’il admire, joue le rôle d’un gardien militant de l’idéologie nazie : « Les historiens et les spécialistes de sciences politiques se groupaient autour du Pr Johann von Leers. Mêlés à eux dans le plus strict incognito, il y avait nous, les « huiles », Eichmann, Mengele et moi. (…) Ces années furent dominées par notre bienfaiteur, Juan Domingo Perôn. L’élite de notre groupe le servit utilement et fidèlement en tant que conseillers militaires et scientifiques. (…) Tandis que Mengele se plongeait avec ardeur dans le tourbillon social, Eichmann et moi préférions vivre sans ostentation et dans la retraite, pour des raisons évidentes. Notre inspiration politique, nous la devions au Pr von Leers dont le journal, Der Weg (…), était le porte-parole de notre groupe. La croissance de la conscience nationale allemande de notre rassemblement pouvait se mesurer à la croissance constante du tirage de ce journal, dont plus d’un exemplaire parvint dans notre patrie vaincue et enchaînée. Von Leers défendait avec un incomparable courage notre héritage idéologique national-socialiste, dénonçant les mensonges de (p.292) la presse internationale et exposant le véritable arrière-plan du conflit qui évoluait rapidement vers une confrontation entre l’Ouest et l’Est336. »
Leers n’en continue pas moins de s’occuper, à travers ses réseaux arabo-musulmans, de la guerre contre les Juifs au Proche-Orient. Dans une interview publiée en janvier 1953 par la revue de Leers, Der Weg, le « Grand Mufti » de Jérusalem félicite Leers pour son « très important travail en faveur de l’amitié traditionnelle entre l’Allemagne et la nation arabe337 ». L’admiration de Leers pour Hitler reste entière : « Ce que j’aimais chez Hitler, c’est qu’il combattit les Juifs et qu’il en tua beaucoup338. » En 1955, après la chute de Peron, il s’enfuit pour s’établir au Caire, où il organise, avec l’ancien collaborationniste Georges Oltramare (connu sous son pseudonyme « Charles Dieudonné339 »), la propagande antisémite, dite « antisioniste », du régime nassérien340. Le « Grand Mufti » al-Husseini l’accueille au Caire par un chaleureux discours de bienvenue : « Nous vous remercions d’être venu jusqu’ici reprendre le combat contre les puissances des ténèbres incarnées dans la juiverie mondiale341. » Converti à l’islam avec la bénédiction d’al-Husseini, Johann von Leers prend le nom d’Omar Amin, devenant « Omar Amin von Leers », et travaille pour la cause du nationalisme arabe, incarné alors par le colonel-président Nasser dont il est l’un des conseillers politiques, rattaché au ministère de l’Information. Nasser le nomme à la tête de son Institut pour l’étude du sionisme. Devenu un homme de confiance du Raïs, Leers l’amène à placer à la tête des services spéciaux (le « Moukhabarat ») l’un de ses proches, Gerhard Hartmut von Schubert, lui-même ancien collaborateur de Goebbels342. L’un et l’autre ont eu le même parcours : des services de propagande du Troisième Reich aux services spéciaux du régime péro-niste et, pour finir, l’engagement en faveur de la cause arabo-musulmane contre les Juifs.
William Stevenson, ancien correspondant de guerre en Afrique du Nord et au Moyen-Orient devenu journaliste d’investigation, a raconté sa rencontre avec Leers au Caire en 1956, peu après la crise du canal de Suez, qui se termine à la mi-novembre 1956. Notons au passage qu’après la guerre, le 23 novembre 1956, une proclamation du ministère des Affaires religieuses est lue dans toutes les mosquées, affirmant que « tous les Juifs sont des sionistes et des ennemis de l’État » et promettant leur expulsion prochaine. Des dizaines de milliers de Juifs se voient alors contraints de quitter le pays après avoir abandonné leurs biens au gouvernement égyptien. C’est donc dans ces circonstances que Stevenson rencontre « le professeur Johann von Leers » au ministère de l’Information, où il est « directeur de la propagande contre Israël343 ». Leers se présente à lui comme « un spécialiste des affaires sionistes », et, sans cacher qu’il est recherché comme « criminel de guerre344 », affirme devant son interlocuteur médusé qu’il y a « véritablement une conspiration sioniste », qu’elle a « toujours existé » et que « rien ne peut guérir l’espèce humaine de la peste juive, sinon une opération héroïque345 ». Bref, pour Leers, Israël est « un cancer à extirper346 », ou pour le moins « une absurdité qui doit disparaître347 ».
(p.293)
Le propagandiste nazi devenu musulman contribue à la publication par les Services d’information de la RAU, en avril 1957, d’une édition en arabe des Protocoles des Sages de Sion, présentés dans l’introduction due au « Comité des ouvrages politiques » comme « un document sioniste secret de la plus haute importance », permettant de « connaître la portée des objectifs du sionisme international, dont le germe maudit a été semé dans notre pays de Palestine par l’impérialisme israélien348 ». Une seconde introduction « historique », de facture nazie, dans laquelle sont cités notamment Theodor Fritsch, Ulrich Fleischhauer et Alfred Rosenberg, montre l’influence que pouvaient avoir Leers et ses comparses (en particulier Louis Heiden, devenu au Caire Louis Al-Hadj349) sur l’orientation de la propagande nassérienne. Sa conclusion est que la recherche de l’identité de l’auteur des Protocoles est « d’importance secondaire », « car le texte du document prouve suffisamment qu’aucun cerveau aryen au monde n’aurait été capable d’élaborer un tel programme15 » ». Convaincu de l’utilité des Protocoles par ses collaborateurs nazis, Nasser déclarera en septembre 1958 à R. K. Karandjia, rédacteur en chef du journal indien de langue anglaise Blitz : «Je me demande si vous avez lu un livre appelé Protocols of thé Learned Elders of Zion. Il faut absolument que vous le lisiez. Je vous en donnerai un exemplaire. Il prouve irréfutablement que trois cents sionistes (…) gouvernent le sort du continent européen351. » On peut également mettre au compte de l’influence exercée par Leers et ses collaborateurs sur Nasser les déclarations négationnistes (avant la lettre) faites par ce dernier, notamment dans une interview publiée en mai 1964 par l’hebdomadaire allemand du néonazi Gerhard Frey, la Deutsche National Zeitung, où, après avoir précisé que « pendant la Seconde Guerre mondiale, notre sympathie allait aux Allemands », le Raïs lance : « Personne ne prend au sérieux le mensonge des six millions de Juifs assassinés352. » C’est à cette époque que Leers entretient une correspondance amicale avec les deux « pionniers » français du négationnisme : Maurice Bardèche et Paul Rassinier353. Parallèlement, Johann von Leers exerce la fonction de « contact pour l’organisation des anciens membres des SS [le réseau ODESSA] en territoire arabe354 ».
(p.294) L’islamisation du mythe au XXe siècle
L’accusation de crime rituel, d’origine européenne, païenne puis chrétienne, a été acclimatée au cours du XIXe siècle au Moyen-Orient, à travers plusieurs affaires dues à des accusateurs chrétiens359, puis intégrée au XXe dans le discours antijuif du monde arabo-musulman360. Selon Bernard Lewis, on ne trouve pas trace dans le monde musulman de « cette forme particulière de calomnie antijuive durant toute la période classique361 ». L’historien en repère les premières manifestations en terres d’islam au cours de la seconde moitié du XVe siècle, mais elles restent jusqu’à la fin du XIXe siècle le fait des milieux chrétiens : « Sa première apparition date du règne du sultan ottoman Mehmed le Conquérant et eut presque certainement pour origine l’importante minorité grecque-orthodoxe issue de l’empire Byzantin, où de telles accusations étaient monnaie courante. Elles demeurèrent sporadiques sous les Ottomans et furent régulièrement condamnées par les autorités. Ce n’est qu’au XIXe siècle que, prenant les proportions d’une véritable épidémie, elles se répandirent dans tout l’Empire, allant parfois jusqu’à déclencher des émeutes populaires362. » C’est au début du XXe siècle que les accusations de meurtre rituel lancées régulièrement par les communautés chrétiennes dans le monde musulman commencent à être reprises par les milieux musulmans eux-mêmes. En 1910, l’un des premiers signes de l’islamisation de l’accusation surgit en Iran, lorsqu’un pogrom est déclenché à Chiraz dans le quartier juif par des rumeurs de crime rituel : les accusateurs sont musulmans, comme la jeune victime supposée, une petite fille de quatre ans. Le pogrom fait 12 morts et plus de 50 blessés parmi les Juifs de Chiraz, lesquels, au nombre de 6 000, sont dépouillés de tous leurs biens363
(…)
(p.295) Dans un premier temps, l’arabisation de la judéophobie européenne s’opère par les chrétiens locaux ; dans un second temps, intervient l’islamisation des matériaux symboliques, laquelle s’accélère après la création de l’État d’Israël365. Dans ce nouveau contexte culturel, les enfants chrétiens sont donc concurrencés, puis remplacés par les enfants musulmans. Après la création de l’État d’Israël, la représentation du Juif comme criminel rituel est intégrée dans le discours ainsi que dans les images de propagande « antisionistes ». Après la guerre des Six-Jours (5-10juin 1967), des accusations de meurtre rituel sont ainsi lancées contre les Juifs en Egypte dès le 21 juin 1967, puis en 1971, 1972 et 1973, ainsi qu’au Liban et en Irak en 197l366. Par exemple, dans une interview publiée le 14 novembre 1973 par l’hebdomadaire Akhir Sa’a, Hassan Zaza, professeur d’hébreu à l’Université ‘Ayn Shams du Caire, affirme que les Juifs, bravant leurs propres lois, utilisent le sang de non-juifs à des fins rituelles367. En janvier 1978, dans le mensuel Octobre, édité au Caire, le journaliste influent Anis Mansour, ami du président Anouar el-Sadate, n’hésite pas à relancer l’accusation de crime rituel368. Quelques années auparavant, en août 1972, le roi Fayçal d’Arabie Saoudite, interrogé par un journaliste égyptien, commençait par accuser les Juifs d’avoir toujours eu des « intentions criminelles » et d’avoir pour objectif « la destruction de toutes les autres religions ». Il les accusait aussi d’avoir « déclenché les Croisades (…) afin d’affaiblir à la fois les chrétiens et les musulmans ». Puis il réaffirmait contre eux l’accusation de crime rituel : « Pour se venger, un jour dans l’année, ils^mélangent le sang des non-Juifs à leur pain avant de le consommer. » À titre de preuve, Fayçal racontait que deux ans auparavant, alors qu’il était en visite à Paris, il avait appris que la police avait découvert les cadavres de cinq enfants assassinés et vidés de leur sang par un groupe de Juifs à des fins rituelles. Et le roi de conclure ce bref tour d’horizon : « Cela vous indique la force de leur haine et de leur cruauté à l’égard des peuples non-juifs369. »
La réactualisation récente de ce mythe antijuif est repérable d’abord au milieu des années 1980, puis à la fin des années 1990 dans le monde arabo-musulman, en vue de criminaliser l’image d’Israël. Les propagandistes musulmans se servent de la vieille accusation chrétienne dans l’espoir de rallier les chrétiens370. Dans la propagande « antisioniste », le peuple palestinien est transfiguré en peuple de « héros » et de « martyrs », jusqu’à être christifié en peuple d’enfants-martyrs, ce qui réactive le vieil imaginaire antijuif du meurtre rituel. Le recyclage de ce thème d’accusation permet d’exploiter, dans la propagande « antisioniste », les images du Juif vampire et du Juif cannibale. En 1983, à Damas, Mustafa Tlass (né en 1932), alors ministre syrien de la Défense – il sera également vice-Premier ministre -, publie un ouvrage consacré à l’affaire de Damas, sous le titre Le Pain azyme de Si’on371. Ce livre pseudo-historique est en réalité un pamphlet antijuif, qui s’efforce de transformer la légende du meurtre rituel en une série de faits historiquement établis. Le libelle de Moustafa Tlass, ami intime et proche collaborateur du dictateur Hafez el-Assad, devient un best-seller dans le monde arabe, et ses traductions en anglais, en français et (p.296) en italien sont toujours diffusées par des réseaux néonazis372. En première page de couverture du livre est représenté un homme à la gorge tranchée dont le sang est recueilli dans une cuvette par des Juifs conformes aux caricatures nazies. Dans l’introduction de son pamphlet, Tlass présente l’assassinat rituel comme un invariant du comportement des Juifs, avant et après la création de l’État d’Israël : « [En 1840], Damas s’est trouvée sous le choc d’un crime terrible : le prêtre Thomas al-Kaboushi [le Capucin] est tombé entre les mains de Juifs qui ont cherché à le vider de son sang pour l’incorporer à des préparations destinées à la fête de Yom Kippour [sic]. Ce crime n’était pas le premier du genre. L’Occident a connu plusieurs crimes similaires, de même que la Russie tsariste. (…) L’incident de 1840 s’est reproduit plusieurs fois au XXe siècle, quand les sionistes ont commis des crimes à grande échelle en Palestine et au Liban — actes qui ont choqué les bonnes gens dans le monde entier et ont été unanimement condamnés. Mais à chaque fois, l’influence financière, médiatique et politique des sionistes a réussi à calmer la colère et à faire oublier ces crimes. (…) En publiant ce livre, je compte apporter des éclaircissements sur certains secrets de la religion juive en [décrivant] les actions des Juifs, leur fanatisme aveugle et répugnant vis-à-vis de leurs croyances et la mise en œuvre des préceptes talmudiques compilés en Diaspora par leurs rabbins (…)373. »
La banalisation de l’accusation de crime rituel dans le discours de propagande arabo-musulman s’est manifestée jusque dans certains débats à Î’ONU. Le 8 février 1991, lors du débat sur la discrimination raciale à la Commission des droits de l’homme à I’ONU, la représentante de la Syrie, Mme Nabila Saalan, après avoir évoqué « les crimes nazis perpétrés par les autorités sionistes d’occupation », a invité tous les membres de la Commission à lire Le Pain azyme de Sion, présenté comme un « livre précieux, qui confirme (…) le caractère raciste du sionisme374». En novembre 1999, dans un grand magazine littéraire syrien, Jbara al-Barguti publiait un article d’une extrême violence intitulé « Shylock de New York et l’industrie de la mort », où il amalgamait d’une façon caricaturale nombre de stéréotypes antijuifs : « Les enseignements du Talmud, imprégnés de haine et d’hostilité envers l’humanité, sont enracinés dans l’âme juive. À travers l’histoire, le monde a connu plus d’un Shylock, plus d’un père Thomas victime de ces instructions talmudiques et de cette haine (…). Maintenant, le temps du Shylock de New York est venu (…). Le pain azyme d’Israël continuera à être imprégné du sang que le Talmud l’autorise à verser à la gloire de l’armée juive375. » Le 28 octobre 2000, le grand quotidien gouvernemental égyptien Al-Ahram publiait un long article d’Adel Hammouda, titré « Une matza juive faite avec du sang arabe376 ».
(…)
Le thème du crime rituel juif est aussi revenu en force dans l’espace culturel du monde arabo-musulman avec certaines séries télévisées et une production de caricatures antijuives qui a fortement augmenté depuis la deuxième Intifada. En novembre 2003, durant le mois du ramadan (commencé le 27 octobre), Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah, présentait « Al Shatat » (« Diaspora »), une série syrienne constituant une grande fresque antisémite378, à l’instar de la production égyptienne, « Le Cavalier sans monture », diffusée lors du ramadan de l’automne 2002379, principalement fondée sur les Protocoles des Sages de S/on380. L’ampleur de la campagne antijuive déclenchée en Egypte par cette dernière série a été telle qu’en décembre 2002 le conseiller du président Moubarak pour les affaires politiques, Ossama El-Baz, spécialiste de droit international, a dû publier dans Al-Ahram une longue mise au point historique et critique sur les Protocoles, la légende du meurtre rituel et d’autres rumeurs antijuives circulant dans le monde arabo-musulman381. Mais, alors que « Le Cavalier sans monture » se contentait de démarquer les Protocoles, la série « Diaspora » puise ses matériaux narratifs à la fois dans le mythe du complot juif mondial et dans celui du crime rituel juif, sur la base d’écrits anti-talmudiques. L’idée directrice du récit est que les Juifs suivent les commandements de la morale immorale du Talmud, ordonnant le meurtre pour atteindre l’objectif final : la domination totale du monde. Cette série est composée de trente épisodes qui, à coups de clichés et de stéréotypes antijuifs, prétendent retracer l’histoire du sionisme de 1812 (date de la mort de Meyer Amschel Rothschild) jusqu’à la création de l’État d’Israël. Le refrain conspirationniste que fait entendre ce feuilleton syrien de propagande « antisioniste » est emprunté à la littérature dérivée des Protocoles : « Les Juifs dominent et contrôlent le monde. » Dans le vingtième épisode, le thème du crime rituel est mis en images : on voit un rabbin enseignant à des Juifs l’obligation religieuse de trancher chaque année la gorge d’un enfant chrétien et d’en mélanger le sang avec la farine permettant de préparer le pain azyme, pour, selon le rituel, « goûter la sainte matza de Pâque ».
(p.300) Digression sur l’affaire al-Dura
Dans la construction du « sionisme » comme une entreprise génoci-daire, les propagandistes font feu de tout bois : après avoir transformé les Palestiniens en symboles des pauvres, des humiliés et des offensés, puis en victimes de « l’impérialisme d’Israël » ou plus largement d’un « complot américano-sioniste » mondial, ils leur donnent le visage de prétendus enfants « martyrs ». C’est en effet par assimilation avec la légende du « crime rituel juif» que s’est opérée l’exploitation internationale, par toutes les propagandes « antisionistes », du prétendu assassinat par l’armée israélienne au cours d’une fusillade au carrefour de Netzarim (bande de Gaza), le 30 septembre 2000 (alors que commençait la seconde Intifada), du jeune Palestinien Mohammed al-Dura38S. Compte tenu de la gravité de cette affaire et de son rôle dans le déclenchement de la vague antijuive des années 2000, il convient de l’analyser de façon détaillée.
Le cameraman palestinien Talal Abu Rahma, travaillant régulièrement depuis 1988 pour France 2 en collaboration avec le journaliste Charles Enderlin, correspondant permanent de la chaîne publique en Israël, a filmé environ vingt-sept minutes de l’incident, constituant les rushes du reportage. La chaîne publique France 2 a diffusé le jour même, dans son journal, un court extrait du reportage contenant l’image-choc du jeune Palestinien de douze ans qui aurait été « tué de sang-froid », dans les bras de son père, par des soldats israéliens. Cette image de l’enfant inerte, présentée par Charles Enderlin – qui n’était pas présent à Netzarim sur le lieu de la fusillade – comme la preuve de la mort de l’enfant, a été diffusée et rediffusée par tous les médias de la planète, véhiculant et renforçant le stéréotype du Juif criminel et pervers, assassin d’enfants. Cette interprétation de la courte séquence de moins d’une minute, sélectionnée et commentée par le journaliste de France 2, a été confirmée par la déclaration faite sous serment par Talal Abu Rahma, devant l’organisation palestinienne de défense des droits de l’homme, à Gaza, le 3 octobre 2000 : « L’enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid par l’armée israélienne. »
Les effets d’incitation au meurtre de la diffusion de ces images ainsi interprétées ont été immédiats : le 12 octobre 2000, aux cris de « vengeance pour le sang de Mohammed al-Dura ! », des Palestiniens déchaînés ont mis en pièces les corps de deux réservistes israéliens. La haine et la violence meurtrière contre les Juifs paraissaient justifiées. La seconde Intifada, avec ses effets d’imitation hors des lieux du conflit, a été lancée sur le marché médiatique mondial d’une façon particulièrement efficace par ce montage d’images destiné à provoquer l’indignation. Dans ce contexte, le président français Jacques Chirac, accueillant le 4 octobre 2000 le Premier ministre israélien Ehoud Barak à Paris, a cru pouvoir lui lancer : « Ce n’est pas une politique de tuer des enfants. » Lors d’une manifestation propalestinienne organisée à Paris, place de la République, le 7 octobre 2000, (p.301) à l’appel de multiples associations (dont l’Union générale des étudiants de Palestine en France, le MRAP et la Ligue des droits de l’homme) et de partis politiques (les Verts, la LCR), des cris « Mort aux Juifs ! » et «Juifs assassins ! » sont lancés dans un contexte de nazification frénétique d’Israël, des Israéliens et des Juifs en général. Des panneaux portent l’image du « petit Mohammed » et de son père, sous le feu supposé des soldats israéliens, transformé en « assassins » et en « nazis ». On lit par exemple sur une affiche : « Stop au terrorisme juif hitlérien ! 1 Palestinien mort = 1 000 inhumains (Juifs) morts ». Une première depuis la Libération389. Dans diverses autres manifestions pro-palestiniennes en Europe, l’effigie d’un cercueil d’enfant est arborée en tête de cortège. De son côté, le poète palestinien Mahmoud Darwich compose un poème à la mémoire de cet « oiseau terrorisé par l’enfer tombant du ciel », qui « voudrait rentrer à la maison », mais qui « fait face à une armée » et « voit venir sa mort, inexorable ». Dans ce poème engagé, on apprend aussi que le jeune garçon a été abattu par le « fusil de chasseur de sang-froid ». L’inspiration du poète est en parfait accord avec la propagande de l’autorité palestinienne qui, sur le site officiel de l’Université de Gaza, diffuse le message suivant : « Le meurtre du petit Mohammed al-Dura a été commis intentionnellement et de sang-froid. »
La « mort atroce » supposée de l’enfant « martyr », tué par les « sionistes », est ainsi devenue sans tarder une légende, et l’enfant objet de culte dans les pays arabo-musulmans. On connaissait la transfiguration médiatique du Che, avec ses implications commerciales : celle de l’enfant al-Dura n’a rien à lui envier. Elle présente, en outre, de frappantes analogies avec le traitement des prétendus « enfants martyrs », sanctifiés ou canonisés à l’issue de certaines affaires médiévales de meurtre rituel. Quoi qu’il en soit, à partir du début d’octobre 2000, on voit l’image-choc du « petit Mohammed » à la télévision, dans les manuels scolaires, sur des timbres-poste et des tee-shirts. Mondialement diffusée durant l’année 2002, la vidéo de propagande réalisée par les islamistes pakistanais qui ont assassiné le journaliste américain Daniel Pearl paraît justifier l’assassinat sauvage et théâtralisé du « Juif Daniel Pearl », véritable crime raciste390, par le « martyre » du jeune musulman Mohammed al-Dura, reconnaissable en arrière-plan de la photo du journaliste avant son égorgement. Dans l’opinion occidentale, on observe des réactions semblables à celle de la journaliste Catherine Nay, déclarant sur Europe 1 : « Avec la charge symbolique de cette photo, la mort de Mohammed annule, efface celle de l’enfant juif, les mains en l’air devant les SS, dans le Ghetto de Varsovie. » La suggestion est claire, et illustre parfaitement l’idéologie de la substitution : le « racisme anti-arabe » a remplacé le « racisme antijuif» ; l’arabophobie et l’islamophobie représentent la forme contemporaine de la judéophobie. Dans la société de communication planétaire, les images peuvent constituer des armes redoutables, dès lors qu’elles inspirent des désirs de vengeance et alimentent la propagande en faveur dujihad mondial391.
(…)
(p.302) À la suite de nombreuses contre-enquêtes mettant en cause la chaîne publique de télévision française, France 2, qui avait diffusé le court montage d’images (55 secondes) destiné à faire le tour du monde, alimentant la haine à l’égard d’Israël et des Juifs, la mystification a commencé à être reconnue à l’automne 2007. À une mise en scène organisée par des Palestiniens sur place se serait ajoutée la sélection d’images due au journaliste Charles Enderlin, suivi en cela par les responsables de France 2393, et, bien sûr, le commentaire « explicatif» du journaliste. Charles Enderlin, dans un entretien avec Elisabeth Schemla réalisé le 1er octobre 2002, a rappelé ce qu’il avait dit lors du premier reportage, alors même qu’il n’était pas sur les lieux de la fusillade : « Ici, Jamal et son fils sont la cible de tirs venus de la position israélienne394. » II ne faisait là que reprendre les propos tenus par son cameraman Talal Abou Rahma, qui avait affirmé sous serment le 3 octobre 2000 que l’enfant avait été « tué intentionnellement et de sang-froid par l’armée israélienne ». L’ennui, c’est que le cameraman palestinien s’était piteusement rétracté le 30 septembre 2002. Il avait donc menti sous serment le 3 octobre 2000 comme il avait menti le 30 septembre 2000 à Charles Enderlin, qui lui faisait entièrement confiance.
Pour dénoncer l’imposture, il n’est nul besoin de suspecter la bonne foi de Charles Enderlin, qui a vraisemblablement été trompé par son collaborateur395. Il faut souligner le fait que l’attribution à des tirs israéliens de la mort supposée du petit Mohammed repose sur le seul témoignage, à géométrie variable, du cameraman palestinien. Or ce qui a été établi par les diverses enquêtes conduites par des journalistes et par l’armée israélienne depuis octobre 2000, c’est que, au cas où le jeune al-Dura aurait été tué (ce qui reste à prouver396), il l’aurait été selon une haute probabilité par une balle palestinienne397.
Dans une lettre datée du 23 septembre 2007, le directeur du Bureau de presse gouvernemental israélien, Danny Seaman, a estimé publiquement que les images avaient fait l’objet d’une manipulation de la part du cameraman Talal Abu Rahma. Il a précisé dans un entretien que, étant donné la position d’où tiraient les troupes israéliennes, les balles ne pouvaient pas toucher le père ni l’enfant. Il a aussi souligné que la vidéo ne montrait pas la mort du petit Mohammed. Dans une lettre datée du 10 septembre 2007, l’armée israélienne avait demandé à France 2 de lui communiquer, pour enquête, les rushes correspondant au reportage398. Ces interventions significatives sont en fait le résultat d’initiatives individuelles qui, en dépit des sarcasmes, se sont poursuivies en vue d’établir les faits, indépendamment des rumeurs. Outre les universitaires Richard Landes et Gérard Huber, les journalistes Denis Jeambar, Daniel Leconte et Luc Rosenzweig ont contribué à mettre en doute la conformité du reportage avec la réalité des événements399. Mais c’est surtout grâce aux efforts de Philippe Karsenty que l’icône victimaire al-Dura s’est transformée en « affaire al-Dura ». Après avoir visionné et analysé, avec d’autres observateurs, les rushes de France 2, Philippe Karsenty, jeune chef d’entreprise français qui dirige une (p.303) agence de notation des médias, Media-Ratings, s’est engagé dans un combat difficile en diffusant sur son site, le 22 novembre 2004, les conclusions de son examen critique, qualifiant de « supercherie » sur la base d’une « série de scènes jouées » le reportage du correspondant permanent en Israël, responsable du montage et du commentaire des images. Il n’hésite pas alors à affirmer qu’il s’agit d’un « faux reportage » et d’une « imposture médiatique », bref d’un reportage truqué. La direction de France 2 et son journaliste Charles Enderlin engagent des poursuites contre Philippe Karsenty qui, après avoir été jugé coupable de diffamation en première instance, le 19 octobre 2006, par la 17e chambre correctionnelle de Paris, fait appel400. À la demande de la 11e chambre de la cour d’appel de Paris, les rushes filmés par le cameraman palestinien sont visionnés et commentés par les deux parties au cours de l’audience du 14 novembre 2007. Mais, sur les 27 minutes de rushes qui ont été annoncées, France 2 n’en présente que 18, lesquelles donnent à voir notamment des répétitions de mise en scène de fausses fusillades, avec de faux blessés, ce qui suffit à jeter le doute sur le sérieux du reportage. Ce qui est sûr, c’est qu’il y avait un dispositif de mise en scène chez les Palestiniens présents sur les lieux. L’examen du fond de l’affaire est alors fixé au 27 février 2008.
Selon plusieurs articles de presse, le soupçon de truquage a été renforcé par le visionnage des rushes401. La dépêche de l’AFP du 14 novembre 2007 a fort bien caractérisé le point en litige : « Alors que le reportage se terminait sur une image de l’enfant inerte, laissant à penser qu’il était mort à la suite des tirs, dans les rushes, on voit, dans les secondes qui suivent, l’enfant relever un bras. C’est un des éléments qui poussent M. Karsenty à affirmer qu’il y a eu mise en scène402. » Contrairement à ce qu’a déclaré Charles Enderlin, les rushes ne contiennent aucune « image insupportable d’agonie d’enfant403 ». En déclarant que l’agonie de l’enfant a été filmée, Charles Enderlin semble avoir menti ou avoir été lui-même trompé, et s’être contenté d’en parler par ouï-dire. Quoi qu’il en soit, rien de tel n’a été filmé. Contrairement à ce que les médias n’ont cessé de répéter, la « mort en direct » de l’enfant n’a pas eu lieu. Si les rushes relatifs à « l’agonie » puis à la « mort de l’enfant » n’ont pas été présentés lors de l’audience du 14 novembre 2007, c’est tout simplement parce qu’ils n’existent pas. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune preuve que l’enfant a été tué. Ce qui n’exclut pas, bien sûr, que l’enfant, au cas où il aurait été touché – par des balles de tireurs palestiniens ou par des balles perdues, elles-mêmes probablement d’origine palestinienne, ayant fait ricochet —, soit décédé à la suite de ses éventuelles blessures. Mais on ne dispose d’aucune preuve de ce décès. Le 27 février 2008, devant la 11e chambre de la cour d’appel de Paris, Philippe Karsenty cite le rapport d’un spécialiste de balistique, Jean-Claude Schlinger, expert en armes et munitions près la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, intitulé Examen technique et balistique. Les conclusions de ce rapport confirment les doutes exprimés par divers spécialistes sur la version de Charles Enderlin et de son cameraman : « Si Jamal et Mohammed al-Dura ont été atteints par balles, les tirs ne pouvaient techniquement pas provenir du poste israélien, mais seulement du poste palestinien PITA, ou de tireurs placés dans le même axe.
(p.304) Aucun élément objectif ne nous permet de conclure que l’enfant a été tué et son père blessé dans les conditions qui ressortent du reportage de France 2. Il est donc sérieusement possible qu’il s’agisse d’une mise en scène404. »
Reste à s’interroger sur les raisons qui ont conduit le professionnel aguerri qu’est Charles Enderlin à sombrer dans ce qui ressemble à une faute professionnelle. Il faut tout d’abord tenir compte de la forte pression idéologique qui s’exerçait au début de l’Intifada Al-Aqsa. En février 2005, s’interrogeant sur le fait que les soldats israéliens avaient été si facilement accusés, sans la moindre preuve, d’avoir tiré sur l’enfant, le journaliste Daniel Leconte a justement relevé qu’il existait une « grille de lecture de ce qui se passe au Proche-Orient405 », et que les commentateurs avaient une forte tendance à y adapter les événements relatés, moyennant quelques « corrections » et accommodations. Dans une interview, croyant ainsi pouvoir se justifier, Charles Enderlin a ingénument déclaré : « Pour moi, l’image correspondait à la réalité de la situation, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie406. » Telle est la tyrannie de l’idéologiquement correct, fondé sur un sommaire manichéisme : d’une part, les méchants agresseurs, incarnés par les soldats israéliens sans visage ou par leurs machines à tuer, les tanks ; d’autre part, les innocentes victimes, représentées par les enfants palestiniens, avec des visages d’enfants qui souffrent. C’est peut-être là le principal succès de la propagande anti-israélienne depuis la première Intifada : dans les années 1990, et massivement lors de l’Intifada Al-Aqsa, les dirigeants palestiniens, en stratèges cyniques, mettent volontiers en avant les femmes et les enfants, donc des non-combattants supposés, susceptibles de faire d’émouvantes « victimes innocentes ». Le jeu manichéen des stéréotypes positifs et négatifs devient, en s’exportant dans le monde entier, un principe de codification des représentations du conflit israélo-arabe. C’est ainsi que l’idéologiquement vraisemblable a pu se transformer magiquement en réalité. En outre, n’étant pas présent à Netzarim sur le lieu de la fusillade supposée, le journaliste Charles Enderlin, qu’il ait été ou non saisi par le désir du scoop, a vraisemblablement été manipulé par son cameraman palestinien qui, membre du Fatah, n’a jamais caché son engagement politique. Quand Talal Abu Rahma a reçu un prix, au Maroc, en 2001, pour sa vidéo sur al-Dura, il a déclaré à un journaliste : «Je suis venu au journalisme afin de poursuivre la lutte en faveur de mon peuple4« 7. » Quoi qu’il en soit, Richard Landes, présent lors de cette audience, a relevé le fait qu’il manquait dans les rushes présentés le 14 novembre par France 2 et Charles Enderlin à la cour d’appel de Paris « les scènes les plus embarrassantes pour eux, notamment la scène du jeune au cocktail Molotov avec une tache rouge au front », avant d’ajouter : « Aux États-Unis, la présidente de la Cour aurait dit : « Comment osez-vous nous dire que vous avez enlevé les passages qui vous semblaient sans rapport ? C’est à nous de décider408. » »
Mais le mal était fait, et la rumeur criminalisante lancée. Innocente de ce dont on l’accusait, l’armée israélienne est devenue la cible de campagnes de diffamation visant, par un appel démagogique à l’émotion, à ternir l’image d’Israël. Une véritable opération de déshumanisation des « sionistes » a été orchestrée par tous les ennemis d’Israël, avec la complicité des médias manquant gravement à leur devoir d’objectivité. Des
(p.305) monuments commémoratifs se sont multipliés dans le monde musulman. La principale place de la capitale du Mali, Bamako, a été baptisée « place Mohammed al-Dura », où les autorités ont fait ériger un monument reproduisant une image des al-Dura, le fils blotti contre le père. En outre, exploitée par la propagande des islamistes radicaux, l’image du « petit Mohammed »-martyr a « sonné l’heure du Jihad mondial dans le monde musulman409 », un an avant les attentats antiaméricains du 11 septembre 2001. Cette image a paru confirmer l’une des affirmations récurrentes des hauts dirigeants d’Al-Qaida, selon laquelle les Juifs et leurs alliés américains « tuent les musulmans », ce qui justifiait le déclenchement du «Jihad défensif », impliquant l’obligation pour tout musulman de combattre les agresseurs des musulmans ou les envahisseurs des « terres musulmanes », bref tous les « ennemis de l’Islam41 » ».
Les islamistes palestiniens n’ont pas manqué d’instrumentaliser l’icône al-Dura dans la guerre politico-culturelle qu’ils mènent contre « l’ennemi sioniste » ou plus simplement « les Juifs ». Le Hamas s’est ainsi lancé dans une opération d’endoctrinement des jeunes enfants palestiniens dans la perspective du Jihad, en sloganisant l’accusation visant les Juifs comme « tueurs d’enfants ». Chaque vendredi après-midi, sur la chaîne satellitaire du Hamas, Al-Aqsa TV, est diffusée une émission pour enfants intitulée « Les Pionniers de demain ». La star de cette émission, très regardée par les enfants de tout le monde arabe, est une abeille géante nommée Nahoul. Le journaliste du Monde Benjamin Barthe présente ainsi cette émission de propagande : « Durant une demi-heure, Nahoul et la jeune présentatrice Saraa interprètent une série de sketchs entrecoupés d’interventions de spectateurs par téléphone. Les scénarios mêlent devinettes, conseils pratiques (« Les bienfaits de l’ananas ») et morale familiale (« Pourquoi il faut aimer sa mère ») à une forte dose de propagande islamiste, truffée d’apologie du « martyre » et d’incitation à la haine des « Juifs »4U. »
Précisons que l’abeille Nahoul a remplacé la souris Farfour, personnage ressemblant à Mickey Mouse, dont l’un des messages, au printemps 2007, était un appel à libérer « les pays musulmans envahis par les assassins ». Réagissant à une menace de procès par la compagnie Disney, Al-Aqsa TV a décidé de sacrifier Farfour, non sans une ultime provocation, qui a consisté à mettre en scène la mort de la souris islamiste, victime de l’extrême violence d’un interrogateur israélien, désireux de lui voler sa propriété412. Le mot de la fin a été prononcé par la présentatrice Saraa : « Farfour est mort en martyr en protégeant sa terre, il a été tué par les tueurs d’enfants. » L’intention directrice de l’émission est parfaitement exprimée dans le charmant dialogue destiné à présenter le nouveau personnage :
« – Saraa : Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
– Nahoul : Je suis Nahoul l’abeille, le cousin de Farfour.
– Saraa : Qu’est-ce que tu veux ?
– Nahoul : Je veux suivre les pas de Farfour.
– Saraa : Ah ? Comment ça ?
- Nahoul : Oui, le chemin de l’Islam, de l’héroïsme, du martyr et des Nous prendrons notre revanche sur les ennemis d’Allah, les assassins d’enfants innocents, les tueurs de prophètes, jusqu’à ce que nous libérions Al-Aqsa de leur impureté…
(p.306) – Saraa : Bienvenue, Nahoul413. »
L’objectif d’une telle émission est clair : conduire les jeunes téléspectateurs à intérioriser cette représentation du Juif comme criminel et infanticide afin de les disposer à devenir des combattants fanatiques. La légende du « crime rituel juif», réactivée par l’exploitation symbolique de la « mort en direct » du jeune al-Dura, est devenue une source d’inspiration pour toutes les formes culturelles de la propagande antijuive contemporaine, des timbres-poste et des affiches à l’effigie d’al-Dura aux émissions interactives de télévision. Il est hautement significatif que, face aux critiques, Hazem Sharawi, le jeune concepteur des « Pionniers de demain », ait ainsi défendu son émission : « Nous ne faisons que refléter la réalité. Regardez ce qui est arrivé à Mohammed al-Dura… » Pour les professionnels de la criminalisation des Juifs, l’absence de preuve de la mort d’al-Dura est devenue la preuve par al-Dura. La poupée engagée a donc continué à prêcher lejihad. Le journaliste du Monde souligne l’association récurrente entre l’appel au Jihad et le thème répulsif du «Juif tueur d’enfants»: «Dans un épisode diffusé fin juillet [2007], l’abeille islamiste parle de libérer la mosquée Al-Aqsa, dans la Vieille Ville de Jérusalem, des « impuretés des Juifs criminels ». À une petite spectatrice qui explique par téléphone vouloir devenir « journaliste », Nahoul conseille de « photographier les Juifs quand ils tuent les enfants ». Puis une autre fillette appelle et clame que, une fois grande, elle sera une « combattante du Jihad ». « Si Dieu le veut », répond Saraa, comblée par la ferveur islamiste de son très jeune public414. » On trouve une forme hyperbolique de l’accusation d’infanticide dans un dessin de propagande « antisioniste » dû au caricaturiste palestinien Alaa’Allaqta qui, né au camp de réfugiés d’Al-Shati dans la bande de Gaza, vit depuis 2006 au Caire où ri exerce sa profession de médecin. Sollicitant dans ses caricatures la plupart des stéréotypes antijuifs traditionnels, avec une préférence pour le symbole du serpent, Allaqta est un collaborateur régulier du quotidien du Hamas distribué dans la bande de Gaza, Felesteen, du site Internet du Jihad islamique palestinien, Paltoday, ainsi que de divers journaux saoudiens (tel Al-Madinah) et qataris (telAl-Sharq). Le dessin en question, publié le 14 mai 2007 dans le journal qatari Al-Sharq, représente un Israélien, dont on ne voit que la main armée d’un revolver et la manche ornée d’une étoile de David, tirant à bout portant sur un fœtus palestinien, en visant la tête415. La légende précise : « L’objectif d’Israël est [de tuer] des fœtus [palestiniens] dans le ventre de leur mère. » Ce qui est suggéré par cette caricature de combat, c’est que les Juifs ne se contentent pas de tuer des « enfants palestiniens innocents » : ces fils de Satan s’attaquent aux fœtus, donc à des êtres intrinsèquement innocents.
(p.307) En Israël, la prise de conscience du rôle des médias dans de telles opérations de propagande a stimulé la volonté de faire toute la vérité sur « l’affaire al-Dura ». Dans un article mis en ligne le 3 février 2009 par Ynetnews, l’écrivain Frimet Roth, citoyenne israélienne et mère de Malki Roth, tuée lors d’un attentat terroriste palestinien au restaurant Sbarro en 2001, fait observer que « Charles Enderlin a révélé que Yasser Arafat avait mis en scène son don de sang aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, à l’attention des médias, pour contrer l’effet des images embarrassantes de Palestiniens fêtant ces attentats dans les rues ». Elle poursuit en notant que cette révélation « illustre à quel point tous ceux qui sont impliqués dans la diffusion du mythe al-Dura continuent à faire preuve d’impudence » et déplore le fait que ces derniers « bénéficient du soutien du gouvernement français, soucieux de défendre la réputation de sa chaîne de télévision ». Mais Frimet Roth ne se montre pas moins indignée par « le silence du gouvernement israélien » qui, selon elle, « doit rétracter officiellement son aveu de culpabilité et affirmer qu’il n’a en rien contribué à la mort d’al-Dura, si celui-ci a été tué418 ». En réalité, les autorités israéliennes, dans un premier temps et avant toute enquête, n’avaient pas formellement écarté l’hypothèse que des balles d’origine israélienne aient pu toucher l’enfant. Cette hypothèse a été définitivement abandonnée à la suite de l’enquête menée par l’armée israélienne en octobre et novembre 2000, à la requête du général Yom-Tov Samia.
Dans l’affaire al-Dura, contrairement par exemple à l’affaire Dreyfus, le Juif innocent injustement accusé n’est pas un individu, c’est un être collectif : les Israéliens, diabolisés à travers leur armée polémiquement construite comme tueuse d’enfants arabo-musulmans, et, plus largement, les (p.307) « sionistes », c’est-à-dire les Juifs, pour tous leurs ennemis. Depuis octobre 2000, ce reportage n’a cessé d’alimenter, dans le monde musulman, le discours de propagande et d’endoctrinement fondé sur le culte du « martyr », dont l’objectif est d’inculquer, notamment aux enfants, les idéaux liés aujihad, culminant dans la mort en « martyr » illustrée par les « attentats-suicides ». Ce reportage a également encouragé, dans le monde occidental, les accusateurs professionnels d’Israël, comme ce sous-préfet français osant affirmer sur un site islamiste, en mars 2008, qu’Israël est le « seul État du monde dont les snipers abattent des fillettes à la sortie des écoles419 ». Ce qui revient à accuser l’Etat d’Israël de pratiquer, contre les Palestiniens, l’infanticide rituel. L’affaire al-Dura ne fait vraisemblablement que commencer.
(…) L’ennemi sioniste est par nature non seulement un criminel pratiquant le palestinocide, mais encore un voleur de « terre musulmane ».
(p.313) Dans son Anthropologie du point de vue pragmatique, Kant n’hésite pas à légitimer la représentation des Juifs (« les Palestiniens ») en tant que « nation d’escrocs » ou de « trompeurs » : « Les Palestiniens qui vivent parmi nous ont la réputation fort justifiée d’être des escrocs, à cause de l’esprit d’usure qui règne depuis leur exil parmi la majeure partie d’entre eux. Il est vrai qu’il est étrange de se représenter une nation d’escrocs, mais il est tout aussi étrange de se représenter une nation de commerçants, dont la partie^de loin la plus importante, liée par une ancienne superstition qu’accepté l’État où ils vivent, ne cherchent aucune dignité civile, mais veulent remplacer ce dommage par l’avantage de tromper le peuple qui les abrite ou même de se tromper les uns les autres28. »
Le pamphlet d’un élève de Kant, le professeur de philosophie Jakob Friedrich Pries (1773-1843), Über die Gefährdung des Wohlstandes und des Charakters der Deutschen durch die Juden (« Sur la mise en péril du bien-être et du caractère des Allemands par les Juifs »), publié en 1816, paraît être une mise en application politique de la « caractérologie » négative des Juifs élaborée par Kant. Assimilant l’esprit du christianisme et la nation allemande, Pries voit dans les Juifs une communauté étrangère, aux ramifications internationales, formée de « brocanteurs et de négociants en quête de filouteries », il les dénonce comme une « peste » et une « maladie des peuples », qu’il s’agit d’éliminer « à la racine29 ». Les Juifs constitueraient donc, pour la nation allemande, un triple danger : politique, économique et moral30. La haine du peuple pour les Juifs serait dès lors justifiée. Pour Pries, seule l’extirpation du judaïsme, vestige d’un passé barbare, est susceptible d’améliorer les Juifs31.
Le stéréotype négatif va ensuite se transformer en archétype littéraire, celui du spéculateur répulsif, incarné par d’innombrables personnages de romans ou de pièces de théâtre. Dans le roman de Charles Dickens, The Adventures of Oliver Twist (1837-1839), le personnage haïssable et méprisable du receleur juif Fagin, dont la fourberie n’a d’égale que la méchanceté, paraît être une nouvelle réincarnation littéraire, après Shylock, du type médiéval de l’usurier juif répulsif à tous égards32. La description qu’en fait Dickens en 1838 se fonde sur le postulat physiognomonique de la correspondance symbolique entre l’apparence physique et le caractère moral : « Un très vieux Juif ratatiné, dont le visage répugnant à l’aspect dépravé était couvert par quantité de touffes de poils roux33. » On sait que la rousseur est la couleur originellement associée à Judas34. L’illustrateur du roman, George Cruikshank, avait en outre affublé Fagin d’un nez crochu, complétant ainsi le portrait stéréotypé.
Rothschild ou la féodalité financière
Parmi les romanciers populaires, en France, le cas de Jules Verne (1828-1905) est particulièrement intéressant pour l’historien des stéréotypes antijuifs. On sait que Jules Verne, ancien agent de change peu performant, a tiré de sa malheureuse expérience directe de la Bourse une aversion pour le « vil métal ». Dans son premier écrit, Voyage en Angleterre
(p.314) et en Ecosse, l’écrivain débutant stigmatise sur le mode de l’ironie la puissance financière des Rothschild : « Il avait hâte de quitter Paris, son air lourd, son atmosphère ammoniacale (…) et la forêt vierge nouvellement plantée autour du palais de la Bourse où s’agitent les fidèles Giafars du puissant Haroun-al-Rothschild35. » Le mythe moderne du Juif riche, incarné par Rothschild, va devenir une matière première pour le romancier saisi par une haine obsessionnelle envers la « maudite soif de l’or » (auri sacra fames)*6 et sa version moderne capitaliste-financière37. Dans son roman Hector Servadac, publié en 1877, Verne caractérise le Juif « cousu d’or » Isac Hakhabut par cette addition de clichés négatifs : « C’était un homme de cinquante ans qui paraissait en avoir soixante. Petit, malingre, les yeux vifs mais faux, le nez busqué, la barbiche jaunâtre, la chevelure inculte, les pieds grands, les mains longues et crochues, il offrait ce type si connu du Juif allemand, reconnaissable entre tous. C’était l’usurier souple d’échiné, plat de cœur, rogneur d’écus et tondeur d’œufs. L’argent devait attirer un pareil être comme l’aimant attire le fer, et, si ce Shylock fût parvenu à se faire payer de son débiteur, il en eût certainement revendu la chair au détail38. »
(p.315)
Le motif fait l’objet d’infinies variations dans la presse catholique, à commencer par le journal fondé par les Assomptionnistes en 1883, La Croix, qui, en septembre 1890, se proclame « le journal le plus antijuif de France46 » et déplore que « notre presse nationale » soit « presque tout entière entre les mains de la juiverie cosmopolite et antifrançaise47 ». Dans l’hebdomadaire Le Pèlerin, qui s’est progressivement aligné sur les positions du journal La Croix après le scandale de Panama (1889), on peut lire en décembre 1892 cette paraphrase de Drumont : « Ceux qui, aujourd’hui, sont tout n’étaient rien il y a un siècle, ils sont arrivés en 1790 dans un pays riche, et seuls maintenant ils sont riches dans le pays appauvri48. » Là où est le Juif, affirme encore le père Bailly dans l’hebdomadaire catholique, « on voit l’or et l’argent accourir vers lui, comme le fer à l’aimant. Il est millionnaire, milliardaire, tout est à lui49 ».
En 1890, le socialiste blanquiste Albert Regnard résume sa vision sociale-raciste du Juif : « Le Juif est vis-à-vis de l’Aryen comme le capitaliste vis-à-vis du prolétaire et, dans une bonne mesure, le capitalisme est une création sémitique50. » Regnard attribue aux Juifs la pratique de l’usure comme un caractère de race : « II est faux que les fils d’Abraham aient été réduits à l’usure par le fait des circonstances. Allons donc ! On ne devient pas usurier sous le poids des événements ; on naît tel ! Et c’est précisément le cas de la race juive51. » Quelques années plus tard, le chansonnier montmartrois Aristide Bruant (1851-1925), défenseur des malheureux, des prostituées et des condamnés s’attaque aux « Youpins » dans une goualante à succès : « Les Youpins, c’est des vilains types (…). Ils sont mariolles, i’ sont rupins. l’s ont du pognon plein leurs poches, Les Youpins52. »
Dans L’Argent, roman publié en 1891, Emile Zola reconstitue avec une terrible précision les thèmes antijuifs obsessionnels de son époque, centrés sur la « Haute Banque juive » incarnée par les Rothschild. Sans les reprendre à son compte, en témoin et en enquêteur, le romancier a réuni tous les stéréotypes négatifs tournant autour du «Juif usurier » devenu le grand financier moderne visant à dominer le monde. Dans le personnage du financier malheureux Saccard, on retrouve des traits d’Eugène Bontoux, banquier catholique et légitimiste ruiné par le krach de l’Union générale (1881-1882). Quant au banquier juif Gundermann, ennemi de Saccard, il joue dans le roman le rôle d’un banquier impitoyable construit sur le modèle de Rothschild. Commençons par le portrait du banquier juif devenu milliardaire : « Gundermann occupait là un immense hôtel, tout juste assez grand pour son innombrable famille. (…) En moins d’un siècle, la monstrueuse fortune d’un milliard était née, avait poussé, débordé dans cette famille, par l’épargne, par l’heureux concours aussi des événements. Il y avait là comme une prédestination, aidée d’une intelligence vive, d’un travail acharné, d’un effort prudent et invincible, continuellement tendu vers le même but. (…) »
(p.327) La figure du Juif perfide et usurier, parasite et prédateur, incarnation de la « finance internationale », après avoir été reprise par les idéologues nazis, à commencer par Hitler153 et par divers professionnels de la dénonciation du complot juif mondial depuis les années 1930154, est, depuis la fin du XXe siècle, exploitée par les mouvances islamistes, du Hamas à Al-Qaida155. Mais l’accusation de perfidie, loin d’appartenir aux seuls islamistes, qu’ils soient fondamentalistes ou expressément jihadistes, circule dans des milieux fort divers du monde arabo-musulman, y compris les milieux nationalistes censés être « laïques ». En 1989, Abou lyad, alors numéro deux de la hiérarchie de l’OLP derrière Yasser Arafat, pouvait ainsi déclarer : « Les Juifs, qui sont l’excrément de l’espèce humaine, peuvent-ils tenir une promesse (puisqu’ils n’ont pas tenu la promesse (p.328) faite au Prophète) ? La perfidie coule dans leurs veines, comme le montre le Coran. Les Juifs sont tels qu’ils ont toujours été156. »
Complot
Le Juif, puissance occulte, ou le judéo-maçon
Le cinquième thème d’accusation identifiable est celui du complot juif. Le mythe du complot juif se présente historiquement sous trois formes : d’abord sous celle d’un complot local à l’époque médiévale, ensuite sous celle d’un complot national (ou intra-national) dans la seconde moitié du XIXe siècle, enfin sous celle d’un complot international ou mondial à la fin du XIXe et au XXe siècle (prolongé par le début du XXIe siècle)157. Sa présupposition générale est la conviction que les Juifs sont solidaires entre eux (thème déjà présent dans le Pro Flacco, plaidoirie de Cicéron prononcée en 59 avant J.-C.)158, cette solidarité interne particulièrement prononcée allant de pair avec un exclusivisme sans pareil. L’accusation de complot fait partie du stock des calomnies utilisées contre les Juifs dès le début de l’ère chrétienne. Mais son élaboration, sa transformation en récit légendaire, ne s’opérera qu’à partir du XIVe siècle. Au XIXe siècle, le complot juif se délocalise, pour devenir soit national, soit international. Il fournit un cadre interprétatif à la dénonciation de la « conquête juive » et de la « domination juive », présentées comme la conséquence fatale de l’émancipation des Juifs, ou l’effet catastrophique de l’individualisme démocratique.
(p.332) Lorsqu’Adolf Hitler décide de s’affilier en septembre 1919 au Parti ouvrier allemand (DAP, Deutsche Arbeitpartei)]94, où sont violemment dénoncés l’« esclavage de l’intérêt» et le «capitalisme juif», c’est après avoir « lu avec intérêt » une brochure pamphlétaire d’Anton Drexler (1884-1942), l’un des dirigeants de ce parti nationaliste et raciste patronné secrètement par la Société Thulé : Mein politisches Erwachen. Aus dem Tage-buch eines deutschen sozialistischen Arbeiters (« Mon éveil politique. Carnets d’un ouvrier allemand socialiste »)l<b. Drexler y cite les « instructions d’un rabbin » incitant les Juifs à pousser les ouvriers à la révolution et aux émeutes « pour nous rapprocher du seul but qui compte, dominer la terre selon la promesse donnée à notre père Abraham196 ». Face à ce danger, Drexler appelle les travailleurs à s’unir pour lancer aux Juifs : « Hors d’Allemagne ! Hors de tous les partis ! Hors de tous les pays ! Repartez dans votre patrie, la Palestine ! Ou alors, tyrans du monde, vous serez écrasés197 !»
(p.337) / le mythe du juif raciste/
Il convient bien sûr d’analyser les contextualisations diverses, depuis la fin du XIXe siècle, de cette narration mythique fondatrice située au cœur de la vision antisémite de l’antisémitisme. Elle met en scène un ordre d’évolution stadial supposé invariable, qu’on peut reconstruire et présenter selon le schéma suivant : « I. Avant l’installation des Juifs : les peuples vivent heureux ; IL L’accueil des Juifs, leur installation et leur affermissement ; III. L’action négative des Juifs, inassimilables, dominateurs et destructeurs par nature ; IV. La réaction antijuive : résistance des peuples à l’emprise juive », hostilité ouverte, réactions de défense et de rejet5. » Cette légitimation réactionnelle des mobilisations antisémites peut être illustrée par ce fragment d’un discours, daté de 1940, du révérend Gerald B. Winrod : « Une vague d’antisémitisme balaie le monde comme une réaction contre (1) le contrôle juif des moyens de communication, (2) la finance juive internationale, et (3) le communisme athée, qui fut originellement engendré par l’intellectualisme juif et le capitalisme juif’. »
(p.339)
En décembre 2000, dans l’hebdomadaire égyptien Octobre, le général de réserve Hassan Souïlem a donné une version sécularisée, se réclamant des travaux scientifiques contemporains, du même discours de dénonciation, qui persiste en dépit de la substitution d’une légitimation scientifique à une légitimation religieuse. Les Juifs, des origines à nos jours, seraient restés les mêmes, agissant en permanence comme un principe de corruption et une cause de troubles ou de conflits : « Les historiens, les professeurs en études raciales et les sociologues s’accordent pour dire que l’humanité, durant sa longue histoire, n’a jamais connu une race telle que la race juive, où sont concentrés autant de traits vils et méprisables. Les Juifs ont une caractéristique qui les distingue des autres : chaque fois qu’ils se sont rassemblés dans un lieu particulier et qu’ils s’y sont sentis à l’aise, ils ont transformé ce lieu en repaire du mal, de la corruption, de l’incitation à la division et de la multiplication des conflits. (…) Il n’y a pas de différence, comme l’affirment certains, entre le Juif d’hier et le Juif d’aujourd’hui, entre l’identité juive et l’identité israélienne. En effet, Israël en tant qu’État est un réceptacle pour tous les Juifs du monde. Le sionisme est l’aspect politique et colonialiste de la religion juive18. »
Peu après les attentats antiaméricains du 11 septembre 2001, le cheikh égyptien Mohammed al-Gameya, représentant de l’Université al-Azhar aux États-Unis, et qui exerce la fonction d’imam au Centre islamique et à la mosquée de New York, rentre précipitamment en Egypte, se plaignant d’avoir fait l’objet de « persécutions » aux États-Unis, « comme tous les musulmans et tous les Arabes » après les attentats de Manhattan. C’est donc d’Egypte qu’il multiplie les déclarations sur les « véritables responsables » des attentats terroristes, précisant qu’il a « compris que tout le monde savait que les Juifs et les sionistes étaient derrière ces actes criminels, mais que personne n’avait le courage de le dire publiquement », car « les sionistes contrôlent tout, y compris les décisions politiques, les médias et les grands centres financiers et économiques19 ». Dans l’une des interviews qu’il accorde dans ce contexte, al-Gameya reprend alors les vieilles accusations contre les Juifs, assorties d’une mise à jour paraissant tirée du Juif International de Henry Ford, pour en déduire qu’ils ont organisé secrètement les attentats antiaméricains : « Les Juifs sont conformes à la parole d’Allah : « Ils ont répandu la corruption sur la terre. » Nous savons qu’ils ont toujours violé les accords, tué injustement les Prophètes et trahi la confiance qu’on leur avait accordée (…). On les voit
(p.340) à tout moment répandre la corruption, le blasphème, l’homosexualité, l’alcool et la drogue. Ils ont créé le strip-tease, les clubs d’homosexuels et de lesbiennes partout, afin d’imposer leur hégémonie et de coloniser le monde entier (…). Maintenant, ils exercent leur domination sur les grandes puissances (…). Ils ont aussi exercé leur domination sur l’Allemagne, mais Hitler les a éliminés parce qu’ils l’avaient trahi (…). Tous les signes convergent en direction des Juifs, parce qu’ils sont les seuls capables de concevoir une action pareille [les attentats du 11 septembre 2001]. (…) Si les Américains avaient appris la vérité, ils auraient fait aux Juifs ce qu’Hitler leur a fait. (…) Allah a dévoilé le complot des Juifs qui essayaient de déformer l’image des musulmans20. »
Si les Juifs, mus par la haine de l’islam qui est chez eux une « disposition naturelle21 », poursuivent depuis toujours leur objectif principal, la « destruction de l’islam », alors il convient de lancer contre eux le Jihad : le « combat sacré » représente la seule réaction légitime contre les pires ennemis des musulmans. Le « combat contre les Juifs » s’impose comme un « combat sacré ».
(p.346) Le topos judéophobe a été repris par Dieudonné dans ses diatribes contre « le peuple élu ». Dans un entretien publié le 23 janvier 2002 par Lyon Capitale, l’humoriste engagé et « antiraciste » tonitruant, interviewé en tant que candidat à l’élection présidentielle (tout arrive !), précisait sa pensée très approximative sur « les Juifs » : « Le racisme a été inventé par Abraham. « Le peuple élu », c’est le début du racisme. Les musulmans aujourd’hui renvoient la réponse du berger à la bergère. Juifs et musulmans pour moi, ça n’existe pas. Donc antisémite n’existe pas parce que Juif n’existe pas [sic]. Ce sont deux notions aussi stupides l’une que l’autre. Personne n’est juif ou alors tout le monde [sic] (…). Pour moi, les Juifs, c’est une secte, c’est une escroquerie. C’est une des plus graves [re-sic] parce que c’est la première55. » La circulation de ce thème d’accusation a été fortement favorisée, dans les années 1990 et 2000, par l’action des relais médiatiques de la propagande palestinienne, particulièrement nombreux et efficaces en France. C’est ce dispositif qui a favorisé la banalisation de ce que Robert Wistrich a appelé « l’antisémitisme intellectuel » en Europe de l’Ouest56. À l’automne 2004, le journaliste-militant « antisioniste » Alain Ménargues, alors directeur général adjoint de l’information de Radio France Internationale (RFI), publie un essai « engagé » intitulé Le Mur de Sharon, aussitôt largement médiatisé. Dans un chapitre de son livre57, il fait remonter au Lévitique et à la séparation du pur et de l’impur le principe théologico-religieux dont s’inspire selon lui la « barrière de sécurité », qualifiée de « mur de la honte » en écho de la propagande palestinienne. La construction du « mur » manifesterait la volonté des Juifs de se séparer des Palestiniens « impurs », et marquerait la permanence de « l’esprit de ghetto58 ». Et le journaliste ne se prive pas d’affirmer dans les médias qu’Israël est « un Etat raciste59 ». Tout est bon pour démoniser Israël et le sionisme : un simple « mur » suffit. Tel est le détour fait par Ménargues pour justifier son accusation de « racisme », d’« épuration ethnique60 » et d’« apartheid » visant Israël61.
Parmi les nouveaux ennemis non déclarés des Juifs, à l’extrême gauche, on trouve ceux qui, pour illégitimer l’existence même d’un peuple juif doté d’une identité propre, poussent l’universalisme abstrait (p.347) jusqu’à l’absurde. Dans cette perspective dogmatique développée par des penseurs contemporains dits « radicaux », toute identité de groupe fait scandale en ce qu’elle est une mise à part, une manière pour une communauté fictive de s’ériger en exception sacralisée ou de pratiquer un insupportable exclusivisme, niant l’impératif d’égalité universelle. Le « bon Juif » ne peut être, à leurs yeux, que le Juif départicularisé, donc déjudaïsé, soit le Juif non-juif, le «Juif de négation » (comme dit Jean-Claude Milner) ou l’« Alterjuif » (comme dit Shmuel Trigano après Muriel Darmon), voire le Juif antijuif02. Qu’il y ait encore aujourd’hui des individus s’identifiant comme Juifs, cela relève pour eux de l’intolérable : il ne devrait y avoir que des individus semblables et égaux, de purs représentants quelconques du genre humain – « ni Juifs ni Grecs… ». Dans l’introduction de son » »7 recueil de textes illustrant le genre « radical-chic » de la préciosité pamphlétaire, Circonstances, 3. Portées du mot « juif », paru en 2005, Alain Badiou définit ainsi l’objet de sa réflexion sur le mot «juif» : « II s’agit (…) de savoir si le mot « juif constitue, oui ou non, un signifiant exceptionnel dans le champ général de la discussion intellectuelle publique, exceptionnel au point qu’il serait licite de lui faire jouer le rôle d’un signifiant destinai, voire sacré63. » La question ainsi posée n’est qu’un geste rhétorique : pour Badiou, la réponse est oui. Le « signifiant « juif » serait donc, parmi les « noms communautaires, religieux ou nationaux » indûment « sacralisés », le plus dangereux. Ce gauchiste de la chaire, resté un admirateur du dictateur Mao64, explicite ainsi sa position, en s’inscrivant * dans une lignée supposée prestigieuse : « Une variante abstraite de ma position consiste à remarquer que, de l’apôtre Paul à Trotski, en passant par Spinoza, Marx ou Freud, l’universalisme créateur ne s’est étayé du communautarisme juif qu’en créant un nouveau point de rupture avec lui. Il est clair qu’aujourd’hui, l’équivalent de la rupture religieuse de Paul avec le judaïsme établi, de la rupture rationaliste de Spinoza avec la Synagogue, ou de la rupture politique de Marx avec l’intégration bourgeoise d’une partie de sa communauté d’origine, est la rupture subjective avec l’État d’Israël, non dans son existence empirique, ni plus ni moins impure que celle de tous les États, mais dans sa prétention identitaire fermée à être un « État juif et à tirer de cette prétention d’incessants privilèges, singulièrement quand il s’agit de fouler aux pieds ce qui nous tient lieu de droit international65. »
(p.350) La racisation du sionisme culmine avec sa nazification, devenue ordinaire dans le discours néo-gauchiste et néo-communiste des années 2000-2005 à travers l’amalgame polémique « Sharon = Hitler ». Mais dans le nom « Sharon », il faut entendre « Israël » ou « le sionisme », et, à travers la figure de Hitler, c’est le nazisme comme système raciste et génocidaire qu’il faut voir. Il faut enfin considérer ce que cet amalgame de propagande rend possible et acceptable, voire souhaitable. Face à cette figure supposée du Mal absolu, Israël, seule s’impose la logique de l’éradication totale. Le slogan « Mort à Israël ! » a remplacé le slogan « Mort aux Juifs ! ».
(p.353) L’antisionisme radical, figure contemporaine de la judéophobie
La mythologie « antisioniste » a une valeur instrumentale pour les ennemis de l’État juif dans la guerre culturelle qu’ils mènent contre ce dernier, partout dans le monde. Cette mythologie s’est inscrite au cœur de la vision islamiste du monde, qui tourne autour d’un projet utopique et « révolutionnaire » d’islamisation de la planète, objectif final d’une stratégie visant à multiplier les États islamiques, en commençant par renverser les gouvernements existants dans les pays musulmans jugés soumis à la mécréance occidentale. Dans le discours islamiste – quelles qu’en soient les variantes -, la « libération de la Palestine », comprise comme une « libération » de toute la « terre musulmane » de la Palestine dite « occupée » par les Juifs, constitue l’une des étapes fondamentales dans la réalisation du programme d’islamisation du monde. Autrement dit, dans la perspective islamiste, la « cause palestinienne » constitue à la fois un motif de Jihad et un puissant moyen d’attirer la sympathie de fractions du monde non-musulman afin d’y nouer des alliances provisoires. En Europe et dans les deux Amériques, par exemple, nombreux sont les militants pro-palestiniens, notamment à l’extrême gauche, qui puisent sans prudence ni scrupule dans la mythologie « antisioniste », croyant ainsi gagner en efficacité dans leur combat pour la cause palestinienne. Ils croient pouvoir négliger le fait que ladite « cause palestinienne » est déjà largement islamisée, et ce, d’une façon croissante depuis la fin des années 1980, comme en témoigne la création du Hamas. Ces militants néo-gauchistes ou tiers-mondistes, s’imaginant combattre pour la « libération » d’un peuple « opprimé » et en quête d’un État national, ne savent pas qu’ils combattent pour une cause islamique, par définition supranationale. Ou bien ils font semblant de ne pas savoir qu’ils soutiennent une « cause » nationale-religieuse impliquant la destruction d’un État existant, l’État d’Israël.
(p.354) La même mythologie « antisioniste » structure le système des croyances des masses musulmanes soumises à un endoctrinement permanent par les services spécialisés d’États autoritaires ou despotiques, présentant pour certains des traits totalitaires, que ce soit dans le monde arabe (Libye, Syrie, Arabie Saoudite) ou ailleurs, en particulier en Iran. Une enquête d’opinion sur les attitudes envers Israël dans cinq pays arabes (Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweit et Liban), réalisée en mars 2002 par Zogby International, montre que le sentiment anti-israélien y est extrêmement fort : les opinions très défavorables envers Israël vont de 79 % en Egypte à 97 % en Arabie Saoudite1. Par ailleurs, d’autres enquêtes permettent d’établir que le rejet d’Israël se traduit par le rejet des Juifs : une étude d’opinion réalisée en Egypte après les attentats du 11 septembre 2001 montre qu’environ 90 % des personnes interrogées ne souhaitent pas avoir un Juif pour voisin2.
(p.355) (…) Les attitudes qu’on appelle ordinairement « anti-israéliennes » ou « antisionistes » sont donc dotées d’une valeur prédictive pour la connaissance des attitudes antijuives (« antisémites »). Il s’ensuit que lorsque les critiques envers Israël sont à la fois systématiques et virulentes, on peut considérer comme hautement probable le fait que ces critiques soient « le masque d’un antisémitisme sous-jacent7 ».
(p.357) La grande vague de judéophobie d’extension planétaire aujourd’hui observable a pour moteur principal une vulgate anti-israélienne qui, élaborée par la propagande soviétique autant que par la propagande arabo-musulmane dans les années 1950 et 1960, s’est mondialisée à grande vitesse depuis la fin des années 1960.
(p.358) Le concept d’antisionisme radical a été repris par Jean-Christophe Rufin dans son rapport remis au ministre de l’Intérieur (Dominique de Villepin) le 19 octobre 2004 : Chantier sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Un rapport exceptionnellement lucide et courageux, qui a valu à l’écrivain une campagne de dénigrement22. Dans son rapport, Rufin définit en particulier la catégorie d’« antisémitisme par procuration », qu’il distingue nettement de celles, respectivement, d’« antisémitisme comme pulsion » (celui des auteurs de violences) et d’« antisémitisme comme stratégie » (celui des idéologues ou des agitateurs professionnels). L’« antisémitisme par procuration » est « celui des facilitateurs qui, par leurs opinions – ou leur silence -, légitiment les passages à l’acte » tout en se gardant de commettre eux-mêmes des actions violentes23. Et, « parmi toutes les formes, subtiles, d’antisémitisme par procuration », Rufin en distingue une tout particulièrement, « l’antisionisme radical », dont la définition rejoint celle que j’avais donnée de la « nouvelle judéophobie » : « Cet antisionisme moderne est né au confluent des luttes anticoloniales, antimondialisation, antiracistes, tiers-mondistes et écologistes. Il est fortement représenté au sein d’une mouvance d’extrême gauche altermondialiste et verte. (…) La conférence de Durban (…) a donné lieu à la plus violente mise en scène de cet antisionisme antiraciste24. » Le médecin-écrivain met aussi fortement en évidence la force légitimatrice de l’antisionisme radical, comme forme dominante de la judéophobie contemporaine. Il en souligne justement l’une des conditions, le couplage de la cause palestinienne avec d’autres causes mobilisatrices : « En légitimant la lutte armée des Palestiniens quelle qu’en soit la forme, même lorsqu’elle vise des civils innocents », l’antisionisme radical, « amalgamé à des thématiques auxquelles les jeunes sont sensibles : l’avenir de la mondialisation, les dangers écologiques, la pauvreté croissante du Tiers-monde », tend à « légitimer les actions violentes commises en France même25 ».
(p.359) Le président Bush, surtout après les attentats antiaméricains du~7 11 septembre 2001, a été à son tour dénoncé comme «valet» ou « marionnette de Sharon », ou encore des « likoudniks ». Le numéro deux d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri (né au Caire en 1951), considéré comme le « cerveau du Jihad »34, a déclaré sans fard en 2002 : « L’Amérique est aujourd’hui totalement contrôlée par les Juifs35. » « Les Juifs », et non pas seulement les « sionistes » ou les « likoudniks »… À bien des égards, dans (p.360) le nouveau discours antijuif, le jumelage de « l’impérialisme américain « et du « sionisme » a remplacé le couplage du judaïsme et de la franc-maçonnerie, ainsi que l’amalgame entre Juifs et bolcheviks.
CHAPITRE 12 Le nouveau régime des accusations antijuives
(p.363) Dès la fin des années 1960, dans la rhétorique « antisioniste », l’accusation de « génocide » s’ajoute à celles de « colonialisme » et de « racisme » et, bien sûr, d’« impérialisme », présentes dans le discours palestinien de propagande dès ses premières esquisses, dues au travail préparatoire des réseaux du mufti Haj Amin al-Husseini et des « nazis du Caire », dont Johann von Leers (« Omar Amin»), l’un des plus actifs1. En Europe, certains milieux négationnistes d’extrême droite apportent leur pierre à l’édifice « antisioniste », notamment à l’époque de la guerre des Six-Jours, par un double argument : alors que la « Solution finale », selon eux, n’aurait jamais, pour les nazis, signifié « génocide » des Juifs (position négationniste), les Israéliens la mettraient réellement en application vis-à-vis des Palestiniens, avec le soutien de la « juiverie internationale ». Le néonazi François Duprat, en juillet 1967, théorise ainsi l’accusation infâme : « Les Israéliens sont-ils débarrassés des tares physiques de leur race ? (…) Israël, un pays débarrassé de la lèpre de l’internationalisme (…) juif, plaie de tous les peuples du monde ? (…) Ils savent compter sur la juiverie internationale, toujours prête à entrer en action lorsque les intérêts de la « Race Élue » sont menacés n’importe où dans le monde. (…) L’exploitation des pseudo « Six millions de morts » du national-socialisme a arraché à l’Allemagne Fédérale un milliard de dollars depuis 1952 (…) Le frénétique impérialisme sioniste se donne libre cours2. »
(p.366) Le 26 mai 2005, la cour d’appel de Versailles a condamné le sociologue Edgar Morin et Jean-Marie Colombani, en qualité de directeur de la publication du Monde, ainsi que le député européen (chevènementiste) Sami Naïr et la romancière (pro-palestinienne) Danièle Sallenave15, pour « diffamation raciale » envers le peuple juif. Pour la cour d’appel de Versailles, la tribune libre intitulée « Israël-Palestine : le cancer », parue dans Le Monde le 4 juin 2002 sous la signature d’E. Morin, D. Sallenave et S. Naïr, contient deux passages (ceux rapportés ci-dessus) qui constituent une diffamation raciale au sens des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel a donc condamné MM. Morin, Colombani, Naïr et Mme Sallenave à verser à l’association France-Israël et à l’association Avocats sans Frontières un euro de dommages-intérêts, ainsi qu’un total de 6 000 euros de frais de procédure, et a ordonné la publication de l’arrêt dans Le Monde. Elle a infirmé ainsi le jugement rendu en première instance, le 12 mai 2004, par le tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) qui avait débouté ces associations de leurs poursuites. Dans ses attendus, la cour d’appel de Versailles reproche aux trois cosignataires de l’article (et au directeur du Mondé) d’avoir imputé « à l’ensemble des Juifs d’Israël le fait précis d’humilier les Palestiniens et d’en tirer satisfaction » et d’avoir imputé « aux Juifs dans leur globalité et, au-delà même des seuls Juifs d’Israël, le fait de persécuter les Palestiniens ». La cour estime que ces passages, « par l’imputation outrancière des faits se (p.367) distinguent du reste de l’article qui renferme l’expression des convictions personnelles des auteurs dans le cadre d’un débat politique dont le caractère grandement polémique se justifie par la nature même du conflit » israélo-palestinien. Elle juge cependant que les passages condamnés « sont au-delà de la polémique » en ce qu’ils dressent « un constat péremptoire diffamatoire de la nation juive16 ».
(p.370) Dans un sermon prononcé le vendredi 13 mai 2005, retransmis depuis la Grande Mosquée de Gaza en direct sur la télévision de l’Autorité palestinienne, /le cheikh Ibrahim/ Muderis affirmait en substance que « l’ultime étape de l’histoire sera la domination de tous les pays chrétiens par l’Islam et l’extermination de tous les Juifs ».
(p.371) /Muderi:/ « (…)Regardez l’histoire moderne. Où sont la Grande-Bretagne, la Russie tsariste, la France qui dominait presque la totalité du monde ? Où est l’Allemagne nazie qui a massacré des millions de personnes et dominé le monde ? Où sont parties toutes ces superpuissances ? Lui qui les a faites disparaître fera aussi disparaître l’Amérique, Inchallah. »
Mais, dans son sermon, le cheikh Mudeiris ne s’en tient pas à ce résumé saisissant de la vision conspirationniste de l’Histoire, il formule en outre une prophétie, celle de la revanche finale de l’islam sur ses ennemis :
« Nous avions autrefois dominé le monde, et par Allah, le jour viendra où nous le dominerons à nouveau. Le jour viendra où nous dirigerons l’Amérique. Le jour viendra où nous dirigerons la Grande-Bretagne et le monde entier. Sous notre domination, les Juifs n’auront pas une vie tranquille, parce qu’ils sont des traîtres par nature, et ils l’ont toujours été tout au long de l’histoire. (…) Le jour viendra où tout sera repris aux Juifs, même les arbres et les pierres qui ont été leurs victimes. Chaque arbre et chaque pierre voudront que les musulmans viennent à bout de tous les Juifs29. »
(p.372) Dans un entretien accordé le 21 octobre 2001 au journaliste Taysir Aluni pour Al-Jazira, Oussama Ben Laden répond sans détour à la question de savoir s’il est partisan du « choc des civilisations » : « Sans aucun doute. Le Livre [saint] le mentionne clairement. Les Juifs et les Américains ont inventé ce bobard de paix sur terre. Ce n’est qu’un conte pour enfants. Ils ne font que chloroformer les musulmans tout en les conduisant à l’abattoir. Et la tuerie continue. Si nous nous défendons, on nous appelle terroristes. Le Prophète a dit : « La fin [du monde] n’adviendra pas avant que les musulmans et les Juifs ne se combattent jusqu’au point où le Juif se cachera derrière un arbre et un rocher. Alors l’arbre et le rocher diront : ‘Eh musulman ! il y a un (p.373) Juif qui se cache derrière moi. Viens le tuer !’. » Celui qui prétend qu’il y aura une paix durable entre nous et les Juifs est un impie [kafa] car il renie le Livre [saint] et son contenu34. »
On soulignera le fait qu’une opération relevant du « crime contre l’humanité » apparaît ainsi pour la première fois, dans la période postnazie, comme un objectif clairement fixé d’un combat mondial. Il reste à s’interroger sur le fait non moins troublant que c’est seulement dans le monde musulman, et en référence à une certaine lecture du Coran, qu’un tel projet criminel de grande envergure est formulé. Voilà qui semble donner raison aux pessimistes culturels qui jugent que l’islam est une religion de combat et de conquête, prônant l’extermination des « ennemis de l’Islam ». La position de ceux qui, prêcheurs angéliques du « dialogue des civilisations », continuent inlassablement d’affirmer avec optimisme que « l’islam est une religion de paix et de tolérance », paraît difficile à défendre dans un tel contexte. Face à la réalité du monde islamique aujourd’hui, où les minorités actives jihadistes donnent le ton et nourrissent l’enthousiasme militant des masses, les pessimistes pourraient bien être des réalistes lucides, et les optimistes angéliques de simples illuminés perdus dans leurs rêves. Néanmoins, ce même réalisme interdit aussi de réduire les multiples manières de pratiquer la religion musulmane à ses formes politiques à la fois fondamentalistes et révolutionnaires.
L’« antisionisme » extrémiste en cours de dilution dans le terrorisme islamique, donnant souvent dans le délire paranoïaque, porté par des pulsions criminelles, voire exterminatrices, légitimé par un islam réduit au fanatisme jihadiste et n’hésitant pas à fabriquer ou exploiter des faux (les Protocoles ou d’autres « forgeries » récentes), ne saurait être confondu avec une critique de la politique mise en œuvre par tel ou tel gouvernement israélien, critique politique restant dans les limites du débat démocratique dont nul (sauf précisément les extrémistes) ne met en cause la légitimité. Lorsque la critique est insistante, permanente, sans nuances, elle perd sa légitimité démocratique pour se transformer en machine à diaboliser. Un antisioniste peut ainsi, sur un continuum idéologique, partir d’une posture critique (premier pôle) et aboutir à un projet de destruction d’Israël (deuxième pôle). Ce projet n’est autre que l’antisionisme absolu, déni du droit à l’existence d’Israël et appel à son éradication. C’est pourquoi, pour simplifier, l’on peut distinguer entre un antisionisme de critique politique et un antisionisme éradicateur. Cette distinction se réinterprète en faisant jouer la catégorie d’essentialisme. On distinguera alors deux types de position critique, selon la conception de l’objet visé, qui peut être soit ce qu’Israël fait (réellement), soit ce qu’Israël est (ou, plus exactement, est censé être). Dans le premier cas, il s’agit d’un « antisionisme » (certes fort mal nommé) d’ordre politique, alors que, dans le second cas, il s’agit d’un antisionisme essentialiste, global, où l’on peut voir avec certains bons auteurs l’antisionisme tout court35.
(p.374) (…) En 1996, dans une déclaration publique où il se dévoile, Robert Faurisson s’attaquera expressément aux Juifs, et non plus seulement aux « sionistes », comme dans ses déclarations de 1978 et de 1980 : « Ou bien la Shoah a existé avec les chambres à gaz, et alors les Allemands, dans cette affaire, se sont comportés en fieffés criminels. Ou bien la Shoah, ces chambres à gaz, n’ont pas existé, et les Juifs se comportent, dans cette affaire, comme de fieffés menteurs. Et, pour moi, puisque cette Shoah, ces chambres à gaz, n’ont jamais existé, j’en conclus que, dans cette affaire, les Juifs depuis cinquante ans se comportent en fieffés menteurs. » L’accusation est claire : pour le chef de file du negationnisme international, l’invention et la diffusion du « mensonge d’Auschwitz » sont les produits d’un complot pour dominer le monde au moyen d’une entreprise de^ culpabilisation ayant eu notamment pour effet de justifier la création de l’Etat d’Israël.
CHAPITRE 13 Variations dans la vague antijuive : chiffrages et décryptages
(p.375) L’évolution de la judéophobie dans les années 2000 présente deux caractéristiques principales : d’une part, l’importance de plus en plus grande prise par le pôle arabo-musulman dans la diffusion et la réorientation du discours judéophobe – dans un sens jihadiste ; d’autre part, le déplacement du noyau dur des accusations antijuives du stéréotype hérité du XIXe siècle : « Les Juifs ont trop de pouvoir » au stéréotype forgé par l’extrême droite dans les années 1930, avant d’être recyclé dans la propagande « antisioniste » de la fin du XXe siècle : « Les Juifs (ou « les sionistes ») contrôlent la politique des États-Unis au Moyen-Orient. »
(p.375) C’est en France, parmi les pays d’Europe de l’Ouest, qu’on a recensé leplus grand nombre d’incidents antijuifs.
(p.376) En 2003, comme en 2002 et en 2000, les Juifs apparaissent, et de loin, comme les premières victimes des actions violentes ou des menaces à caractère raciste ou xénophobe. Il en va de même en 2004. Si les cibles préférentielles sont les Juifs, les auteurs des violences et des menaces les visant ne sont plus majoritairement des individus d’extrême droite : ils sont recrutés avant tout parmi les «jeunes » des « quartiers sensibles », souvent issus de l’immigration, notamment maghrébine et d’identité culturelle « musulmane ». Sur 463 menaces antijuives rencensées en 2003, 50 d’entre elles seulement paraissent imputables aux milieux d’extrême droite8. Alors qu’en 1993, 92 % du total des violences racistes et xénophobes (antisémitisme compris) étaient imputables à l’extrême droite, ce pourcentage tombe en 2003 à 18 % (14 % en 2002). Les auteurs de ces attentats contre des lieux juifs fortement symboliques ou de ces agressions contre des personnes juives sont pour la plupart marqués par la propagande islamiste ou antisioniste, et, pour certains, peuvent être considérés comme étant « en rupture avec leur environnement social9 ».
(p.378) Rappelons qu’en France, les Juifs sont environ 600 000, que le nombre des musulmans – dont la rumeur dit qu’il se situerait entre 4 et 6 millions – ne dépasse pas 3,7 millions de personnes (nourrissons inclus !)n. Quant au nombre des étrangers ou des Français d’origine maghrébine, il serait de l’ordre de 3 millions12. Or les incidents antijuifs sont régulièrement supposés « en baisse », dénoncés par certains médias comme « surestimés » ou « inférieurs en nombre » aux incidents « islamophobes » ou « anti-Maghrébins » (alors même que les statistiques disponibles établissent le contraire). L’opinion paraît suivre. Par exemple, alors qu’en 2003 il est établi que 72 % du total des violences et des menaces recensées ont visé des Juifs, le sondage d’opinion réalisé par l’institut BVA du 24 novembre au 5 décembre 2003 pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) montre que, dans l’opinion française, les « Arabes », les « Maghrébins » ou (p.379) les « musulmans » sont perçus comme les premières victimes du racisme. Il y a donc une distorsion entre la perception collective des manifestations de racisme et leur réalité sociale13.
(…)
Le ministère de l’Intérieur précise qu’au total, en France, les enquêtes sur les violences antijuives en 2002 (au nombre finalement fixé à 195) « ont conduit à l’interpellation de 77 personnes mettant en cause 55 personnes d’origine maghrébine et 6 d’origine africaine, issues de « quartiers sensibles » », et que les 737 menaces antijuives répertoriées au cours de la même année « ont été suivies de 85 interpellations, parmi lesquelles celles de 46 jeunes d’origine maghrébine, de 5 militants d’extrême droite et de 2 militants d’extrême gauche15 ». Notons au passage qu’en Grande- „ Bretagne, le profil des auteurs de violences antijuives reste plus traditionnel : en 2005, à Londres, 52 % des auteurs d’incidents antijuifs pour lesquels on disposait d’une description physique étaient des « autochtones », des « Blancs », souvent d’extrême droite16.
Voilà donc ce qui émerge de l’analyse des multiples indicateurs -disponibles, ce qui paraît aussi surgir de la poussière des événements lorsqu’on se risque à les interpréter, en même temps qu’à entendre les messages de haine qui les accompagnent : un mélange répulsif de vieil antisémitisme résurgent (« Les Juifs ont trop de pouvoir ») et d’anti-sionisme palestinophile en expansion (« Les Juifs tuent nos frères palestiniens »), porté autant par diverses mouvances d’extrême gauche que par » certains milieux d’extrême droite. La radicalité croissante de cette nouvelle configuration judéophobe va de pair avec sa banalisation, ce qui la fait fonctionner comme une nouvelle vulgate.
(p.381) Le rapport Obin (juin 2004) comporte une synthèse des informations recueillies par l’Inspection générale de l’Éducation nationale consacrée au thème « L’antisémitisme et le racisme » qui, sur un ton modéré, indique la gravité de la situation :
«Des institutions et des médias se sont largement fait l’écho du récent développement de l’antisémitisme dans la vie sociale et dans les établissements scolaires. Nous ne pouvons hélas que confirmer l’ampleur et la gravité d’un phénomène qui prend deux formes principales. D’une part on observe la banalisation, parfois dès le plus jeune âge, des insultes à caractère antisémite. Le mot « juif lui-même et son équivalent « feuj » semblent être devenus chez nombre d’enfants et d’adolescents une insulte indifférenciée, pouvant être émise par quiconque à l’endroit de quiconque. Notre sentiment est que cette banalisation ne semble en moyenne que peu émouvoir les personnels et les responsables, qui mettent en avant, pour justifier leur indifférence, le caractère banalisé et non ciblé du propos, ou encore l’existence généralisée d’insultes à caractère raciste ou xénophobe entre élèves, visant par exemple les « Arabes » ou les « Yougoslaves » : une composante de la « culture jeune » en quelque sorte. D’autre part les insultes, les menaces, les agressions, bien ciblées cette fois-ci, se multiplient à l’encontre d’élèves juifs ou présumés tels, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements ; elles sont généralement le fait de condisciples d’origine maghrébine. Dans les témoignages que nous avons recueillis, les événements du Proche-Orient ainsi qu’une sourate du Coran sont fréquemment invoqués par les élèves pour légitimer leurs propos et leurs agressions. Ces justifications peuvent aller jusqu’à assumer les persécutions ou l’extermination des Juifs. L’apologie du nazisme et de Hitler n’est pas exceptionnelle : elle apparaît massivement dans d’innombrables graffitis, notamment de croix gammées, et même parfois dans des propos ouvertement tenus à des instituteurs, professeurs et personnels d’éducation. Ces agressions n’épargnent pas des personnels ni d’autres élèves, comme cette collégienne turque nouvellement arrivée en France et devenue le souffre-douleur de sa classe parce que son pays « est un allié d’Israël ». Il est d’ailleurs devenu fréquent, pour les élèves, de demander sa religion à un nouvel élève ou à un nouveau professeur. Nous avons constaté que beaucoup de professeurs ne refusaient pas de répondre à cette question. Ces agressions, parfois ces persécutions ravivent des souvenirs particulièrement douloureux chez les familles dont les enfants en sont les victimes. Elles ont notamment pour effet, dans certaines grandes agglomérations où l’offre scolaire et les transports en commun le facilitent, le regroupement des élèves d’origine juive, dont la sécurité n’est plus assurée dans nombre d’établissements publics, dans des établissements privés et publics dont l’aspect « communautaire » ou « pluri-communautaire » est de plus en plus marqué. (…) Dans d’autres établissements, comme dans ce collège d’un bourg de la vallée du Rhône, nous avons (p.382) constaté que la scolarisation d’élèves juifs ne se faisait plus que grâce à sa dissimulation, seul le principal en ayant été informé par les parents et assurant discrétion et vigilance ; mais le patronyme des élèves ne le permet pas toujours. Cette situation existe également s’agissant de personnels. Quoi qu’il en soit, si le racisme le plus développé dans la société reste le racisme antimaghrébin, ce n’est plus le cas dans les établissements scolaires, où il a été très nettement supplanté par le racisme anti-juif. Il est en effet, sous nos yeux, une stupéfiante et cruelle réalité : en France les enfants juifs – et ils sont les seuls dans ce cas – ne peuvent plus de nos jours être scolarisés dans n’importe quel établissement. »
(p.385) Sur les 55 pays membres de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération policière en Europe), seuls 29 États tiennent des statistiques « sur les crimes d’intolérance commis chez eux » (sommet de Cordoue, 9-10 juin 2005). À s’en tenir aux seuls chiffres disponibles, on risque donc de surestimer ou de sous-estimer l’importance des phénomènes dits racistes et antisémites dans les pays considérés. Ces limites une fois mises en évidence, incitant à une grande prudence méthodologique, il est cependant possible de donner une analyse comparative partielle portant sur tel ou tel aspect de la judéophobie en Europe et dans quelques pays non européens.
Prenons, par exemple, les chiffres que fournissent les services autrichiens : 63 incidents antijuifs recensés en 2002, 108 dans les 8 premiers mois de l’année 2003 (actions et menaces confondues). Des chiffres comparativement élevés, et fort inquiétants, pour un pays doté d’une population à peine supérieure à 8 millions (et comptant environ 8 000 Juifs), alors que la France compte environ 62 millions d’habitants (dont environ 600 000 Juifs). Mais ce qui domine dans le tableau, ainsi que le note l’EUMC, c’est la banalisation du discours antijuif. En l’absence de statistiques fiables autorisant des comparaisons objectives, on peut seulement supposer que l’Italie, la Grèce, l’Espagne, la Hongrie et la République tchèque sont dans une situation semblable : peu d’actions violentes, mais une forte circulation de clichés antisémites, dans les médias comme dans la vie quotidienne. Le cas de la Pologne reste à étudier :
(p.386) (p.386) selon certaines sources, en particulier le rapport de l’OSCE rendu public au sommet de Cordoue, les 9 et 10 juin 2005, ce pays serait le plus touché par l’antisémitisme tant rhétorique que « physique ». Selon un rapport du Conseil de l’Europe publié le 15 juin 2005, les principaux responsables des incidents antijuifs en Pologne, où vivent entre 5 000 et 10 000 Juifs, seraient des groupes néonazis. Mais les informations restent aussi très insuffisantes sur les autres pays d’Europe de l’Est (les anciens pays du bloc soviétique) : plutôt que les États, ce sont les ONG et d’autres associations civiles qui recueillent les données permettant de quantifier approximativement les incidents antijuifs. Les résultats de certaines enquêtes d’opinion permettent à la fois, selon divers indicateurs d’« antisémitisme », de comparer un certain nombre de pays européens et d’étudier leurs évolutions respectives quant aux représentations et aux croyances antijuives. Les deux grandes enquêtes d’opinion, déjà citées, réalisées en 2005 et en 2007 par le groupe Taylor Nelson Sofres (TNS) à la demande de l’Anti-Defamation League (ADL) montrent que le taux global d’« antisémitisme », en Europe, est passé de 37 % en 2005 à 43 % en 200729. L’augmentation des opinions judéophobes est donc générale, à l’exception d’un seul pays, les Pays-Bas, passés de 27 % en 2005 à 26 % en 2007. Les pays les plus touchés sont, en 2005 comme en 2007, l’Espagne, la Hongrie et la Pologne. Les moins touchés restent le Royaume-Uni (de 24 % à 30 %), les Pays-Bas, la France (de 28 % à 34 %) et l’Allemagne (restée stable à 36 %). Quant à l’Autriche, elle est passée de 35 % en 2005 à 47 % en 2007.
Quatre pays semblent peu touchés par la vague antijuive récente : l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Finlande. La Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et, dans une moindre mesure, le Danemark et la Suède présentent un paysage comparable à celui qu’offre la France, avec une forte proportion d’agresseurs d’origine maghrébine, variant entre le tiers et les deux tiers selon les pays et les années – des immigrés ou des individus issus
d’une immigration de religion musulmane -, sans que les violences antijuives y atteignent des niveaux semblables. En Grande-Bretagne, par exemple, où vivent environ 300 000 Juifs, les « incidents antisémites » ont augmenté depuis la fin des années 1980 (1989-1995) – 301 «incidents» par an entre 1993 et 1995 – puis ont diminué entre 1996 et 1998 (236 « incidents »), avant de remonter en 1999 (270).
(p.387) En Suède, 131 incidents antijuifs ont été enregistrés durant l’année 2000 ainsi qu’en 2002 (et 115 en 2001). Un certain nombre d’enquêtes ont établi le fait que les Juifs suédois dissimulaient souvent en public leur identité religieuse et mettaient leur numéro de téléphone sur « ligne rouge » pour éviter d’être harcelés. Dans de nombreux établissements scolaires, les élèves juifs subissent l’hostilité déclarée de groupes d’élèves arabo-musulmans. Dans l’opinion, le thème du pouvoir juif et celui de la manipulation juive de la politique et des médias sont largement répandus, notamment sous la forme de la dénonciation du « lobby sioniste ». Par ailleurs, le mouvement antimondialisation apparaît comme le vecteur d’un antisionisme radical, dont témoignent nombre de sites Internet32. Dans tous les pays européens mentionnés, les incidents antijuifs se sont multipliés à partir du mois d’octobre 2000, lorsque la deuxième Intifada a été lancée. En Allemagne, par exemple, après une diminution du nombre des incidents antijuifs entre 1996 et 1999, on note une brutale augmentation de ces derniers en 2000 : leur nombre est multiplié par trois au cours du 4e trimestre 2000. Les actes antijuifs violents sont passés de 18 en 2001 à 28 en 2002. Quant aux menaces, elles ont considérablement augmenté depuis 2000. Les milieux d’extrême droite continuent de jouer un rôle important dans les attaques (visant surtout les monuments ou les symboles) et les intimidations. Depuis les premiers mois de 2004, on note en Allemagne une augmentation des agressions contre des Juifs commises par des individus caractérisés comme des «jeunes musulmans ». En Belgique (où la population juive approche 40 000 personnes), alors que les incidents antijuifs recensés s’élevaient à 4 en 1999 et à 3 en 2000, ils sont passés à 27 en 2001, 51 (62) en 2002, 28 en 2003, 46 en 2004, 60 en 2005, 66 en 2006 et 69 en 2007. Il faut tenir compte de fortes disparités régionales : en 2006, par exemple, les attaques contre les personnes physiques ont visé des Juifs orthodoxes à Anvers, tandis que les menaces, les insultes et les actes de vandalisme ont été observés plutôt à Bruxelles33. En Suisse germanophone, d’après des chiffres fournis par l’association Aktion Kinder des Holo-caust, le nombre d’incidents antijuifs recensés a doublé en 2006. Une hausse comparable a été observée en Suisse francophone.
En Amérique du Nord, on notera qu’au Canada le nombre des incidents antijuifs est passé de 459 en 2002 à 584 en 2003, la plupart ayant eu lieu en Ontario (400) et au Québec (108), régions du territoire canadien où l’on trouve le plus grand nombre de Juifs. En 2004, le Canada est apparu comme l’un des pays occidentaux les plus touchés par la récente vague antijuive, après la France et la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, le (p.388) nombre des incidents antijuifs est d’abord resté stable à un niveau élevé, passant de 1 559 en 2002 à 1 557 en 2003, avant d’augmenter en 2004, notamment dans les derniers mois, pour atteindre 1 821, ce qui correspond à une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente. Les incidents antijuifs relevés sont relatifs d’abord aux violences commises par les nombreux groupes néonazis existant aux États-Unis, ensuite aux conduites de harcèlement dont sont victimes les jeunes Juifs en milieu scolaire, et, à un moindre niveau, aux intimidations ou aux agressions sur les campus universitaires34. L’Australie, où la propagande négationniste s’était diffusée dans les années 1980 et 1990, n’est pas épargnée par la récente vague : le nombre des incidents antijuifs enregistrés entre octobre 2003 et septembre 2005 est supérieur de 50 % à la moyenne des quatorze dernières années dans ce pays35.
Quant à l’Amérique latine, le cas de l’Argentine, qui compte une population juive d’environ 190 000 personnes, montre que la haine antijuive y persiste à un niveau élevé : en 2004, un rapport de la communauté juive (rendu public au début de 2005) recense 174 agressions antisémites, et note l’apparition récente de drapeaux à croix gammée et de courriels antijuifs. La présence d’une population musulmane d’environ 300 000 personnes constitue l’un des vecteurs, avec l’extrême gauche, de l’antisionisme radical. En outre, le thème de la puissance juive internationale reste largement répandu dans l’opinion36. Depuis 2003, au Venezuela, sous la dictature masquée du nouveau type de caudillo qu’est Hugo Châvez, populiste d’extrême gauche violemment antiaméricain et corrélativement « antisioniste », les incidents antisémites se sont multipliés. Dans ce pays, le président lui-même donne le ton en la matière, par exemple en reprenant à son compte la dénonciation altermondialiste des « maîtres du monde » tout en suggérant que ces derniers se confondent largement avec les représentants d’une « puissance financière » internationale caractérisée selon les poncifs judéophobes37. Dans une allocution prononcée la veille de Noël, le 24 décembre 2005, devant l’auditoire du Centre Manantial de Los Suefos dans l’État de Miranda, un centre d’hébergement et de réinsertion de personnes sans domicile fixe, Châvez, après s’être lancé dans ses diatribes habituelles contre « l’impérialisme », en est venu à célébrer lyriquement « Jésus, le commandant des commandants des peuples, Jésus le justicier (…), le Christ révolutionnaire, le Christ socialiste », puis s’est risqué à faire allusion à certaines diaboliques « minorités qui se sont emparées des richesses mondiales » : « Aujourd’hui, plus que jamais en 2 005 ans, il nous manque Jésus-Christ (…). Le monde dispose d’assez de richesses et de terres pour tous (…), mais, dans les faits, des minorités, les descendants de ceux-là mêmes qui crucifièrent le Christ, les descendants de ceux qui jetèrent Bolivar hors d’ici et le crucifièrent aussi à leur manière à Santa Marta en Colombie (…), se sont emparées des richesses mondiales, une minorité s’est approprié l’or de la planète, (…) et
[a concentré les richesses entre quelques mains. »
Comme l’ont fait remarquer les responsables du Centre Simon-Wïesenthal pour l’Amérique latine (Argentine), le président vénézuélien sollicite dans ce discours deux stéréotypes de l’antijudaïsme traditionnel :
(p.389) les Juifs comme peuple déicide et comme puissance financière. Dans la vulgate chrétienne encore largement dominante dans les pays latino-américains, ce sont en effet toujours les Juifs qui sont accusés d’avoir crucifié Jésus. Et il n’est guère difficile d’identifier les membres de la « minorité » possédant aujourd’hui « la moitié des richesses du monde entier » lorsqu’ils sont désignés comme les « descendants » de ceux qui « crucifièrent le Christ ». Sauf à supposer, avec un grain d’ironie, que Châvez visait les Italiens d’aujourd’hui, en tant que lointains descendants des Romains.
En Europe de l’Est, c’est surtout en Pologne, en Ukraine et en Russie que les violences antijuives peuvent s’observer. Le cas de la Russie, où l’on comptait au début des années 2000 un peu plus de 224 000 Juifs (contre 540 000 en 1989), est singulier : on y rencontre à la fois un racisme antijuif porté par un grand nombre de groupes d’extrême droite (de « skinheads » et de néonazis), un antisémitisme politique traditionnel exploité par des leaders politiques (tel Vladimir Jirinovski) et une judéo-phobie d’opinion ou populaire, nourrie ces dernières années par les campagnes anti-oligarques38. Le 27 juin 2005, on a ainsi appris avec stupeur que le procureur général de Russie avait décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer si le recueil de halacha (lois juives) « Shoulchan Arouch », écrit au XVIe siècle par le rav Yossef Karo, incitait à la violence contre les Russes non juifs. Le même procureur a également demandé d’envisager de mettre hors la loi la religion juive et les organisations juives russes, ce qui revient à donner une caution officielle à l’antisémitisme montant en Russie. Car le nombre d’actes antijuifs, en Russie, est en augmentation constante ces dernières années, et ces actes sont essentiellement le fait de jeunes Russes sensibles à la thématique néonazie. Le 12 janvier 2006, un jeune skinhead russe âgé d’environ 20 ans, est entré dans la synagogue Poliakov (Loubavitch) de Moscou en criant « Heil Hitler !» et a poignardé dans le dos les fidèles qui priaient, en blessant neuf. Parmi les blessés, on comptait trois Israéliens, le rabbin et un gardien de la synagogue. Quatre des personnes touchées étaient dans un état grave. Selon la police, Alexander Kupatchev fréquentait les milieux néonazis moscovites et était dans un état d’ébriété avancée lorsqu’il a commis son agression. Fin mars 2006, le jeune agresseur antijuif a été condamné à treize ans de prison ferme par un tribunal russe. Le parquet avait requis 16 ans de détention et un traitement psychiatrique39.
Il convient de relever le cas singulier de la Turquie : ce pays, désormais dirigé par un parti islamique, se caractérise par l’évolution inquiétante de son opinion qui, travaillée par une propagande antijuive spécifique — de facture anti-judéo-maçonnique – portée par des milieux islamistes très mobilisés, est de plus en plus imprégnée par les thèmes de l’antisionisme radical. La dénonciation du « complot judéo-maçonnique » s’inscrit désormais explicitement, chez les islamistes, dans le projet d’en finir avec le kémalisme (Mustapha Kemal étant dénoncé comme un « judéo-maçon ») et de rétablir le califat, tout en instituant la Chari’a. Les attentats expressément antijuifs de novembre 2003 en Turquie suffisent à montrer que les islamistes radicaux sont décidés à recourir à la violence terroriste contre les (p.390) Juifs partout dans le monde. Le 15 novembre 2003, à Istanbul, deux attentats à la camionnette piégée, à l’évidence coordonnés, faisaient 25 morts et plus de 300 blessés (bilan fait le 17 novembre), l’un visant la synagogue de Beth Yaakov (située au cœur de Fera, l’ancien quartier juif d’Istanbul) où 300 fidèles assistaient à une Bar Misvah, l’autre contre la plus importante synagogue de la grande ville turque, Neve Shalom40. Ces deux attentats ont été aussitôt revendiqués par une organisation islamiste clandestine, le Front islamique des combattants du Grand-Orient (IBDA-C), fondé en 1985, dont l’objectif est d’instaurer un État islamique en Turquie. Ils ont aussi été revendiqués par les Brigades du martyr Abou Hafs al-Masri, qui appartiennent au réseau Al-Qaida, lequel n’a cessé en effet de menacer les régimes islamiques modérés (Turquie, Indonésie, Maroc). Et l’on sait que la Turquie est l’un des principaux alliés régionaux d’Israël et des États-Unis. Cinq jours plus tard, le 20 novembre 2003, une deuxième série d’attentats terroristes commis à Istanbul, visant des intérêts britanniques (le consulat de Grande-Bretagne et une agence de la HSBC, banque anglaise), faisait 27 morts, dont le consul général de Grande-Bretagne, et 450 blessés41. Comme les attentats antijuifs du 15 novembre, ces attentats anti-britanniques ont été organisés par des cellules locales entraînées dans le Jihad mondial, avec ou sans chef d’orchestre, mais avec une aide logistique étrangère, qu’on peut attribuer à Al-Qaida42. Nouvelle preuve que le terrorisme islamiste planétaire est décidé à n’épargner aucun pays.
Après les attentats antiaméricains du 11 septembre 2001, la pratique de la terreur antijuive s’est étendue à certains pays du Maghreb. Même la Tunisie, l’un des pays de culture musulmane dont les dirigeants politiques sont les plus hostiles à l’islamisme radical, paraît touchée par la vague antioccidentale et antijuive. L’attentat terroriste meurtrier contre la synagogue de Djerba, en Tunisie, constitue un symptôme de la présence active des réseaux islamo-terroristes dans ce pays. Cet « attentat-suicide » commis par un islamiste de l’organisation d’Oussama Ben Laden, le 11 avril 2002, contre le lieu de pèlerinage le plus vénéré du judaïsme séfarade (après le Mur des Lamentations), a fait 21 morts, dont 14 Allemands, 5 Tunisiens et 2 Français. L’attentat avait été organisé sous la direction de Khalid Cheikh Mohammed, le responsable des opérations extérieures d’Al-Qaida, surnommé « le cerveau » par Oussama Ben Laden. La Tunisie a ainsi été le premier pays visé par Al-Qaida après les attentats du 11 septembre 200l43. La menace islamiste, en Tunisie, est contenue par le gouvernement autoritaire du président Ben Ali, au prix, certes, d’un système de répression qui peut parfois déraper, mais l’islamo-terrorisme étant une menace sérieuse, il s’agit pour ce gouvernement de se donner les moyens de la conjurer44. Le Maroc n’a pas été non plus épargné par le terrorisme islamiste, qui privilégie les cibles juives dans le cadre d’une stratégie de purification ethnique consistant à terroriser les derniers Juifs qui y résident pour les pousser à l’émigration. Les cinq attentats (à la bombe ou à la voiture piégée) qui ont eu lieu à Casablanca, dans la soirée du 16 mai 2003, visaient principalement des Juifs, fixés au Maroc ou de passage en touristes. Le choix des cibles est significatif: le Cercle de l’Alliance israélite, l’ancien cimetière israélite, un restaurant italien (El Positano) dont le
(p.391) patron est juif et le restaurant de la Casa de Espana, très fréquenté par les touristes (notamment israéliens)45. Ces attentats-suicides ont fait 45 morts (dont 12 islamikazes) et une centaine de blessés. Les islamikazes appartenaient vraisemblablement à un groupe islamiste local, « Le Droit chemin » (Al-Sirat Al-Moustaqim), lié à la mouvance jihadiste-salafiste46. Le Français Richard Robert, converti à l’islam et passé à l’islamisme radical (avec le titre d’« émir »), accusé d’activités terroristes, a été condamné à la réclusion à perpétuité dans la nuit du 18 au 19 septembre 2003 par la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat. Comme en écho aux attentats de Casablanca, cinq attentats-suicides ont été perpétrés en Israël du 17 au 19mai200347. ‘ ‘ 4
La vague de terrorisme islamiste visant des Juifs au Maroc s’est confirmée quatre mois plus tard : le 11 septembre 2003, un commerçant estimé, Albert Rebibo, Juif marocain âgé de 55 ans, a été assassiné par deux tireurs cagoules à Casablanca. Confiant, Albert Rebibo n’avait pas émigré, malgré la pression (la montée en puissance des mouvements islamistes, et leurs succès électoraux), parce que, disait-il : « Le Maroc, c’est ma vie. Il n’y a aucune raison d’avoir peur. » Deux jours plus tard, le 13 septembre, un autre Juif, Elie Afriat, 72 ans, était poignardé à mort à Meknès. Le meurtre de Casablanca, selon des sources policières marocaines, pourrait avoir été commis par des terroristes liés à Al-Qaida venus de l’étranger48. Au Maroc, en passant à l’offensive au printemps 2003, les islamistes ont bien ouvert un nouveau front, qui s’ajoute aux fronts ouverts en Algérie, en Indonésie, en Arabie Saoudite, en Israël et en Irak49. La pénétration d’Al-Qaida au Maghreb s’est accélérée en septembre 2006, avec l’allégeance officielle du GSPC algérien à l’organisation de Ben Laden et Zawahiri50. Le chef du GSPC s’inspire désormais de la rhétorique d’Al-Qaida, comme dans ce début de message : « Dans ces heures sombres où la coalition judéo-croisée et ses esclaves parmi les renégats ont déclaré une guerre totale contre l’Islam et les musulmans… » Le 24janvier 2007 avait lieu la création officielle d’Al-Qaida au Pays du Maghreb Islamique, suivie par une série d’attentats en Algérie et au Maroc51. Les communiqués du nouveau groupe jihadiste se terminent comme ceux des combattants d’Al-Qaida en Irak : « Puisse Allah nous aider à vaincre les Juifs, les chrétiens et leurs agents parmi les renégats ! Puisse Allah soutenir les Moudjahidines partout où ils se trouvent en leur apportant des renforts52 ! » j
Au Maghreb, d’autres indices d’une pénétration culturelle de l’islamisme peuvent être relevés. Par exemple, un incident significatif a eu lieu à Tunis en mars 2006 dans un contexte universitaire, montrant l’imprégnation antijuive d’une partie de la jeunesse étudiante tunisienne, travaillée par la propagande islamiste. Les faits sont les suivants, tels que rapportés par l’agence Guysen.Israël.News, le 14 mars 2006 : « Une cérémonie s’est déroulée le 10 mars à la faculté des Lettres de Manouba lors de la remise à l’Université tunisienne par la famille du professeur Paul Sebag, historien des Juifs de Tunisie décédé en 2004, d’une partie de la bibliothèque de ce dernier, l’autre partie ayant été remise à l’Alliance Israélite universelle (AIU). Des étudiants ont crié : « Les Juifs à la mer ! Vive la Palestine ! Vive le Hamas ! Destruction d’Israël ! Nous ne voulons (p.392) pas de la bibliothèque de Paul Sebag, un communiste stalinien ! Pas de Juifs à l’Université ! Nous tuerons tous les Juifs ! » Les perturbateurs ont essayé de bloquer l’entrée de l’amphithéâtre. Quelques professeurs qui protégeaient la fille de Paul Sebag et Claude Nataf, président de la Société d’histoire des Juifs de Tunisie (SHJT), ainsi qu’un orateur du colloque prévu sur l’œuvre de Paul Sebag, ont été frappés. Les autorités universi-l_ taires tunisiennes ont présenté des excuses53. »
(p.3936) La République islamique d’Iran est devenue l’un des principaux centres mondiaux, avec l’Arabie Saoudite et la Syrie, de diffusion de la propagande antijuive.
CHAPITRE 14 Explication fonctionnelle de l’antisionisme radical : du monde arabo-musulman à la dictature iranienne
(p.396) En 2002, un rapport sur le développement humain dans le monde arabe, rédigé par un comité d’intellectuels arabes et publié sous l’égide des Nations unies, a mis en évidence un certain nombre de faits d’ordre comparatif illustrant divers aspects du sous-développement dans les pays arabo-musulmans, qu’il s’agisse de la vie culturelle, de la recherche scientifique ou des performances économiques2. Les populations arabo-musulmanes sont, en conséquence, dans une situation de frustration permanente, l’absence de toute perspective d’amélioration produisant une amertume et un ressentiment de masse, qui s’expriment et s’affichent en tant qu’« humiliation ». Dans ces conditions, l’islam reste la seule consolation, tandis que l’accusation des prétendus responsables extérieurs de tout ce qui ne va pas, l’Amérique et Israël, permet de canaliser le sentiment de révolte et la volonté de vengeance. Tout se passe comme si les passions antiaméricaines et antijuives, sans cesse réalimentées, constituaient, dans ces pays, un mode de réduction des tensions sociales, voire un mode de régulation de la cohésion sociale. Il s’ensuit que P« anti- ‘ sionisme », ciment du consensus fabriqué par les propagandistes d’État comme par les prédicateurs islamistes, remplit une fonction indispensable dans ces pays : il fait partie de l’art de gouverner.
(p.398) Ce que le journaliste, politologue et historien libanais Samir Kassir, assassiné en juin 20058, appelait le « malheur arabe » ne tient pas seulement au fort taux d’analphabétisme observable dans les sociétés arabes, aux inégalités socio-économiques qu’on y constate (les écarts y sont criants entre les immensément riches et les désespérément pauvres), à la condition inférieure de la femme (par ailleurs victime de traitements indignes, voire criminels)9, à la surpopulation des villes et à la désertification des provinces, aux régimes despotiques qui gouvernent par la terreur et la (p.399) manipulation des masses ; il tient encore et surtout au sentiment général que « l’avenir est obstrué », plus précisément qu’il ne se dessine guère que dans un millénarisme morbide fondé sur le culte de la mort et l’exaltation de la figure de Yistichhadi (« celui qui demande le martyre »)10. Le monde arabe, n’hésite pas à affirmer Samir Kassir dans son essai percutant paru en 2004, est « la région de la planète où l’homme a. aujourd’hui le moins de chances d’épanouissement. Et d’ajouter : « À plus forte raison la femme11. » C’est de ce monde désespérant que proviennent les passions négatives et les délires accusatoires les plus déchaînés contre les démocraties respectivement américaine et israélienne. À son malheur sans issue imaginable, le monde arabo-musulman ajoute la haine et le ressentiment, l’appel à la violence sanguinaire et la fuite dans le mythe d’une purification par le massacre des « ennemis ». L’antisionisme démonologique structure l’imaginaire arabo-musulman et remplit une fonction de diversion qu’aucun autre mythe politique n’est susceptible de remplir. Voilà qui interdit tout optimisme irénique.
En tant que témoin privilégié, la psychologue américaine d’origine syrienne Wafa Sultan voit dans l’islam, à la fois système de croyances (religion proprement dite) et conception normative de l’ordre social et politique, la cause principale du « malheur arabe », pensé ordinairement en termes de « retard » ou de « stagnation » : « Choisissez un pays musulman. N’importe lequel. Qu’y observez-vous ? Rien, si ce n’est ce retard, la pauvreté, la dictature, l’ignorance, la maladie. (…) Pourquoi? Nos vies dans le monde musulman sont le produit des enseignements islamiques, car nos vies sont ce que sont nos croyances. Vous ne pouvez pas améliorer votre vie tant que vous ne voulez pas améliorer vos croyances. Votre situation réelle résulte de vos comportements qui sont liés à vos croyances. Donc, pour changer votre situation, vous devez changer vos comportements, et donc vos croyances12. »
D’après un rapport de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), le tiers du monde arabe est analphabète : sur 335 millions de personnes, environ 99,5 millions sont analphabètes13. Au-delà du monde arabo-musulman, c’est le monde musulman dans son ensemble qui fait problème. Si l’on privilégie ainsi les causes culturelles du triste état dans lequel se trouvent les sociétés musulmanes, privées de liberté et sans perspectives d’avenir, alors il faut chercher une solution soit dans un abandon de l’islam, jugé irréformable, soit dans une révision radicale de ses enseignements, tâche difficile qui, pour s’accomplir, demandera autant de courage et d’inventivité que de temps. Dans l’hypothèse la plus optimiste, la sortie du tunnel ne pourra se faire qu’à long terme. Ce qui nous ramène à un certain pessimisme, aussi nuancé soit-il. J
Le couple formé par les dictateurs-démagogues et les masses asservies-endoctrinées domine le monde arabo-musulman, et favorise l’auto-enfermement dans des prisons mythopolitiques : la persistance dans la voie stérile du ressentiment (« Qui nous a fait ça ? », « C’est la faute de… »), le refuge dans la vision du complot (aujourd’hui « américano-sioniste »), la stase complaisante dans la victimisation (« Nous, Arabes et musulmans, sommes agressés et humiliés par des étrangers, des mécréants, etc. »), (p.400) l’instrumentalisation cynique de la cause palestinienne, sans que soit fait le moindre effort en vue de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Maxime Rodinson a caractérisé cette disposition d’esprit comme l’expression d’une « culture du ressentiment », qui fait aujourd’hui couple avec la culpabilité d’un Occident chrétien saisi par la repentance14. À vrai dire, ce mélange de faillite, de sentiment d’humiliation et de fort ressentiment contre l’ex-colonisteur ou les « puissances impérialistes » se rencontre dans la plupart des États postcoloniaux du Maghreb et d’Afrique subsaharienne15. Il semble que l’islam constitue dans cette pathologie sociale un facteur aggravant, qui stimule les tendances paranoïaques et alimente l’imaginaire du complot. En 2001, l’islamologue français dessine ainsi le visage de cette culture musulmane devenue folle : « L’islam d’aujourd’hui se pose, plus que comme un message de vérité, comme un parti idéologique attaqué de tous côtés, comme un bloc de « damnés de la terre », comme une forteresse assiégée, ou une patrie menacée. Ceux qui doutent de son message ne sont pas, dès lors, des esprits dans l’erreur. Essentiellement, ce sont des ennemis et des traîtres16. » L’argument de l’« humiliation », utilisé d’une façon globalisante pour désigner à la fois l’effet produit par les défaites militaires des pays arabes et l’atteinte morale provoquée par le sentiment d’un outrage frappant l’islam, est particulièrement efficace pour toucher les milieux populaires : il permet de désigner une cause extérieure, immédiatement identifiable (Israël, l’Amérique ou l’Occident), des malheurs subis ou de la détresse vécue. C’est pourquoi l’imaginaire de l’« humiliation » (ihâna) est massivement orchestré par les divers courants de l’islam politique autant que par les propagandes étatiques. Le psychanalyste Fethi Benslama donne une analyse éclairante de cette machine à engendrer de l’illusion dans le monde musulman : « La notion d’ihâna en langue arabe désigne précisément le mépris envers un être qui pèse peu de poids, qui ne compte pas. Dans la majeure partie du monde arabe, outre la pauvreté, voire le dénuement, les gens sont dépossédés de toute responsabilité, de toute possibilité d’action et infantilisés. (…) Ce qu’on appelle « humiliation » correspond donc à une situation réelle de mépris et d’insignifiance de l’humain dans ce monde (…). Le discours islamiste exploite cette réalité en l’inscrivant dans des matrices théologico-politiques simples et en l’accréditant auprès de masses assoiffées de dignité. (…) Les islamistes ont usé d’une arme puissante : la construction d’un mythe identitaire qui prétend restaurer la dignité des masses musulmanes17. » Cet état d’esprit et son exploitation politico-religieuse sont loin de caractériser le seul monde arabo-mulsulman sunnite. Il est tout autant présent dans le chiisme à l’iranienne. L’ayatollah Khomeiny inscrivait ce thème d’accusation porté par le ressentiment et la victimisa-tion chimérique dans une vision conspirationniste : « Les Juifs, l’Amérique et Israël cherchent à nous enfermer et à nous tuer, à nous sacrifier18. »
6e partie La France dans la tourmente
(p.420) En 2006, Ken Livingstone, pour avoir proféré des injures antisémites à un journaliste d’origine juive, s’est vu suspendu de son mandat de maire pendant un mois. L’islamophilie de « Ken le rouge », qui va jusqu’à l’isla-mismophilie, pourrait n’être elle-même qu’un symptôme d’une passion négative si forte qu’elle ne peut qu’être tenue secrète, et ne se révéler qu’à travers des lapsus ou à l’occasion de moments de colère. D’autres exemples de dérives judéophobes montrent que la complaisance à l’égard du fondamentalisme islamique peut devenir connivence, voire complicité.
Les convergences entre Qaradhawi et Livingstone, deux personnages publics dotés d’une grande influence, montrent que l’islamo-gauchisme ne se réduit pas à un phénomène marginal. Ces convergences, qui peuvent déboucher sur des alliances, se fondent sur une dénonciation obsessionnelle de « l’islamophobie ». Or, en Europe, le parti anti-islamophobe est sorti des frontières de l’espace des discours pour passer dans le champ des pratiques criminelles. L’assassinat sauvage pour péché d’islamophobie, le 2 novembre 2004 à Amsterdam, du cinéaste et chroniqueur Théo Van Gogh, ennemi déclaré de l’islamisme, montre que les propos incendiaires des prédicateurs islamistes et des militants « antiracistes » appelant à la chasse aux « islamophobes » peuvent être suivis de passages à l’acte dans un pays européen. Car l’assassin de Théo Van Gogh, Mohammed Bouyeri, âgé de 26 ans en 2004, né aux Pays-Bas mais possédant la double nationalité néerlandaise et marocaine, appartenait à un groupe islamiste organisé, d’obédience salafiste47, qui projetait de commettre d’autres assassinats politico-religieux, dont celui d’une jeune députée libérale d’origine soma-lienne, Ayaan Hirsi Ali, réfugiée aux Pays-Bas en 1992 pour échapper à un mariage forcé, et connue pour ses critiques du fondamentalisme islamique48. Il n’est pas exclu que Bouyeri, qui portait sur lui son testament de « martyr », ait agi en vertu d’une fatwa provenant d’un imam radical. C’est à la mosquée Al-Tawhid (Amsterdam), liée au mouvement Tabligh et connue pour les prêches virulents de son imam Mahmoud El-Shershaby, que Bouyeri semble avoir été endoctriné. Le document accroché par l’assassin à un poignard planté dans le ventre du cinéaste, tué de plusieurs coups de revolver puis égorgé d’une oreille à l’autre, était une lettre de menace adressée à Ayan Hirsi Ali. Selon ce texte, la jeune élue était une « soldate du mal » ayant « tourné le dos à la Vérité », une « menteuse » qui allait « se briser en mille morceaux contre l’islam », et devait être tuée puisqu’elle s’était ralliée aux « ennemis de l’islam49 ». C’est elle, en effet, qui avait demandé à Van Gogh de réaliser le court-métrage Submission Part I, lequel, diffusé en septembre 2004 par la télévision (p.421) néerlandaise, dénonçait les violences faites aux femmes par l’islam radical. On trouvait également dans le document laissé par l’assassin des menaces visant les « maîtres juifs » de la chambre des députés, le maire d’Amsterdam Job Cohen et le président du Parti de la Liberté et de la Démocratie (VVD) – auquel Hirsi Ali s’était ralliée -, Jozias Van Aartsen, quant à lui nullement d’origine juive.
La société multiculturelle qu’est la société néerlandaise, qui se veut > « ouverte » et « tolérante », s’est révélée particulièrement perméable aux infiltrations islamistes et, en conséquence, dangereuse pour les malpensants osant transgresser les règles de l’islamiquement correct50. L’angé-lisme peut frayer en silence la voie à la barbarie. L’islamisation de l’Europe passe par l’exploitation des failles du pluralisme libéral51. Van Gogh achevait un film sur la vie du leader populiste Pim Fortuyn, lui aussi ennemi déclaré de l’islamisme et hostile à une immigration non contrôlée, qui a été assassiné par un illuminé écolo-gauchiste le 6 mai 2002, à Hilversum (Pays-Bas)52. Le meurtre islamiste du cinéaste Van Gogh a provoqué une brutale mais salutaire prise de conscience, chez les Européens de l’Ouest, de la vulnérabilité de leurs sociétés pluralistes, confrontées à la nouvelle menace interne qu’incarnant les réseaux islamo-terroristes circulant librement dans l’espace de Schengen53. Aux Pays-Bas comme en Grande-Bretagne, la vision angélique du multiculturalisme, masquant la réalité d’un « développement séparés » des « communautés », a fait place à un examen critique fondé sur une expérience malheureuse : une société ayant institutionnalisé le multiculturalisme constitue une structure d’accueil et un terrain particulièrement favorables pour le développement de l’islamisme, en particulier dans sa variante jihadiste54. Mais tous les yeux ne se sont pas ouverts. L’acte de pointer une menace réelle telle que la menace islamiste, même après le 11 septembre 2001, demeure suspect aux yeux de ceux qui, dans l’espace public européen, veulent dormir tranquilles sous la voûte du « politiquement correct ». C’est ce qu’attesté l’acte de censure qui a visé, au printemps 2005, la projection du film Submission en Italie, au festival de Locarno. Théo Van Gogh, victime du premier assassinat en Europe pour péché d’islamophobie, faisait encore peur six mois après sa mort. Les organisateurs du festival disaient vouloir éviter de provoquer un nouvel assassinat ! Cette censure idéologique révèle l’esprit de démission qui menace l’Europe.
Mais il y a plus grave. L’esprit de démission peut se transformer en 1 esprit de soumission, voire de collaboration avec l’ennemi islamiste déclaré, pour peu que ce dernier prenne des gants et sache se travestir en personnage respectable. C’est la stratégie suivie par un Tariq Ramadan, d’abord en Suisse – où son père Saïd Ramadan (le gendre du fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna), bénéficiant d’un soutien financier de l’Arabie Saoudite, a créé en 1961 le Centre islamique de Genève -, puis en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas55. L’islamologue supposé qu’est Tariq Ramadan ne cache pas que sa principale préoccupation est de lutter contre « l’islamophobie » ou, comme il croit devoir le préciser, contre « ce que certains sociologues britanniques appellent le « racisme antimusulman »56 ».
(p.422) La différence de traitement entre ce prédicateur islamiste et la militante anti-islamiste Ayaan Hirsi Ali est emblématique de l’aveuglement des élites politiques et intellectuelles des pays dont le muticulturalisme a considérablement affaibli la capacité politique fondamentale de distinguer entre ami et ennemi. Bien qu’élue du WD, parti néerlandais de centre droit, Ayaan Hirsi Ali a été poussée par une campagne de diffamation à quitter les Pays-Bas pour les États-Unis où, en tant que « condamnée à mort » par les milieux islamistes, elle a continué de bénéficier d’une protection policière, avant d’en être privée par décision des autorités néerlandaises en 2007. Alors même que cette femme courageuse était abandonnée à son sort par l’Etat néerlandais, le prédicateur islamiste Tariq Ramadan était accueilli comme professeur invité à l’Université Erasmus de Rotterdam, pour traiter du thème « Citoyenneté et Identité », avant de se voir offrir, le 9 novembre 2007, une chaire d’enseignement à l’Université de Leyde (Leiden). On lui proposait d’occuper la chaire d’Études islamiques, financée par le sultanat d’Oman, considéré comme une « dictature islamo-fasciste », à hauteur de 2,5 millions d’euros59. Une chaire que l’habile prédicateur n’aurait pas manqué de transformer en relais d’une propagande « poliment fondamentaliste60 ». Face aux vives réactions critiques déclenchées aux Pays-Bas par sa nomination, Ramadan a renoncé prudemment à occuper cette chaire. Senior Research Fellow à l’Université d’Oxford, ce refus ne le condamne pas au chômage.
En février 2008, le « professeur » Ramadan a appelé au boycottage du Salon du livre de Turin (8-12 mai 2008), dont Israël, qui fêtait ses soixante ans, était l’invité d’honneur.
(p.428) C’est dans cette perspective qu’a été lancée début mai 2004, en vue des élections européennes du 13 juin 2004, la liste Euro-Palestine en Ile-de-France, ayant pour tout programme la mise au ban d’Israël9 et affichant Dieudonné en seconde position, occasion pour l’humoriste de dénoncer « « l’axe glouton » (américano-sioniste) » – Christophe Oberlin, militant pro-palestinien proche des communistes, et Olivia Zemor, présidente de la CAPJPO, y figuraient respectivement en première et troisième positions10. Cette liste a certes obtenu seulement 1,83 % des suffrages en Île-de-France, mais elle a réalisé de véritables « percées » dans de nombreuses communes à forte population issue de l’immigration : 10,75 % à Garges-lès-Gonesse, 8,15 % à Villetaneuse, 6,73 % à Bobigny, 6,47 % à Villepinte, 6,08 % à Clichy-sous-Bois, 6 % à Mantes-la-jolie11. D’où aussi l’annonce provocatrice par Dieudonné, lors d’une conférence de presse organisée le 2 juillet 2004, de la création d’un Conseil représentatif des Institutions noires de France d’ici janvier 2005 (avec l’appui d’une quinzaine d’associations afro-antillaises), visant à institutionnaliser une alliance entre Noirs et Arabes – victimes supposées des « Juifs sionistes » -, avec ce commentaire : « Ce sont les Noirs et les Arabes qui vont sauver la République et, en face, on a un système de donneurs de leçons » (référence aux « amis de l’apartheid » ou des « mouvements extrémistes sionistes », étant entendu que « le sionisme est une secte »). Cette incitation à la concurrence haineuse entre « communautés » fait système avec les campagnes en faveur de la « discrimination positive », des « réparations » dues aux descendants des esclaves africains-noirs et de la « visibilité » (politique et médiatique) des élites d’origine africaine. Il y a là une racialisation conflictuelle des rapports sociaux, sur le modèle anglo-saxon, qui risque de détruire les fondements du civisme républicain à la française.
Le paradoxe involontairement comique des postures de Dieudonné tient à ce qu’il est devenu un agitateur communautariste tout en continuant de dénoncer le « communautarisme12 », mais seulement du côté juif! Il va de soi que, chez Dieudonné, la critique du communautarisme relève de la pose, et n’est qu’une manière de justifier sa virulente critique de ce qu’il appelle le « lobby sioniste ». Le 2 juillet 2004, le président du CRIF a ainsi été criminalisé par Dieudonné : « Roger Cukierman prône la haine et les valeurs mafieuses communautaires. » En direct sur Beur FM, le 28 mars 2005, en principe pour faire la promotion de son dernier spectacle, Dieudonné a réitéré ses attaques : «Je pense qu’il y a un cancer, c’est les communautarismes, qui est orchestré, organisé par une association comme le CRIF qui est une association ultra-communautaire. Ils ont appelé au boycott de mon spectacle. Je suis dans le collimateur de ce M. Cukierman que je n’ai jamais vu. D’ailleurs invitez-le, moi je veux bien que l’on discute avec M. Cukierman. Quel est son projet ? Organiser une vaste ratonnade contre les Noirs et les Arabes ? C’est cela son véritable projet ? Diviser la France pour je ne sais pas quoi, et pour servir les intérêts d’un autre pays13 ? »
La dénonciation du « communautarisme juif » est devenue récurrente dans le discours « antisioniste » contemporain, marquant l’émergence d’une variante du vieux thème d’accusation de « solidarité juive », (…).
(p.433) C’est en novembre 2006 que Dieudonné et son ami Alain Soral commencent à se rapprocher publiquement du Front national. L’ex-antilepéniste et l’ex-communiste inauguraient ainsi leur nouvelle carrière de transfuges28. Le 11 novembre 2006, en compagnie de Soral, Dieudonné se rend à la fête annuelle des Bleu-Blanc-Rouge (BBR) du Front national, au Bourget, et y échange une poignée de main avec Le Pen, l’invitant à son spectacle. Le 13 novembre, questionné par Michel Field sur LCI, l’humoriste déclare qu’il faut « cesser de dire que cet homme-là [Le Penl est le diable29 ». En décembre 2006, on assiste au déplacement en masse des principaux responsables du Front national, Bruno Gollnisch, Jean-Michel Dubois et Farid Smahi, accompagnés de Jany Le Pen, au spectacle de l’humoriste, « Dépôt de bilan », au Zénith de Paris30. Dès l’automne 2005, Soral était présent dans l’équipe de campagne du Front national. Mais son ralliement au parti lepéniste ne sera rendu public que le 29 novembre 2006, dans un entretien diffusé sur le Web. Le 18 novembre 2007, le jour de sa réélection à la présidence du Front national, Le Pen nomme Soral membre du Comité central de son parti. L’ami de Dieudonné, et « son inspirateur sur la question juive31 », est devenu l’ami de Le Pen, et son « nègre ». Ce que Le Pen n’ose plus dire tout haut Dieudonné et Soral le disent à sa place. Il en va ainsi de la dénonciation du « communautarisme judéo-sioniste32 ».
(p.436) Le fait que les pouvoirs publics aient tardé à reconnaître la réalité de ces violences a provoqué un grand désarroi chez beaucoup de Français juifs : d’octobre 2000 à mars 2002, les leaders de gauche et de droite, pour la plupart, ont, en effet, choisi de garder le silence, de minimiser ou de relativiser les incidents antijuifs. Certains d’entre eux les ont niés sans vergogne. La reconnaissance publique de la gravité des faits, par les plus hautes autorités de l’État, ne s’est produite que le 31 mars et le 1er avril 2002, après que trois synagogues ont été incendiées ou vandalisées durant le week-end de Pâques. Mais, depuis l’automne 2000, la multiplication des petits incidents antijuifs dans certains quartiers et certaines banlieues produisait un climat détestable et nourrissait des inquiétudes fusionnant avec celles engendrées par les attentats meurtriers dus au terrorisme islamiste planétaire. D’où le profond malaise des Juifs de France, dont témoigne en particulier l’augmentation notable des départs à l’étranger de 2002 à 2005 : environ 5 000 Juifs auraient quitté la France en 2002, la moitié d’entre eux pour s’installer en Israël. Plus précisément, selon les chiffres communiqués par l’Agence juive, le nombre des Juifs de France qui ont fait leur aliyah est passé de 1 000 environ en 2001 à 2 566 en 2002, puis à 2 133 en 2003. Au cours du premier semestre 2004, 685 Juifs de France se seraient installés en Israël, contre 544 pour la même période en 200339. Dans les neuf premiers mois de 2004, marqués par une intensification des violences antijuives, Y aliyah des Juifs de France a progressé de 18 % par rapport à la même période l’année précédente40. Rappelons qu’à la fin des années 1990, les Juifs de France étaient moins de 1 000 par an à partir (p.437) pour s’installer en Israël41. Le Salon de l’aliyah, tenu à Paris le 2 mai 2004, a été visité par 5 000 personnes. Deux séries de motivations doivent être prises en compte pour comprendre les départs vers Israël : d’une part, l’inquiétude devant la montée de la judéophobie dans certains secteurs de la société française, et, d’autre part, le désir des émigrants juifs de réaliser leur idéal sioniste ou d’« assurer l’éducation et l’avenir de leurs enfants dans un cadre juif42 ». D’autres Français juifs vivant dans des banlieues où ils se sentent en danger les quittent pour habiter dans des quartiers supposés plus accueillants. Plus de 16 000 Juifs auraient ainsi quitté les banlieues nord de Paris depuis 2001.
(…) L’État-providence ne sait guère résister, à l’âge de la démocratie d’opinion, à la tentation forte de dériver vers une « République des victimes » ou des communautés victimaires, dont les revendications croissantes montrent qu’elles sont à la fois irresponsables et insatiables dans leur exigence de repentance43. Le psychanalyste Michel Schneider caractérise et stigmatise ce processus comme la « dérive maternelle » d’un État bienveillant qui, cherchant à faire le bonheur de ses citoyens, tend à renoncer à ses « fonctions masculines » pour étouffer sous ses caresses démagogiques des citoyens maintenus dans la dépendance, infantilisés, déresponsabilisés44. Si l’avenir de la France est préfïgurable par l’affrontement indéfini de minorités exclusivistes, dénué du moindre sens de la communauté de destin et de responsabilité constituant la nation républicaine, sous le regard tutélaire d’un pouvoir « doux » et impuissant, alors on a de bonnes raisons de perdre le goût de l’avenir.
(p.439) Un facteur important de cette vague judéophobe a été l’islamisation ou la réislamisation d’une partie de la jeunesse issue de l’immigration. C’est ce que met en évidence une étude détaillée sur les Français issus de (p.440) l’immigration maghrébine, africaine et turque, réalisée par deux chercheurs du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), Sylvain Brouard et Vincent Tiberj : Français comme les autres ? Enquête sur te citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque1. Cette étude a le mérite df fournir des données chiffrées sur l’influence de l’islam dans ce qu’on appelle « l’intégration » (aussi bien sociale que politique) et, plus particu lièrement, sur la corrélation entre pratique de l’islam et sentiment1; antijuifs4. Les 1 003 personnes de plus de 18 ans de l’échantillon représentatif appelé « RAPFI » viennent majoritairement des classes populaires et votent largement à gauche (63 %). Dans deux domaines, la pratique de l’islam marque un véritable clivage : les mœurs et les préjugés (ou les stéréotypes) antijuifs. Alors que ces nouveaux Français sont plus jeunes, en moyenne plus diplômés et plus à gauche que le reste de la population5, ils se montrent plus conservateurs en matière de moeurs^. Ils sont par exemple 39 % à condamner l’homosexualité (contre 21 % des Français). Ils sont 43 % (contre 26 %) à approuver des horaires séparés pour les femmes dans les piscines et encore 32 % (contre 8 %) à exiger la virginité avant le mariage7. Le décalage est d’autant plus frappant qu’il s’accroît parmi les jeunes générations. Alors que seulement 3 % des Français de 18 à 31 ans donnent des réponses qui les classent comme « conservateurs », ils sont 37 % parmi ceux qui sont issus de ces immigrations (39 % parmi les 18-24 ans et 35 % parmi les 25-31 ans)8. Ce rigorisme, essentiellement porté par les jeunes hommes musulmans, se heurte au désir d’émancipation des femmes musulmanes de leur âge, beaucoup plus permissives. Ce qui explique les tensions observées ces dernières années. Aujourd’hui, près de 59 % des descendants de Turcs, Africains ou Maghrébins se disent musulmans, 13 % catholiques, 2 % protestants, et 20 % sans religion9 ; 22 % des musulmans pratiquent régulièrement, contre 18 % dans les autres religions10.
(p.441) Une nouvelle forme d’antijudaïsme religieux, disctincte de la forme chérétienne traditionnelle, a pris racine en France avec l’installation d’une immigration de masse de culture musulmane.
(p.442) Le contraste est frappant entre l’antiracisme d’État qui ne cesse de se manifester dans l’espace public par des indignations ou des condamnations solennelles et la réalité sociale des violences (physiques ou symboliques) visant notamment des Juifs. L’antiracisme officiel tend à méconnaître la spécificité des violences judéophobes en les diluant dans un cocktail dont la formule militante est standardisée : « contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie », mélange auquel peuvent s’ajouter « l’intolérance », « l’homophobie » ou les « violences intercommunautaires ». Cette dernière expression, fort répandue, n’en est pas moins trompeuse, car, ainsi que nous l’avons déjà souligné, il n’y a nulle symétrie dans les agressions : alors que des groupes déjeunes (Français ou étrangers) issus de l’immigration se sont attaqués à des synagogues ou à des écoles juives, aucun groupe de jeunes Français juifs n’a incendié une mosquée, ni agressé une jeune fille maghrébine (ou une musulmane) en tant que telle.
(p.444) Mais il convient aussi de prendre en compte un facteur politique étrangement méconnu, peut-être parce qu’il constitue une exception nationale gênante, qui ne saurait être totalement assumée : l’existence d’un antisionisme d’Etat, ou plus précisément d’un parti pris anti-israélien largement partagé par les élites administratives de gauche et de droite. Cette israélophobie institutionnelle, dont l’intensité ne peut être comparée qu’aux expressions les plus fortes de l’antiaméricanisme dans certaines conjonctures (par exemple, celle de la seconde guerre d’Irak), s’est mise en place au cours des années 1960 et 1970. Jusqu’à l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, Israël a été en permanence dénoncé ou condamné avec indignation par les plus hauts dirigeants politiques français (à quelques exceptions près), sur ce seul point en parfaite consonance avec la plupart des médias. Cette vulgate anti-israélienne allait de pair avec un pro-arabisme d’État. Tel aura été l’ultime héritage de la « politique arabe de la France » définie par le général de Gaulle entre 1962 et 1967, qui a longtemps déterminé les orientations du Quai d’Orsay.
(p.445)
Certes, l’État français reconnaissait l’existence de l’État d’Israël, mais cette reconnaissance formelle était régulièrement relativisée, voire annulée, par les critiques systématiques dont la politique israélienne, quelle qu’elle fût, faisait l’objet, dans le cadre d’une diplomatie globalement favorable aux pays arabes et particulièrement complaisante à l’égard du nationalisme palestinien29. Non sans tomber parfois dans l’israélophobie énoncée sans fard, sur le mode rendu célèbre en 2001 par un ancien porte-parole du Quai d’Orsay devenu ambassadeur de France, Daniel Bernard, qui, rappelons-le, après avoir stigmatisé Israël comme un « petit pays de merde »v l’a accusé de conduire à une éventuelle « troisième guerre mondiale ». À quoi il faut ajouter que, dans un contexte où l’autorité de Yasser Arafat était contestée par un nombre croissant de responsables palestiniens, la France s’est singularisée en continuant de reconnaître une légitimité et une représentativité à l’autocrate corrompu et corrupteur, déclaré officiellement mort le 11 novembre 2004. De la part des autorités politiques françaises, nulle déclaration officielle n’est venue démentir la rumeur d’un empoisonnement du leader palestinien par les Israéliens, rumeur antijuive traditionnelle réactivée qui, lancée par divers propagandistes sur les territoires palestiniens et entretenue en France par Leïla Shahid (la représentante dans l’Hexagone de l’Autorité palestinienne)30, s’est largement répandue dans l’ensemble du monde arabo-musulman. Par ailleurs, à propos de la « barrière de sécurité », ne peut-on reconnaître la légitimité des mesures d’autodéfense prises par un État de droit pour protéger ses citoyens d’un terrorisme qui ne recule devant aucune pratique meurtrière, recourant le plus souvent aux « bombes humaines » ? On constate un parti pris anti-israélien dans les prises de position de nombreux leaders politiques français, en accord sur ce point avec leurs homologues européens. Le parti pris israélophobe s’est manifesté en 2003-2004 par les condamnations hyperboliques qui ont visé la construction de la « barrière de sécurité » antiterroriste, assimilée abusivement au « mur de la honte » de l’ex-Allemagne de l’Est communiste ou à un symbole du système de l’apartheid. Deux poids, deux mesures, principe qu’on peut illustrer par un complexe de jugements devenu ordinaire : condamner de façon hyperbolique un « mur » dont le principe est pourtant facilement compréhensible (protéger les civils israéliens des actions terroristes), tout en montrant une compréhension mêlée de complaisance à l’égard des « bombes humaines » (présentées comme des « victimes de l’oppression israélienne » mues par le « désespoir ») et en restant silencieux sur les victimes civiles israéliennes.
Ce qu’on a appelé l’« affaire Al-Manar », c’est-à-dire le scandale déclenché par l’autorisation d’émettre – sous certaines conditions -accordée le 19 novembre 2004 par le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) à la chaîne du Hezbollah libanais, a joué le rôle d’un révélateur11. On sait que la chaîne Al-Manar diffuse des émissions à forte teneur antijuive, qu’elle fait l’apologie des actions terroristes anti-israéliennes, notamment des attentats commis par des « bombes humaines » tuant des civils, et que son thème de propagande dominant est l’appel à l’éradication de l’État d’Israël – accusé, selon la méthode de nazification de l’ennemi, de « crimes contre l’humanité » Ces émissions (feuilletons, débats, interviews, reportages, (p.446) clips musicaux, etc.) mêlent les vieilles accusations de crime rituel et de complot aux thèmes de l’antisionisme absolu, et constituent une incitation permanente à la haine et à la violence contre les Israéliens. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre deux clips musicaux parmi d’autres, « Jérusalem est à nous » et « Mort à Israël »32, qui transmettent des messages incitatifs dénués de toute ambiguïté : « Sion l’oppresseur maudit sera exterminé », «Jérusalem est à nous, les Arabes, ceux qui l’occupent seront exterminés », dit la première chanson que chante un professeur dont chaque phrase est reprise en écho par les élèves ; dans la deuxième, entre deux phrases musicales l’on peut entendre des fragments d’un discours prononcé par le leader du Hezbollah, cheikh Hassan Nasrallah : « Mort à Israël, la fin de cet abcès purulent, mort à Israël (…), Israël est un mal absolu, une entité attaquante, oppressante, occupante, terroriste, cancéreuse, sans absolument aucune légalité ni aucune légitimité, et elle n’en aura jamais. » À la suite d’une vaste mobilisation où le CRIF et le journal en ligne Proche-Orient.info ont joué un rôle déterminant, le CSA a fini par résilier la convention conclue avec la société Lebanese Communication Group SAL, le 17 décembre 2004.
Or le chef de l’État français s’était jusqu’alors refusé à laisser inscrire le Hezbollah sur la liste des mouvements terroristes établie par l’Union européenne. On sait que le Hezbollah, mouvement islamo-terroriste, est aussi un parti politique doté d’une représentation parlementaire au Liban. Les défenseurs d’Al-Manar ont joué sur cette dimension institutionnelle du Hezbollah, pour récuser l’accusation de « terrorisme », en accord avec la position officielle de la France. Dès lors, le gouvernement libanais était en droit de s’interroger sur la logique politique de l’interdiction d’une telle chaîne en France. Le contraste avec les Etats-Unis est net : le Hezbollah y a été inscrit sur la liste des organisations terroristes, et le Département d’État a interdit la diffusion de la chaîne Al-Manar, menaçant de sanctions tout individu ou groupe « ayant des liens avec cette chaîne ». Politique cohérente. Quelque chose comme un double jeu peut donc être ‘ mis en évidence chez les gouvernants français de l’époque : en politique intérieure, totale condamnation des violences antisémites, mais, en politique étrangère, stigmatisation permanente d’Israël et relative complaisance à l’égard des mouvements terroristes présentés comme des mouvements de « résistance ». On est dès lors en droit de s’interroger sur la bonne foi de ! certains « anti-antisémites d’État », en France et ailleurs en Europe.
(p.447) En dépit des données chiffrées disponibles et d’autres indicateurs d’ordre sociologique, certains esprits continuent de soutenir qu’il ne s’est rien passé en France et ailleurs en Europe ces dernières années qui relèverait de la haine antijuive et se marquerait par une flambée significative. Les partisans du « rien ne se passe » sont soit des aveugles de bonne foi (péchant par exemple par simple ignorance), soit des adeptes du déni de réalité sélectif, lorsque la réalité sociale aveuglante dérange leurs convictions idéologiques (ce sont, par exemple, les « antisionistes » radicaux, les défenseurs inconditionnels du « voile islamique », les militants « antiracistes » en lutte contre la seule « islamaphobie » et tous ceux qui veulent éviter à tout prix de « stigmatiser les jeunes des banlieues », quoi qu’ils puissent faire)34. Les sceptiques et les « dubitationnistes » attribuent à leurs adversaires une thèse que ces derniers ne soutiennent pas, à savoir : « La France est un pays antisémite. »
CHAPITRE 18 Figures du malaise dans la nation française
(p.451) Commençons par souligner le fait que, depuis le printemps 2002, en France, les pouvoirs publics ont commencé à prendre leurs responsabilités, en s’engageant clairement dans une lutte sur plusieurs fronts contre les manifestations de la haine antijuive. On ne peut à cet égard que saluer l’action conjointe, en 2002 et 2003, de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, de Luc Ferry au ministère de l’Éducation nationale, suivi en cela par son successeur François Fillon, et du garde des Sceaux Dominique Perben. Mais la reconnaissance des incidents antijuifs a été tardive, et la « 7 volonté d’agir efficacement ne s’est pleinement manifestée que dans les derniers mois de l’année 2002. D’octobre 2000 à mars 2002, peu de responsables politiques ont reconnu publiquement la gravité et l’ampleur des violences antijuives observables en France. On peut citer par exemple Pierre Lellouche, Claude Goasguen ou François d’Aubert à droite, et Dominique Strauss-Kahn à gauche. Au silence sur les faits ont succédé des tentatives pour les minimiser ou les relativiser Cette remarque vaut autant pour le gouvernement socialiste que pour l’Elysée. C’est seulement après le week-end de Pâques des 30 au 31 mars 2002, durant lequel trois synagogues ont été brûlées ou vandalisées, que Lionel Jospin et Jacques Chirac sont intervenus sans ambiguïté pour condamner ces violences. Des mesures ont été prises pour protéger les lieux de culte et les écoles juives. Mais lors de la grande manifestation des Juifs de France qui, organisée le 7 avril 2002 à Paris par de nombreuses associations sous l’égide du CRIF, a rassemblé environ 100 000 personnes, n’étaient présents que François Bayrou, Alain Madelin et Corinne Lepage. Lionel Jospin avait interdit à ses ministres de s’y montrer.
La mobilisation de la société civile n’a pas été plus significative que ‘ celle des sommets de l’État et de la classe politique. La manifestation du 7 avril 2002 n’a pas déclenché un mouvement de solidarité des syndicats (notamment d’enseignants), des associations culturelles ou humanitaires ou encore des Églises. Il en est allé de même lors de la manifestation contre l’antisémitisme du 16 mai 2004 (environ 15 000 personnes à Paris), avec cette différence notable : des hommes politiques s’y sont montrés ostensiblement. Mais le « peuple de gauche » ne s’est toujours pas déplacé. Les Français juifs inquiets ont défilé à peu près seuls. Cette indifférence ne peut-elle être interprétée comme un abandon ? Et cet abandon comme l’expression d’une hostilité plus ou moins sourde ? Derrière l’accusation de « communautarisme » visant ces manifestations contre l’antisémitisme, lancée notamment par le MRAP et la Ligue des droits de l’homme (ainsi que par certaines organisations d’enseignants), ne peut-on supposer l’existence (p.451) d’une hostilité profonde, ici traduite et déguisée en langage « politiquement correct » ? Celui de « l’humanisme », du « progressisme », de « l’universalisme », polémiquement retourné contre l’insupportable particularisme juif ? Lorsqu’ils s’expriment, les nouveaux judéophobes bien-pensants s’indignent sur le mode : « Comment peut-on encore être juif, oser se dire juif ? » (ou « Comment peut-on être sioniste, Israélien, etc. ? »), alors qu’il est si facile de se dire, par exemple, « citoyen du monde », de se vouloir « cosmopolite » et/ou « métissé », ou encore de se prononcer en faveur de la « créolisation » du monde. L’explication réductrice de la vague judéophobe récente à une simple importation mimétique du conflit israélo-palestinien alimente l’indifférence relative de la société civile et lui sert de justification, par des arguments du type : « Ces conflits entre Juifs et Arabes ne nous concernent pas. » Le désir de dormir tranquille sait trouver des alibis.
Au début d’avril 2002, sortant du silence et du déni, Jacques Chirac a enfin dit ce qu’il fallait dire : « Lorsqu’un Juif est agressé, c’est la France qui est agressée. » Mieux vaut tard et forcé que jamais. La voix de l’État français, celle de la République française, s’est alors fait entendre, à travers une déclaration de principe. Le président de la République l’a plusieurs fois réaffirmée, notamment lors d’un discours solennellement prononcé le 8 juillet 2004 au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), lieu hautement symbolique1. (…)
Des exceptions notables doivent cependant être mentionnées, comme celle représentée par le Mouvement des Maghrébins laïques, dont les prises de position courageuses sont à saluer, comme celles de l’association Ni putes ni soumises. Le 12 juillet 2004, le Mouvement des Maghrébins laïques a dénoncé publiquement la « montée de l’antisémitisme dans l’immigration maghrébine, principalement liée au travail de terrain effectué par les intégristes musulmans qui communiquent une haine viscérale du « Juif », en ajoutant que « ce sont les mêmes qui tentent de saboter les principes républicains et laïques ». Nasser Ramdane, membre de Ni putes ni soumises, a déclaré le même jour : « Ce n’est pas parce qu’on est jeune et pauvre qu’on a le droit d’être antisémite. » Dans le même sens, après les deux agressions antisémites commises à Sarcelles (Val-d’Oise) le 3 mars 2006 par un groupe de jeunes comprenant des Noirs – comme l’avait indiqué, le 4 mars, l’entourage du ministre de l’Intérieur Nicolas (p.453) Sarkozy -, le Cran (Conseil représentatif des associations noires de France) a publié le 7 mars un communiqué dans lequel il condamnait « avec fermeté » les agressions antisémites de Sarcelles et rappelait aux « populations noires de France leurs devoirs et leurs droits ». Dans son communiqué, le Cran « lance un appel au calme et met en garde contre toute exploitation globalisante qui utiliserait les origines réelles ou supposées des agresseurs présumés ». L’association, créée en novembre 2005, « redit aux populations noires de France leurs devoirs et leurs droits et leur rappelle tout en le regrettant que tout acte commis par un(e) Noir(e) jette l’opprobre sur une grande partie, si ce n’est sur l’ensemble des populations noires ». Le Cran, ajoute le communiqué, « entend dire et redire qu’aucune souffrance ne peut excuser des actes de terreur et qu'(…)il travaille ardemment à ce que des solutions républicaines puissent être trouvées pour faire face à la situation de désespérance2 ». Ces prises de position publiques, courageuses et lucides sont cependant restées minoritaires dans l’espace des associations.
Les responsables politiques ne se sont guère risqués non plus à désigner clairement les principaux responsables de ces violences antijuives, qui ne sont plus principalement des militants d’extrême droite, mais des «jeunes issus de l’immigration » ou des « individus issus de quartiers sensibles », comme la CNCDH l’indique d’une façon euphémisée. Or, à force de vouloir à tout prix éviter de « stigmatiser » certains secteurs de la population française (souci en lui-même légitime), on n’ose plus rien nommer précisément ni caractériser sans équivoque. Journalistes et sociologues rivalisent de zèle pour réinterpréter d’une façon « politiquement correcte » la réalité observable. Des violences ethniquement ciblées et revendiquées clairement par leurs acteurs sont ainsi mises au compte du seul ressentiment social, voire de la légitime révolte contre « les inégalités » ou « la discrimination », et, partant, interprétées comme l’expression d’une « politisation potentielle », dès lors que les agresseurs viennent des « quartiers sensibles » ou sont « issus de l’immigration ». L’application aux violences commises par les «jeunes des quartiers » du modèle interprétatif de la « politisation potentielle » ou de la « demande de politique », censée attendre sa traduction honorable par une mobilisation politique effective, constitue une transfiguration de la réalité sociale par laquelle la plupart des sociologues d’extrême gauche ou d’une gauche paternaliste cherchent à redonner vie à leurs engagements révolutionnaires et à donner un sens politique à des comportements qui en sont dépourvus, actes de vandalisme ou actions crapuleuses commis par des délinquants, non « potentiels » quant à eux. Le refrain sociologisant est connu : derrière les voitures et les écoles brûlées, il faudrait deviner une demande d’intégration ou de reconnaissance sociale, et l’aspiration à sortir de la marginalisation. C’est là attribuer de bonnes intentions, selon les valeurs et les normes démocratiques, aux «jeunes défavorisés » des « quartiers », parce que jeunes et défavorisés, et ce, quelles que soient leurs actions violentes. Et c’est là aussi postuler que ces explosions de « colère » sont spontanées, qu’elles ne sont en aucune manière manipulées, ou simplement canalisées3. Les grands oubliés de cette approche angélique, ce sont les caïds et tous les profiteurs de (p.454) l’économie souterraine qui, engendrée par des activités criminelles, s’est installée dans de nombreuses « cités4 ».
Lorsque les victimes de violences racistes ou dotées d’une dimension raciste (parmi d’autres) sont des Français dits « de souche », c’est-à-dire reconnus par leurs agresseurs comme « Blancs », la réaction ordinaire est, dans les milieux de l’antiracisme bien-pensant, de nier le caractère raciste desdites violences. Rien ne va plus (de soi) lorsque des violences racistes sont attribuées à des « non-Blancs » ou à des individus n’appartenant pas à une mouvance d’extrême droite. Le raciste-type de l’antiracisme angé-lique, le type répulsif que tout le monde est prêt à détester et aime tant haïr, c’est le néonazi ou le skinhead, « de type européen » (en langage policier), militant d’un groupuscule extrémiste violent. Comme si le racisme allait toujours et nécessairement du « Blanc » à « l’homme de couleur ». Comme si le « raciste » (et/ou « l’antisémite ») était nécessairement d’extrême droite. Comme si encore le fait, pour un individu, d’appartenir à une minorité dite, de façon contestable, « ethnique » (« Arabes » ou « Maghrébins »), ou, d’une étrange façon, « invisible » (« Les Noirs en France5 »), le rendait par nature inapte au « racisme ». C’est ce dont témoigne le surprenant débat déclenché fin mars et début avril 2005 par la pétition lancée par l’Hachomer Hatzaïr et Radio Shalom contre les « ratonnades anti-Blancs » commises à Paris, par des bandes de jeunes venant pour l’essentiel de certaines banlieues et où les « Noirs » étaient surreprésentés, lors des manifestations lycéennes du 15 février et – surtout – du 8 mars 2005. Le texte de la pétition, lancé par l’Hachomer Hatzaïr, mouvement de jeunesse s’identifiant comme « sioniste de gauche », était le suivant : « II y a deux ans, presque jour pour jour, le 26 mars 2003, quelques-uns d’entre nous lançaient un cri d’alarme. Quatre jeunes du mouvement Hachomer Hatzaïr venaient de se faire agresser en marge d’une manifestation contre la guerre en Irak [22 mars 2003] parce qu’ils étaient Juifs. Une tentative de lynchage en plein Paris, un scandale. La mobilisation des médias, des politiques, des simples citoyens a été formidable. Mais aujourd’hui les manifestations lycéennes sont devenues, pour certains, le prétexte à ce que l’on peut appeler des « ratonnades anti-Blancs ». Des lycéens, souvent seuls, sont jetés au sol, battus, volés et leurs agresseurs affirment, le sourire aux lèvres : « parce qu’ils sont français ». Ceci est un nouvel appel parce que nous ne voulons pas l’accepter et parce que, pour nous, David, Kader et Sébastien ont le même droit à la dignité. Écrire ce genre de textes est difficile parce que les victimes sont kidnappées par l’extrême droite. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant : il ne s’agit pas, pour nous, de stigmatiser une population, quelle qu’elle soit. À nos yeux, il s’agit d’une question d’équité. On a parlé de David, on a parlé de Kader mais qui parle de Sébastien6 ? »
(p.455) Dans son roman paru en janvier 2008, Le Village de l’Allemand*, le romancier algérien Boualem Sansal a osé décrire sans fard la réalité de l’islamisation en France. Dans certaines « cités » sont fabriqués des militants islamistes fanatiques, de véritables « talibans », tandis qu’un système parallèle s’est mis en place, formant quelque chose comme un mini-État totalitaire, avec ses lois, ses tribunaux et son impôt, au sein du territoire de l’État républicain. Malrich, un personnage du roman, prophétise : « À ce train, parce que nos parents sont trop pieux et nos gamins trop naïfs, la cité sera bientôt une république islamique parfaitement constituée. Vous devrez alors lui faire la guerre si vous voulez la contenir dans ses frontières actuelles. » II va jusqu’à comparer sa « cité » à un « camp de concentration » dont les habitants, en proie au désœuvrement, seraient devenus, sous l’autorité tyrannique de l’imam, leurs propres « kapos ». Boualem Sansal justifie ainsi la vision répulsive des « cités » que donne son roman : « Le diagnostic de Malrich n’est pas exagéré. C’est la triste réalité. Dans nos pays, les cités populaires abandonnées par l’État à la misère, au banditisme et à l’islamisme sont déjà des camps de concentration. Certaines banlieues françaises sont de la même manière sous la coupe des gangs mafieux et islamistes, en connexion avec les gangs d’Algérie et les réseaux salafistes d’Al-Qaida dans le monde. Le journaliste Mohamed Sifaoui, à travers ses enquêtes sur le terrain et ses documentaires, en a apporté la preuve. Moi-même, au cours de mes déplacements en France, j’ai eu l’occasion de le constater et de l’entendre de la bouche même des habitants de ces cités9. »
Sur la question des nouveaux acteurs principaux des violences anti-juives, en France ou en Belgique tout particulièrement, le « politiquement correct » continue de dominer. L’antiracisme devenu vulgate, avec son orientation pro-immigrationniste, détermine le dicible et le non dicible : le « politiquement correct » à l’européenne est défini par un code culturel interdisant de désigner en position autre que celle de « victime » (de racisme ou de xénophobie) les populations issues de l’immigration (« Arabes », « musulmans », « Maghrébins », etc.). C’est également ce qu’on peut reprocher au rapport, remarquable par ailleurs, de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) que dirige à Vienne Béate Winkler, intitulé Manifestations d’antisémitisme dans l’Union européenne, rendu public les 31 mars et 1er avril 2004. On sait qu’un premier rapport, qui devait être publié au printemps 2003, ayant été jugé non conforme aux attentes et à certaines convenances idéologiques, a été mis sous le boisseau – mais la censure a été déjouée, et l’étude jugée insatisfaisante a finalement été diffusée sur le site du CRIF le 1er décembre 2003. Les auteurs du rapport « non publié » (officiellement) soulignaient le fait : « Ce ne sont pas les partis et les groupes d’extrême droite qui ont joué un rôle décisif» dans la récente vague antijuive. Et ils ajoutaient : « En Espagne, en France, en Italie et en Suède, une partie de la gauche et des groupes arabo-musulmans ont joint leurs efforts pour organiser des (p.456) manifestations pro-palestiniennes. (…) Alors que ces manifestations n’étaient pas intrinsèquement antisémites, des slogans antisémites ont été proférés et des banderoles antisémites ont été brandies dans certaines d’entre elles ; certaines de ces manifestations se sont terminées par des agressions contre des Juifs ou des institutions juives. » Ce qui a donc été jugé impubliable en 2003, c’est une étude désignant sans détour des «jeunes musulmans», des milieux « pro-Palestiniens », des «groupes islamistes » et des militants « anti-mondialisation » d’extrême gauche comme responsables, à côté d’individus ou de groupes d’extrême droite, des actions et des menaces antijuives récentes en Europe. Les rapporteurs donnaient, dans divers pays européens, plusieurs exemples « où, durant la période d’observation, des attaques physiques contre des Juifs, la profanation et la destruction de synagogues ont été souvent le fait de jeunes musulmans. »
(p.456) Kofi Annan a déclaré : « Le combat contre l’antisémitisme doit être notre combat et les Juifs du monde entier doivent considérer les Nations unies comme leur maison10. » Encore faut-il, pour répondre pleinement à cette belle invitation, que l’ONU ne se transforme pas en lieu de rendez-vous de tous les ennemis d’Israël.
CHAPITRE 19 Le meurtre d’Ilan Halimi, crime de synthèse et symptôme social
(p.457) C’est dans ce contexte euphorique que s’est faite la découverte du jeune Ilan Halimi le long d’une voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), le 13 février 2006, nu, bâillonné, menotte, le corps arrosé d’essence ou d’acide, couvert de traces de tortures et de brûlures1, grièvement blessé à l’arme blanche2. Ilan est mort au cours de son transport à l’hôpital. Cette découverte dérangeante devait rester confinée à la rubrique des faits divers de la semaine. Kidnappé le 21 janvier 2006 par une bande de Bagneux (Hauts-de-Seine) exigeant une rançon, séquestré durant trois semaines, Ilan avait finalement été laissé pour mort par ses ravisseurs : une affaire crapuleuse parmi d’autres. Sa judéité paraissait sans rapport avec son enlèvement et sa lente mise à mort. En tout cas, c’est la thèse que n’ont cessé de réaffirmer, après l’avoir lancée, les responsables de la police et le procureur de la République de Paris, suivis par des intellectuels et des journalistes.
Reconnaître un crime antijuif
Le message commun venant de la justice et de la police a consisté d’abord à exclure tout mobile antisémite dans ce « crime crapuleux », puis à exprimer des « réserves » sur le caractère antisémite du meurtre, enfin à minorer ou relativiser, voire à nier la dimension antijuive du crime. Les premières déclarations du procureur de la République de Paris, Jean-
Claude Marin, (p.458) ont été largement exploitées par ceux qui, en appelant à la « prudence » pour diverses raisons (dont certaines inavouées), voulaient justifier leurs doutes sur le caractère antijuif du crime. Des doutes qui pouvaient aller jusqu’à la conviction que le crime n’avait rien d’antisémite. Même après la reconnaissance, dans cette affaire d’enlèvement, d’un mobile antisémite retenu comme circonstance aggravante par les juges d’instruction (Corinne Goetzmann et Baudoin Thouvenot), le 20 février 2006, le parti pris « dubitationniste » n’a pas baissé les bras, et les articles ou les propos minimisant ou niant la dimension antijuive du crime se sont multipliés. Jean-Claude Marin a ainsi présenté la situation, le 21 février : « Lorsque l’information judiciaire a été ouverte, le caractère antisémite n’apparaissait pas du tout. Puis, pendant le week-end [18 au 19 février], certaines personnes entendues ont pu dire, de manière indirecte, que le choix d’un Juif garantissait le paiement de la rançon. Le juge a donc considéré qu’il y avait éventuellement là un mobile antisémite. Mais nous sommes vraiment, [avec ce groupe], dans le degré zéro de la pensée3.» Cette dernière remarque est surprenante : faut-il être doté d’une pensée de haute tenue pour être vraiment « antisémite » ? Sylvie Anne Goldberg a aussitôt relevé l’argument sophistique : « La question se pose (…) de savoir si pour être antisémite il faut parfaitement maîtriser les définitions qu’en donnent la langue française et le code pénal, puisque, de nos jours, les propos qualifiés d’antisémites sont passibles de sanctions légales4. »
(p.459) Ilan a donc été choisi parce qu’il était juif, et perçu comme tel. Selon un enquêteur, dans le discours de certains ravisseurs, l’amalgame «Juifs-argent» s’accompagnait de propos insultants sur les Juifs, traités d’« ordures ». Parmi les stéréotypes et les préjugés négatifs qui circulent dans la France des banlieues, ceux du «Juif riche » et du « pouvoir juif » sont les plus courants. Faut-il rappeler la boutade provocatrice mais symp-tomatique de Dieudonné : « II n’y a pas de SDF juif15 » ? Les formules de Dieudonné sont souvent révélatrices de l’imaginaire antijuif ambiant. L’un des « geôliers » a écrasé sa cigarette allumée ou son « joint » sur le front d’Ilan, non sans lancer qu’il n’aimait pas les Juifs, dévoilant ainsi ses sentiments antijuifs16. Un autre geôlier d’Ilan, se prenant pour un combattant palestinien, déclarera plus tard : «J’ai flippé quand j’ai su qu’Ilan était juif, car j’avais peur que le Mossad vienne me buter17. » Les enquêteurs ont par ailleurs établi que sur les six personnes approchées par le gang en vue (p.460) d’une tentative d’enlèvement, quatre étaient des Juifs. Qu’après l’échec des contacts avec la famille Halimi les ravisseurs aient joint le rabbin du VIIIe arrondissement de Paris – « trouvé en consultant Internet », selon Fofana – en lui enjoignant de payer la rançon, cela confirme qu’ils voyaient les Juifs comme les membres d’une communauté tribale, une sorte de grande famille caractérisée par sa solidarité et sa richesse. On retrouve ici la série des stéréotypes antijuifs s’enchaînant sur l’axe « solidarité-communauté-lobby-mafta18 ». Et l’on notera à cet égard que, dans ses diatribes judéophobes, Dieudonné passe régulièrement du terme « communauté » aux termes « lobby » et « mafia », concernant le judaïsme organisé en France ou encore le « sionisme ».
(p.470) Face à l’assasinat d’Ilan Halimi, les néo-négationnistes se contentent de poser sur les assassins des questions rhétoriques du type : « Ont-ils un discours idéologique suffisamment consistant contre les Juifs pour qu’on puisse le dire ‘antisémite’ ? Ont-ils en tête un programme antijuif ? (…) »
(p.472) C’est là oublier bien sûr qu’il y a eu un terrible précédent : les nazis sont parvenus au pouvoir en 1933 après avoir gagné les élections. Donc dans les formes démocratiques. Et ils ne se sont en aucune façon transformés en de paisibles démocrates. Nombreux sont pourtant les Occidentaux qui, conduits par leurs rêves iréniques, aimeraient par leur conduite conciliante produire une modération chez les extrémistes qui leur font peur. Mais comment ne pas voir la part d’illusion dans ce rêve de pacification ? Il est de la nature de l’extrémiste que d’aller jusqu’au bout de sesconvictions motrices. Quoi qu’il en soit, ces vaines attentes d’une « désex-trémisation » de l’extrémisme ont favorisé l’émergence d’un mélange de
L soulagement, de démission et de soumission préventives. En Europe, un vent de dhimmitude volontaire souffle dans le monde des élites politiques (p.473) et intellectuelles, à quelques exceptions près. Telle est la vérité du rêve d’une Europe comme « puissance tranquille », qui prétend dialoguer avec ses ennemis déclarés, oubliant le fait que les frontières sont perméables entre le fondamentalisme islamique et le terrorisme islamiste, entre lejihad idéologique et le Jihad armé. Le glissement du Jihad idéologique de style « aide humanitaire » vers lejihad armé est parfaitement illustré, en France, par la famille Benchellali, de Vénissieux, connue pour avoir pris part aux manifestations en faveur du port du voile islamique et envoyé des dons au Comité de bienfaisance et de soutien aux Palestiniens (CBSP). Plusieurs membres de cette famille sont passés au terrorisme islamiste : Menad, soupçonné d’avoir préparé un attentat chimique en France, et Mourad, parti rejoindre Al-Qaida en Afghanistan en 2001, avant les attentats antiaméricains du 11 Septembre80. C’est là ce sur quoi s’aveugle l’Europe de ceux qui, soucieux avant tout de maintenir leur bien-être, s’imaginent que l’attitude conciliatrice est le seul et sûr moyen d’« avoir la paix », quitte à épouser les thèses « antisionistes » du monde arabo-musulman81. Dans un contexte international chaotique où le conflit israélo-palestinien est non seulement relancé mais élargi aux dimensions mythiques d’un conflit mondial entre le camp « américano-sioniste » et celui de l’islam travaillé par les minorités actives d’inspiration jihadiste, une bande de « barbares » autodésignés d’une banlieue française peut s’autoriser à sacrifier « un Juif ».
Profanateurs de Carpentras et assassins d’Ilan
(p.473) (…) Après la découverte de la profanation de Carpentras, l’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing s’est réfugié dans le silence, tactique prudentielle qu’il avait précédemment choisie après l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic, le 3 octobre 1980 : tandis que son Premier ministre, Raymond Barre, faisait un commentaire aussi malheureux qu’odieux sur l’attentat meurtrier, le président n’avait pas cru devoir interrompre son week-end de chasse. On se souvient des propos choquants tenus par Raymond Barre, quelques heures après l’attentat meurtrier, action à la fois terroriste et antijuive, du 3 octobre 1980 : le Premier ministre, déjà connu pour ses truismes maladroitement formulés, avait cru bon de dénoncer « cet attentat odieux qui a voulu (p.474) frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et [qui] a frappé des Français innocents qui traversaient la rue ». Lapsus dont le contenu latent a été immédiatement entendu : les « Israélites » (euphémisation de « Juifs » dans le langage châtié d’après guerre) ne peuvent être ni français ni innocents. Une fois de plus, on pouvait constater que Jean-Marie Le Pen était loin d’être le seul homme politique à donner dans ce qui a été justement caractérisé comme une forme d’« antisémitisme insidieux84 ». (…) En France, on se mobilise plus volontiers contre l’extrême droite que î contre l’antisémitisme. C’est ce que les manifestations d’avril 2002 (entre 70 000 et 100 000) et surtout de février 2006 (entre 30 000 et 70 000) montreront : le refus de l’antisémitisme, dissocié de la « lutte contre l’extrême droite », ne mobilise guère la population française.
(p.475) Le contraste entre ces deux crimes antijuifs possède une haute valeur symbolique : jusque dans les années 1980 (et encore dans les années 1990), les violences antijuives étaient pour l’essentiel le fait d’individus d’extrême droite ; depuis le début des années 2000, il n’en va plus de même, les Juifs sont désormais attaqués avant tout par des individus étrangers à l’extrême droite, et dont une proportion significative est représentée par des jeunes issus de l’immigration africaine subsaharienne et maghrébine. La culture en mosaïque des «jeunes issus de l’immigration » mêle des héritages culturels familiaux et des éléments de la culture médiatique mondiale, mais elle est aussi largement imprégnée d’islamisme radical, dont les thèmes sont diffusés sur de multiples sites Internet et traduits par des images télévisuelles qui passent en boucle.
(p.478) Il convient de mentionner un autre meurtre antijuif qui a été assimilé
scandaleusement à un simple fait divers. Sébastien Sellam, jeune Français juif de 23 ans, est assassiné dans la nuit du 19 au 20 novembre 2003, de plusieurs coups de couteau dans le cou et sur le visage, par Adel Amastaibou, jeune Français musulman d’origine maghrébine, qui habite le même immeuble que sa victime, à Paris, dans le Xe arrondissement, depuis leur enfance. Sébastien, connu sous son nom de DJ, LAM.C, a acquis une certaine célébrité dans son milieu professionnel parisien, et vient de fonder sa maison de disques. Avant d’assassiner Sébastien, dont il jalouse les succès, Adel était connu dans le quartier en tant que délinquant, condamné à plusieurs reprises par la justice française. Adel était un « perdant », Sébastien un « gagnant », ce qui explique que, dans l’assassinat de ce dernier, la jalousie a joué le rôle d’un facteur déclenchant. Mais la dimension antijuive de l’agression mortelle n’en a pas moins été déterminante. Adel avait précédemment manifesté avec violence des sentiments antijuifs, ce qui lui avait valu une condamnation. Son milieu familial était connu pour son hostilité aux Juifs. Aussitôt après avoir assassiné Sébastien, Adel aurait confié à sa mère, le 20 novembre 2003 : «J’ai tué un Juif et j’irai au Paradis. » En 2006, le meurtrier, estimé irresponsable au moment des faits, a bénéficié d’un non-lieu, des experts l’ayant présenté comme atteint de « maladie mentale ». On peut se demander, avec un zeste d’ironie, si ce (p.479) singulier comité d’experts n’a pas découvert sans le savoir une nouvelle « maladie mentale » en France : l’antisémitisme criminel. La pathologi-sation du crime est une manière comme une autre de le nier. Mais l’affaire n’en est pas restée là, grâce à la ténacité de Juliette Sellam, la mère de Sébastien. Le 19 octobre 2007, la famille Sellam a été reçue à l’Elysée. Un mois plus tard, le 22 novembre 2007, la chambre de l’instruction du tribunal de Paris rendait publique son intention de traduire en justice le présumé meurtrier du DJ. Le 17 janvier 2008, la 4e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rendait un arrêt ordonnant un supplément d’information et la nomination d’un collège d’experts, et confiant le dossier du meurtre de Sébastien Sellam, à Mme Minguet, juge d’instruction. Maître Axel Metzker, l’avocat de Juliette Sellam, la mère de Sébastien, a déclaré le 18 janvier 2008 : « On va enfin pouvoir enquêter sur ce crime antisémite97. »
Après l’arrestation de Youssouf Fofana, les violences antijuives ordinaires ont repris de plus belle en France. Pour éviter les reconstructions sociologisantes en langage « politiquement correct », qui masquent le vécu des agressions par leurs victimes, contentons-nous d’enregistrer quelques-uns des incidents tels qu’ils ont été racontés par ces dernières ou des témoins oculaires, avec leurs mots. Le 3 mars 2006, à Sarcelles (Val-d’Oise), trois jeunes adolescents juifs français ont été agressés par des Noirs et des individus décrits comme des « Nord-Africains ». Le lendemain, à Sarcelles encore, devant un restaurant casher, quatre « individus de couleur », d’origine africaine selon des témoins, ont pris à partie un jeune Juif de 28 ans portant kippa. La victime, souffrant de contusions, a été hospitalisée à la suite d’une blessure à l’épaule. Les quatre auteurs présumés de l’une des agressions ont été arrêtés par la police98. Depuis la fin des violences urbaines de novembre 2005, le maire PS de Sarcelles, François Pupponi, avait recensé début mars 2006 trente agressions, « la plupart contre les Juifs99 ». Le 6 mars, un élève juif de 13 ans et demi du collège Gilbert-Dru (Lyon) était agressé devant son collège par des jeunes qui, selon certains témoins, auraient été originaires de Turquie ou d’Afrique du Nord. Les quatre agresseurs, âgés de 14-15 ans, l’ont frappé violemment au visage, lui brisant le nez, puis l’ont jeté à terre et se sont acharnés sur leur victime malgré la présence de témoins, qui d’ailleurs se sont enfuis. Ils ont fini par dire à la victime : « Sale Juif ! Si tu parles, on te tue ! » La famille a porté plainte. Les quatre mineurs ont été interpellés puis placés en garde à vue pour « violence en réunion et injures à caractère antisémite ». Le recteur de l’académie de Lyon, Alain Morvan, a dénoncé une agression « d’inspiration antisémite » et a ouvert une enquête administrative. Il a également porté plainte. Au collège Mauvert (Villeurbanne), dans une affaire de racket de portables, un groupe de jeunes d’origine maghrébine et africaine, depuis le 3 mars, insultait des élèves juifs (« Sales Juifs ! ») et les menaçaient d’actes similaires à ceux attribués à Youssouf Fofana. Des plaintes ont été déposées par des parents d’élèves du collège. Toujours à Villeurbanne, une lettre anonyme de menaces a été reçue par la synagogue de la ville, évoquant un projet d’attentat à la voiture piégée. Dans la nuit du 6 au 7 mars, la caméra de surveillance d’une école
(p.480) talmudique a été brisée. Un homme a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Le 7 mars au matin, à Paris (75019), une dame juive âgée, Mme A., volontaire bénévole aux Tables du cœur (les « restes du cœur » casher), a été prise à partie par un individu qu’elle a décrit comme « maghrébin », dans la rue de Lorraine, à hauteur d’un foyer de travailleurs immigrés. Cet individu a proféré des insultes antisémites et lui a porté un violent coup sur la tête. Mme A. a déposé plainte. Le 12 mars 2006, à Garges-les-Gonesses (95), A. Didier (32 ans) a été victime d’une agression accompagnée d’insultes antijuives, dans les conditions ainsi précisées par le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) : « A. Didier conduisait sa voiture lorsqu’il s’est rendu compte qu’un véhicule le poursuivait. Il s’est arrêté pour demander à ses 3 poursuivants – deux hommes d’origine africaine et un d’origine maghrébine -, de cesser de le « coller ». Ceux-ci pénétrèrent de force dans son automobile. La victime déclare avoir entendu l’homme d’origine maghrébine dire en arabe « Ha Yehoudi » (« c’est un Juif»). Les trois individus le mettent à terre, lui assènent des coups au corps et à la tête et s’enfuient quand un troisième véhicule arrive. Malgré ses contusions et une côte fêlée, la victime relève le numéro d’immatriculation, se rend au commissariat de police pour y déposer plainte. La police a identifié et interpellé deux des agresseurs » »1 » Autre exemple de violence antijuive ordinaire : dans la soirée du 10 avril 2006, sur le parking du centre commercial Val-d’Europe à Serris (Seine-et-Marne), un homme de 43 ans portant une kippa a été pris à partie par quatre jeunes. L’un d’entre eux, titubant, s’est accroché avec l’homme, lui lançant des insultes antisémites avant de s’en prendre à lui physiquement, avec deux de ses amis, en le frappant à la tête et à la mâchoire. La victime a reçu 10 jours d’ITT. Grâce à l’intervention des vigiles, deux des jeunes ont pu être interpellés, mais les deux autres ont réussi à s’enfuir. A l’issue des 48 heures de garde à vue, les deux jeunes arrêtés sont passés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Meaux. Cet homme avait été agressé et violenté en tant que Juif, identifié comme tel par la kippa qu’il portait. Les deux jeunes majeurs ont été condamnés à quatre mois d’emprisonnement, dont un mois ferme avec mandat de dépôt. Lors de son réquisitoire, le procureur a établi une comparaison avec l’affaire Ilan Halimi.
L’année 2006, sur le front de la judéophobie, avait donc fort mal commencé : les premières statistiques policières, loin de confirmer la baisse des violences antijuives de 2005, faisaient apparaître une hausse. Cette dernière se confirmera dans les mois qui suivront11« . Certes, une tendance à la baisse a été constatée au dernier trimestre 2006, qui s’est maintenue en 2007102. Mais, ainsi que l’a suggéré le rapport du SPCJ, les incidents antijuifs forment désormais un « bruit de fond » dans la société française. Et l’on doit relever le fait que, dans les années 2000, le total annuel des incidents antijuifs n’est jamais redescendu au niveau où il se situait avant le début de la seconde Intifada. Bref, la vague antijuive est toujours là, dans les esprits plus que dans les violences physiques observables. Mais ces dernières n’ont pas disparu du paysage. Le 22 février 2008, à Bagneux encore, deux ans après l’assassinat d’Ilan Halimi, un jeune Juif de 19 ans, (p.481) Mathieu Roumi, a été séquestré par six jeunes, âgés de 17 à 25 ans, qui lui ont fait subir des sévices à caractère antijuif et homophobe1« 3. Séquestré dans un appartement, puis dans un box d’une cité HLM (la résidence Pablo-Picasso), le jeune garçon a été attaché avec des menottes. Avec un Typex, ses agresseurs lui auraient inscrit sur le visage les insultes « sale juif» et « sale pédé », avant de le forcer à avaler des mégots de cigarette et des médicaments comme des suppositoires, puis de l’obliger à boire jusqu’à l’ivresse et à sucer un préservatif déroulé sur un bâton. Des heures durant, le jeune homme a été insulté, humilié, frappé à coups de poing et de pied. Pour effrayer encore plus leur victime, ses agresseurs ont à plusieurs reprises fait référence au « gang des barbares » de Youssouf Fofana. « Nous admirons Youssouf Fofana », lui ont-ils crié au visage. Mathieu a été relâché, en sang, en début de soirée, à la suite d’un différend entre ses geôliers et tortionnaires. Le jeune homme, « très choqué », a été hospitalisé le soir de son agression. Il a porté plainte le lendemain. Les six agresseurs ont été arrêtés dans les jours qui ont suivi et placés en détention le 27 février. Ils ont été mis en examen et écroués pour « violences aggravées en réunion et en raison de l’appartenance véritable ou supposée à une race ou à une religion », et « en raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée », « séquestration en bande organisée, actes de torture et de barbarie, vol aggravé, extorsion et menaces ». Le CRIF a souligné le fait que les agresseurs étaient jeunes et que, « dans cette génération, la connotation antisémite des violences vient très vite, cela fait partie de leur fonds culturel ». Que les attitudes judéophobes se soient à la fois répandues et banalisées, c’est ce que révèle la remarque conclusive de la journaliste du Monde : « Dans la cité, les jeunes habitants ne comprennent effectivement pas l’émotion suscitée par cette agression1« 4. »
L’affaire Ilan Halimi nous donne une leçon que Léon Poliakov avait parfaitement formulée : « Ceux qui ne dénoncent pas l’antisémitisme sous sa forme primitive et élémentaire, au seul motif qu’elle est si primitive, devront affronter la question de savoir s’ils ne donnent pas secrètement leur approbation aux antisémites partout dans le monde, justement pour cette raison1« 5. » Comment les citoyens français et européens, ceux du moins qui sont conscients des effets dévastateurs de l’ethnicisation des rapports sociaux dans un contexte de fragmentation conflictuelle des États-nations que savent exploiter les stratèges islamistes, pourraient-ils avoir quelque raison de voir l’avenir en rosé ?
CHAPITRE 20 Guerre contre les « judéo-croisés » et droit de légitime défense
(p.485) La récente vague judéophobe en France, quelles que soient ses parti- / cularités nationales, n’est intelligible qu’à la condition d’être rapportée au contexte international spécifique dans lequel elle se déploie, celui d’une nouvelle guerre contre les Juifs et, plus largement, contre les «judéo-croisés », déclarée par les seuls islamistes radicaux, mais conduite avec le soutien de certains pays musulmans et la sympathie d’une partie de l’opinion du monde musulman, aussi divers soit-il. La « nouvelle judéo-phobie » est inséparable d’un nouvel anti-occidentalisme, qui prend le plus souvent la figure d’un antiaméricanisme aussi virulent que paranoïaque (son postulat étant que tous les malheurs du monde sont imputables, de près ou de loin, aux Américains et aux « sionistes »). Cette guerre ne se réduit pas aux attentats terroristes de grande envergure, dont le nombre a considérablement augmenté dans les années 20001. Cette guerre est notamment conduite sous la forme d’une guerre culturelle au sein des pays occidentaux par des prédicateurs proches des Frères musulmans ou des milieux wahhabites, souvent de tendance salafiste2, soutenus par une multitude d’associations pratiquant le prosélytisme. Leur objectif est d’abord d’empêcher l’intégration des populations issues de l’immigration par un endoctrinement islamiste les mettant à l’écart de la société globale (d’où l’importance du port du voile islamique), ensuite de favoriser la création de réseaux de soutien et de groupes de militants fanatiques prêts à tuer et à sacrifier leur propre vie pour la cause3. Pour comprendre la signification de ces comportements, il convient de rappeler leur cadre théologico-religieux, clairement résumé dans le 5e point du credo des Frères musulmans, entériné par leur IIIe congrès, en mars 1935 : «Je crois que le musulman a le devoir de faire revivre l’Islam par la renaissance de ses différents peuples, par le retour de sa législation propre, et que la bannière de l’Islam doit couvrir le genre humain et que chaque musulman a pour mission d’éduquer le monde selon les principes de l’Islam. Et je promets de combattre pour accomplir cette mission tant que je vivrai et de sacrifier pour cela tout ce que je possède4. »
La condition de toute action collective contre la « montée de l’antisémitisme » est, bien sûr, de reconnaître que l’intégration des jeunes issus de l’immigration peut et doit être améliorée. Car elle a en partie échoué5. Le chômage frappe massivement les jeunes Français issus de l’immigration maghrébine et africaine subsaharienne, soumis à des discriminations spécifiques (à l’emploi et au logement). Cette situation favorise la montée du (p.484) ressentiment (« C’est la faute de la France si… ») et sa traduction dans l’idéologie victimaire, qui enferme le sujet dans une alternative : la revendication haineuse ou la délinquance violente. Cette dernière s’est manifestée en France lors des manifestations lycéennes organisées à Paris, en particulier le 8 mars 2005, dont Luc Bronner, dans Le Monde, a fait un compte rendu scrupuleux, étranger au « politiquement correct ». Des lycéens, perçus comme des « Français de souche » à travers divers indices (couleur de la peau, habillement, etc.), ont été attaqués, tabassés et dévalisés par des « bandes de jeunes Noirs », « casseurs » et « cogneurs » venus de certaines banlieues parisiennes (Seine-Saint-Denis) et des quartiers nord de Paris6. Le journaliste du Monde a justement pointé dans ces actions violentes « un mélange de racisme et de jalousie sociale », dont témoigne ce programme d’action esquissé par la formule d’un « cogneur » : « Se venger des Blancs. » Un certain nombre de témoins, journalistes ou militants politiques, n’ont pas hésité, dans ce contexte, à parler de « racisme anti-Blancs » ou « anti-Français » (« francophobie ») et de « ratonnades anti-Blancs ». Ces expressions ont choqué certains milieux « antiracistes », et une polémique s’est déclenchée, montrant une fois de plus la fissure entre les organisations « antiracistes » pro-immigrationnistes (MRAP, Ligue des droits de l’homme) et les autres (parmi lesquelles la Liera s’est montrée la plus lucide).
(p.485) Depuis la fin des années 1980, les islamistes les plus avisés ont compris qu’ils étaient plus libres dans les pays démocratiques européens garantissant les libertés publiques que dans la plupart des pays musulmans. Pourquoi ne pas profiter de la tolérance dont font preuve les démocraties libérales/pluralistes, notamment en y pratiquant ce que Youssouf al-Qaradhawi, l’autorité suprême des Frères musulmans et plus largement, depuis le début des années 1990, du « Mouvement islamique » en Europe, appelle l’« ouverture sans fusion13 » ? La stratégie islamiste de l’inclusion différentialiste fait partie du projet d’islamisation en douceur de l’Europe, étape par étape. L’Europe est ainsi devenue une terre de conquête par le dialogue (« inter-religieux », bien sûr) et la séduction rhétorique, visant certains secteurs de l’opinion, en particulier l’électoral de gauche et d’extrême gauche, supposés sensibles à la cause palestinienne, l’un des principaux vecteurs de la propagande islamiste destinée à l’Occident. Dans le code culturel islamique auquel recourt Tariq Ramadan, l’Europe constitue un « espace de témoignage », distinct à la fois de la « demeure de la guerre » et de la « demeure de l’islam14 ». Mais la stratégie du « témoignage-dialogue » n’exclut nullement la pratique du Jihad lorsque certaines conditions sont favorables, en vue de réaliser des objectifs divers (terroriser les populations civiles, faire pression sur les gouvernements, entretenir le sentiment d’une menace, etc.). L’assassinat par un fanatique salafiste, le 2 novembre 2004 à Amsterdam, du cinéaste Théo Van Gogh a provoqué une prise de conscience, aux Pays-Bas comme en Belgique : la réalité de (p.486) la menace islamo-terroriste a été enfin reconnue15. Car les conditions d’une mobilisation et d’une radicalisation des milieux islamistes sont toujours là : imams radicaux prêchant lejihad dans certaines mosquées transformées en foyers fondamentalistes, sites Internet et émissions de radio appelant à la haine, diffusion de cassettes audio et vidéo, usage de ce matériel de propagande par des recruteurs jihadistes dans certains quartiers où ils sont concentrés, etc. Quant au programme politico-religieux des islamistes de toutes obédiences pour l’Europe, il peut être défini par l’islamisation progressive de l’espace européen, selon le plan des Frères musulmans qu’a récemment dévoilé un service de renseignements occidental. Mais cet objectif ainsi résumable : « De l’islam européen à l’Europe musulmane16 » n’est lui-même qu’une étape stratégique dans la vaste entreprise imaginée par les chefs de la confrérie des Frères musulmans : établir un « pouvoir islamique sur toute la terre » par tous les moyens, par l’infiltration dans tous les lieux de pouvoir, par la propagande et l’endoctrinement à travers la prédication, par l’alliance avec les combattants dujihad, et, s’il le faut, par la guerre17. Tel est le programme d’action exposé systématiquement dans un « rapport » anonyme en langue arabe, le « Projet », daté du 1er décembre 1982, qui a été découvert, lors d’une perquisition effectuée à la demande de la Maison Blanche après le 11 septembre 2001 à Campione, dans la villa de Youssef Nada, directeur de la banque Al-Taqwa, banquier et émissaire secret des Frères musulmans. Ce « rapport » est intitulé « Vers une stratégie mondiale pour la politique islamique (Points de départ, éléments, procédures et missions)18 ». Cette stratégie est celle du « Mouvement islamique mondial » dont l’objectif final est l’établissement d’un État islamique mondial à travers la multiplication des États islamiques. C’est dans cette perspective utopique que sont pensées l’islamisation de l’Europe et l’islamisation de la cause palestinienne.
Le « point de départ 11 » du « Projet » consiste à « adopter la cause palestinienne sur un plan islamique mondial, sur un plan politique et par le biais dujihad, car il s’agit de la clef de voûte de la renaissance du monde arabe d’aujourd’hui ». Ce « point de départ » à la fois particulier et essentiel est ainsi commenté, quant à ses « éléments », ses « procédures » et les « missions suggérées » : « Préparer la communauté des croyants au Jihad pour la libération de la Palestine. (…) Créer le noyau dujihad en Palestine (…) et le nourrir pour entretenir cette flamme qui va éclairer le seul et unique chemin vers la libération de la Palestine (…). Recueillir suffisamment de fonds pour perpétuer lejihad. (…) Lutter contre le sentiment de capitulation au sein de l’Oumma, refuser les solutions défaitistes, et montrer que la conciliation avec les Juifs porterait atteinte à notre mouvement et à son histoire. (…) Créer des cellules de Jihad en Palestine, les soutenir pour qu’elles couvrent toute la Palestine occupée. Créer un lien entre les Moudjahidines en Palestine et ceux qui se trouvent en terre d’islam. Nourrir le sentiment de rancœur à l’égard des Juifs et refuser toute coexistence. »
Ce programme rejoint celui de la branche piétiste des salafistes considérant l’Europe, « terre de mécréance », comme une « terre de pacte », au contraire de la branche jihadiste, qui la considère comme une (p.487) « terre de guerre », où le Jihad est licite19. Les attentats de Madrid, le 11 mars 2004 (191 morts), et ceux de Londres, le 7 juillet 2005 (56 morts), montrent, à la suite du méga-attentat du 11 septembre 2001, que les islamistes radicaux ont décidé de porter la guerre contre l’Occident au cœur même des pays occidentaux. La deuxième étape de ce programme d’islamisation de l’Europe, adapté à la situation nouvelle des années 2000, consiste à organiser le prosélytisme islamiste dans les prisons européennes, notamment françaises, lesquelles sont devenues l’un des principaux lieux de conversion ou de reconversion à un islam intégriste et de combat, compte tenu du grand nombre de détenus musulmans, dont les demandes spécifiques ne sont guère prises en considération20. Parallèlement, les organisations islamistes officielles et les islamistes les plus intellectualisés (du type Tariq Ramadan) s’efforcent de rendre acceptable une loi interdisant le blasphème au nom du « respect des croyances religieuses », manière de faire passer toute critique de l’islam, voire de l’islamisme, pour de l’islamo-phobie. Le principe de la liberté d’expression n’étant pour ses ennemis islamistes qu’une détestable invention de l’Occident moderne, un produit juridico-politique de la mécréance visant à légitimer les attaques contre l’islam, il faut le limiter par un principe contraire. Dans son sermon prononcé au Qatar et diffusé par Al-Jazira le 30 novembre 2000, Youssouf al-Qaradhawi réaffirmait que l’islamisation de l’Europe n’était qu’une étape sur la voie de l’islamisation du monde : « Avec la volonté d’Allah, l’islam retournera en Europe, et les Européens se convertiront à l’islam. Ils seront ensuite mieux à même de propager l’islam dans le monde, mieux que nous, les anciens musulmans. Tout cela est possible, pour Allah21. »
L’Europe est ainsi devenue un espace islamisable par divers moyens, dans l’esprit de nombre d’islamistes, dits modérés ou radicaux de diverses obédiences. La défense militante du port du voile islamique (hidjab) est l’un de ces moyens22, qui s’accompagne d’une violente dénonciation du « racisme » de l’Etat français ou de « l’islamophobie » de la société française, dans laquelle la loi interdisant le port des signes religieux dans l’espace scolaire est largement approuvée par l’opinion (76 % des personnes interrogées, selon un sondage réalisé au printemps 2004). Après les milieux « altermondialistes », infiltrés par les stratèges culturels islamistes, c’est au tour des mouvements antiracistes de faire l’objet d’une tentative de séduction et de canalisation. Certaines associations antiracistes ou de défense des droits de l’homme n’opposent aucune résistance à cette offensive : le MRAP, la Ligue des droits de l’homme et la Ligue de l’enseignement ont accepté de défiler « contre tous les racismes » avec des organisations islamistes le 7 novembre 2004 à Paris. Ces organisations « antiracistes » utilisent abusivement leur légitimité pour dénoncer comme « raciste » ou « islamolophobe » toute critique philosophique de l’islam – même dans ses dérives fondamentalistes – ou de pratiques dites musulmanes (concernant notamment les femmes), comme si seule une islamo-philie inconditionnelle était de mise. Il est bon de rappeler la ferme mise au point de l’écrivain canado-ougandaise Ershad Manji, auteur de Musulmane, mais libre : « Le racisme dont souffrent les musulmans en Occident n’est rien comparé à ce que les non-Arabes endurent dans le monde arabe.
(p.4488) Ici, on ne leur oppose pas d’obstacles. Au contraire : on n’a pas le droit de critiquer trop durement l’excision des femmes, parce que « c’est leur culture »23. » La stratégie politico-culturelle des islamistes est de multiplier les tribunes et les lieux d’influence, à travers des conférences-prêches, des meetings ou des manifestations dites « unitaires » (qui les respectabilisent). Autant de formes tactico-strategiques à travers lesquelles sont poursuivis les objectifs d’une « idéologie totalitaire d’infiltration », dont la fin dernière est l’établissement d’un « État islamique mondial », conformément à l’utopie politico-religieuse des Frères musulmans24.
(…)
Entre 2001 et 2007, une quinzaine d’imams étrangers ont été expulsés du territoire français en prévention du terrorisme islamique. Début novembre 2007, dix-sept imams expulsables. dont de nombreux salafistes et proches des frères musulmans, étaient toujours sur le territoire français. Sous le coup d’un arrêté ministériel d’expulsion pour des prêches radicaux ou des comportements susceptibles d’attenter à la sécurité nationale, ils bénéficiaient de la protection d’associations musulmanes influentes. On sait par exemple qu’Ilyes Hacene, imam salafiste suivi de près par les services de police, a prononcé nombre de prêches « soutenant les Moudjahidines et fustigeant Israël et les États-Unis ». Mais cet incitateur dangereux n’en est pas moins soutenu par la Mosquée de Paris et par l’Union des organisations islamiques de France (UOIF)26.
(p.489) En Allemagne, le ministre social-démocrate de l’Intérieur Otto Schily, dénonçant la « béatitude multiculturelle »é qui conduit à nier les problèmes (dont celui du terrorisme islamique), a déclaré en novembre 2004 que son gouvernement était en droit d’ « attendre de tous les musulmans en Allemagne qu’ils s’investissent activement contre les instigateurs de l’islamisme ».
(p.491) Dans un enregistrement audio mis en ligne le 2 avril 2008 par As-Sahab, Ayman al-Zawahiri s’en prend aux Nations-Unies, dénoncées comme « l’ennemi de l’islam et des musulmans », et prédit que la défaite des Américains en Irak ouvrira aux guerriers du Jihad la voie de Jérusalem : « Nous promettons à nos frères musulmans (p.492) que nous ferons de notre mieux pour frapper les Juifs, en Israël et à l’étranger, avec l’aide et l’assistance de Dieu51. »
(…) En décembre 2005, les Frères musulmans ont fait une percée remarquable aux élections. Il en est allé de même au Liban, où les électeurs ont fait entrer le Hezbollah au gouvernement. Ce qui n’a nullement empêché la milice islamo-terroriste, soutenue et surarmée par l’Iran et la Syrie, de lancer le 12 juillet 2006 une opération meurtrière contre des soldats israéliens, provoquant ainsi la seconde guerre du Liban (12 juillet-14 août 2006). Les antisionistes radicaux occidentaux n’ont pas manqué de dénoncer l’intervention israélienne et de chanter les louanges du Hezbollah, pour sa « résistance héroïque » à l’armée israélienne. En visite au Liban début janvier 2008, Norman Finkelstein, connu pour sa dénonciation de « l’industrie de l’Holocauste », a rencontré Nabil Kaouk, commandant du Hezbollah pour le Sud-Liban, avant de déclarer lors d’une conférence de presse : «Je pense que le mouvement Hezbollah représente l’espoir. Ils combattent pour défendre leur patrie52. » La victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes, en janvier 2006, confirme le dynamisme de la vague islamiste dans le monde musulman53. C’est donc par les urnes que s’impose en douceur le totalitarisme islamiste. C’est que la démocratie, comme système fondé sur des élections libres, ne suffit pas à garantir la liberté, et qu’elle a des effets pervers : même quand elle fonctionne bien, non seulement elle n’empêche pas la victoire de mouvements hostiles à la démocratie pluraliste, mais elle peut encore, en leur conférant une légitimité politique, contribuer à l’expansion des mouvements de type totalitaire. Aurait-on oublié la manière dont Hitler s’est approprié le pouvoir en Allemagne ? C’est par des élections libres que le démagogue bavarois est devenu le Fùhrer du Troisième Reich. Il faut parfois défendre la liberté contre les effets pervers de la liberté.
(p.493) Le grand romancier algérien Boualem Sansal rappelait judicieusement, en janvier 2008, que l’efficacité de la lutte contre l’islamisme tient à la mobilisation des musulmans eux-mêmes, éclairés par leurs théologiens et leurs intellectuels. Or les premiers se taisent et les travaux des seconds n’ont guère d’écho dans les masses musulmanes. Le tableau qu’offre la triste réalité présente du monde arabo-musulman suggère une vision pessimiste des évolutions futures : « La lutte contre l’islamisme, matrice du terrorisme, réclame un engagement des musulmans et de leurs théologiens. Il leur revient de sauver leur religion et de la réconcilier avec la modernité, faute de quoi l’islam finira par n’être plus que l’islamisme. Mais le danger dans les pays arabes et musulmans est tel qu’aucun théologien n’ose entreprendre ce nécessaire travail d’ijtihad. Et les intellectuels qui s’y emploient avec talent dans les démocraties occidentales (Soheib Bencheikh, Malek Chebel, Mohamed Arkoun, Abdelwahab Meddeb…) ne sont guère entendus dans nos pays. Mon humble avis est que l’islam a déjà trop pâti de l’islamisme et du nationalisme arabo-musulman, je ne vois pas comment il pourrait reprendre le chemin des Lumières qui jadis fut le sien54. »
(…) il convient de ne point exclure du champ des possibles cette vision d’un avenir sombre : la double montée en puissance du courant neutraliste européen et du parti de la capitulation devant le terrorisme islamique, fêtant leurs fiançailles sur les ruines des liens transatlantiques et l’abandon d’Israël. C’est pourquoi aussi il importe d’inscrire la lutte contre la judéo-phobie mondialisée dans le cadre de la lutte contre la nouvelle menace globale : l’islamisme international. Ce dernier ne se réduit pas aux actes « 7 terroristes que ses stratèges médiatisent mondialement avec habileté, il . mène une guerre culturelle faisant feu de tous bois. Le combat contre J l’islamisme radical doit être pluridimensionnel et sans compromis56. L’attitude frileuse des élites politiques et intellectuelles, en Europe, face aux mobilisations violentes initiées par les milieux islamistes exploitant le malaise provoqué par la publication des caricatures de Mahomet, montre que s’est insensiblement imposée la logique « plutôt verts que morts ». Dans un discours prononcé le 26 novembre 1938, quelques jours après la « Nuit de cristal » (9-10 novembre) organisée par les nazis, Léon Blum faisait remarquer à ses contemporains tentés par l’« esprit munichois » : « II n’y a pas d’exemple dans l’histoire qu’on ait acquis la sécurité par la lâcheté, et cela ni pour les peuples, ni pour les groupements humains, ni (p.494) pour les hommes57. » Cinq ans plus tôt, après la prise du pouvoir en Allemagne par les nazis, Joseph Goebbels s’était publiquement réjoui en tenant ces propos ironiques : « Cela restera toujours l’une des meilleures farces de la démocratie que d’avoir elle-même fourni à ses ennemis mortels le moyen par lequel elle fut détruite. »
L’aveuglement de la démocratie allemande n’est plus de saison. C’est la faiblesse et la pusillanimité de la communauté internationale – et de l’Europe au premier chef – qui, aujourd’hui, renforcent le camp des ennemis de l’Occident démocratique, au premier rang desquels apparaît l’Iran totalitaire, suivi par les réseaux protéiformes d’Al-Qaida. La sous-estimation de l’ennemi est l’opium des sociétés démocratiques. Face aux nouvelles menaces, nous devons conserver à l’esprit la remarque ironique de Goebbels, qui vaut comme un avertissement. Le devoir des défenseurs de la liberté n’est-il pas aujourd’hui de tout faire pour qu’un leader islamiste, après avoir pris le pouvoir dans un pays occidental, ne puisse un jour prochain se permettre de lancer de tels sarcasmes contre les démocraties libérales ? Il faut imaginer l’impensable pour se donner les moyens d’éviter qu’il ne se réalise.
CONCLUSION
Occidentalisation polémique des Juifs et nouveau régime de judéophobie
(p.495) Dans le vieil antisémitisme à base ethno-raciale, le Juif était perçu * comme un « Asiatique » ou un « Oriental » particulièrement menaçant, donc comme un type racial étranger et hostile à toutes les nations européennes, et, plus largement, à la civilisation occidentale ou chrétienne. Il s’agissait de le mettre à part, ou de le chasser des pays où il était censé vivre en étranger prédateur. Dans l’imaginaire « déracialisé », donc « post-antisémite », de la nouvelle judéophobie, le Juif est « désorientalisé », « désasiatisé » ou « désémitisé », et corrélativement « occidentalisé », pour être finalement désigné comme l’ennemi de tous les peuples (première figure) ou bien comme l’ennemi de la libération des peuples (deuxième figure) ou encore comme l’ennemi de l’islam et des musulmans du monde entier (troisième figure).
(p.496) Toutes ces accusations convergent vers une conclusion qu’on peut ainsi formuler : le peuple juif est un intrus dans le genre humain. Dans le vieil antisémitisme, les Juifs faisaient figure d’intrus dans les nations européennes, de peuple en trop venu d’Orient, sans territoire, au sein de l’Occident chrétien. Amalgamés avec les Occidentaux, ils sont désormais traités comme des intrus au Moyen-Orient et, plus largement, dans la société mondiale. Doublement diabolisés en tant que « sionistes » et Occidentaux, ils sont rejetés comme le peuple en trop par excellence – ce que traduit la rumeur qu’Israël serait un État en trop. Un État-monstre, le seul à être supposé tel. Telle est la nouvelle matière symbolique exploitée depuis près d’un demi-siècle par les ennemis, déclarés ou non, des Juifs.
(…) Dans ses Remarques mêlées, Ludwig Wittgenstein ne cachait pas sa perplexité face à l’antisémitisme : « Si tu ne peux démêler une pelote, le plus sage est de le reconnaître ; et le plus honorable, de l’admettre. [Antisémitisme.] Ce que l’on doit faire pour guérir le mal «’est pas clair. Ce que l’on ne doit pas faire est clair cas par cas2. » Mais seul un esprit instruit par les enseignements ambigus du passé peut être véritablement attentif à I ce qui survient sans avoir été prévu.
(p.498) CHAPITRE PREMIER L’islamisme et ses ennemis : Juifs et « Croisés »
- Voir Matthias Kiintzel, Jihad and Jew-Hatred : Islamism, Nazism and thé Roots of 9/11, tr. améric. Colin Meade, préface de Jeffrey Herf, New York, Telos Press Publishing, 2007 (lre éd. allemande, Fribourg, 2002). À travers différentes études de cas (Hassan al-Banna et les Frères musulmans, le « Grand Mufti » de Jérusalem – le pro-nazi Haj Amin al-Husseini -, Sayyid Qutb, etc.), Kùntzel montre comment dans le monde arabo-musulman, sous l’influence du nazisme et avec l’aide (notamment financière) des nazis, l’idéologie islamiste s’est formée, donnant naissance à la fois à la vision jihadiste de l’islam et à sa définition de l’ennemi absolu, le Juif (ou le «judéo-maçon »), l’Occidental moderne (libéral, démocrate, adepte de la laïcité ou partisan de la sécularisation) ou encore le «judéo-croisé », amalgame polémique du même type qu’« américano-sioniste ». Dans la même perspective, voir David Dalin, Pie XII et les Juifs. Le mythe du pape d’Hitler [2005], tr. fr. Claude Mahy, Perpignan, Éditions Tempora, 2007, p. 185-211 (chap. 6 : « Le Mufti d’Hitler : l’antisémitisme musul-man, et l’incessante guerre islamique contre les Juifs »).
(p.504) 82. Avant de lancer une attaque aérienne contre des cibles syriennes non identifiées, le 6 septembre 2007, les forces d’élite israéliennes auraient saisi du matériel nucléaire nord-coréen au cours d’un raid dans une base militaire secrète située au nord-est de la Syrie. Voir Corme Lesnes, « Interrogations à Washington sur des activités nucléaires nord-coréennes en Syrie », Le Monde, 18 septembre 2007, p. 4 ; « Israël a saisi du matériel nucléaire nord-coréen en Syrie » (d’après AFP), Le Soir en ligne, http://lesoir.be/actualite/monde/, 23 septembre 2007.
(p.506) 112. Robert Faurisson, Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’Histoire. La question des chambres à gaz, précédé d’un avis de Noam Chomsky, Paris, La Vieille Taupe, 1980 (achevé d’imprimer en novembre). Sur l’affaire Chomsky déclenchée par cet acte de cautionnement, voir Pierre Vidal-Naquet, Les Juifs, la mémoire et le présent, Paris, François Maspero, 1981, p. 280-289 ; Wemer Cohn, Partners in Hâte : Noam Chomsky and thé Holocaust Deniers, Cambridge, MA, Avukah Press, 1995 (en ligne : http://wernercohn.com/Chomsky.html) ; là., « Chomsky and Holocaust Déniai », m Peter Collier and David Horowitz (eds), The AntiChomsky Reader, San Francisco, Encounter Books, 2004, p. 117-158.
(p.512) 172. Lettre en ligne sur le site Internet de Radio Islam, dirigé par l’islamiste et négationniste Ahmed Rami, qui diffuse aussi bien les Protocoles des Sages de Sion que les écrits de Robert Faurisson et de ses disciples, sans oublier La Question juive de Marx ni Le Juif international, recueil d’articles antijuifs attribués à Henry Ford (en fait, rédigés par ses proches collaborateurs et les journalistes de son hebdomadaire antijuif, The Dearborn Independent, de mai 1920 à janvier 1922). Rami est un admirateur de celui qu’il appelle le « grand militant mujahid Roger Garaudy ». Voir Pierre-André Taguieff, Prêcheurs de haine, op. cit., p. 88-89, 475 (note 23), 780-781 (et note 428), 786-787 ; Laurent Duguet, « La haine raciste et antisémite tisse sa toile en toute quiétude sur le Net », Les Études du Crif, n° 13, novembre 2007, p. 10-13.
- Voir le compte rendu qu’en a fait Nicolas Weill dans Le Monde daté du 20 avril 1996 : « L’abbé Pierre soutient les aberrations négationnistes de Roger Garaudy ».
(p.630) 419. Bruno Guigue, « Quand le lobby pro-israélien se déchaîne contre l’ONU », http:// www.oumma.com/, 13 mars 2008. À la suite de la diffusion de cet article, son auteur, sous-préfet de Saintes (Charent-Maritime), a été limogé par le ministre de l’Intérieur, le 19 mars 2008, pour avoir enfreint son devoir de réserve. Voir Le Monde, 25 mars 2008, p. 10 : « Sous-préfet limogé le 19 mars, M. Guigue écrivait depuis 2006 sur le site oumma.com ».
(p.644) 6. Gerald B. Winrod, 1940 ; cité par Charles Y. Glock and Rodney Stark, Christian Beliefs and Anti-Semitism, New York et Londres, Harper and Row, 1966, p. 107. Le révérend Winrod (1900-1957), directeur d’un journal antisémite significativement titré The Defender (allusion à son organisation « Les Défenseurs de la Foi chrétienne », créée en 1925), qui comptait près de 110 000 abonnés réguliers, fut, dans 1’entre-deux-guerres, un diffuseur très actif des Protocoles des Sages de Sion et un prédicateur dénonçant inlassablement la « conspiration judéo-communiste ». Il est notamment l’auteur d’une brochure intitulée The Truth About the Protocols (1933), indéfiniment rééditée aux États-Unis par les milieux d’extrême droite, et plus particulièrement par les chrétiens fondamentalistes ; en ligne : http:// www.biblebelievers.org.au/truth.htm. Il affichait son admiration pour Hitler, qu’il comparait à Luther. Au milieu des années 1930, il résuma ainsi sa position vis-à-vis du nazisme ; « De tous les pays européens, l’Allemagne est le seul qui a eu le courage de défier l’occultisme maçonnique juif, le communisme juif et la finance internationale juive » (cité par Norman Cohn, Histoire d’un mythe, op. cit., p. 235). Voir Peter R. D’Agostino, « Winrod, Gerald B. », in Richard S. Levy (éd.), Antisemitism : A Historical Encydopedia…, op. cit., vol. 2, p. 772-773.
(p.664) 18 Jacques Chirac, par exemple, au moment où les banlieues étaient embrasées par la flambée de judéophobie liée aux débuts de la seconde Intifada, n’a pas hésité à déclarer à un éditeur juif : « Cessez de dire qu’il y a de l’antisémitisme en France. Il n’y a pas d’antisémitisme en France » ; http://www.amitiesquebec-israel.org/textes/antisemfr.htm. En 2004, Raymond Barre a également fait des déclarations publiques allant dans le même sens (voir infra, chap. 19). Ce déni de réalité a pris des couleurs « scientifiques » après que le journal Le Monde eut décidé de titrer d’une façon trompeuse une étude nuancée de Nonna Mayer, concernant les seuls sondages d’opinion : « La France n’est pas antisémite » (Le Monde, 4 avril 2002). Voir Pierre-André Taguieff, Prêcheurs de haine, op. cit., p. 228-229. Cet article était le texte abrégé d’une intervention de Nonna Mayer faite lors d’une table ronde organisée à Paris le 19 mars 2002, et qui portait le titre tout différent : « Nouvelle judéophobie ou vieil antisémitisme ? ». Elle y discutait notamment, comme il se doit, les thèses que j’avais présentées dans mon livre La Nouvelle Judéophobie, publié deux mois auparavant. Cet article, dont le contenu n’est nullement résumé par son titre, est devenu la référence rituellement citée
par tous les « dénégateurs » de la vague judéophobe en France. Voir par exemple Pierre Tévanian, La République du mépris. Les métamorphoses du racisme dans la France des années Sarkozy, Paris, La Découverte, 2007, p. 23.
3 Documents
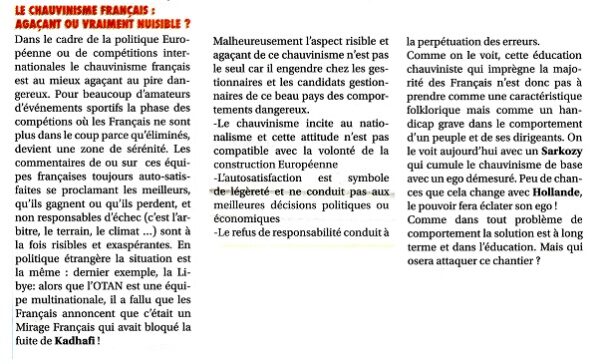
Le chauvinisme français : agaçant ou vraiment nuisible?
(UBU, 19/11/2011)
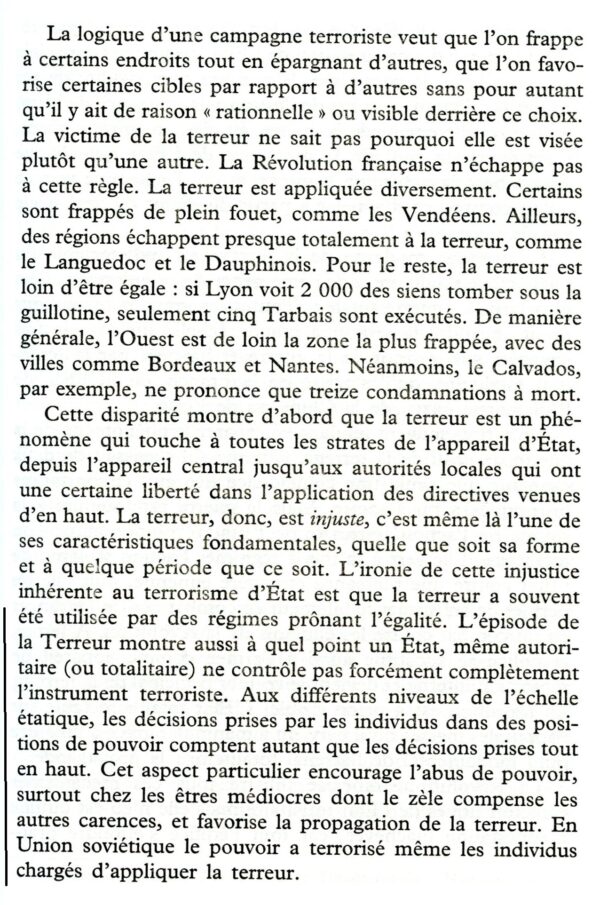
L'origine française du terrorisme: la Terreur
(in: Chaliand Gérard, Blin Arnaud, éd., Histoire du terrorisme, éd. Fayard, 2015, p.139-


La France et une partie de ses colonies
4 Couvertures de livres consultés