Elsass-Lothringen, l’Alsace-Lorraine, colonies de la France…
Elsass-Lothringen, von Frankreich kolonisiert
Alsace-Lorraine, French colonies
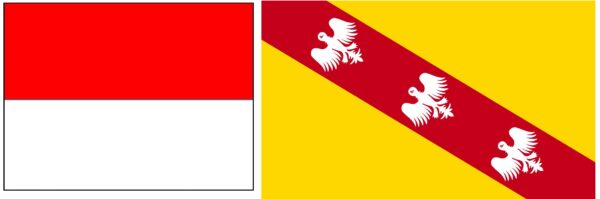
das Elsass / Lothringen : Flaggen - L'Alsace / la Lorraine : drapeaux
PLAN
1 Analyses
1.0 Histoire méconnue de l’Alsace-Lorraine
1.1 Annexion à la France, état centralisateur : la fin d’une certaine autonomie
1.2 Destruction de l’Alsace-Lorraine par la France
1.3 La réalité alsacienne : germanique
1.4 Le racisme français anti-alsacien-lorrain : toujours d’actualité
2 Documents
1 Analyses
1.0 Histoire volontairement méconnue de l’Alsace-Lorraine


|
Prof. Alfred de Zayas (Geneva School of Diplomacy) (Geneva, Switzerland), An English connection?, Newsweek July 2, 2007, p.16
“France, that again wanted to grab Alsace-Lorraine, which had been taken from the Holy Roman Empire by successive French wars of aggression, and which Germany had recovered in 1871 (…)
|
|
1210 |
René Lasne, Anthologie de la poésie allemande, 1, éd. Marabout, 1967
Gottfried von Strassburg (+- 1210) fait partie de la sphère littéraire allemande.
|
1300s |
Eine elsässische Befreiungsfront, Europa Ethnica, 2/1976, p.65: EL-Front autonomiste de libération
Guerre d’identité mais pas paix religieuse, GEO, 124, 1989, p.134-137 (p.134) “La grande époque de la prospérité alsacienne, dont le moindre ancien village porte la marque, date du Moyen Age à son déclin et de la renaissance. Elle fut la conséquence de l’union que firent dix villes indépendantes en 1353-1354 et qui prit le nom de Décapole. Le chef du Saint Empire de nation germanique, Charles IV, lui accorda son patronage et les belles années commencèrent. Le Saint Empire, dont Voltaire a bien eu tort de se moquer et que Napoléon n’avait pas dû détruire, respectait la diversité des lois et des coutumes locales, il ignorait l’étatisme centralisateur. C’est ainsi qu’à Sélestat, ville de la Décapole, “on comptait plus de savants que le cheval de Troie n’avait enfermé de guerriers”.
|
1789- |
Jo Gérard, Histoires d’Alsace: 1. Le chevalier Erwin de Steinbach, s.d.
On mesure mal, aujourd’hui, le degré d’aboutissements de certains révolutionnaires de 1789. A Liège, le peintre Léonard Defrance, littéralement enragé, exigea et obtint la destruction de la cathédrale Saint-Lambert. A Strasbourg, le sinistre Saint-Just et son ami Lebas donnèrent, en 1793, l’ordre d’abattre les superbes statues de la cathédrale. Mais un Alsacien, …, le professeur Jean G. Hermann, réussit à faire enlever ces chefs-d’oeuvre.
|
1815- |
Bernard Vogler, Catholiques et protestants entre deux langues et deux nations de 1815 à 1945
(univ. De Strasbourg 2) (p.21 sv.) « L’Alsace est un pays germanique annexé à la France de 1648 à 1681. » (p.21)
|
1870- |
Guy Héraud, In memoriam, in : Europa Ethnica, 2-3/1988, p.134
Pierri Zind (1923-1988) Professeur à l’Institut des Sciences de l’Education (Université de Lyon II). « Elsass-Lothringen, une nation interdite, 1870-1940 », Copernic, Paris, 1979. Livre largement étouffé, de même que son résumé, « Brève histoire de l’Alsace », Albatros, Paris, 1977.
|
1870- |
Pierri Zind, Elsass Lothringen, Alsace Lorraine, 1870-1940, s.d.
(p.1) “Les nombreuses sociétés d’histoire qui couvrent l’Alsace abordent “avec délices” la préhistoire et l’archéologie, l’époque romaine, le Moyen Age et les temps contemporains, mais elles évitent soigneusement de dépasser la barre fatidique de 1871. Au-delà, et jusqu’ en 1940, c’est le silence, un silence voulu ou imposé, le silence du refoulement: il n’ est pas honnête d’en parler, et encore moins d’ écrire sur un tel sujet!”
(p.17) “Jadis durant un millénaire “Herzland des Heiligen Römisches Reiches Deutscher Nation” (p.18) (p.29) Les activités pro-français de la mystérieuse ligue d’Alsace créée en 1871 par Gambetta (généreusement financée par la France). – Selon la li constitutionnelle pour l’Alsace-Lorraine ou Verfassungsgesetz, adoptée par le Reichstag en 1911, (p.35) “le § 26 imposait dans l’administration et dans l’enseignement la langue allemande dans les régions germanophones et la langue française dans les ragions francophones. Un modèle de respect des identités linguistiques que la France jacobine ignore!” Dans l’esprit revanchard: (p.43-44) “Publication en 1912 d’ouvrages aussi partiaux qu’haineux tels que les Histoires de l’oncle Hansi / destinées aux petits enfants d’Alsace et de France/ avec des subventions accordées par Raymond Poincaré. et des tournées de conférence dans les lycées et les collèges français – directeurs de revue: “C’est surtout lors des 2 offensives d’août 1914 que les militaires français s’emparèrent de nombreux otages:” des milliers de personnes. – en 1914-1918: déportations par ce qu’elles ne parlaient pas français ou le parlaient mal. et vice versa dans la partie francophone de l’ Alsace-Lorraine. (p.55) “Les Français comme les Allemands exerçaient des représailles;” (p.60-61) “Le désir profond de l’Alsace-Lorraine de devenir un Etat fédéré allemand de plein droit se heurtait à une double opposition: celle de la France assimilatrice, d’ une part, celle de l’ Allemagne méfiante d’ autre part.”
L’après 14-18: (p.110-111) Le racisme français: l’idée raciste de répartir les Alsaciens-Lorrains en 4 races suivant 4 modèles de cartes d’ identité, la carte Modèle A, barrée aux couleurs tricolores, remise aux habitants dont les parents et les grands-parents étaient nés en France ou en Alsace-Lorraine, la carte Modèle B, barrée de 2 traits rouges, imposée aux habitants dont un des membres de la famille était d’ une origine dite étrangère, c-à-d. non française et non alsacienne-lorraine, la carte Modèle C, barrée de 2 traits bleux, attribuée aux Alsaciens-Lorrains dont les 2 branches maternelles et paternelles étaient originaires de pays alliés à la France ou resté neutres durant la guerre de 14-18. La carte Modèle D, sans aucune barre de couleur, réservée aux “étrangers des pays ennemis”, aux descendants d’Allemands, d’Autrichiens,; de Hongrois ou d’autres peuples des Empires centraux, “Cette carte D revenait aussi à leurs enfants, même s’ ils étaient nés depuis 1870 en Alsace-Lorraine.” – disloquer les régions et surtout les familles
(p.168) On se mit à baptiser les rues et les places publiques en les affublant de noms choisis sur la liste des nouveaux vainqueurs ou de traductions stupides, telle la rue Knobloch, du nom de la célèbre famille des imprimeurs strasbourgeois aux XVe et XVIe siècles, devenue la rue de l’Ail. Beaucoup de noms de communes furent déformées ou traduites en français.”
Du jour au lendemain, les jeunes Alsaciens-Lorrains durent subir les cours en français alors que pour 90 % d’entre eux, la langue française était complètement étrangère, selon le journal socialiste Die freie Presse en 1920.
On eut tôt fait d’importer de nombreux fonctionnaires des Postes et du réseau de Chemin de Fezr d’Alsace-Lorraine, ignorant l’allemand parlé là-bas.
La division de l’Alsace-Lorraine en 3 départements à partir de 1919. “Ainsi se trouvait le voeu de l’abbé Wetterlé en 1915: (p.146) Nous voulons que l’Alsace-Lorraine disparaisse pour se transformer en 3 départements qui ne se distingueront en aucune manière des 86 autres.”
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’était et n’est reconnu valable que s’ il joue en faveur des intérêts français.
Suite au traité de Versailles, des plébiscites d’autodétermination furent notamment organisés dans les cantons de Saint-Vith, Malmedy et Eupen, dans le Schleswig à la frontière danoise MAIS pas en Alsace-Lorraine.
ASSIMILATION
(p.155) “Culturellement, depuis la destruction systématique des langues et des dialectes des régions et des minorités ethniques, la France était appauvrie par un monolinguisme étroit. (p.156) Or, l’Alsace-Lorraine se voulait bilingue.” (p.157) “Confessionnellement, culturellement, économiquement, socialement et politiquement, l’Alsace-Lorraine différait de la France.” Tous les leviers de l’économie française se trouvent à Paris. Or, sous le régime allemand, l’Alsace-Lorraine possédait su place, à Strasbourg, d’une manière presque autonome, la gestion de son économie. (p.199) “L’administration française établit une discrimination intolérable entre les fonctionnaires indigènes et les fonctionnaires parachutés de l’Intérieur.’ Ces derniers se voyaient attribuer de confortables indemnités de séjour, de logement, de fonction, etc., à l’instar de ce qui se pratiquait pour les fonctionnaires coloniaux d’ Afrique ou d’Asie.”
(p.388-390) Dans les années 20 “L’étude d’ensemble de l’attitude nationaliste des évêques face aux revendications ethniques, tant dans les colonies que dans les états européens, reste à faire.” A cette époque, l’évêque de Bruges condamnait les autonomistes flamands, l’évêque de Quimper, les autonomistes bretons, et l’évêque de Strasbourg les autonomistes alsaciens-lorrains. Ils semblaient confondre leurs propres conceptions politico-religieuses avec l’Eglise, sans prendre conscience , tout au moins en France, du jacobinisme anti-chrétien et païen qui divisait les catholiques sur l’autonomie et qui véhiculait un “état d’ âme non catholique”.
(p.449) “En Alsace-Lorraine, …, il ne suffisait pas d’accepter d’être devenu Français sans avoir été consulté, il fallait encore aimer le conquérant victorieux de 1918, devenu oppresseur, ne point aimer la France, c’était une faute, un délit justiciable devant tribunal.”
(p.449) ‘Les tribunaux de la république française se sont mis au service de la politique nationaliste française, cherchant un moyen de verdicts démesurés à extirper jusqu’ à la racine les journaux qui notamment refusent de cautionner le grand mensonge d’une Alsace originellement française.’ Un représentant des maîtres du cadre local, autonomiste, au Conseil départemental de l’Instruction publique, fut arrêté en 1927 pour permettre la nomination du candidat gouvernemental. (p.454) ‘En 1918, en entrant à Strasbourg, le général Gouraud proclamait: “La France vient à vous comme une mère vers un enfant perdu, chéri et retrouvé. Non seulement, elle respectera vos coutumes, vos traditions locales, vos croyances religieuses, vos intérêts économiques, mais elle pansera vos blessures …” (pays toujours libéré pour être toujours opprimé — botte de Paris / de Berlin)
(p.455) Il fallait compromettre les autonomistes dans un « complot contre la sûreté de l’Etat ». Et les autorités gouvernementales françaises, leur Police spéciale et leurs journalistes nationalistes s’affairaient à en fabriquer laborieusement.
(le procès de Colmar en 1928) (p.462) Après la condamnation à un an de prison des autonomistes pacifiques accusés d’un complot imaginaire contre la Sûreté de l’Etat, la foule entonna le chant autonomiste d’ alors: “O Strassburg, o Strassburg, du wunderschöne Stadt!” (p.465) suppression des journaux écrits en allemand.
|
1871- |
Michel Krempper, Aux sources de l’autonomisme alsacien-mosellan 1871-1945, éd. Yoran, 2015
(p.14) Les accusations anciennes ont néanmoins la vie dure. A l’occasion des campagnes électorales, elles resurgissent périodiquement28. Encore 70 ans après, on voit revenir dans la presse ou dans les déclarations de certains jacobins le reproche fait aux « autonomistes alsaciens » – agrégés en un bloc indifférencié – d’avoir assisté le national-socialisme allemand dans ses actions criminelles : « l’autonomisme » aurait d’abord préparé souterraine- ment l’annexion de l’Alsace et de la Moselle au IIIe Reich et espionné pour son compte ; ensuite collaboré outrageusement avec l’occupant nazi entre 1940 et 1945 en facilitant ses crimes, comme l’incorporation de force. Sur ces thèmes, des historiens autoproclamés entonnent également le grand air de la calomnie. Ainsi Philippe Arnold titre l’un des chapitres de son Histoire secrète de l’Alsace « Préguerre et réannexion secrète : les autonomistes au service de l’Allemagne hitlérienne »29. Une autre, spécialiste de l’histoire romancée fait du Dr Roos un espion personnel de Joseph Goebbels, dont il aurait fréquemment partagé la table à Berlin pour ses comptes-rendus30. Sans le moindre début de preuve évidemment.
(p.31) Un sixième et dernier parti sera constitué spécialement pour les élections au nouveau Landtag par l’abbé Emile Wetterlé28, personnage trouble et ambigu. Ordonné prêtre en 1885, il est d’abord pendant cinq ans précepteur dans une famille princière à Rome avant de devenir, un court laps de temps, vicaire à Mulhouse en 1890. Puis il se lance dans le journalisme et la politique, constat étant fait par sa hiérarchie de son peu d’aptitude à la vie paroissiale. En 1898, le Kreis de Ribeauvillé l’envoie pour la première fois au Reichstag ; en 1900, il entre au Landesausschuft. D’une francophilie exacerbée et – selon ses nombreux ennemis – soutenu financièrement par les – agents du gouvernement français, il crée un parti autonomiste équivoque dont l’extrémisme devait fomenter une agitation irrédentiste en faveur de la France. Avec 24 de ses amis, parmi lesquels le Dr Pfleger, Jacques Preiss, depuis toujours opposé à « la germanisation de l’Alsace » et l’ancien démocrate anticlérical Daniel Blumenthal, l’abbé Wetterlé publie le 4 juin 1911 un Manifeste attaquant la nouvelle Constitution du Reichsland Elsass-Lo- thringens octroyée le 31 mai 1911. Selon lui, « elle représente dans son ensemble un recul. Nous sommes plus éloignés de l’autonomie qu’aupara- vant », prétend-il, pour justifier la fondation de l‘Elsass-Lothringische Nationalpartei (Parti national alsacien-lorrain), auquel est assigné un seul but officiel : « la création d’un État alsacien-lorrain autonome et de mêmes droits que les autres États fédérés, au sein de l’Empire allemand, dans lequel notre originalité alsacienne-lorraine pourra s’épanouir librement ».
(p.37) Avec cette Verfassung, sa Constitution de 1911, l’Elsass-Lothringen dispose d’institutions qui lui ont été octroyées. De sa propre initiative, elle va également se donner des symboles qui lui seront propres et suffisamment forts pour que l’esprit des Alsaciens en soit durablement marqué, au point que leurs traces perdurent encore aujourd’hui.
(p.51) Le Volksparlament76 du Reichsland EIsass-Lothringens n’aura connu qu’un seul président, le docteur Eugène Ricklin, par ailleurs porté plusieurs fois par les Alsaciens à la députation au Reichstag. Ignoré en France – où les marques de son souvenir ont été si systématiquement effacées qu’on a pu le dire « interdit de mémoire77 » pour son action politique de l’entre-deux- guerres -, il n’en fut pas moins « un des seuls hommes politiques alsaciens ae carrure internationale » (Bernard Wittmann), voire « le plus grand politique que l’Alsace ait connu » (Léon Kieffer)78. Il naît le 12 mai 1862 à Dammerkirch/Dannemarie de parents alsaciens et suivra le cursus classique pour des jeunes de sa génération issus des classes moyennes (son père est aubergiste) : études secondaires au collège de Belfort, puis aux lycées d’Altkirch et de Colmar, études supérieures en Allemagne : a Ratisbonne, puis Fribourg en Brisgau, Munich et Erlangen, où il obtient son titre de docteur en médecine. Revenu exercer dans sa Heimet79, il poursuit sa carrière médicale à Dannemarie de 1888 à 1910, puis à Carspach-Sonnenberg. Ricklin se voit proposer un poste de conseiller municipal de sa ville de Dannemarie, puis, ultérieurement, la mairie (1898). Deux ans plus tôt, il avait été désigné au Bezirkstag de Haute-Alsace (il en deviendra le président durant la guerre). En 1900, le Bezirkstag, l’envoie au Landesausschuss de Strasbourg. En 1903, il siège à Berlin au Reichstag, après avoir remporté les élections pour la députation dans la circonscription de Thann-Altkirch. Les autorités le détesteront vite pour son franc-parler. À la suite d’une plainte déposée contre lui pour offense au Kaiser et aussi pour le sanctionner d’avoir revendiqué le statut de Bundesstaat pour l’EIsass-Lothringen, l’administration allemande le destitue en 1902 de son poste de maire (il reste néanmoins membre du conseil municipal jusqu’en 1908). Ses relations avec les Allemands ne sont en effet pas des meilleures. Dans sa famille, on parle le français, qu’il a appris au collège de Belfort. Courageux, d’une grande intelligence et profondément humain, Ricklin ne cessera de se battre au nom de la justice et de la défense du peuple alsacien face à l’administration impériale ; ce qui lui vaudra le surnom80 Der sundgauer Leeb, le Lion du Sundgau. Il ira (p.52) jusqu’à refuser le Roten Adlerorden (Ordre de l’Aigle rouge), dont on voulait le décorer. En revanche, son autorité, sa droiture et ses compétences lui assurent, au sein de son parti, le Zentrum EL, le respect et la considération de ses collègues. De sorte qu’après les élections de 1911, il sera le candidat naturel des centristes à la présidence de la Seconde Chambre du Landtag. Il y accédera le 6 décembre 1911.
(p.59) La terre d’Empire créée sous Bismarck en 1871 devient ainsi le 26e État de plein droit de la Confédération germanique, bénéficiant de toutes les attributions d’un État souverain. Ce jour, tant attendu, est évidemment historique, puisque pour la première fois de l’histoire alsacienne, Elsass-Lothringen se voit reconnu un statut d’État souverain, dans toute son intégrité territoriale, assorti d’un gouvernement composé uniquement d’Alsaciens-Lorrains. Son souvenir restera amer car il intervient tard, beaucoup trop tard.
(p.64) À cet instant, le Docteur Ricklin est encore dans la plus totale illusion. Il se persuade que l’autonomie du Land pourrait être octroyée par une Conférence de la Paix à la suite d’un plébiscite probablement favorable, ce qui permettrait alors de négocier, d’État à État, sur un pied d’égalité, le rattachement du pays à la France de manière à sauvegarder toutes les libertés et toutes les valeurs ethniques du Volkstum Elsass-Lothringen. L’accord entre la France et l’Alsace-Lorraine serait ainsi garanti par tous les États réunis à cette conférence internationale. C’est avec ces sentiments et cet espoir que Ricklin franchit en cet après-midi du 12 novembre 1918 le seuil de la grande salle du Landtag où se réunit le tout jeune ElsaB-Lothringischer- National rat. Mais après son discours inaugural – très applaudi – dans lequel il justifie la légitimité des initiatives prises, n doit déchanter. Car les masques tombent : le président du Conseil national s’aperçoit brusquement qu’il a perdu la main et que les nouveaux maîtres du jeu sont le Lotnringer Block et les amis de l’abbé Nicolas Delsor, favorables au rattachement immédiat à la République française ! Au soir, ceux-ci s’en prennent violemment au président. Estimant qu’il n’était plus représentatif de l’opinion, ils le contraignent à démissionner de son poste de président du Verwaltungsausschuss, ce comité exécutif du Nationalrat. Ainsi Delsor uarvient à faire échouer la politique d’autonomie de Ricklin, tout comme Ricklin avait fait échouer la politique d’autonomie de Karl Flauss. Si bien que es adversaires de l’autonomie et les partisans du retour pur et simple à la France deviennent les maîtres du Conseil. L’abbé Delsor déclarera : « Nous sommes ici d’abord au nom de la souveraineté du peuple d’Alsace-Lorraine ; nous sommes les représentants de ce peuple, et au jour où l’Empire allemand a dû nous abandonner, il ne reste plus aucune autre souveraineté que la nôtre ; et en prenant en main la souveraineté du peuple, nous n’avons pris que ce dont on nous avait privé depuis 47 ans ». En renvoyant à 1871, Delsor signifie clairement que l’Alsace-Lorraine devait revenir à la France. Cependant, bien qu’éliminé de la présidence du Comité exécutif, le Docteur Ricklin reste toujours président du Conseil national. À ce titre, il mène une ultime tentative et provoque une nouvelle réunion de l’Assemblée dans l’après-midi du 13 novembre. Afin de neutraliser l’abbé Delsor, il a personnellement invité les anciens membres du gouvernement Schwan- der alors présents à Strasbourg, dont Karl Hauss. Mais Ricklin ne parviendra pas à renverser le cours des événements. Les ultra-francophiles contrôlent l’Assemblée et FHauss est empêché de s’exprimer. Delsor va jusqu’à l’accuser de malhonnêteté. Brisé, celui qui avait été député de Guebwiller au Reichstag depuis 1911, le chef et porte-parole du Zentrum EIsass-Lothringens au Reichstag durant sept années, l’ancien Staatssekretär du dernier gouvernement alsacien-lorrain quittera l’Assemblée aigri jusqu’à la fin de ses jours contre ses anciens collègues. Il n’obtiendra jamais la moindre réhabilitation officielle de la part de ses calomniateurs.
(p.65) Une lettre de Clemenceau au Haut-commissaire Maringer du 14 janvier 1919 – strictement confidentielle et non officielle – (et non pas adressée directement à Delsor pourtant toujours président de l’EIsass-Lothringischer-Nationalrat depuis l’éviction de Ricklin) marquera la fin de toutes les illusions. En tout cas, elle énonce sans ambiguïté la fin d’un Conseil national d’Alsace-Lorraine qui a perdu toute utilité dans le nouveau dispositif mis en place par les vainqueurs. Le président du Conseil mettra ainsi les points sur les « i ». Pour Zind, qui la cite intégralement107, « cette lettre révèle le frémissement du Tigre « tenant sa proie ». Clémenceau écrit en effet : « J’ai une satisfaction égale à constater que sur les trois points essentiels, l’accord est complet entre le gouvernement et les auteurs de la motion [en l’occurrence une motion transmise par Delsor le 19 décembre]. 1° On y écarte que le Conseil national puisse avoir aucune attribution législative. 2° On y repousse pour l’Alsace-Lorraine le privilège d’une autonomie, avec laquelle l’unité et l’indivisibilité de la nation française seraient incompatibles. 3° On n’y méconnaît pas la nécessité de faire (avec discernement, mais dès maintenant) évoluer certains services d’Alsace et de Lorraine vers le cadre départemental d’institutions françaises ».
/1918/ (p.73) Les « revenants12 » charriés dans les fourgons de l’armée française, Alsaciens émigrés généralement protestants ou juifs, presque toujours profondément laïcs et républicains, donc jacobins dans l’âme, méconnaissent totalement la réalité alsacienne, profondément religieuse, tenant par-dessus tout à son particularisme et au maintien de ses coutumes, promis d’ailleurs par les plus hautes autorités, Joffre dès 1914, Deschanel, puis les généraux de 1918. Militaires et fonctionnaires arrivés en Alsace fin 1918 ignorent tout de la région. Ceux qui croient la connaître se sont bâti des certitudes par les écrits, dessins, caricatures de Zislin, Wetterlé et surtout Hansi. Déçus, ils constatent qu’on est loin du « paradis tricolore ». Partout, on parle « boche » ! Incapables de distinguer le dialecte du Hochdeutsch, ils ignorent aussi que la langue des Alsaciens n’a pas été introduite après 1870, mais qu’elle est même antérieure à l’allemand standard13. Les responsables français se tournent donc plus volontiers vers les « revenants », parlant un français parfait, mais témoignant d’une incompréhension totale à l’égard des problèmes de leurs compatriotes restés sur place. Pour la plupart de ces « revenants », surtout ceux nés en France de I’ «intérieur », il faut fondre au plus vite l‘ex-Elsass-Lothringen dans le moule de la République14.
(p.74) Pour les Alsaciens-Mosellans, ce décret du 15 novembre 1918 constitue une extraordinaire régression. Il ramène l’ancien Reichsland EIsass-Lothringen 47 ans en arrière, pratiquement au régime de la loi allemande du 30 décembre 1871. Aussi grave : ce décret viole d’emblée l’article 5 de la convention d’armistice signée quatre jours plus tôt et oui prévoyait le maintien de l’administration locale sur la rive gauche du Rhin, cette administration locale devant passer à partir du 11 décembre sous le simple contrôle militaire. Par ce décret, la République française signifie donc clairement qu’elle ne reconnaît pas le Nationalrat constitué en novembre : à cette date, les troupes françaises n’ont pas encore fait leur entrée triomphale dans le Land Elsass-Lothringen et les généraux – le cas de Joffre en 1914 mis à part – pas encore proclamé leurs promesses solennelles. Comme aucune protestation sérieuse ne s’élève contre ces violations flagrantes de la convention d’armistice, Poincaré et Clémenceau signent dans la foulée un second décret, le 26 novembre 1918. Il abroge pratiquement (p.75) la Constitution du Reichsland, cette Constitution que les autonomistes avaient arrachée de haute lutte à l’Empire allemand en 1911. L’historien Pierri Zind, qui n’est pas juriste, exprime un étonnement justifié : un simple décret supprime une loi organique aussi importante qu’une Constitution’5 ? Par ce nouveau texte, ironiquement baptisé Novemberverfassung, Constitution de novembre, le Service général d’Alsace-Lorraine – constitué le 15 septembre 1918 autour de Clémenceau – reçoit pour mission de centraliser à Paris l’administration des trois commissaires de la République de Metz, de Colmar et surtout de Strasbourg. Dans la plus pure tradition centralisatrice française, décisions et responsabilités sont ainsi immédiatement monopolisées par la capitale. Retour en force du jacobinisme ! Violation de plus de l’article 5 de la Convention d’armistice et nouvelle marque de mépris à l’égard de l’ancienne terre d’Empire.
(p.76) 2. Les errements de la nouvelle administration française L’attribution inique des cartes A, B,C,D Les origines du racisme des temps modernes sont bien connues. On les trouve chez le comte Joseph-Arthur de Gobineau, dans son fameux Essai sur l’inégalité des races humaines (1854). Après lui, en France, dans les débuts ae la IIIe République, ce racisme prend rapidement une coloration politique. Il va alors servir à justifier la colonisation des vaincus, c’est-à-dire des races inférieures, par les vainqueurs, c’est-à-dire les races supérieures. Comme beaucoup de bourgeois impérialistes de son temps, le ministre Jules Ferry partagera l’idéologie raciste. Ne déclare-t-il pas à la Chambre des députés (le 28 juillet 1885) : « Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures… parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures » ? Mais l’idée raciste de répartir les Alsaciens-Lorrains en quatre groupes ethniques est à mettre au compte (déjà sinistrement chargé21) de l’abbé Émile Wetterlé, ex-député de Ribeauvillé au Reichstag et au Landtag, courageusement réfugié en Suisse en 1914, puis à Paris. Dès les 19 et 26 avril 1915, la Conférence d’Alsace-Lorraine avait adopté ses idées et ses suggestions : ainsi, au fur et à mesure que les troupes françaises pénètrent en Alsace-Moselle, elles distribuent immédiatement quatre modèles de cartes d’identité. Ces cartes sont officiellement instituées par l’arrêté ministériel du 14 décembre 1918. La carte Modèle A, barrée aux couleurs tricolores, est remise aux habitants dont les parents et les grands-parents étaient nés en France ou en (p.77) Alsace-Lorraine. Les détenteurs de la carte A se trouvaient volens nolens « réintégrés de plein droit ». La carte Modèle B, barrée de deux traits rouges, est imposée aux habitants dont un des membres de la famille était d’une origine dite étrangère, c’est-à-dire non française et non alsacienne-lorraine.
La carte Modèle D, sans aucune barre de couleur, est réservée aux « étrangers des pays ennemis », entendons par là aux descendants d’Allemands, d’Autrichiens, de Hongrois ou d’autres peuples des Empires centraux. Cette carte D revenait aussi a leurs enfants, même s’ils étaient nés depuis 1870 en Alsace-Lorraine ! Ces cartes d’identité ethniques vont jouer un rôle discriminatoire en de multiples occasions : pour l’établissement des listes électorales, bien évidemment, mais aussi dans la liberté de circulation : les cartes B et C n’autorisent à se déplacer que dans le Kreis de la résidence du titulaire et les Kreis limitrophes, la carte D consigne dans la commune. Seuls les titulaires de la carte A passent pour être français. La discrimination s’applique également pour l’échange de la monnaie allemande contre de la monnaie française. Contrairement à la Convention d’armistice, la France déclare illégale la monnaie allemande en Alsace-Moselle après le 15 décembre 1918 et elle impose la monnaie française. Or un porteur de la carte d’identité Modèle A échangera son mark contre 1,25 franc alors qu’un porteur de la carte Modèle D échangera son mark contre seulement 0,74 franc. Le premier touchera donc 125 francs pour 100 marks, tandis que le second devra se contenter de 74 francs. « Ce classement des Alsaciens-Lorrains en quatre catégories alimente d’autant plus l’inquiétude et le mécontentement que les mariages mixtes sont nombreux. Ainsi à Strasbourg, les cartes B – délivrées aux personnes dont l’un des parents est d’origine étrangère, pour l’essentiel des descendants de couples Allemands-Alsaciens – représentent près de 12% des cartes distribuées. » Selon les dénombrements effectués sur Strasbourg par François Uberfill, le tiers de la population de la ville était d’origine allemande avant la guerre. Ainsi les cartes D – délivrées aux étrangers d’origine allemande, autrichienne ou hongroise et à leurs descendants même s’ils sont natifs d’Alsace – représentent près du tiers des cartes. Notons que les trois quarts des couples « alsacien-allemande », la moitié des couples « allemand-alsacienne » et un quart des couples « allemand-allemande1 resteront finalement à Strasbourg22. »
(p.78) Le système raciste des Commissions de triage Toujours sur les conseils de Wetterlé, ce prêtre égaré par l’hyper-nationalisme, Clémenceau fait paraître dès le 2 novembre 1918, donc une semaine avant l’armistice, une instruction ministérielle ordonnant la création de « Commissions de triage » immédiatement après l’entrée des troupes sur le territoire ; le prétexte avancé est d’assurer la sécurité militaire, conformément à l’article 9 de la loi du 9 août 1849. Ces Commissions de triage seront de deux niveaux : de première et de deuxième instance. Selon une instruction de Jules Jeanneney, « les commissions ont été instituées pour examiner les Alsaciens et les Lorrains suspects, c’est-à-dire : les personnes qui ont montré des sentiments germanophiles ; qui ont fait des manifestations anti-françaises ; qui se sont livrées à des dénonciations ; qui ont prêté leur concours d’une manière blâmable à nos ennemis avant la guerre ou durant les hostilités… ; qui ont accepté des grades dans l’armée allemande dans des conditions qui peuvent faire suspecter leur loyalisme23 ». Bref, il s’agit d’interner ou d’expulser les suspects et les indésirables. Au total, 300 commissions seront réunies. Les Commissions de triage de première instance sont présidées par un officier du service d’espionnage et comprennent un collaborateur alsacien-mosellan désigné par l’administration militaire et deux autres Alsaciens ou Mosellans, réfugiés en France durant ou avant la guerre, et déjà membres des commissions chargées des camps de prisonniers et des camps d’internement français. Cette première Commission fournit un rapport à une Commission de triage de deuxième instance, pratiquement secrète ; il appartient à elle seule de proposer les expulsions et les internements au Commandement militaire des troupes d’occupation françaises, constitué autour du général d’état-major Pettolat. Un officier intègre, membre de cet état-major, jugera ainsi ses collègues. « Ces Messieurs, aussi ignorants de l’Alsace que j’eusse le droit de l’être de la Catalogne, se croyaient positivement en pays ennemi. Ils ne parlaient que d’arrestations, d’expulsions, etc. et se considéraient comme des justiciers vis- à-vis des Alsaciens n’ayant pas cru fermement dans les dernières années de la guerre à la Revanche… Ils ne comprenaient rien aux vicissitudes des pays de Marche, ni à la nécessité pour certains Alsaciens pourvus de fonctions publiques de faire, je dirais, gros dos devant les exigences de leur situation… Un Ricklin était un traître ne. Dans la famille du baron von Bülach, il fallait faire de tous les membres un fagot uniforme et le jeter au feu24… » (p.81) Sur le terrain, les deux principaux responsables de ces expulsions sont l’officier d’état-maior du général Gouraud, le général Vandenberg, et le haut-commissaire Maringer, surnommé « la grande ganache ». De novembre 1918 à septembre 1920, 111 915 personnes sont brutalement obligées de quitter l’Alsace-Moselle ; environ 15 000 en décembre 1918 et janvier 1919 ; puis de février 1919 à septembre 1920, 29 083 hommes, 29 492 femmes et 36 840 enfants, auxquels il faut ajouter environ 1500 Feldgrau qui préféreront rester en Allemagne et qui ne rentreront pas dans leurs foyers. Or après 1870-1871, les Allemands n’avaient strictement expulsé personne ! Jusqu’au 1er octobre 1872, tout Alsacien-Lorrain pouvait choisir entre la citoyenneté française et allemande. Tous les « optants » pour la France étaient partis de leur plein gré. Bien plus, ceux qui avaient opté pour la France avaient dû tranquillement rester dans leur Heimet avec le statut légal d’étrangers. De ce comportement inauguré par les autorités de la IIIe République en Alsace-Moselle après la fin de la Première Guerre En considérant aujourd’hui ces événements d’il y a un siècle avec le recul nécessaire, la grande majorité des historiens reconnaissent « ce qu’il y eu d’odieux à chasser de leur propre pays des Alsaciens-Mosellans que le traité de paix signé à Versailles allait reintégrer dans leur nationalité française, cela uniquement parce qu’ils avaient peut-être manifesté quelque servilité à l’égard du gouvernement allemand, dont ils étaient les fonctionnaires, parce qu’ils avaient misé sur le mauvais cheval et pavoisé, avec plus ou moins d’enthousiasme, à l’annonce des victoires allemandes. Et que s’est-il passé ? Les dénonciations pleuvaient, émanant des gens les moins recommandables qui, pour se venger d’un ennemi personnel, pour se débarrasser d’un créancier gênant ou d’un concurrent, parfois tout simplement pour faire oublier leur propre passé, se livraient à la plus misérable délation33 ». À la suite des troupes françaises, des bandes de « patriotes français » parcourent (p.82) les rues des villes, pillent les magasins des uns, baissent le rideau métallique des autres en leur interdisant tout commerce. Chaque magasin doit afficher la nationalité de son propriétaire ; les firmes qui avaient exploité le privilège de fournir la Cour impériale du Kaiser se hâtent de faire de la surenchère patriotique et apposent de grands placards tricolores : « Maison essentiellement française » ! Durant Ta dictature militaire prussienne de 1914-1918, parler français était jugé séditieux. Sous la dictature patriotique d’après 1918, parler en Hochdeutsch n’est pas moins suspect. Plus tard, des journaux seront même interdits au motif qu’ils sont publiés en langue allemande, qui est pourtant la transcription écrite du dialecte. Au mépris de la Convention d’armistice et de la plus élémentaire justice, les expulsés ne peuvent emporter que 30 kg de bagages et une somme d’argent strictement limitée, au demeurant fortement ecornée par le change discriminatoire. À Strasbourg, les victimes doivent, en colonne et à pied, parcourir le chemin jusqu’au pont de Kehl. Les « patriotes français » qui constituent des « Comités d’accueil » les y attendent : femmes hystériques, voyous payés par les « Nationaux » qui injurient les expulsés, leur crachent au visage, leur lancent des immondices. Dans la Strassburger Neue Zeitung du 3 décembre 1918, un certain Haniel, spectateur sadique et cynique, étalera sa joie perverse en rapportant ces pratiques quotidiennes. À Colmar on expulse en camions militaires. Les Altdeutsche, qui pendant ce demi-siècle écoulé s’étaient entièrement identifiés aux Alsaciens et avaient souvent fondé des familles avec eux, sont rassemblés dans la cour du Cercle Saint-Martin. S’y trouve l’un des plus haineux « grands patriotes », Jean-Jacques Waltz, le fameux mais funeste « oncle Hansi », dont la production littéraire et artistique avait entretenu l’esprit revanchard français. Il préside aux opérations et « excitait des bandes de jeunes gamins irresponsables à hurler des chansons injurieuses à l’adresse des victimes. Ainsi, parmi les malheureux, une femme avec un nouveau-né dans les bras voulut lui donner du lait, lorsqu’une furie se précipita sur elle, arracha le biberon des mains de la mère, en versa le contenu sur le sol en criant : « Un enfant boche ne boira pas du lait français ! » ». Gustav Gneisse avait été le plus célèbre proviseur du lycée de Colmar. L’affublant du surnom de Professor Knatschké, Hansi l’avait caricaturé outrancièrement. Vieillard et aveugle, il vivait retiré à Colmar, lorsque la police se présenta à son domicile pour lui notifier l’ordre d’expulsion… « Le fanatisme patriotique de Hansi n’en réclamait pas moins » puisqu’il s’agissait d’un enseignant avec qui il avait eu maille a partir dans sa jeunesse . À Metz, Mgr Wiïlibrord Benzler, bénédictin et éveque de ce diocèse, avait courageusement défendu les Lorrains durant la guerre ; il n’en est pas moins convoqué à se présenter à la gare centrale le 27 août 1919 « avec 30 kg de bagages au maximum, deux jours de vivres et au plus 2000 marks en argent de poche » pour être expulsé avec un groupe d’autres Altdeutsche. Son vicaire général et futur successeur, Mgr Pelt, finira par obtenir que l’évêque en titre puisse se retirer à Lichtenthal, où il décédera deux ans plus tard. Il sera inhumé dans l’abbaye bénédictine de Beuron sur les bords au Danube. Quant à l’évêque de Strasbourg, (p.83) Mgr Adolf Fritzen, également très apprécié, c’est la mort seule qui le 9 septembre 1919 lui permettra de demeurer en Alsace ; son discret enterrement le 11 septembre 1919 sera l’ultime manifestation du Nationalrat auquel il avait appartenu. Le traitement discriminatoire des fonctionnaires Des mesures vexatoires sont également prises à l’égard des autochtones. Ce sont d’abord les lois du 24 février 1919 et du 28 juillet 1921 en faveur des victimes civiles de la guerre : elles stipulent que seuls sont pris en considération les méfaits imputables aux Allemands. Or la plus grande partie des destructions en Alsace étaient dues aux armées françaises. Par ailleurs le législateur se refuse d’indemniser les anciens internés alsaciens-lorrains détenus dans les camps français durant le conflit35. Il faudra attendre une proposition du députe mosellan Robert Schuman (le futur « père de l’Europe ») pour que la loi prenne en considération, dix ans apres, l’injustice qui les avait frappés36. Vient le temps du « malaise des fonctionnaires » (Pierri Zind), expression au demeurant bien faible pour caractériser la tension qui va régner. De nouvelles erreurs sont en effet commises par les autorités françaises, cette fois à l’égard des agents publics : fonctionnaires de l’administration, cheminots, postiers, etc. Avant l’armistice de 1918, ceux-ci bénéficiaient d’un statut différent et surtout meilleur que le statut français. Ainsi, des retenues pour retraite sont instituées. Deux catégories sont distinguées : le service « actif » et le service « sédentaire », le second sensiblement défavorisé par le système français. Le régime allemand accordait aux veuves et aux orphelins une pension très supérieure ; lors du décès du mari, la veuve et les enfants touchaient durant trois mois encore le traitement complet du défunt : cette pratique allemande est supprimée. Le régime français de santé est également moins favorable que le régime allemand. Surtout, l’administration française établit une discrimination jugée intolérable entre fonctionnaires indigènes et fonctionnaires parachutes de « l’intérieur ». Dix mille fonctionnaires Altdeutsche et Alt-Elsasser-Lothringer ayant été expulsés, ils sont à remplacer rapidement. Les nouveaux-venus se voient attribuer de confortables indemnités de séjour, de logement, de fonction, etc., à l’instar de ce que la France pratique pour ses fonctionnaires coloniaux expédiés en Afrique ou en Asie. Or ces indemnités pour fonctionnaires métropolitains en Elsas-Lothringen sont parfois supérieures aux traitements eux-mêmes ! Les fonctionnaires autochtones se trouvent aussi bloqués dans leur avancement, à moins de surenchère patriotique et jacobine. Cette situation paraîtra d’autant plus inique que les fonctionnaires autochtones, formés sous le régime allemand, avaient dû faire face à des exigences plus rigoureuses : stages plus longs, instruction et formation pédagogique ou administrative supérieures, etc. Alors que, dans leur spécialité ils ont une meilleure qualification que leurs homologues, leur rémunération et leur position sociale sont largement inférieures. (p.84) Dans leur quasi-totalité, les fonctionnaires « de l’intérieur » ignorent complètement la langue écrite et orale de la population qu’ils ont a administrer. Ils ne cherchent d’ailleurs pas à l’apprendre. Par contre, les fonctionnaires autochtones sont astreints à l’effort a assimiler rapidement une langue étrangère parlée et écrite. Investis des postes de commandement et de direction, les parachutés par Paris prétendent introduire des méthodes de travail inusitées, souvent moins efficaces. Heurts entre personnes, perturbation inutile des services, irritation continuelle, incompréhension mutuelle sont le lot quotidien. Charles Frey, journaliste, directeur du Nouveau journal, chef du Parti républicain démocrate en 1919, élu à quatre reprises député du Bas-Rhin à l’Assemblée nationale où il siégera plus de 17 ans, également trois fois sous-secrétaire d’État au début des années 1930 et maire de Strasbourg en 193537, est tout le contraire d’un francophobe. Il n’en dénonce pas moins les pratiques du « gouvernement qui semble avoir pris le parti d’écarter les Alsaciens de tout poste élevé dans leur pays. L’Alsacien est administré par le Français de l’intérieur qui, à partir d’un certain niveau dans les carrières, règne seul ». De fait, l’administration française en Alsace-Moselle est du plus pur style colonial. Le corps enseignant se sent particulièrement menacé. La Conférence d’Alsace-Lorraine réunie à Paris avait en effet prévu l’exclusion de 70% du personnel scolaire : environ 3000 hommes et femmes devaient perdre leur poste et être remplacés par autant d’enseignants français, souvent des mobilisés, ne possédant pas, la plupart du temps, la moindre formation pédagogique. Il est vrai que leur mission première n’était pas éducatrice, mais simplement politique. Avec Pierri Zind on peut la résumer ainsi : « détruire et assimiler l’Elsässertum8, déculturer et (déraciner les enfants d‘Elsass-Lothringen, leur enseigner que les Alsaciens-Lorrains ne descendaient pas des Germains, mais des Gaulois, et que le dialecte alsacien était un dialecte celte ; faire croire finalement aux enfants que les Français étaient seuls généreux et civilisés au contraire des Allemands, brutes barbares confondues avec les Huns ». Les premiers manuels scolaires introduits après l’Armistice sont édifiants à cet egard39. Ils restent des preuves durables de la sottise incommensurable qui régné au sein du ministère français de l’Instruction publique de cette époque. (p.105) Dès l’arrivée des troupes françaises en Alsace-Lorraine, la langue française devient brutalement la seule langue scolaire dans un pays germanique à 87,20 % en 1910 et encore à 80,90 % en 1926 (malgré la forte immigration de fonctionnaires français après l’Armistice). Les écoliers alsaciens-mosellans se voient donc contraints de laisser leur langue maternelle à la maison pour apprendre une langue qui leur est étrangère. Mille cinq cents instituteurs de l’intérieur seront appelés à l’aide.
(p.116) Répression administrative et policière En revanche, tous les organes de la presse nationaliste et les groupements patriotiques se déchaînent. Les Heimatbündler sont traités de « francophobes », de « séparatistes », d’« irrédentistes ». Le tocsin est sonné contre le « danger national » qu’ils représentent. Le Manifeste est même qualifié « d’attentat contre l’unité nationale ». Des « comités d’action anti-autonomistes » sont créés pour « lutter contre les menées antinationales de la Zukunft et du Heimatbund ». Appelé à sévir, le gouvernement opte pour la répression. Dès le 16 juin, sur décision du ministre de la Justice Pierre Laval, des sanctions tombent, au motif que « par les termes employés et par son esprit, le Manifeste cherche à porter atteinte à l’unité nationale ». En l’absence de suites judiciaires possibles – puisqu’aucune loi ne permet, en France, à un tribunal de sanctionner l’autonomisme -, les mesures ^seront d’ordre disciplinaire : tous les signataires maires, fonctionnaires d’État ou employés municipaux, ainsi que les cheminots sont immédiatement suspendus de leurs fonctions et déférés devant les chambres de discipline professionnelles. Leur mandat officiel est enlevé aux notaires signataires, de même que la qualité de médecin-conseil de l’assurance-maladie. Les deux conseillers généraux Edmond Herber et l’abbé Gromer sont mis en demeure de retirer leur signature ou de laisser leur mandat. Vis-à-vis de Jean Keppi, secrétaire général de la ville de Haguenau, le préfet demandera des sanctions au Conseil municipal, mais celui-ci ne se laissera pas intimider. Par contre, l’évêque concordataire Charles Ruch engagera une procédure disciplinaire à l’égard des membres du clergé : il leur fera prêter serment de fidélité au gouvernement en vertu des stipulations du Concordat napoléonien. La procédure engagée contre Joseph Rossé aura le plus grand retentissement. Le secrétaire général du Syndicat des instituteurs alsaciens-lorrains – sorti vainqueur en 1920-1923 de son bras-de-fer avec le gouvernement sur le statut des fonctionnaires du cadre local – est convoqué devant la chambre disciplinaire de Colmar pour avoir apposé sa signature au bas d’un texte censé porter « atteinte à l’intégrité du territoire » et pour « menées pro-allemandes ». Avec plus de 30 témoins à décharge, la comparution se transforme en tribunal politique. Rossé n’en est pas moins révoqué de la fonction publique le 4 août 1926 et démis immédiatement de son poste d’instituteur, (p.117) officiellement pour « déloyauté envers ses employeurs ». La sanction est bien entendu illégale : le jugement sera annulé – ainsi que ses conséquences – par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1933. En attendant, elle n’en prendra pas moins effet mais, à la quasi-unanimité, les adhérents de son syndicat vont s’empresser de réélire Rossé à leur tête111. Le pouvoir déclenche alors une répression à grande échelle. Le 12 novembre 1927, il interdit la Zukunft – hebdomadaire alors lu dans un foyer alsacien sur douze -, la Volkstimme et deux autres titres, propriétés de Claus Zorn von Bülach. Prétexte fallacieux : ces journaux sont « écrits en langue étrangère » ; une mesure d’autant plus discriminatoire que quasiment toute la presse alsacienne est alors publiée en allemand, y compris les feuilles nationalistes ! D’autres titres se voient également frappés quelques mois plus tard, dont en mars 1928, Das Neue Elsass de Camille Dahlet, l’ancien journaliste radical passé à l’autonomisme avec son parti, la Fortschrittspartei. Débute alors une vaste campagne de perquisitions : près de 100 clans la seule nuit de Noël 1927. « On leur a bien arrangé leur Noël boche » jubilera le journal d’Alsace et de Lorraine proche du pouvoir. Par la suite le nombre de perquisitions domiciliaires montera jusqu’à 200. Les arrestations de Heimatbündler se succèdent par dizaines. Rossé est arrêté le premier. Suivent les rédacteurs de la Wahrheit, puis beaucoup d’autres dont l’abbé Fashauer, Paul Schall, René Hauss, le journaliste Marcel Stürmel et enfin, le 16 mars 1928, le Docteur Eugène Ricklin, emmené, à pied, sans bretelles et menotté (p.118) (à 65 ans…)- La presse gouvernementale subventionnée fantasme : pour créer l’ambiance, elle invente une armée secrète alsacienne prête à l’engagement contre la France, des dépôts cachés d’armes – légères et lourdes – et précise même le nom des ministres du futur gouvernement de la « République d’Alsace et de Lorraine ». Le journal parisien Le Temps – supposé, comme ses confrères, « proche des milieux bien informés » – s’appuie (évidemment à tort) sur les perquisitions pour expliquer à ses lecteurs que les personnes arrêtées n’étaient pas des autonomistes mais des « agents du Deutschtum » et des « vrais traîtres à leur pays ». (31 décembre 1927).
(p.122) Au début des années 1920, près de 150 000 Alsaciens-Mosellans se trouvent réfugiés en Allemagne, dont près de 100 000 expulsés par les autorités militaires françaises et les Commissions de triage. À fin d’entraide mutuelle et pour la défense de leurs droits, ils se constituent en une association : le Hilfsbund der vertriebenen Elsass-Lothringer im Reich, dirigée par Max Donnevert. Le siège est installé à Freiburg-im-Breisgau où beaucoup d’émigrés vivent dans clés conditions d’extrême précarité, comme d’ailleurs r ceux dispersés dans le Reich : leur afflux avait été aussi massif qu’inattendu. Les « optants » français de 1871 avaient eu plusieurs années pour émigrer d’Alsace-Moselle vers « l’intérieur ». Eux non, ils avaient été expulsés brutalement. (p.171) À la fin de la Première Guerre mondiale, Clémenceau avait cherché à obtenir l’annexion de la Sarre à la France. Il s’était alors heurté à l’opposition très vive des Alliés. Finalement, selon les décisions du Traité de Versailles, le territoire sarrois avait été placé sous la tutelle de la Société des nations pour une période de quinze ans, pendant laquelle la France était propriétaire des mines de charbon. (p.172) Au plan du droit international, le Saargebiet relève toujours de la souveraineté allemande. La France ne se voit confiée que son administration. Une Commission de gouvernement représente la Société des Nations ; elle comprend cinq personnes, dont un Français, un non-Français originaire de la Sarre et trois autres personnes ne venant ni de France ni d’Allemagne. Pendant la durée du mandat, la France cherchera par divers moyens à séparer définitivement de l’Allemagne ce territoire, mais l’encouragement qu’elle apporte aux mouvements séparatistes ne donne que peu de résultats : la population sarroise, très attachée à sa culture allemande, suit d’un très mauvais œil la politique jacobine conduite par les autorités françaises en Alsace-Moselle voisine. Elle n’a nulle envie de renoncer à son particularisme. En 1933, de nombreux opposants au nazisme quittent l’Allemagne pour s’installer en Sarre, le seul territoire allemand échappant au contrôle du régime nazi. Ils lancent une campagne visant à ce que la Sarre reste sous mandat de la Société des Nations aussi longtemps qu’Adolf Hitler se trouvera à la tête de l’Allemagne. Mais cette campagne fera un flop face à celle que les nazis vont déclencher. C’est même un puissant ressentiment antifrançais qui va s’exprimer lors du plébiscite tenu le 13 janvier 1935 : 90,7% des votants choisissent l’union avec l’Allemagne, 8,9 % le statu quo, et 0,4 % l’union avec la France. Pour sa part, l’Alsace s’était intéressée de près au plébiscite sarrois pour de multiples raisons, culturelles mais aussi économiques, ce territoire étant l’un des clients les plus importants de l’agriculture alsacienne. En 1933, le député Stürmel avait posé à la Chambre le problème des débouchés sarrois et demandé la conclusion d’une Union douanière ; l’année suivante le député Meck, de l’UPRA réitérera la demande. Le résultat du plébiscite sera une surprise, notamment pour les catholiques qui avaient supposé que leurs coreligionnaires ne voteraient pas pour l’Allemagne hitlérienne et antichrétienne .
/1921/ (p.173) Les Français favorisent (…) en Rhénanie le développement d’un mouvement séparatiste, comme ils cherchent à le faire dans le Saargebiet. Son organisateur est Adam Dorten, dont l’action devient particulièrement vigoureuse après l’occupation franco-belge de la Ruhr en 1923. La pression exercée par la Grande-Bretagne sur la France et la Belgique empêchera qu’elle aboutisse. Une « République rhénane », proclamée à Aix-la-Chapelle le 21 octobre 192367, s’étendra cependant avec les putschs de Dorten et Matthes à Trêves et à Coblence, pour finalement échouer en raison de la mésentente de ses chefs.
(p.190) Une contrepartie à une aide secrète apportée aux nazis par les services français ? Que la montée au pouvoir du parti national-socialiste allemand ait fait l’objet de financements occultes ne fait l’ombre d’un doute pour aucun historien. Les preuves abondent. L’aide des grandes entreprises allemandes, des trusts anglo-saxons, n’était peut-être pas absolument indispensable aux nazis, mais sans leur contribution la progression de la NSDAP en aurait été au minimum ralentie. Pierri Zind134 fait, quant à lui, état de financements en provenance des services secrets français. En l’absence des archives du ministère français des Affaires étrangères, détruites au Quai d’Orsay le 16 mai 1940 avant l’arrivée des Allemands à Paris, pour éviter qu’elles ne tombent entre les mains de (p.191) la Wehrmacht, l’historien ne peut s’appuyer sur aucun document. Il en est réduit à des témoignages indirects pour tenter de démontrer la réalité de ces contributions. Il cite ainsi les Mémoires de Heinrich Brüning, chancelier du Reich du 28 mars 1930 au 30 mai 1932, qui tentera vainement de faire dissoudre les troupes paramilitaires nazies (alors fortes de 400 000 SA et SS). Mais plutôt que de remettre en cause sa propre politique économique catastrophique de déflation qui avait contribué massivement à l’impopularité de son parti, le Zentrum, et au succès électoral de la NSDAP, ‘ex-chancelier centriste préférera écrire : « L’un des principaux facteurs de a montée de Hitler fut le fait qu’il avait reçu en 1923 et plus tard de grosses sommes d’argent de l’étranger et qu’il avait été bien payé pour avoir saboté la résistance passive de la Ruhr135 ». Effectivement, alors qu’à l’époque toute l’Allemagne protestait violemment à l’appel du chancelier Cuno et que tous les partis s’étaient associés à cette protestation contre l’action franco-belge, Hitler était resté muet, alors même qu’il tenait meeting le jour de l’occupation, débutée le 11 janvier 1923. Les nazis iront jusqu’à condamner le terrorisme antifrançais ultérieur. Mais cela ne suffit pas à prouver la réalité des subventions évoquée. Dans une veine analogue, l’écrivain lorrain et fils de diplomate, comte Jean de Pange évoquera, dès 1927, dans son Journal136 – sans plus de preuves ou précisions – ce financement du parti d’Adolf Hitler par les fonds français dans les années 20. Selon lui, ceux-ci répondaient à deux finalités : la lutte contre le bolchévisme, à l’égard duquel la NSDAP apparaît comme un rempart, mais aussi la volonté d’affaiblir la république de Weimar par l’encouragement aux séparatistes bavarois. Ces accusations sont d’ailleurs formulées lors du procès de Hitler à Munich (26 février-27 mars 1924)137. Pierri Zind, suivi sur ce point par Bernard Wittmann, fait du commandant français Xavier-Augustin Richert (plus tard promu au grade de général), l’entremetteur des financements destinés à affaiblir l’Allemagne weimarienne, objectif constant de Poincaré et axe stratégique de sa politique allemande, il est vrai. Dès 1921, ce militaire affecté a SarrebrucK disposera ainsi de fonds très importants pour financer les séparatistes rhénans et sarrois, ainsi que les autonomistes bavarois et leurs organisations paramilitaires. Les intermédiaires allemands de ce Richert sont connus : interpellés et identifiés, ils passeront en jugement à Munich le 5 juin 1923. Il s’agit des dénommés Fuchs et Machaus. Leur procès pour trahison établira les montants versés par les Français138 ; ils furent d’au moins 70 millions de marks les premières années. Mais, publiquement compromis, mis en cause à la Chambre des députés, devenu dans la presse allemande le Putschmajor, l’agent français est rapidement obligé de disparaître du paysage bavarois pour un commandement au Maroc dans la Légion étrangère…. et avec lui, toute trace de financements supposés avoir été servis aux factieux allemands. Notons que chez Zind, il n’est alors pas question du parti nazi, mais bien des Bavarois, c’est-à-dire des monarchistes avec lesquels les hitlériens auront maille à partir en 1933. Pour justifier son propos concernant le soutien qu’aurait apporté le gouvernement français à la NSDAP, l’historien avance139 une aide plus tardive. Selon lui, « en 1930 par exemple, le gouvernement avait (p.192) autorisé le Crédit Lyonnais à avancer 20 milliards de francs à 8% à Hitler par l’intermédiaire d’industriels allemands pour la campagne électorale, avec le résultat que l’on sait : 640 000 voix envoyèrent, le 14 septembre 1930, 104 députés nazis au Reichstag, alors que le 20 mai 1928, les nazis n’avaient pu réunir que 810 000 voix pour seulement douze sièges ». Outre qu’il est particulièrement naïf de suggérer que 20 milliards auraient suffi, à eux seuls, à déplacer des millions de voix alors que les nazis disposaient par ailleurs de bailleurs de fonds infiniment plus importants, il est surtout regrettable que la réalité des flux financiers n’ait jamais pu être établie autrement que par des témoignages tout aussi indirects que tardifs. Ainsi celui de l’ancien ministre des Finances du Land de Prusse qui, en 1952, aurait « affirmé qu’au cours d’un voyage à Paris auprès du ministère des Affaires étrangères avant-guerre, le Quai d’Orsay lui avait montré une quittance signée par Hitler en reconnaissance d’une somme d’argent avancée par ce ministère’40 ». (p.258) Le gouvernement républicain va aussi et surtout se permettre un grand coup en mai 1940. Il n’hésitera pas à faire arrêter près de 500 personnes (p.259) à la fois – de 16 mois à 82 ans – appartenant aux milieux autonomistes de toutes tendances et de toutes fonctions : conseillers généraux (quatre, dont un communiste), conseillers d’arrondissement, maires, conseillers municipaux, industriels, cheminots (nombreux), instituteurs, artisans, paysans, religieux catholiques (deux prêtres) et protestants (seize pasteurs dont Karl Peter Maurer, président de l’Église évangélique luthérienne d’Alsace-Lorraine, ainsi que l’ancien député Georges Wolf, qui se croyait portant rayé des Carnets B de la police depuis qu’il avait repris le service religieux d’une paroisse). S’y retrouve également l’épouse de Karl Roos. Comme l’écrira l’historien Bernard Vogler : « Il s’agit d’anéantir une fois pour toutes l’autonomisme212 ». À l’intention spéciale des personnes arrêtées, un camp d’internement est installé à Saint-Dié dans les Vosges. Il reçoit 200 prisonniers. Trop vite saturé, on le complète par un deuxième camp construit à la hâte dans le Fort d’Arches près d’Épinal, dans les Vosges également. Quatre cent cinquante personnes y sont enfermées – dont une partie transférée de Saint-Dié – sous le contrôle de 68 soldats commandés par un lieutenant auxquels on prétend qu’il s’agit d’espions, qu’ils maltraitent en conséquence. Finalement, les internés de Saint-Dié et d’Arches seront libérés le 20 juin 1940… par les Panzer allemands de la Wehrmacht, naturellement accueillis sous les vivats213. Si cette affaire constitue ainsi une des ultimes et nombreuses erreurs psychologiques que la IIIe République n’a cessé d’accumuler depuis la fin de la Première Guerre mondiale à l’égard des « chères Provinces recouvrées », ce ne sera cependant pas la dernière. Mais en attendant, c’en est bel et bien fini de l’autonomisme « dans le cadre de la France » et même de l’autonomisme tout court. Quant aux autonomistes, il leur faudra affronter leurs destins individuels pour traverser les épreuves que la Seconde Guerre mondiale va imposer à l’ancienne Elsass-Lothringen. Selon Bernard Vogler : « une des plus terribles de son histoire, avec la guerre de Trente ans214».
(p.271) 1. Le drame de l’évacuation de l’Alsace-Moselle L’ultime erreur de la IIIe République La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939. À 4 heures 45, la Wehrmacht envahit la Pologne. Soixante-trois divisions, dont sept Panzer, soit environ 950 000 hommes, 2000 blindés et 2000 avions, sont envoyés à l’assaut par Hitler, sans déclaration préalable. En moins de 28 jours, le pays est écrasé. L’Alsace et la Moselle sont immédiatement plongées, elles aussi, dans le conflit. Avant même que – solidaire de la Pologne – la France, conjointement avec le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ne déclare la guerre à l’Allemagne (ce sera 60 heures plus tard, le 3 septembre à 17 heures), le 1er septembre toujours, les autorités militaires françaises donnent l’ordre d’évacuer Strasbourg. Simultanément est décrétée la mobilisation générale. C’est le début d’un drame qui, au bout du compte, concernera plus de 600 000 Alsaciens-Mosellans obligés de quitter leurs foyers pour être expédiés à l’autre bout du pays, neuf mois avant que les combats ne s’engagent réellement entre la France et l’Allemagne1… Au son du tocsin, en quelques heures, la métropole alsacienne est vidée de la majorité de ses habitants, avec ceux des villages alentour. Les populations des autres villes et villages d’une zone située tout le long de la frontière, de la Suisse au Luxembourg, sur une profondeur moyenne de 10 kilomètres sont obligées de se rendre par leurs moyens personnels dans des sites de rassemblement, d’où ils prendront le train à destination du Sud de la France. (p.272) tenus d’abandonner chariots et animaux d’attelage. En peu de jours, dans toute la bande frontalière dite « zone 12 » va s’établir un indescriptible chaos dû à l’inorganisation, à l’improvisation et au non-respect des plans d’évacuation, découverts par les maires à la dernière minute lorsqu’ils ouvrent l’enveloppe « Secret » conservée à la gendarmerie et qui contient les instructions. Animaux domestiques, chevaux, bétail, volailles sont laissés à l’abandon, tout comme 127 000 hectares de terres. La quasi-totalité de la récolte de 1939 est perdue, soit : 200 000 quintaux de froment, 320 000 quintaux d’avoine, 12 000 quintaux de seigle et d’orge et un million de quintaux de pommes de terre. Le bétail, qui n’a pas suivi le déplacement, sera en grande partie anéanti : 141 000 porcs (sur 180 000), 140 000 têtes de bétail (sur 285 000) et 21 000 chevaux (sur 38 000). Strasbourg est livrée aux chiens et chats3. Le transfert vers les sites de destination se fait dans des conditions non moins chaotiques de pagaille et d’irresponsabilité : carence des services préfectoraux dépassés par la situation4, conditions de transport invraisemblables, dispositions sanitaires lamentables. En outre, chacun ne peut emporter que le strict nécessaire : 30 kg par personne5. « L’acheminement des réfugiés se fait par trains spéciaux, la plupart du temps en wagons à marchandises ou à bestiaux. Beaucoup de ces wagons arborent encore à cette époque l’inscription : Hommes 40, Chevaux 8 (en long). Le service médical est totalement inexistant. Des accouchements prématurés se produisent, de même que des décès. Le lieu de destination est atteint après un périple de trois voire quatre jours, parfois jusqu’à dix-neuf, quand les sites initialement prévus sont saturés et que les trains sont réexpédiés ailleurs6. » À titre d’exemple, devant la totale saturation de la Dordogne, son préfet prévient le ministre de l’Intérieur le 26 septembre 1939 : « Je refoule [sic] sur le département de l’Indre tous les trains dirigés sur Périgueux ». Il télégraphie le même jour à la commission régulatrice du repliement à Dijon : « Diriger sur Chateauroux tous trains transportant des évacués de Strasbourg-ville’».
Au total, 430 000 Alsaciens originaires de 231 communes seront ainsi déplacés de septembre 1939 à mai 19408. Le tiers de la population ! Les Moselians : 314 000, provenant de 301 communes sur 765 . Autre scandale : les biens culturels sont également transférés. Une partie du patrimoine régional (archives, bibliothèques, BNU, œuvres d’art, pièces de musées, vitraux, le trésor de la cathédrale et des collections de valeur, etc.) est emballée et évacuée par centaines de wagons, (…).
(p.273) L’évacuation administrative de Strasbourg pose encore davantage de problèmes. La ville abrite en effet de nombreux services, locaux, départementaux et interdépartementaux : trésorerie générale, rectorat, perception, contributions, chambres de commerce et d’agriculture. On les replie sur Périgueux, chef-lieu de la Dordogne (de même que huit banques, des compagnies d’assurance, les caisses maladie et vieillesse, etc.). La municipalité, avec à sa tête l’adjoint Naegelen, s’installe également dans cette ville avec une partie des services12. Les autres restent à Strasbourg avec le maire Charles Frey13. Ils rallieront Périgueux le 15 juin 1940. Les hospices civils sont installés à proximité, à Clairvivre, dans des conditions de précarité extrêmes. D’autres services, les journaux, Radio Strasbourg et de nombreuses entreprises (usines d’automobiles, Grands Magasins…) sont réinstallés à Bordeaux où rigoureusement rien n’a été prévu pour les recevoir, risque les plans initiaux écartaient la Gironde comme terre d’accueil pour e Bas-Rhin14. En revanche, le préfet et ses services, la police, les tribunaux, e parquet et d’autres, comme les consulats étrangers, resteront à proximité, au pied des Vosges (Vallée de la Bruche, Saverne…). Et toujours sans qu’un seul coup de feu n’ait été échangé entre Allemands et Français. À l’arrivée, les problèmes d’adaptation seront tout simplement immenses. D’abord au plan matériel : non seulement parce que les capacités d’hébergement des localités d’accueil sont quantitativement très insuffisantes pour recevoir des tels flots humains, mais aussi et surtout parce que les zones désignées pour l’accueil sont particulièrement sous-équipées. Ainsi, 90 000 Alsaciens-Lorrains vont échouer en Charente, 90 000 en Dordogne, 60 000 dans la Vienne, 40 000 en Gironde et 25 000 dans les Landes, soit dans autant de départements pauvres et totalement impréparés à les recevoir. « Ils camperont durant des mois dans des granges, des écoles, des auberges, des châteaux abandonnés ou même des écuries et quand on leur proposera une habitation, la plupart du temps elle sera dépourvue d’eau, d’électricité, de WC et de moyen de chauffage15 » L’écrivain anglais Somerset Maugham voyage à travers la France en guerre comme correspondant de journaux suisses. Il décrira le cas de ces réfugiés logés dans les étables, « parce que le magnat charentais, maître des lieux, et propriétaire d’un château totalement inoccupé avait même refusé les logements de domestiques aux Alsaciens-Lorrains16 ». Pour ces transplantés ayant dû abandonner leurs fermes opulentes de la plaine alsacienne ou leurs appartements urbains confortables, dans des villes assainies et électrifiées depuis l’époque du Reichsland, le contact avec l’habitat du Sud-Ouest des années 30 sera d’une rudesse infinie. Un vrai traumatisme, d’autant plus mal vécu qu’aux difficultés matérielles se surajouteront les difficultés culturelles, linguistiques et religieuses qui transformeront vite le déracinement en un vrai choc de cultures. L’historien Bernard Vogler l’exprimera sobrement : « Les évacués vivent l’incommunicabilité avec leurs compatriotes sous diverses formes, (p.274) au niveau de la langue et de la rencontre de deux cultures rurales17. » En maints endroits ils sont pris pour des « Boches » et insultés comme tels. Dans les meilleurs des cas, on les appellera « ya-ya », ce qui est presque affectueux. Le professeur Emile Baas, qui a vécu la situation, souligne « la méfiance et la froideur réticente de l’accueil, car bien des réfugiés et expulsés ont été reçus comme des trouble-fêtes et des bons à rien18 ». Des pasteurs protestants qui voudront célébrer le culte se verront refuser des salles de classe par les municipalités anticléricales, qui sont nombreuses. En outre, une circulaire d’octobre 1939 interdira aux communes de mettre des bâtiments publics à la disposition des groupements. On utilisera donc des cinémas ou des hôtels. Les paroisses catholiques répugnent à ouvrir les églises aux « parpaillots » et même parfois à leurs coreligionnaires. Le pasteur Charles Altorffer19 a été, de 1929 à 1939, le directeur des Cultes pour les trois départements concordataires. Devenu directeur des Services des réfugiés d’Alsace et de Lorraine, il témoignera des problèmes que lui ont posés les conceptions « laïques » de beaucoup d’enseignants notamment au moment de la célébration des fêtes de Noël, inconnue dans ces régions où l’on ne célèbre que le Nouvel an : « Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens20 » dira-t-il en toute charité chrétienne. Deux régimes scolaires antinomiques vont devoir cohabiter. Un décret-loi pris dès le 5 septembre 1939 crée une situation inédite : « Le régime spécial des Cultes, de l’Instruction publique, des Assurances sociales, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable, pendant la durée de leur repliement, aux populations de ces départements évacués d’office sur ordre des autorités publiques 21 ». Avec le printemps 1940, les difficultés s’estompent un peu. Le 21 mars 1940, le député mosellan Robert Schuman est placé à la tête d’un Sous-secrétariat aux réfugiés nouvellement créé. Il gardera ce poste jusqu’au 10 juillet 1940. Sous son impulsion, des souscriptions et collectes de dons en espèces sont organisées par les préfets. Objets mobiliers et vivres sont expédiés par train avec des vêtements, des meubles, de la literie, des bicyclettes, etc. Mais après le 10 mai 1940, la situation générale s’aggrave à nouveau quand des réfugiés hollandais et belges, suivis par ceux du Nord et de la région parisienne, fuient vers le sud l’invasion allemande foudroyante. Depuis Te début de 1939, le Sud-Ouest accueille en effet déjà d’autres réfugiés : les Espagnols républicains. Le désastre de la déroute Au pays, les destructions – purement gratuites – de l’armée française ajouteront encore à l’ampleur de la catastrophe morale subie par les Alsaciens-Mosellans. Déjà, les villages évacués sont livrés au saccage durant l’hiver 1939-1940. Le 5 novembre 1939, dans une allocution radiodiffusée à 20 heures, Camille Chautemps, vice-président du Conseil et coordinateur des Services, déclare aux évacués alsaciens-mosellans : « Je vous fais la (p.275) promesse que sur vos foyers, notre armée veillera avec une attention et une fermete de tous les instants, et s’il est arrivé que, parfois certains dommages inévitables dans les premières heures, ont été causés à vos biens, ne doutez pas […] que la légitime réparation qui vous est due ne vous sera pas marchandée ». En fait, l’hiver sera tellement rude (le plus froid du siècle) que dans des villages désertés, mais censés être protégés, meubles et parties boisées des maisons (portes, fenêtres, volets, planchers et même poutres des colombages) seront utilisés par les militaires pour se chauffer ! L’armée française ne se contentera cependant pas de bois de chauffe. Objets de valeur, vaisselle et vêtements, vins en cave, restés sur place – du fait de la limite des 30 kilos de bagages imposée aux évacués – sont emportés par la soldatesque mais aussi par des officiers22. Les villes n’échappent pas au pillage. Par exemple, Sarreguemines, est mise à sac malgré la présence d’une garde civile de 44 hommes, de la gendarmerie, d’un commandant de la place et de 100 militaires… incarcérés dans la prison pour vol23. Grâce à la poigne de fer du colonel Staehlin, Strasbourg est toutefois mieux tenue. Les évacués de la capitale alsacienne retrouveront leurs biens intacts. Ailleurs, c’est le chaos. En dépit des voix de nombreux parlementaires de tous bords (Burrus, Dahlet, Seltz, Brogly, Elsässer, Eccara) qui s’élèvent en direction du gouvernement pour se plaindre des soldats-voleurs ou des officiers-brigands, et réclamer qu’il soit mis fin aux exactions, les pillages se prolongeront, malgré les menaces pesant sur les militaires coupables. Un décret-loi du 1er septembre punit en effet les pilleurs de la peine de mort. Mais il sera rarement appliqué. L’état-major fera valoir le « secret-défense » pour nier le problème, pourtant soulevé par une enquête militaire dès le 10 novembre 1939, et masquer son incapacité à contrôler ses troupes24. « Les déprédations commises sont passées sous silence par les autorités dans le but de ne pas effrayer la population et surtout pas les évacués25. » Au cimetière des mensonges d’État proférés à l’encontre des Alsaciens-Mosellans, la promesse de Chautemps rejoindra ainsi celles de son illustre prédécesseur Herriot et celles des généraux de 191826. Ce sont encore les militaires français qui poursuivront la casse, mais cette fois à grande échelle, avant de battre lamentablement en retraite en mai-juin 1940. Ils feront « sauter le maximum de ponts, de centraux téléphoniques, de centrales électriques, de voies ferrées, de postes d’aiguillage, de nœuds routiers et d’usines à travers toute l’Alsace […] pratiquant une vraie stratégie de la terre brûlée » qui provoquera l’intervention fréquente de maires ou de l’autorité préfectorale au vu de leur évidente inutilité. « Le bilan des destructions est impressionnant : 405 ponts routiers, 109 ponts de chemin de fer, 81 écluses (dont 52 sur 101 sur le seul canal Rhin-Rhône), les stations émettrices de Mulhouse et de Colmar et 1071 km de voies ferrées seront même totalement hors d’usage. » Sera encore plus totalement dépourvu de justification militaire « le dynamitage de nombreuses unités de production (raffinerie sucrière d’Erstein, installations pétrolières de Pechelbronn, moulins d’Illkirch), du tout récent barrage de Kembs (qui avait fait la fierté nationale), de centrales électriques (dont celle de Strasbourg), des installations (p.276) portuaires sur le Rhin, ou de quartiers d’habitations proches de ces équipements détruits par de trop fortes doses d’explosifs27 ». Cette dévastation gratuite de tout un territoire ne pèsera cependant en rien sur l’issue des combats. En effet, après les mois d’attente de la « drôle de guerre », celle-ci arrête d’être drôle. L’attaque allemande finit par se produire, mais pas du tout comme s’y attendaient les stratèges de la IIIe République et les chefs militaires28. La 8e Armée française, chargée de tenir le secteur du Rhin, se croit à l’abri derrière la Ligne Maginot. Mais en mai 1940, l’Allemagne la contourne. Hitler lance ses Panzerdivisionen en Belgique et dans les Ardennes, parvient rapidement à percer un système défensif français beaucoup trop statique, et envahit le nord du pays. En juin, après un début de panique à Paris, le front de la Somme et de l’Aisne est renforcé dans l’urgence par des unités transférées depuis l’Alsace, où elles étaient en attente. Mais le dispositif se disloque, malgré quelques combats héroïques menés par les fantassins français contre la déferlante des chars allemands appuyés par les Stukas de la Luftwaffe. Ce sera le début de la débâcle. Devant la menace d’encerclement, le 13 juin, la 8e Armée reçoit l’ordre de se replier sur les Vosges et la trouée de Belfort, ne laissant en Alsace qu’un faible rideau défensif. Le 14, les Allemands entrent dans Paris après avoir bousculé les Français sur la Somme et avoir poussé les Anglais à réembarquer en catastrophe leur corps expéditionnaire a Dunkerque. Le 15, des troupes allemandes franchissent le Rhin en quatre points dans le centre-Alsace au moyen de 250 canots d’assaut et 950 bateaux pneumatiques. Le 17, Colmar est occupée, Mulhouse le 18. Strasbourg, vide de ses habitants, est évacuée par ce qui reste de Français dans la nuit du 17 au 18 juin, devant des Allemands médusés de pouvoir occuper la ville sans avoir à tirer un seul coup de feu alors qu’ils s’attendaient à une forte résistance29. Les seuls combats conséquents sont livrés dans le nord de l’Alsace où quelques fortifications font l’objet d’attaques par l’avers et le revers, combinées aux bombardements de Stukas. Ils dureront jusqu’au 2 juillet, soit neuf jours après la signature de l’armistice. L’obstination de leur commandement ne pèsera toutefois pas plus lourd sur le cours des événements que n’aura pesé l’ensemble de l’inutile dispositif conçu par André Maginot et soutenu par tous les gouvernements successifs de la IIIe République80. (p.277) Pour en comprendre l’énormité, force est de reconnaître que, si pour les militaires l’évacuation du tiers de l’Alsace-Moselle représentait un impératif stratégique corollaire du choix de la stratégie purement défensive imaginée par Maginot et soutenue par le système, que De Gaulle dénoncera33, pour de nombreux politiciens jacobins elle est aussi l’occasion inespérée de réaliser, du même coup, un vieux rêve des révolutionnaires de 1794. Dans sa Dissertation sur la francilisation de la ci-devant Alsace, l’ex-prêtre Rousseville n’avait-il pas appelé à « la déportation34 d’une bonne partie des Alsaciens dans les lieux où il faudra qu’ils deviennent Français, et où on laissera l’autre pour se franciser avec la colonie, qu’on appellera de l’intérieur de la République, en l’occurrence les Vendéens que l’on déportera sur le Rhin » ? Les journaux parisiens de l’époque ne se trompent d’ailleurs pas sur la finalité ultime de l’opération de septembre 1939. Le Temps35 parlera (p.278) de « transplantation » et de « fusion des populations ; et un peu plus tard, l’hebdomadaire Aux écoutes36 expliquera que « les évacuations devaient donner l’occasion d’une fusion intime entre les deux populations ». Il s’agit bien, en effet, d’un véritable projet politique : pour ses promoteurs, les populations des villages alsaciens étaient appelées à demeurer dans le Sud- Ouest, où il y avait assez de terres disponibles pour permettre leur fixation définitive. Dans leurs villages saccagés et pillés, devaient plus tard – après rénovation – s’installer des paysans venus de l’Intérieur. Mais deux obstacles de taille interdiront la mise en œuvre complète du plan jacobin jusqu’à sa seconde phase, qui devait voir l’installation des colons de l’Intérieur dans les villages des bords du Rhin. Le premier, majeur : la déconfiture de juin 40, totalement inattendue, qui conduira les troupes allemandes jusqu’à Bordeaux, le 24, la veille de l’armistice ! Le second : l’attachement obstiné des Alsaciens à leur Heimet. Un fonctionnaire du Service central des services déplacés d’Alsace et de Lorraine en conviendra en juillet 194337 : « J’avais à l’époque dissuadé fermement les cercles autour de Valot38 de poursuivre un tel plan. Ma conviction était que les Alsaciens en toutes circonstances voudront retourner chez eux, même s’ils devaient porter sur leurs épaules les cercueils de leurs défunts pour les ramener au pays ». De fait, sur les quelque 600 000 déplacés, seuls 60 000 ne reviendront plus en Alsace-Moselle39, notamment la plupart des israélites. Sur un point au moins le projet jacobin connaîtra malgré tout une réussite partielle. Alors que pour les déplacés, « tout ce qui comptait c’était rester ensemble40 », la dispersion sera au contraire la réglé. Ainsi, les habitudes de vie communautaire, les liens familiaux et la cohésion des collectivités seront pour le moins mis à mal. Les Strasbourgeois déportés ne se verront pas disséminés dans moins de 357 communes ; les habitants de la petite ville mosellane de Forbach dans 28 ! Les évacués de Bischheim seront dispersés dans seize communes, ceux de Saint-Louis dans quatorze communes du Gers et dix-huit communes des Landes, qui accueillent aussi dans seize autres localités les habitants de Village-Neuf, etc., etc. Tous départements totalement démunis de transports collectifs qui permettraient des liaisons entre les familles dépourvues de moyens individuels (autres que la bicyclette). Ainsi, après l’épreuve de l’évacuation, de nombreuses communautés villageoises vivront celles de leur totale dislocation, de la rupture parfois définitive des liens sociaux anciens, sans que, pour autant, de nouvelles relations parviennent à vraiment s’établir entre communes d’Alsace-Moselle et du Sud-Ouest, à l’époque trop éloignées culturellement41. Cependant, en dépit – ou à cause – de l’échec des plans de l’équipe Valot, le vieux rêve des extrémistes révolutionnaires de 1794 continuera à hanter différents esprits ultra-chauvins. C’est ainsi qu’une fois la guerre finie, on pourra voir le fantôme de l’abbé Rousseville ressurgir au cœur même de la Préfecture du Bas-Rhin pour y faire renaître le fantasme de la transplantation des Alsaciens trop germanisés42.
(p.301) Une autre campagne va concerner les drapeaux. Le drapeau français est le premier visé. Après avoir fait collecter sans succès les drapeaux tricolores, puis invité leurs propriétaires à les découdre et à faire un usage ménager du tissu, le Gauleiter autorise, le 1er juin 1941, le commandant de la Sicherheitspolizei à envoyer pour un an en camp de concentration les contrevenants à l’ordre de destruction. Suite à des visites domiciliaires – la plupart sur dénonciation récompensée – la menace sera effectivement mise à exécution155. Mais, fait à moitié surprenant, les drapeaux Rot un Wiss de l’autonomisme alsacien, celui à bandes horizontales en rouge et blanc adopté par le Landtag en 1911156 comme celui de la République de Mulhouse indépendante jusqu’à 1798 seront également interdits. D’un jacobinisme à l’autre C’est que « toutes les manifestations d’un sentiment patriotique alsacien, toutes les marques d’attachement à la Heimet157 allant dans le sens de l’autonomisme sont tout aussi suspectes aux dirigeants badois de la NSDAP que naguère aux politiciens français partisans de l’assimilation à la République « une et indivisible158 ». Médard Brogly159, sénateur, ami de Ricklin dès avant la Grande Guerre, parlementaire de la Volkspartei de façon quasi-ininterrompue de 1911 à 1944, – du Landtag alsacien au Sénat français en passant par la Chambre des députés – témoigne : « Il n’était pas dans l’intention du national-socialisme de tenir compte, de quelque façon que ce fût, du particularisme du pays ou de la spécificité ae son Histoire. Il fallait que es Alsaciens devinssent des Allemands au même titre que les Mecklembourgeois ou ceux du Brunswick160 ». Si YEIsalï a disparu des cartes de géographie pour se fondre dans le Gau Oberrhein, son histoire sera aussi traquée pour être réécrite à la mode national-socialiste. L’Université allemande ae Strasbourg supprime l’Institut d’Histoire d’Alsace. L’Histoire de l’Alsace de Lucien Sittler, parue en langue allemande chez Alsatia en 1935, est interdite de réédition161. En 1932, différents cadres de la Volkspartei (p.302) dont Rossé, Stürmel, Keppi, avaient publié – en hommage au Dr Xavier Haegy – une monumentale histoire en quatre volumes intitulée Das Elsaft von 1870-1932, près de 2400 pages de textes et de cartes. Cet ouvrage de référence162, connu sous le nom familier de Haegy-Werke est retire des librairies et bibliothèques sa réédition interdite. Le Dr Joseph Lefftz, cet ethnologue emprisonné avec les Nancéiens, puis libéré in extremis avant les tribulations du groupe, avait travaillé durant des années à collecter les chants populaires alsaciens. Il préparait leur édition en plusieurs volumes. Cela lui sera interdit, car il aurait dû y ajouter des chants populaires badois et donner au tout le titre Chants populaires du Rhin supérieur. La revue folkloriste Elsassland’(>3 paraissait en langue allemande depuis 1920. Elle est aussi supprimée. Elle aurait pu sauver son existence, si elle avait accepté sa fusion avec la revue badoise Oberrheinische Heimat, ce que refusent aussi bien la rédaction de la revue que les éditions Alsatia164. En réalité, l’élimination à terme du particularisme alsacien et de l’élément principal de son Volkstum propre, le dialecte alsacien, est bel et bien programmée. Le quotidien strasbourgeois du parti, les Strassburger Neueste Nachrichten, qui en octobre 1940 appelait encore à « déwelchiser » la langue régionale, passe à l’étape suivante. En février 1941, il déplore que la population continue à le parler : « Cette pratique [écrit-il] peut être une protestation passive des Alsaciens contre le régime allemand ». Elle l’est d’ailleurs très largement. À Colmar, le Bürgermeister Luzian Manny, Oberstadtkommissar adresse une circulaire aux employés de sa mairie leur demandant de n’employer que le haut-allemand pendant les heures de service. La Zivilverwaltung ne cherche plus seulement à bannir le français. Il s’agit de façon toujours plus nette, d’inviter la population à employer le Hochdeutsch, l’allemand standard, dans l’usage courant. Puis, aans une note adressée au ministre des Cultes et de l’Instruction, le Gauleiter Wagner finira par révéler l’objectif à long terme de la politique linguistique : « Il s’agit de sceller la cohésion du Reich par l’unité de la langue, les dialectes devant disparaître au profit du seul haut-allemand165 ». Ainsi, après avoir tenté de lutter durant les décennies de l’entre-deux guerres contre le jacobinisme tricolore bleu-blanc-rouge au travers de ses partis régionalistes et autonomistes, la population alsacienne est donc à présent confrontée au jacobinisme brun. Sa force n’est pas moindre, tant s’en faut. Depuis que, le 30 janvier 1934, le Reichstag a adopté la loi dite de « la reconstruction du Reicn166 », l’organisation territoriale au pays connaît un changement institutionnel majeur. Réalisant l’un de ses rêves du début, le nazisme a fait passer l’Allemagne du statut d’État fédéral, réputé faible, à celui d’État national, centralise et fort. Les droits historiques et souverains des Länder ont été transmis au Reich, les gouvernements régionaux subordonnés au gouvernement central et placés sous la surveillance administrative du ministre de l’Intérieur du Reich. Dès lors, le centralisme règne d’autant plus en maître à Berlin que, le 1er décembre 1933, a été promulguée la « loi pour la garantie de l’unité du parti et du Reich » assurant une confusion absolue entre l’appareil d’État et l’appareil de la NSDAP : deux appareils imbriqués et totalement régis par le Führerprinzip, avec un seul Führer à leur sommet.
(p.305) Réduites à elles-mêmes, les familles vont tenter – avec leurs faibles moyens – de s’opposer à cette mesure unanimement rejetée. Les premiers incidents se produisent dès les premiers départs d’octobre 1942 oui voient alors de vrais actes de rébellion. Des réfractaires se cachent ; d’autres se mutilent ou produisent des faux dossiers médicaux. Des milliers de mobilisables choisissent la fuite en Suisse ou bien lors du passage de la frontière. Des incorporés refusent de prêter serment : ils sont aussitôt envoyés en camp de concentration. « Une véritable terreur s’abat alors sur l’Alsace : elle multiplie condamnations à mort, tortures et séjours en camps de rééducation à Schirmeck, dont le seul nom devient jusqu’à la Libération synonyme de tortures et de sévices176. » Puis les mesures d’intimidation se font de plus en plus impitoyables. Le 16 février 1943, treize jeunes de Ballersdorf dans le Sundgau, qui tentent de suivre en Suisse les 800 autres déjà passés, sont pris, condamnés à mort et exécutés au Struthof. Les familles des suppliciés sont transplantées dans le Reich en camp de travail. Par la suite, une ordonnance du 1er octobre 1943 introduira « légalement » le Sippenhaft, la responsabilité collective de tous ceux qui habitent sous le même toit que le réfractaire. Elle les menace de déportation dans le Reich, en Pologne ou dans les Carpates, avec séquestration des biens. L’historien Bernard Vogler recensera au total 3549 cas177.
/après le 8 mai 1945, il s’agit / (p.333) d’« assurer le rattachement définitif de l’Alsace à la France ». « L’objectif était non plus seulement de réprimer les crimes et les délits, mais encore d’assainir pour l’avenir l’atmosphère politique dans les départements du Rhin. On voulait protéger l’unité nationale et rendre la revendication allemande sur l’Alsace impossible dans le futur272. » Ainsi la politique de la France va-t-elle vite se clarifier : certes dénazifier, mais surtout « dégermaniser » définitivement l’Alsace, accessoirement la Moselle. En attendant, désir de vengeance, cupidité, calomnie, dénonciations, arrestations hâtives et arbitraires, internements et déportations injustes vont se donner libre-cours. D’autant qu’au nom de la politique qu’elles sont chargées de mettre en oeuvre, les nouvelles autorités feront de leur mieux pour encourager la délation. Le drame des camps d’internement Au total, 45 000 Alsaciens et Lorrains ont été internés dans le cadre de l’épuration273. Haelling, le nouveau préfet du Bas-Rhin fait sienne la devise des jacobins d’antan, jadis imprimée sur les assignats : « la Nation récompense le dénonciateur » et affirme : « Je préfère inculper 200 innocents que de laisser en liberté un coupable ». Cornut-Gentille son successeur confirme les promesses de récompense274 et les justifie : « aider l’administration et la justice dans la tâche d’épuration légale est un devoir civique auquel personne ne doit se dérober ». Résultat : on arrête à tort et à travers, « les prisons sont combles, la place manque pour loger les détenus ». D’autant que la chasse aux collaborateurs nazis, à ceux que Vonau appelle les « acolytes », s’étend très vite. Pour les épurateurs, l’autonomisme devient preuve de collaboration, tous les autonomistes – sans distinction – sont considérés comme des traîtres, quelle qu’ait pu être leur attitude sous l’Occupation. Or avant la guerre, dans leurs différentes nuances, ils représentaient la majorité des élus locaux et des parlementaires, 60% des électeurs ! Par un raisonnement pernicieux, on les rend responsables de l’annexion de facto et de son crime suprême, l’incorporation de force. « S’ils n’avaient pas milité pour la langue allemande, la défense de l’alsacianité et du particularisme régional, s’il n’y avait pas eu de mouvement autonomiste, les Allemands n’auraient pas songé à une annexion », leur dira-t-on. Comme si au Luxembourg où il n’y avait pas eu de mouvement analogue à celui des Heimatrechtler alsaciens, les nazis n’avaient pas pratiqué la même politique. Comme si en 1871 Bismarck n’avait pas exigé la cession de l’Elsass-Lothringen en l’absence de tout parti autonomiste ! En réalité, comme l’écrira Robert Heitz, le résistant gaulliste condamné à mort par le Reichskriegsgericht, « les véritables responsables [de l’annexion déguisée] furent les politiciens français qui ne surent ni éviter la guerre, ni la préparer, ni la gagner. » Mais plutôt que de pointer ces responsabilités effectives, les nouvelles autorités républicaines préfèrent qu’on s’en prenne à des boucs émissaires pour pratiquer, selon ‘expression de Camille Dahlet, « une des persécutions politiques les plus cyniques de l’histoire alsacienne ». (p.334) Dénoncés à tort ou à raison, les emprisonnés officiellement placés sous le régime de « l’internement administratif » seront détenus pour des durées variables et en différents lieux : sur Strasbourg à la Gallia, au Lycée Fustel de Coulanges, dans les Forts puis à la Meinau, a Sélestat, à Colmar, Stosswihr, Masevaux, Thann, Sainte-Marie-aux-Mines, Altkirch. Les conditions de détention y sont sévères, l’alimentation insuffisante, les privations et humiliations nombreuses pour des hommes, des femmes, des femmes enceintes, des vieillards, des impotents, des enfants et des bébés entassés là, pêle- mêle, frappés par des mesures arbitraires, sans même être passés devant un tribunal. Elles y seront cependant moins mauvaises que dans les camps de Schirmeck et surtout du Struthof, rouverts par les FFI en janvier 1945. À leurs débuts, ceux-ci reçoivent des détenus civils allemands arrêtés dans le cadre des mesures préventives imposées par la poursuite des combats. Puis ils voient arriver ces authentiques collaborateurs qu’avaient été les miliciens français, les doriotistes reflués en Alsace et les quelques cadres alsaciens des organisations nazies. Par la suite, 3000 personnes seront internées en moyenne à Schirmeck, 4000 à 5000 au nouveau Struthof français. S’y côtoient des étrangers, des individus fortement compromis et encourant des peines sévères, ainsi que de simples suspects, le plus souvent arrêtés sur une simple dénonciation, puis internés sans passage préalable devant un juge. Il ne saurait être question de mettre sur le même plan les deux Struthof successifs. Dans le camp français, il n’y eut ni chambre à gaz, ni crématoire. Il ne s’agissait évidemment pas de camp d’extermination. Pourtant, Marilène Hoffet, pasteur venue assister les détenus dans le cadre de l’aumônerie protestante, a pu observer que « le sadisme qui était dans l’air avait bien des points communs avec celui qui venait de régner dans ces lieux ». Et ce témoin indiscutable de donner maints exemples de la maltraitance infligée par les gardiens aux ordres d’un chef de camp, qualifié de « brute épaisse ». L’historien Roland Oberlé confirme ces témoignages concordants sur « leur comportement qui ne cédait en rien, en violence et en brutalité, à celui de la chiourme nazie ». Bernard Schwengler, politologue, explique que « le sentiment de haine et de vengeance, l’idée d’avoir a punir des « traîtres », des « boches », des « nazis », des « bourreaux » entraîna pour les victimes de ces internements une multiplication de mauvais traitements allant jusqu’à des pratiques de torture et des assassinats275 ». À Schirmeck, le camp est commandé par un certain Weber qui manie volontiers lui-même la cravache. Au Struthof, le « commandant » FFI Sibille sera rapidement démis de ses fonctions avec 35 de ses gardiens pour vols, actes sadiques et tortures sur les internés, pour être remplacé par un communiste de Lingolsheim, Rohfritsch, oui journellement fera lever le drapeau rouge en même temps que les couleurs tricolores et dotera les gardiens d’un insigne étoilé représentant la faucille et le marteau. Parmi les cibles des mauvais traitements, les religieux des deux confessions seront particulièrement visés : chez les pasteurs internés Brumt, Deckert, Frey, Neumann, Kaufman, ainsi que Guggenbühl, qui avait déjà connu les camps de Saint-Dié et d’Arches en 1940 et avait tiré de cette expérience un livre publié en 1942276 ; (p.335) chez les prêtres catholiques les abbés Jenn, Rauch, Cridlig, Muller, de Baulin et d’autres, dont l’abbé Brauner, qui y sera martyrisé à mort le 10 janvier dans des circonstances racontées par ae nombreux témoins277. Il avait connu la prison à Nancy en 1939-40 et après l’odyssée des Nanziger, il avait repris ses activités aux Archives et à la Bibliothèque municipales, dont il redevenu directeur avant qu’on vienne à nouveau l’interner, sans motif aucun.
(p.335) Fin août 1945,Robert Heitz qui, de retour de captivité, est devenu président de la section bas-rhinoise de l’Association des internés et déportés politiques d’Alsace (AIDPA) est invité à passer au quai Lezay-Marnésia voir en urgence le directeur de (p.336) cabinet du commissaire de la République. Il raconte : « Il paraissait que le préfet Cornut avait réussi à convaincre le commissaire Bollaert qu’il fallait frapper un grand coup contre les villages protestants du Bas-Rhin, notoirement germanophiles. Ils étaient décidés à faire déporter dans le Sud-Ouest de la France, sans autre forme de procès, tous les habitants des quatre « noyaux » peu sûrs, à savoir les secteurs de : 1) Ittenneim-Furdenheim, 2) Sarre-Union, 3) Bouxwiller-lngwiller, 4) Hatten-Hunspach. Rien que cela. — Voyons, voyons… Les épurés peut-être, les condamnés ? — Pas du tout. Les autres, tous les autres ! Je demandai un rendez-vous d’urgence à Bollaert et l’obtins pour le lendemain matin. Pendant quatre heures d’horloge, je me battis contre ses flots de salive, ses trémolos, ses adjurations patriotiques : « Pensez à nos camarades morts ! ». Aucun argument de raison ne semblait toucher cet esprit pourri par la phraséologie. — Mais croyez-vous donc que, quand ils rentreront sur leurs lopins de terre, ces paysans seront devenus de meilleurs Français ? — Il n’est pas question qu’ils rentrent. Leur expulsion sera définitive. » À croire Heitz, ce n’est qu’au bout de quatre heures de discussions que Bollaert se mit à flancher et par céder à ses arguments… ou à la faim : il était deux heures de l’après-midi. Plus tard, Cornut-Gentille remerciera le président bas-rhinois de l’AIDPA « de lui avoir évité la gaffe la plus monumentale de sa vie282 ». Ce que ce dernier omet cependant de dire dans ce récit où il se donne le beau rôle, c’est que le fantôme de l’abbé Rousseville qui avait suggéré au préfet Cornut et au commissaire Bollaert la déportation des paysans alsaciens dans le Sud-Ouest français – dans la continuité de ses préconisations de 1939-40 aux services de Valot et conformément aux projets des jacobins-robespierristes de 1793 – s’était aussi manifesté aux deux dirigeants de la propre association de Robert Heitz, puisque c’est d’eux que venait la proposition initiale ! En effet, courant août 1945, l’Association des internés et déportés politiques d’Alsace avait rédigé un rapport, intitulé Questions alsaciennes, sous-titré « Pour un retour rapide et total de l’Alsace à la France ». Son contenu : des propositions sur diverses questions urgentes d’ordre politique (épuration et assimilation à la France), économique et social (enseignement, police, prisonniers de guerre…), censées permettre « la réadaptation [des Alsaciens] à la vie française [p. 1] », car « la lutte contre la France en Alsace avait [selon lui] déjà commencé [p. 113] ». L’auteur principal en était René Mengus, en tant que président de la commission d’enquête de l’AIDPA. Il avait été seconde par Y. Bouchard, président de l’Association et aidé par Robert Heitz, président de la section au Bas-Rhin. Mengus avait été condamné à mort, le 16 juillet 1943, par le Volksgerichtshof, (p.337) avec Alphonse Adam et huit autres camarades283 tous accusés de haute trahison, d’activisme contre le Reich et ses soldats et d’aide aux prisonniers de guerre. Cependant, contrairement aux membres du groupe, Mengus n’avait pas été exécuté, mais interné dans la Festungshaftanstalt de Lanasberg-am-Lech. Libéré par les troupes alliées, il était revenu en Alsace avec un profond sentiment de vengeance. Son rapport, qui sera remis aux préfets et « aux chefs de l’épuration [sic] » entend constituer un manuel pour une épuration radicale indiquant la marche à suivre pour châtier dix catégories de coupables pour lesquelles est prévu le « tarif [sic] » des peines à appliquer. Les « autonomistes », catégorie unique englobant indistinctement « membres du parti autonomiste [?], cléricaux et communistes dissidents » sont classés au sommet de l’échelle des peines, immédiatement après les « collaborationnistes », sans qu’il soit question de tenir compte des attitudes individuelles. Leurs dirigeants doivent être frappés d’interdiction de séjour, leurs « sympathisants » exclus des emplois publics, ceux qui « ont joué un rôle dans la coalition » y compris les curés et pasteurs, éloignés d’Alsace284. Une annexe spéciale de ce rapport285 traite du thème des « villages allemands ». Sont particulièrement concernés par cette appellation l’arrondissement de Saverne, les cantons de Sarre-Union, Drulingen et de La- Petite-Pierre (soit l’Alsace Bossue), mais aussi ceux de Bouxwiller, Niederbronn-les-Bains, Woerth, Soultz-Sous-Forêts, Wissembourg, Bischwiller, Brumath et de Wasselonne. Les rapporteurs préconisent d’y « prendre des mesures totales et rapides ». L’une d’elles est tout simplement de transplanter les populations concernées vers l’intérieur de la France ! Pour « justifier » une proposition aussi insensée, le même Mengus expliquera – lors de la création de la section bas-rhinoise de l’Association nationale des familles des fusillés et massacrés – que « l’Alsace n’est pas assez française », que « la population de l’Alsace Bossue, par exemple, est composée de 90% de Boches et, au grand maximum, de 10% de Français286 ». À ce niveau, ce n’est plus du patriotisme, ni même de l’hyperpatriotisme, mais du délire hystérique le plus total !
(p.339) Parmi les criminels ayant sévi en Alsace, l’ancien commandant du camp du Struthof, Joseph Kraemer, arrêté à Bergen-Belsen, condamné à mort par un tribunal militaire britannique, sera pendu le 12 décembre 1945. Par contre, l’Obersturmführer SS Karl Buck commandant le camp de Schirmeck, arrêté dès 1945, après avoir été témoin au procès de Wagner, sera d’abord condamné à mort pour assassinat en 1946 par un tribunal militaire britannique, puis une seconde fois à mort le 18 mars 1947 à Rastatt, puis encore une fois en janvier 1953, par le tribunal militaire de Metz. Remis en liberté en 1955, il terminera paisiblement ses jours en juin 1977, âgé de 80 ans. Plusieurs autres bourreaux de l’Alsace connaîtront également un sort clément, tels par exemple les chefs de la Gestapo de Colmar ou encore ces « médecins » de l’université nazie de Strasbourg qui avaient fait des expériences au Struthof sur des juifs, des tziganes, des Polonais, des Russes. Les uns réussissent à disparaître en 1945, les autres, condamnés par le tribunal militaire de Metz en 1952, seront libérés moins de trois ans après295. (p.358) 280. Le cas de l’abbé Lucien Jenn est caractéristique des pratiques honteuses alors couvertes par la IVe République naissante. Arrêté le 12 janvier 1945 par les FFI dans son presbytère de Bischhoffsheim, suite à une dénonciation calomnieuse, et interné au camp de Schirmeck, il est libéré le 5 avril, toutefois astreint à résidence au couvent du mont Sainte-Odile. Mais, pour s’y être rendu avec retard, il sera renvoyé à Schirmeck le 30 avril. De là, pour avoir fait un sermon en allemand afin d’être compris des fidèles, le 3 juin, il sera transféré au camp du Struthof – sous le matricule B. XV n° 5608 – pour n’y être libéré le 22 décembre 1945 après y avoir subi sévices et humiliations, sans avoir vu un seul juge… (p.363) En même temps, la culpabilité va lourdement peser. Mais le malaise profond qui va en résulter se manifestera très différemment de celui de 1918 : au lieu de s’exprimer sur la place publique, il sera complètement intériorisé. La plupart des rescapés se tiendront à l’écart de la vie politique, d’autant que certains hyperpatriotes les feront passer volontiers pour des traîtres, voire comme d’anciens nazis, leur faisant parfois subir l’épuration, à l’instar des collaborateurs ayant soutenu l’occupant allemand. Quand ils dénonceront le vécu dans les camps d’internement soviétiques et quand ils témoigneront des conditions de vie et de la guerre à l’Est, ils seront même très violemment attaqués par un Parti communiste français qui avait besoin de faire oublier sa passivité, après le pacte germano-soviétique, jusqu’à l’opération Barbarossa. Dans un contexte de patriotisme hystérisé, beaucoup d’Alsaciens vont alors laisser se développer en eux un complexe d’infériorité4 par rapport au reste des Français, lié à leur culture qui est celle de l’ennemi, à leur connaissance insuffisante de la langue française… et à leur accent. Ach ! Ce fichu accent ! Que ne feraient-ils pas bientôt pour pouvoir s’en débarrasser ? « C’est tellement plus chic de parler français ! » leur expliquera-t-on sur les affiches apposées dans toutes les rues et cours d’école. D’ailleurs, Mgr Ruch, interdit de retour au pays par les Allemands en 1940, n’a-t-il pas à la Libération5 adressé à ses ouailles alsaciennes, depuis le Sud-Ouest où on l’avait relégué, un message leur disant qu’il n’était plus défendu de « respirer un air français, de parler, d’écrire ou de prier en langue française, d’agir, de mourir Français » ? En fait, les Alsaciens ne le savent pas encore, du moins pas tous : en 1945, l’idée régionaliste va sombrer corps et biens !
(p.364) L’Église catholique prend très tôt ce chemin, pour ce qui concerne le particularisme linguistique, qu’elle va sacrifier sur l’autel des particularismes scolaire et religieux. Par un acte quasi historique, les évêques de Strasbourg et Metz envoient un signal fort le 9 juillet 1946 : ils ordonnent à leur base de ne plus assurer le catéchisme qu’en français, alors qu’en ce temps-là, 40% des enfants ignorent la langue de Molière ! À cette fin, sont d’ailleurs immédiatement imprimés les supports écrits nécessaires. C’est que la hiérarchie catholique, qui doit passer des compromis délicats, vient de réussir sa négociation donnant-donnant : le Concordat et un statut scolaire favorable contre la renonciation de l’Église à défendre la langue allemande. Dans le contexte de la naissance de la IVe république et de l’accouchement difficile de la constitution de 1946, les évêques doivent aussi trouver de nouveaux modes de coopération avec un parti catholique profondément renouvelé depuis l’arrivée du MRP8.
(p.369) Et voici qu’un peu plus de dix ans après, le paysage change du tout au tout. En 2009, Unser Land, le Mouvement alsacien relaye l’Union du peuple alsacien/ Elsâssische Volksunion, suite à un regroupement avec l’association de jeunes Fer’s Elsass. En mars 2015, des élections sont organisées pour mandater de nouveaux conseillers départementaux. Première surprise : le nombre de candidats. Plus d’un canton sur deux est couvert par une candidature Unser Land, qui présente des candidatures sur 24 des 40 cantons que compte l’Alsace, soit un taux de couverture de 60%. Or le taux de couverture était d’à peine 22% en 2011 (huit candidatures sur les 36 cantons renouvelables en Alsace). Deuxième surprise : le nombre de suffrages recueillis. Cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix- sept électeurs font confiance à Unser Land, ce qui représente 9,23 % des suffrages exprimés sur toute la région. Unser Land recueille ainsi plus de voix que le PS, Europe Ecologie et tous les partis de gauche, qui pourtant bénéficient d’un large appui des médias nationaux et parfois d’un temps de parole disproportionné dans les émissions et débats locaux. Troisième surprise : le pourcentage de votants. Le score moyen réalisé par les candidats Unser Land est de 14,40%. Le parti dépasse les 10% dans 22 des 24 cantons. Dans le canton de Saint-Louis, les candidats Unser Land manquent le second tour de 24 voix seulement. Unser Land dépasse les 20% dans plus d’une centaine de communes et franchit la barre des 30% dans une vingtaine de localités. Parti de rien il y a une dizaine d’années, Unser Land est ainsi devenu l’une des principales forces régionalistes de l’hexagone avec des scores comparables à ceux enregistrés par ses alliés en Corse et au Pays-Basque.
(p.372) Le cas du Mosellan Robert Schuman confirme à quel point le « relèvement » avait été arbitraire : à la Libération, le ministre de la Guerre, André Diethelm, exige que « soit vidé sur-le-champ ce produit de Vichy » en parlant de Schuman. Cette aualification vient de son vote du 10 juillet 1940 et comme « ex-ministre de Pétain » (un mois). Son vote des pleins pouvoirs à Pétain le met sous le coup de l’inéligibilité automatique prévue par l’ordonnance du 21 avril 1944 et, comme ancien ministre de Pétain, il est frappé « d’indignité nationale ». Souhaitant reprendre des responsabilités politiques, il finit par écrire au général de Gaulle, le 24 juillet 1945, pour lui demander de revenir sur cette décision. Des amis MRP de Schuman interviennent auprès du chef du Gouvernement provisoire pour appuyer cette demande. De Gaulle décide que l’affaire soit classée. La commission de la Haute-Cour prononce un non-lieu en sa faveur, le 15 septembre 1945, et Robert Schuman pourra immédiatement reprendre sa carrière politique française. Il retrouve son siège de député de la Moselle (MRP) dès 1946 et deviendra président du Conseil des ministres en 1947.
(p.372) Seuls le sont les journaux francophones ou bilingues ; ces derniers doivent contenir plus de 25% de textes en français ; leurs rubriques sportives ou destinées à la jeunesse seront obligatoirement en français. Les titres des journaux et des rubriques le seront idem.
|
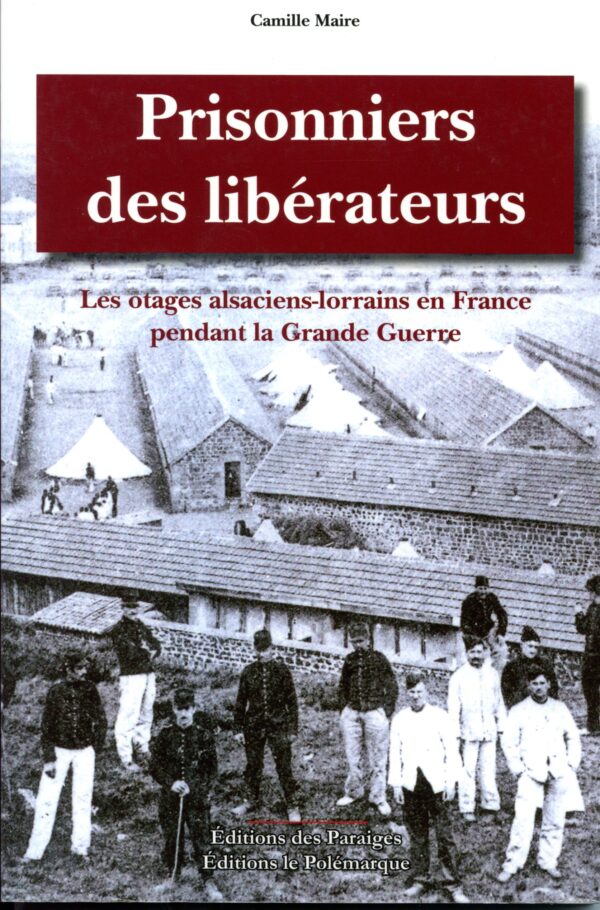
1914-18
Camille Maire, Prisonniers des libérateurs, éd. des Paraiges, 2014
Les otages alsaciens-lorrains en France pendant la Grande Guerre
Cet ouvrage propose de lever le voile sur les « dommages collatéraux », méconnus, voire inconnus, de la Première Guerre mondiale pour les Alsaciens- Lorrains : les nombreuses prises d’otages de civils innocents — parmi lesquels des femmes, des enfants et des vieillards — opérées par les troupes françaises en retraite et le sort réservé, en France, aux malheureux acteurs de ces événements, traînés brutalement en captivité.
Des camps de concentration français, éloignés des frontières et de la zone des combats, furent aménagés à la hâte. Ecoles, séminaires, casernes, couvents, fabriques désaffectées, arènes furent utilisés pour loger les détenus dans des conditions pitoyables.
Près de cent ans plus tard, il est temps de montrer que les exactions commises pendant la guerre n’étaient pas l’apanage des envahisseurs allemands. Les souffrances que les Alsaciens-Lorrains ont dû endurer en France sont-elles plus excusables parce que leurs auteurs, militaires et civils, sont français ?
Professeur honoraire, Camille Maire est originaire du pays de Sarrebourg. Outre ses travaux sur les otages alsaciens-lorrains, il a soutenu une thèse consacrée à l’émigration des Lorrains en Amérique au XIXe siècle, sujet sur lequel il a publié plusieurs ouvrages.
(p.7) (…) qu’en est-il des civils innocents, parmi lesquels des femmes, des enfants et des vieillards, enlevés par les Français en Alsace-Lorraine ? (p.8) Rien, ou si peu[1]. Il y a bien, ici et là, quelques allusions aux otages saisis par les Français, mais présentés comme allant de soi ou parfaitement justifiés. Ainsi, la Dépêche (Toulouse) du 11 août 1914 écrit-elle, sous le titre « Quelques otages sont pris par la France » : « En raison de l’exécution injustifiée de sujets français par les Allemands [en Alsace], on a pris comme otages sept notables de Montreux-Vieux. » Dans un ouvrage paru en 1918 et à propos de l’arrestation de femmes en Haute- Alsace, Fauteur écrit sans sourciller : « On les avait tout simplement envoyées en France, sans les séparer, d’ailleurs, de leurs enfants[2]. » Les Français avaient donc fait preuve de beaucoup d’humanité en ne séparant pas les enfants de leurs mères !
Les camps de concentration français, éloignés des frontières et de la zone des combats, ont été aménagés à la hâte. Ecoles, séminaires, casernes, couvents, fabriques désaffectées, arènes ont été utilisés pour loger les détenus dans des conditions pitoyables. Peu d’hygiène, nourriture insuffisante et de qualité médiocre, brimades des gardiens et de la population furent leur lot quotidien. Mais c’est la séparation de leurs familles qui leur pesait le plus avec un courrier intermittent et soumis aux caprices des responsables des dépôts. A cela s’ajoutait l’incertitude du lendemain et la méconnaissance des événements de la guerre. (p.9) Quel camp allait en sortit vainqueur ? Il leur arrivait d’envier les prisonniers de droit commun qui, eux, avaient été jugés et connaissaient le terme de leur détention.
Libérés pour la plupart en juillet 1918, les otages d’Alsace-Lorraine sont rentrés dans leurs foyers et ont repris les occupations de leur métier, aigris d’avoir été traités en ennemis par des soldats que beaucoup avaient accueillis en libérateurs. Ensuite les otages des Français restèrent dans l’ombre. Et on les oublia, alors que leurs compatriotes, prisonniers d’Ehrenbreitstein 3, se faisaient connaître, étaient fêtés comme des héros rescapés des geôles et de la barbarie teutonnes. Les souffrances que les Alsaciens-Lorrains avaient dû endurer en France étaient- elles plus excusables parce que leurs auteurs, militaires et civils, étaient français ?
Près de cent ans plus tard, il est temps, répétons-le, de montrer que les exactions commises pendant la guerre n’étaient pas l’apanage des envahisseurs allemands. En saisissant et en déportant des centaines d’otages innocents des provinces qu’ils prétendaient libérer, les soldats français ont, malheureusement, montré qu’ils étaient capables d’égaler le manque d’aménité et la brutalité aveugle de leurs adversaires. [3]
(p.12-13) Les archives concernant l’internement des Alsaciens- Lorrains en France ont été consultées dans les départements suivants (archives départementales) :
Ardèche/Privas, pour le camp de Viviers.
Aveyron/Rodez, pour les camps de Rodez, d’Espalion et de Saint-Affrique.
Bouches-du-Rhône/Marseille, pour les camps de Saint- Rémy-de-Provence et Saint-Michel de Frigolet (Tarascon).
Creuse/Guéret, pour les camps d’Aurec et d’Ajain.
Hérault/Montpellier, pour les camps de Béziers (arènes et Plaisance).
Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand, pour les camps de La Fontaine du Berger et d’Issoire.
iMoselle/Metz, dossiers d’indemnisation des otages lorrains qui rendent compte, plus ou moins longuement, de leur arrestation et de leur séjour dans divers camps français.
Aucun document ne subsiste concernant la maison de correction d’Epinal (archives départementales des Vosges/ Epinal) et les camps provisoires de Moulins (archives départementales de l’Allier/Moulins).
(p.15) Arrestations – Evacuations
« Les otages étaient ramassés sur les routes, dans les champs, dans les villages, dans leurs demeures et obligés de se concentrer en un lieu déterminé. » C’est ainsi que deux auteurs français déjà cités1 décrivent la manière d’agir des Allemands en Belgique et dans les départements français du Nord et de l’Est.
Les Français pénètrent en Lorraine et en Alsace à partir du 6 août 1914, occupent une frange du Reichsland qu’ils sont obligés d’évacuer2 après les batailles de Morhange et de Sarrebourg, le 23 août. Au cours de cette présence d’une quinzaine de jours, ils saisissent plusieurs centaines d’otages en utilisant des méthodes qui n’ont rien à envier à celles des Allemands.
(p.17) Mais, dans la majorité des cas, les gens sont appréhendés avec beaucoup moins d’égards, et sans aucune explication, tandis qu’ils sont occupés aux tâches ordinaires de leur métier ou inoccupés, chez eux ou dans la rue. A Lorquin, où l’asile d’aliénés a été transformé en hôpital militaire de campagne, le docteur Gerich, un Allemand, soigne les nombreux blessés des deux camps aidé par des Lorquinois volontaires, dont le jeune Félicien Thomas, candidat notaire, en vacances chez sa mère. Le 22 août, un officier français se présente pour s’assurer de la personne du docteur. La femme de celui-ci demande à Thomas d’intervenir pour connaître les raisons de l’arrestation de son mari. Il est roué de coups et emmené sans ménagement avec le docteur.
Charles Schwartz, pâtre communal, est pris alors qu’il garde son troupeau près du petit village de Fribourg ; Germaine Chevreux en revenant de son travail de moissonneuse dans son village (Manhoué, près de Château- Salins) ; Victor Bournique, de Vasperviller en conduisant deux vaches au village voisin de Saint-Quirin ; Willy Haas, de Sarrebourg, en allant chercher de l’herbe pour ses lapins. Nicolas Meyer, de Hartzviller, père de six enfants en bas âge, était allé voir si son avoine était sèche. Il voulait la rentrer et la battre pour la vendre aux troupes françaises. Il est arrêté comme espion.
(p.18) (…) Quelques-uns se disent victimes de dénonciation, comme Joseph Fleurant, de Bisping, village dont l’instituteur, Jules Griette, est également emmené par les Français. Victor Strazielle, instituteur de Niderhoff, croit que c’est son collègue de Bertrambois — village français, à trois kilomètres de Niderhoff— qui l’a dénoncé parce qu’il aurait battu un élève qui chantait la Marseillaise !
Ceux de la montagne, qui ont aidé les soldats français en leur servant de guides et qui sont retenus sans même pouvoir faire leurs adieux à leur famille, sont particulièrement révoltés. Ainsi Joseph Reno, de Brouderdorf : « On ne me laisse pas retourner chez moi, ma besogne accomplie », écrit-il. Florent Halter, de Walscheid, est « emmené par les troupes françaises auxquelles il montrait un chemin de forêt ». A Buhl, le 19 août, les nombreux blessés ont été rassemblés à l’église, mais il n’y a pas de médecin pour les soigner. Le jeune Adam Schiwy propose d’aller en chercher un à Sarrebourg, à trois kilomètres. Il enfourche sa bicyclette, mais un poste fixe à l’entrée de la ville l’empêche d’aller plus loin. Il est emmené à la sous- préfecture puis emprisonné avec une trentaine d’hommes et de femmes, les nombreux otages de la ville[4] [5].
Beaucoup d’autres sont appréhendés à leur domicile, comme Joseph Hantzo, de Brouderdorff : « J’étais dans la maison n° 45, un officier entra et me somma de le suivre avec une lanterne. » Sa femme ne le reverra que quatre ans plus tard.
Certains vont bientôt se retrouver en prison simplement parce que leur comportement n’a pas plu aux soldats français5. A Maizières-lès-Vic, d’après un témoin, « à l’arrivée (p.19) des Français, le maire Bouchy, l’instituteur Velting, le fermier Heck, un Bavarois, et une quatrième personne se trouvaient à la mairie. En présence des Français, les quatre parlaient allemand, ce qui aurait motivé leur arrestation[6] [7] ». A Haut- Clocher, au nord-ouest de Sarrebourg, le père Degrelle, quatre-vingt-quatre ans, qui a servi dans l’artillerie à la guerre de soixante-dix, apercevant des canons français près du village, s’en approche pour satisfaire sa curiosité. Il est embarqué sans ménagements, malgré son grand âge ; c’est un espion. Le 19 août, dans le même village, les blessés sont regroupés dans l’école sur la façade de laquelle un drapeau de la Croix-Rouge a été placé par l’appariteur Joseph Niva, à la demande d’un médecin major. Le lendemain, un soldat ordonne à Niva de placer le drapeau plus bas. Lorsqu’il s’exécute, un officier de chasseurs à cheval intervient et l’apostrophe : « Vous avez fait des signaux aux Allemands avec votre drapeau, je vais vous faire emmener[8]. » Et Niva, malgré ses protestations, se trouve poussé par les soldats en retraite avec plusieurs membres du conseil municipal réunis au préalable à la mairie.
(p.21) Saales est une petite ville de Basse-Alsace située à la frontière du département des Vosges. C’est un chef-lieu de canton de quelque mille deux cents habitants qui compte son lot de fonctionnaires, parmi lesquels des immigrés.
Au moment de l’attaque française, le 11 août à dix heures et demie, les troupes allemandes, un escadron de cavalerie et une compagnie de cyclistes, évacuent la ville et se replient. Plusieurs fonctionnaires les accompagnent. L’un d’eux a raconté qu’à son retour, le 15 août, il a (p.22) constaté que sa femme avait disparu de sa maison, saccagée par les Français. Il l’a cherchée en ville, en vain. Il a pu alors se rendre compte que onze femmes de fonctionnaires, vingt enfants et deux jeunes filles avaient été enlevés par les Français avec trois femmes employées au sanatorium voisin de Tannenberg et leurs cinq enfants[9]. Une « dame de Saales » a raconté son expérience d’otage des Français après un retour de captivité exceptionnellement rapide et sur lequel nous reviendrons plus loin[10] :
C’est le 12 août que ma mère, ma sœur et moi avons été arrêtées par des gendarmes français, sous prétexte que je n’avais pas obtenu la permission de porter le brassard de la Croix-Rouge et de soigner les blessés. Le drapeau de la Croix-Rouge, qui avait été hissé alors que les troupes allemandes se trouvaient à Saales, fut abaissé et déchiré par une patrouille [française], après que notre maison, dans laquelle se trouvait encore un soldat allemand gravement blessé, a été bombardée en vain pendant deux heures. On ne nous permit pas d’emporter le strict nécessaire. On nous accorda deux minutes, puis des soldats baïonnette au canon nous conduisirent à la mairie, où nous aurions été obligées de coucher à même le carrelage si des lits n’avaient pas été mis à notre disposition par le maire. Le lendemain à trois heures et demie on nous emmena avec dix-huit fonctionnaires et habitants de Saales ; les femmes étaient dans des charrettes, les hommes allaient à pied. A Provenchères, on nous fit entrer dans un local extraordinairement sale de la gendarmerie où nous nous assîmes à même les dalles jusque dans l’après- midi. Ensuite, nous reprîmes notre chemin de souffrances en direction de Saint-Dié. Les mots ne peuvent décrire les (p.23) insultes les plus obscènes qui nous étaient adressées. On nous jetait des pierres et les femmes se conduisirent d’une façon qu’il est impossible d’imaginer. Dans chaque tallage, nous étions accueillis par leurs visages qui grimaçaient et hurlaient. En chemin, nous croisâmes tout le 14e Corps d’armée qui se dirigeait vers l’Allemagne. Aucune trace de discipline : même les officiers se comportaient comme leurs hommes et insultaient les femmes sans défense. Nous ne pouvions pas avancer car les soldats empêchaient notre voiture de passer et nous dûmes attendre plus d’une demi-heure et supporter les injures les plus grossières.
Dans son livre de souvenirs, l’institutrice Elisa Rossignol a raconté l’arrestation de son père en Haute Alsace. 11 était allé au canal voisin, espérant rapporter une friture, lorsqu’un gamin vint le prévenir qu’il devait se rendre à la mairie du village. Il y subit un premier interrogatoire en compagnie d’une demi- douzaine de cheminots. Dehors, un camion attendait. « Au départ, mon père était optimiste, il trouvait normal qu’un contrôle fût exécuté sur les civils. Mais quand, à Belfort, on ne les interrogea même pas, qu’on les enferma dans les W.C. de la gare et qu’ils furent embarqués dans des wagons à bestiaux, il comprit que la petite formalité prenait un mauvais tour. » Il est finalement interné à l’île de Groix après avoir transité par Moulins et Hennebont. « Souffrir seul, il le pouvait ; mais il étouffait de rage en pensant au désarroi des siens. Comment supporteraient-ils cette infamie[11] ? »
Si, comme les femmes de Saales, les otages subissent la fureur des civils français sitôt la frontière franchie — on en verra encore plusieurs exemples — les militaires qui les appréhendent dans la Terre d’Empire les traitent souvent avec une brutalité telle qu’elle ne laisse pas d’étonner et de révolter le lecteur de leurs plaintes. Des civils ! Des femmes, (p.24) des enfants et des vieillards ! Qui, comme l’écrit l’un d’eux, « vers lesquels [les soldats français] ils étaient venus avec la plus sincère confiance et les sentiments les plus amicaux[12] ». Heureusement, la plupart des gendarmes, eux, ont toujours eu un comportement correct envers leurs prisonniers, les protégeant parfois contre la fureur aveugle des civils, comme nous aurons l’occasion de le voir.
« Le 10 août, je fus sans motif arrêté par l’autorité militaire, le 58e RI. La corde au cou, pieds nus, je fus contraint de quitter mon foyer », écrit Emile Jacquot, de Moncourt[13]. Quant àjoseph Schmitt, pris près de Sarrebourg le 20 août, il passe une nuit entière attaché à un arbre sur l’ordre d’un officier supérieur[14] avant d’être évacué, le lendemain matin, vers Cirey-sur-Vezouze.
(p.25) Évacuations : à pied vers l’inconnu
Nous connaissons bien les péripéties du parcours à pied des otages de la région de Lorquin grâce aux témoignages écrits de François Laurent[15] et de Théo Hommes qui, en deux groupes séparés, l’un précédant l’autre, sont conduits à Baccarat.
Pour tout le monde, la marche est difficile, sur les bas- côtés de la route occupée par les militaires et leurs véhicules et il fait toujours très chaud. À Cirey, les gendarmes ont donné une boîte de singe à Laurent et au juge qui font halte pour la nuit à Harbouey, puis à Nonhigny, presque entièrement détruit par les Allemands quelques jours auparavant. Des tombes fraîches bordent le chemin. En sortant d’un bois, ils aperçoivent au loin un groupe de cavaliers que les gendarmes prennent pour des uhlans (« S’il faut se rendre, on se rendra », dit l’un d’eux.) Mais ce sont des cuirassiers français. Les deux compagnons étanchent leur soif aux fontaines publiques des villages. Avant d’arriver à Sainte- Pôle un violente orage éclate, qui les trempe jusqu’aux os. Ils sont épuisés et se traînent sous les lazzis des militaires qu’ils croisent. A Sainte-Pôle, un de leurs gendarmes entre dans un café et leur achète un litre vin, qu’ils boivent au goulot. Lorsqu’ils arrivent à Baccarat, la population amassée les suit et les insulte : « Zigouillez-les ! A mort les espions, les pillards ! » « D’otages, écrit Laurent, nous étions descendus au rang d’espions et de charognards. »
Comme Laurent, Hommes insiste sur la pénibilité de la marche sous la grande chaleur, surtout pour les deux ouvriers qui ont abandonné leurs sabots et vont pieds nus (p.26) et pour le garde forestier Tiedemann qui n’est plus tout jeune. Dans tous les villages traversés les insultes pleuvent. Même les femmes et les enfants s’en mêlent : « A mort ! A mort ! Tuez-les !» Un officier pris de compassion détache Tiedemann et le fait charger dans une voiture. Dans un village, un militaire se précipite sur Frantz, lui arrache ses lunettes, les jette par terre et les piétine. Plus loin, dans une autre localité, la chaîne de trois prisonniers dont fait partie Hommes est jetée à terre. Autre surprise, dans une forêt un soldat lui offre une gorgée d’eau additionnée d’alcool de menthe, « un geste noble de la part d’un ennemi », apprécie Hommes. Le soir, le groupe arrive à Baccarat.
Des gens sortent en hâte des maisons ; leur chahut, leur insolence ne sont pas une nouveauté. Notre chef d’escorte leur dit à plusieurs reprises que nous sommes des Alsaciens-Lorrains innocents et leur demande de ne pas nous importuner. Il obtient un résultat inattendu : il doit se protéger contre des coups de bâton et encaisser des injures parce qu’il prétend protéger des Boches. « A mort ! Tuez-les ! Ce sont des espions ! » hurle la populace en délire. Des soldats font semblant de nous attaquer à la baïonnette… Quand j’y pense aujourd’hui, je m’étonne encore que notre escorte ait réussi à contenir cette émeute. Et c’est avec soulagement que j’aperçus la porte de la prison. Mais des centaines de manifestants nous y avaient devancés pour nous faire un mauvais sort. Heureusement, nous fûmes bientôt soustraits à leur vue. La liste de leurs triste savoir-faire est éloquente : jets de pierres, crachats, injures de toutes sortes (pillards, vaches, bandits, crapules, fumiers, etc.) et j’en oublie. Je m’en tirai avec quelques heurts et bosses. Enfin nous voilà en prison… Ouf ! À l’abri.
Pour François Laurent et le juge Steffens, Baccarat n’est qu’une étape. A leur arrivée dans la petite ville, ils sont conduits à la gendarmerie. Parqués dans une cour. Ils voient une porte cochère s’ouvrir et s’avancer un autocar. Un lieutenant de gendarmerie et huit gendarmes armés de carabines en descendent. Le lieutenant commande : (p.27) « Approvisionnez ! », et les gendarmes chargent leurs armes. Une deuxième porte s’ouvre et livre passage à une fournée d’otages que Laurent connaît pour la plupart, il y a là deux maires, deux instituteurs, une institutrice et l’abbé Meyer, curé de Hattigny.
Ordre est ensuite donné de laisser sur place les valises et leur contenu. Les gendarmes poussent ensuite tout le monde dans l’autobus, qui démarre sous les huées de la foule massée devant la gendarmerie. Pendant le voyage d’environ deux heures, les gendarmes ne cessent de se moquer de leurs prisonniers, leur disant qu’ils ne sont pas dignes de fouler le sol français. Il y a parmi eux deux Allemands, prisonniers de guerre, qui mordent à belles dents dans du pain blanc et que les gendarmes trouvent dignes de leurs louanges : « Eux, ils ont fait leur devoir », disent-ils. Un gendarme qui circule dans l’allée centrale du bus, s’amuse à distribuer des coups de crosse au hasard. De temps à autre, le véhicule s’arrête et le chauffeur ne manque pas d’expliquer à la population qui se rassemble qu’il transporte des espions allemands, ce qui provoque un flot des habituelles insultes. Les femmes et les jeunes filles, note Laurent, sont les plus enragées.
Tandis que l’autobus de Laurent s’arrête finalement à Rambervillers, la charrette des « dames de Saales » fait son entrée à Saint-Dié :
Des gens par centaines nous attendaient, chacun armé d’un gourdin ou de quelque autre arme. Avant que nous soyons arrivées en ville, il y en avait des milliers et le tumulte était indescriptible On nous fit faire un détour afin que la foule puisse nous tourmenter à son aise et nous arrivâmes à la gendarmerie. Notre gendarme n’était pas assez fort pour nous protéger de la meute et ce sont deux déserteurs allemands du 99e Régiment de Réserve qui s’interposèrent. Ils joignirent ensuite leurs voix enthousiastes aux cris de « Vive la France ! » poussés par leurs « frères ». On releva nos noms, puis on nous conduisit à pied à la prison, où les femmes furent logées dans un dortoir isolé[16].
(p.28) Même en supposant que ces arrestations étaient justifiées, pourquoi ont-elles été accompagnées, dans de nombreux cas, de violences absolument gratuites exercées à l’encontre de personnes désarmées, souvent âgées, qui n’avaient pas manifesté la moindre animosité envers les troupes françaises ? Fracture du crâne de l’abbé Meyer, un œil perdu par Charles Schmitt à la suite d’un coup de fouet, coups de crosse à Joseph Heitz qui ne marchait pas assez vite…
Et pourtant, des recommandations avaient été faites aux soldats au moment de franchir la frontière du ReichslancL. Ainsi, au 159e RI : «Vous n’êtes pas ici en territoire ennemi… Vous traiterez les populations comme vous le feriez dans votre pays natal… Toutes les femmes sont vos mères ou vos sœurs, les enfants sont vos enfants. » Ils n’ignoraient certainement pas que l’Alsace ou la Lorraine, ce n’était pas « la véritable Allemagne ». Il s’y trouvait bien des «Allemands authentiques » parmi une population envers laquelle « nous devions nous conduire avec les plus grands égards[17] ».
(p.29) Chapitre II
Premières prisons françaises
Nous avons laissé l’instituteur Hommes au moment où il échappe à la fureur de la populace en se réfugiant dans la prison de Baccarat, au soir du 21 août.
Dans la cour, un des geôliers, « une grande perche », s’en prend à Gerich et Thomas, toujours en blouse blanche et attachés l’un à l’autre. Il se rue sur eux et les roue de coups de poing et de pied en proférant une litanie d’injures. Les deux hommes s’écroulent sur le pavé, ils sont méconnaissables.
A l’intérieur, on les soulage de tout le contenu de leurs poches. Un des gardiens ayant découvert un chapelet, l’exhibe en grimaçant et s’écrie : « Demain, on vous en donnera d’un autre genre. » Et le même énergumène se précipite de nouveau sur Thomas, courbé en deux et qui se protège le visage tant bien que mal. Comme la brute s’apprête à lui assener un coup de crosse, un gendarme réussit à le maîtriser. Puis ils sont enfermés dans des cachots où, après maintes prières renouvelées, on consent enfin à leur donner un peu d’eau.
Le lendemain matin, les prisonniers ont droit à un morceau de pain accompagné d’une boîte de singe et se retrouvent dans la cour. C’est l’heure des chapelets promis. Gerich, Thomas et Tiedemann sont enchaînés ensemble : premier chapelet. Hommes est attaché avec Jacquot, Frantz et les deux ouvriers : deuxième chapelet. C’est alors que le maire de la ville apparaît, rouge de colère, revolver au poing: « Si j’avais été là hier soir, lance-t-il, je vous aurais descendus l’un après l’autre. »
Devant la porte, un camion, moteur ronflant, attend son chargement de prisonniers. Une meute hurlante entoure le véhicule et les coups pleuvent sur les otages qui embarquent difficilement, gênés par leurs chaînes. Hommes, debout (p.30) sur le marchepied reçoit un coup derrière l’oreille dont il souffrira longtemps.
À Rambervillers, le 22 août, François Laurent et ses camarades descendent de l’autobus devant la prison municipale. Des soldats attendent, ils sont venus voir les « bêtes curieuses ». Steffens et le maire Licourt sont frappés. On les fait entrer dans le bâtiment et on les enferme à quatre dans des cellules prévues pour une personne. Laurent se retrouve avec le juge, l’abbé Meyer et le fils Schmitt, de Schneckenbusch. Il y a un lit de camp sur lequel tous les quatre s’assoient, Schmitt a les pieds en sang, tous sont épuisés. L’abbé Meyer, qui a reçu un coup de crosse au moment de son arrestation, a la tête bandée et sa soutane toute tachée de sang. Il est persuadé qu’il va être fusillé et confie son porte-monnaie à Laurent en le chargeant de le remettre, plus tard, à sa mère. Un soldat entre dans la cellule avec un seau recouvert d’un couvercle et une seule cuiller et leur dit de manger. Steffens et Schmitt se risquent à goûter à la tambouille, les deux autres renoncent.
Ensuite un gardien se fait remettre tout ce qu’ils ont dans leurs poches, argent, portefeuilles, montres, couteaux. Ils essaient de dormir, deux d’entre eux sur le lit de camp, les autres par terre. A une heure du matin, ils changent de place. Au matin on ouvre la cellule et on leur rend les objets confisqués la veille. Steffens constate qu’il lui manque une pièce de vingt marks en or. Mais auprès de qui réclamer ?
A huit heures du matin, les prisonniers reprennent place dans l’autobus qui, vers dix heures arrive à Epinal. François Laurent écrit : « Nous attendîmes un certain temps en dehors de la ville. La population s’assembla autour de nous ; nous fûmes molestés et insultés comme la veille. On aurait cru qu’on avisait la population de notre arrivée. Une jeune fille apercevant l’abbé Meyer, lui cracha au visage est dit : “Il faut lui couper ça”, en indiquant qu’il fallait le châtrer ! La populace coassa aussi à qui mieux mieux[18]. »
(p.31) À la prison de Saint-Dié, les femmes de Saales se trouvent sous la coupe d’une mégère, « véritable démon personnifié ». Elle prétend leur arracher leurs vêtements et tente de s’emparer des boucles d’oreille et de l’alliance de l’une des otages, mais y renonce devant la résistance qui lui est opposée. Elles passent la nuit sur des sacs remplis de feuilles et le lendemain mangent une mauvaise soupe. Cette nourriture est ensuite remplacée, pendant les trois jours suivants, par du pain sec et de l’eau.
Le 15 août, à trois heures du matin, on les réveille : « Dehors ! Le train part dans dix minutes », crie leur cerbère. À la gare, elles aperçoivent des soldats allemands qu’elles avaient rencontrés au sanatorium de Saales. Le sana a été complètement saccagé par les Français.
A Epinal, François Laurent et ses vingt-quatre compagnons sont dirigés sur la maison de correction où le gardien chef leur lance en guise de souhait de bienvenue : « Si j’avais quelque chose à dire, on vous jetterait tous à l’eau, votre air empeste. » Pensait-il à l’eau de la Moselle, qui traverse la ville, pour les noyer ? Bouclés dans une première salle nue, les prisonniers sont ensuite transférés dans un autre local où, surprise, se trouvent déjà les otages du groupe Hommes, parmi lesquels beaucoup de connaissances. Thomas, note Laurent, est toujours en blouse blanche, il a l’œil au beurre noir et voit mal, ses lunettes ayant été cassées.
La nourriture apportée le soir consiste en un morceau de pain, l’eau fournie dans une cruche en grès est chaude et il n’y a que deux gobelets pour tout le monde. Plus tard, on leur sert un bouillon où flottent quelques morceaux de foie et de poumon. Immangeable !
De temps à autre, d’autres prisonniers sont joints au groupe. C’est le cas, un jour, de « papa Degrelle », l’octogénaire.
Curieusement, Hommes ne mentionne pas ces retrouvailles dans son récit. Mais il a bien résumé la détention d’Epinal, qui s’achèvera dans la nuit du 27 au 28 août :
(p.32) Nos journées s’écoulaient, monotones, dans une halle dallée nue, sans tables, chaises ou bancs. Une lucarne grillagée assurait une médiocre aération, de sorte qu’une puanteur de tinette nous rappelait toujours l’âcre relent de nos gîtes antérieurs. Matin et soir « récréation » de dix minutes dans la cour, où nous profitions de l’aubaine de pouvoir nous laver le visage et les mains dans un jet d’eau. Mais c’était aussi le moment où s’exécutait l’indispensable corvée des cuves de W.C.
Nous passions la nuit au premier, sur la paille, tellement serrés les uns contre les autres qu’il était pratiquement impossible de bouger. Les tinettes étaient constamment utilisées dans un va-et-vient bruyant.
L’estomac ne digérait rien, pour la simple raison qu’il n’avait rien, ou pas grand-chose à faire. Notre alimentation consistait, le matin, en un huitième de litre de café, à onze heures en une maigre ration de soupe malpropre dans une gamelle crasseuse. Un jour, j’y ai trouvé un bout de gosier garni d’une touffe d’herbe et il m’a fallu du courage pour avaler cette mangeaille sans cuiller ni fourchette. Nous avions tous, en permanence, une faim dévorante. L’eau nous était distribuée dans de vieux récipients répugnants à raison d’un quart par tête[19].
Il existe plusieurs témoignages sur la prison de Belfort où beaucoup d’Alsaciens on été incarcérés en août et septembre 1914. Un juge[20], qui y arrive le 17 août, se souvient du directeur qui émaillait ses jurons de « cochons, sales Boches », adressés aux détenus, dont certains étaient en manches de chemise et en sabots, tenue dans laquelle les soldats les avaient enlevés. Dans le dortoir régnait une affreuse puanteur. Lorsqu’ils réclamaient à manger, un gardien leur répétait : « Allez chez Guillaume[21] ! »
D’autres prisons des départements frontaliers ont été utilisées pour loger les otages, en attendant leur transfert (p.33) vers les camps français du Midi ou de l’Ouest. Ceux qui les ont décrites sont d’accord sur les manifestations des populations hostiles et vengeresses qui les attendaient à leur arrivée, la malpropreté des lieux, l’entassement dans les cachots, la rareté et la mauvaise qualité de la nourriture servie dans des ustensiles crasseux, l’absence totale d’hygiène et de soins médicaux aux malades et, surtout, la grossièreté et l’agressivité des gardiens.
Le soir du 27 août, cinquante-deux otages d’Épinal sont séparés des autres. L’abbé Meyer, qui souffre toujours beaucoup de sa blessure à la tête[22], n’en fait pas partie. Lorsqu’ils franchissent le seuil de la maison de correction, on entend l’ordre : « Baïonnette au canon ! Approvisionnez ! » Des soldats leur disent : « Maintenant on va vous fusiller. » Puis ils encadrent les prisonniers et les conduisent à la gare où plusieurs trains de blessés stationnent, « l’œuvre de Guillaume », dit-on. A deux heures du matin, ils montent dans un wagon de 3e classe sans toilettes. D’autres voitures sont occupées par des blessés revenant du front. La dame de Saales constate que « l’attitude des gardiens change. Quand ils ont vu nos papiers et réalisé que nous n’étions pas des espions, ils nous ont demandé de les excuser ». Mais, poursuit-elle :
On entendait les pires insultes à l’adresse de notre Empereur. Lorsque nous disions qu’il avait publié tous les documents concernant les causes de la guerre et qu’il n’en était pas responsable, on nous répondait : « Ce sont des faux. » La haine contre le Kronprinz est extraordinaire. S’ils le font prisonnier ils ont l’intention de le mettre à mort de la manière la plus barbare. Lorsqu’un convoi de blessés passa, la fureur contre notre Empereur ne connut plus de bornes. On nous raconta aussi que la famine et la révolution régnaient en Allemagne, que l’Empereur était dans un asile de fous à cause des soucis que lui causaient les pertes énormes de ses troupes, (p.34) que beaucoup de princes allemands étaient déjà tombés et bien d’autres choses encore. Manifestement, les Français sont abreuvés de tous ces mensonges. Un officier bavarois blessé qui monta dans le train dit en cachette à ma mère quelle était la situation des troupes allemandes : « Victoires sur toute la ligne ! » Ce fut l’un des plus beaux moments de notre vie. Ce que cet officier raconta des mauvais traitements qu’il avait subis entre Baccarat et Epinal est terrible.
Le train ne se met en marche qu’après une attente de deux heures. Il s’ébranle enfin à quatre heures.
(p.35) Chapitre III
En route vers la « Terre Promise[23] »
Dans les gares où s’arrête le train, il y a toujours foule. Inscriptions sur les wagons : « espions, boches. » A l’un de ces arrêts, les dames de la Croix-Rouge distribuent du cacao aux soldats blessés et à ceux qui gardent les otages. Comme elles en donnent aussi à quelques prisonniers, un sergent se fâche, disant qu’il ne donnait pas d’argent à la Croix-Rouge pour qu’une pareille canaille reçoive quelque chose. Mais les dames ne se laissent pas impressionner et finissent par donner leur boisson chaude à tous les otages. Dans une autre gare, une femme offre du café aux blessés et aux gardiens. Il fait une chaleur torride et François Laurent s’adresse à elle pour lui demander un verre d’eau, « pour l’amour de Dieu ». « La mégère, écrit Laurent, commença à m’injurier et à m’insulter en ajoutant qu’elle ne croyait pas en Dieu, mais que nous aurions ce que nous méritions, qu’elle ne comprenait pas comment notre mère nous avait élevés, qu’elle était une mère française… » Et elle refuse le verre d’eau demandé.
C’est à Gray (Haute-Saône) qu’on distribue du pain aux prisonniers, trois livres pour huit personnes, deux boîtes de conserves et un peu d’eau. Partout où le train s’arrête, huées et insultes. «Je crois que la population était prévenue d’un endroit à l’autre de notre arrivée », écrit encore François Laurent.
Enfin à minuit, le 28 août, ils descendent du train à Paray-le-Monial pour être immédiatement poussés dans l’écurie de l’Hôtel de Bourgogne voisin. Il n’y a là que de la paille humide, un baquet pour les besoins et un bassin (p.36) rempli d’eau pour boire. Rien à manger ce soir-là. Ils y restent jusqu’au dimanche 30 août, nourris de conserves et de pain. Quelques-uns réussissent à se procurer du vin. L’un d’eux confie une pièce d’or à un civil chargé d’une course en ville. Le commissionnaire ne reparaît pas.
Mais, tout compte fait, ces cinquante-deux hommes ont eu de la chance, car quelques jours auparavant deux convois d’otages, logés dans la même écurie, ont au préalable subi des vexations et des violences dont on aurait pu croire les militaires et les gendarmes français incapables. Les scènes qui se sont déroulées à leur arrivée — l’une a même été photographiée — ont été décrites par quatre otages. Deux de leurs récits méritent d’être cités en entier :
Arrivés à Paray-le-Monial [le 21 août], nous avons été accueillis par des gendarmes qui nous emmenèrent dans une cour, à l’opposé de laquelle se trouvait une écurie et séparée de la rue principale par un mur bas. Un commandant apparut, qui nous ordonna de nous placer sur une ligne. Toujours sur son ordre, nous dûmes enlever nos chaussures et nos chaussettes et les placer par terre devant nous. Tous les hommes placés aux deux extrémités de la ligne furent priés de faire cinq pas en avant, sur quoi nous fûmes pour ainsi dire dégradés par les gendarmes. Cette dégradation se déroula ainsi : un gendarme armé d’un couteau coupait notre col, ouvrait en les déchirant notre gilet et notre chemise, coupait tous les boutons du gilet et du pantalon, de sorte que notre pantalon tombait et que nous nous retrouvions là, debout en chemise. Tout ce qui avait été arraché et coupé fut jeté sur un tas auquel on mit le feu. Ensuite le commandant ordonna aux dix soldats de garde de charger leurs fusils et de nous mettre en joue, au milieu des cris de joie et des bravos de la foule des témoins. Tous nous croyions notre dernière heure arrivée, mais heureusement on en resta à cette mise en joue. Puis on nous fit jeter nos souliers dans une remise et on nous poussa dans une écurie pleine de fumier. Comme il faisait très chaud, nous avions soif et demandâmes de l’eau. La sentinelle, après avoir demandé à son supérieur, nous désigna un baquet dans l’écurie qui, les jours précédents, avait été utilisé pour les besoins. Il nous fallut donc le nettoyer pour (p.37) ensuite y puiser notre eau. À midi, nous eûmes de la viande en conserves et un quart de pain.
Nous restâmes deux jours dans cette écurie. Le troisième était un dimanche [25 août]. Le matin nous dûmes nettoyer l’écurie et, à deux heures et demie, notre voyage continua. Quand nous voulûmes récupérer nos chaussures, nous nous aperçûmes qu’elles avaient disparu. A leur place il y avait de vieilles pantoufles. La moitié d’entre nous marcha donc pieds nus et tout le monde tenait son pantalon des deux mains en allant vers la gare. Avant le départ du train, des civils lancèrent de la paille enflammée par les ouvertures de notre wagon[24].
Un certain Joseph Hils, également de Thann, a rapporté moins longuement ce même séjour à Paray-le-Monial, mais en donnant certains détails passés sous silence par le premier témoin. Il signale ainsi qu’à leur arrivée, c’est un colonel qui les apostrophe : « Ah, voilà les pillards, les espions, les salauds ! » et que, après qu’on leur eut coupé tous leurs boutons, on leur enleva leurs bagues, montres, argent en leur disant que toutes ces choses ne leur serviraient plus à rien puisqu’ils seraient fusillés dans une demi-heure (mais qu’on enverrait le tout à leurs familles). On leur apprend ensuite qu’ils vont être dirigés sur Clermont-Ferrand et traduits devant le Conseil de guerre de la 13e Région. Avant le départ, il sont de nouveau enchaînés par quatre[25].
Dans son petit livre[26] — 64 pages — l’instituteur Litschgy consacre un chapitre de quatre pages et demie au « train des quatre-vingt-trois ». Il insiste sur l’attitude des dames de Paray-le-Monial, spectatrices des sévices infligés aux otages, avec le cœur de Jésus cousu sur la poitrine[27], qui hurlaient leur approbation tandis que le commandant fumait tranquillement sa pipe. « Les “frères reconquis”, écrit-il, (p.38) n’oublieront jamais. Ils raconteront la conduite scandaleuse des “libérateurs du joug des barbares” à leurs femmes, à leurs frères et sœurs et les transmettront à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Il y avait encore de nombreux liens familiaux qu’un destin aux nombreuses péripéties avait créés entre la France et l’Alsace-Lorraine. Les Français les ont brisés. Des grands-pères qui avaient versé leur sang pour la France sur les champs de bataille de Russie, d’Afrique et d’Asie ont pleuré lorsqu’ils ont réalisé le sort que le pays de leurs idéaux avait préparé à leurs enfants et petits-enfants. »
Peu après le départ du groupe précédent, quatre-vingt- trois hommes, arrive à Paray un autre convoi d’otages. « Une Alsacienne » a conté ce qu’elle y avait vécu :
C’était un dimanche après-midi à deux heures et le moment choisi par le public français, plusieurs centaines de personnes, pour nous accueillir. Ici se répéta tout ce qui nous était arrivé en route et on nous laissa deux heures, debout, sous le soleil brûlant, au milieu d’une place. Nous étions tous sur le point de nous trouver mal. Des larmes coulaient, même des yeux des hommes. Ce que nous, les femmes, ressentions ne peut être décrit. Comme nous demandions aux soldats pourquoi on nous obligeait à rester là, debout, ils nous répondirent que c’était là que nous allions être fusillés. Moi- même souhaitai que cela se produise, pour que cela mette fin à tous ces tourments. Mais j’avais de la peine pour mon enfant, il me demandait tout le temps pourquoi on allait nous fusiller. Enfin, un officier ouvrit la porte d’une écurie et comme du bétail on nous poussa à l’intérieur. Là au moins nous avions l’avantage d’être à l’abri des gens. Mais les dalles de pierre couvertes d’un peu de paille ne paraissaient guère accueillantes. Nous rassemblâmes notre argent, environ 1,20 franc, et le donnâmes à un soldat en lui demandant de nous apporter un seau d’eau. Je n’oublierai jamais l’image de tous ces gens se précipitant sur ce seau, chacun ne pensait à rien d’autre qu’à étancher sa soif. Nous, les deux femmes et mon enfant, nous fûmes ensuite séparés des hommes et enfermés dans la prison, dans une cellule sombre. Un petit trou dans la porte ne laissait pas passer assez de lumière (p.39) et d’air. Deux lits de camp en bois et deux sacs de paille horriblement sales, un vieux pot qui devait servir pour nos besoins, une cruche pour l’eau, tel fut notre unique mobilier pendant troisjours, en compagnie d’une nombreuse vermine. Le troisième jour on nous fit sortir et nettoyer les cellules. La nourriture consistait en viande en conserves et pain. Nous avons passé d’horribles nuits dans cet endroit, sans lumière, sans air, sans aide. Les crises d’asthme de mon enfant se multiplièrent. Je me dis toujours que nous devions avoir un protecteur particulier, sans quoi nous ne serions plus en vie. Le soir du quatrième jour, on vint nous chercher pour nous conduire à la gare, où nous retrouvâmes les hommes. Entretemps, d’autres prisonniers étaient arrivés, parmi lesquels une femme avec un bébé de quelques jours et deux autres enfants. Ce n’est qu’à contrecœur que nous montâmes dans le train[28].
La « dame de Saales » signale la conduite « convenable » des gardiens entre Gray et Paray-le-Monial. Ils donnent de la viande et du café aux otages. Elles rencontrent beaucoup de trains de troupes et notent que « partout, les gens partaient en guerre en affichant un enthousiasme exubérant et la certitude de la victoire. Ils étaient convaincus qu’après six semaines de guerre l’Allemagne n’existerait plus. » Par chance, ce convoi ne s’arrête pas à Paray-le-Monial.
Dimanche, 31 août, dix heures du matin. Laurent et ses cinquante et un compagnons sont conduits à la gare. Cette fois on n’embarque pas dans un wagon de 3e classe. On les fait monter dans un wagon à bestiaux — Hommes 40 – Chevaux 8 —, normalement prévu pour quarante hommes. La porte est fermée de l’extérieur. A l’intérieur, quelques bancs. Bientôt, la chaleur est terrible. Rien à boire et pas de baquet non plus pour les besoins.
A midi, le train s’arrête à Moulins et stationne près de la gare de marchandises. Le soleil tape dur sur le toit en bois goudronné du wagon. Les supplications des occupants (p.40) restent sans effet, personne ne leur apporte de l’eau. Non loin du wagon, à un poste de ravitaillement des locomotives, l’eau coule à flots, par terre. Supplice. Le facteur à la retraite Forfert s’évanouit. Un cheminot de service s’amuse à leur lancer des boulets de charbon par les ouvertures.
Au milieu de l’après-midi, un train de soldats s’arrête tout près. Le wagon des otages, qui porte l’inscription pillards, est pris d’assaut par les militaires, ils montent sur le toit et essaient d’y pénétrer par des ouvertures trop petites, menacent les prisonniers de leurs couteaux et crachent dans leur direction. Enfin, ils tentent même de renverser le wagon, en vain. Ce sont des condamnés en route pour l’Afrique et les Bat d’Af, appelés aussi Joyeux[29].
Finalement, à huit heures du soir, le convoi se remet en marche en direction de Clermont-Ferrand.
Mais d’autres Alsaciens-Lorrains connaissent un nouvel emprisonnement dans le chef-lieu de l’Ailier, ainsi que l’a rapporté l’un d’eux, déjà cité :
En marchant dans les rues de la ville [Moulins], nous fûmes de nouveau insultés et menacés. Dans une des rues principales, un monsieur bien habillé franchit le cordon des soldats et se précipita dans nos rangs, m’attrapa par derrière, me secoua et d’une violente poussée me jeta à terre. Mon chapeau en vola à quelques mètres. Les soldats considérèrent tout cela sans intervenir et mes compagnons me relevèrent et durent me protéger de nouvelles attaques du même personnage. À Moulins, on nous divisa en deux groupes : les fonctionnaires et les non-fonctionnaires ; les premiers, cent trente-sept personnes, furent logés dans la salle de (p.41) gymnastique de la société La Bourbonnaise, les seconds dans une autre salle. Dans la salle de gymnastique, malpropre, nous couchâmes par terre sur une mince couche de paille, sans couvertures. Il n’y avait ni tables ni chaises, cent trente- sept personnes devaient se laver à un petit robinet, sans les moindres objets de toilette. La ville de Moulins livrait pour nous nourrir sept kilos de viande par jour. Cette « viande » consistait principalement en mâchoires de vache avec les dents et en lambeaux d’une graisse puante. Avec cela, on nous préparait une soupe claire qu’on nous servait deux fois parjour, à onze heures du matin et à six heures du soir ; c’était notre unique nourriture. Pour épaissir un peu la soupe, nous étions obligés d’acheter nous-mêmes des pommes de terre. On nous donnait du pain en quantité suffisante. Toute la journée, nous pouvions nous promener dans une petite cour au milieu de laquelle il y avait une mare malodorante où aboutissaient les eaux usées de la cuisine. A six heures on faisait l’appel dans cette cour et à huit heures, tout le monde était couché sur la paille. Personne n’avait encore pu changer de linge ou de vêtements. Il était impossible de faire la lessive et, bientôt, les poux prirent le dessus. Personne ne pouvait s’en défendre, mais chacun leur faisait la chasse plusieurs fois par jour. Enfin, on nous autorisa à écrire à nos familles et à acheter à un commerçant qui venait au camp des objets de toilette, des sous-vêtements et des couvertures. Ce brave homme nous apportait ses vieux fonds de boutique et nous les vendait à des prix incroyablement élevés. Un médecin venait aussi de temps à autre ; mais comme il écoutait à peine les malades et ne disposait, pour toutes les maladies — internes et externes — que de teinture d’iode, notre confiance dans sa capacité disparut bientôt. De temps en temps nous recevions la visite de dames, c’est-à-dire des bonnes amies de nos gardiens, à qui ceux-ci montraient triomphalement les Boches sur la paille. Après environ quatorze jours, le commandant de la ville nous questionna de nouveau sur notre identité, notre profession et notre domicile. Ce n’était pas un mauvais bougre. Il nous raconta les choses les plus extravagantes sur les atrocités allemandes en Belgique. Naturellement, il expliqua qu’il n’en avait rien vu, mais que de bons amis à lui lui avaient assuré que c’était la vérité. Dans ces conditions, il regrettait de ne pouvoir rien faire pour améliorer notre sort. Comme nous (p.42) lui demandions pourquoi on nous retenait en détention, il répondait que lui-même ne le savait pas, que nous étions vraisemblablement des otages. Nous lui demandions aussi ce que, en tant qu’otages, nous garantissions, puisque Mulhouse et ses environs avaient été abandonnés depuis longtemps par les Français. Il ne répondait pas. Les journaux étaient formellement interdits, mais, de temps en temps, nous réussissions à nous en procurer en soudoyant les gardiens. Ils nous renseignaient sur les rapports mensongers concernant la famine en Allemagne, la révolution à Berlin et la prise et l’occupation des « forteresses » d’Altkirch et Mulhouse, auxquelles nous avions nous-mêmes assisté. Tout cela nous amusait beaucoup[30].
L’arrivée des « quatre-vingt-trois » à Clermont-Ferrand, donne lieu, comme d’habitude, à de nombreux incidents provoqués par une foule en rage. Plusieurs Alsaciens sont blessés à la tête. Un ouvrier de Thann, Wolf, âgé de soixante- dix ans, dont le pantalon a glissé par terre, est traîné, évanoui, par les deux camarades auxquels il est enchaîné. Ce pitoyable trio, qui retarde la marche des autres, est aiguillonné par les baïonnettes des soldats. Joseph Hils, également de Thann, reçoit un coup de « Rosalie » dans la cuisse[31]…
Le Libéral de l’Ailier du lendemain, 20 août, a rendu compte de cette réception réservée aux otages sous le titre : Les pilleurs de cadavres sont conduits de Mulhouse à Clermont, et sous-titres : Ce sont tous des Allemands. De violentes manifestations se produisent. Plusieurs prisonniers sont blessés. En voici les passages les plus importants :
Hier soir, à 11 h 33, sont arrivés en gare de Clermont quatre-vingt-trois Allemands, misérables bandits qui suivaient les armées pour dévaliser nos blessés et nos morts sur les champs de bataille. Presque tous ont été arrêtés aux environs de Mulhouse, dès les premiers combats. […] Ils vont (p.42) comparaître devant le conseil de guerre du 131‘ Corps.
Au moment de leur arrestation, on a trouvé sur eux de nombreux bijoux, des bagues, beaucoup d’alliances, des sommes importantes volées à des officiers ou à des sous- officiers et soldats ; quelques-uns avaient même gardé des porte-monnaie, des portefeuilles ayant appartenu à nos soldats et renfermant des souvenirs.
La nouvelle de leur arrivée s’est vite répandue dans Clermont ; dès dix heures et demie une foule énorme stationnait avenue du Château-Rouge et sur l’Esplanade. Quand le train est entré en gare à l’heure exacte, une immense clameur s’éleva : « A mort ! A mort ! » L’on répétait, sur l’air des lampions : « Conspuez Guillaume ! Conspuez ! » On agitait des drapeaux français. Les barrages établis sont débordés malgré d’importantes forces d’infanterie, d’artillerie et de police. […]
Parmi ces prisonniers, il y a des gamins imberbes à la figure vicieuse, des hommes à cheveux et à barbe blanche (sic), de solides gaillards blonds et moustachus. Les uns et les autres sont moins que rassurés. Beaucoup tremblent de tous leurs membres. Nous entendons un monsieur, vêtu avec une certaine recherche, coiffé d’un chapeau gris aux larges ailes, et qui est enchaîné avec un éphèbe à l’allure équivoque dire en français : « Mais ils vont nous tuer ! »
Tous ont les menottes ; ils sont attachés quatre par quatre. On les bouscule pour les faire marcher plus vite ; sur leurs visages on lit une angoisse profonde : ils sont pâles, livides.
Maintenant ils marchent vers la foule. Et c’est un tumulte extraordinaire, un indescriptible brouhaha ! Des poings se tendent vers eux ; on les frappe à coups de canne ; l’un est assommé d’un coup de valise ; il chancelle ; des agents le soutiennent ; entraîné par ses compagnons de chaîne, il continue jusqu’à la place Delille. Là il tombe, la tête fendue. D’autres sont également blessés. Le sang coule. Et la foule, de plus en plus grande, réclame qu’on lui livre les prisonniers pour les lyncher.
Les gendarmes, les soldats, les commissaires de police, les agents essaient, mais vainement, de protéger les pillards ; ils sont frappés eux-mêmes. […]
Devant la caserne de la Chasse, le tapage est formidable. (p.44) On crie, on chante, on pousse des clameurs, on se jette sur les Allemands qui sont littéralement assommés. Enfin, on parvient à les faire entrer dans les bâtiments, tandis que la foule continue à pousser des clameurs de mort.
Notons que ces pillards — le fait nous a été affirmé de la façon la plus formelle — avaient en leur possession plusieurs brassards de la Croix-Rouge ; il leur était facile ainsi de parcourir les champs de bataille pour exercer leur ignoble et épouvantable industrie.
Voici donc les otages — allemands, non pas alsaciens- lorrains — descendus au rang de « pilleurs de cadavres ».
Dix jours plus tard, le train des cinquante-deux, toujours dans leur prison roulante, entre en gare de Clermont à minuit. Comme il a du retard, l’escorte militaire prévue pour les accompagner a été renvoyée dans ses casernes. Quelques curieux consentent enfin à leur apporter de l’eau, en échange de laquelle ils réclament de l’argent allemand. Quelques groschen et pfennigs leur sont donnés avec plaisir. Quelques instants plus tard, une bonne âme ouvre la porte de leur wagon et les occupants peuvent sortir, satisfaire leurs besoins et se dégourdir les jambes. De retour dans le wagon, c’est l’attente ; on s’arrange comme on peut pour le reste de la nuit, mais rares sont ceux qui peuvent trouver le sommeil.
Au lever du jour, des soldats, des gendarmes arrivent à la gare, on met les prisonniers en rangs. En ville, malgré l’heure matinale — il peut être cinq heures — la foule est là qui attend puis se comporte comme dans les gares précédentes. Mais cette fois on ne la laisse pas faire : le commandant de gendarmerie en tête du convoi déclare à la meute hurlante qu’elle devrait avoir honte de se conduire ainsi et d’insulter les prisonniers, que si elle possédait vraiment du patriotisme, elle ferait mieux d’aller à la frontière et combattre l’ennemi.
Citons encore deux témoignages de deux autres otages qui, eux, ne bénéficient pas de l’assistance du courageux commandant.
(p.45) L’Alsacienne mère d’un enfant, déjà rencontrée à Paray-le-Monial, écrit :
Ici, l’escorte ne réussit pas à contenir la foule ; on a été obligé d’appeler à l’aide de la cavalerie qui, sabre au clair, tint la meute sauvage à distance. Malgré cela, on nousjeta des pierres, des ordures, des vieilles bouteilles et d’autres choses de ce genre. Ils criaient aux soldats de nous livrer à eux pour qu’ils puissent nous mettre à mort10.
Quant au receveur des postes de Thann, son groupe arrivant en pleine nuit est pris à partie par une cohue, presque tous des ouvriers armés de gourdins et de couteaux, qui ont éteint les réverbères et profèrent les habituelles injures. Des vêtements sont arrachés ou déchirés tandis que les gendarmes sont impuissants devant le nombre des agresseurs.
Pour éviter de nous voir assommés, et comme nous ne pouvions plus avancer, on nous fit entrer dans un bâtiment de garde où, toujours enchaînés, nous restâmes jusqu’à sept heures du matin. Puis un officier ordonna qu’on nous débarrasse de nos fers et une escorte renforcée nous mena à la prison11.
Pour François Laurent et Théo Hommes, le séjour dans la prison militaire de Clermont-Ferrand sera de courte durée, deux jours, mais des Alsaciens, arrivés avant eux, y moisiront, certains huit, d’autres dix jours. La nourriture y est convenable, la paille fraîche, mais il n’y a, comme à Epinal et Paray-le-Monial, dans le local où ils couchent, qu’un baquet de zinc qui sert de toilettes.
Ensuite chaque prisonnier est interrogé par un capitaine de gendarmerie, assis à une table au milieu d’une grande cour. Quand Laurent lui dit qu’il a été emmené comme (p.46) otage, l’officier se montre étonné, d’autant qu’auparavant il a appris que le prisonnier était marié à une Lorraine, pas à une immigrée allemande. Pour finir, il inscrit « non suspect » sur sa fiche. Maigre consolation !
Hommes, lui, est surpris d’entendre le capitaine lui parler dans sa langue maternelle et lui dire : « Ah otage !Ehr kene nochem Krej veschosse werê2 ! »
Au cours de la nuit suivante, le 1er septembre, les prisonniers sont réveillés, comptés, mais on ne leur donne rien à manger. Puis on leur adjoint un groupe de femmes. Il est quatre heures et demie. Conduits dans la rue, tous montent dans plusieurs voitures à échelles qui se mettent en route.
Hommes a décrit les premiers kilomètres de ce voyage dont personne ne connaît le but : « Nous longeâmes de grands vergers, de beaux vignobles. La route était en forte pente, un peu comme le col de Saverne. Soudain, devant nous, surgit le puy de Dôme, 1 465 mètres d’altitude. »
Lorsque la montée s’accentue, les hommes sont invités à descendre et à poursuivre à pied. Les femmes et quelques vieillards, dont le « papa Degrelle », continuent dans les voitures. « Dans les villages, écrit Laurent, c’était toujours la même chose, la foule s’assemblait et les insultes pleuvaient sur nous. Ce fut le cas, entre autres, à Chamalières. »
Après une marche d’environ douze kilomètres, vers huit heures, les voitures et les piétons arrivent à un camp d’une douzaine de baraquements en planches, La Fontaine du Berger[32] [33]. Il y a là, déjà, de nombreux détenus, hommes, femmes, enfants, allemands et alsaciens-lorrains, dont beaucoup ont été arrêtés à la foire de Lyon, où ils étaient employés.
En altitude — 1 008 mètres, celle du Donon — il fait chaud le jour et, déjà, très frais la nuit. Et pourtant, des mères et leurs jeunes enfants couchent sur la paille, comme les hommes.
(p.51) En Auvergne : le camp d’Issoire
À la gare d’Issoire, cent-vingt soldats du 16e RA attendent les prisonniers, deux cent trente-trois personnes. En rang par quatre, ils se mettent en marche ; dans les rues de la ville, comme d’habitude, une foule excitée attend, peut-être plusieurs milliers, note Laurent. Toujours les mêmes cris, les mêmes injures, les mêmes jets de pierres. Une dame bourgeoisement mise attaque un otage qui porte un pansement à la tête, le frappe avec son ombrelle en criant : « Ah, même un barbare blessé ! » Plusieurs hommes se précipitent dans les rangs et essaient de s’approprier les couvre-chefs des prisonniers. La marche dure une demi- heure entre deux haies qui braillent et menacent. Elle se termine enfin dans une caserne.
(p.53) Les soldats de la garde ne manquent jamais une occasion de tourmenter leurs prisonniers. Quand ils vont aux feuillées et qu’ils évitent de marcher dans la boue, les sentinelles leur ordonnent de faire demi-tour pour qu’ils s’enlisent dans l’épaisse couche de gadoue du chemin. A l’aller et au retour, ils sont obligés de faire le salut militaire en passant devant la sentinelle. « Ce n’est pas nous que vous saluez, leur dit-on, c’est la France. » D’abord des soldats de (p.54) l’active, puis des territoriaux, ils semblent tous manquer de l’instruction qui s’impose en temps de guerre : l’un d’eux, incapable de fixer sa baïonnette au bout de son fusil, est dépanné par un vétéran de soixante-dix ; ils manipulent sans précautions leurs Lebel chargés, si bien que trois balles parties par inadvertance se logent dans le toit et les murs du hall, sans blesser personne heureusement. Lorsque des soldats du Nord remplacent les Auvergnats, ils fraternisent avec les détenus. Comme eux ils sont séparés de leurs familles, domiciliées dans la zone occupée par les Allemands, et sans nouvelles d’elles. L’un d’eux dit un jour : « On est ici au centre de la France, mais on se croirait plutôt au bout du monde. Les Auvergnats ne sont pas civilisés. Au lieu d’envahir la Belgique et le Nord, les Allemands auraient mieux fait de venir ici. »
(p.54) Les conditions de détention sont telles, surtout le manque d’hygiène, qu’il y a toujours beaucoup de malades. La diarrhée semble avoir touché l’ensemble des occupants du hall. Un docteur nommé Jouan reçoit les patients à l’infirmerie de la caserne. « Il était bon et humain avec les détenus », écrit Laurent. Mais il ne dispose pas des médicaments nécessaires et doit se contenter de pilules d’opium, d’huile camphrée et de l’inévitable teinture d’iode, considérée comme une véritable panacée. Plusieurs détenus sont conduits à l’hôpital mixte ou à l’hospice de la ville. Bien qu’ayant jusque-là bien supporté la captivité, « papa Degrelle » meurt à l’hôpital le 26 septembre. Hommes note, et il semble qu’il n’a pas tout à fait tort : « Pour être hospitalisé il fallait être mourant. » Au sujet de « papa Degrelle », il écrit encore : « Il a enduré d’horrible souffrances à cause d’une hernie de la taille d’une tête d’enfant. C’était navrant d’entendre ce vieillard, qui ne parlait que le français, juger ses compatriotes en termes sévères. Chacun de ses mots était une accusation de ses soi- disant libérateurs. » Quatre autres détenus sont décédés cet automne-là, trois à l’hospice, le quatrième, Schwœrer, un bûcheron retraité de soixante-huit ans, dans le hall. Il s’était couché plusieurs nuits avec des vêtements mouillés après avoir travaillé sous la pluie. Naturellement, les détenus ne peuvent pas assister aux enterrements.
(p.61) Cette captivité se termine le 13 mars 1916. A cette date les prisonniers sont transférés au camp de l’île Longue, dans la rade de Brest. Le voyage dans des wagons sans toilettes via Millau, s’achève dans la nuit à Aurillac où les prisonniers sont logés dans un ancien couvent.
Saint-Rémy-de-Provence
(p.69) En mai 1917, le directeur s’adresse au sous-préfet pour lui signaler que les internés « notamment les plus lettrés » désirent former « une petite société de chant et de musique pour se distraire dans le dépôt ». Il n’y voit aucun inconvénient à condition que l’orchestre soit composé uniquement d’un piano et d’instruments à cordes. Mais le préfet n’est pas d’accord1. Un mois plus tard, nouvelle demande de l’interné Xavier Schlienger adressée au ministre de l’Intérieur. 11 écrit à propos de la « petite chorale de chant en allemand » qu’il veut organiser : « Nous tenons à faire ressortir que nous ne choisirons pas précisément des chants patriotiques ou pouvant donner lieu à objection. » Quant à la « petite société musicale » projetée, elle se composerait de huit à dix violons, accompagnés d’un piano, « telle qu’il en existe dans tous les dépôts, aussi bien dans les camps français que dans les camps allemands ». Il fallait s’y attendre, la demande est rejetée. Il est interdit de chanter en allemand, mais beaucoup ne s’en privent pas, qui ne savent pas beaucoup, ou pas du tout, de français — et qui ne font aucun effort pour l’apprendre, note Laurent. S’ils chantent en allemand, c’est aussi pour affirmer leur germanité. C’est ainsi qu’un soir un groupe d’Alsaciens qui marchent au pas cadencé pour prendre de l’exercice en fredonnant puis en chantant des airs de marche, entonnent le Deutschland über Alles, rythmé par un des leurs qui frappe sur une caisse. Mais ils n’arrivent pas au bout du premier couplet et les sanctions pleuvent : interdiction de marcher au pas, annulation d’un concert projeté, interdiction absolue de chanter et de faire de la musique.
Deux camps du Midi: Béziers et Tarascon
(p.91) L’arrivée des Castelsalinois est marquée par un incident tragique, dont Bock a fait le récit après sa libération :
A la suite du manque de nourriture pendant le voyage de trois jours de Nancy à Béziers, notre compagnon de souffrances Eugène Merling, de Château-Salins, était devenu complètement fou, de sorte que nous qui occupions le même compartiment eûmes toutes les peines du monde à l’empêcher de devenir violent. Tout de suite après notre arrivée aux arènes, je signalai au commandant du camp, un vieux Français irritable, l’état dans lequel se trouvait Merling. Pendant ce temps, celui-ci se comportait comme un dément et voulait entraîner ses camarades dans un café voisin. Comme personne ne le suivait, il voulut y aller tout seul, mais tomba au milieu des arènes. Le commandant lui envoya un gendarme et un soldat qui lui donnèrent chacun un coup de baïonnette, l’un au côté, l’autre dans le bras. Ils laissèrent ensuite le pauvre homme, appuyé à un mur, perdre son sang. Puis il fut surveillé par deux soldats, baïonnette au canon. Peu après, dans le local où nous devions coucher, nous entendîmes un cri déchirant. Comme nous l’apprîmes le lendemain matin, l’une des sentinelles avait embroché Merling. Madame Merling, qui écrivit lettre après lettre à son mari, n’apprit sa mort que quatre ou cinq mois plus tard[34] [35].
Fallait-il vraiment user de la baïonnette pour maîtriser le prisonnier ? C’était un homme dans la force de l’âge, plutôt corpulent, mais il y avait là plusieurs gendarmes et soldats. Ou bien en finir avec un Boche a-t-il paru une solution beaucoup plus simple et plus rapide ? Eugène Merling était père de huit enfants mineurs. Sa femme, déjà souffrante au moment de son arrestation, mourut le 5 juillet 1919. Et son fils Jean toucha une indemnité de 40 francs, le 21 juillet 1931[36] !
Quelques jours plus tard arrivent deux instituteurs (p.92) lorrains : Jules Griette, le 25 août et Louis Hinschberger, le 3 septembre.
Ainsi que le relate une télégraphiste alsacienne, le logement aux arènes manquait singulièrement de confort :
A Béziers, nous fûmes logés dans de vieilles arènes qui menaçaient ruine. Notre lieu de séjour fut une ancienne cave avec une fenêtre, aux murs nus et humides, couverts de mousse et de toiles d’araignées. Notre couche : un peu de paille sur le sol de terre battue. Il n’y avait ni chaises, ni bancs, ni table. La toiture était en très mauvais état ; partout il pleuvait à l’intérieur, de sorte que des flaques d’eau se formaient parfois sur le sol. Dans de telles conditions, nous nous blottissions ensemble dans un coin un peu plus à l’abri. Deux d’entre nous avaient des parapluies que nous ouvrions. C’étaient de bien longues nuits ! Malheureusement, il pleuvait souvent. Notre litière de paille, que nous sortions chaque fois qu’il y avait du soleil, était difficile à sécher et s’émiettait de plus en plus. Chacun de nous souffrait de rhumatismes[37].
Le tableau concernant la nourriture est également plutôt sombre :
Comme nourriture, on nous donnait une gamelle de soupe claire le matin. L’après-midi à cinq heures, il y avait ou de la soupe de riz ou de petits pois ou de lentilles. Nous devions avoir de la viande trois fois par semaine. Mais quelle soupe c’était ! Il y avait plein de crottes de souris dans le riz, dans chaque petit pois on trouvait un charançon et les haricots et les lentilles étaient aussi de mauvaise qualité. Additionnés de soude, ils étaient immangeables. En outre ils étaient très salés et poivrés, pour que nous soyons obligés de boire du vin, car c’était le cantinier qui fournissait la nourriture. La viande était d’une qualité inférieure, des morceaux de mou ou un petit morceau de lard rance qui était très dur et que malgré notre faim nous utilisions pour cirer nos chaussures. Pendant quatre semaines, on nous donna un mauvais pain de son gâté par la nielle. Mais comme la plupart d’entre nous étaient tombés malades, on nous en fournit du meilleur après l’intervention du médecin.
(p.93) Au sujet de la discipline au camp, le même auteur écrit :
La plus petite faute était punie de quinze jours d’arrêts. C’est ainsi qu’un juge fut condamné à quinze jours d’arrêts, au pain et à l’eau avec une soupe tous les quatre jours, parce que, à la cantine, il s’était mis à une place réservée à des soldats et sous-officiers. On l’enchaîna et on le mena à travers la ville. Il ressortit de la prison après dix-sept jours : on l’avait oublié et il n’avait rien eu à manger pendant deux jours.
Il y a peut-être quelque exagération dans le propos de la « télégraphiste alsacienne », peut-être une Allemande, mais cette description des arènes, sans doute unique, devait être citée.
Marseille: le château d’If et l’île du Frioul
(p.105) Un garde forestier mourut d’un catarrhe intestinal. Il avait fait le voyage de l’Alsace à Marseille d’une seule traite, naturellement sans aucune nourriture. Lors d’un arrêt à une gare, lorsqu’il avait supplié qu’on lui donne un peu d’eau, un employé lui avait répondu qu’il ne lui en donnerait jamais, « même s’il tirait une langue aussi longue que le bras ». A cette occasion, ou lors d’un cas similaire, un cheminot avait apporté deux seaux d’eau et en avait versé le contenu sur le quai, devant les yeux du prisonnier languissant.
(p.107) La nouvelle de beaucoup de décès d’enfants ne parvint jamais jusqu’aux hommes, parce que les quelques quatre cents femmes étaient logées dans un local séparé. D’après une famille suisse, internée là par erreur pendant un certain temps, trente enfants seraient déjà morts sur l’île avant la fin de 1914, « Kindersterben », in KR, p. 65.
(p.109) Mais, comme notre île était l’unique station de quarantaine en Méditerranée, nous fûmes obligés de la quitter. Un deuxième convoi fut envoyé au monastère de Corbara, en Corse, où les détenus furent convenablement » traités et bien nourris, mieux que sur l’île du Frioul. Les Alsaciens-Lorrains devaient maintenant être libérés s’ils n’étaient pas coupables de quelque délit et s’ils n’étaient pas soupçonnés de sentiments allemands. Les Français les considéraient comme de futurs Français.
Les Français et les otages d’Alsace-Lorraine
(p.131) Il est inutile de revenir sur le comportement des foules excitées qui, dans les villages traversés, dans les gares ou sur le chemin des prisons ou des camps réservent un accueil musclé aux otages prisonniers. A Baccarat, Epinal, Gray, Saint-Dié, Paray-le-Monial, Moulins, Clermont-Ferrand, Issoire, Collioure, Montélimar, Marseille, se déroulèrent les mêmes scènes indignes. Elles ont été rapportées dans les chapitres précédents et atteignirent, au moins en une occasion, à Paray-le-Monial, des sommets de cruauté et de sadisme. Là, la conduite des militaires, des gendarmes et des civils français ne fut pas loin d’égaler la barbarie des envahisseurs allemands.
Mais, après l’installation des prisonniers dans les camps, comment la population civile réagit-elle à la présence de ces indésirables ?
Les simples citoyens expriment leur désapprobation en lançant des « Boches ! Sales Boches ! » aux détenus qui passent dans la rue, à Issoire ou à Saint-Rémy. Ils en sont d’autant plus enclins qu’à Issoire, par exemple, dans les cafés, les Alsaciens ne se gênent pas et s’expriment dans leur dialecte ou en allemand. Certains parce qu’ils sont incapables d’utiliser le français, qu’ils n’ont jamais appris ; mais d’autres, tout à fait capables d’y avoir recours, préfèrent souvent leur langue maternelle dans la conversation et même pour pousser la chansonnette. C’est, en quelque sorte, le naturel alsacien qui revient au galop.
(p.134) L’hostilité, en France, envers les Alsaciens-Lorrains n’avait, en fait, pas attendu les otages soupçonnés d’espionnage et crimes commis sur les morts et blessés des champs de bataille. Dès avant la grande offensive française en Alsace-Lorraine, un journal messin pouvait noter :
Contre les Allemands règne une haine violente, dont les Alsaciens-Lorrains sont l’objet tout aussi bien que les autres. Les Alsaciens qui reviennent, sans excepter les femmes, peuvent raconter les injures, les menaces, les mauvais traitements qu’ils ont essuyés tout le long du trajet par les contrées françaises. […] Les frères perdus, les frères que l’on veut par la guerre de revanche, soi-disant reconquérir, sont maltraités par les Français et mis par eux dans le même sac que tous les autres Allemands ».
(p.141) Combien de Lorrains ont été ainsi emmenés alors que, nés français ou de parents français, ils croyaient ne rien risquer de la part de l’armée française ? Plusieurs disent qu’ils avaient accueilli les « pantalons rouges » en les considérant « comme leurs frères » ou « avec la plus sincère confiance et les sentiments les plus amicaux ».
(p.144) Tous les otages ne sont pas rentrés en juillet 1918. D’abord les morts dont le nombre n’est pas connu et qui dépasse probablement la centaine, la plupart du temps enterrés à la va-vite à Clermont, Issoire, Saint-Rémy, Béziers, Marseille… Plusieurs n’ont revu leur famille qu’après l’armistice, quelques-uns même en 1919.
En 1920, une veuve ayant demandé le rapatriement du corps de son mari, décédé en 1916 à Clermont-Ferrand, se vit répondre par le préfet du Puy-de-Dôme que le ministère de l’Intérieur, ne disposant dans son département d’aucun crédit « pour les dépenses de cette nature », ne pouvait donner satisfaction à cette demande[38].
On a vu comment, pendant la guerre même, peu de gens, dont Barrés, se sont préoccupés du sort des internés.
Le drame des otages alsaciens-lorrains n’est, finalement, connu que dans les familles dont un membre a passé la guerre dans les camps d’internement français. Et encore. En 1999, ayant lu notre article « Château-Salins, août 14[39] », deux messieurs à l’air grave sont venus me voir. C’étaient les petits-fils d’un otage qui avait connu, entre autres, les affres du séjour dans les arènes en ruines de Béziers. Leur grand- mère, devenue veuve, ne leur avait rien dit de la captivité de son mari. C’était un épisode douloureux de sa vie dont il ne fallait pas parler. Ils ont voulu voir les documents d’archives prouvant ce que j’avais écrit à propos de leur aïeul. Ils n’en revenaient pas… La tradition du silence, en effet, a franchi les générations ; on n’aime pas, près d’un siècle après les (p.145) événements, évoquer la question.
Après la guerre, par contre, l’incarcération dans les camps ou forteresses allemands a constitué, pour ceux qui en revenaient, comme un ornement admirable. Parlant d’un habitant de Schirmeck récemment rapatrié, l’historien Louis Madelin affirme que « ses quatre ans et plus de prison et d’exil lui font une auréole[40] ». « Tous, écrit Emile Hinzelin, sont cruellement atteints dans leur santé et leur fortune. Tous, par conséquent, pour avoir été à la peine, méritent d’être à l’honneur[41] [42]. » Personne, apparemment, ne s’avisa de soulever le cas des Alsaciens-Lorrains internés en France qui, autant que leurs compatriotes prisonniers des Allemands, avaient été « cruellement atteints dans leur santé et leur fortune ». Mais il aurait fallu du courage, et aucun journaliste, publiciste ou homme politique n’en montra.
(p.146) Nos demandes de renseignements ont provoqué, à plusieurs reprises, des réactions d’étonnement et d’incrédulité de la part des archivistes. C’est le cas, par exemple, du directeur des Archives départementales de la Vienne (Poitiers) qui nous a répondu : « Vous êtes le premier à me faire état de camps, dans le département de la Vienne, où des Alsaciens- Lorrains auraient été internés pendant la Première Guerre mondiale[43]. » Et celui d’Aurillac : « En réponse à votre courrier […], je commencerai par vous dire qu’il n’y eut pas, à Aurillac, de “camp de concentration” pour Alsaciens-Lorrains durant la Première Guerre mondiale[44]. » Or, plusieurs Sarrebourgeois, l’instituteur Hommes parmi d’autres, ont été détenus dans un dépôt (un ancien couvent) du chef-lieu du Cantal. Il est vrai que, avec Jean-Claude Farcy, « on peut se demander si ces camps ne constituent pas l’une des pages peu reluisantes de notre histoire[45] » et qu’il vaut peut-être mieux ne pas conserver de traces de leur existence.
(p.149) Il reste que, aujourd’hui encore, près de cent ans apres îa fin de la Grande Guerre, on se demande encore pourquoi la France, qui se battait pour libérer les « provinces perdues », a pu saisir, interner et maltraiter les premiers Alsaciens- Lorrains « libérés ».
(p.164) Deutschoth = Audun-le-Tige
ANNEXE 8
OTAGES FRANÇAIS EN ALLEMAGNE
(p.171) Peu avant son départ pour la Suisse, en septembre 1917, l’instituteur Alphonse Lévêque s’était réjoui en apprenant que le gouvernement allemand s’était enfin décidé à enfermer deux mille Français à Holzminden. Il avait fait remarquer, aussi, qu’à son avis les prisons allemandes valaient beaucoup mieux que les françaises.
La guerre finie, plusieurs internés de Holzminden ont rendu compte de leur expérience dans le camp le plus connu d’Allemagne. Leur vie était-elle différente de celle des Alsaciens-Lorrains en France ?
Contrairement à beaucoup de Lorrains et d’Alsaciens évacués en France, les otages de la région occupée du nord de la France savaient pourquoi ils étaient arrêtés : il s’agissait pour l’Allemagne de faire pression sur le gouvernement français pour obtenir la libération des fonctionnaires alsaciens-lorrains indûment retenus en France.
Ils étaient mille, six cents hommes et quatre cents femmes appartenant à toutes les conditions sociales, des hauts magistrats aux simples ouvriers en passant par les négociants et les ecclésiastiques. La plupart des hommes avaient dépassé la cinquantaine, et les vieillards de soixante- dix, soixante-quinze ans n’étaient pas rares.
(p.172) L’accueil de Holzminden
L’accueil des civils de la petite ville de Holzminden ressemble beaucoup à ce que les Alsaciens-Lorrains ont vécu à Baccarat ou Clermont-Ferrand. Des hurlements et des cris féroces arrivent jusqu’aux femmes. Les civils qui sont là ont dû veiller dehors plusieurs heures dans la nuit glaciale. Les injures et les huées sont accompagnées de jets de pierres. Les sentinelles regardent et laissent faire. Les officiers se moquent des prisonnières. Le camp se trouve à deux heures de marche.
On les entasse dans quatre baraques aux cloisons disjointes. Elles couchent sur de misérables paillasses dans des lits superposés. Il n’y a pas de couvertures.
Le Bitchois Jules Pascaly a assisté à l’arrivée des Françaises. Il écrit :
« Ce jour-là, il faisait un temps “à ne pas mettre un chien à la porte”. Les femmes arrivaient par groupes, toutes grelottantes, après avoir stationné depuis deux heures du matin à la gare. Il y en avait de tous les âges, beaucoup entre soixante-dix et quatre-vingts ans, traînant péniblement leurs bagages et houspillées par de la soldatesque armée jusqu’aux (p.172) dents On tasse ces dames comme des harengs dans quatre baraques, quand il y en avait au moins trente de vides. Les lits ! Grand Dieu, consistaient en un assemblage de chevrons et de planches. Imaginez-vous des cages à lapin superposées, avec un sac de bruyères comme litière. Véritable nid de punaises. Voilà en quoi consistait l’hospitalité de Sa Majesté Guillaume II à l’égard des dames des premières familles de France, parmi elles la baronne d’Huart, de Longwy, Mme Labbé, de Gorcy… »
Nourriture et soins médicaux
L’alimentation des hommes consiste en une soupe claire à midi et, le matin et le soir, en une infusion chaude. Il n’y a ni soins ni médicaments. Dès les premiers jours les malades sont nombreux et vingt-cinq meurent en quelques semaines.
Malgré leur état de faiblesse, les otages sont obligés de travailler. Ils déblaient la neige et abattent des arbres dans la forêt proche. Ensuite il faut transporter et débiter ces arbres.
Les punitions sont infligées pour la moindre entorse au règlement : corvées de nettoyage des latrines et de vidange de la fosse.
Dans leurs baraques, les femmes souffrent beaucoup du froid l’hiver et de la chaleur l’été. Les puces et les punaises pullulent. Pour les humilier on les fait défiler, un jour, entièrement nues devant des femmes de la ville. Il n’y a pas de WC, ils sont remplacés par des trous qu’aucune cloison ne protège des regards des voisins.
La nourriture : une tranche de pain noir de 200 grammes par jour. Le matin, soupe avec morceaux de carottes et de betteraves, à midi et le soir soupe très claire.
Un médecin russe prisonnier a été affecté au camp, mais il n’a pas de médicaments.
La correspondance avec la famille dans les régions occupées est interdite. Les maris, les enfants, les amis ignorent ce qu’elles sont devenues, où elles se trouvent.
[1] Nous avons publié, en 1998, le récit d’un otage lorrain : 1914- 1918. Des Alsaciens-Lorrains otages en France, aux Presses Universitaires de Strasbourg. Et le titre de cet ouvrage reprend celui d’un article intitulé « Prisonniers des libérateurs. Le drame des otages lorrains en août 1914 », Cahiers Lorrains (Metz), n° 4, décembre 1998. Autres publications du même auteur sur la question des otages : « Les camps de concentration aveyronnais de la Grande Guerre », Etudes aveyronnaises (Rodez), 1998. – « Un camp de concentration à Aurillac pendant la Grande Guerre : la Mense », Revue de la Haute-Auvergne (Aurillac), avril- juin 1998. – « Plaisance : un camp de concentration à Béziers (1914- 1916) », Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers, vol. III, 1998- 1999. – « Grandes vacances dans le Midi. Les instituteurs lorrains otages des Français pendant la Grande Guerre », L’Ancien (Bulletin des anciens élèves des écoles normales de Metz), n » 115, septembre 1999.
[2] Raoul Allier, op. cit., p. 147.
[3] Forteresse dominant la confluence du Rhin et de la Moselle située face à Coblence où de nombreux Lorrains avaient été incarcérés peu avant le début de la guerre. Ils créèrent une association : Incarcérés lorrains pendant la Guerre du Droit.
[4] Rapport de gendarmerie du 2 septembre 1922. ADM 5 R 534.
[5] Concernant l’arrestation de l’instituteur Gachot, ci-dessus, page 8,
une autre version est donnée par le préfet de la Moselle dans une lettre au Commissaire général de la République à Strasbourg (19 septembre 1921) : « Au début de la guerre, des officiers français s’étant rendus à la mairie de Moussey, y trouvèrent le maire et M. Cachot. Ce dernier, qui était pris de boisson, eut une attitude arrogante et inconvenante envers ces officiers qui le gardèrent comme otage. » ADM 5 R 527.
[7] ADM 5 R 535.
[8] ADM 5 R 532.
[9] Saarlouiser Journal, 5 septembre 1914, qui reprend une information parue dans la Norddeutsche Allgemeine Zeitung. – D’après un autre journal, il s’agirait de huit fonctionnaires et leurs femmes et d’environ vingt enfants : Gazette de Lorraine (Metz), 28 août 1914.
[10] « Als Geiseln in Frankreich – Wie die Franzosen die Frauen behandeln » (Otages en France – Comment les Français traitent les femmes), Metzer Zeitung (Metz), 17 et 18 septembre 1914. – Titre à comparer avec celui d’un article paru à Metz après la guerre : « Le martyr des otages. Comment les Françaises furent traitées à Holzminden », Le Lorrain, 9 janvier 1919.
[11] Elisa Rossignol, Une enfance en Alsace, 3′ éd., Mulhouse, 1995, pp. 112-113.
[12] L’instituteur Adolphe Jacquot, de Voyer, à son inspecteur, 12 juin 1919. ADM 5 R 529.
[13] Lettre au préfet, 18 janvier 1922. ADM 5 R 529.
[14] Enquête de gendarmerie du 7 mars 1922. ADM 5 R 534.
[15] FL.
[16] Sur l’accueil des otages français en Allemagne, Henriette Celarié écrit : « Les captives arrivent à Holzminden. Ordre leur est donné de descendre [du train]. Elles obéissent, s’acheminent vers la sortie. Des hurlements, des cris féroces viennent jusqu’à elles. Pour attendre les otages, pour les bafouer, les injurier, une partie de la population de la petite ville a veillé, dehors, dans la nuit glaciale ! Des hommes, des femmes, des enfants se pressent aux alentours de la gare. […] Non contents de nous huer, de nous faire des grimaces, ces Boches ramassent des pierres, nous les jettent. Les sentinelles regardent, laissent faire et les officiers qui les commandent se moquent des captives. » Article cité, p. 658.
[17] Première citation in Pierre Fervacque, L’Alsace minée ou De l’autonomisme alsacien, Paris, 1929, p. 32. – Deuxième citation : lettre de l’aide- major de lère classe Sébastien Caillol à sa femme, 19 septembre 1914. Coll. part.
[18] FL, pp. 52-53.
[19] HS, pp. 32-33.
[20] Un immigré, probablement.
[21] « Erlebnisse in franzôsischen Zivilgefangenenlagmi. Von rinem Richter » (Expériences d’un juge en captivité en France), KR, pp. 2-5.
[22] II avait une fracture du crâne, il fut libéré et hébergé par un de ses confrères à Epinal.
[23] L’expression est de l’instituteur Hommes, dont les sentiments allemands ne flancheront jamais et qui exercera souvent son ironie à l’égard de la France et de tout ce qui est français.
[24] Récit d’un receveur des postes de Thann, in KR, pp. 23-24.
[25] LG, pp. 22-23. Contrairement à KR, les auteurs donnent les nom et prénom des auteurs des récits.
[26] LY, pp. 36-39.
[27] A cause du pèlerinage au Sacré-Cœur, organisé dans la ville depuis 1873.
[28] KR, pp. 29-30.
[29] Libéral de l’Ailier, 6 septembre 1914. « Plusieurs trains de «Joyeux » — c’est ainsi qu’on nomme les repris de justice que l’on dirige sur les régiments de discipline — sont passés à destination du Maroc et de l’Algérie. Un de ces trains s’est rencontré avec un train de prisonniers. Les «Joyeux » se sont précipités sur le wagon des prisonniers en les invectivant et en cherchant à les frapper. Les officiers n’ont pu qu’à grand peine rétablir l’ordre. » Ni Laurent, ni Hommes ne parlent de l’intervention d’officiers.
[30] KR, pp. 9-10. – Le témoin quitte Moulins le 24 septembre pour un camp en Bretagne, comme le signale le Libéral de l’Ailier du 27 septembre.
[31] LY, pp. 40-41.
[32] En alsacien : « Vous pourrez être fusillé après la guerre. »
[33] Commune d’Orcines.
D’après un membre de groupe, Joseph Heitz, dix-huit personnes avaient été arrêtées en même temps et conduites à marche forcée en direction de Nancy. Il avait, lui, reçu des coups de crosse parce qu’il ne marchait pas assez vite. ADM 5 R 28.
[35] LG, pp. 43-44. Ceci se passa le 23 août.
[36] Mandat de paiement du 30 juin 1931. ADM 5 R 531.
[37] KR, pp. 67-69. Comme les deux citations suivantes.
[38] Lettre de la veuve Noël au préfet du Puy-de-Dôme, 7 août 1920.
- Préfet au Commissaire de la République à Strasbourg, 2 juin 1920.
- Dépêche du ministre de l’Intérieur, 29 mai 1920. ADPD MO 2892. – Auguste Noël est décédé à la caserne de La Chasse le 12 avril 1916.
[39] Le Pays lorrain (Nancy), juillet-septembre 1999, pp. 187-194.
[40] Louis Madelin, Les heures merveilleuses d’Alsace et de Lorraine, Paris, 1928, p. 81.
[41] Emile Hinzelin, L’Alsace la Lorraine et la paix, Paris, 1928, p. 21.
[42] Lettre au commissaire de la République, 8 août 1919. ADM 5 R 535.
[43] II ajoutait : « Quelques liasses ont trait aux réfugiés, y compris Alsaciens » (lettre du 19 août 1996). Dans la Vienne, deux camps, l’un à Poitiers, l’autres à Montmorillon, ont « accueilli » des Alsaciens-Lorrains pendant la Grande Guerre.
[44] Lettre du 29 avril 1996. Il faut noter au passage l’emploi des guillemets, alors que la formule camp de concentration était d’un usage courant (circulaires officielles, rapports, cartes postales, actes de l’état civil) à l’époque de la Grande Guerre. – Plus tard, nous nous sommes rendu compte par nous-même de l’absence de documentation sur le dépôt de La Mense.
[45] |ean-Claude Farcy, Les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale (1914-1920), Paris, 1995, p. 359.
1918- |
Joseph Rohr, La Lorraine mosellane, 1918-1946, 1973
AVERTISSEMENT
On use à tort et à travers des termes : Alsace, Lorraine, Alsace-Lorraine, Alsace et Lorraine. C’est regrettable. Qui sait encore, par exemple, que la Lorraine comprenait avant 1871 les départements de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle et des Vosges? Que la frontière définie par l’annexion allemande amena la France à constituer avec les morceaux restants de la Moselle et de la Meurthe, ce curieux département à long cou de girafe qui s’appelle la Meurthe-et-Moselle, le nom de Moselle devant être attribué, après 1918, au lambeau de Lorraine récupéré? … Que toute une bande de terre actuellement alsacienne, au sud du Donon, avait fait partie du département des Vosges…? Qui a jamais connu, en France, la situation linguistique véritable des territoires annexés, la nature et la portée exactes de leur bilinguisme ou de leurs divers particularismes? Ce ne sont que confusions, amalgames, fausses assimilations aux cas d’autres provinces… D’où les malentendus qui ont, depuis 1918, empêché la France d’appréhender avec sérénité et discernement les problèmes propres à ces pays. Pour des raisons de prudence, des Alsaciens eux-mêmes se sont fait les propagateurs de cette thèse naïve selon laquelle la germanophonie aurait été l’oeuvre exclusive de l’occupation et de l’école allemandes. L ‘origine de cette fable est dans les oeuvres de Barrès qui peignait la situation de l’ensemble des pays annexés à travers les prismes particuliers de la région messine francophone, dans l’histoire de la « dernière classe » d’A. Daudet, dans les alsacienneries bien intentionnées, mais regrettables à plus d’un titre, de Hansi. Hansi, pour l’essentiel, c’était la grosse artillerie justifiée par les circonstances, disons plutôt du bobard de guerre, aussi indispensable sur les chemins de la Victoire que le carburant dans le moteur des tanks… Beaucoup de Français de l’intérieur, des journalistes parisiens notamment, qui se documentent sur l’Alsace-Lorraine annexée dans les archives municipales de Gorze ou de Château-Salins, vivent encore sur des idées saugrenues de cette origine. D’autres, il est vrai, situent Nancy ou Bar-le-Duc dans l’ancienne Lorraine annexée et font de Jeanne d’Arc une « fille d’Alsace-Lorraine »! Et un homme politique, nancéien de circonstance, dramatise les problèmes propres à sa région en les mêlant à ceux des frontaliers alsaciens-lorrains… [écrit en 1973]
Il y a un peu plus d’une vingtaine d’années, à l’occasion d’une visite du Président Robert Schuman (originaire du nord-est lorrain} à Nancy, nous avons entendu à la radio un speaker évoquant, d’une voix à trémolos, la satisfaction émue des Nancéiens d’entendre le haut visiteur s’adresser à eux « dans la même langue que la leur » Sans doute en « alsacien » ou quelque chose de ce genre! Parlerons-nous aussi de ces gens éminents qui se sont appliqués à démontrer que l’ « alsacien » était une variété de patois français? De tous ceux-là encore qui ont cru devoir opposer « la lourdeur tudesque des constructions wilhelminiennes à la grâce si française des maisons alsaciennes »? De la pure rigolade. En beaucoup de matières, l’intelligence française est rigoureusement hexagonale. Quand des cigognes se posent quelque part sur un toit, elles viennent évidemment d’Alsace. L’idée qu’elles pourraient venir de Bade, du Palatinat ou de Westphalie n’effleure la pensée de personne. La frontière est obstacle, même pour les oiseaux. En fait aucune étude sur l’Alsace et la Lorraine ne devrait paraître qu’accompagnée d’un croquis schématique illustrant bien la situation géographique de ces pays avec frontière d’annexion et zones linguistiques. Sinon, tout est sujet à malentendus. M. Joseph Rohr fait l’honneur bien peu mérité de solliciter, qui nous a notre avis sur différents points de son ouvrage, a bien voulu faire droit à cette suggestion. .
(N.B. Il va sans dire que le respect des documents cités et du style officiel fait apparaître souvent, dans le présent ouvrage : « Alsace et Lorraine » pour « Alsace- Lorraine », “Lorraine” pour « Moselle », etc… Nous ne pouvons hélas! rien rétroactivement contre ce laxisme institutionnalisé).
P. Moinaux
(p.10) Le malaise
Le premier contact entre la France et les provinces recouvrées a été marqué par un élan irrésistible vers la France mais bientôt après se produisit une réaction contre les tendances excessives d’unification, ce qui est connu sous le nom de « malaise alsacien-lorrain »: 1) Un des premiers malentendus est né de la germanophonie en Alsace-Lorraine, les Français croyant dans leur grande majorité que celle-ci était une importation allemande postérieure à 1871. En fait, les parlers allemands en Alsace-Lorraine remontent à plus de quinze siècles. Plus ou moins bien compris par la population dans son ensemble avant 1871, le français n’ était vraiment parlé que dans la bourgeoisie. Il n’y a eu importation linguistique allemande que dans les zones francophones des régions messine et vosgienne (voir carte). Elle fut d’ailleurs nécessairement d’ordre scolaire et d’une efficacité très inégale. 2) Beaucoup de Lorrains ayant servi dans l’ armée allemande pendant la guerre de 1914-1918 ne purent revenir qu’après l’armistice, lorsque les Français avaient déjà fait leur entrée. Ils furent reçus avec une animosité méfiante, comme des prisonniers ennemis, encadrés de troupes baïonnette au canon et dirigés vers une forteresse. Ce n’était sûrement pas leur faute d’ avoir servi dans les rangs allemands… 3) L’idée d’une classification de la population d’Alsace-Lorraine avait été proposée par l’abbé Wetterlé à la conférence d’Alsace et de Lorraine qui prescrivit dès le 19 et 26 avril 1915 de subdiviser la population en 4 catégories : A – B – C – D. Dès l’entrée des troupes, les Mairies furent averties d’établir des cartes d’identité qui servaient en même temps de pièces de légitimation. La carte A fut délivrée d’ office aux Alsaciens et Lorrains qui avaient eu la nationalité française avant 1870 ou à ceux dont les parents et grands-parents avaient été dans ce cas. Ils furent « réintégrés de plein droit » .[L’ancêtre de l’abbé Wetterlé, Laurent Widelin, était immigré (p.11) d’ Adelshausen (Allemagne). Son fils Jean Thomas, mort à Colmar le 29.1.1786, avait épousé à Wintzenheim (H.-Rh.), le 7.5.1742, Madeleine Blindin. Les enfants ont transformé leur nom Windelin en Wetterlé]. Reçurent la carte B ceux dont l’un des parents était de descendance étrangère; La carte C fut délivrée à ceux dont les parents des deux côtés étaient nés dans un pays allié ou neutre; Reçurent la carte D les étrangers originaires des pays ennemis (allemands, autrichiens, hongrois, etc.) et leurs enfants, même s’ils étaient nés en Lorraine. D’après le recensement de 1920, la ville de Sarreguemines comptait 14 187 habitants, dont 7 7 14 personnes avaient été réintégrées de plein droit. (Communication de M. Charles Langguth, mairie de Sarreguemines). Ces cartes d’identité ont joué un grand rôle lors de l’échange de l’argent allemand et des élections et pour la circulation dans le pays. Les titulaires de la carte D et des indésirables durent quitter le pays. Ainsi, de décembre 1918 à octobre 1920, 100 000 Allemands, dont 14 000 fonctionnaires, les uns de gré, les autres de force, quittèrent le pays. Parmi les volontaires figura Mgr. Benzler, évêque de Metz, qui dut démissionner le 12 janvier 1919. Il avait reçu l’ordre de se présenter, le 27 avril 1919, à la gare centrale de Metz. Grâce à l’intervention de son successeur, le vicaire général de Metz, Pelt, cet ordre fut retiré et Mgr. Benzler put quitter, le 27 août, son diocèse par Sierck-Perl. Les vicaires généraux Pelt et Cordel et le Chanoine Collin l’accompagnèrent jusqu’à la frontière. Il est décédé le 16 avril 1921 à Lichtental, archevêque titulaire d’ Attala; il fut enterré à l’ abbaye bénédictine de Beuron. (Un prédécesseur de Mgr Benzler, Mgr Dupont des Loges, bien que né à Rennes le 11.11.1804, avait pu cependant continuer d’exercer ses fonctions d’évêque sous la domination allemande jusqu’à sa mort, survenue le 1 8 août 1886).
(p.12) N.B. Les circonstances du départ de Mgr Benzler soulevèrent à Metz une émotion considérable, le prélat allemand ayant fait preuve d’une grande compréhension à l’égard de la population mosellane.
DOCUMENT ORDONNANT LE RAPATRIEMENT DE MGR. BENZLER Commissariat de la République Service spécial des Rapatriements p. l’Allemagne N° 14bis
Benzler Willibrord, 66 ans – Sa soeur, 51 ans et Amann Ottmar, 51 ans. Rapatrié volontaire : M. Mgr. Willibrord Benzler, âgé de 66 ans , Profession : Evêque, Domicilié à Metz, 15 , Place Ste Clossine, est avisé que sa demande de rapatriement est acceptée. En conséquence, le Commissaire de la République lui donne l’ordre de se trouver le 27 août 1919 , à 9 1/2 heures du matin, à la gare centrale de Metz.Le rassemblement aura lieu dans la grande salle des PasPerdus de la gare.Chaque voyageur pourra emporter . 1 . Un maximum de 30 kg de bagages à main. 2. Deux jours de vivres. 3. Un maximum de 2000 M. par personne majeure et 500 M. par enfant, en billets de banque allemands. Toute somme supérieure sera confisquée. Il est interdit d’emporter soit de l’or, soit de l’argent monnayés, soit des billets de banque français ou alliés, soit des lettres.
(p.13) Les personnes qui, pour une raison quelconque reconnue non valable, manqueraient le départ au jour fixé, se verront refuser ultérieurement toute autorisation. Chaque voyageur devra avoir pris son billet de chcmin de fer à la gare de Metz avant de se présenter au chef de convoi. Les guichets de la salle des Pas-Perdus délivreront les billets depuis l’ avant-veille, jusqu’ à l’heure de la convocation. Metz, le 22 août 1919. Pr. le Commissaire de la République Le Chef de Service Spécial de Rapatriement. Timbre : Le Commissaire de la République rouge : Metz, Service spécial. Rapatriement, Signature : (illisible). Visa du Contrôle sur le quai.
Cette convocation sera présentée à l’autorité militaire à l’arrivée à la gare de Metz (Salle des Pas-Perdus). (Elsass IV, p. 407).
Création d’une commission chargée d’examiner les demandes de naturalisation
Le 15 juin 1922 parut dans l’Impartial de l’Est (Nancy) la liste des commissions qui, dans la Moselle, devaient être chargées d’examiner les demandes de naturalisation formulées par les Allemands en vertu du traité de paix: COMMISSION DE METZ. – Président : M. Boudouin-Bugnet, vice-président au tribunal régional de Metz ; Membres : MM.Vautrin Paul, conseiller général de la Moselle ; le docteur Maret, ancien adjoint au maire de la ville de Metz ; Prével, directeur du Crédit coopératif, ancien maire de la ville de Metz ; Stoos, ancien conseiller municipal à Metz. Président et membres suppléants :Président : M. Taron, juge au tribunal régional de Metz ; membres : MM. Henry Léon, conseiller général, maire de Courcelles-Chaussy ; Charpentier-Moitrier Albert, industriel à Metz ; Strasser, employé et membre du comité des anciens combattants à Metz ; Dezavelle Oscar, rentier à Montigny-lès-Metz.
(p.16) Très souvent les fonctionnaires alsaciens-lorrains cités devant la commission et relâchés furent suspendus ou révoqués de leurs fonctions ou forcés de prendre une retraite anticipée ou se virent exposés à toutes sortes de chicanes administratives ou professionnelles. Expulsés du territoire, les ressortissants allemands ne pouvaient emporter comme bagages que ce qu’ils pouvaient porter et 200F. M. Minck a donné dans la « Dépéche de Strasbourg » , organe radical, du 12 janvier 1930 quelques renseignements sur le fonctionnement des commissions: « Ces tribunaux n’ont pas seulement été illégaux, mais leur procédure et leurs jugements ont été dépourvus de toutes les garanties des procédures et jugements ordinaires. Les juges n’ avaient aucune des qualités officielles qui sont requises pour un juge. Ils n’ étaient ni assermentés ni responsables de leurs jugements. Les témoins ne prêtaient pas serment et n’encouraient aucune responsabilité légale. Ils témoignaient en l’ absence des accusés qui d’ ordinaire ne connaissaient même pas leurs accusateurs. L’accusé ne pouvait pas prendre connaissance de son dossier et l’assistance d’un défenseur lui était interdite. C’est l’accusé qui devait prouver son innocence et non le tribunal sa culpabilité. Le tribunal jugeait sans appel et sans être obligé de motiver son jugement. Il convient d’ajouter que les tribunaux ont usé et abusé de cette situation illégale, au point de baser parfois leurs jugements sur des dossiers sciemment faussés et sur des documents inexistants. » Citons l’opinion d’un juriste M, Robert Redslob, professeur de Droit international à l’Université de Strasbourg, qui en avril 1929 écrivit dans le « Temps »: « Après l’ armistice, une véritable chasse à courre fut déchaînée contre ceux qu’on accusait ou soupçonnait d’avoir fait des concessions à l’ancien maître. Malheureusement, le régime français a fait le jeu de ce mouvement par l’institution d’une sorte de Haute Cour de Justice en patriotisme.
(p.17) Je qualifierai cette Cour du qualificatif le plus indulgent que je sois capable de trouver: je dirai qu’elle fut une conception antijuridique. Faire rendre compte à des Alsaciens et Lorrains devant la barre d’une espèce de tribunal, de l’attitude qu’ils avaient eue pour le régime constitutionnellement établi et basé sur un traité en règle, je dois avouer en toute humilité que je n’ai rien compris à cette procédure… Sans doute, pour le dérèglement de l’attitude alsacienne sous l’ancien régime, il fallait des sanctions. Mais c’était l’opinion publique qui devait réagir contre les coupables – elle était suffisamment armée pour le faire – et non un tribunal. Je sais bien qu’il s’agissait aussi d’une mesure de sécurité pendant l’ occupation militaire, et que nous vivions pour un temps sous un régime d’exception. Mais alors pourquoi n’avoir pas franchement décrété un exil forcé contre les éléments dangereux, mesure analogue à la fameuse « Schutzhaft »? Pourquoi fallait-il créer le simulacre d’un tribunal? On a deviné que je veux parler des commissions de triage. Sait-on le mal que cette institution a fait chez nous ? Aujourd’hui, hélas, elle porte ses fruits. »
A partir du 7 mai 1919, les fonctionnaires ne comparurent plus devant les commissions de triage; ce jour, les conseils de discipline furent rétablis, mais le commissaire général se réservait le droit de déplacer d’office ou de suspendre les fonctionnaires pour des motifs politiques. Le 27 octobre 1919, après la ratification du traité de paix, le 12 octobre, Millerand envoyait aux Présidents des commissions de triage la circulaire suivante : « …La ratification du Traité de Paix offre pour les Alsaciens et Lorrains réintégrés dans la nationalité française un régime nouveau qui ne comporte plus le maintien des mesures en vue desquelles les Commissions de triage et de Classement au second degré avaient été instituées. La mission qui vous avait été confiée ainsi qu’aux membres devra être considérée comme terminée… »
(p.18) Le député Sturmel formula le 8 novembre 1929 une proposition de loi concernant la révision des décisions des commissions de triage et la réparation des injustices commises par lesdites commissions. Le député Schuman déposa le 18 février 1931 une proposition de loi en faveur des fonctionnaires victimes de ces commissions antérieurement à l’arrêté du 7 mai 1919. Ces 2 propositions de loi furent de nouveau remises à l’ordre du jour en 1932, mais le gouvernement refusa de réparer les injustices bien que le gouvernement Chautemps ait parlé le 26 février 1930, dans sa déclaration, de réparer les injustices commises. Le 16 mars 1932 encore le Président du conseil Laval refusa toute réparation, alors que presque tous les députés alsaciens et lorrains se prononcèrent pour une réparation de ces injustices. 5° ) Certains fonctionnaires venus de toutes les régions de l’Intérieur ont contribué par leur incompréhension totale de la situation locale dans une large mesure à aggraver le malaise; pour ne citer que l’organe des fonctionnaires « Le Journal des Contributions » (n° du 28.12.1918): « L’ Administration ne pourra que très rarement employer les ex-fonctionnaires allemands et le mieux sera de chercher parmi le personnel français les employés… Pour le cadre secondaire, il serait possible de les constituer avec du personnel pris parmi les Alsaciens d’ origine anciennement employés des douanes et des octrois de France. On aurait ainsi des employés d’un loyalisme éprouvé, qui seraient vite au courant de leurs obligations et que les populations, à coup sûr , accueilleraient beaucoup mieux que les ex-loups teutons, même recouverts d’habits de berger français. » 6°) Un autre motif du malaise était le régime des traitements et retraites des fonctionnaires. Ne citons qu’un seul cas. Le régime allemand ne faisait subir aux fonctionnaires aucune retenue pour la retraite; le régime français, au contraire comporte une retenue qui était d’ abord de 5 010 , puis de 6 010 du montant du traitement.
(p.19) D’après les lois de l’Empire, l’avancement se faisait automatiquement par années de service, excluant tout favoritisme, toute promotion au choix. Ce n’est qu’en 1923, après des frottements inutiles et des luttes acharnées qu’ on aurait pu éviter, que le cadre alsacien-lorrain dit local (bien plus avantageux que le cadre général) permit de conserver la plupart de ces avantages antérieurs. M, F, Kiener, professeur d’histoire de l’Alsace à la Faculté des Lettres de Strasbourg, en parlant des fonctionnaires du cadre local et du cadre général, dit lors d’une conférence donnée le 6 juin 1928 à Paris, sous les auspices de l’ « Union pour la Vérité »: « Je dirais, si j’avais à formuler la différence, que le fonctionnaire du type local est plus fortement attaché à sa fonction, tandis que le fonctionnaire français est plutôt un employé dépendant de son supérieur. Combien de fois après l’ armistice n’avons-nous pas été étonnés d’entendre dans l’antichambre d’un grand personnage de la République, ces mots : « Le Patron va vous recevoir ». Le Patron, à la tête d’une clientèle, pour désigner un appareil bureaucratique. Le mot est charmant, mais il donne à réfléchir. » (Revue des Vivants, juillet 1928). Aussi le Gouvernement écarte-t-il les Alsaciens et les Lorrains de tout poste élevé; le même procédé avait été employé après 1870 par les Allemands. Voilà comment les conseils de Clemenceau aux fonctionnaires envoyés en Alsace et en Lorraine « Allez et faites aimer la France » furent suivis à la lettre. Donnons un extrait du journal « Le Messin » du 15 septembre 1919, dont on ne peut pas suspecter le patriotisme : »Il serait puéril de dissimuler la vérité: il y a dans nos provinces reconquises un état d’esprit nettement hostile aux fonctionnaires venus de France. L’Alsace-Lorraine était, lorsque nous l’avons reprise, un pays à tendance très particulariste. Il est resté tel… Au point de vue administratif, ce pays prenait l’habitude de l’ordre et de la discipline; au point de vue moral, il avait une mentalité (p.20) toute particulière, différente de celle de toutes les autres régions de la France; et surtout il avait un besoin très ardent de liberté et d’indépendance… On peut affirmer que le Gouvernement n’a pas toujours réussi dans le choix de ses fonctionnaires et dans la rédaction des directives qu’il leur a données… Le malaise est très grave… Il n’y a pas de temps à perdre. » (Das Elsass I, 549).
A toutes ces causes de frictions entre les Lorrains et l’ autorité française s’ajoutait un fait particulièrement grave :le 1 7 juin 1924 la déclaration ministérielle d’Edouard Herriot annonçait avec la suppression de l’ambassade du Vatican l’application rigoureuse de la loi sur les congrégations, l’introduction en Alsace-Lorraine de l’ ensemble de la législation dite républicaine, c’ est-à-dire des lois laïques. Ce fut un vaste mouvement de protestation.Herriot ne se rappelait très probablement plus les paroles du généralissime Joffre prononcées le 24 novembre 1914 à Thann (Haut-Rhin) au nom de la France et publiées dans le Bulletin des Armées le 2 décembre 1914 : »Votre retour est définitif. Vous êtes Français pour toujours. La France vous apporte, avec le respect des libertés qu’elle a toujours respectées, le respect de vos libertés à vous, des libertés alsaciennes de vos traditions, de vos convictions, de vos moeurs. Je suis la France. Vous êtes l’Alsace. Je vous apporte le baiser de la France. » Ces paroles furent confirmées: le 11 février 1915 par le président Poincaré à St. Amarin, le 11 novembre 1918 par le président de la Chambre Deschanel devant la Chambre, le 14 novembre 1918 par le maréchal Pétain dans un ordre du jour lu à tous les soldats avant l’ entrée en Alsace-Lorraine, le 16 novembre 1918 par le général Mangin à Metz,
(p.21) le 24 novembre 1918 par le général Gouraud à Strasbourg, le 29 novembre 1918 par Herriot qui, s’inspirant des paroles du général Gouraud, déclara à Lyon : « la France respectera vos coutumes, vos traditions locales, vos croyances religieuses, vos intérêts économiques. Une telle promesse doit êre tenue.’ le 22 mai et le 2 juin 1919 par le commissaire général Millerand, le 6 septembre 1920 par Millerand, président du conseil à Metz, le 13 novembre 1921 par Barthou, ministre de la justice à un banquet à Strasbourg, le 30 mai 1923 par Millerand, président de la République, en déclarant à Colmar: « C’est ce qu’avaient bien compris des hommes comme Joffre, Poincaré et Clemenceau, quand ils promettaient à l’Alsace et à la Lorraine, au moment où ils mettaient le pied sur leur sol, que la France respecterait avec un soin religieux ses habitudes, ses coutumes, toutes ses croyances, ses opinions, qu’ils n’ avaient rien à craindre du retour à la mère-patrie… Cette politique là, nous ne l’abandonnerons pas . » le 5 juin 1923, il déclara à Metz: « Enfin, et en sens inverse, il est tels moments de la législation locale qu’il importe de maintenir, parce que nous nous réservons d’en faire ultérieurement bénéficier la France entière. Et je laisse volontiers de côté ces parties de la législation locale où la conscience est particulièrement intéressée, et qui ont provoqué des représentants les plus autorisés de la France et de la République de solennels et réitérés engagements. »
En septembre 1924 Millerand confirma en outre ses promesses dans une lettre adressée au député Paqué de St. Avold, et enfin, en janvier 1929, Poincaré donna solennellement l’ assurance qu’il ne sera pas touché à l’école confessionnelle et au concordat sans la volonté des habitants d’Alsace-Lorraine.
(p.23) Protestation du Conseil général de la Moselle :
Les conseillers généraux de la Moselle, réunis hors séance, approuvent à l’unanimité le voeu suivant : « Considérant que les populations qu’ils représentent ont, pendant 48 années de séparation, conservé pieusement leurs traditions et leurs croyances comme un héritage de la France absente; Considérant que ces populations, passionnément attachées à la patrie et à la République attendent d’elles un régime de justice, de liberté, de paix sociale et religieuse; Considérant que le principe de l’unification législative , réclamée en toutes occasions par le Conseil général, doit étre concilié avec le respect de ces traditions et de ces croyances, ainsi qu’ avec la réalisation de cet idéal; Approuvant entièrement les déclarations et les démarches faites dans ce sens par les parlementaires de la Moselle; Considérant qu’à maintes reprises les représentants des gouvernements successifs ont promis qu’il serait tenu compte d’un passé éminemment respectable; Considérant que dans sa déclaration ministérielle le gouvernement s’est engagé à ménager les intérêts moraux des populations désannexées. Font un pressant appel au patriotisme éclairé de M. le président du Conseil et au désir d’union qu’il a manifesté, afin qu’avant toute modification éventuelle des institutions religieuses et scolaires dans les départements recouvrés, soit pris en considération l’avis de tous les organismes qualifiés pour représenter la population lorraine.
24 mai 1926
Combien les craintes exprimées de M. Schuman se trouvaient justifiées, la suite des événements devait le prouver. Tous les mécontentements et les déceptions ont contribué à la fondation de l’Elsass-Lothringer Heimatbund (Ligue de la petite patrie alsacienne-lorraine) le 24 mai, qui allait marquer (p.24) le point de départ de l’activité autonomiste. Deux semaines après sa réunion constitutive, la nouvelle ligue publia un appel à tous les Alsaciens-Lorrains fidèles à la petite patrie le manifeste du Heimatbund (front commun de défense régionale) signé par des personnes de toutes les professions. Les signataires réclamaient l’autonomie pour l’Alsace-Lorraine dans le cadre de la France.
LE MANIFESTE DU HEIMATBUND
Appel à tous les Alsaciens-Lorrains fidèles à la petite patrie (N.B. Traduction maladroite de « Heimat’. .. sol natal, région)
5 Juin 1926. « C’est à une heure particulièrement grave que les soussignés s’adressent aux Alsaciens-Lorrains pour leur demander de s’occuper activement de leurs destinées. Hésiter davantage, ce serait trahir notre pays et nous rabaisser nous-mêmes car la mesure est comble. Depuis sept ans nous assistons, jour par jour, au spectacle écoeurant d’une spoliation méthodique; sur notre sol, on nous dépossède de nos droits, on oublie, on foule aux pieds les promesses solennelles qu’on nous a faites, on s’applique à ignorer les qualités de notre race et de notre langue, on se moque de nos traditions et de nos coutumes. Nous savons aujourd’hui que les fanatiques partisans àe l’assimilation veulent s’attaquer au caractère, à l’âme et à la civilisation même du peuple alsacien-lorrain, sans respect aucun de la liberté de conscience et de la conviction intime des Alsaciens-Lorrains. Dès que nous parlons de nos droits, naturels ou acquis, on nous bafoue et on nous accable de calomnies et de menaces. Sous aucun prétexte, nous ne supporterons désormais cette misère. Nous avons compris que presque tous les Alsaciens-Lorrains, ceux surtout qui, au milieu des défaillances, ont su rester des Alsaciens-Lorrains conscients de leurs devoirs et de leurs droits, (p.25) pensent comme nous et, se plaçant avec nous résolument au point de vue de la conscience alsacienne-lorraine et du culte du sol natal, voudraient remplacer la division qui existe actuellement, par un sentiment d’estime réciproque et les liens d’une forte solidarité. Au premier signe de ralliement ils chercheront à former ce front unique tant désiré pour empêcher, d’un effort unanime, l’oppression et la décadence de notre race. Nous sommes convaincus que la sauvegarde des droits imprescriptibles et inaltérables du peuple d’Alsace-Lorraine et la réparation des torts causés à des milliers de nos concitoyens ne nous seront garantis, en la situation de minorité nationale où nous nous trouvons, que si nous obtenons l’autonomie complète dans le cadre de la France. Cette autonomie législative et administrative trouvera son expression naturelle dans une assemblée représentative, élue par notre peuple, jouissant du droit de budget et dans un pouvoir exécutif, ayant son siège à Strasbourg ; les membres de ce dernier seront pris dans le peuple alsacien-lorrain et auront à assurer, à côté du Parlement de Paris, seul compétent pour les questions françaises d’ordre général, le contact avec l’Etat français. Notre premier devoir sera la création d’un front uniqu e par rapport à la question si délicate des convictions personnelles en matière religieuse, afin de ne pas affaiblir notre force par des divergences d’opinion ou de parti. C’est pourquoi nous désirons, en ce qui concerne les rapports de l’Eglise et de l’Etat et la question scolaire, le maintien de la législation actuelle, jusqu’au moment où le peuple alsacien-lorrain sera lui-même en mesure de donner à ces questions la solution définitive. Quant à la question scolaire, nous pensons qu’il appartient aux parents, de par un droit intangible, de décider du genre d’éducation qui convient à leurs enfants. Nous demandons, en outre, que la conviction chrétienne, qui constitue la base de la vie de la forte majorité de notre population, et qui durant plus de douze siècles, a produit les éléments constitutifs de notre patrimoine alsacien-lorrain soit pleinement respectée et que loin de vouloir la détruire, on laisse, dans (p.26) l’intérêt même de notre peuple, qui aspire au progrès et à la prospérité, se développer librement les forces morales qu’elle nous prodigue. La tolérance impliquée dans ce point dc notre programme garantira dans la même mesure le respect de toute autre conviction et évitera les discordes intestines dont nos ennemis savent si bien profiter pour nous désunir, de nous dépouiller de nos « Heimatrechte ». (N.B. droits régionaux)
Nous exigeons que la langue allemande occupe, en tant que langue maternelle de la majeure partie de notre population et langue classée parmi les premières du monde civilisé, dans la vie publique de notre pays la place qui lui revient. A l’école elle sera le point de départ, véhicule permanent de l’enseignement et matière d’enseignement. Comme telle, elle figurera au programme des examens. Dans l’administration et aux tribunaux elle sera employée simultanément et au même titre que la langue française. Notre enseignement primaire, secondaire et supérieur et toutes nos autres institutions pédagogiques et intellectuelles seront réglés et organisés non pas selon les ordres du pouvoir central de Paris, mais par notre futur Parlement, en conformité avec le caractère et la situation particulière de notre race et en plein accord avec les parents et le corps enseignant. Nous estimons que l’une de nos principales tâches est de cultiver le caractère régional alsacien et lorrain et de conserver à notre peuple le souvenir vivant et exact de son riche passé historique et intellectuel, afin de l’encourager à tirer de ses dispositions naturelles et de ses propres ressources le plus d’avantages et de prospérité possible. En vertu de notre droit primordial et des principes de la justice sociale et en tenant compte de notre langue, nous insistons pour que nos compatriotes qui se sont orientés vers une carrière administrative, aient leur place dans l’Administration et la direction de ce pays, Eux seuls pourront jusque dans les plus hauts emplois, fournir le travail administratif indispensable, rendu doublement
(p.27) difficile par la situation particulière où nous nous trouvons. Eux seuls pourront nous affranchir enfin du poids d’une bureaucratie arriérée et de tant d’injustices qui menacent de nous étouffer. Nous exigeons en outre : – l’autonomie complète du réseau des Chemins de fer d’Alsace-Lorraine, en priorité de la population d’Alsace-Lorraine ; – la protection de l’agriculture, de la viticulture, du commerce et de l’industrie en Alsace-Lorraine, tant dans les traités commerciaux qu’en face de la concurrence des départements de l’intérieur; – la réforme du régime des impôts conformément aux principes de la justice commutative ; – le développement de notre législation sociale, engourdie et retardée depuis des années par les efforts d’une assimilation à rebours ; – le rétablissement de l’ancienne législation communale en l’adaptant aux conditions politiques et économiques actuelles.
Nous sommes : – partisans enthousiastes de l’idée de paix et de collaboration internationale, – ennemis du chauvinisme, de l’impérialisme et du militarisme sous toutes leurs formes.
Etant le sol où deux grandes civilisations se trouvent en contact ininterrompu, notre pays doit avoir sa part à l’ oeuvre de civilisation commune de l’Europe occidentale et centrale. Sur le terrain de ces revendications nous voulons grouper tout le peuple alsacien-lorrain dans une ligue, le « Heimatbund » (Ligue des Alsaciens-Lorrains), qui sans respect humain ni faiblesse remplira son rôle de défense et de guide.
Nous ne formerons pas de parti nouveau, Nous ne serons qu’une organisation qui décidera les partis déjà existants à renoncer enfin à la politique d’atermoiement, de faiblesses et d’erreurs et à mener avec une énergie inlassable la lutte pour les droits et les revendications du peuple alsacien – lorrain. Vive l’Alsace-Lorraine, forte libre et saine ! « (suivent les signatures)
(p.28) Cet appel, dans une édition spéciale de la « Zukunft », était suivi d’un article paraphé par le rédacteur en chef de ce journal, M. Paul Schall, dont nous citerons seulement quelques phrases pour en indiquer le ton général : » A partir de ce moment, le peuple alsacien-lorrain prend lui-même son sort en mains. Nous ne voulons et nous n’avons pas besoin d’être des valets, nous sommes nés pour être des maitres et maitres en notre propre pays. Pour notre propre honte, et aussi à titre d’avertissement pour les générations futures nous devons reconnaitre que certains de nos propres compatriotes ont traitreusement prêté la main aux calomnies et menaces dirigées contre les précurseurs du mouvement autonomiste. Nous les connaissons et garderons bonne mémoire de leurs noms…”
Les signataires du manifeste furent frappés de sévères sanctions, ce qui provoqua un plus grand mécontentement.Les journaux de tendances autonomistes, Die Wahrheit (La Vérité), Die Zukunft (L’Avenir) et Die Volksstimme (La Voix du Peuple) furent interdits le 17 novembre 1927, en application d’un paragraphe de la loi du 12 juillet 1925 interdisant sur le territoire les journaux paraissant en langue étrangère. Naturellement cette mesure ne visait pas la feuille communiste qui paraissait en langue allemande à Metz. Une autre grande imprudence fut commise par le gouvernement le 1 er mai 1928, date à laquelle commença le procès dit des « autonomistes » à Colmar. Le procureur général Fachot dans son réquisitoire a souligné que le Jury pouvait accorder aux inculpés le bénéfice des circonstances atténuantes : il voulait absolument obtenir une condamnation de principe. Les vedettes du procès, le Dr. Ricklin et Rossé, furent condamnés à 1 an de prison le 24 mai. Mais la veille, 29 avril, ces 2 inculpés avaient été élus députés d’Altkirch et de Colmar. Pendant tout le procès on ne parla pas de complot, on put constater que l’autonomisme n’avait pas un caractère séparatiste, mais présentait des revendications régionalistes.(p.29) Ce jugement a provoqué un redoublement de malaise : les condamnés furent amnistiés le 17 juillet.
Janvier – Février 1929 A la suite de plusieurs interpellations des députés et afin de calmer les esprits dans la population, Poincaré, dans un grand discours les 29 et 3 1 janvier devant l’ Assemblée Nationale, parla de ce que la France avait fait et dépensé pour les provinces recouvrées : entre autres, l’échange d’argent aux Alsaciens-Lorrains avait coûté à la France 2 123 334 834 francs de cette époque. Le mark détenu par les Alsaciens-Lorrains avait été converti au cours de 1,25 frs, bien que le mark ne fût plus coté qu’à 0,80 frs ;cet argent, au lieu d’être converti de suite, resta dans les caves de la Caisse des Dépôts jusqu’à l’ effondrement du mark! Mais Poincaré a oublié de dire que « l’Alsace-Lorraine n’était pas revenue à la France les mains vides ». Concernant le bilinguisme dans les 3 départements le président du Conseil a dit textuellement : »Ce bilinguisme des 2 provinces, et surtout de l’Alsace, est, je le répète, une tradition plusieurs fois séculaire. Et chaque fois que des efforts trop marqués ont été faits pour expulser une langue au profit de l’autre, l’Alsace et la Lorraine – je tiens à ce que la Chambre s’en rende bien compte – ont réagi en sens contraire. » Après le procès de Colmar, la poussée autonomiste commença à diminuer ; l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler provoquait incertitude, crainte, peur et elle détournait l’ attention de la population des problèmes étroitement régionaux.
1933 – 1939 Adolf Hitler, chef du parti national-socialiste de l’Allemagne nommé par le maréchal von Hindenburg ( 1847-1934) chancelier du Reich le 30. 1 . 1933, réarma avec une sorte de frénésie, introduisit, le 13.3. 1935 lc service militaire obligatoire et viola le 7 3. 1936 les clauses militaires du traité de Versailles ( 1 9 18) , en occupant la Rhénanie et la Sarre.
(p.32) 1er septembre 1939
Evacuation des localités situées sur la ligne Maginot et au-delà. Alors commencèrent pour de nombreux Mosellans des épreuves et des tribulations qui devaient durer jusqu’à la libération de la France. C’est ainsi que sur un total de 700 000 Mosellans, 302 700 ressortissants des arrondissements de Sarreguemines, Forbach, Boulay et Thionville, soit la population de 300 villages sur 765, durent quitter maisons, terres, bétail, biens, n’emportant souvent que 30 kg de bagages. Ils furent dirigés par les départements de l’Aube et de la Haute-Marne vers les lointains départements d’accueil de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Haute-Vienne, de la Charente et de la Dordogne (Hiegel p.9). L’évacuation effectuée dans des conditions hâtives et désordonnées a en partie ruiné la population évacuée sans que l’Etat ait pu prendre des mesures de préservations souhaitables pour sauver au moins une partie de ces biens. Le cheptel a été en majeure partie récupéré par la troupe qui se réserva un certain nombre de bêtes pour l’amélioration de son ordinaire. Nous empruntons ici au livre de Roger Bruge « Faites sauter la ligne Maginot » – Fayard 1973 – ces témoignages qui en disent long sur l’improvisation et le désordre qui présidèrent à l’évacuation. Témoignage du capitaine Renauld du secteur de Thionville : « L’évacuation fut une véritable débandade dans la plupart des communes, surtout sur la rive droite de la Moselle, face à l’Allemagne. On ne vit sur le terrain aucun sous-préfet ni des maires capables de commander. Le colonel Perrey, commandant les avancées, dut intervenir dans certains cas de carence caractérisée : il menaça de les faire fusiller et les remplaça comme responsables de l’évacuation par des gens moins affolés. Les troupes des avancées durent récupérer les troupeaux et assurer la traite des vaches. » (p. 50). Témoignage d’un chef porion de Petite-Rosselle : « Sur le pas des portes des centaines de chiens et de chats attendaient leurs maîtres et l’heure de leur pâtée quotidienne. La rue de la gare était encombrée de remorques, de valises éventrées, de bicyclettes et de voitures d’enfants abandonnées.
(p.33) Sur les trottoirs il y avait des vêtements, du linge de maison, des paquets, tout ce que les malheureux n’avaient pu emporter dans les trains. » (p.51).
La population de Gros-Réderching arriva le soir du 1er septembre à Lorentzen ; le maire chercha vainement des chambres, des granges pour abriter les vieillards et les enfants. Les évacués durent se coucher dans un pré « au milieu du bétail affolé qui meuglera toute la nuit. » A Destry, le sergent Gérardin du 1 1169 régiment d’infanterie de forteresse fut réveillé en pleine nuit par des appels : « C’était des évacués des villages des frontières, des femmes cherchaient un abri pour leurs enfants. » Aidez-nous, suppliaient-elles en pleurant, nous ne sommes plus que des Zigeuner » (des nomades, des romanichels). La compagnie fut alertée et mes camarades cédèrent leur lit de paille ou de regain aux réfugiés. Le cuistot ralluma la roulante pour préparer du café chaud et, vers 2 heures du matin, je sortis sur la route pour appeler en priorité les mères de famille. Des centaines de personnes étaient couchées au milieu de leurs bagages, dans les fossés et sous les arbres. Les responsables de la Défense passive étaient débordés et le service médical inexistant. On demandait un médecin pour assister des femmes qui allaient accoucher à la gare de Brulange mais personne ne répondait. Je n’avais jamais vu pareille détresse, » (Bruge p. 54).
Les 3800 habitants de Sarralbe du sous-secteur du 51e régiment de mitrailleurs de l’infanterie coloniale de la ligne Maginot devaient prendre à leur première destination à Nouvel-Avricourt des trains pour Angoulême. Les malades furent transportés en autocar à Nouvel-Avricourt. » Après quatre jours d’attente sur les quais et sur la place de la gare, les réfugiés de Sarralbe prendront place le 5 septembre, sous une pluie battante, à bord de 2 trains, quelques voitures de troisième classe ont été insérées ( 1). Ils abandonnent une (1) 11 faut sans doute entendre ici que les convois étaient surtout composés de wagons de marchandises.
(p.34) partie de leurs bagages à Nouvel-Avricourt car, une fois de plus, on a mesuré la place et le convoi est surpeuplé. Après 2 jours et 2 nuits de voyage, les 2 trains s’arrêtent à Angoulême ou personne n’est au courant de leur arrivée. » (Bruge p. 56).
Il faut aussi parler des pillages. On trouve, sous la plume du préfet de la Moselle, M. Bourrat, le témoignage que voici : »Des pillages ont eu lieu. Certaines unités ont pensé que, les villages libérés de leurs habitants, les biens mobiliers étaient leur propriété. Des officiers, hélas, ont donné un triste exemple et j’ai dû, sous peine de publicité, interdire l’expédition des colis. » (p. 57).
De son côté, le maire de Sarreguemines, M. Nicklaus, qui revint deux fois à Sarreguemines après l’évacuation, écrivit : » Dans beaucoup de quartiers, les soldats ont pénétré dans les habitations et les magasins et y ont enlevé tout ce qui leur parut utile. Je tiens à souligner qu’en fouillant les maisons on a défoncé les portes et on a flanqué tout pêlemêle en salissant les appartements (..,), les garages et les boutiques ont été saccagés systématiquement. L’outillage spécial, les petites machines et même des autos démontées furent enlevés. J’ai surpris, les 28 et 29 septembre, des pionniers qui ont vidé à Sarreguemines le garage Fath, en quelques jours. » (Bruge p. 57).
Pour le choix des départements de refuge donnons deux extraits du livre de Jean Vidalenc, l’exode de mai-juin 1943, p. 43/44 . »Il y aurait beaucoup à dire sur le choix même des départements de refuge : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle sont riches et propres, ceux du Périgord sont pauvres, dépourvus d’installations d’hygiène. Les habitations sont en Alsace bien closes et confortables, primitives en Périgord. Les Alsaciens sont religieux, les Périgourdins désertent leurs (p.35) églises et les laissent tomber en ruines. Le patois périgourdin n’est pas plus intelligible pour les Alsaciens parlant le français – et ceux qui ne le parlent pas le comprennent que le patois alsacien aux Périgourdins. » « Tous les villages poitevins sont longs et répandus dans la campagne. Les Lorrains qui ne peuvent supporter d’ être séparés les uns des autres préfèrent s’entasser dans des locaux inhabitables plutôt que de se répandre dans des fermes situées de 5 à 6 km du centre du village. Les maisons poitevines sont dans l’ensemble très pauvres. Les parquets n’existent pas, les sols sont carrelés ou même en terre battue. Ni water-closets, ni égouts, ni chauffage autre que les cheminées. »
Cependant, malgré les déceptions des premiers temps dues aux circonstances exceptionnelles, les réfugiés organisèrent peu à peu leur vie. Des liens d’amitié se sont noués entre les réfugiés et la population des régions d’accueil ; des mariages ont eu lieu ;un certain nombre de réfugiés s’y sont définitivement fixés et après la guerre, nombreuses sont les cités évacuées qui ont invité les communes d’ accueil à leur rendre visite et vice versa.
3 Septembre 1939 La France garante de l’intégrité de la Pologne, déclara la guerre à l’Allemagne. M. Camille Chautemps, vice-président du Conseil, chargé des Affaires d’Alsace-Lorraine, dans une allocution transmise par TSF le dimanche soir, s’adressa en termes émouvants aux « Chers compatriotes et amis » évacués des 3 départements de I’Est ; en voici la péroraison : « Je vous fais la promesse que sur vos foyers notre armée militaire veillera avec une attention et une fermeté de tous les instants et s’il est arrivé que parfois certains dommages difficiles à éviter dans les premières heures ont été causés
(p.50) Août 1940 Après la « conquête » du Reichsland il s’agissait de créer le « fait accompli » en Moselle comme en Alsace, c’est-à-dire les germaniser. A peine nommé Gauleiter, Burckel reçut les ordres du Führer.
Reichsleiter Martin Bormann – Berlin W. le 6.8. 1940 Wilhelmstrasse 54 Bo-An
Très secret .Monsieur le Gauleiter et Reichsstatthalter Josef Burckel – Neustadt an der Weinstrasse Gauleitung der NSDAP
Pour votre propre gouverne je vous communique ce qui suit : « Le Führer s’est entretenu, ce soir de nouveau, en comité restreint – le représentant (Stellvertreter) du Führer était également présent – de la situation en Alsace et en Lorraine.Le Fuhrer demande avec insistance qu’on réinculque sans cesse (immer wieder) à tous les Allemands, mais surtout aux représentants de la Wehrmacht et aux membres du Parti l’idée que toute relation sociale avec la soi-disant « haute volée » (en français dans le texte) en Alsace et en Lorraine serait aussi impossible que, par exemple, les relations mondaines avec les Polonais dans les territoires de l’Est nouvellement conquis. Il n’y aura jamais d’excuse pour des relations avec cette « haute volée » étrangère à notre peuple (Volksfremd).
Il est regrettable qu’il n’en ait pas été ainsi entre 1870 et 1 9 18. Les représentants de la « haute volée » alsacienne-lorraine auraient même été invités par le Reichsstatthalter allemand et y auraient pu s’entretenir sans gêne en français. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Expulsez sans hésiter! Quiconque serait de sentiments français ou ne ferait que grogner (meckern) contre l’occupation allemande ou contre les (p.51) mesures prises par le Reich, devrait être immédiatement embarqué sur des camions et expédié en France au-delà de notre frontière de l’Ouest. Selon le Fuhrer, dans sa déclaration aux Gauleiter, dans les trois mois il ne devra plus subsister, ni en Alsace ni en Lorraine un monument français quelconque, ni une affiche française, ni une inscription française ou des choses semblables. Bien entendu des noms tels que « Kaiser-Wilhelm-Strasse » ne doivent plus être renouvelés. La poste allemande ne devra, par ailleurs, connaître que des noms allemands. Le courrier qui porterait des indications de localités en français, même s’il émane d’Alsaciens ou de Lorrains, devra absolument être retourné à l’expéditeur avec la mention « inconnu ». Les uniformes français – même ceux des pompiers – seront à remplacer au plus tôt par des uniformes allemands.
Voici le texte « français » de la proclamation de Burckel aux Lorrains, affichée en deux langues. Essayons de comprendre ! « Lorrains, vous connaissez tous la tâche que le Führer m’a confiée. Cette province-ci doit être allemande à tout jamais, C’est pourquoi j’ai fait savoir dans mon discours à Metz qu’on ne peut absolument pas renoncer à un rapatriement de la zone linguistique (sic), car dans la zone en question il y a un certain nombre de lieux dont les habitants ont été, au cours des temps, complètement francisés. Il s’agit avant tout de la population paysanne qui habite cette région. Or, d’une part il n’est possible de pacifier immédiatement la frontière qu’ au moyen d’un rapatriement, et d’ autre part, il ne pourrait y avoir qu’un rapatriement dans l’Est du Reich (sic) parce que là-bas nous avons de l’espace nécessaire. C’est pourquoi j’ai fait demander à la population si elle désire un rapatriement en France ou bien un rapatriement dans le Warthegau à l’Est du Reich.
(p.54) 21 Septembre 1940 Burckel, « l’homme que la confiance du Führer avait appelé à être le chef des Lorrains allemands et à reconstruire une Lorraine allemande » fut reçu officiellement le 2 1 septembre à 15 h 45 à la Porte des Allemands à Metz. Le Stadtkommissar Imbt déclara au sujet des travaux déjà exécutés : « De mauvais monuments ont été enlevés ou transformés, le beau marché couvert a été délivré des étalages disgracieux dans la cour et nettoyé de toute saleté à l’intérieur…, à la synagogue, toute trace de l’ancienne activité juive est effacée et le bâtiment est en transformation… l’écrasante majorité de la population manifeste le plus grand intérêt et beaucoup de compréhension pour ces travaux ; ce qui prouve que la plus grande partie de Metz juge sainement et agit honnêtement (anständig) ».,.Puis le Gauleiter gagna l’Hôtel de Ville (Deutsche Front du 22.9. 1940).
Septembre 1940 Dès le mois de septembre Burckel pouvait faire, dans un rapport à Hitler, état de la disparition de toutes les inscriptions françaises, de tous les noms français de localités et de rues, ainsi que des monuments français, Donc en moins de 3 mois, on avait fait déboulonner à Metz les monuments de La Fayette, de Mangin, de Déroulède, de St. Louis, d’Albert 1 er et du Poilu. Les statues de Ney et de Fabert, monuments historiques et artistiques, furent reléguées dans le jardin des Pères Franciscains ; elles y attendirent la défaite des Allemands pour reprendre leur place. La statue du Kaiser Guillaume II, le fameux prophète Daniel du portail de la Cathédrale, fut débarrassée de ses moustaches sur ordre du Stadtkommissar Richard lmbt. Sur les monuments aux morts de la guerre de 1914/18, élevés dans toutes les communes lorraines, la mention « Mort pour la France » fut remplacée par « Tombé pour l’Allemagne,,
(p.55) Octobre 1940
Tout habitant de la Lorraine annexée dut appartenir à une organisation du Parti, sous peine des pires ennuis ; nul ne pouvait être fonctionnaire, employé, chef d’industrie ou dirigeant d’ un établissement s’il n’ était membre d’une formation. Donnons à titre d’information la liste des plus importantes de ces formations : N S D A P (National Sozialistische Deutsche Arbeitspartei), parti ouvrier allemand. D A F (Deutsche Arbeits-Front), front allemand du travail. N S V (National Sozialistische V olkswohlfahrt), fondé en 1933, ligue nationale socialiste de prévoyance sociale. W H W (Winterhilfswerk), secours national d’hiver. K D F (Kraft durch Freude), la « force par la joie » qui organisait les excursions, les vacances, le théâtre populaire. H J (Hitler Jugend), Jeunesse hitlérienne qui datait de 1926. B D M (Bund deutscher Madchen), association des jeunes filles allemandes. S S (Schutzstaffeln), sections de protection qui remontait à mars 1923. S D (Sicherheitsdienst), service de sûreté. Gestapo (Geheime Staatspolizei), police secrète d’Etat. S A (Sturmabteilungen), sections d’assaut, fondées le 3.8. 1 92 1 . N S K K (National Sozialistisches Kraftwagenkorps), corps motorisé, qui remontait à 1934. N S F (Deutsches Frauenwerk), oeuvre des femmes allemandes. N S F K (Fliegerkorps), corps d’aviation, qui datait de 1937.
Enumérons pour terminer les autres organisations de caractère professionnel : N S Ärztebund (association des médecins) Bund deutscher Technik (association des techniciens allemands). Reichsbund der deutschen Beamten (association des fonctionnaires du Reich). N S Lehrerbund (association du corps enseignant).
(p.56) N S D Dozentenbund (association des professeurs de Faculté). N S R B Rechtswahrerbund (association des juristes), union des victimes de guerre. N S K O V (Kdegsopferversorgung).
Toutes ces organisations du parti national-socialiste prirent pied en Lorraine en 1940. Personne ne pouvait échapper à ces mailles de filet du contrôle du parti. Burckel créa à Metz le « Lothringisches Institut für Landes- und Volkskunde » . Son rôle était d’ordre purement politique, ce qui ressort d’un article, paru sous la plume de Stemmermann dans les trois W estmarkische Abhandlungen zur Landes- und Volksforschung, tome lV, p. 120-125 ; »Die politischen Aufgaben der V orgeschichtsforschung in Lothringen » . Précisons que pendant l’annexion aucun Lorrain, sauf un Français de l’intérieur, resté au pays, n’a consenti à prêter son concours aux travaux de ces deux organisations.”
30 Octobre 1940 Burckel proclama officiellement à Sarrebruck l’annexion de la Lorraine (mosellane) au Reich. La Lorraine, la Sarre et le Palatinat formeront dorénavant le Gau « Westmark » (Marche occidentale) avec Sarrebruck pour capitale. L’administration allemande remplaça l’administration française. Chaque Lorrain sous peine d’expulsion et de confiscation de ses biens devait être membre de la D V G (Deutsche Volksgemeinschaft = communauté du peuple allemand). L’occupation essentielle des Reichsdeutschen (Allemands de souche immigrés) fut de nazifier et de surveillr les Lorrains. 7 à 1 0 maisons formèrent un bloc dirigé par un Blockleiter, qui dut connaître toutes les personnes de son « Block » ; tous les Blockleiter d’un
* Voici les traductions respectives des trois références citées dans ce paragraphe : – Institut de recherch pour la connaissance du pays et des gens – Dissertation sur la re herche pour la connaissance du pays et des gens dans les Marches occidentales – Tâches politiques de la science de la préhistoire en Lorraine.
(p.57) quartier se trouvèrent sous l’autorité d’un Zellenleiter et plusieurs Zellenleiter dépendirent d’un Ortsgruppenleiter. Le devoir de tous les Lorrains était de ne pas refuser leur concours aux Allemands dans l’intérêt même de leur pays. Ceux d’entre eux qui furent contraints d’accepter les fonctions officielles, les remplirent le plus souvent au mieux des intérêts de leurs compatriotes, Que serait-il arrivé à la population lorraine si tous les emplois avaient été occupés par des nazis authentiques ? Toutes sortes de mesures furent introduites immédiatement. Les vocables français durent être éliminés (noms des communes, poteaux indicateurs, rues, etc.) ; l’allemand devint la langue officielle : tous les jeunes gens au-dessous de 2 1 ans durent apprendre le « Hochdeutsch » , il était défendu de parler français ;des membres de la jeunesse hitlérienne exigeaient la livraison des drapeaux et des livres français pour les brûler sur une place publique ; le port du béret « coiffure éminemment française » (bien qu’ on ait pu en acheter à Munich) fut défendu ; les prénoms français ne furent plus tolérés ; on dut les germaniser. Les synagogues furent brûlées et on ne- toléra la présence d’aucun juif.
Novembre 1940 Au début de l’annexion, des Israélites restés sur place avaient été expulsés de la Moselle et leurs biens confisqués. Mais dès le 16 août commencèrent les expulsions massives en Lorraine. * Des policiers se rendirent dans chaque localité en autobus conduits par des hommes en uniforme. Cette opération policière avait été précédée ou accompagnée de la remise d’un imprimé préalablement rempli, dont voici la traduction littérale :
* La Moselle francophone fut pratiquement vidée de sa population autochtone à cette époque et remplacée par des « Siedler » (colons allemands). Jugés indésirables en Lorraine non-annexée (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges), dont les Allemands avaient fait une zone d’occupation spéciale, probablement en vue d’une annexion future, les Mosellans expulsés furent dirigés vers la zone dite « libre ». En gare de Nancy des mesures furent prises pour empêcher tout contact avec la population-soeur. Notons que, bizarrement, les populations francophones d’Alsace (régions Schirmeck Saales – Ste-Marie, etc.) ne furent pas expulsées. P.M.
(p.58) « Notification Le Commandant de la Police de Sûreté de S.D. en Lorraine et en Sarre-Palatinat. N° Le (nom, prénoms, profession). . . . . . . né le . . . . . . . . . . . . domicilié à . . . . . . . . . ,. . . est informé que lui et son épouse . … . née le …. à . … , . … ., ainsi que ses enfants (noms) . . . . . . . . pour des mesures de sûreté sont transportés de la Lorraine en France non-occupée.
Avec l’imprimé fut remis la copie du Merkblatt II c’est-à-dire l’ aide-mémoire n° 2, aux évacués dans l’instant même de leur départ. Il contenait la liste des objets qu’ils devaient obligatoirement emporter, pouvaient emporter, et ne devaient pas emporter.
1° Sont à emporter obligatoirement : a) de la nourriture pour quatre jours ; b) cuillers, fourchettes, couteaux, verres ou gobelets ; c) couverture (pas de literie) ; d) un habit complet ; e) une somme d’argent français représentant au plus 250 marks (soit 5.000 francs) par personne adulte, et 125 marks (soit 2.500 francs) par enfant ;0 du savon, un essuie-mains et autres objets pour soins corporels ;g) les papiers personnels.
2° – Peuvent être emportés : a) une valise pour emporter les objets ; b) du linge pour se changer ; c) une deuxième paire de chaussures ; d) une deuxième couverture ; e) une montre en or ou une montre en argent, bagues en or et en argent, à la condition d’avoir été portés quotidiennement.
(p.59) 3° – Ne peuvent être emportés : a) des objets d’art dont le volume et le poids dépassent la charge d’un homme ; b) valeurs mobilières, devises, livrets de caisse d’épargne, couverts en argent, argenterie (assiettes, gobelets, etc.) ; c) meubles et lits ; d) voitures automobiles, bicyclettes ou motocyclettes ; e) inventaire vivant ; f) les espèces au-delà des sommes autorisées ci-haut. « Le poids et le volume des objets emportés ne doit pas dépasser la charge d’une personne. » (Noguères p. 196).
Du 12 au 22 novembre 1940 , 66 trains passèrent en gare de Lyon-Brotteaux, transportant 57 655 habitants de la Moselle, alors que 13 000 avaient déjà été refoulés en France non-occupée.(Alsace-Lorraine, terres françaises, p. 9 , éd. Témoignage chrétien, octobre-décembre 1943).
En violation des conditions d’armistice, 250 000 Mosellans groupés dans 225 villages furent expulsés du 12 au 22 novembre 1940 et au début de 1941 parlant en grande partie le français et possédant des terres à coloniser. (7000 chefs d’exploitation agricoles possédant 25 000 dhevaux, 40 000 bêtes à cornes, 20 000 bovins). Ils n’emportaient que 2 000 francs ct 50 kg de bagages et ils échouèrent lamentablement dans le centre et dans le midi de la Francc, sans secours suffisant, 11 faut avoir assisté à ces drames d’expulsions pour en mesurer l’horreur : des vieillards placés sur des civières, des malades arrachés de lcur Bt, des prêtres arrêtés pendant la céIébration de la messe, des femmes sur le point d’être mères, des enfants en bas âge, tous ces Lorrains qui lmbitaient la Moselle depuis des siècles et dont beaucoup avaient même servi dans l’armée allemandc de 1914 à 1918, étaient brutalement enlevés à leur foyer, perdant leurs biens, leur fortune, privés de leurs souvenirs de famille et du droit de vivre et de mourir à l’ombre du clocher natal. (H. Hiegel, p. 11).
Décembre 1940 Les habitants de 18 communes du canton de Bitche (Hanviller, Haspelschiedt, Liederschiedt, Roppeviller, Schorbach) et du canton de Volmunster (Bousseviller, Breidenbach, Epping, Hottviller, Lengelsheim, Loutzviller, Nousseviller, Ormersviller , Rolbing, Schweyen, Volmunster, Eschviller, W eiskirch, Waldhouse, Walschbronn), déjà évacués en 1939, durent de nouveau quitter leur village ; toute la région de Bitche-Volmunster était destinée (p.60) à être transformée en champ de manoeuvre… Les villages servaient de cibles à l’artillerie en position, soit à Bitche, soit à Ludwigswinkel.
25 Avril 1941 Burckel introduisit en Moselle le Service du Travail obligatoire (R A D = Reichsarbeitsdienst). Après une visite médicale, tous les jeunes gens âgés de 18 ans durent accomplir leur « Arbeitsdienst » (un an) au service du Reich. Le service militaire fut introduit quelq ues mois plus tard en août 1942. Burckel violait ainsi les § 44 et 45 de la convention de la Haye du 9 juillet 1899 que l’Allemagne avait librement reconnue par sa signature : « Il est interdit de forcer la population de territoires occupés à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays et il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie, » *
2Mai 1941 Le texte ci-dessous a été adressé aux gendarmes de l’arrondissement de Sarreguemines concernant l’incorporation de force dans des formations SS. Capitaine de Gendarmerie SARREBOURG / Lorraine Journal n° 831 Sarrebourg, le 2 Mai 1941 TRES CONFIDENTIEL Aux Gendarmeries de l’Arrondissement de Sarreguemines.
Les gendarmes devront se saisir nommément de tous les jeunes lorrains des années 19 14- 1925 pour vérification
* En fait, les Allemands ne pouvaient guère considérer les territoires en question comme « occupés » Selon eux, ils faisaient partie de l’Allemagne par droit d’évidence naturelle. D~ns l’absolu, et malgré la sûreté de sa cause, la France peut aussi encourir devant l’histoire, par exemple le reproche de n’avoir pas organisé le plébiscite promis en Alsace-Lorraine après l’armistice de 1918, Pour les Français, c’était aussi une question d’évidence naturelle. P.M.
(p.61) d’identité sur le fichier de déclaration de résidence auprès de l’office des déclarations de logement. Cette action s’effectuera camouflée à l’intérieur des associations de jeunesse hitlérienne. Aussitôt que ces hommes seront connus nommément une copie de ce fichier sera remise au responsable local de la H.J. (Jeunesse hitlérienne) avec prière d’inviter ces hommes à une réunion en un lieu bien déterminé non connu de tout le monde. A cette réunion sera présent le gendarme responsable sans que ces gens toutefois le remarquent, et qui devra constater lequel de ces hommes serait apte à servir dans les sections de combat SS. Ces hommes aptes me seront présentés sur une liste pour le 17 mai 1941 conformément au modèle ci-après:
N° Nom et prénoms domicile, rue né le Cette mission est très confidentielle. Les jeunes gens nés avant 1925 seront incorporés dans la jeunesse hitlérienne. Conformément aux ordres donnés je dois attirer vo tre attention sur le fait que seulement des hommes physiquement aptes devraient être pressentis au service dans les sections de combat SS. Les qualités corporelles et culturelles exigées de chaque individu sont mentionnées dans le cahier .service d’information politique, groupe B, suite 5 du 20 avril 1941 . Une présentation d’origine aryenne, le consentement du tuteur légal et le certificat de conduite ne sont pas à fournir. Tout ceci incombe à l’office complémentaire de la section de combat SS. Chez nous ce qui compte est évidemment l’aptitude corporelle. signature illisible.
Ce texte explique 1R présence dans la division « Das Reich » de nombreux Alsaciens ; et il explique aussi la réaction ultérieure des parlementaires alsaciens lors de la discussion de la loi sur la responsabilité collective.
27 mai 1941 Le 27 mai, Pierre Laval accorda au représentant de l’ agence américaine « United Press » cette interview qui fut lue au déjeuner (p.62) donné en l’honneur du jubilé journalistique de Jean Luchaire : « Je sais, hélas, que l’Alsace et la Lorraine constituent l’enjeu traditionnel de nos batailles avec l’Allemagne, et je crains que nous n’ayons une fois de plus à subir la loi de l’histoire, Ces provinces sont comme des enfants mineurs issus d’un mariage désuni, vivant, tantôt avec le père tantôt avec la mère qui les revendiquent toujours l’un et l’autre par la violence. Ne pourrait-on pas considérer un jour que ces enfants sont devenus majeurs et qu’ils doivent être non une cause de discorde, mais au contraire de rapprochement entre la France et l’Allemagne ? C’est un problème délicat et grave qui ne pourra être posé et résolu que dans l’entente et dans l’amitié des 2 grands pays voisins. » (Bopp p. 36 1).
L’ensemble des théories nazies à base de racisme et de messianisme pangermanique remontent loin dans l’histoire de la pensée allemande. Elles faisaient du Führer, représentant du peuple élu, le pape d’une religion d’Etat qui n’enseignait pas précisément la charité chrétienne. Aussi la lutte contre la religion catholique prit-elle une allure sauvage en Moselle. On chassa des prêtres ; en septembre 1940 268 prêtres séculiers et 150 prêtres réguliers, et le 28 juillet 1941 , 104 prêtres furent expulsés en France dans des conditions lamentables. Les biens ecclésiastiques furent confisqués, la Gestapo fit à l’Evêché de Metz main basse sur les caisses des messes de fondation et des oeuvres diocésaines, saisit titres et argent liquide : 4 millions de francs. A Longeville-lès-St-Avold, les Pères Franciscains obtinrent l’autorisation de rester dans le couvent, à condition de purger dans les huit jours la propriété de toutes ses dettes. Grâce à la générosité (p63) des amis, elles furent payées immédiatement et, 8 jours plus tard, les religieux étaient expulsés ; le couvent confisqué fut mis à la disposition du Service du travail. Toutes les écoles dirigées par des religieux et religieuses furent fermées et confisquées. L’impôt cultuel fut introduit : le diocèse de Metz fut taxé de 4 millions de francs, sous prétexte que l’on continuait à servir aux prêtres leurs traitements ; mais c’est le Gouvernement de Vichy qui dut finalement payer ces traitements. Le 22 novembre, 1270 maisons de commerce étaient entre les mains des Allemands. L’avoir de 43 caisses d’ épargne de la Moselle d’un montant de 700 millions de francs fut transféré à 7 caisses d’épargne allemandes. (Hiegel p. 10). Toutes grandes usines furent prises en charge par des spécialistes allemands ; le retour des cadres de direction français ayant été interdit, seuls les ouvriers furent autorisés à reprendre le travail. Les usines et aciéries d’Hagondange (Thyssen), Hayange, Rosselange (groupe de Wendel) échurent aux Hermann Goering Werke, les hauts-fourneaux et aciéries de Thionville au Konzern Roechling, les aciéries de Rombas à la Friedrich Flick. (Le Journal de la France n° 117 p. 614). Le pillage des meubles en Moselle de langue française et dans les musées prit de telles proportions qu’en décembre 1940 Burckel menaça de la peine de mort les voleurs… En fait, tout était prétexte à vols, pillages, expulsions et déportations. (Hiegel p. 10). Dès 1942 les Allemands avaient pratiquement suspendu les déportations vers la France ; la perte de capital humain devenait trop considérable ; les expulsés furent envoyés en Silésie, dans le pays des Sudètes.
18 Avril 1942 Le BBC de Londres n’était pas tendre a l’égard du gouvernement de Vichy : »Le devoir de chaque Français, le devoir de chaque Française est de lutter activement par tous les moyens en son pouvoir (p64) à la fois contre l’ennemi lui-même et contre les gens de Vichy qui sont les complices de l’ennemi. A ces gens-là, comme à l’ennemi, les Français ne doivent rien, excepté de les chasser et, en attendant, de saboter leurs ordres et de haïr leurs figures. La Libération nationale ne peut être séparée de l’insurrection nationale. » (A. Brissaud, Hist. H.S. n° 29 p. 61).
19 Août 1942 Introduction du service militaire en Moselle. Le 15.3.1941, le Gauleiter fit paraitre dans la presse : « L’introduction du service militaire allemand en Moselle ne sera pas envisagée avant la signature d’un traité de paix avec la France. » Quelques mois plus tard, il introduisit le service militaire.30 000 jeunes Lorrains furent incorporés de force dans la Wehrmacht. Jusqu’au 1 1 . 1 1 . 1942, 12 000 Alsaciens-Lorrains s’étaient soustraits au service du Travail et à la Wehrmacht. Des sanctions très graves furent prises contre les réfractaires et leurs familles. Dans différents camps et prisons (Grand et Petit Séminaire de Metz et de Montigny-lès-Metz, Queuleu, Woippy, La Brême d’Or près de Forbach, Natzweiler, Schirmeck~ Struthof, Dachau, etc.) furent internés 20 000 Lorrains. Rien qu’à Dachau furent emprisonnés 900 Mosellans, 250 y sont morts, dont 14 de Sarreguemines. (Hiegel p. 1 2).
31 Août 1942 . Bien que le ministre de l’Intérieur allemand adressât à tous les services au début de 1942 une note affirmant que les Alsaciens-Lorrains étaient encore « formalrechtlich » (en droit strict) de nationalité française, toutes les mesures officielles démentirent formellement cette note. Dans une déclaration du 3 1 .8. 1942, parue dans la Saarbrücker Zeitung, le Gauleiter Burckel, de Metz affirme : Je déclare ce qui suit :
(p.65) » Au nom du Reich, et avec effet immédiat, la nationalité allemande est accordée d’office aux Lorrains de communauté (linguistique) allemande qui sont à 98 010 de souche allemande. En conséquence, à partir de ce moment, ils sont devenus citoyens du Grand Reich allemand, il n’y a plus de place pour l’option en faveur de l’une ou de l’autre nationalité. J’annule ainsi les ordonnances antérieures relatives à cette faculté. La concession de la nationalité allemande n’entraîne cependant pas automatiquement le droit de rester en Lorraine à titre définitif Cette question est en relation avec la sécurité du peuple aux frontières de l’Ouest ; le droit des peuples à une paix définitive doit avoir le pas sur les prétentions à des avantages particuliers. Seuls les citoyens allemands qui n’ont laissé subsister aucun doute sur leur attachement indéfectible à l’Allemagne auront le droit d’établissement définitif en Lorraine. » (Alsace et Lorraine p. 16).
Fin août – début septembre 1942 Dans un discours à Metz, Burckel dit : »que ceux qui ne se sentent pas allemands peuvent se faire inscrire avant le 5 septembre pour la France. » L’affluence inattendue était telle qu’on employa menaces et déportation pour « réduire cette minorité insignifiante. » Beaucoup de Lorrains retirèrent leur signature.
4 Septembre 1942 Quelques jours plus tard, le 4 septembre 1942, les représentants des populations alsaciennes et lorraines, réunis à Vichy, demandèrent au gouvernement la publication de la protestation du 3 septembre 1940 contre la violation des dispositions du traité de l’armistice. Après bien des hésitations et de nombreux remaniements on en vint, vers le 14 septembre, à la rédaction du texte définitif.
(p.66) Communiqué » A la suite des mesures prises dernièrement par les autorités allemandes locales, notamment l’incorporation d’Alsaciens et de Lorrains dans diverses formations et dans l’armée allemande, l’attribution de la nationalité allemande et les conditions de résidence en Alsace et en Lorraine, le gouvernement français, tenant compte des clauses de l’ armistice, a protesté auprès du gouvernement allemand contre ces décisions qui ont vivement ému la Nation et son Chef. »
Mais les Allemands s’opposèrent par l’intermédiaire de de Brinon, qui adressa un télégramme au président Laval, à la publication de ce texte. Ce silence imposé au gouvernement de Vichy par les Allemands fut rompu par le général de Gaulle à Londres. Voici le texte de l’émission « Les Français parlent aux Français » à la BBC : » Le Comité National Français vient de formuler la protestation suivante adressée à tous les Etats du monde, contre l imposition, par l’Allemagne, du service obligatoire aux Alsaciens-Lorrains : » Après avoir, en pleine guerre, proclamé l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine, chassé et dépouillé un grand nombre d’habitants, pris les mesures les plus rigoureuses de « germanisation », le Reich contraint maintenant les Alsaciens Lorrains, déclarés « Allemands » par lui, de servir dans l’armée allemande contre leurs propres compatriotes et contre les Alliés de la France. « Le Conseil National, défenseur de l’intégrité de l’unité nationale, gardien des principes du droit des gens, proteste à la face du monde civilisé contre les nouveaux attentats commis, au mépris des conventions internationales, contre la volonté des populations ardemment attachées à la France. »Il proclame le droit inviolable des Alsaciens-Lorrains de rester membres de la famille française. » (Noguères p. 2 15)
(p.67) Les paroles de Londres provoquèrent la réponse suivante de la radio de Vichy . »M. de Gaulle vient, récemment, de faire un communiqué au sujet des événements d’Alsace-Lorraine. »L’ex-général voudrait ainsi conserver l’illusion qu’il peut encore donner des leçons de patriotisme. »Il est étrange qu’un fuyard, résidant sur un sol étranger, ait cette audace. Nous n’avons jamais voulu engager de polémique avec la radio de la dissidence ; il s’agit aujourd’hui, seulement, de donner une leçon aux mauvais Français qui n’ont pas voulu partager, groupés autour du Maréchal, les malheurs de leur Patrie. »Le gouvernement, qui doit faire face à tant de difficultés qui assaillent la France, n’avait pas attendu M. de Gaulle pour protester contre des mesures prises par les autorités locales allemandes, en Alsace et en Lorraine. » (Noguères p. 215)
Septembre 1942 La colonisation de la Moselle fut entreprise par tous les moyens. On fit venir des anciens combattants et des blessés de guerre allemands, d’anciens membres des corps-francs, ainsi que leurs familles, leurs veuves et leurs enfants, d’anciens militants nazis de la première heure, et finalement des Allemands d’Alsace qui, pour avoir défendu l’idée allemande, avaient dû quitter le pays après la première guerre mondiale. (Der Völkische Beobachter du 12.9.1942). En ce mois de septembre 1942, 20 QIQ des colons allemands venus en Lorraine furent installés sur des terres de Lorrains expulsés.
Décembre 1942 – Janvier 1943 Les Russes écrasent devant Stalingrad la 6e armée allemande commandée par le Feldmarschal Paulus.
(p.68) 1943 Dès 1942 les bombardements aériens avaient commencé causant de grands ravages parmi la population civile et ses habitations. C’est ainsi que Sarreguemines subit, du 30.7. 1942 au 15.7, 1944 une dizaine d’attaques aériennes. Le 4 octobre 1943 plus de 200 bombes explosives et une centaine de bombes incendiaires furent lâchées sur l’agglomération. Résultat : 140 personnes tuées, plus de 300 blessés, 52 immeubles détruits, plus de 750 sans abri. En général, les grands centres industriels ont été épargnés par les bombardiers de part et d’autre. (N.B. Le nombre des Sarregueminois morts par faits de guerre, déportation et bombardements s’élève à 1000 environ).
En face de ces bombardements, les occupants nazis ne sont pas restés inactifs. Les mesures de représailles contre les familles des insoumis continuèrent : des familles entières furent arrachées à leur foyer, le plus souvent la nuit, conduites avec leurs maigres hardes aux gares les plus proches pour être expédiées en Silésie. Cette année 1943 fut marquée par d’importantes manifestations publiques de résistance (H. Hiegel p. 15), notamment le 25 juin à l’occasion de l’incorporation, à Sarreguemines, des jeunes gens appelés au service de la Wehrmacht après avoir servi sous le drapeau français. Il y eut des cris séditieux dans les rues, au milieu d’une foule en effervescence, et une bataille rangée à la caserne avec les Allemands. Finalement le transfert en camions à la gare se fit aux accents de la Marseillaise. Le 14 juillet, le drapeau français flotta sur le temple et sur le grand pont.
3 Juin 1944 Pour retrouver les réfractaires, la chasse à l’homme fut organisée de façon inopinée par la gendarmerie et les SS. Le 3 juin une compagnie de SS avait reçu l’ordre d’encercler le village de Longeville-lès-St-Avold pour y arrêter les réfractaires et les déserteurs de la Wehrmacht. Quelques maquisards furent saisis dans leurs cachettes et les introuvables simplement remplacés par un des leurs. Bilan de la journée : 1 1 0 arrestations, suivies de (p.69) déportation, dont un grand nombre ne revinrent plus et 7 exécutions sommaires. Une battue analogue se produisit à Vittersbourg où, dans la forêt de Muhlwald, le jeune Eugène Blanchard a été tué par une balle le 22 septembre 1944.
6 Juin 1944 L’attaque des Anglais et des Américains contre la forteresse européenne, le fameux Atlantik-W all, fut déclenchée sur la CÔte normande.
10 Juin 1944 Oradour-sur-Glane. Parmi les 700 à 800 victimes sauvagement et froidement massacrées par les Allemands à Oradour étaient 44 expulsés lorrains de Charly-sur-Montois près de Metz. Le petit Lorrain Roger Godfrin,, agé de 7 ans, est le seul écolier qui échappa à cette tuerie, une des plus abominables et odieuses de la guerre. Les auteurs de ce crime étaient les hommes de la 3e compagnie du 1 er bataillon du régiment « Der Führer », commandé par le SS Obersturmbannführer Stadler, Le 1 er bataillon avait pour chef le Sturmbannführer Dickmann. C’est lui qui désigna la 3e compagnie commandée par le Hauptsturmführer Kahn (blessé en Normandie). Dickmann (tué en Normandie) prit personnellement le commandement de l’opération. Le régiment « Der Führer » appartenant à la 2e Division blindée SS dépendait du commandement du général Heinz Lammerding. Le soir du 9 juin, le général commandant la Division Lammerding avait reçu l’ordre de rejoindre d’urgence la Normandie « pour rejeter Anglais et Américains à la mer ». Cette division s’illustra sur son ‘passage par des atrocités qui ne pourront jamais être oubliées. “Pendant 26 ans, l’extradition, le jugement et le châtiment de Lammerding ont été réclamés sans relâche. 11 est mort en paisible retraité, le 1 3 janvier 1971, à l’hôpital de Bad-Tolz, en Bavière, où il avait été admis quelques jours plus tôt pour un cancer des bronches. Il avait 64 ans. »
(p.70) * On sait que la présence d’incorporés alsaciens dans le détachement qui anéantit Oradour a dramatiquement gêné la marche de la justice dans les débats dont cette affreuse affaire fit l’objet depuis (manifestations en Alsace) P.M.
« Il n’existe pas d’explications valables du massacre d’Oradour. Ce village fut choisi pour »faire un exemple » précisément parce qu’il n’y existait aucun groupe de résistance et que par conséquent, il n’y aurait pas d’accrochage qui risquât de faire perdre du temps. » (Le Journal de la France n° 161 p. 1832).
28 Juillet 1944 Enlèvement des cloches dans les églises.
15 Août 1944 L’armée française débarque à Toulon. L’armée de Normandie, venant de Paris, et l’armée française commandée par le général de Lattre de Tassigny (1889- 1952), venant du sud, font leur jonction à Champigny. Les premières lignes des Allemands repliés du sud de la France commençaient à la frontière suisse à l’est de Montbéliard et formaient un grand arc, dont le centre de résistance était Belfort. Il s’incurvait vers le nord en passant à travers les contreforts sud-ouest des Vosges et les vastes forêts de montagne entre la Mortagne et la Moselle pour aboutir en Lorraine. La 1 ère armée française stationnait devant la trouée de Belfort et les Vosges méridionales. Les points d’appui de la 7e armée américaine du général Patch avec qui combattait la division blindée française Leclerc (1902- 1947), étaient Lunéville et Epinal. Au nord de celle-ci, la 3e armée du général Patton atteignit la frontière occidentale de la Moselle : Thionville était libéré. Les Alliés s’arrêtèrent pendant 3 mois (septembre à novembre) à la Moselle et à la Seille. Les autorités allemandes en fuite depuis le 1 er septembre revinrent pour organiser le front (travaux de fortifications exécutés par des milliers de travailleurs indigènes et allemands). La Lorraine fut vidée de sa substance.
(p.71) Dans les Vosges, l’offensive partait de la ligne Pont-de-Roi Remiremont (libéré le 20 septembre) ; elle avait comme objectif de pénétrer en Haute-Alsace par la trouée de Belfort (libéré le 29 novembre) ou par les cols des Hautes-Vosges situés au sud de St. Dié : Bruyères, Comimont, Bru, Menil furent pris après une lutte acharnée.
Septembre 1944 Le débarquement des alliés en Normandie, le 6 juin 1944, aggrava la situation dans tout le pays. Pour parer à l’avance alliée, le Kreisleiter de Fénétrange Hans Rothacker, ancien commerçant , originaire de Badenweiler (Allemagne), nommé chef des travaux de retranchements du secteur A (arrondissements de ChâteauSalins, de Sarrebourg, de Sarreguemines et de Saverne), mobilisa la population pour des travaux de terrassement sur les lignes de défense prévues. Aucune journée de répit ne fut laissée à la population. Même les dimanches, en colonnes, les habitants se rendaient avec pelle et pioche sur l’épaule au chantier. Accusant la population de ravitailler les prisonniers évadés et des parachutistes réfugiés dans les forêts, Rothacker recourut aux menaces, à la violence et même à la condamnation à mort sans appel. Ce fut la terreur dans toute la région, Les sentiments d’aversion se changèrent en haine farouche. Rothacker ordonna, après un simulacre de jugement, la pendaison de 2 Lorrains, Le 7 septembre 1944, à Munster, le laboureur Michel Wilhelm fut pendu devant toute la population au lieu-dit » Les Tilleuls » , le corps resta exposé toute la journée. Détail horrible : le lendemain, 8 septembre, le fils de Michel Wilhelm, incorporé de force dans la Wehrmacht, arrivait en permission. Le 10 septembre, 3 jours plus tard, à Lixheim, le serrurier Joseph Dorschner accusé d’avoir tenu des propos anti-allemands fut pendu au balcon de la mairie. Son corps, par ordre de Rothacker, se balança là jusqu’au soir. Deux habitants choisis par lui durent exécuter la pendaison de leurs propres concitoyens. Dans un but d’intimidation, Rothacker fit placarder l’avis (p.72) dans l’exercice de ses fonctions, Peut-être y a-t-il eu en Alsace-Lorraine proportionnellement moins de collaborateurs actifs et convaincus que dans les autres parties de la France. Dans ce pays abandonné – pieds et poings liés à l’Allemagne la population, tant par les lois alors en vigueur, que par des menaces toujours réitérées, était obligée de feindre par une attitude conforme au caractère ou au tempérament de chacun son loyalisme à l’égard de la « nouvelle patrie » et son reniement de la patrie française. L’Alsace-Lorraine a été annexée par l’Allemagne qui a tiré de cette annexion toutes les conséquences de droit et de fait et les a imposées, en l’absence de la France, et sous la menace de lourdes sanctions.
Un des phénomènes les plus pénibles, dans les premiers temps qui suivirent la Libération, fut celui des malentendus et des règlements de comptes, les expulsés et internés même ayant une tendance humainement explicable à rendre ceux que la guerre avait relativement épargnés responsables de leurs affreuses souffrances. Un super-patriotisme très inégalement justifié se traduisit par des délations d’une inspiration contestable. Il y eut de scandaleuses promotions dans l’ordre des fonctions publiques et des honneurs par homologation rétroactive de services dans la Résistance, fort ambigus et parfois nuls. Falsifications de documents et de notes de fonction, erreurs voulues dans l’addition de points de mérites patriotiques homologués, etc. ; tous les coups étaient permis au niveau des fonctionnaires d’ autorité désireux d’imposer un protégé à quelque poste d’enseignement ou autre. Le non-protégé lésé était mis avec une subtilité diabolique dans l’impossibilité de se défendre. A quelques nuances près, tout ceci se retrouve d’ailleurs au niveau national. Pierre Taitinger, ancien député, ancien président du Conseil municipal de Paris, croit devoir donner dans son livre « Et Paris ne fut pas détruit » p. 205 les précisions chiffrées que voici : « On est pris de nausée à la pensée qu’au mois de janvier 1945, il y avait déjà 123.000 demandes d’homologation pour (p.81) le seul département de la Seine, adressées à la Direction des FFI au Ministère de la Guerre. Cent-vingt-trois mille!. Or, je repète que 3000 hommes au plus ont pris part aux combats de la Libération de Paris .L’imposture est ici éclatante. Il en va de même pour la province. A Marseille, par exemple, les services officiels de la Résistance comptaient 4 1 0 inscrits à la veille de la Libération. Quinze jours après l’arrivée des Alliés dans la seconde ville de France ces inscrits étaient passés au nombre de …95 000 1 . Ils sont maintenant 360 000!!” Que le jeu des promotions rétroactives soit à l’origine des carrières aussi foudroyantes que suspectes de certains hauts personnages n’est que trop évident.
Pour l’observateur attentif et nuancé, rien de plus éprouvant que le conventionnalisme patriotique et manichéen des propos touchant les faits de guerre et de résistance » rien de plus irritant que les amalgames qui enveloppent dans un même pathos le sublime et le dérisoire, les sacrifices héroïques et les ennuis mineurs, et finissent par rendre injustement suspect le souvenir des mérites les plus authentiques. 0n aurait pu sans doute épargner a beaucoup de gens morts vingt ou vingt-cinq ans après la guerre, et a un age avancé, le ridicule de mettre leur décès sur le compte de leurs épreuves du temps de guerre. Littérature trop facile et trop facilement accordée et qui finit par ne plus honorer personne.
P.M. L’EPURATION – FAITS ET DOCUMENTS
Le Comité de Libération avait été institué à Alger le 3.6. 1943 par ordonnance rédigée et signée par le général de Gaulle. Un mois plus tard, l’ordonnance du 6.7.1943, connue en France par la Radio de Londres, donna les précisions suivantes : « Sont déclarés légitimes tous actes accomplis postérieurement au 16.6.1940 dans le but de servir la cause de la libération de la France quand bien même ils auraient constitué des infractions au regard de la législation appliquée à l’époque. » (Requête… p. 27)
(p.97) V STATUT RELIGIEUX
Il apparaît que les dispositions du Concordat et de la loi Falloux ne sont plus appliquées dans les départements d’Alsace et de Lorraine ; nombre de biens appartenant aux églises, aux oeuvres charitables et aux membres du clergé ont fait l’objet de confiscations. Des entraves ont été apportées au libre exercice du culte, à l’enseignement religieux, à l’autorité des parents en matière de religion, mesures contraires à l’article 46 du Règlement de La Haye du 1 8 octobre 1907 et qui ont heurté les sentiments traditionnels d’une population fortement attachée à sa foi. Pour les divers motifs ci-dessus énoncés, les mesures dont il vient d’être question ne peuvent être considérées comme fondées. La Convention d’armistice ne contient, en effet, aucune clause spéciale relative aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Le Reich ne saurait donc valablement leur appliquer un régime différent de celui des autres départements français occupés. Comme dans ces derniers, ses droits y sont limités et ses devoirs déterminés par les règles du Droit des gens et par les Conventions en vigueur, notamment par la Convention 1V de La Haye du 18 octobre 1907. Pour toutes ces raisons, d’une gravité exceptionnelle, le Gouvernement français a aujourd’hui l’impérieux devoir de transmettre au Gouvernement du Reich la présente protestation dont l’urgence et la légitimité ne sauraient être contestées.
APRES LA LIBERATlON .
Epuration locale – Faits et documents
Les textes qui suivent ne font qu’illustrer sur le plan régional la mentalité publique de justice arbitraire qui sévissait au niveau national, Ils laissent aussi entrevoir ce que le souci d’une justice (p.98) équitable pouvait en soi avoir d’aléatoire en raison même de la fragilité des critères. Après la promulgation des ordonnances du 26.6. 1944, du 26.8. et du 26. 12. 1944 le Préfet de la Moselle Rebours et publia le 20.1. 1945 l’arrêté suivant :
Préfecture de la Moselle
République Française Cabinet Le Préfet de la Moselle Commissaire de la République Officier de la Légion d’Honneur Vu l’ordonnance du 10.1. 1944, sur la division du territoire métropolitain en Commissariats Régionaux de la République, Vu l’ordonnance du 29.9.1944, sur la création de Commissariats Régionaux de la République dans les Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Vu l’ordonnance du 4. 1 0. 1944, sur les mesures d’ordre administratif à l’égard des individus dangereux pour la sécurité publique.
ARRETE :
Article 1 er. – Toutes les personnes ayant appartenu pendant l’occupation allemande à une formation militaire ou politique nazie (SS – SA – NSKK – NSDAP – NSFK) ou au parti fasciste, devront se présenter une fois par semaine à la Gendarmerie ou au Commissariat de Police, ou à défaut, à la mairie de leur domicile à l’heure et au jour indiqués par les autorités locales. Article 2 – Ces mêmes personnes ne pourront circuler sur la voie publique entre 18 heures et 7 heures du matin, sauf, s’il y a lieu, pour se rendre à leur travail. Article 3 – Les infractions à ces dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par l’art. 47 1 – § 1 5 du Code Pénal sans préjudice des mesures d’ordre administratif.
(p.99) ARRETE :
Article 1 er – Les individus ayant adhéré depuis 1940 à des formations civiles ou paramilitaires nazies (SA – SS – NSKK NSDAP – NSFK), ou au parti fasciste ne pourront changer de domicile en dehors de leur commune sans autorisation de la Gendarmerie ou du Commissaire de Police, ou, à défaut, du maire de la Commune. Article 2 – Dans les villes de plus de 1 0 000 habitants, cette mesure sera applicable à ces personnes, lorsqu’elles désireront changer de domicile à l’intérieur de la localité. Article 3 – Cette mesure est et restera applicable jusqu’au jour où une décision définitive sera intervenue à leur égard. Article 4 – Les infractions à ces dispositions seront punies de peines prévues àl’art 47 1 § 1 5 du Code Pénal, sans préjudice des mesures d’ordre administratif.
Metz, le 20 janvier 1945. Le Préfet : signé Rebourset (Courrier de la Sarre du 3.2. 1945).
Des « Comités de libération » et « d’Epuration » se formèrent comme partout en Moselle. Le ton de ceux-ci nous est restitué par l’entrefilet suivant paru dans le Courrier de la Sarre le 5.5.1945 :
QUI VEUT ETRE JURE AUPRES DE LA COUR DE JUSTICE ?
« Conformément à une instruction de M. le Président de la Chambre de Metz (Cour d’appel de Colmar) relative à la répression des faits de collaboration et à la constitution d’une sous-section de la Cour de Justice à Sarreguemines, nous prions tous les gens de Sarreguemines, ayant fait de la résistance, déportés etc. et désirant faire partie comme juré à la sous-section de la dite cour de bien vouloir se faire (…).
|
-Alsace-Lorraine, colonies françaises
L’Alsace et la Lorraine ont été annexées à la France et colonisées par celle-ci au fil des siècles.
Au détriment de ces deux régions.
1.1 Annexion à la France, état centralisateur : la fin d’une certaine autonomie
1.1 Vogler Bernard, Catholiques et protestants entre deux langues et deux nations de 1815 à 1945 (univ. De Strasbourg 2)(p.21 sv.)
« L’Alsace est un pays germanique annexé à la France de 1648 à 1681. » (p.21)
1.2 Guerre d’identité mais pas paix religieuse, GEO, 124, 1989, p.134-137
(p.134) “La grande époque de la prospérité alsacienne, dont le moindre ancien village porte la marque, date du Moyen Age à son déclin et de la Renaissance. Elle fut la conséquence de l’union que firent dix villes indépendantes en 1353-1354 et qui prit le nom de Décapole. Le chef du Saint Empire de nation germanique, Charles IV, lui accorda son patronage et les belles années commencèrent. Le Saint Empire, dont Voltaire a bien eu tort de se moquer et que Napoléon n’aurait pas dû détruire, respectait la diversité des lois et des coutumes locales, il ignorait l’étatisme centralisateur. C’est ainsi qu’à Sélestat, ville de la Décapole, “on comptait plus de savants que le cheval de Troie n’avait enfermé de guerriers.”
1.2 Destruction de l’Alsace-Lorraine par la France
1.2.0 Ri, Bestürzender Sprachverlust links des Rheins, Europa Ethn., 1/90, p.25-26
(p.26) “Auch auf den Friedhöfen waren nur französischsprachige Grabaufschriften zugelassen (wie ähnlich unter Mussolini in Südtirol und der Venezia Giulia), alle Vornamen wurden französisiert.”
(p.26) das verschwinden der deutschen Sprache in Metz und in übrigen Lothringen.”
Guy Héraud, In memoriam, in : Europa Ethnica, 2-3/1988, p.134
Pierri Zind (1923-1988)
Professeur à l’Institut des Sciences de l’Education (Université de Lyon II).
« Elsass-Lothringen, une nation interdite, 1870-1940 », Copernic, Paris, 1979.
Livre largement étouffé, de même que son résumé, « Brève histoire de l’Alsace », Albatros, Paris, 1977.
1.2.1. Pierri ZIND, Elsass-Lothringen, une nation interdite, 1870-1940, Copernic, Paris, 1979.
(p.1) “Les nombreuses sociétés d’histoire qui couvrent l’Alsace abordent “avec délices” la préhistoire et l’archéologie, l’époque romaine, le Moyen Age et les temps contemporains, mais elles évitent soigneusement de dépasser la barre fatidique de 1871. Au delà, et jusqu’en 1940, c’est le silence, un silence voulu ou imposé, le silence du refoulement: il n’est pas honnête d’en parler, et encore moins d’écrire sur un tel sujet!”
(p.17) “/L’Alsace-Lorraine fut/ jadis durant un millénaire “Herzland des Heiligen Römisches Reiches Deutscher Nation”
(p.18) (p.29) /On put constater/ les activités pro-françaises de la mystérieuse ligue d’Alsace créée en 1871 par Gambetta (généreusement financée par la France)
/Tolérance germanique/
(p.34-35) – Selon la loi constitutionnelle pour l’Alsace-Lorraine ou Verfassungsgesetz, adoptée par le Reichstag en 1911, “le § 26 imposait dans l’administration et dans l’enseignement la langue allemande dans les régions germanophones et la langue française dans les régions francophones, un modèle de respect des identités linguistiques que la France jacobine ignore!”
(p.43-4) Dans l’esprit revanchard / de la France/, en 1912, furent publiés des ouvrages aussi partiaux qu’haineux tels que les Histoires de l’oncle Hansi / destinées aux petits enfants d’Alsace et de France avec des subventions accordées par Raymond Poincaré.
“C’ est surtout lors des 2 offensives d’août 1914 que les militaires français s’emparèrent de nombreux otages:” des milliers de personnes.
– en 1914-1918: déportations par ce qu’elles ne parlaient pas français ou le parlaient mal.
et vice versa dans la partie francophone de l’Alsace-Lorraine.
(p.55) “Les Français comme les Allemands exerçaient des resprésailles.”
(p.60-61) “Le désir profond de l’ Alsace-Lorraine de devenir un Etat fédéré allemand de plein droit se heurtait à une double opposition: celle de la France assimilatrice, d’une part, celle de l’Allemagne méfiante d’ autre part.”
L’après 1914-18
(p.110-111) Le racisme français : l’idée raciste de répartir les Alsaciens-Lorrains en 4 races suivant 4 modèles de cartes d’ identité, la carte Modèle A, barrée aux couleurs tricolores, remise aux habitants dont les parents et les grands-parents étaient nés en France ou en Alsace-Lorraine, la carte Modèle B, barrée de 2 traits rouges, imposée aux habitants dont un des membres de la famille était d’ une origine dite étrangère, c-à-d. non française et non alsacienne-lorraine, la carte Modèle C, barrée de 2 traits bleux, attribuée aux Alsaciens-Lorrains dont les 2 branches maternelles et paternelles étaient originaires de pays alliés à la France ou resté neutres durant la guerre de 14-18 ; la carte Modèle D, sans aucune barre de couleur, réservée aux “étrangers des pays ennemis”, aux descendants d’Allemands, d’Autrichiens, de Hongrois ou d’autres peuples des Empires centraux, “Cette carte D revenait aussi à leurs enfants, même s’ils étaient nés depuis 1870 en Alsace-Lorraine.”
(p.168) On se mit à baptiser les rues et les places publiques en les affublant de noms choisis sur la liste des nouveaux vainqueurs ou de traductions stupides, telle la rue Knobloch, du nom de la célèbre famille des imprimeurs strasbourgeois aux Xve et XVIe siècles, devenue la rue de l’Ail. Beaucoup de noms de communes furent déformées ou traduites en français.”
Du jour au lendemain, les jeunes Alsaciens-Lorrains durent subir les cours en français alors que pour 90 % d’ entre eux, la langue française était complètement étrangère, selon le journal socialiste Die freie Presse en 1920.
On eut tôt fait d’importer de nombreux fonctionnaires des Postes et du réseau de Chemin de Fer d’ Alsace-Lorraine, ignorant l’allemand parlé là-bas.
Division de l’ Alsace-Lorraine en 3 départements à partir de 1919.
“Ainsi se trouvait le voeu de l’ abbé Wetterlé en 1915:
(p.146) Nous voulons que l’ Alsace-Lorraine disparaisse pour se transformer en 3 départements qui ne se distingueront en aucune manière des 86 autres.”
Le droit des peuples à disposer d’ eux-mêmes n’était et n’est reconnu valable que s’il joue en faveur des intérêts français.
Suite au traité de Versailles, des plébiscites d’autodétermination furent notamment organisés dans les cantons de Saint-Vith, Malmedy et Eupen, dans le Schleswig à la frontière danoise MAIS pas en Alsace-Lorraine.
ASSIMILATION
(p.155) “Culturellement, depuis la destruction systématique des langues et des dialectes des régions et des minorotés ethniques, la France était appauvrie par un monolinguisme étroit. (p.156) Or, l’ Alsace-Lorraine se voulait bilingue.”
(p.157) “Confessionnellement, culturellement, économiquement, socialement et politiquement, l’Alsace-Lorraine différait de la France.”
Tous les leviers de l’économie française se trouvent à Paris. Or, sous le régime allemand, l’Alsace-Lorraine possédait sur place, à Strasbourg, d’ une manière presque autonome, la gestion de son économie.
(p.199) “L’administration française établit une dicrimination intolérable entre les fonctionnaires indigènes et les fonctionnaires parachutés de l’Intérieur.’ Ces derniers se voyaient attribuer de confortables indemnités de séjour, de logement, de fonction, etc., à l’instar de ce qui se pratiquait pour les fonctionnaires coloniaux d’Afrique ou d’sie.”
(p.388-390) dans les années 20
“L’ étude d’ensemble de l’attitude nationaliste des évêques face aux revendications ethniques, tant dans les colonies que dans les états européens, reste à faire.”
A cette époque, l’évêque de Bruges condamnait les autonomistes flamands, l’évêque de Quimper, les autonomistes bretons, et l’évêque de Strasbourg les autonomistes alsaciens-lorrains.
Ils semblaient confondre leurs propres conceptions politico-religieuses avec l’Eglise, (…).
(p.49) “En Alsace-Lorraine, …, il ne suffisait pas d’accepter d’être devenu Français sans avoir été consulté, il fallait encore aimer le conquérant victorieux de 1918, devenu oppresseur, ne point aimer la France, c’était une faute, un délit justiciable devant tribunal.”
(p.449) ‘Les tribunaux de la république française se sont mis au service de la politique nationaliste française, cherchant un moyen de verdicts démesurés à extirper jusqu’à la racine les journaux qui notamment refusent de cautionner le grand mensonge d’une Alsace originellement française.’
Un représentant des maîtres du cadre local, autonomiste, au Conseil départemental de l’Instruction publique, fut arrêté en 1927 pour permettre , au mépris de toute démocratie , la nomination du candidat gouvernemental.
(p.454) ‘En 1918, en entrant à Strasbourg, le général Gouraud proclamait: “La France vient à vous comme une mère vers un enfant perdu, chéri et retrouvé. Non seulement, elle respectera vos coutumes, vos traditions locales, vos croyances religieuses, vos intérêts économiques, mais elle pansera vos blessures …
(pays toujours libéré pour être toujours opprimé — botte de Paris ou de Berlin)
(p.455) Les autonomistes
Il fallait les impliquer dans un complot contre la sûreté de l’Etat,
“que les autorités gouvernementales françaises, leur Police spéciale et leurs journalistes nationalistes s’affairaient à fabriquer laborieusement.”
(le procès de Colmar en 1928)
(p.462) Après la condamnation à un an de prison des autonomistes pacifiques accusés d’un complot imaginaire contre la Sûreté de l’Etat, la foule entonna le chant autonomiste d’alors: “O Strassburg, o Strassburg, du wunderschöne Stadt!”
(p.465) Suppression des journaux écrits en allemand.
1.2.3 Le mouvement gaulliste à Londres en 1940 avait conseillé aux Alsaciens et aux Lorrains de colaborer avec l’occupant pour ne pas être déporté en masse. En 1945, on avait tout oublié: on a arrêté 45 000 personnes qu’on accusait de collaboration.
1.2.4 Vr., Frankreich / Gegen die deutsche Sprache in den Zeitungen gerichtete Vorschriften im Elsass, Eur. Ethnica, 4/88, p.191
Aufgrund des Art.11 der Verordnung Nr. 45-2113 vom 13. September 1945 über die provisorische Regelung der Zeitschriften, Press im Elsass und in Lothringen dürfen zweispprachige Zeitungen im Elsass und in Lothringen nur einen französischsprachigen Titel haben, ferner müssen mindestens 25 % des Inhalts in französischer Sprache verfasst sein, wobei dies insbesondere für die Kleinanzeigen, für Werbetexte, für die Verlautbarungen der Standesämter, für die Sportnachrichten und für die Jugendnachrichten gilt. Diese dürfen überhaupt nur in Französisch verfasst sein. Diese Bestimmung wurde mit enem gesetz vom 27. November 1986 auf Antrag des Präsidenten des Generalrates Dr. Goetschy vom Senat ersatzlos aufgehoben. Dennoch gibt es, wie die Organisation EL (Elsass-Lothringen, Union des Elsässichen Cvolkes) in ihrer Ausgabe vom juli-August 1988 mitteilt, immer noch Schwierigkeiten und ist diese regelung noch keineswegs durchgeführt. Dagegen wendet sich jetzt die neugegründete Union du Peuple Alsacien, die die ethnische identität der elsässischen Volksgemeinschaft betont und fordert, dass eine Autonomie für das Elsass eingeführt wird, die als einzige Möglichkeit ein überleben der elsässischen Identität mit sich brächte. »
1.2.5 in: DELTA, 3, maart 2000
(p.22) Frans taalimperialisme
Ongeveer 2 miljoen Elzassisch-Duits sprekenden worden in Frankrijk nog altijd taalkundig gediscrimineerd. Er kunnen bv. geen eentalige dag- en weekbladen worden uitgegeven, omdat de Franse wet in het Frans moeten zijn. Op dezelfde wijze worden in Frankrijk alle minderheidstalen genegeerd, zelfs uitgeroeid. En er waren (zijn?) er nog al wat! (…) In totaal niet minder dan de taal van 22 miljoen Fransen. (…) Frankrijk is en blijft het land van het unitaire jacobinisme.
1.3 La réalité alsacienne : germanique
Ainsi, si l’on consulte un journal comme Les dernières nouvelles de Strasbourg, celui du 02/09/1983, le caractère germanique de l’Alsace y est fort marqué :
– les patronymes y sont très majoritairement germaniques, sans parler des toponymes.
Une réalité écrasée par le rouleau compresseur jacobin…
|
Les dernières nouvelles de Strasbourg, 02/09/1983
Dans ce journal, on remarque le caractère allemand très marqué de cette région : les noms d’hommes politiques: J.-P. Hamman, A. Muller, René Gremmel les noms des villes et villages: les noms des personnes dans les faire-part: 95 % des noms en allemand
|
|
Ri, Bestürzender Sprachverlust links des Rheins, Europa Ethn., 1/1990, p.25-26
(p.26) “Auch auf den Friedhöfen waren nur französischsprachige Grabaufschriften zugelassen (wie ähnlich unter Mussolini in Südtirol und der Venezia Giulia), alle Vornamen wurden französisiert.” (p.26) Das Verschwinden der deutschen Sprache in Metz und in übrigen Lothringen.”
|
1.4 Le racisme français anti-alsacien-lorrain : toujours d’actualité
1.4.1 Ainsi l’actrice Anémone :
ANEMONE / Les Alsaciens ne sont pas des Boches, La Libre Belgique 08/12/93
Poursuite en diffamation contre la comédienne pour avoir assimilé les Alsaciens à des « Boches » en novembre 1992, sur France 2.
1.4.2 Ou l’attitude condescendante d’un Président de la République :
Paris Match, 22/4/88
“Chirac prend l’Alsace dans ses bras”
(candidat premier ministre)
“…loin du parlementarisme médiatique (sic), il a pris une petite fille /en costume alsacien/ dans ses bras comme pour serrer contre lui la France de demain (sic) qu’il espère mener lui-même vers l’an 2000.”
1.4.3 Manipulation par la presse
Edito, p.5, s.d.
“Si l’Alsacien a longtemps souffert de sa double nature (sic) – était-il un Français vivant dans une ambiance germanique, ou un Germain ne pouvant vivre que parmi les Français (sic) ? – il découvre aujourd’hui que cette différence, cette “alsacianité”, qui lui fut si souvent fatale, est un plus, non un moins.”

