
Le racisme, fondement de la France
B.-H. Lévy,
L’ idéologie française, 1981
« Il est l’ heure, enfin, de regarder la France en face. » (p.9)
« Car je crois, effectivement, qu’ il y a eu, un demi-siècle avant Vichy, un national-socialisme à la française. Mieux: que la France (…) est, en un sens, la propre patrie du national-socialisme en général. » (p.133)
PLAN
1 Analyses
2 Documents
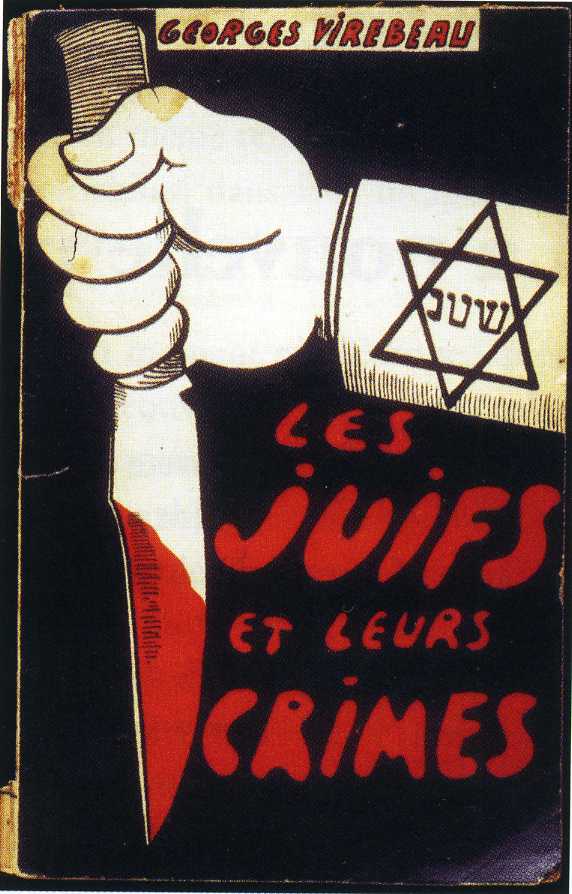
Paris 1938
1 Analyses
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981
(p.254) Meurtre rituel.
Dès le départ, nous retrouvons ainsi certains éléments essentiels qui, à travers les siècles, seront caractéristiques de ces sortes d’affaires. Il faut y ajouter cet autre que nous rencontrons aussi à différentes reprises : l’un des principaux accusateurs, le moine Théobald de Cambridge, était un renégat juif, baptisé de fraîche date. C’est lui qui fournit, semble-t-il, toutes les rocambolesques données relatives aux motifs du crime et à son mode d’exécution. L’affaire suivante paraît avoir été bien plus simpliste. En 1147, à Würzburg, en Allemagne, lors de la prédication de la IIe Croisade, on trouve dans le Main le cadavre d’un Chrétien : aussitôt les Juifs de la ville sont accusés du meurtre, on les poursuit, on en massacre quelques-uns. En revanche, l’imputation qui surgit trois années plus tard est d’une inspiration infiniment plus subtile. Il s’agit du thème de la profanation des hosties, thème à vrai dire déjà ancien — on le trouve chez Grégoire de Tours — mais qui était traité comme une légende se passant dans quelque Orient lointain, Beyrouth ou Antioche. Voici que, pour la première fois, les faits nous sont relatés comme se passant tout près, sous les (p.255) yeux du narrateur, c’est un « fait divers » en quelque sorte : voici surtout que l’hostie meurtrie se transforme en cadavre d’un petit enfant… Mais laissons la parole au chroniqueur liégeois Jean d’Outremeuse, qui nous assure qu’en 1150 eut lieu le miracle qui suit :
(p.258) La rouelle et le procès du Talmud.
Après avoir examiné les sombres légendes jaillies du tréfonds de l’imagination populaire, et qui, on l’a vu, furent combattues par les autorités ecclésiastiques, passons-en à deux initiatives prises au xme siècle par ces autorités, et qui, à leur tour, donneront naissance à de nouvelles légendes, tout aussi tenaces. Il s’agit de l’imposition du port d’un signe distinctif aux Juifs et de la condamnation expresse de leurs livres sacrés. La première mesure fut décidée par le IVe concile (p.260) du Latran qui, en 1215, marque l’apogée de la puissance pontificale. Pendant trois semaines, près de quinze cents prélats, venus de tous les points de l’horizon chrétien, avalisent les décisions souveraines prises par Innocent III. Certaines d’entre elles, adoptées à la dernière réunion du concile, concernent les Juifs. En voici un extrait : « Dans les pays où les Chrétiens ne se distinguent pas des Juifs et des Sarrasins par leur habillement, des rapports ont eu lieu entre Chrétiens et Juives ou Sarrasines, ou vice-versa, Afin que de telles énormités ne puissent à l’avenir être excusées par l’erreur, il est décidé que dorénavant les Juifs des deux sexes se distingueront des autres peuples par leurs vêtements, ainsi que d’ailleurs cela leur a été prescrit par Moïse. Ils ne se montreront pas en public pendant la Semaine sainte, car certains d’entre eux mettent ces jours-là leurs meilleurs atours et se moquent des Chrétiens endeuillés. Les contrevenants seront dûment punis par les pouvoirs séculiers, afin qu’ils n’osent plus railler le Christ en présence des Chrétiens. »
(…) Dès lors, les modes d’application de la mesure varieront considérablement suivant les pays. Fille aînée de l’Eglise, c’est la France qui s’y conforme le plus rapidement, d’autant plus que la croisade des Albigeois y renforce à cette époque la vigilance à l’égard des mécréants de toute espèce. C’est en France, en particulier, que semble avoir surgi à l’imitation du vieil usage musulman 1, l’idée de traduire la différence par le port d’un insigne spécial. Dès le début, la forme de celui-ci sera circulaire (d’où le terme de rouelle) et jaune sera la
(p.261) couleur imposée. On perçoit ainsi dès le départ l’intention de rendre la discrimination afflictive et humiliante. Dès lors, on comprendra que les Juifs aient déployé pour se soustraire à une mesure qui les désignait à la risée et la vindicte des foules de considérables efforts. Aussi bien, de 1215 à 1370, rien qu’en France, douze conciles et neuf ordonnances royales en prescrivaient-ils la stricte observation, sous peine de fortes amendes ou de châtimerfts corporels. L’industrieux Philippe le Bel en fit même une source de revenus : les rouelles furent vendues, et leur vente, affermée : elle rapporta, en 1297, cinquante livres tournois pour les Juifs de Paris, et cent, pour ceux de Champagne. Lorsqu’en 1361 le roi Jean le Bon rappela les Juifs en France, il disposa que la couleur de l’insigne serait dorénavant mi-rouge, mi-blanc : sans doute les Juifs réclamèrent-ils ce changement de coloris en débattant des conditions de leur retour. Ils furent du reste dispensés du port de la rouelle lorsqu’ils étaient en voyage ; d’où l’on voit que les autorités avaient pleinement conscience du risque auquel étaient exposés les porteurs de l’insigne. |
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981
(p.264) Quelques années plus tard, à l’époque même où les experts ci-devant Juifs convoqués par Frédéric II lavaient le judaïsme de l’accusation de meurtre rituel, un autre Juif converti entreprenait une action en sens contraire. Frère dominicain de la Rochelle, l’apostat Nicolas Donin se rendait à Rome et exposait à Grégoire IX que le Talmud était un livre immoral et offensant pour les Chrétiens. Le pape s’adressa aux rois de France, d’Angleterre, de Castille et d’Aragon, ainsi qu’à divers évêques, en leur enjoignant d’ouvrir une enquête pour vérifier le bien-fondé de l’accusation, Saint Louis fut le seul à y donner suite : dans toute la France, des exemplaires du Talmud furent saisis, et, en 1240, une grande controverse publique s’ouvrait à Paris, à laquelle prirent surtout part Eudes de Châteauroux, chancelier de la Sorbonne, et Nicolas Donin du côté chrétien, Yehiel de Paris et Moïse de Coucy du côté juif. Nous en possédons des relations circonstanciées, tant latines qu’hébraïques. Les thèmes traités furent groupés en trente-cinq articles, tels que les suivants :
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981
(p.296) Prenons le cas de la France. Ni Philippe Auguste ni saint Louis n’étaient parvenus à expulser les Juifs (bien que le premier l’ait tenté, et le second y ait souvent songé), ni même à apporter des changements substantiels à leur condition. En 1306, Philippe le Bel y réussit mieux, et les expulse en bloc, encore qu’il retient pendant plusieurs mois les plus riches d’entre eux, afin d’encaisser jusqu’au dernier sou les sommes qui leur restaient dues, car dans l’esprit de ce prince éminemment pratique, il s’agissait avant tout de réaliser une opération avantageuse pour le trésor royal. Cédant à « la commune clameur du peuple », comme l’assure l’ordonnance, Louis X les rappelle en 1315, mais six années plus tard, après l’affaire des « Pastoureaux », ils sont expulsés de nouveau, et il semble que pendant quarante ans il n’y en eut point en France : en tout cas, nulle source, nulle chronique ne mentionne leur présence. Mais voici qu’en 1361 la situation financière du royaume devient si désastreuse que la trésorerie est incapable de réunir les sommes nécessaires pour la rançon de Jean le Bon, fait prisonnier par les Anglais : entre autres mesures, le dauphin Charles se résout alors (p.297) à faire appel aux Juifs. Ils sont réadmis en France à des conditions toutes nouvelles : ils sont soumis à une lourde capitation individuelle de sept florins de Florence par an et par adulte, plus un florin par enfant, mais, en revanche, ils sont autorisés à acquérir maisons et terrains, et un « gardien des Juifs » spécial (Louis d’Etampes, cousin éloigné du roi) est désigné pour veiller à leurs intérêts ; surtout, ils sont autorisés à prélever un intérêt exorbitant de 87 p. 100 ; enfin, détail significatif, leur communauté est autorisée à mettre au ban un membre, sans avoir à solliciter l’autorisation du « gardien des Juifs », mais doit dans ce cas verser l’énorme somme de cent florins au trésor, en compensation du contribuable qui disparaissait de la sorte… Tout est donc mis en œuvre pour pomper par l’intermédiaire des Juifs autant d’argent que faire se peut.
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981
(p.330) D’autant plus frappante est la trace que les apostats ont laissée dans l’histoire juive. Si les Juifs ont de tout temps préoccupé les imaginations et joué un rôle historique disproportionné à leur nombre, à quel point cette disproportion est-elle plus déconcertante dans le cas de la poignée de renégats juifs, cette infime minorité d’une minorité dont tant de représentants sont demeurés illustres. Une boutade prétend que, de saint Paul à Karl Marx, ces renégats furent les principaux artisans de l’histoire occidentale ; boutade à part, on comprendra facilement que, faisant le plus souvent de la conversion de Juifs et de la dénonciation de Juifs leur métier principal, ils constituaient pour les communautés juives un véritable fléau. (p.331) De Théobald de Cambridge à Nicolas Donin, nous avons déjà rencontré quelques noms ; de Johann Pfefferkorn à Michael le Néophyte, nous en rencontrerons bon nombre d’autres. En plus des calamités qu’étaient susceptibles de déclencher ces transfuges, le simple fait de leur défection, sapant à la base la tradition la plus sacrée, frappait les Juifs, nous l’avons vu, au plus intime de leur être. Rien d’étonnant, dans ces conditions, qu’ils aient fait l’objet d’une haine et d’une horreur inégalées, dont de nos jours encore on relève quelque trace chez les Juifs les plus « assimilés » et les plus détachés des choses de la religion.
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
La France des Lumières
(p.31) Voltaire.
Aux temps de la domination hitlérienne en Europe, un agrégé d’histoire, Henri Labroue, n’eut pas de peine à composer un livre de deux cent cinquante pages à l’aide des écrits antijuifs de Voltaire 1. Dans leur monotonie, les textes ainsi réunis n’ajoutent rien à la gloire du grand homme : c’est d’abord leur licence qui frappe. Par exemple, dans l’adaptation libre qu’il donne du chapitre XXIII d’Ezéchiel : « Les passages les plus essentiels d’Ezéchiel, les plus conformes à la morale, à l’honnêteté publique, les plus capables d’inspirer la pudeur aux jeunes garçons et aux jeunes filles, sont ceux où le Seigneur parle d’Oolla et de sa sœur Ooliba. On ne peut trop répéter ces textes admirables. « Le Seigneur dit à Oolla : « Vous êtes devenue grande ; « vos tétons se sont enflés, votre poil a pointé… ; le temps « des amants est venu ; je me suis étendu sur vous… ; mais « ayant confiance dans votre beauté vous vous êtes prostituée « à tous les passants, vous avez bâti un bordel… ; vous avez « forniqué dans les carrefours… On donne de l’argent à toutes « les putains, et c’est vous encore qui en avez donné à vos « amants… » « Sa sœur Ooliba a fait encore pis : « Elle s’est abandonnée « avec fureur à ceux dont les membres sont comme des « membres d’âne, et dont la semence est comme la semence « des chevaux… Le terme de semence est beaucoup plus « expressif dans l’hébreu… »
Dans sa Profession de foi… déiste, Voltaire se fait également le gardien des bonnes mœurs : « Les mœurs des théistes sont nécessairement pures ; puisqu’ils ont toujours le Dieu de la justice et de la pureté devant eux, le Dieu qui ne descend pas sur la terre pour ordonner qu’on vole les Egyptiens, pour commander à Osée de prendre
(p.32) une concubine à prix d’argent et de coucher avec une femme adultère. Aussi ne nous voit-on pas vendre nos femmes comme Abraham. Nous ne nous enivrons pas comme Noé, et nos fils n’insultent pas au membre respectable qui les a fait naître… » D’une manière générale, c’est surtout l’organe sexuel mâle qui, en cette matière, excitait l’imagination de Voltaire : dans les seules pages 32 à 35 du recueil de Labroue, les mots de « prépuce », « déprépucé », « gland » et « verge » reviennent plus de vingt fois. Mais en châtrant ainsi les Juifs, le génial élève des déistes anglais n’obéissait-il pas à une préoccupation supérieure, celle de lutter contre l’obscurantisme ecclésiastique, d’écraser l’Infâme ? Rien n’est plus révélateur que le dépouillement du document capital, document voltairien qu’est le Dictionnaire philosophique. Sur ses cent dix-huit articles, une trentaine prennent à partie les Juifs, nos maîtres et nos ennemis, que nous croyons et que nous détestons (art. « Abraham »), le plus abominable peuple de la terre (art. « Anthropophage »), dont les lois ne disent pas un mot de la spiritualité et de l’immortalité de l’âme (art. « Ame »), et ainsi de suite, jusqu’à « Torture », et jusqu’à Z. « Job », qui trouve grâce aux yeux de Voltaire, n’est point Juif ; il est Arabe. L’article « Juif » est l’article le plus long du Dictionnaire (30 pages). Sa première partie (rédigée vers 1745) s’achève ainsi : … vous ne trouverez en eux qu’un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent ; suit la fameuse recommandation qui dans un tel contexte produit l’effet d’une clause de style : // ne faut pourtant pas les brûler. Plus significative encore est la dernière partie de cet article («Septième Lettre»), rédigée en 1770. Le patriarche de Ferney y harangue des Juifs imaginaires, au nom de la Chrétienté : « Nous vous avons pendus entre deux chiens pendant des siècles ; nous vous avons arraché les dents pour vous forcer à nous donner votre argent ; nous vous avons chassé plusieurs fois par avarice, et nous vous avons rappelés par avarice et par bêtise… », et ainsi de suite ; mais, en définitive, les Juifs sont tous aussi coupables que leurs bourreaux chrétiens, sinon davantage : « Toute la différence est que nos prêtres vous ont fait brûler par des laïcs, et que vos prêtres ont toujours (p.33) immolé les victimes humaines de leurs mains sacrées… » (Nous reviendrons encore à cette obsession voltairienne du meurtre rituel.) Suit cette recommandation : « Voulez-vous vivre paisibles ? imitez les Banians et les Guèbres ; ils sont beaucoup plus anciens que vous, ils sont dispersés comme vous. Les Guèbres surtout, qui sont les anciens Persans, sont esclaves comme vous après avoir été longtemps vos maîtres. Ils ne disent mot ; prenez ce parti. » En conclusion, enfin : Vous êtes des animaux calculants, tâchez d’être des animaux pensants. Cette comparaison entre le Chrétien qui pense et le Juif qui calcule, anticipe l’a priori de l’antisémitisme raciste, décrétant la supériorité de l’intelligence créatrice des Chrétiens, devenus des Aryens, sur le stérile intellect des Juifs. On retrouve le même Voltaire moderne lorsqu’il affirme que les Juifs sont plagiaires en tout, ou lorsqu’il écrit, dans l’Essai sur les mœurs : « On regardait les Juifs du même œil que nous voyons les Nègres, comme une espèce d’homme inférieure. »
(p.43) De même, à différentes reprises, Jean-Jacques parle des Juifs de l’Antiquité de la manière conventionnelle : « le plus vil des peuples », « la bassesse de [ce] peuple incapable de toute vertu », « le plus vil peuple qui peut-être existât alors ». Enfin la médiation théologique gênait cet apôtre de la religion du cœur tout comme beaucoup de ses contemporains : d’où la fameuse exclamation : « Que d’hommes entre Dieu et moi ! » Mais à Moïse le législateur, Rousseau porte une admiration infinie. Dans un écrit peu connu, il lui attribue le mérite d’avoir institué d’emblée un système de gouvernement à l’épreuve du temps, et abstraction faite de la condensation anachronique, on ne peut pas dire que son jugement ait été démenti (…) « [Moïse] forma et exécuta l’étonnante entreprise d’instituer en corps de nation un essaim de malheureux fugitifs, sans arts, sans armes, sans talents, sans vertus, sans courage et qui, n’ayant pas en propre un seul pouce de terrain, faisaient une troupe étrangère sur la face de la terre. Moïse osa faire de cette troupe errante et servile un corps politique, un peuple libre, et, tandis qu’elle errait dans les déserts sans avoir une pierre pour y reposer sa tête, il lui donnait cette institution durable à l’épreuve du temps, de la fortune et des conquérants, que cinq mille ans n’ont pu détruire et même altérer, et qui subsiste encore aujourd’hui dans toute sa force, lors même que le corps de la nation ne subsiste plus. « Pour empêcher que son peuple ne fondît parmi les peuples étrangers, il lui donna des mœurs et des usages inalliables avec ceux des autres nations ; il le surchargea de rites, de cérémonies particulières ; il le gêna de mille façons pour se tenir sans cesse en haleine et le rendre toujours étranger parmi les autres hommes ; et tous les liens de fraternité qu’il mit entre les membres de sa république étaient autant de barrières qui le tenaient séparé de ses voisins et l’empêchaient de se mêler à eux. C’est par là que cette singulière nation, si (p.44) souvent subjuguée, si souvent dispersée et détruite en apparence, mais toujours idolâtre de sa règle, s’est pourtant conservée jusqu’à nos jours éparse parmi les autres sans s’y confondre, et que ses mœurs, ses lois, ses rites, subsistent et dureront autant que le monde, malgré la haine et la persécution du reste du genre humain… » (Considérations sur le gouvernement de Pologne.)
(p.48) Mais, traitant de la médecine, le même Jaucourt s’emportait contre les Juifs, au nom de la médecine somatique naissante, méfiante des guérisons par l’esprit : « Les anciens Hébreux, stupides, superstitieux, séparés des autres peuples, ignorants dans l’étude de la physique, incapables de recourir aux causes naturelles, attribuaient toutes leurs maladies aux mauvais esprits (…), en un mot, l’ignorance où ils étaient de la médecine faisait qu’ils s’adressaient aux devins, aux magiciens, aux enchanteurs, ou finalement aux prophètes. Lors même que Notre Seigneur vint dans la Palestine, il paraît que les Juifs n’étaient pas plus éclairés qu’autrefois… » Toujours Jaucourt, à l’article « Menstruel », se complaît à comparer les femmes juives, avec leur hantise de la souillure et leurs absurdes observances, aux Négresses de la Côte d’Or et du royaume du Congo. A l’article « Pères de l’Eglise », ce « maître Jacques de l’Encyclopédie » ne manque pas de se rappeler l’immoralité du patriarche Abraham, ce qui lui permet de mieux critiquer saint Jean Chrysostome et saint Augustin. D’autres auteurs, traitant de tous autres sujets (par exemple, Géographie ou Astronomie), déniaient tout mérite à Moïse qui n’aurait fait que se mettre à l’école des Egyptiens ; d’une manière générale, les encyclopédistes eurent tendance à glorifier l’histoire de l’Egypte, afin de mieux rabaisser l’histoire sacrée des Juifs. A l’article « Economie politique », c’est d’une manière plus traditionnelle, si l’on peut dire/ainsi, que son auteur, Nicolas Boulanger, critiquait la/« superstition judaïque » :
(p.49) « Le monarque, chez les Juifs endurcis et chez toutes les autres nations, était moins regardé comme un père et un Dieu de la paix, que comme un ange exterminateur. Le mobile de la théocratie aurait donc été la crainte : elle le fut aussi du despotisme : le Dieu des Scythes était représenté par une épée. Le vrai Dieu chez les Hébreux était aussi obligé, à cause de leur caractère, de les menacer perpétuellement (…). La superstition judaïque qui s’était imaginée qu’elle ne pouvait prononcer le nom terrible de Jehovah, qui était le grand nom de son monarque, nous a transmis par là une des étiquettes de cette théocratie primitive… » Mais ces flèches ou ces critiques, lors desquelles le dénigrement des Juifs ne servait le plus souvent que de paravent pour de tout autres attaques, sont bien peu de choses à côté du grand article « Messie », dû à un disciple de Voltaire, le pasteur Polier de Bottens. Cet article avait été commandé par le maître lui-même, qui en fournit le plan et ensuite le retoucha de sa main ; on y reconnaît bien sa manière, qui consiste à faire longuement sa pâture de l’ignominie des Juifs, ce qui permet, en passant, de tourner en dérision l’Eglise établie, sous couleur de la défendre : « Si les Juifs ont contesté à Jésus-Christ la qualité de Messie et la divinité, ils n’ont rien négligé aussi pour le rendre méprisable, pour jeter sur sa naissance, sa vie et sa mort, tout le ridicule et tout l’opprobre qu’a pu imaginer leur cruel acharnement contre ce divin Sauveur et sa céleste doctrine ; mais de tous les ouvrages qu’a produit l’aveuglement des Juifs, il n’en est sans doute point de plus odieux et de plus extravagant que le livre intitulé Sepher Toldos Jeschut, tiré de la poussière par M. Wagenseil dans le second tome de son ouvrage intitulé Tela Ignea, etc. » (Suit un long résumé du Toldoth léchouth, un écrit blasphématoire qui circulait dans les ghettos ; il date probablement des premiers siècles de l’ère chrétienne. Jésus s’y trouvait décrit comme le fils d’une femme de mauvaise vie et d’un légionnaire romain ; sa biographie était ornée de maint détail obscène. Dûment attribué aux Juifs et accompagné d’invectives à leur égard, le pamphlet pouvait passer la censure et faire les délices des ennemis de l’Eglise. Dans cette affaire, le pasteur Polier semble avoir été un outil entre les mains de Voltaire. Un procédé semblable fut employé en 1770 par la « synagogue holbachique », publiant le traité antichrétien Israël vengé…, du Marrane Orobio de Castro.)
(p.55) (…) dès le début du XVIIIe siècle, un curieux précurseur du transformisme, Benoît de Maillet, parle des races humaines, sorties, d’après lui, des mers. Autre adepte du « polygénisme » avant la lettre, Voltaire marque fortement la supériorité raciale des Européens, « hommes qui me paraissent supérieurs aux nègres, comme ces nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres… ». Ensuite, des penseurs à l’esprit plus méthodique jettent les bases de la future anthropologie, mais le rejet de la cosmogonie biblique leur laisse le champ libre pour des spéculations qui sont le plus souvent peu flatteuses sur le compte des « sauvages ». Les jugements de valeur portés de la sorte subissent l’empreinte du jeune orgueil bourgeois caractéristique de la société éclairée du temps, et sans doute faut-il faire la part de la pensée matérialiste des lumières, appliquée à arracher au corps les secrets de l’âme. Telle demeurera l’orientation générale de la recherche anthropologique : des générations durant, les savants s’évertueront à chercher les preuves matérielles et tangibles, inscrites dans le corps, de la supériorité intellectuelle et morale de l’homme blanc, ne se résignant pas à ce que sa constitution biologique soit pareille à celle du nègre, et semblable à celle du singe. La rapide diffusion du mot et du concept de race est fort éclairante à tous ces égards.
(p.56) Mais cette dignité et ces prérogatives, Buffon ne les trouvait pleinement présents que chez l’homme blanc d’Europe, le seul à incarner la pure nature humaine, dont toutes les autres races auraient dégénéré. Une telle conception, dont le premier auteur semble avoir été le mathématicien Maupertuis, dans sa Vénus physique, est développée par Buffon dans son discours De la dégénération des animaux. Partisan de l’unité de l’espèce humaine, il y suppose qu’en se répandant à travers le globe l’homme a subi des « altérations » de caractère dégénérescent : « … elles ont été légères dans les régions tempérées, que nous supposons voisines du lieu de son origine ; mais elles ont augmenté à mesure qu’il s’en est éloigné, et lorsque… il a voulu peupler les sables du Midi et les glaces du Nord, le changement est devenu si sensible qu’il y aurait lieu de croire que le Nègre, le Lapon et le Blanc forment des espèces différentes, s’il n’y a eu qu’un seul Homme de créé… »
(p.59) Ainsi donc, c’est dans la mesure même où le nouvel homme prométhéen du Siècle des Lumières, l’artisan de la science et du progrès, tend à prendre au sommet de la Création la place de Dieu, que s’élargit l’écart qui le sépare des autres créatures, des quadrupèdes, des singes et des sauvages. L’émancipation de la science de la tutelle ecclésiastique, l’abandon de la cosmogonie biblique et le délaissement des valeurs chrétiennes laissait la voie libre aux spéculations racistes ; chez certains savants en renom du temps, elles revêtaient déjà un caractère mani-chéiste. Ainsi, chez le philosophe allemand Christophe Meiners, qui croyait avoir découvert l’existence de deux races humaines : la race « claire et belle », et la race « foncée et laide », contrastant entre elles comme la vertu et le vice. Cette théorie, assurait-il, permettait de percer (p.60) le secret des « hommes supérieurs » qui ne surgissent que chez les peuples nobles : « Seuls les peuples blancs, surtout les peuples celtes, possèdent le vrai courage, l’amour de la liberté, et les autres passions et vertus des grandes âmes… les peuples noirs et laids en diffèrent par une déplorable absence de vertus et par! plusieurs vices effroyables… »
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
/France/ (p.111) (…) on a l’impression très nette qu’à leur égard le sectarisme du culte de la Raison redoublait de virulence, notamment dans les départements de l’Est, s’alimentant à la sensibilité antijuive traditionnelle. Symptomatique à cet égard est une brochure populaire à la gloire de Marat, le comparant à Jésus, « tombé lui aussi sous les coups du fanatisme, en travaillant de toutes ses forces à opérer le salut du genre humain ». Dans les départements de l’Est se poursuivait une propagande antijuive ouverte. Le conventionnel Baudot, commissaire aux armées du Rhin et de la Moselle, proposait même un nouveau genre de régénération des Juifs, la régénération guillotinière : « … partout, ils mettent la cupidité à la place de l’amour de la patrie, et leurs ridicules superstitions à la place de la raison. Je sais que quelques-uns d’entre eux servent dans nos armées, mais en les exceptant de la discussion à entamer sur leur conduite, ne serait-il pas convenant de s’occuper d’une régénération guillotinière à leur égard ? » A la même époque (brumaire an II), toutes les municipalités du Bas-Rhin recevaient l’ordre « de réunir à l’instant tous les livres hébreux, notamment le Talmuth, ainsi que tous les signes quelconques de leur culte, afin qu’un autodafé fût fait à la Vérité, le décadi de la seconde décade, de tous ces livres et signes du culte de Moïse ». Il semble que cet ordre ne fut pas suivi d’effet, car en pluviôse, c’est-à-dire trois mois plus tard, une autre circulaire portait défense aux « citoyens qui osent ternir le beau nom de citoyen et l’amalgamer avec celui de juif, de s’assembler dans leurs ci-devant synagogues et y célébrer leurs anciennes simagrées, dans une langue inconnue, avec laquelle on pourrait aisément troubler la sûreté générale ». Le II thermidor, enfin, ce n’est plus leur superstition, mais leur agiotage qui était reproché aux Juifs alsaciens, et l’ordre était donné aux municipalités du district « d’avoir sans cesse les yeux fixés sur ces êtres dangereux, qui sont les sangsues dévorantes des citoyens ».
(p.113) A première vue, il semble bien que sur le chapitre des Juifs plus que sur tout autre, Napoléon fut le fils fidèle de la Révolution, et plus spécialement de la Montagne. Il chercha à régénérer les Juifs, c’est-à-dire à les déju-daïser, et il y réussit en partie. Ses jugements sur les enfants d’Israël, principalement inspirés par la pensée déiste de son temps, n’étaient pas tendres, et cet ennemi des « idéologues » ne se souciait guère du problème responsabilités que posait leur condition avilie, en sorte qu’assemblés bout à bout ces jugements fourniraient la matière d’un petit catéchisme antisémite. Ils combinaient (p.114) l’ancien préjugé théologique à la naissante superstition scientiste : « Les Juifs sont un vilain peuple, poltron et cruel. » « Ce sont des chenilles, des sauterelles, qui ravagent les campagnes. » « Le mal vient surtout de cette compilation indigeste appelée le Talmud, où se trouve, à côté de leurs véritables traditions bibliques, la morale la plus corrompue, dès qu’il s’agit de leurs rapports avec les Chrétiens. » II n’en reste pas moins que les Juifs forment pour lui une race, et que cette race est maudite : « Je ne prétends pas dérober à la malédiction dont elle est frappée cette race qui semble avoir été seule exceptée de la rédemption, mais je voudrais la mettre hors d’état de propager le mal… » Le remède, à ses yeux, consiste dans la suppression de la race, qui doit se dissoudre dans celle des Chrétiens. La tâche est ardue : « … le bien se fait lentement, et une masse de sang vicié ne s’améliore qu’avec le temps ». « Lorsque sur trois mariages, il y en aura un entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d’avoir un caractère particulier. » Dans les faits, Napoléon régenta les Juifs d’une main ferme et efficace ; pourtant, ses desseins administratifs et politiques faisaient leur part à des rêves visionnaires, et peut-être aussi à une peur superstitieuse. Dès l’expédition d’Egypte, il lançait une proclamation aux Juifs, leur proposant de s’enrôler sous ses drapeaux pour reconquérir la Terre promise. Mais ceux-ci restèrent sourds à son appel, et le projet peut être rangé parmi ses « mirages orientaux ». Trois ou quatre années ensuite, une fois nommé Premier Consul, Bonaparte entreprenait de régler les questions religieuses. Cependant, la loi du 18 germinal an X sur l’organisation des cultes catholique et protestant laissait le judaïsme à l’écart : « … quant aux Juifs, aurait-il dit, c’est une nation à part, dont la secte ne se mêle avec aucune autre ; nous aurons donc le temps de nous occuper d’eux plus tard. » Ce temps vint sous l’Empire, au printemps 1806, et il semble bien que son intention première ait été de les priver de leurs droits civiques. Mais le Conseil d’Etat, peuplé d’anciens juristes de la Révolution (Regnault de Saint-Jean d’Angely, Beugnot, Berlier), sut exercer une influence modératrice sur lui. En fin de compte, il décidait de sonder auparavant les reins et les cœurs des Juifs, dont il réunissait à Paris les représentants, en une « Assemblée générale ». (p.115) Tenaient-ils à être Français ? Etaient-ils prêts à jeter par-dessus bord, s’il le fallait, la loi de Moïse ? Aux douze questions embarrassantes qui leur furent posées, les délégués répondirent d’une manière on ne peut plus satisfaisante. « Les Juifs… regardent-ils la France comme leur patrie et se croient-ils obligés de la défendre ? » « Oui, jusqu’à la mort ! » s’exclamait l’Assemblée unanime. Mais les nouveaux patriotes redevinrent le peuple à la nuque dure lorsqu’il fut question des mariages mixtes, dont l’Empereur souhaitait que les rabbins les recommandent expressément : sans heurter de front l’autocrate, l’Assemblée réussissait à esquiver la réponse. Dans l’ensemble, elle subit avec succès l’examen, et produisit une impression favorable sur les commissaires (Pasquier, Portalis) désignés par l’Empereur. Encore fallait-il trouver le moyen de lier la population juive bigarrée de l’Empire, des Pays-Bas à l’Italie, par les décisions adoptées par l’Assemblée : les commissaires furent fort surpris d’apprendre qu’il n’existait aucune autorité organisée, aucun gouvernement central, auquel tous les fidèles de Moïse prêtaient allégeance (un étonnement qui est encore parfois partagé, de nos jours). C’est dans ces conditions que naquit l’idée de réunir à Paris un Grand Sanhédrin, qui, à dix-huit siècles de distance, renouerait avec la tradition d’un gouvernement d’Israël. L’idée enflamma aussitôt l’imagination de Napoléon ; au-delà d’un instrument de régénération et de police des Juifs, le génial opportuniste crut pouvoir utiliser un tel organe pour les besoins de sa grande politique. Le projet fut mis au point par lui au cours des derniers mois de l’année 1806, en même temps que celui du blocus continental ; sans doute comptait-il sur la pieuse allégeance des hommes d’affaires juifs pour mieux affamer l’Angleterre. Le nouveau gouvernement d’Israël allait être une réplique fidèle de l’ancien, et compter le même nombre de membres (soixante et onze), revêtus des mêmes titres ; des invitations furent adressées, au-delà des frontières de l’Empire, à toutes les juiveries de l’Europe. L’ouverture s’effectua le 9 février 1807, en grande pompe, dans la chapelle désaffectée Saint-Jean, rue des Piliers, qui fut débaptisée en rue du Grand-Sanhédrin.
Mais une telle forme de régénération des Juifs était riche d’associations fâcheuses, voire provocatrices, pour la sensibilité chrétienne. Le Sanhédrin n’était-il pas le tribunal juif qui avait accepté le marché de Judas, et lui (p.116) compta les trente pièces d’argent ? N’était-ce pas là que « se passa cette scène d’outrages sans nom où le Fils de Dieu fut souffleté, couvert de crachats et d’insultes ? » Ne fut-il pas, en un mot, l’organe même du déicide? Dès lors, les imaginations se donnèrent libre cours. La propagande antinapoléonienne à l’étranger exploita vigoureusement et longuement ce thème, qui vint compléter celui de Napoléon l’antéchrist, ainsi que nous allons le voir plus loin. En France, même les catholiques ralliés ne manquèrent pas d’y faire des allusions. « Pour le christianisme, l’état malheureux des Juifs est une preuve qu’on voudrait, avant le temps, faire disparaître… », protestait de Donald, comparant le Sanhédrin des Juifs à la Convention des philosophes. Un pamphlet anonyme, qui fut saisi par la police, représentait Napoléon comme « l’oint du Seigneur, qui sauvera Israël ». Mais ce nouveau messie des Juifs ne serait-il pas lui-même d’origine juive ? C’est ce que L’Ambigu, l’organe des émigrés français à Londres, s’empressa d’affirmer, et cette imputation elle aussi a laissé sa trace dans la mémoire des hommes. Le rapide licenciement du Sanhédrin peut laisser croire que ces campagnes impressionnèrent Napoléon, au point de susciter chez lui également une sorte de peur superstitieuse. En effet, cette assemblée au nom millénaire ne tint que quelques séances, au cours desquelles furent entérinées les décisions antérieurement prises par 1′ « Assemblée générale » ; le 9 mars 1807, un mois après son ouverture solennelle, elle fut dissoute, et il ne fut plus jamais question de la réunir à nouveau.
Par ailleurs, non seulement les Juifs des pays étrangers, mais aussi ceux de l’Empire, ne manifestaient pas un enthousiasme excessif pour l’institution appelée à les régir, sous la surveillance impériale. En résultat, et quels qu’aient pu être ses mobiles, Napoléon renonça à son grand plan politico-messianique. En définitive, il se contenta de soumettre les Juifs, par le décret dit « infâme» du 17 mars 1808, à des mesures d’exception partielles, département par département : ceux de la Seine et des départements du Sud-Ouest (auxquels plusieurs autres vinrent se joindre par la suite) gardèrent la plénitude de leurs droits ; ceux des autres départements furent assujettis à des mesures de discrimination qui entravaient leurs déplacements, et l’exercice par eux du commerce. Le décret du 17 mars, qui ruina bien des familles juives, était motivé par la lutte anti-usuraire, (p.117) mais les laborieuses enquêtes sur « les abus des Juifs » prescrites à cette occasion aux préfets nous montrent une fois de plus comment leur mauvaise réputation tenait d’abord à leur qualité de Juifs. (…)
Là où les Juifs restaient effectivement nombreux à exercer le métier de Juifs, ainsi que cela était le cas dans les départements rhénans, ils servaient couramment de prête-noms à des Chrétiens qui n’osaient pas juddiser ouvertement. Les rapports des préfets et des maires signalent à de multiples reprises cet état de choses, que le maire de Metz décrivait comme suit : « Les acquéreurs et les soumissionnaires des biens nationaux (p.118) cherchèrent et trouvèrent de l’argent chez les Juifs. Ils l’obtinrent à très haut prix, parce que les Juifs, en ayant peu, se firent pour ces opérations les courtiers des particuliers non juifs, qui voulurent se procurer de gros bénéfices, en conservant les dehors honnêtes sous lesquels ils étaient connus dans la société. Ainsi, l’odieux était pour les Juifs, et le profit revenait à d’autres. La liberté du commerce de l’argent favorisa d’ailleurs l’usure ; on vit à Metz des usuriers dans toutes les classes de la société… »
Pourtant, les commissaires de l’Empereur rejetaient le blâme sur les Juifs seuls : « On eût dit que [les Juifs] enseignaient à ceux qu’ils dépouillaient l’oisiveté et la corruption, tandis qu’ils étaient leur moralité à ceux qu’ils ne dépouillaient pas. Des notaires publics, séduits par eux, employaient leur ministère à cacher leur honteux trafics, et des domestiques, des journaliers, leur apportaient le prix de leurs services ou de leurs journées, afin qu’ils le fissent valoir comme leurs propres derniers. De cette] manière, les professions utiles étaient abandonnées par un certain nombre de Français, qui s’accoutumaient à vivre sans travail des profits de l’usure… »
(p.135) Pour entrer dans la grande société, il leur fallait passer d’abord par l’école publique. Chemin de croix pour bien des enfants juifs, les marquant pour le reste de leurs jours. Arrivé au faîte des honneurs, Adolphe Cré-mieux évoquait ce passé : « … je ne pouvais pas traverser les rues de ma ville natale sans recueillir quelques injures. Que de luttes j’ai soutenues avec mes poings ! ». (Pour corriger les effets de cette évocation, l’homme d’Etat ajoutait aussitôt : « Eh bien, peu d’années je faisais mes études à Paris, et quand je rentrais à Nîmes, en 1817, je prenais ma place au barreau et je n’étais plus juif pour personne ! » Ainsi donc, la société nîmoise eut le tact de ne pas voir le Juif en Crémieux ; tel est peut-être le secret de la tolérance française…) Se fondant, on peut le croire, sur ses souvenirs d’enfance, Frédéric Mistral évoquait dans Nerto ces guerres enfantines, à cinquante contre un : « Lou pecihoun ! Lou capeu jaune ! A la jutarié ! que s’encaune ! Cinquante enfant ié soun darrié1… » Tout porte à croire que dans l’est de la France, les brimades, aux rites semblables, étaient tout aussi courantes. Le rabbin de Metz, J.-B. Drach, décrivait l’enfance de son frère « … que ses camarades d’école… poursuivaient au sortir de la classe, l’accablant d’injures, de coups de pierre, et, que pis est, lui frottant les lèvres avec du lard. Malgré les chefs de l’école, qui interposèrent plus d’une fois leur autorité, ces persécutions continuèrent jusqu’à ce que mon frère se fût distingué par ses progrès et les prix qu’il obtenait à la fin de chaque année ; il est maintenant un des meilleurs miniaturistes de sa province ».
1 « Le guenillon ! le chapeau jaune ! A la juiverie ! qu’il se cache ! Cinquante enfants après lui… »
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
La France Avant l’Affaire.
(p.284) Si on voulait mesurer la force de l’antisémitisme dans un pays à la quantité d’encre répandue à propos des Juifs, c’est sans doute à la France que reviendrait la palme, à la fin du 19e siècle. L’affaire Dreyfus demeure en effet le procès le plus retentissant de tous les temps ; mais entre autres conséquences, il donna à l’antisémitisme français une résonance qu’on peut croire artificielle. Qu’on tienne cette affaire pour une honte nationale, ou pour une gloire nationale — sans doute fut-elle les deux à la fois — elle ranima en la décuplant, à partir de 1894, une agitation qui commençait à se diluer tout comme dans les pays germaniques, et pour quelques années, la France devint effectivement la seconde patrie de tous les hommes qui se sentaient concernés, d’une manière ou de l’autre, par le débat international autour des Juifs. Les perspectives historiques s’en sont trouvées faussées, au point que des philosophes ont pu voir dans l’Affaire une répétition générale (heureusement avortée) du nazisme. Il reste qu’avant même qu’elle n’éclate, la France fut, dans le monde occidental, le second foyer des campagnes antisémites du type moderne, et qu’il n’y en eut pas de troisième : il y eut donc, à ce propos, une sorte de dialogue franco-allemand, dont on est tenté de se demander s’il ne fut pas l’indice, d’une certaine affinité, remontant peut-être à des temps très anciens, lorsque les descendants de Charlemagne régnaient des deux côtés du Rhin (p.285) et que la future Allemagne s’appelait « Francie orientale»… Mais, en tout cas, si l’antisémitisme français fut pour une partie calqué sur l’antisémitisme germanique, pour une autre partie il correspondait à une tradition différente, et coulait de sources autochtones. D’une manière ou d’une autre, il s’agissait en France de certaines séquelles de la Révolution. De ses prolongements idéologiques directs, d’abord : nous avons vu à quel point les mouvements socialistes, qu’ils aient été « utopiques » ou « scientifiques », à la seule exception du saint-simonisme, étaient entachés d’antisémitisme. Mais au cours des années 1880, le relais fut pris par les militants du camp adverse, surtout par des catholiques pour lesquels la Révolution était le Mal incarné, un Mal attribué à un complot ourdi par des forces antichrétiennes et antifrançaises occultes. C’est en effet en France que s’est formée, au lendemain du drame révolutionnaire, l’école de pensée pour laquelle les complots montés par des ennemis du genre humain constituent la clef majeure de l’histoire universelle. Cette école, dont au xxe siècle les nazis furent les principaux, mais non les seuls adeptes, a la fâcheuse tendance de tirer ses preuves les plus péremptoires de l’absence de preuves, puisque l’efficacité d’une société secrète se mesure le mieux par définition, au secret dont elle sait entourer ses activités. La plus grande ruse du Diable n’est-elle pas de faire croire qu’il n’existe pas ? Des convictions de ce genre permettent au dénonciateur de gagner à tous les coups. Pour ce qui est de la Révolution de 1789, l’ennemi invisible fut d’abord figuré par les protestants, mais dès 1807, il est question d’une conspiration juive ; par la suite, les protestants passèrent à l’arrière-plan, tandis que les Juifs et les francs-maçons occupaient alternativement ou conjointement l’avant-scène. Au demeurant, les comploteurs étaient le plus souvent censés opérer pour le compte du Diable ou de l’Antéchrist, qui (d’après les révélations de Léo Taxil, acclamées par l’ensemble de l’épiscopat français) leur donnait ses instructions par télégraphe ou par téléphone : en prenant connaissance de ces exploits de « Satan Franc-Maçon », on en vient à se dire que c’est dans la France de Louis Pasteur et d’Ernest Renan que furent établis les records absolus de la crédulité humaine, du moins au xixe siècle.
(p.291) Le bestseller français de la deuxième moitié du XIXe siècle : La France Juive d’Edouard Drumont (1886). (…) Pourquoi ce subit triomphe ? Drumont était un bon journaliste, et son énorme volume, dont l’index comptait plus de trois mille noms, était une chronique scandaleuse, dans laquelle étaient dénoncés non seulement les inévitables Rothschild et autres « fils d’Abraham », mais aussi tout ce qui en France avait un nom, pour peu que ses porteurs aient cultivé des relations avec les Juifs. Il y avait là certes de quoi provoquer de l’intérêt pour le livre : mais non de quoi entourer Drumont de l’auréole de prophète, « révélateur de la Race » (Alphonse Daudet), « le plus grand historien du 19ee siècle » (Jules Lemaitre), «observateur visionnaire » (Georges Bernanos).
(p.292) Faut-il s’étonner si La France juive trouva ses lecteurs les plus enthousiastes parmi ces « bons prêtres » que Drumont exhortait à « expliquer que la persécution religieuse n’est que la préface du complot organisé par la ruine de la France » ? Mais sans doute sa plus grande habileté fut-elle de « rajeunir la formule » (Barrés), en asseyant une partie de son argumentation sur les prestiges de la science. Tout son livre premier était consacré, sur la foi de sommités aussi peu cléricales que Littré et Renan, au contraste entre « le Sémite mercantile, cupide, intrigant, subtil, rusé » et « l’Aryen enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc, confiant jusqu’à la naïveté. Le Sémite est un terrien… l’Aryen est un fils du ciel (…) [Le Sémite] vend des lorgnettes ou fabrique des verres de lunettes comme Spinoza, mais il ne découvre pas d’étoiles dans l’immensité des cieux comme Lever-rier », et ainsi de suite. S’étant ainsi mis en règle avec la science de son siècle, Drumont, une centaine de pages plus loin, commençait à récrire à sa façon l’histoire de la France, évoquant les Juifs à travers les paroles ou les actes de Saint Louis et de Bossuet. En fin de compte, c’est surtout à ce syncrétisme théologico-raciste qu’on peut attribuer les triomphes de Dru-mont. Dans cette foulée, La Croix, une fois devenue ouvertement antisémite, opposait à la « race juive » non pas une race chrétienne, mais la « race franque », un autre jour elle écrivait « qu’en dehors de toute idée religieuse», il serait absurde de penser qu’un Juif puisse devenir un Français. En regard, l’abbé Lémann, un Juif converti, entendait assumer, avec une humilité plus que chrétienne, sa responsabilité de Juif pour le crime de la Crucifixion (« Oui, le bourreau méritait d’être réhabilité avant nous; car le bourreau ne fait mourir que les hommes, les coupables, et nous, nous avions fait mourir le Fils de Dieu, l’innocent ! »).
II va de soi que le thème juif devint à partir de 1886 un thème à la mode, un vrai filon pour les journalistes aussi bien que pour les romanciers. Au total, la production (p.293) antisémite française de la Belle Epoque se compte par des centaines, voire des milliers de titres. Certains propos peuvent donner l’impression que l’antisémitisme était en voie de devenir en France, vers 1890, une sorte de monopole catholique. En septembre 1890, La Croix se proclamait fièrement « le journal le plus antijuif de France » ; en mars 1891, le premier numéro d’une feuille éphémère qui s’intitula L’anti-Youtre déplorait que « jusqu’ici, les cléricaux seuls se sont attaqués à la juiverie », et au plus fort de l’affaire Dreyfus, Georges Clemenceau ne disait pas autre chose, en constatant que « l’antisémitisme n’est qu’un nouveau cléricalisme en train de reprendre l’avantage », A peu près à la même époque, un rédacteur de La Croix écrivait à son directeur, le P. Vincent de Bailly : « L’affaire de la juiverie passionne de nouveau tous les Chrétiens… Un grand nombre de semi-incrédules commencent à trouver qu’en France, il n’y a de vrais Français que les catholiques », constituant ainsi l’antisémitisme en attribut exclusif de la catholicité. Mais tous les catholiques ne pensaient pas ainsi, et surtout, l’antisémitisme laïque, scientiste et intégralement raciste, ne manquait pas de champions de son côté.
L’impérissable inspiration voltairienne, par exemple, est manifeste dans les très populaires écrits, si prisés par S. Freud, de l’essayiste et psychologue Gustave Le Bon : « Les Juifs n’ont possédé ni arts, ni sciences, ni industrie, ni rien de ce qui constitue une civilisation… Aucun peuple n’a laissé, d’ailleurs, de livre contenant des récits aussi obscènes que ceux que renferme la Bible à chaque pas. » Le philosophe matérialiste Jules Soury, l’ami et la caution scientifique de Maurice Barrés, s’exprimait pour sa part en termes plus matérialistes : « Faites élever un Juif dans une famille aryenne dès sa naissance (…) ni la nationalité ni le langage n’auront modifié un atome des cellules germinales de ce Juif, par conséquent de la structure et de la texture héréditaires de ses tissus et de ses organes. » Ce n’est pas pour rien que Soury croyait avoir découvert « le substratum cérébral des opérations rationnelles ». On peut citer aussi l’anthropologue illuminé Georges Vacher de Lapouge qui, redoutant l’extinction des Aryens, consignait en 1887 cette vision effectivement prophétique : «Je suis convaincu qu’au siècle prochain, on s’égorgera par milliers pour un ou deux degrés de plus ou de moins dans l’index céphalique… les derniers sentimentaux pourront (p.294) assister à de copieuses exterminations de peuples.» Dans la vie politique, le camp socialiste, tout en commençant sur le tard à se distancer d’une idéologie qui était en voie de devenir l’apanage de la bourgeoisie catholique, comptait encore dans ses rangs, vers 1900, c’est-à-dire au lendemain de l’affaire Dreyfus, des antisémites convaincus comme le médecin Albert Régnard ou le célèbre avocat belge Edmond Picard, tandis que René Vivian! ou Alexandre Millerand, par exemple, adoptaient une attitude ambiguë. Mais l’ambiguïté — ou ce que nous aurons tendance à qualifier rétrospectivement de ce nom — I paraissait régner à tous les niveaux : en 1892, Guesde et Lafargue eux-mêmes ne dédaignaient pas de se mesurer au cours d’une réunion contradictoire avec deux lieutenants de Drumont, et en janvier 1898 encore, le parti socialiste, sous les signatures de Jaurès, de Sembat et de Guesde, renvoyait dreyfusards et antidreyfusards dos à dos, en leurs qualités respectives d’opportunistes et de cléricaux : « Prolétaires, ne vous enrôlez dans aucun des clans de cette guerre civile bourgeoise ! » D’autres idéologues voulaient combiner, tout comme en Allemagne, socialisme et antisémitisme. Au début de 1890, il s’était formé à Paris, sous la présidence de Drumont, une « Ligue antisémitique nationale de France », dont le vice-président, Jacques de Biez, se qualifiait de « national-socialiste ». Ce mouvement descendit dans la rue et chercha à se prolétariser, avec pour animateur l’aventureux marquis de Mores, chef d’une bande de forts des Halles et de bouchers de la Villette. Comme en Allemagne, un groupe antisémite se constitua alors à la Chambre des députés : en novembre 1891, une proposition de loi tendant à l’expulsion générale des Juifs recueillit 32 voix. Comme en Allemagne, il se trouva des auteurs à entreprendre la démonstration de l’aryam’té de Jésus, que Jacques de Biez affiliait patriotiquement à la race celte. Et cependant l’antisémitisme français supporte mal la comparaison avec l’antisémitisme germanique.
(p.298) (…) Si Proust a ainsi cruellement mis à nu la psychologie de certains « Israélites », un artiste presque aussi grand que lui, Maurice Barrès, le premier maître à penser du général de Gaulle et de tant d’autres Français illustres, reste le meilleur témoin de la perception antisémite des Juifs, aux temps du Panama. A lire Barrès, on retrouve l’ambivalence des antisémites français, chez lesquels l’attirance ou même l’admiration sont si clairement perceptibles, derrière la haine. Dès 1890, il s’interrogeait sur « le caractère commun des intelligences juives » : « Le juif est un logicien incomparable. Ses raisonnements sont nets et impersonnels, comme un compte en banque (…) Ainsi échappent-ils à la plupart de nos causes d’erreurs. De là leur merveilleuse habileté à conduire leur vie… » Dans le même contexte, Barrés ne dissimulait pas son admiration pour Disraeli, et Léon Blum, qui le connut à l’époque, évoquait en 1935 « la grâce fière et charmante de son accueil, cette noblesse naturelle qui lui permettait de traiter en égal le débutant timide qui passait son seuil. Je suis sûr qu’il avait pour moi de l’amitié vraie… » Ce n’est que pendant l’affaire Dreyfus que Barrés fut atteint de la manie de persécution antisémite, qui empreint du début jusqu’à la fin son grand « Roman de l’Energie nationale » (1897-1902). Réunis dans le salon du baron de Reinach, les financiers juifs « sont le gouvernement de notre pays, auxquels nos ministres demandent de diriger dans l’ombre et sans responsabilités les finances de l’Etat » ; ils n’en sont pas moins des « laquais allemands », mais ces laquais « se mêlaient de négocier la France même ».
L’Affaire.
De bonne heure, nombre de fils de famille juifs s’étaient lancés à l’assaut des carrières militaires qui, en France, leur étaient ouvertes : dès 1880, ils étaient « proportionnellement » dix fois plus nombreux à l’Ecole polytechnique que les Chrétiens ; en ce qui concerne l’ensemble du corps des officiers, il comptait, en 1894, près de 1 p. 100 de Juifs (plus de 300 sur 40000), et Drumont s’indignait de voir que les Lévy y étaient déjà plus nombreux que les Martin. Aussi bien la toute première attaque de La Libre Parole, en mai 1892, visait-elle ces traîtres en puissance, un officier juif étant par définition « l’officier qui trafique sans pudeur des secrets de la défense nationale » (de là, la série des duels que nous avons mentionnés). Sans doute un grand nombre d’officiers catholiques partageaient-ils ce jugement, et sans doute le quotidien de Drumont n’avait-il pas complètement tort lorsqu’il ajoutait qu’il «existait chez l’énorme majorité des militaires un sentiment de répulsion instinctive contre les fils d’Israël ». La médiocre sympathie, si souvent relevée, qu’inspirait le capitaine Alfred Dreyfus à ses frères d’armes, doit être appréciée aussi à cette lumière-là, et sa façon de parler de son « cœur alsacien » (jamais de son « cœur juif ») n’y pouvait rien changer.
Il est vrai qu’en ce qui concerne la genèse policière du drame, « on ne pourrait, sans s’aventurer beaucoup, déterminer dans quelle mesure exacte le fait que Dreyfus fût juif fit pencher du mauvais côté la balance ». Mais on peut le faire à partir du moment où, en novembre 1894, elle commença à défrayer les journaux, et jusqu’à la fin. L’essentiel a été dit en deux mots par Théodore Herzl, qui, en sa qualité de journaliste, avait assisté au procès et à la dégradation : « Ils ne hurlaient pas « A bas Dreyfus ! » mais « A bas les Juifs ! » Mais s’ils, c’est-à-dire les Français pour une fois quasi unanimes, hurlaient de la sorte, c’est qu’ils étaient patriotiquement excités par l’ensemble de la presse, travaillée à cette fin par l’état-major, et qui par surcroît avait à se faire pardonner d’avoir été naguère (p.300) stipendiée par Reinach, Cornélius Herz et Arton, ces corrupteurs juifs. C’est seulement ainsi qu’on peut s’expliquer « l’extraordinaire intérêt passionnel » (Herzl) porté au procès. Peu nombreux étaient les contemporains à ne pas succomber à la frénésie antisémite de ces semaines. Citons parmi eux Saint-Genest, le chroniqueur militaire du Figaro : « Eh bien ! avant qu’on le juge, je déclare encore une fois que tout cela est fou. Dreyfus n’est rien, ce procès n’est rien. Ce qui est grave, c’est le spectacle que nous avons donné à l’Europe… »
(p.304) L’agitation antisémite en France ne prit nullement fin en été 1898, en même temps que les tumultes de l’Affaire, comme on est souvent porté à le croire. Sous ces rapports, l’année 1898 se laisse même considérer comme un point de départ tout comme un point d’arrivée. Certes, l’affaire Dreyfus fit éclore une génération nouvelle de témoins chrétiens, d’écrivains et de penseurs chez lesquels la justice rendue aux Juifs orienta désormais leur œuvre — et d’abord, Charles Péguy, le prophète qui, le premier en Europe, défendit, souvent contre les Juifs français eux-mêmes, « le droit d’Israël à la différence » (comme on le dirait de nos jours). Mais cette même année 1898 vit naître nombre d’organisations antisémites nouvelles, telles que la Ligue de la patrie française, présidée par le poète François Coppée, la Jeunesse nationale et antisémite, présidée par Drumont, et surtout L’Action française de Charles Maurras et Léon Daudet. Si le premier nommé devint le théoricien le plus écouté d’un nationalisme « intégral », auquel l’antisémitisme servit jusqu’à l’invasion nazie comme de pierre de touche, le second fut un polémiste particulièrement efficace, au « style charnel, olfactif », n’épargnant ni son ami Marcel Schwob, avec « son extrême laideur ethnique, boursouflée, ses grosses lèvres de jambon » ni les Juifs accusés de meurtre rituel en Russie, « animaux à face humaine qui oscillent avec monotonie de l’or à l’obscénité », et apercevant la main d’Israël même dans les dérèglements de la nature, tels que l’inondation parisienne de 1910. Sur ce dernier point, son argumentation reflète fort bien en quoi le style antisémite moderne différait du style médiéval. Pour le fanatique du Moyen Age, c’est sciemment que, par exemple, le Juif propageait la peste ; pour son émule moderne, sa spéculation sur le bois entraînait des déboisements, qui entraînaient les inondations : ainsi donc, dans le premier cas, le Juif était nocif délibérément et en vertu de son idéologie, dans le second, il pouvait l’être à son insu et en
1. L’Europe suicidaire, Calmann-Lévy, 1977, pp. 75-78.
(p.305) raison de sa nature — ce qui, du point de vue de la rationalité, n’était guère un progrès.
(p.306) /Clémenceau, essayiste en 1898/
Au pied du Sinaï, un recueil de nouvelles sur les Juifs de Galicie (qu’il avait eu l’occasion d’approcher lors de ses cures à Carlsbad). Certes, le poncif n’en est pas absent — « Ce qui domine à Busk, après le canard et l’oie, c’est le Juif crasseux (…) des nez crochus, des mains en griffes s’accrochant aux choses obscures, et ne les lâchant que contre monnaie sonnante. » Mais c’est l’admiration qui l’emporte, et de loin, pour « cette race énergique, partout répandue sur la terre, toujours combattue, toujours vivante (…) possédant le plus précieux trésor, le don de vouloir et de faire ». Pourtant, comment les Juifs employaient-ils ce capital ? A en entendre Clemenceau, grâce à lui, ils espéraient devenir les maîtres du monde : « Méprisé, haï, persécuté pour nous avoir imposé des dieux de son sang, [le Sémite] a voulu se reprendre et s’achever par la domination de la terre. » Sémite, ici, est synonyme de Juif ; ailleurs, sémitisme ou judaïsme désignent, chez Clemenceau, comme chez Karl Marx et tant d’autres, le règne de l’argent en général : « Le sémitisme, tel que nous en voyons présentement tant d’exemples chez les enfants de Sem et de Japhet… » Ailleurs encore, il se réclame de son idéalisme aryen pour déplorer la montée de l’endurante race. Mais, à sa manière, il conclut sur des paroles d’espoir : « II suffit d’amender les Chrétiens, encore maîtres du monde, pour n’avoir pas besoin d’exterminer les Juifs en vue de leur voler le trône d’opulence jusqu’ici convoité des hommes de tous les temps et de tous les lieux. » C’est sur cette note conciliante que s’achève Au pied du Sindi. Ainsi donc, tout comme un Wagner ou un Dostoïevski, encore que dans un esprit bien différent, Clemenceau admettait la proximité d’un « règne juif » ! Vingt ans plus tard, en automne 1917, il témoigna d’une autre façon des pouvoirs qu’il prêtait aux enfants d’Israël, puisqu’il accusait les Juifs allemands d’être à eux tout seuls les fauteurs de la Révolution et de la défection russes. Sans doute s’agissait-il d’une intoxication du 2e Bureau ou de quelque autre agence, comme on le verra plus loin.
Quelles conclusions tirer ? L’une serait banale : à savoir, qu’un très grand homme, traitant d’un très grand sujet (grande race tragique, écrivait encore Clemenceau), est porté à se contredire plus que quiconque. L’autre serait que jadis antisémitisme et sionisme n’étaient guère incompatibles, ainsi que l’attestent les propos ou les écrits de Martin Luther, de Fichte, de H. Stewart Chamberlain (p.307) ou de Drumont, pour ne citer que quelques antisémites majeurs. A la réflexion, la proposition se laisserait étendre à Clemenceau, qui n’intitula pas son recueil de nouvelles Au pied des Carpathes, ainsi que l’aurait commandé la géographie.
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981 (p.467) Surtout, depuis 1933, le spectre du martyr persécuté d’outre-Rhin vint s’adjoindre à celui du persécuteur-bourreau de Moscou, pour ouvrir des perspectives encore plus terribles. « Tout plutôt que la guerre ! » Or, était-il concevable que, menacé comme il l’était par Hitler, le Juif international ne s’emploie pas à provoquer une mobilisation générale ? Par conséquent, sus au Juif ! C’est ainsi qu’entre beaucoup d’autres choses se laisse comprendre la conversion publique à l’antisémitisme de Céline, après 1933. Certes faisant flèche de tout bois, Céline ne manquait pas de honnir les Juifs à l’aide d’arguments tant classiques — « une fois bien sûrs qu’ils vous possèdent jusqu’aux derniers leuco-blastes, alors ils se transforment en despotes, les pires arrogants culottés qu’on a jamais vus dans l’Histoire » — que modernes — « Kif à nos youtres, depuis que leur Bouddha Freud leur a livré les clés de l’âme. » Mais sa véritable terreur, l’ancien combattant et l’émule de Vacher de Lapouge la hurlait désormais comme suit : « Au point où nous en sommes de l’extrême péril racial, biologique, en pleine anarchie, cancérisation fumière, où nous enfonçons à vue d’œil, stagnants, ce qui demeure, ce qui subsiste de la population française devrait être pour tout réel patriote infiniment précieux, intangible, sacré. A préserver, à maintenir au prix de n’importe quelles bassesses, compromis, ruses, machinations, bluffs, tractations, crimes. Le résultat seul importe. On se fout du reste ! Raison d’Etat ! La plus sournoise, la plus astucieuse, la moins glorieuse, la moins flatteuse, mais qui nous évite une autre guerre. Rien ne coûte du moment qu’il s’agit de durer, de maintenir. Eviter la guerre par-dessus tout. La guerre pour nous, tels que nous sommes, c’est la fin de la musique, c’est la bascule définitive au charnier Juif. « Le même entêtement à résister à la guerre que déploient les Juifs à nous y précipiter. Ils sont animés, les Juifs, d’une ténacité atroce, talmudique, unanime, d’un esprit de suite infernal, et nous ne leur opposons que des mugissements épars. « Nous irons à la guerre des Juifs. Nous ne sommes bons qu’à mourir… »
(p.468) « Les Juifs ainsi définis réagissent tôt ou tard en Juifs, et renouent, même si c’est à leur corps défendant, leurs vieux liens (…) Une telle alliance, qui transcende toutes les frontières, sème des méfiances qui deviennent « aryennes », en vertu du contraste, et isolent à nouveau les Juifs ; tel est le cercle vicieux hitlérien 1. » Et au-delà de ces enchaînements psycho-historiques, la bourgeoisie, les nantis avaient d’autres motivations, d’autres peurs, que nous venons d’évoquer. Ainsi que l’écrivait François Mauriac peu avant de mourir, « la génération d’aujourd’hui ne saurait concevoir ce que la Russie soviétique de ces années-là et le Frente Popular de Madrid incarnaient pour la bourgeoisie française ». C’est dans ces conditions que se comblait rapidement la faille entre l’imaginaire et le réel. La « disparité » sur laquelle nous nous sommes interrogés prenait fin. L’agitation antijuive gagnait la rue, des meetings antisémites répondaient aux meetings antihitlériens. La société française, une seconde fois, sortit de sa réserve et, surtout lorsque le sang commença à couler outre-Pyrénées, oublia les conventions relatives aux Juifs. On vit alors La Croix, qui pourtant en 1927 avait abjuré l’antisémitisme, proposer sous la plume de son chroniqueur, Pierre l’Ermite, une explication simple de la guerre d’Espagne : « Les Espagnols avaient tout pour être heureux. Baignés d’azur, sans grands besoins, ils pouvaient rêver sous le soleil, vivre de leur industrie, se nourrir sur leur sol et jouer de la mandoline… « Un jour, soixante Juifs arrivent de Moscou. Ils sont chargés de montrer à ce peuple qu’il est très malheureux : « Si vous saviez comme on est mieux chez nous. » Et voici cette nation chevaleresque qui se met, pieds et poings liés, à la domesticité de la lointaine Russie, laquelle n’est pas de sa race… » On vit alors l’hebdomadaire Je suis partout, qui en 1930-1935 s’était tenu dans les limites de la décence, tourner effectivement au « Juif partout », publier deux numéros
1. Cf. L. poliakov, De l’Antisionisme à l’Antisémitisme, Paris, 1969, p. 57.
(p.469) spéciaux sur les Juifs qu’il fallut réimprimer, citer longuement Céline — « Nous le récitons, nous le clamons, nous en avons fait notre nouveau Baruch » — ; traiter Jacques Maritain de « souilleur de race », et même concéder quelque mérite à Staline, lors des grandes purges : « Pour cet homme du peuple brutal et fruste, la patrie a un sens, un sens qu’elle n’a jamais eu et qu’elle ne pourra jamais avoir pour les Trotski, les Radek et les Yagoda. » On vit Georges Bonnet, le ministre des Affaires étrangères, anticiper les discriminations raciales en infligeant un affront à ses collègues juifs Georges Mandel et Jean Zay, pour mieux faire honneur à Joachim von Ribbentrop. Le suicide de la IIIe République ayant été signifié de la sorte, on vit enfin un autre de ses collègues, mieux connu comme une gloire des lettres françaises, réclamer l’institution d’un ministère de la Race. Jean Giraudoux, car c’est de lui qu’il s’agissait, mettait en avant les considérations que voici : « [Les Juifs étrangers] apportent là où ils passent l’à-peu-près, l’action clandestine, la concussion, la corruption, et sont des menaces constantes à l’esprit de précision, de bonne foi, de perfection qui était celui de l’artisanat français. Horde qui s’arrange pour être déchue de ses droits nationaux et braver ainsi toutes les expulsions, et que sa constitution physique, précaire et anormale, amène par milliers dans les hôpitaux qu’elle encombre… » On voit que l’argument biologique de rigueur n’avait pas été oublié.
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
La solution finale
(p.492) Il convient maintenant de parler un langage simple et clair. Dès le printemps 1933, le gouvernement du IIIe Reich promulguait des lois qui excluaient les Juifs de la fonction publique et du barreau, et prenait des mesures démagogiquement spectaculaires, telles qu’une journée de boycott des commerces juifs, et les autodafés des livres d’auteurs juifs, sur les places publiques. Mais ce n’est qu’en été 1935, lorsque l’Allemagne et les pays étrangers aussi s’étaient pour ainsi dire accoutumés à l’idée d’une discrimination raciste au centre de l’Europe et que les facultés d’indignation s’étaient émoussées, que Hitler fit édicter les fameuses « lois de Nuremberg », qui instituaient de nouvelles barrières raciales, interdisant sous peine de prison, tant les mariages que les « rapports extra-maritaux » entre Juifs et « sujets de sang allemand ». C’était mettre les Juifs hors la loi, donnant force légale à des tabous sexuels, ces tabous que Hitler évoquait volontiers dans ses discours et dans ses écrits : « Le jeune Juif aux yeux noirs épie, pendant des heures, le visage illuminé d’une joie satanique, la jeune fille inconsciente du danger, qu’il souille de son sang… » (Mon Combat.)
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
Le cas particulier de la France
Dans les pays vaincus et occupés à l’Ouest — je me contenterai ici d’évoquer le cas de la France — les événements prirent d’abord un tout autre tour. Le souci de « correction » caractéristique pour les premiers mois de l’occupation interdisait les brutalités publiques, et plus généralement tout exhibitionnisme antisémite : d’ailleurs les Nazis espéraient que la France finirait par y voir clair d’elle-même ; en attendant, il s’agissait « d’éviter, dans ce domaine, la réaction du peuple français contre tout ce qui vient d’Allemagne », comme l’écrivait le capitaine SS Lischka, en poste à Paris. Il fallait donc que les mesures antijuives parussent bien françaises. Ce qui était faisable, puisqu’un climat fascisant régnait à l’époque parmi les dirigeants de « l’Etat français » du maréchal Pétain, pour une bonne part les héritiers ou les conservateurs des passions antidreyfusardes d’antan. C’est spontanément qu’ils prirent les premières mesures, qui du reste frappaient beaucoup plus durement les Juifs étrangers que les Juifs français — en ce sens, les hommes de Vichy furent plus xénophobes que vraiment racistes. Dès l’été 1940, des dizaines de milliers d’étrangers furent internés dans les camps de Gurs, de Rivesaltes, de Récébédou, etc., ou astreints à des travaux forcés dans des « compagnies de travailleurs », tandis que, en ce qui concerne les Juifs (p.497) français, le « Statut des Juifs » d’octobre 1940 se contentait pour commencer de les écarter de l’armée, de la fonction publique et de la presse et accordait même dans certains cas des exemptions. Les contradictions de l’antisémitisme vichyssois sont on ne peut mieux illustrées par cette brève correspondance :
Le 27 janvier 1941 « Monsieur le maréchal Pétain, Je lis dans un journal de la région : « En application de la loi du 3 décembre 1940, M. Peyrouton a révoqué (entre autres noms) Cahen, chef de cabinet de la Préfecture de la Côte-d’Or. » M. Peyrouton aurait dû se renseigner avant de prendre cette mesure ; il aurait appris que l’aspirant Jacques Cahen a été tué, le 20 mai, et inhumé à Abbeville. Il a suivi les glorieuses traditions de ses cousins, morts pour la France en 1914-1918, l’un comme chasseur alpin, l’autre comme officier au 7e génie, à l’âge de 24 et 25 ans, nos deux seuls fils et dont les mânes ont dû tressaillir d’horreur devant un pareil traitement. Agréez, etc. »
CABINET DU MARECHAL PETAIN Vichy, le 31 janvier 1941 « Madame, Le maréchal a lu la lettre que vous lui avez adressée au sujet de votre neveu. Il a été d’autant plus ému, que l’un de ses collaborateurs s’est trouvé avec M. J. Cahen le 20 mai 1940, quelques heures avant qu’il soit frappé. Le maréchal Pétain va demander à M. le Ministre de l’Intérieur de reconsidérer la mesure qu’il avait prise à rencontre de votre neveu. Veuillez agréer. Madame, mes hommages respectueux. » D’où l’on voit que, en ces temps-là, un Juif français pouvait même devenir un français à part entière — à condition d’être mort…
(p.504) Après les protestations de l’Eglise de France de l’été 1942, et a fortiori après la défaite de Stalingrad, au printemps 1943, le double jeu, à tous les niveaux, des politiciens et des fonctionnaires, conduisit les hommes d’Eichmann à désespérer de l’aide de l’administration et de la police française, dans la zone occupée également *. C’est pourquoi, en partie du moins, le nombre des Juifs qui périrent dans les chambres à gaz demeura inférieur à cent mille, dans le cas français.
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
(p.517) Mais revenons au camp d’Auschwitz. Les sursitaires juifs y connurent des destinées diverses, puisque d’une manière générale, la société concentrationnaire était singulièrement hiérarchisée, de sorte que certains détenus, en fonction de leur ancienneté et de leur origine, mais surtout de leur entregent et de leur flair, parvenaient à se hisser à des postes d’un grand pouvoir. Ces kapos étaient le plus souvent des vieux routiers allemands, transférés des camps remontant aux premières années du IIIe Reich. Ils devenaient de la sorte des rouages du système SS, et en acquéraient d’ordinaire, en vertu d’un mimétisme à la longue quasiment inévitable, les caractères typiques, la brutalité, le vocabulaire, l’allure générale, et d’une certaine façon la mise, à commencer par les bottes.
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
(p.518) Avant la guerre, Gandhi avait adressé un appel aux Juifs d’Allemagne, leur conseillant la non-violence.
|
|
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981
Ainsi, le professeur Georges-François Dreyfus, de l’université de Strasbourg, écrivait en janvier 1988 : « Quant à l’idée de la solution finale, elle n’apparaît véritablement que dans la seconde moitié de 1941 : c’est-à-dire après que les services allemands aient mis la main sur les archives de Smolensk. Et ils pouvaient y découvrir que l’URSS avait exterminé ses adversaires par centaines de milliers sans que personne dans le monde y trouve à redire. » (La Presse française, 8 janvier 1988, p. 3).
|
|
|
|
Léon Poliakov, Le mythe aryen, éd. Calmann-Lévy, 1971
(p.27) /des/ événements semi-légendaires connus dans les langues sous le nom d’ « invasions barbares » mais que la langue allemande – la nuance ne laisse pas d’être significative – qualifie de « migrations de peuple » (Völkerwanderungen).
(p.31) Telle est la puissance du mythe franc sous cette forme carolingienne, que dans les langues slaves, roi se dit « korol » ou « kral », c’est-à-dire se dérive à partir du nom germanique de Karl (ainsi, si le Slave est l’« esclave » des langues occidentales, l’empereur occidental est le « roi » des langues slaves), Napoléon, pour mieux asseoir son « Premier Empire », se pose en successeur de Charlemagne (certains de ses décrets débutaient par la formule : «Attendu que Charlemagne, notre prédécesseur…»). (p.32) Grandeur dynastique, grandeur royale: tout près de chez nous, Charles de Gaulle n’invoquait-il pas en Allemagne le mythe de Charlemagne le géant, aux fins de sa politique de grandeur française?
(p.144) contentons-nous de citer Diderot, peut-être la meilleure tête française de son temps, pour lequel « les lois morales sont les mêmes partout2 » — un signifiant typique des Lumières, et dont le signifié pourrait en définitive se transcrire « la raison du plus fort est toujours la meilleure » — car la Raison dite universelle européenne était, les dictionnaires nous le disent bien, à la fois juge et partie, sentence sans appel et plaidoirie contraignante, lourde de menaces sous-entendues…
La partialité de cette Raison fut d’autant plus lourde de conséquences que des conceptions préracistes risquaient également de se laisser induire des nouvelles méthodes scientifiques-expérimentales. Qui dit expérience dit observation, mais aussi instrument, loupe, scalpel ou balance; avant l’élaboration de la méthode psychanalytique, la science positive n’explorait de l’homme que ce qui était en lui tangible, mesurable ou pondérable, et c’est dans ce cadre que les savants étaient facilement conduits à postuler, à partir des caractères physiques, les seuls qui leur fussent accessibles, des caractères mentaux ou moraux, et à spiritualiser de la sorte, à leur insu et souvent malgré leur matérialisme, la forme des crânes et la couleur des épidermes. Il va de soi que ces errements étaient eux aussi (p.145) imposés, au-delà de la nécessité ou de la limitation scientifique, par une option philosophique. C’est Voltaire qui, dans son Traité de Métaphysique, en énonçait un principe général : « Quand nous ne pouvons nous aider du compas des mathématiques ni du flambeau de l’expérience et de la physique, il est certain que nous ne pouvons faire un seul pas. »
(p.151) L’ANTHROPOLOGIE DES LUMIERES
(p.166) Il n’est pas difficile de trouver le pendant ou le reflet des vues de Buffon chez des auteurs aussi idylliques — ou aussi idéalisés — que Bernardin de Saint-Pierre, qui invoquait, à propos des Noirs, la malédiction de Chain \ ou que l’anti-esclavagiste abbé Raynal, chez lequel « le sang nègre se mêle peut-être à tous les levains qui altèrent, corrompent et détruisent notre population ». C’est à peine si l’article « Nègres » de la célèbre Encyclopédie de Diderot et d’Alembert manifeste plus de bienveillance3. Quant à Diderot lui-même, il lui arrivait de proclamer la supériorité blanche par la bouche de son « bon sauvage » tahitien, et de philosopher comme suit sur la race inférieure des Lapons : « Qui sait si ce bipède informe, qui n’a que quatre pieds de hauteur, qu’on appelle encore dans les voisinages du pôle un homme et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n’est pas l’image d’une espèce qui passe?» D’autres auteurs, notamment Voltaire, dont C’est ainsi que certains des champions les plus écoutés des Lumières posaient les fondements du racisme scientifique du siècle suivant.
3. Non seulement leur couleur les distingue, mais ils diffèrent des autres hommes par tous les traits de leur visage, des nez larges et plats, des grosses lèvres et de la laine au lieu de cheveux, paraissant constituer une nouvelle espèce d’hommes. Si on s’éloigne de l’équateur vers le pôle antarctique, le noir s’éclaircit, mais la laideur demeure : on trouve également ce vilain peuple qui habite la pointe méridionale de l’Afrique (…) Si par hasard on rencontre d’honnêtes gens parmi les Nègres de la Guinée (le plus grand nombre sont toujours vicieux), ils sont pour la plupart enclins au libertinage, à la vengeance, au vol et au mensonge. Leur opiniâtreté est telle qu’ils n’avouent jamais leur faute, quelque châtiment on leur fasse subir; la crainte même de la mort ne les émeut pas. »
(p.170) « Les Palestiniens qui vivent parmi nous ont la réputation fort justifiée d’être des escrocs, à cause de l’esprit d’usure qui règne parmi la majeure partie d’entre eux. Il est vrai qu’il est étrange de se représenter une nation d’escrocs; mais il est tout aussi étrange de se représenter une nation de commerçants, dont la partie de loin la plus importante, reliée par une ancienne superstition, reconnue par l’État où ils vivent, ne recherchent pas l’honneur bourgeois, et veulent compenser cette défaillance par l’avantage de tromper le peuple qui leur accorde sa protection ou même de se tromper les uns les autres. Mais une nation qui n’est composée que de commerçants, c’est-à-dire de membres non productifs de la société, ne peut être autre chose que cela… » (in: Vermische Schriften, KANT)
(p.173 ) LES ANTHROPOLOGUES EXTRÉMISTES (LE POLYGÉNISME)
La doctrine de l’unité du genre humain, contestée dès les temps préchrétiens pour des raisons cabalistiques ou philosophiques, fut combattue au siècle des Lumières au nom de considérations qui se voulaient scientifiques : mais la ligne exacte de partage est malaisée à tracer. L’un des premiers adeptes du « polygénisme », le médecin anglais John Atkins (1685-1757), convenait lui-même d’une « hétérodoxie » qu’on peut croire plutôt religieuse : « Bien que cela soit un peu hétérodoxe, je suis convaincu que les races blanche et noire descendent, ab origine, de premiers parents de couleur différente », écrivait-il4. Atkins pensait également que la * race noire pouvait se croiser avec la race simiesque, pour enfanter des hybrides infertiles, semblables en cela aux mulets. Peu après, cette doctrine trouvait un champion formidable, en la personne de Voltaire. (p.174) Pour l’historien, le paradoxe ou l’énigme présentés par Voltaire est qu’il demeure dans la mémoire des hommes le prince des apôtres de la tolérance, en dépit d’un impitoyable exclusivisme qu’on ne saurait qualifier autrement que de raciste, et dont ses écrits témoignent autant que sa vie. En ce qui concerne les hommes de couleur, il révélait lui-même, dès sa première attaque, l’une des clés de sa passion. Ouoiqu’en dise « un homme vêtu d’une longue soutane noire, écrivait-il dans son Traité de métaphysique (1734), les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crins, et les hommes sans barbe, ne viennent pas du même homme ». L’ancien élève des jésuites s’insurgeait donc contre l’enseignement qu’il avait reçu; mais il se conformait à la vue commune en plaçant les Noirs tout au bas de l’échelle : les Blancs étaient « supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres », écrivait-il un peu plus loin x. Vingt ans plus tard, Voltaire développait sa vision anthropologique dans son célèbre Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Après avoir posé qu’il « n’est permis qu’à un aveugle de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos… sont des races entièrement différentes», il appliquait spécifiquement aux Nègres l’épithète « d’animaux »; puis, se référant aux auteurs anciens, il parlait des « espèces monstrueuses (qui) ont pu naître de ces amours abominables », entendant par là les accouplements entre singes et Négresses. Plus loin, l’existence du Nouveau Monde lui fournissait d’autres arguments en faveur du polygénisme, et le polygénisme à son tour lui permettait de proposer des justifications « naturelles » à l’esclavage. L’édifice anthropologique de Voltaire est couronné dans le chapitre traitant de l’Inde, à laquelle il attribue une ancienneté ou une priorité qui lui permet de démystifier à loisir l’enseignement judéo- chrétien, en jouant notamment sur les étymologies : Adam ne vient-il pas d’Adimo, et Abraham, de Brama ? C’est dans ce chapitre que ses éditeurs posthumes (probablement Condorcet) se sentirent obligés d’insérer une assez longue note rectificative, pour dire qu’entre monogénisme et polygénisme, il était impossible à un auteur sérieux de trancher B. Pour sa propre part, Voltaire s’en tint à des procédés polémiques de ce genre jusqu’à la fin de ses (p.175) j0urs, qu’il s’agisse des attaques antijuives de son célèbre Dictionnaire -philosophique (1764), ou des pointes antijésuites de la Défense démon oncle (1767), où, traitant « Des hommes de différentes couleurs », il s’en prenait notamment au Père Lafitau. Si aucun homme n’en a fait autant que Voltaire pour démolir les idoles et les préjugés du passé, nul n’a autant propagé et amplifié les aberrations du nouvel âge de la science.
(p.180) Une recherche plus approfondie que la nôtre montrerait peut-être qu’au lendemain de 1815, les extrémistes des théories raciales en France se recrutaient parmi les bonapartistes plutôt que parmi les partisans des Bourbons. De ce point de vue, il serait intéressant de comparer entre elles plus systématiquement que nous ne saurions le faire, deux grandes encyclopédies de sciences naturelles, publiées toutes les deux à partir de 1816 à Paris. L’une, le Dictionnaire des sciences naturelles, était dirigée par le baron de Cuvier (personnage hautement officiel), assisté de « plusieurs naturalistes du Jardin du Roi »; l’autre, le Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, par Jean-Joseph Virey (qui venait de démissionner de l’armée), assisté d’une « société de naturalistes et d’agriculteurs ». Certes, à l’article « Homme », les races de couleur se trouvaient malmenées dans l’un comme dans l’autre, mais au ton relativement mesuré du comte de Lacépède dans la première encyclopédie s’opposaient les outrances de la seconde, où on retrouvait, sous la signature de Virey lui-même, les fables relatives au commerce amoureux des Nègres avec les singes, à leur sang et à leur cerveau noirs, et ainsi de suite. Pour mieux marquer que le Noir n’était pas un homme, Virey avançait, entre autres arguments, celui du pediculus nigritarum. « Ajoutons une induction, qui n’est pas sans importance, et qui m’a été communiquée par notre savant entomologiste Latreille; savoir que comme chaque espèce de mammifère, d’oiseau, etc., a souvent ses insectes parasites, qu’on ne trouve que pour elle seule, il en est de même du nègre; il a son pou qui est tout différent de celui du blanc. Le pediculus nigritarum (Fabricius, Syst. antl., Brunsw. 1805, p. 340) a la tête triangulaire, le corps rugueux et une couleur noire, ainsi que le nègre…
(p.248) Hegel décrivait les races de couleur, les Noirs notamment, d’une manière qui suggérait invinciblement l’idée d’une infériorité congénitale. « Le nègre représente l’homme naturel dans toute sa sauvagerie, écrivait-il; il faut faire abstraction de tout respect et de toute moralité si on veut le comprendre; on ne peut rien trouver dans son caractère qui rappelle l’homme. » Il ne fallait pas chercher loin les preuves de l’indignité du nègre : « C’est considéré comme une chose permise de manger de la chair humaine… l’immortalité de l’âme est ignorée… » (…) (p.249) Hegel en venait à invoquer, à mots à peine couverts, la pureté du sang germanique. « La pure intériorité de la nation germanique, écrivait-il, a été le terrain véritablement propre à l’affranchissement de l’esprit; les nations latines, au contraire, ont au plus profond de leur âme, dans la conscience de l’esprit, conservé la division; issues du mélange du sang romain et du sang germanique, elles gardent toujours encore en elles-mêmes cette hétérogénéité. » L’idée se trouvait ensuite reprise dans un langage plus typiquement hégélien : « Chez les peuples latins se manifeste aussitôt la scission, l’attachement à un abstrait, et par suite nullement cette totalité de l’esprit, du sentir, que nous appelons âme, cette méditation de l’esprit sur lui-même en soi — mais au plus profond d’eux-mêmes, ils sont hors d’eux-mêmes … » Ce jugement sur les « Welches » se laisse mettre en rapport avec les écrits de jeunesse de Hegel, qui font pénétrer dans un curieux univers mystique2. Les condamnations, d’une férocité parfois inouïe 3 qu’il porte dans ces Theologische Jugendschriften contre le peuple juif, y enrobent un passage où il en vient à déplorer l’oubli par les Allemands de leurs propres traditions et légendes.
(p.251) On en arrive au cas instructif de Karl Marx et Friedrich Engels, qui voulurent replacer l’hégélianisme « sur ses pieds ». On respire aussitôt un autre air; et pourtant, les fondateurs du socialisme scientifique ne pouvaient faire autrement que situer les « civilisés », moralement et intellectuellement, au-dessus des « sauvages », précisément parce qu’ils se pliaient au verdict pratique de la science de leur époque. Au surplus, ils ne tiraient pas respectivement les mêmes conclusions de cette science, ce qui les amenait à l’occasion à polémiquer entre eux; de ce fait, leur cas devient doublement instructif. Pour Engels comme pour Marx, il était entendu que la race blanche, porteuse du progrès, était plus douée que les autres races. Dans sa Dialectique de la Nature, par exemple, Engels écrivait que « les sauvages les plus inférieurs » pouvaient retomber dans « un état assez proche de celui de l’animal »; plus loin, un raisonnement plus précis, au cours duquel il se référait à Hegel et à Lamarck, lui faisait conclure que les Noirs étaient congénitalement incapables (p.252) de comprendre les mathématiques.
(p.256) L’exaltation patriotique des guerres napoléoniennes, la glorification de la langue, de la religion ou du sang des Germains, trouvait son terrain le plus favorable dans les universités, et dans les milieux révolutionnaires, qui rêvaient d’une Allemagne unifiée, dont seraient exclus les allogènes, c’est-à-dire les Welches et les Juifs, déjà boycottés par la plupart des corporations estudiantines. (…) . De ce fait, de nombreuses voix réclamèrent, (p.257) tout au long du XIXe siècle, le retrait des droits civiques aux Juifs. La querelle, qui fit surtout rage en 1815-1830, faisait pendant à sa manière à la querelle française des deux races; comme cette dernière, elle avait des soubassements (ou des prétextes) d’ordre économique. Si, en France, la « force pécuniaire », selon Saint-Simon, était détenue par les Gaulois, un chœur de voix s’élevait en Allemagne pour déplorer la mainmise des Juifs sur cette force, et en ce sens, Karl Marx, dans sa Question juive, ne faisait que refléter une opinion largement répandue.
(p.279) Donnons maintenant la parole au principal champion des Francs dolicho-blonds, Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), qui augurait fort mal de l’avenir de la patrie : « Le trouble des idées est profond. La faillite de la Révolution est éclatante (…) Celle-ci a été avant tout la substitution du brachycéphale au dolicho-blond dans la possession du pouvoir… Par la Révolution, le brachycéphale a conquis le pouvoir, et par une évolution démocratique, ce pouvoir tend à se concentrer dans les classes inférieures, les plus brachycéphales… L’Aryen tel que je l’ai défini est tout autre, c’est l’Homo Europaeus, une race qui a fait la grandeur de la France, et qui est aujourd’hui rare chez nous et presque éteinte 2. » Faut-il préciser que Lapouge expliquait par l’extinction des Aryens tous les malheurs de la France? Au fil des années, sa craniologie, qu’il appela anthroposociologie, se faisait plus cruelle : « C’est déjà un fait grave que de nos jours la malédiction de l’indice fasse des brachycéphales, de toutes les races brachycéphales, des esclaves nés, à la recherche de maîtres quand ils ont perdu les leurs, instinct commun seulement aux brachycéphales et aux chiens. C’est un fait très grave que partout où ils existent, ils vivent sous la domination des dolicho-blonds, et à défaut d’Aryens, sous celle des Chinois et des Juifs… » « Les ancêtres de l’Aryen cultivaient le blé, continuait Lapouge, alors que ceux du brachycéphale vivaient encore probablement comme des singes 4. » Mais s’il délirait, son délire même lui faisait Prophétiquement pressentir d’autres délires, à l’échelle planétaire cette fois : « Le conflit des races commence ouvertement, dans les (p.280) nations et entre les nations, et l’on se demande si les idées de fraternité, d’égalité des hommes n’allaient pas contre les lois de la nature (…) Je suis convaincu qu’au siècle prochain, on s’égorgera par millions pour un ou deux degrés en plus ou en moins dans l’indice céphalique. C’est à ce signe remplaçant le shiboleth biblique et les affinités linguistiques que se feront les reconnaissances… les derniers sentimentaux pourront assister à de copieuses exterminations de peuples. »
(p.285) On pourrait citer aussi, dans le cas de la science française, l’esprit original que fut Gustave Le Bon. Ses diatribes antijuives manquaient pourtant complètement d’originalité, en ce sens que tout ce qu’il disait avait déjà été dit, et avec davantage de brio, par Voltaire — au terme près d’Aryen. Il a été souvent observé que l’antisémitisme français servit de dérivatif à l’humiliation nationale de 1871. En 1883, un banal article du Figaro illustrait remarquablement ce mécanisme. Son auteur, René Lagrange, entreprenait d’évoquer l’entrée triomphale des troupes prussiennes à Paris. Loin d’en contester 1’ « aryanisme », il paraissait rendre hommage, en les décrivant, aux mânes de Clovis et de ses compagnons : « Ils portaient pour la plupart, l’uniforme brillant des cuirassiers. Coiffés de casques dont le cimier portait des animaux chimériques, revêtus de cuirasses ornées d’armoiries en relief ou d’écussons en métal, ces cavaliers étincelaient sous les premiers rayons d’un soleil de mars. La physionomie de ces soudards aristocratiques était en harmonie avec leurs mâles armures. (…) » (p.286) Ses ressentiments de vaincu, René Lagrange les manifestait un peu plus loin, dans sa description : « Ce groupe militaire était immédiatement suivi d’un autre, mais civil, celui-là. Le second groupe était, assurément, plus curieux encore que le premier. Derrière ces Centaures tout bardés de fer et étincelants d’acier, s’avançaient, enfourchés sur leurs chevaux comme des pincettes, des personnages bizarres vêtus de longues houppelandes brunes et ouatées. Mines allongées, lunettes d’or, cheveux longs, barbes rousses et sales, vermiculées en tire-bouchons, chapeaux à larges bords, c’étaient autant de banquiers israélites, autant d’Isaac Laquedem, suivant l’armée allemande comme les vautours. A cet accoutrement, il n’était pas difficile de reconnaître leur profession. C’étaient, évidemment, les comptables ou financiers juifs chargés de l’encaissement de nos milliards… »
(p.296) L’école de Paris s’en tenait plus classiquement à la physiologie; et son célèbre chef, le docteur J.-M. Charcot (1825-1893) en vint à penser que les Juifs étaient racialement prédisposés à la « névropathie » des voyages ou du nomadisme; le légendaire Juif errant ne faisait que typifier ce « besoin irrésistible de se déplacer, de voyager sans pouvoir se fixer nulle part ». En conséquence, Charcot chargeait l’un de ses assistants, le docteur Henry Meige, d’étudier systématiquement et sous sa direction le phénomène du Juif Errant. (p.297) Dans sa thèse de doctorat, le docteur Meige qualifiait celui-ci de « prototype des Israélites névropathes pérégrinant à travers je monde ». « N’oublions pas, continuait-il, qu’ils sont Juifs, et qu’il est dans le caractère de leur race de se déplacer… » Décrivant ensuite les cas cliniques observés par lui et ses confrères, il cherchait à distinguer entre ce terrain caractériel et l’étiologie : « Quelles ont été les causes occasionnelles de cette maladie du voyage? Des traumatismes comme dans le cas de K… Des émotions violentes comme chez S… C’est l’étiologie même de leurs attaques. N’est-ce pas à la suite d’une émotion violente, la vue de Jésus-Christ sous la torture du calvaire, que Cartophilus s’enfuit de sa demeure et se mit à pérégriner? »
(p.321-322) LA MYSTIQUE ARYENNE
(…) L’exégèse théologique s’ingéniait à solliciter à cet effet la Bible, et plus spécialement la malédiction de Cham; du reste, à l’apogée de l’européocentrisme racial, c’est-à-dire dans la seconde moitié du XIXe siècle, le concile du Vatican lui aussi refusait de lever cet anathème, et le cardinal Lavigerie, l’apôtre de l’anti-esclavagisme, pensait que seule la conversion de la race noire lui permettrait d’y échapper. Il reste que le sectarisme protestant permettait de s’engager infiniment plus loin dans les théologies de ce genre.
(p.331) l’œuvre de Marcel Proust, (…) wagnérien, contient maint témoignage et (…) est illustrée par un discours d’Alfred Naquet, devant la Chambre des Députés : « Moi qui suis Juif et non antisémite, je crois… qu’il y avait chez les Juifs, relativement à la race aryenne, une infériorité… Il y a eu, par rapport aux Juifs, une fécondation intellectuelle par l’Aryen… » (1895). (NB La conduite et les déconvenues du « Juif honteux » Albert Bloch, dans la ‘Recherche du temps perdu’, sont particulièrement instructives à cet égard.)
|
|
|
|
Sternhell Zeev, (prof. à l’Univ. hébraïque de Jérusalem), « Le Pen, avatar de la droite nationaliste », LS 25/04/2002
Auteur de « Naissance de l’idéologie fasciste » (Folio-Gallimard), il affirme dans ses travaux que la France fut le berceau du fascisme, né du mariage entre révisionnisme marxiste et droite nationaliste radicale.
|
|
|
|
Bernard-Henry Lévy, L’idéologie française, éd. Grasset, 1981
La France aux Français
(p.44) Quelle autre explication d’ ailleurs à la cascade de ralliements qui, très tôt, viendront grossir les rangs du Maréchal de recrues inattendues ? Je pense à un Gaston Bergery, créateur en 1933 du » Front commun antifasciste », et qui invite maintenant à reconstruire la France de haut en bas, » sur les ruines » de la république. A un Frossard, ce vétéran du socialisme qui alla jadis à Moscou et en revint avec les statuts du P.C.F. avant de s’en retourner sagement dans le giron de la » vieille maison « , et qui inonde à présent le très pétainiste Mot d’ordre, à Marseille, de vibrants éditoriaux. A un Spinasse, ex-ministre de Blum, plus fier que jamais de son passé » de militant, de député, de ministre de 36 » et dont le journal, quatre ans plus tard, proclame que » la révolution est impossible sans un État autoritaire et populaire ». A un Marcel Déat même, ministre en 1936 lui aussi, éditeur des œuvres de Proudhon en 1933, et qui annonce maintenant que » la France se couvrira s’il le faut de camps de concentration « , que » les pelotons d’exécution y fonctionneront en permanence « , car » l’ enfantement d’un nouveau régime se fait aux forceps et dans la douleur ». A d’autres, tant d’autres encore qui, jusque dans les rangs du Parti communiste – (…) (p.45) qui n’hésitent pas une seule seconde à adhérer de toute leur âme à l’utopie qu’on leur propose. (…) ils n’ auront aucun mal, tous ces hommes, à retourner leurs poches vides et à prouver qu’ils ont agi d’un bout à l’autre par « idéal ». Inertie alors ? lassitude ? C’est de la démocratie qu’ elle était lasse, cette cohorte de néos, de planistes, de futuristes, d’hommes de gauche, qui piaffent d’impatience devant le grand champ de débris qu’il leur appartient de relever. Non, ce n’ est pas le coeur serré que ces politiques-là ont continué le combat : c’ est dans la ferme conviction, plutôt, que le fascisme français est une déviation du socialisme.
Plus net encore : le cas des syndicats et de l’allégeance d’une partie d’entre eux au pétainisme triomphant. S’ est-on jamais demandé par quel mystère un Lagardelle, héritier de Georges Sorel et du syndicalisme révolutionnaire, a pu finir dans le fauteuil d’un ministre du Marécha1 ? Yvetot, l’un des plus dignes survivants des luttes ouvrières du début du siècle, dans la peau d’une victime des bombes anglaises, enterré avec les honneurs et la fanfare de la Wehrmacht ? Charles Dhooges, l’anarchiste, l’insoumis, l’habitué des tribunaux et des prisons de l’ avant-guerre, dans le rôle d’un propagandiste du S.T.O. qualifié d’ « oeuvre de justice sociale » ? Dumoulin, l’ ami de Monatte, l’ adversaire de l’union sacrée en l4, le vétéran incontesté de l’ anarcho-syndicalisme à ses débuts, dans celui d’un flic, d’un délateur signalant à la Gestapo la « position raciale » des « juifs Guigui et Buisson » ? Là non plus, pas de rupture : tous ces hommes ne manquent jamais, à la fin du mois de mai, d’ aller se recueillir au mur des Fédérés où ils célèbrent en silence la mémoire (p.46) de la Commune. Peu ou pas de corruption : race à un vieux soldat qui renonce à sa retraite (sic) pour leur faire don de sa personne, les travailleurs de France ont à coeur, disent-ils, de renvoyer d’ eux-mêmes l’image la plus probe et la plus digne de l’illustre exemple. Encore moins d’adhésion subie, attentiste, passive, comme on l’a dit : cette collaboration où ils s’engagent, ils tiennent au contraire à rappeler que ce sont eux, après tout, les syndicalistes, qui l’ ont inventée et baptisée avec les articles de René Belin, publiés à l’hiver 1938, et intitulés justement Propos sur la collaboration.
(p.47) On connaît mieux, en revanche, le renfort que, très tôt aussi, apportèrent un certain nombre d’intellectuels. Faut-il rappeler par exemple l’ode vibrante de Paul Claudel à la gloire du Maréchal ? Celle de Valéry, en 1944, qui, trouvant à peine ses mots pour dire « le sentiment de vénération et de reconnaissance » qui l’ étreint, conclut, à bout de souffle, que ce n’ est pas un poème mais un « marbre qu’il faudrait tailler » ? La joie infâme des Brasillach, des Céline, des Drieu qui, même s’ils ne goûtent guère, on le verra, le style de Vichy, n’ en saluent pas moins, avec lui, l’ effondrement sans retour de la démocratie ? Les joies plus troubles et masochistes qu’ avoueront tels ou tels autres à se plier aux douces rigueurs de la censure, aux délices inconnues du crayon bleu, pourvoyeur de pensée ferme, propre et virile ? L’émoi de Gide encore, à peine remis pourtant de son « retour de l’U.R.S.S. », quand, dans un soupir d’aise, il évoque l’exquise violence d’« une dictature qui, seule, je le crains, nous sauvera de la décomposition » ? Cette histoire-ci, hélas, il n’est plus nécessaire de la conter. Elle figure en toutes lettres dans les oeuvres complètes de nos écrivains. Mais il y a une chose, tout de même, qui vaut d’ être soulignée : collabos (p.48) mous ou enragés, pétainistes d’une heure ou de quatre ans, ils ont tous ceci de commun d’ avoir joui, dans l’ abjection, de l’ ordre nouveau qu’ elle instaurait. Et quand un Emmanuel Mounier déclare que « la France s’est suffisamment confessée, mes amis », qu’il n’est plus temps de s’ attarder » dans une mauvaise conscience morbide » et qu’il n’ est plus question surtout de » s’ écarter de l’ aventure vivante que vient maintenant inaugurer » le régime du Maréchal, – il est bien au coeur du délire. Infiniment loin de la pénitence et des mea-culpa moroses. A mille lieues de l’image convenue d’ un pays découragé. Et tout près, au contraire, de l’exaltation devant cette grande révolution culturelle et populaire que lui propose l’ époque et dont il lui appartient, pense-t-il, de relever le défi…
(p.58) De là aussi – et c’est bien entendu essentiel – qu’aucune pression allemande n’ explique ni ne justifie les lois les plus scélérates qu’ à peine venu aux affaires décrète le Marécha1. C’est souverainement par exemple qu’il décide le 7 août d’ enfermer en camps de concentration tous les étrangers mâles, de dix-huit à quarante-cinq ans, inutiles à l’ économie nationale. Sans la moindre sollicitation que, dès le 22 juillet, Raphaël Alibert, garde des Sceaux, décide de réviser toutes les naturalisations issues de la loi de 1927. En toute liberté, dans une hâte étrange, que rien ni personne n’ exige, qu’ on abroge, le 27 août, la loi anti-raciste de 1939 pénalisant les outrances antisémites dans la presse. Et c’ est au nom de la France enfin, alors qu’ aucune demande allemande ne s’ est encore manifestée, que, dès le 3 octobre, quelques mois à peine après son sacre, Pétain édicte le statut des juifs qui suffira bientôt à envoyer des milliers de Français vers les fours crématoires d’ Auschwitz. Oui, la France c’est aussi ce pays-là. Le pays d’un État français dont l’un des premiers gestes est d’ épurer sa race. Un pays de vieille tradition humaniste où de très humanistes fonctionnaires s’empressent, de leur propre chef, de ficher et d’ enfermer des hommes, des femmes et des enfants juifs. Un pays sans gauleiter, je l’ ai dit, mais où un maréchal de France fait mieux et plus vite que les gauleiters . devançant les exigences allemandes, comblant comme par avance les désirs de la machine allemande, Pétain fait la politique de Pétain et demeure, autrement dit, seul comptable de son ignominie.
Dira-t-on qu’ en agissant ainsi il faisait l’ économie, précisément, de la brutalité d’un gauleiter? Qu’ en s’ empressant de la sorte, il se salissait certes les mains mais évitait, du coup, » le pire » ? On l’ a dit, effectivement. (p.59) Mais c’ est une ignominie de plus. Qui ne tient pas, elle non plus, à la moindre analyse des faits… Il n’ évite pas le pire, en effet, ce statut promulgué par Vichy et qui, définissant le juif par un critère racial (« Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive »), va au-delà des textes allemands applicables en zone occupée et qui se fondaient, eux, sur la confession religieuse. Elle n’ évite pas le pire, cette innombrable législation antisémite, constamment, pieusement, presque amoureusement remise sur le métier et qui apparaît plus sévère, au bout du compte, que celle de tels satellites du Reich, comme la Hongrie ou la Slovaquie, où ne sont tenues pour juives que les personnes explicitement inscrites à une communauté religieuse. Il n’ évite pas le pire, non plus, le très français Pierre LavaI quand, préparant avec l’ Allemand Dannecker la rafle de juillet 1942, il propose spontanément, à la stupéfaction de son interlocuteur, avant même, là encore, que la moindre sollicitation se soit exprimée en ce sens, « d’y comprendre également les enfants âgés de moins de seize ans », attendu que « la question des enfants juifs restant en zone occupée ne l’intéresse pas ». Il n’évite toujours pas le pire, Louis Darquier de Pellepoix, dont l’ Allemand Knochen, pourtant orfèvre en la matière, note que « dès son arrivée » au commissariat général aux Affaires juives, il fit, lui aussi, « de l’ excès de zèle, allant au-devant de nos désirs et pratiquant à l’ occasion la surenchère »9. Les juifs, d’ ailleurs, ne s’y trompent pas qui, aux heures les plus sombres de la sombre chasse à l’homme, sans recours désormais contre la meute française à leurs trousses, ne trouveront parfois le salut qu’en allant se jeter dans les bras de la police mussolinienne : et on vit alors à Valence, à Annecy, à Chambéry ce singulier spectacle de préfets de police fascistes donnant des leçons de droits de l’homme à une police française qui prétendait, n’est-ce pas, nous éviter le pire… (p.60) Le spectacle, du reste, n’avait probablement rien pour surprendre les contemporains. Car c’était l’époque – cela aussi, on le sait mal – où la France, elle, préférait donner des leçons de fascisme. Il faut se rappeler Xavier V allat, antisémite grand teint, haut perché sur ses ergots, lançant à ce sauvage, à cet ignorant de Dannecker . « Je suis un plus vieil antisémite que vous, je pourrais être votre père à cet égard. » Il faut les réentendre, lui et les autres, se targuer de leurs traditions, aligner leurs quartiers de noblesse et, de la chrétienté à Drumont, de la monarchie à Gobineau, dépenser tant d’ énergie, rédiger tant de forts ouvrages, pour prouver qu’ils ont, eux, la haine du juif dans le sang. Il n’est pas jusqu’au Maréchal lui-même qui, invitant la France à méditer sur « les principes qui ont assuré la victoire de ses adversaires », a « la surprise d’y reconnaître un peu partout son propre bien, sa plus pure et sa plus authentique tradition ». Et qui, tout ébloui de sa découverte, conclut sur cette note solennelle : « l’idée national-socialiste » fait partie de ces « vérités » que nous » pouvons reprendre sans les emprunter à personne », sans » nous renoncer en aucune manière, mais au contraire en nous retrouvant nous-mêmes », puisqu’ elles sont rien moins que » partie de notre héritage classique ». On ne saurait être plus clair. Réclamer plus clairement retour de l’adresse à l’envoyeur. Engager plus fermement l’ étrange et monstrueuse requête en paternité. Le pétainisme, de l’ avis même de son fondateur, est un produit de pays; et le national-socialisme, symétriquement, un produit d’ exportation.
(p.68) Oui, c’ est cet homme-là, ce sont tous ces hommes-là la première fois dans notre histoire moderne, le crime absolu de légaliser le racisme et la xénophobie. C’est dans leurs rangs, dans leurs seuls rangs que se pensa et se planifia la solution finale à la française. Ce sont ces cervelles banales, toutes irriguées de culture et d’humanisme classiques, toutes pétries de bienséance et de conformisme patriotes, qui accouchèrent, quatre ans durant, de la version française, si profondément française, de l’abjection du siècle. Rien de comparable dans tout cela à cette curée de factieux, d’ activistes, d’ hommes neufs dont on se plaît à imagi- ner qu’ils auraient pris d’assaut un État au bord de la vacance : ce sont tous des hommes anciens, des notables d’ ancien régime, depuis longtemps déjà présents, pour la plupart, dans les rouages du tout-État français, – et qui n’ auront à se donner la peine que de prendre d’assaut leur propre bureau. Rien qui ressemble non plus à je ne sais quelle rétractation d’hommes qui, soudain pris de folie, eussent renoncé à ce qu’ils étaient pour endosser d’autres défroques et s’en aller à l’aveugle sur des sentiers nouveaux : c’ est naturellement, spontanément, presque sans y songer, sans rien renier d’essentiel à leurs croyances les plus intimes, qu’ils ont pris le parti qui les menait au précipice. Les monstres étaient là, autrement dit, familiers aux yeux et aux oreilles, aux aguets d’eux-mêmes et de la France, formidable lettre volée au code très ancien, – qui, d’un coup, fut déchiffrée dans l’ éblouissement de la circonstance.
(p.70) (…) , un beau matin de 1944, s’ ouvrit une page nouvelle de l’histoire de notre pays. Que, dans l’euphorie de la victoire militaire, nul ou presque ne songea à se demander comment, pourquoi, en vertu de quelles perversions ou peut-être de quelles traditions, tant d’horreur avait pu, tant d’ années, nous advenir. Qu’un peu comme ces chirurgiens qui, saisis d’ effroi devant l’irréversible avancement d’un mal généralisé, préfèrent refermer sans un mot la béante cicatrice, les hommes de la France libre, confrontés à la profondeur, à la trivialité de la calamité, semblent avoir pris le parti de suturer à la diable cette grande plaie purulente au flanc du corps de France. La France était libérée, et c’ était bien. Les armées nazies en déroute, et c’ était assez. Mussolini pendu comme un porc à son croc de boucher, et ce n’ était que justice. Moyennant quoi la France put persévérer comme devant dans son amnésique somnolence. S’émerveiller d’un épisode clos, à si peu de frais finalement. Se satisfaire d’un dénouement dérisoire à une tragédie sans précédent. Et être le seul pays d’Europe, de nouveau, à faire délibérément l’économie de ce procès de défascisation qui, partout ailleurs, vaille que vaille, plus ou moins profondément, avec plus ou moins de succès c’ est évident, fut à tout le moins entrepris.
(p.71) C’est ainsi surtout qu’ on put alors assister à un extraordinaire spectacle, exactement symétrique de celui auquel on avait assisté en 1940. Les mêmes hommes de nouveau, tous à leurs places et dans leurs rôles, assassins parmi nous toujours, barbares plus souriants que jamais, réoccupant les mêmes bureaux et reprenant discrètement le chemin du devoir. Les mêmes fonctionnaires – l’analyse comparée des annuaires des grands corps de l’État de 1939 à la Libération en témoigne – recommençant de gérer, de décréter, d’administrer, comme si rien ne s’ était passé, et avec, enterré quelque part au fond de leur mémoire, le spectre des résistants, des juifs, des métèques qu’ils venaient à peine de sacrifier à leur délire. Ceux-là mêmes qui, quelques années ou quelques mois plus tôt, avaient froidement signé les actes qui expédiaient quelques dizaines de milliers de (p.72) leurs compatriotes à la mort et parfois aux chambres à gaz et qui, non moins froidement, avec le même imperturbable sang-froid, apposent leur paraphe aux décrets du régime nouveau qui condamne les excès de l’ ancien. Quatorze dignitaires de Vichy qui, en 1958, reviennent siéger au Parlement. Cinq ans plus tôt déjà, un des 569 qui avaient jadis voté les pleins pouvoirs entrant en grande pompe, et dans l’indifférence générale, au palais de l’Élysée. Aujourd’hui encore, tant de complices des miliciens qui continuent de rôder, très logiquement, et sans que personne ou presque ne trouve à y redire, dans tels appareils de la France giscardienne… La France est ce pays – il ne faut jamais l’ oublier – où le propre procureur général qui fut chargé de juger les crimes de Pétain et de Laval ne fut autre que celui qui, cinq ans plus tôt, contribuait sous leur autorité à la révision des naturalisations issues de la loi de 1927 , et dont je ne puis qu’inviter, pour finir, à relire l’ouvrage qu’il crut bon de publier alors et dont le titre, à soi seul, est déjà tout un programme, tout son programme, tout le programme de la France depuis un demi-siècle bientôt : Quatre années à rayer de notre histoire.
(p.73) PÉTAINISME ROUGE
L’opération, je le répète, devait réussir au-delà des plus folles espérances. Ces quatre années, elles ont été mieux que rayées puisqu’ elles sont proprement refoulées de notre histoire et de nos têtes. Mieux même que refoulées, c’est comme un grand charivari de mots, de vaines et dupes gloses, qui ont fini par les recouvrir et en brouiller peu à peu la piste. Et j’en veux pour preuve ultime l’ aspect le plus mal connu, le plus controversé, le plus « délicat » paraît-il, de cette période : le rôle qu’y joua, de juin 1940 au moins au 22 juin 1941, le Parti communiste français.
Il y a d’abord, bien sûr, son attitude à l’égard de l’ Allemagne. Toute une série de faits qui témoignent à eux seuls d’une singulière conception de la patrie, de la liberté, du « socialisme ». Et qui, même s’ils appartiennent plutôt, eux, à l’histoire de l’Occupation proprement dite, n’ en méritent pas moins, me semble-t-il, d’être brièvement rappelés. C’est l’incroyable démarche, par exemple, de Tréand, Catelas et l’ avocat Foissin qui, fin juin, s’ en vont, bénis par Duclos, faire antichambre à la Propaganda Staffel pour réclamer le visa nazi pour la reparution de l’Humanité . La non moins incroyable lettre qu’ils adressent le soir même à leurs respectables interlocuteurs et où ils s’ engagent, dans le cas où le précieux visa leur serait octroyé à « dénoncer les agissements des agents de l’impérialisme britannique qui veulent entraîner les colonies françaises dans la guerre « . Ce tract meurtrier, distribué dans les rues de Paris en mai 1941, où on désigne à la Gestapo, et pour de bon cette fois, avec noms et localisations géographiques à l’appui, l’existence dans l’ Ariège d’une « organisation qui fournit les papiers et l’ argent nécessaires à ceux qui veulent aller rejoindre les troupes anglaises » et « combattre » à leurs côtés. Les appels, parallèlement, à la fraternisation des « travailleurs français » et des « soldats allemands » qu’il est si « réconfortant », dit-on, « en ces temps de malheur », de voir « s’ entretenir amicalement », prolétaires de tous pays unis, par-dessus la tête des « bourgeois aussi stupides que malfaisants », au coin de « la rue » ou au zinc du « bistrot du coin ». Des appels comme celui-ci, la collection de l’Humanité clandestine en est pleine. Des ouvriers en bleu de chauffe devisant avec des S.S. bottés, il s’ en trouva, hélas, pour répondre à de si pressantes invites. Et si les mots ont un sens et qu’ on veut bien donner aux choses leurs noms, il faut bien convenir que le Parti qui prenait le risque d’ appels de ce genre n’était ni plus ni moins qu’ un parti de collabos.
Pas n’importe quels collabos d’ ailleurs. Mais des collabos heureux. Des collabos raisonneurs. Des collabos dialecticiens. Car il n’ est peut-être pas inutile de se souvenir non plus que, dès le 16 mai 1940, l’Humanité, en bon adepte déjà de la théorie du blanc bonnet et du bonnet blanc, renvoyait dos à dos Hitler et la démocratie comme deux « gangsters » qu’il faut « mettre tous les deux hors d’ état de nuire ». Il est piquant – et tragique – de voir avec quelle agilité théorique les mêmes journaux qui, pendant la drôle de guerre – c’ est-à-dire quand il s’ agissait de se battre contre le nazisme -, appelaient au sabotage de la production, appellent (p.75) brusquement maintenant – c’ est-à-dire quand il s’ agit de nourrir les S.S. stationnés à Paris – à « mettre hors d’état de nuire » les « saboteurs de la reprise du travail ». Pas inintéressant non plus de noter qu’un peu plus tard, bien avant qu’un Georges Marchais ne soit entré, avec la discrétion que l’ on sait, dans la cohorte des héros du Chagrin et de la pitié, le Comité central voyait déjà dans les premières déportations des travailleurs français « un élément d’internationalisation de la lutte ouvrière » dont le prolétariat aurait grand tort de bouder l’heureuse et féconde discipline. Que ce S.T.O. serve surtout à fabriquer les Messerschmitt qui mitrailleront bientôt les Alliés, ils n’ en ont cure apparemment. Qu’en invitant la France à « se remettre au travail « , ils ne fassent que reprendre mot pour mot l’exhortation de Goering, cela ne les gêne pas non plus. Quand d’ autres au même moment prennent le chemin inverse et entrent en rébellion, ils n’y voient que des traîtres, complices des traîtres, vendus à la « City ». Car tout semble indiquer qu’ils ont clairement pris leur parti alors : œuvrer à leur façon, à leur place, avec leurs moyens, à la construction de la Nouvelle Europe – qui sera l’Europe des camps, staliniens et hitlériens confondus…
(p.98) < Une certaine idée de la race
(…) la place éminente qu’ occupe la culture française – avec d’ autres certes, mais bien souvent en avant-garde – dans la formation, l’élaboration, les déplacements du concept moderne de race.
(p.99) La première étape, le premier ébranlement, ce fut, à n’en pas douter, celui de la mort de Dieu justement. Le lent déclin, plus exactement, de la vieille croyance judéo-chrétienne, inscrite dans les Évangiles autant que dans la Bible, en un engendrement unique, d’un seul geste consommé, de toutes les sortes d’hommes, sauvages comme civilisés, tous enfants d’un même Adam, « afin que nul ne puisse dire ton père est supérieur au mien « . L’ effritement de ce monogénisme intraitable, exalté tout autant par les théologiens catholiques que par les rabbins, et qui cimentait une anthropologie où la notion même de « race « , de différences « raciales « , en son acception moderne, n’avait par défInition pas de place. Cette idée neuve, du coup, et aux conséquences incalculables, d’une genèse plurielle, d’une création à plusieurs temps, sans père ni tronc communs, où (p.100) d’innombrables humanités, comme autant d’ espèces hybrides et substantiellement différentes, auraient éclos dans le désordre, la dispersion des origines et de très lointains cousinages… Or il se trouve que cette première idée, déjà, n’ est pas aussi neuve pour tout le monde.
On la trouve en Angleterre, c’ est vrai, mais très marginalement, dans l’entourage de Raleigh et Marlowe, les « esprits forts » de l’ ère élisabéthaine. On en décèle des signes précurseurs en Italie, mais marginaux eux aussi, avec Giordano Bruno par exemple, qui contestait que des êtres aussi étranges que les Amérindiens, les Pygmées ou les Noirs puissent être issus de la même souche. L’ Allemagne n’y est pas étrangère non plus – voir Paracelse- mais la relecture de l’ Ancien Testament induite par la Réforme, l’ absence de traditions coloniales peut-être aussi et d’ expérience directe du » terrain », en retarderont longtemps la pleine et complète expansion. Et c’ est en France, par contre, qu’ elle a indéniablement, et dès le XVIIe siècle, les titres les plus solides, avec cette » académie putéane » par exemple, où se regroupent, autour des frères Dupuy, les » libertins érudits » Nodé, Gassendi, La Mothe Le Vayer. En France qu’un peu plus tard, elle devient le corrélat de la vaste entreprise de ces apprentis sorciers qui, au long du XVIIIe, occupés qu’ils sont à dissiper les ombres de l’ obscurantisme d’ antan, éteignent du même geste les lumières des vieilles thèses monogénistes. En France qu’ elle dispose du plus prestigieux de ses pères fondateurs, en la personne de Voltaire, le premier doctrinaire européen d’un polygénisme conséquent, qui, tout à son souci de déconsidérer les Écritures, croit nécessaire de démontrer que les Blancs sont » supérieurs à ces nègres comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres ». En un mot : c’ est très tôt, plus tôt que dans toutes les autres terres de tradition et de confession chrétiennes, que commence chez nous de se lézarder la haute digue de Foi qui, depuis des millénaires, contenait l’éventuelle crue.
(p.101) Très tôt aussi, par conséquent – dès les premières décennies du siècle suivant – que commence d’y triompher une autre révolution, scientifique celle-là, qui naît de la première et vient meubler le vide qu’elle a creusé dans les consciences. C’est à Paris en effet que, dès la fin des années 20, apparaît cette « Société ethnologique » où une poignée de savants se mettent brusquement en tête d’ observer, de classer, de ranger cette poussière de dissemblances que l’ oeil chrétien voyait, bien sûr, à la surface des corps et des visages, mais qu’il ne savait rapporter encore qu’ à un obscur, dérisoire et incompréhensible caprice de la main du Créateur. A Paris aussi qu’ à l’initiative de Broca, Quatrefages, Geoffroy Saint- Hilaire, naît une « société d’ anthropologie » – la première du genre en Europe – où d’ autres savants s’ occupent à recenser des crânes, à mesurer leurs « dentelures », à comparer leurs «indices céphaliques » et à ordonner sur cette échelle des types humains spécifiques, dont tout indique, selon eux, la substantielle étrangeté. A Paris encore, qu’un darwinisme paradoxalement boudé à Londres où l’ on demeure trop attaché aux antiques leçons bibliques, peu goûté en Allemagne également où son « historicisme » heurte trop rudement la volonté de croire à la pérennité mystique de l’ antique peuple germain, va connaître sa plus rapide, sa plus fulgurante carrière et accréditer partout l’idée d’une origine physique, purement physique, des espèces et des hommes. Car peu importe que ce darwinisme s’ oppose, en bien des points, à l’ ethno-anthropologie naissante. L’ essentiel est qu’il contribue lui aussi à la preuve que nous sommes d’ abord, nous, les hommes, des animaux et des corps. A cette vaste clameur, inaudible jusque-là, qui fait de la biologie la reine nouvelle des disciplines. A ce (p.102) culte de la Vie en tant que telle, qui devient le nouveau Dieu d’une époque en mal de sacré. Et au fait que la France, alors, est peut-être l’un des lieux où l’ on a le plus activement travaillé à dresser ce second pilotis du dispositif racial : l’inscription dans la chair, et dans la chair seulement, de cet essaim de différences qui existaient certes de tous temps mais qui n’ étaient à l’ âge classique ni fondamentales ni donc définitives, ni inscrites dans l’ ordre de la matière ni donc irrémédiables, – et qui, rapatriées maintenant au coeur d’une hypothétique « nature », découpent le genre humain en autant de variétés organiquement, physiologiquement, et donc irréversiblement séparées. Mais aussi l’un de ceux où l’ on a le plus fait – troisième étape, troisième révolution – pour découper le genre humain en autant de variétés psychologiquement, culturellement, et donc intégralement séparées. Car Paris est également la patrie de ce Jules Soury, dont Lucien Herr et Anatole France ne dédaignaient pas de venir écouter les cours à l’ École pratique des hautes études, et qui montrait comment déduire, de la couleur d’une peau ou de la forme d’une mâchoire, l’ ensemble des caractéristiques psychologiques d’un individu donné. Celle d’un Georges Vacher de Lapouge, collectionneur de crânes lui aussi, tenu par son époque pour l’un des plus brillants représentants de la nouvelle « science craniologique » (!), et qui, avec quelques années d’ avance sur ses homologues allemands, prétendait expliquer les tours et les détours de l’histoire universelle à partir de la différence entre les « brachycéphales bruns » et les « dolichocéphales blonds » *.
(* on appréciera l’influence de cet étrange savant si l’on se souvient qu’un Paul Valéry, par exemple, fut son disciple. Et qu’en 1891 il aidait son maître à mesurer six cents crânes à mesurer six cents crânes humains déterrés dans un vieux cimetière de la région de Montpellier.) Celle de Gustave Le Bon, lié à Sorel et souvent (p.102) proche de Bergson, théoricien de la « psychologie des foules » et de « l’âme raciale des peuples », dont les livres, encombrés de tous les poncifs de l’antisémitisme le plus assassin, demeurent parmi les plus grands succès de la littérature scientifique de son siècle et du nôtre… Tous ces hommes ont ceci de commun que, non contents de prêter l’ oreille aux leçons de la biologie, ils décident de les étendre au champ de l’immatériel. Qu’ils font du corps, maintenant, la signature de l’ âme et des marques visibles de l’un l’indice des impalpables mouvements de l’autre. Qu’ils fraient la voie à un Ribot, du coup, qui pourra divaguer tranquillement, dans un classique traité d’ Hérédité psychologique, sur les » vices » que la « race bohémienne » possède « à titre de culte héréditaire « . Qu’ils rendent possible, un Charcot surtout, qui n’ aura aucune peine, sur cette base, pensant lui aussi la psychologie naissante comme si elle était de la physiologie, à isoler cette » névropathie » singulière à quoi les juifs sont » racialement prédisposés ». Tout est dit. L’essentiel est joué. La France, dans cette partie, a abattu sa maîtresse carte. Et si on compare cet antisémitisme justement à celui qui, au même moment, sévit en Allemagne, on a quelque peine, parfois, à décider lequel est » en avance » sur l’ autre : ce sont les Langbenh, les von Egidy, les de Lagarde qui, persistant à disjoindre les deux ordres, s’en tiennent bien souvent à un antijudaïsme culturel qui consent à admettre les juifs assimilés dans le sein du » volk » ressuscité*, (* Il n’est pas question de nier, bien sûr, le caractère meurtrier de l’antisémitisme allemand de la fin du siècle. Mais je dis simplement que, si un de Lagarde parle d’une lutte à mort entre « germains » et « juifs », il continue de penser cette lutte comme l’affrontement de deux « spiritualités » dont l’une est depuis longtemps fossilisée et l’autre récemment revivifiée. Que les arguments proprement raciaux n’apparaissent chez Langbenh que dans une édition tardive (1900) de son Rembrandt éducateur dont l’argument central demeure celui d’une renaissance « culturelle », « religieuse », voire « artistique » de l’Allemagne éternelle. Que Moritz von Egidy persiste à penser que les juifs qui auront conservé la marque de leur « spiritualité » de jadis pourront, moyennant certaines conditions, et nonobstant leur « sang », se fondre dans le » Volk » advenu à sa vérité. On consultera à ce propos le livre de G.L. Mossé (cité en fin de volume). Et celui de Fritz Stern : The Politics of Cultural Despair, Berkeley and Los Angeles, 1961.
– et ce sont souvent nos (p.104) savants, nos hommes de lettres qui, abolissant la mince frontière de la chair et de l’esprit, les opposent irréductiblement à l’éternelle » race aryenne ». La race aryenne ? Le mythe, ce n’est pas douteux, est cette fois d’origine étrangère. C’est bel et bien en Allemagne qu’il apparaît pour la première fois, dans les parages d’un romantisme – les frères Schlegel – qui s’ en va chercher loin, sur les hauts plateaux de l’Inde, le berceau de la civilisation européenne. En Allemagne encore qu’il accède à la dignité scientifique par le détournement, presque au même moment, des premiers résultats de la linguistique, de la philologie, des études orientales qui fleurissent dans les universités. Mais il n’ est pas douteux non plus, pourtant, qu’ à cette floraison Paris ne demeure pas longtemps étranger, où s’ ouvre, dès 1816, la première chaire européenne de sanscrit. Que nous avons nous aussi des savants qui, comme Burnouf, Fauriel ou le Suisse Pictet, transmettent et diffusent, chacun à sa façon, les conclusions d’une philologie qui démontre l’ origine indo-européenne des langues contemporaines. Et qu’en France aussi, les sciences de l’homme naissantes vivent sous la tyrannie de cette linguistique pilote dont un Broca peut constater, en 1862, qu’elle a « sur nous » ce » grand avantage » qu’ elle peut » se passer de nous tandis que nous ne pouvons, nous, nous passer » d’elle… Non pas, bien sûr, que cette linguistique soit, comme telle, génératrice de racisme. Mais le thème est lancé d’une origine aryenne des langues qu’il suffira – et qu’il suffit aujourd’hui encore : voir la » nouvelle droite » – de (p.105) déplacer insensiblement pour inventer celui d’une origine aryenne des peuples. Le terme est là, présent sur toutes les lèvres et terriblement fascinant qui vaut aux années 60 une kyrielle de « bibles aryennes » signées Louis Jacolliot ou, surtout, Michelet. L’idée circule à une vitesse foudroyante, dont Renan va se faire le vulgarisateur infatigable, souhaitant par exemple que, sur les décombres de «l’épouvantable simplicité de l’esprit sémitique » qui « rétrécit le cerveau humain » et « le ferme à toute idée délicate », s’impose une race indo-européenne appelée à devenir «maîtresse de la planète » et à présider aux « destinées de l’humanité ». La révolution est passée – la quatrième de notre série – qui permet à un Hippolyte Taine, dans cette vénérable Histoire de la littérature anglaise qu’ on étudie encore, un siècle après, dans les écoles, de soutenir qu »‘ il.y a naturellement des variétés d’hommes comme des variétés de taureaux et de chevaux », et que tout sépare notamment » les races aryennes » éprises » du beau et du sublime », et les » races sémitiques » éternellement » fanatiques » et « bornées » . Taine et Renan : il ne s’ agit plus de savants ni d’hommes de laboratoire mais de l’idéologue quasi officiel de la IIIe République et de l’un des maîtres incontestés de la critique européenne; et ce sont des hommes de ce genre qui, un siècle avant le IIIe Reich, placent déjà le duel entre sémites et aryens non seulement au coeur des sociétés, – mais au foyer de l’histoire générale des sociétés en général.
La nuance est capitale, prenons-y garde, qui dénote la cinquième mutation dont le concept avait besoin pour s’ affirmer. Car cette idée d’une histoire générale des sociétés dont la guerre des races serait le moteur est elle aussi une idée neuve. Elle était impensable aux yeux d’un Augustin, d’un Bossuet, qui n’imaginaient guère que le projet eût un sens de doter l’Histoire d’un moteur immanent qui échappât aux règles transcendantes (p.106) de la divine providence. Elle ne devient possible, en Allemagne, qu’avec Karl Marx qui, pour la première fois, s’essaie à une sociologie générale des structures, des successions et des rapports entre les formations sociales. Elle n’ a son répondant en France qu’ avec Auguste Comte qui, lui aussi, s’efforce à décrire le procès de l’humanité comme un enchaînement réglé de principes et de raisons immanents. Comte n’était pas raciste. Ni Marx, du moins fondamentalement. Mais ils ont un contemporain qui l’est, lui, en revanche, et qui, dans cette perspective, reprend la généralité de leur dessein. Un théoricien français dont l’ ambition est identique à la leur, même si, au lieu de la « positivité » de l’un et de la « dialectique » de l’ autre, il met, lui, la race au poste de commandement. Je veux parler d’ Arthur de Gobineau et de cet Essai sur l’inégalité des races humaines dont il est de bon ton, ici ou là, d’ admirer le brillant, l’élégance ou la modération alors qu’ on tient là le premier, le plus global, le plus achevé peut-être, des bréviaires de la haine dont l’ Europe se soit jamais dotée. Il est vrai qu’il n’est pas, contrairement à la plupart des autres, polygéniste et qu’il continue de penser, vaille que vaille, dans l’horizon du christianisme . mais les thèmes sont là pourtant, les images, les obsessions, et bien des chaînes idéologiques, qu’ on retrouvera plus tard dans Mein Kampf. Il fut mal reçu en France, c’est vrai aussi, comme le déplore d’ ailleurs Renan dans une lettre de 1856 où il salue dans l’ Essai « un livre des plus remarquables, plein de vigueur et d’originalité d’esprit »: mais il sera accueilli à bras ouverts, en revanche, dans l’ Allemagne des années 90 où Ludwig Scheemann, pionnier du nazisme, le diffuse auprès des instituteurs des cercles pangermanistes, des membres des cercles Richard Wagner et dans les casernes prussiennes d’avant 1422. Et s’il est vrai enfin qu’il contribua peu à populariser (p.107) dans les masses françaises les grands thèmes de l’infamie, s’il ne pouvait que heurter nos racistes de base par son noir pessimisme quant au destin des races supérieures, il fut soigneusement annoté en revanche par des hommes aussi différents que Taine et Renan encore, Maurras et Sorel, Bernanos et Drumont qui, tous, y voyaient la bible du racisme moderne, – et se chargeront, eux, d’en assurer la divulgation.
Car c’est alors que Drumont vint. Le polémiste enragé et le compilateur médiocre qu’un Alphonse Daudet qualifiait pourtant de « révélateur de la race » et le critique Jules Lemaitre de « plus grand historien du XIXe siècle ». L’antisémite radical, à qui Bernanos consacrera une bonne part de sa Grande Peur des bien-pensants. dont il dit, dans les Grands Cimetières sous la lune qu’ « il n’y a pas une ligne de ce livre qu’il ne pourrait signer de sa main, de sa noble main, si du moins je méritais cet honneur » , et qu’il ne cessera jamais, jusques et y compris à l’ époque de la guerre d’Espagne ou de la résistance à l’hitlérisme*,
* Sait-on que, jusque dans Français si vous saviez, en contrepoint de son hommage aux combattants du ghetto de Varsovie, Bernanos continue de saluer son « vieux maître Drumont » (Gallimard, 1961, p. 322) ? Qu’en janvier 1944, alors qu’il a pris les distances que l’on sait avec Vichy, il continue de reprendre à son compte la thèse maurrassienne – et ignoble – de la collusion judéo-nazie ? Qu’il en vient à reprocher alors à Hitler d’avoir « déshonoré à jamais » 1e très doux, très noble, très responsable « mot « … d’« antisémitisme » (le Chemin de la croix des âmes, Gallimard, 1948, p. 417) ? Bernanos ou la quintessence même de l’antisémitisme à la française.
de saluer comme son maîtres. L’ auteur de la France juive surtout qui, avec son bon millier de pages et son volumineux index tenu comme un fichier de police, connut cent quatorze éditions dans la seule année de sa parution ( 1886) ; le plus grand succès de librairie du siècle avec la Vie de Jésus de Renan ; sans parler des innombrables réimpressions de la version « abrégée » pour antisémites pressés. Car l’important, en l’occurrence, (p.108) n’est pas ce que dit le livre. Sur le fond de l’ « analyse « , il n’ apporte pas grand-chose de neuf par rapport aux étapes antérieures. Mais il leur donne un ton, un tour nouveaux, qui vont les lester d’une dernière dimension et assurer, dans les masses, leur foudroyant succès. Mieux qu’un principe d’explication de l’Histoire, il fait du racisme, à présent, une entière vision du monde, une grille de lecture de toutes choses, une catégorie de la pensée et presque de l’être. Ce n’est même plus le juif comme tel qu’il vise mais, comme il le dit lui-même dès les premières lignes de l’ ouvrage, tout ce qui « en vient « , tout ce qui « y revient », c’est-à-dire une « juiverie » cosmique et quasiment métaphysique. Cette juiverie, elle sert à désigner le patron, le capital, le bourgeois, l’ argent, le parlement, le protestant, les armes mêmes qui ont tiré à Fourmies, et jusqu’ à la main que la cervelle malade de Léon Daudet devine derrière les inondations parisiennes de 19l0. Et la race, à ce point, n’est plus un concept mais un crédo.
Le racisme, plus une doctrine mais une mystique. L’ antisémitisme, plus un thème mais un mythe. Le mythe qui travaille l’ensemble de l’idéologie française. Le mythe par excellence, au sens quasi sorélien du terme, où elle baigne tout entière, tel le navire en sa charpente. La quasi-religion où la moitié de la France, au moment de l’ affaire Dreyfus, dans les bandes de Jules Guérin ou les faisceaux du marquis de Morès, derrière les parlementaires antisémites et les lecteurs de l’Antijuif ou de l’Anti-Youtre, va pouvoir communier. Car ce qui est sûr c’ est qu’ au terme de cette ultime étape, le grand oeuvre est consommé et le concept tout armé, qui n’ a plus qu’ à se propager et circuler dans la société. Il n’a pas grand-chose à voir, on le constate, avec je ne sais quel délire importé, contracté à l’extérieur, comme une de ces maladies honteuses qui, dans les bonnes familles, s’ attrapent toujours au-dehors et (p.109) dans les mauvais lieux. Il ne nous est pas tombé du ciel – ni d’Allemagne – mais d’un discours réglé, rigoureusement déduit à partir de non moins rigoureuses prémisses, qui en font tout autre chose que ce dérisoire supplément, ce très local abcès que nos autruches professionnelles veulent aujourd’hui encore y voir. Ce n’est même pas dans des cervelles fêlées, chez des Hitler français, chez des brutes sanguinaires, qu’il a trouvé à se former, mais chez de dignes savants, des hommes aussi respectables que Taine, Renan ou Bernanos.
Strictement rien à voir, du coup, avec je ne sais quelle pellicule conceptuelle, qu’il suffirait de gratter un peu à la surface de notre culture pour en écailler le chiffre sanglant, puisqu’il semble faire masse au contraire avec cette culture, la hanter, l’obséder, la travailler du dedans, en un affreux corps à corps dont nous portons encore les stigmates. Et c’est la raison pour laquelle je crois qu’il faut poursuivre le voyage. Aller observer d’un peu plus près ce corps à corps furieux. Estimer plus attentivement ce travail et les enfantements auxquels il procède. Repérer les effets, dans le discours, de ce tronc commun racial. Les plis qu’il y provoque. Les chaînes signifiantes où il s’intègre. Celles, aussi bien, qu’il y induit. En un mot, et c’est la seconde partie du programme : après la formation du concept, le jeu de ses déplacements… J’ai choisi, pour cela, d’aller interroger l’oeuvre de deux autres écrivains. A peu près contemporains de Taine ou de Renan. Au moins aussi considérables. Mais plus modernes peut-être encore. Maurice Barrès et Charles Péguy.
Oui, Maurice Barrès d’abord. Ce singulier catholique qui, prétendant purger le christianisme de son ignoble » ferment judaïque « , réduisait le message des Evangiles (p.110) à de vagues instructions païennes à usage des hommes de glèbe de sa Lorraine mythique. Cet écrivain, largement informé des travaux des vraies et fausses sciences de son temps, qui estimait que le lieu le plus propre à juger Dreyfus l’ « hébroïde » était moins un tribunal militaire qu’une « chaire d’ ethnologie comparée ». Ce maître à vivre et à penser où tant de générations se sont, depuis cinquante ans, frottées, mais dont il n’ est pas inutile de rappeler qu’il était lui-même le disciple de Soury et de Le Bon, convaincu avec eux que la culpabilité du capitaine était inscrite dans ses gènes, dans sa race, dans la forme de son crâne. Cette étoile de première grandeur au panthéon d’un Aragon qui, tout à sa légitime admiration de l’écrivain, oubliait probablement qu’il admirait aussi l’un des plus actifs propagandistes de la mythologie aryenne et de son principe d’ explication de l’histoire. L’homme en qui Malraux lui-même saluait « le sens épique de la continuité française », mais qui confondait explicitement, lui, son combat pour la continuité de la France avec la lutte éternelle – et combien plus épique encore ! – contre les races sémitiques. Ce prince de la jeunesse enfin, auréolé dans la légende de l’esthète, qui fut surtout, on le sait moins, prince d’ abjection, dédiant à Edouard Drumont tel de ses livres et ne se lassant pas, dans tels autres, de dire la louange et les éminents mérites de l’auteur de la France juive. Bref, l’homme qui, mieux que nul autre, a su rassembler comme en gerbe les cinq ou six fils épars de la pensée raciale ; qui, dans l’ ordre des principes, n’y ajoute assurément, et lui non plus, rien d’ essentiel. mais qui a le singulier talent, beaucoup plus essentiel pour ce qui nous occupe, de savoir les nouer en un projet, un dessein, une vision politique d’ ensemble.
Car il y a aussi un Barrès politique, moins connu sans doute, mais qui n’ en a pas moins pesé que l’ écrivain (p.111) sur la modernité. C’ est le boulangiste déçu par exemple, qui, méditant dans l’ Appel au Soldat sur la défaite du mouvement auquel il avait tant cru, en voit la principale raison dans la sotte répugnance du général à jouer franchement et sans vergogne la carte antisémite. C’est le hussard lorrain qui, par trois fois, partit à la conquête du siège de député de Nancy aux cris de « A bas les juifs » et ouvrait couramment ses réunions électorales par de tonitruants procès de la « Haute Banque sémite » ou des « hauts ministres et fonctionnaires issus de la Synagogue ». C’ est le fin stratège surtout, se flattant d’ avoir mis au point une mirobolante « formule antijuive en politique » qui, confondant sous l’injurieux vocable les « escrocs » et « rapaces » de tous poils, permettait selon lui de réunir en faisceau le « menu peuple » las des exactions du « peuple gras »… La question, face à des textes et des prises de position de ce genre, n’est pas de savoir si Barrès le dandy croyait vraiment aux insanités qu’il proférait. Elle n’est même pas de savoir si, comme plaident les barrésiens, il s’est absurdement fourvoyé en des traverses où il n’avait que faire. Car ce qui en ressort, c’ est, au contraire, le portrait d’un politicien génial qui avait compris avant tout le monde le formidable usage qui se peut faire des thèmes antisémites. Celui d’un amateur de haute volée qui s’ avise, un demi-siècle avant Goebbels, de cette loi mystérieuse qui veut qu’exclure l’ Autre ce n’est pas diviser la communauté mais la souder plutôt, et l’intégrer comme jamais.
Celui du premier homme politique moderne, autrement dit, qui ait songé à faire de la haine raciale en tant que telle un slogan, une arme, une quasi technique du coup d ‘État. (p.113-114) Elle a bien travaillé la race, la vieille taupe raciale, qui pourrait bien être à l’origine, en un mot, de ce qu’ on appelle çà et là, mais sans toujours bien mesurer la pertinence de l’ expression, et sans toujours s’ aviser surtout de ses authentiques racines françaises, le fascisme rouge.
(p.114) Même chose, même type de travail, mais plus fécond, plus prodigue encore, chez Péguy, cet autre pilier majeur de l’idéologie française naissante. Je sais, bien entendu, que, sur des points essentiels de l’ époque, il prit des positions adverses. Je n’ignore pas, par exemple, qu’il fut dreyfusard et d’un dreyfusisme quasi mystique qui, jusqu’ à la dernière heure, tint ferme sur les principes. Je n’ oublie pas non plus, et nul n’ a le droit d’ oublier, qu’il fut de ces catholiques, point si nombreux alors, qui ne transigèrent jamais avec l’ antisémitisme. Je me souviens même de mon émotion, presque de ma gratitude, quand je lus pour la première fois le beau portrait de Bernard Lazare dans Notre jeunesse et l’hommage qui s’ensuivait à l’Élection d’Israël. Et pourtant !. Oui, pourtant, je me souviens aussi de ma gêne quand, dès les premières lignes du livre, je découvris l’ étrange projet, où s’insérait l’hommage d’une étude d’« histologie ethnique » censée retrouver le « tissu », le « drap », la « pleine trame » où «poussait la race française du temps qu’il y avait une race ». Je me rappelle mon trouble, un peu plus loin, face à la définition de ce « socialisme racial » ancré dans la » réalité de la race », issu d’une saine et primitive » race ouvrière » et que le » monde bourgeois », lisais-je, aurait coupé de ses racines, » abtronqué » de son sol, » contaminé » d’une intolérable » seconde race ». Je ne pus réprimer surtout un violent sentiment de dégoût quand, aux dernières pages du livre, au (p.115) terme de la confesssion du dreyfusard, j’appris que « la vraie, la réelle division de l’affaire Dreyfus » tint dans l’ affrontement de deux « mystiques », aussi respectables l’une que l’autre, et qui n’avaient différé qu’en ceci que la première visait « le salut temporel de la race » et la seconde, au contraire, son « salut éternel ». Et je me demandais comment il se pouvait qu’un homme à bien des égards estimable, qu’un apôtre des valeurs de justice, qu’un défenseur « des humbles et des petits « , pût partager avec son époque sa plus ignoble langue, – d’une histoire réduite, encore et toujours, à la sempiternelle guerre des races.
(p.122) L’idée de race, je l’ ai dit, je le répète, j’y insiste, n’ a plus, à ce point, le sens qu’ elle avait au commencement de cette analyse. Elle n’a plus grand-chose à voir, c’est sûr, avec la forme scientifique, biologique, aryanisante qu’elle revêtait chez Le Bon, Vacher de Lapouge ou même Barrès. Le concept a travaillé, s’est déplacé, a pivoté autour de lui-même et, émondé de ses aspects les plus choquants, il a accouché d’une folie douce, de bon ton, de bon aloi. Miracle d’un racisme épuré, naturalisé, nationalisé, assimilé au génie, à la mesure, aux couleurs de la France profonde. Prodige d’un racisme sans racisme, d’un racisme des racines, d’un racisme qui, sans tuer, sans bruit ni tapage, exclut celui, simplement, où ne se repère point le collectif lignage. Merveille surtout de ce racisme de France réelle qui s’ est si bien banalisé, si habilement fondu à nos paysages et nos terroirs, qu’il en est devenu une conception du monde, une philosophie de la société, une entière architecture pour les cités pétainistes d’hier, d’ avant-hier, et peut-être de demain. Si je m’y suis ainsi attardé c’ est que je le crois, pour ces raisons précisément, plus redoutable encore que l’autre. C’est qu’il est plus sournois, plus retors, infiniment plus acceptable que celui des misérables histrions élucubrant je ne sais quelle résurrection de Hitler. C’est qu’on trouve là, et au-delà bien sûr de Vichy, 1’embryon d’un dispositif dont j’ aurai, bientôt, à reprendre et à réarticuler les pièces et qui me paraît au centre de notre pensée réactionnaire. Péguy nationaliste ? Péguy socialiste ? La question, du coup, n’ a plus grand intérêt. Ce qui ressort de ces quelques remarques c’ est que les deux bords se touchent, sont parfaitement contigus l’un à l’ autre. Et ce qui se dit là, d’un bord à l’autre, comme chez Barrès, c’est la réalité, simplement, de ce qu’il faut bien appeler, déjà, un national-socialisme à la française.
(p.125) LA PATRIE DU NATIONAL-SOCIALISME
Car je crois, effectivement, qu’il y a eu, un demi-siècle avant Vichy, un national-socialisme à la française. Mieux : que la France, la patrie des droits de l’homme de nouveau, est, en un sens, la propre patrie du national-socialisme en général. Que c’est à nous, Français, à nos laboratoires, et sans ambiguïté cette fois, qu’il revient d’en avoir inventé, pensé jusqu’au bout, et parfois même exporté, sinon le fait, du moins le concept. Et je voudrais, pour le montrer, rappeler maintenant deux séquences de notre Histoire. Deux histoires apparemment riv aIes et, en réalité, étrangement convergentes. Celle des débuts de notre socialisme d’une part. Celle des débuts de notre nationalisme d’autre part. Où émergent, on va le voir, deux figures qui comptent, a l’égal de Péguy et de Barrès, parmi les saints patrons de l’idéologie française : Georges Sorel et Charles Maurras.
Commençons donc par le socialisme. Notre cher socialisme français. Notre matinal socialisme aux panaches de liberté. Ces traditions « libertaires « , « antiautoritaires », « autogestionnaires », qui seraient, paraît-il, notre honneur et notre apanage. Ces sources éminemment françaises où tant d’hommes de gauche, (p.126) aujourd’hui encore, à l’heure de la crise du marxisme, voudraient nous ressourcer. Pourquoi nous parlent-ils si peu, par exemple, de ces matins de l 880 où les rescapés de la Commune rejoignent avec ardeur la ligue des patriotes ? De ces héroïques chefs blanquistes qui, ensuite, se rallient à Boulanger ou de ces autres – Guesde, Lafargue – qui « entrevoient toute l’importance » de ce « véritable mouvement populaire » qui porte le général factieux ? De ces singulières origines, tout de même, où le groupe parlementaire socialiste vote couramment aux côtés du groupe antisémite et où Pelletan et Pelloutier écrivent à la Cocarde de Barrès, aux côtés de Léon Daudet et de Charles Maurras ?
C’est l’époque où un travailleur parisien distingue mal ce qui sépare les diatribes anticapitalistes de Drumont et celles de Vallès. Où la base « possibiliste » contraint parfois ses chefs à la démission quand elle les voit renâcler devant l’ alliance avec le parti national. Où Jaurès lui-même s’en va solliciter l’appui de Rochefort, le plus enragé des boulangistes, dans le cadre d’une élection partielle dans un arrondissement de Paris. Les socialistes allemands, de loin, observent tout ce manège. Engels m ultiplie les mises en garde, les lettres aux caciques parisiens. Bebel et Liebknecht grondent, éberlués par le chauvinisme qui règne alors à Paris. Mais qu’ont-ils à faire, les Parisiens, de ces blâmes venus d’outre-Rhin ? De quoi se mêlent-ils donc, ces Blücher en robe de clercs qui suivent – à moins qu’ils ne les précèdent – les canonnières prussiennes ? Que vaut même leur marxisme, cette doctrine « antifrançaise », si peu « sympathique, dit-on, à notre tempérament » ? Notre socialisme naissant, de fait, a choisi son camp. I1 a choisi, plus exactement, sa patrie et ses racines. Il sera français, exclusivement français, ou il ne sera pas. Il sera national, pleinement national, ou il ne sera rien. Et il apparaît tout imbibé, d’emblée, de quelques-uns (p.127) des fantasmes dont on fait d’habitude le privilège de la droite.
Ainsi de l’ antisémitisme. On imagine mal, aujourd’hui, à quel point il en est infecté, en cette première aurore. On a peine à imaginer le spectacle de Louise Michel, étreignant, lors d’une réunion publique, le marquis de Morès, ce raciste déchaîné qui, la veille encore,arpentait les rues de Paris en quête de juifs à lyncher, à la tête de sa bande de « bouchers de la Villette « . Celui de Lafargue haranguant, coude à coude avec Drumont, les ouvriers de Fourmies au lendemain du massacre du 1 er mai 1891, ou de Clovis Hugues, poète et député socialiste, remerciant le même Drumont d’ avoir su gagner tant de coeurs à la cause du socialisme. La faveur dont jouit la France juive dans les rangs de la gauche d’ alors et les deux articles élogieux que lui consacre la Revue socialiste par exemple, le périodique de Benoît Malon, socialiste indépendant, proche de Jaurès, et qui ne dédaignait pas lui-même de condamner » les radotages antihumains » des « juifs fanatiques ». Exception ? Cette même revue ose publier une série d’ articles d’ Albert Regnard, qui s’ échelonnent sur plus de deux années et où se trouve proclamée, entre autres, l’ « éclatante vérité » de » l’excellence de la race aryenne » et, en regard, la juste » haine du sémitisme » chez » les jeunes révolutionnaires » du Second Empires. Malentendu ? Quand, au bout de ces deux longues années, Gustave Rouanet finit par protester et par engager la polémique avec Regnard, Benoît Malon, fort embarrassé, clôt prudemment le débat en renvoyant dos à dos les » superbes études ethniques » de ces deux » coreligionnaires » et en invitant » les lecteurs » à trancher » en dernier ressort « . Un thème parmi d’ autres alors ? marginal dans le discours ? Ce n’est pas l’avis du Cri du peuple qui identifie explicitement » question sociale » et » question juive » ; (p.128) ni de Guesde estimant en substance qu’il n’y aura pas de » vraie république » en France tant que les Rothschild y seront encore en vie ; ni d’un Auguste Chirac, auteur de les Rois de la République et qui, tout comme Drumont, fait du » juif » une catégorie générale et de la haine de la » juiverie » le pivot d’une politique authentiquement socialistes.
Car si l’ on observe d’un peu plus près encore cette scène des commencements, on s’ aperçoit qu’il s’ agit d’un antisémitisme à forte teneur idéologique, parfaitement pensé et articulé, et qui joue déjà de tous les claviers où s’ orchestrera le calvaire du XXe siècle. Il y a le registre anticapitaliste bien sûr, le mieux connu, qu’on lisait déjà chez la plupart des socialistes utopiques et dont la forme la plus élaborée se trouve probablement dans les Juifs, rois de l’époque que publiait en 1845 le révolutionnaire Alphonse Toussenel : souvent réédités depuis, cités par Drumont comme une de ses sources, exhumés en 1940 en France et dans les années 30 en Allemagne, ils accréditent l’idée, presque l’ évidence, que la misère ouvrière revient exclusivement à l’influence juive dans la banque, le commerce, l’industrie naissante. Il y a sa dimension politique ensuite, liée à la première, issue des mêmes traditions et où le juif apparaît sous les traits du Parasite, corps noir dans la société française, obstacle à sa cohésion présente et future, bouc émissaire, du coup, dont la haine est un précieux adjuvant pour mobiliser un mouvement de masse : c’ est sur cette ligne qu’un journal comme l‘Antisémitique, premier modèle du genre en Europe, peut lancer dès l 883 » une enquête sur les juifs » où il invite ses lecteurs à lui signaler tous ceux qui occupent, dans leur bourg, dans leur département, des fonctions politiques, administratives ou judiciaires . Il y a sa facette religieuse encore, ou plus exactement antireligieuse, anticléricale, fanatiquement athée, avec cette (p.129) idée neuve que le juif est moins odieux, comme on le pensait jusqu’ici, pour avoir tué le Christ, que pour l’ avoir inventé au contraire et être à l’origine de cette lèpre moderne qu’est le christianisme : ce courant, inauguré avec Voltaire, continué par Blanqui, culmine avec les livres de Gustave Tridon, blanquiste et communard, qui, dès 1865, confond dans le même haïssable « sémitisme » ces « mauvais génies de la terre » que sont le catholicisme et le judaïsme. Et il y a enfin, pour couronner le tout, une dimension proprement raciale, hallucinante de modernité, dont il n’ est pas exagéré de dire que c’ est là, dans les rangs socialistes, qu’ elle atteint le plus tôt à son maximum d’intensité. Il est temps de se souvenir en effet du racisme bestial qui imprègne la pensée de Proudhon, le seul théoricien sérieux, paraît-il, qui puisse, dans notre patrimoine, soutenir la comparaison avec Marx : « Les juifs, dit-il, sont une race » . cette race « envenime tout » et « se fourre partout » ; il n’y a qu’un remède à ce venin, qui est de « demander leur expulsion hors de France » , à terme, une solution finale, qui serait de les « renvoyer en Asie » ou de les «exterminer » . avec une exception néanmoins puisqu’il consent, le ‘père du socialisme autogestionnaire, à « tolérer les vieillards qui n’engendrent plus » . Il n’est peut-être pas inutile non plus de relire, à l’ autre bord, tel texte où Jules Guesde salue « les ouvriers californiens » qui « ont accueilli à coups de couteau », aux cris d’« à bas les hommes jaunes », les « hordes asiatiques » qui venaient leur voler leur travail : car quand il ajoute qu’il ferait « injure à notre
prolétariat en admettant un instant qu’en pareille occurrence il pût hésiter à agir de même », on ne peut s’empêcher de songer que le P.C.F. d’aujourd’hui ne fait, bien souvent, qu’honorer le voeu de son grand ancêtre. Il faut savoir également qu’en l’absence de tradition marxiste – on le verra plus loin en détail – (p.130) c’ est sur la même base raciale qu’ apparaît parfois, à cette même époque toujours, le concept même de lutte des classes : le mouvement socialiste hérite en effet, à travers des historiens comme Augustin Thierry ou Michelet, de la vieille problématique de la « guerre des deux races », la « franque » et la « germaine », qui alimentait depuis quelques siècles le fonds de la pensée réactionnaire française et qu’il leste, lui, maintenant, de la dimension révolutionnaire qu’ elle n’ avait bien entendu pas. Et c’est ainsi qu’on comprend enfin qu’un homme comme Georges Vacher de Lapouge n’ était pas seulement le « craniologue » que j’ ai dit; pas seulement le « savant » dont nous savons aujourd’hui que Hitler connaissait les théories, pas seulement ce précurseur que les collabos de 1940 tiendront à remettre à l’honneur, pas seulement, non plus, l’un des maîtres à penser, explicites et avoués, de la « nouvelle droite » cuvée 1980 : mais aussi, mais d’ abord, parce que de son vivant, un militant guesdiste, lié à Paul Lafargue, qu’il intronisa même, au moment des élections de 1889, dans la circonscription proche de Montpellier où il régnait en maître, – et qui, à ses heures perdues, contribuait nonchalamment à jeter les bases d’un socialisme « français », « eugéniste », « sélectionniste ». On pourrait continuer longtemps, hélas, dans ces parages. Évoquer l’obsessionnelle présence, chez nombre de ces idéologues du mouvement ouvrier, du thème aryen. Citer tel texte de l’époque à prétention militante autant que scientifique, qui s’ attarde à de singulières comparaisons sur la « sodomie juive » ou la taille et la forme des « nez juifs ». Rappeler le cas d’Edmond Picard, citoyen belge mais édité en France et actif dans les milieux socialistes français, qui est probablement le premier disciple conséquent d’ Arthur de Gobineau. Celui, plus inoffensif sans doute, mais identique en sa (p.131) démarche, d’un Clovis Hugues, maniaque de celtitude et de Vercingétorix… La vérité, c’est que ces premiers socialistes ne sont pas seulement infectés de racisme mais que ce racisme, souvent, fait corps avec leur doctrine. Que, exactement comme chez Barrès et Péguy, il est pris dans des chaînes de raisons qui font du juif l’équivalent symbolique de toutes les turpitudes capitalistes et de l’antisémitisme, à l’inverse, une pièce organique de leurs discours. Qu’ on a tort, en ce sens, de parler des « sources de gauche » de cet antisémitisme, comme si elles étaient différentes – plus nobles ? plus excusables peut-être ? – de ses sources de droite, puisque c’est la même source, le même foyer, où s’alimentent les deux traditions. Mieux : on pourrait montrer – cela a été montré – qu’il n’ est presque pas un thème de la littérature d’ extrême droite la plus ordurière qui n’ait été pressenti, tout entier exprimé, expérimenté en tout cas, dans ces cornues prolétariennes. Et ce qui est sûr, en un mot, c’est qu’à la veille de l’affaire Dreyfus, la France est un pays où la gauche naît à droite; et où le socialisme, bien souvent, demeure, comme dirait l’autre, le « socialisme des imbéciles ».
(p.133) Car qu’est-ce au juste que cet anarcho-syndicalisme dont on nous rebat les oreilles, de nouveau, et sur lequel notre C.G.T. s’est fondée avant que ne la lamine, dit-on, le rouleau compresseur marxiste ? Qui est surtout ce Georges Sorel dont on nous assure, çà et là, qu’il est, avec Proudhon, l’autre valeur sûre de notre patrimoine, – notre anti-Marx méconnu, le génial théoricien d’un socialisme inédit dont nous aurions eu le tort de si vite perdre le fil ? A première vue, et si l’ on s’en tient du moins à la légende pieuse, tout n’y serait qu’angélisme, pureté, intransigeance morale et politique. Il ne s’ agirait, dans les Réflexions sur la violence par exemple, que d’exalter les valeurs d’insoumission, de chanter la rébellion, d’exhorter à la libération des humbles et des damnés. Ce serait un grand cliquetis de chaînes qui se défont, de servitudes conjurées, et ce défi, cet immortel esclandre soudain adressé au monde, d’un malheur ouvrier qui n’est pas la fatalité qu’on croit et dont le terme est pensable, prévisible, imminent. Ce serait le projet mirobolant d’une révolte sans partis, d’une société sans État, d’une politique sans mensonges ni imposture et, au bout du chemin, au bout d’une révolution à nulle autre semblable, ce monde nouveau, cet homme nouveau, cette histoire enfin cassée en son milieu, dont les marxistes avaient rêvé, – mais que Sorel, seul ou presque, aurait réellement pensés. En un mot, l’ auteur des Réflexions serait le père de l’ultragauche contemporaine. Ils seraient, ces anarchosyndicalistes, les fondateurs de ce qu’on appelle aujourd’hui le » gauchisme ». Et, de fait, ce n’ est pas faux ; la légende, une fois n’est pas coutume, est effectivement à demi vraie ; mais à demi seulement, hélas, – et étrangement, obstinément muette sur le reste. Le reste ? Eh bien, c’est d’abord que, sur un certain nombre de points tout de même essentiels, ce fondateur de l’ultragauche française n’ a pas grand-chose à envier (p.134) à Malon, Chirac, ou Toussenel… Il est l’ auteur par exemple d’une Révolution dreyfusienne qui constitue l’un des plus violents réquisitoires publiés après l’ Affaire contre le capitaine traître et le « parti » qui l’ avait soutenu. D’un Procès de Socrate, plus ancien, où il refait à sa façon le procès du philosophe assassiné et où il le condamne en appel pour délit de « dialectique », nous dirions aujourd’hui d’ « intellectualisme ». D’une série de Propos posthumes où l’ on découvre au fil des pages qu’il y a quelque part en France, mal aimé de ses pairs, un « grand journaliste », un « écrivain excellent », qui a « le talent de dire des vérités en ayant l’ air d’inventer » .
. Edouard Drumont. Un autre, jeune encore, mais « vrai chef » déjà, non moins « excellent » que l’ auteur de la France juive, et qui, outre le mérite d’ animer « le seul mouvement nationaliste sérieux « , a celui d’ être un des rares intellectuels immunisés contre « le virus démocratique » : Charles Maurras. Ajoutez à cela le fait que notre « socialiste révolutionnaire » est aussi l’ animateur d’un journal, l’Indépendance, où une autre de nos vieilles connaissances, Gustave Le Bon, vient chercher et trouver asile après que l’université et l’ État républicain l’ ont convaincu d’imposture et mis au ban de la communauté des savants*. Qu’on peut lire dans la même mouvance, au Mouvement socialiste d’Hubert Lagardelle, un étrange article intitulé « Le dreyfusisme ou le triomphe du parti juif », où l’ on a l’impression que rien, strictement rien, ne s’ est passé depuis le temps des antisémites fous de la période boulangiste. Qu’ ailleurs encore, mais dans le même voisinage toujours, à la Guerre sociale d’Hervé, on apprend que l’Humanité de Jaurès est financée par ( p.135) les Rothschild et tout entière consacrée à servir leurs ténébreux desseins. Oui, ajoutez tout cela, et vous aurez quelque idée du singulier contexte où s’inscrit, par exemple, la naissance de notre C.G.T…
(p.137) Ce socialisme est de nouveau racial : le « peuple », dit Berth encore, est une réalité charnelle tissée de » sang », de « tradition », de » races ». Il n’est plus explicitement aryen en revanche : mais il rêve désormais de hordes barbares venant nettoyer le monde de son immondice marchande. Son eugénisme est plus subtil, plus politique, que celui d’un Vacher de Lapouge : il se propose simplement d’ éliminer les » inconscients », les » déchets », les » zéros humains ». Mussolini ne s’y trompa pas qui vit dans ce socialisme français une source du fascisme italien. Et Georges Sorel non plus qui, pas peu fier de l’hommage, voyait dans le fascisme l’incarnation de son socialisme.
Notre ultragauchisme national aux sources du fascisme ? Cette filiation est si souvent contestée, ou en tout cas minimisée, qu’il n’ est peut-être pas inutile, sur ce point, de rappeler quelques vérités d’histoire. Les textes de Mussolini d’ abord, parfaitement clairs : en 1926, à Madrid, la phrase fameuse : » C’est à Georges Sorel que je dois le plus » ; en 1932, l’ article où il rappelle l’influence fondamentale qu’eut le Mouvement socialiste sur sa doctrine en gestation ; en 1932 toujours, les entretiens avec Emile Ludwig, publiés à Paris, qui laissent peu de doute sur ce qu’i1 doit – ou croit devoir – au syndicalisme révolutionnaire français. Les textes de Sorel ensuite, disparu quelques mois avant la prise du pouvoir, mais qui eut le temps, tout de même, entre 1919 et 1921, de donner au Resto (p.138) di Carlino de Bologne une série d’ articles où il salue en Mussolini un « génie politique » . l’heureuse synthèse, sous son égide du « mythe » socialiste et du « mythe », la juste articulation fasciste du «corporatisme » à l’intérieur et de l’ « expansion impériale » à l’extérieur,. sans parler de la correspondance avec Croce, Missiroli, Roberto Michels, voire du recueil de Propos, qui attestent qu’il ne dédaignait pas de se reconnaître dans le fascisme réel. Enfin et surtout, la réalité de l’influence qu’il exerça, durant toutes ces années, sur l’intense activité doctrinale qui précéda et accompagna la montée de ce fascisme : ce sont les syndicalistes qui passent au corporatisme et qui trouvent dans ses livres de quoi légitimer leur geste; une série de revues – La Voce, Il Regno, Il Tricolore, La Lupa surtout de Paolo Orano – qui le tiennent, à des degrés divers, pour leur inspirateur et leur maître à , La Gerarchia, que fonde Mussolini lui-même, penser, où on trouve nombre de jeunes intellectuels soréliens et qui, au lendemain de la mort du « Maestro », lui rend le plus vibrant hommage. Il est clair que les Réflexions sur la violence n’étaient pas une technique du coup d’État ni la prémonitoire recette de la marche sur Rome. Il est possible que Croce lui-même ait surestimé leur rayonnement quand, en 1933 encore, il y voit le « bréviaire du fascisme » triomphant et une des sources idéologiques du nazisme en gestation. Il est exact, encore, que Sorel salua au moins aussi haut l’ expérience d’ octobre 1917 et que, peu regardant sur la couleur de la barbarie, il eut le temps de reconnaître dans la terreur rouge une autre figure de l’ « héroïsme » selon son coeur. Mais l’un, hélas, n’exclut pas l’autre. Et il est non moins indéniable que sa pensée joua un rôle réel, un rôle de catalyseur en tout cas, dans une synthèse fasciste dont la France, à travers lui, eut ainsi le privilège de commencer de penser la formule.
(p.139) Lénine, Mussolini, l’ antisémitisme, le protocorporatisme : n’est-ce pas assez ? que faut-il de plus aux chantres du retour à Sorel ? quoi de plus, aux nostalgiques de notre doux » socialisme français » ? A ceux qui n’ont pas plus de goût pour la potence que pour la guillotine, je crois que cette première conclusion s’impose : oublier ce socialisme-là avec la même énergie, la même détermination que le socialisme marxiste, léniniste ou stalinien… D’autant que ce n’est pas tout. Qu’il n’est pas même nécessaire d’ aller chercher si loin pour voir se faire la synthèse dont je parle. Qu’il se trouve, au coeur même de Paris, un mouvement de droite extrême, inventeur d’un » nationalisme intégral », qui va reconnaître dans ce socialisme son plus précieux allié. Et que ce mouvement c’ est, contre toute attente, la toute jeune Action française de Charles Maurras, qui vient de se constituer elle aussi dans le sillage de l’ affaire Dreyfus et qui commence d’ emplir les têtes françaises du bruit de ses fureurs meurtrières… Car dissipons d’abord une équivoque. Sur la question clé du racisme et de l’antisémitisme encore. Dont on a un peu trop tendance, dans ce pays – voir aujourd’hui le cas de la » nouvelle droite » – à sous-estimer la gravité dès lors qu’ils affectent des hommes qui se veulent ou se prétendent des » intellectuels ». Car faut-il rappeler par exemple les textes innombrables de Maurras sur les » miasmes », la » lèpre », les » microbes » juifs ? L’ aveu, -maintes fois renouvelé, que l’ antisémitisme » constitue l’un de nos points de départ essentiels » ? Tels accès de démence, fréquents dans l’Action française, sur » les ghettos immondes » qui » favorisent les épidémies » et qui font de la » pullulence « , (p.140) de la » vermine », du » choléra » juifs, » une peste chronique et une infection en permanence » ? Le rôle que joua la Ligue dans la diffusion des Protocoles des sages de Sion et la constance surtout, unique dans notre histoire, avec laquelle ces » journalistes » entretinrent, un demi-siècle durant, un climat de pogromes larvé ? Les prises de position du maître, dans les années 40 enfin, quand il estimait les mesures de Vichy insuffisantes, la route longue encore pour parvenir à l’élimination définitive du judaïsme ? son indignation, en 1944, à l’idée que l’ on puisse songer à recueillir, dans des villages de France abandonnés, » ce qu’il y a de plus crasseux dans les ghettos d’Europe centrale » ? Je ne rappellerais pas ces morceaux d’anthologie s’il ne se trouvait de fins dialecticiens pour nous expliquer que ces » antisémites d’ État » ne trempèrent jamais dans l’horrible » antisémitisme de peau » réservé aux seuls Allemands. S’il ne se trouvait pas, aujourd’hui même, de lugubres arithméticiens pour nous assurer que cet antisémitisme-là, sans doute plus proche de celui de Drumont que de celui de Gobineau, fut nécessairement plus clément et moins empreint de barbarie. S’il n’y avait pas tant de bernanosiens attardés pour traiter avec indifférence cette passion » nationale « , simplement et banalement nationale, qui n’ aurait jamais vu dans le juif que (!) le nécessaire parasite sans la haine duquel la communauté patriote serait impuissante à se souder. Merci pour lui. Merci pour nous tous. Merci pour la démocratie. Ce qui me paraît sûr, en tout cas, c’ est que des hommes qui osent écrire, un jour de confidence, que » tout paraît impossible ou affreusement difficile sans cette providence de l’ antisémitisme « , que » par elle tout s’ arrange, s’ aplanit et se simplifie » et que » si l’ on n’ était antisémite par volonté patriotique on le deviendrait par simple sentiment de l’opportunité », – que ces hommes-là, donc, (p.141) ne sont pas seulement des déments ; qu’ils ne sont plus seulement des détraqués irresponsables; mais qu’il s’ agit bel et bien d’ assassins conscients, résolus, besogneux, appliqués à la tâche et, par conséquent, d’autant plus redoutables.
(p.147) La cérémonie aura lieu à Paris comme il se doit, le 16 décembre 1911. Maurras est présent, jubilant de bonheur, qui préside la séance. Sorel, lui, n’est pas là, mais i1 a dépêché Édouard Berth, son plus proche compagnon d’ armes. Une certaine émotion habite ces hommes qui représentent « deux traditions françaises » qui se sont « opposées au cours du XIXe siècle » et dont on s’ apprête maintenant à célébrer l’hymen. L’heure est grave, décisive même, où l’on voit se conjoindre, et s’ entrelacer enfin, ces deux fils parallèles, «synchroniques » (p.148) et « convergents « , qui s’étaient si longtemps évidés dans le désordre et tant de fois égarés, du coup, dans des rivalités et des affrontements stériles. En un mot, le cercle Proudhon est né, officiellement baptisé, provisoire épilogue à cette double et symétrique aventure, qui s’assignera explicitement pour tâche de fournir un cadre commun aux idées de l’ Action française et aux aspirations syndicales. Une institution est née où, pour la première fois dans l’histoire de l’Europe, des hommes de gauche et de droite vont, ensemble, filer la trame d’un discours qui reprendra tous les thèmes épars de la critique de la ploutocratie, de la haine du cosmopolitisme, du procès de l’intellectualisme décadent, ou d’un antisémitisme désormais monochrome. Le national-socialisme lui-même est né, dans la pierre et dans les textes, statutairement proclamé cette fois, et dont la doctrine va s’écrire dans une série de Cahiers où le Cercle, trois ans durant, prétendra hâter tout à la fois le « réveil de la force et du sang » français et l’ avènement d’un socialisme paysan, guerrier, gaulois…
L’ expérience sera éphémère, c’ est vrai. Elle aura peine à déborder les cercles intellectuels. D’ autres orages menacent surtout, qui, en août 1914, interrompront de force l’expérience. Mais les jeux sont faits, d’une certaine manière, et à jamais jouée la scène qui ailleurs se rejouera. Mais l’ a1ambic est là au moins, où bouillonnent déjà les mots qui envahiront bientôt le siècle. Mais les monstres sont lâchés qui, quoique encore titubants, arpenteront désormais les terres de la détresse. Oui, elle est née la bête immonde. Elle est éclose la chimère, du ventre fécond de la France. Elle est là, la pierre philosophale qui connaîtra, ailleurs et plus tard, les foudroyants succès que l’on sait. Valois et Berth, (p.149) satisfaits, savent qu’ils ont fait leur office et il ne leur reste que d’enjamber la guerre pour s’en aller fonder, l’un le Faisceau, et l’ autre le Parti communiste. Drieu, Rebatet, Déat, et d’autres à l’étranger n’oublieront jamais tout à fait cette étrange bombe à retardement qui « contenait déjà de quoi faire pétarader tous les moteurs de l’histoire ». Nous-mêmes, soixante-dix ans après, nous devons nous souvenir de ce court-circuit qui s’ est fait, qui se fait, qui peut se faire, aussitôt que défaille la croyance en ces vieilles et fragiles valeurs que sont les valeurs « démocratiques ». Et pour l’heure, en tout cas, les fascistes du monde entier ont les yeux tournés vers une France qui, tandis que l’Allemagne par exemple est encore la patrie du marxisme et du » socialisme scientifique », est, elle, et sans conteste, le foyer du fascisme et du socialisme national.
(p.151) Bref, la question qu’il faut poser maintenant, c’est de savoir si l’on ne va pas un peu vite en besogne quand on tient pour acquis, aujourd’hui comme hier, cette éternelle « faute-à-l’Allemagne » – à Marx, à Nietzsche, à Hegel – qui a la miraculeuse propriété, de nouveau, et dans l’ ordre théorique cette fois, de laver de tout soupçon les sources de l’idéologie française… (p.153) Bref, il y a, en France, une solide , tradition de germanophobie intellectuelle dont on ne peut nier qu’ elle a sa source, déjà, dans quelques-uns des hauts lieux de notre national-socialisme…
Mais ce qui est sûr également, c’ est qu’ elle ne se réduit pas à cela, cette tradition germanophobe. Qu’ elle a sa source dans un autre haut lieu encore, plus spécifique, de notre idéologie en formation. Qu’ elle plonge ses racines dans une autre contrée, moins bien connue sans doute, mais dont le rôle, en l’occurrence, ne pouvait qu’être décisif. Et cette contrée, c’est l’Université moderne, telle qu’ elle apparaît, en France, aux lendemains de la guerre de 1870. C’est l’époque, en effet, où nos mandarins prennent la route de Göttingen et de Berlin pour aller y étudier sur place les causes profondes de la puissance allemande et de la défaite française. Où un Louis Liard, un Albert Dumont acquièrent la conviction que cette défaite a aussi des causes intellectuelles, liées au sous-développement philosophique d’une Sorbonne somnolente et sclérosée. Où Lavisse et Gabriel Monod, directeurs de l’ École normale supérieure, entreprennent de réformer celle-ci sur le modèle des facultés d’ outre-Rhin. Mais où d’ autres, beaucoup d’ autres, parfois aussi les mêmes, arrivent à la conclusion que c’est ici, surtout, dans les amphithéâtres et les bibliothèques prussiennes, que s’ enfantent silencieusement (p.154) les monstres de la barbarie teutonne… De là, un formidable vent de croisade qui souffle dans les têtes de nos dignes professeurs. Il n’ est bruit que d’une nouvelle guerre entre la douce France de lumière, de grâce, de spiritualité et la redoutable, la sinistre, la ténébreuse Allemagne « matérialiste ». Feu sur les livres de Nietzsche par exemple, « ces folies écrites par un fou », qui contiennent en germe, selon le pauvre Alfred Fouillée, tout l’immoralisme contemporain. Exécution de Hegel, ce penseur « dogmatique », « panlogique », « déterministe », nous dirions aujourd’hui « totalitaire ». Mort à toute la clique de Iéna, à son galimatias, à ses insensées spéculations où nos maîtres ne devinent que trop bien la loi du pangermanisme et du militarisme prussien. On n’en est pas encore, et pour cause, à faire de Fichte et de Schelling les ancêtres des S.S. . mais à une formidable chasse aux sorcières déjà, où ce sont tous les penseurs allemands – autant dire, à l’ époque, toute la pensée européenne – qui, comme dira Victor Basch en 1927, sont purement et simplement » lynchés » comme une vulgaire bande de » malfaiteurs intellectuels « . D’autant que cette Université française n’en reste pas au lynchage ni aux imprécations de principe. Qu’elle va s’ employer à contenir hors de son sein ces redoutables malfaiteurs. Et que, renouant avec les bonnes vieilles méthodes du regretté Victor Cousin, elle va se doter d’un véritable dispositif de » protectionnisme philosophique « . Les jurys d’agrégation, présidés par Lachelier ou Ravaisson, sont autant de douanes ou d’ octrois où les jeunes philosophes, une fois l’ an, viennent payer leur dîme de révérence à l’idéologie française. Le choix des sujets de thèse fonctionne, à de rares exceptions près – pour un Gabriel Monod combien de Ravaisson ou de Delbos ? – comme une formidable pompe à refouler la marchandise, la pacotille étrangères. Le circuit (p.155) des traductions surtout, où l’ essentiel, inévitablement, se joue, est comme un front, une ligne de combat où veillent sur les hauteurs de doctes sentinelles. Les manuels eux-mêmes qui, tel celui de Rabier, parviennent en cinq cents pages à ignorer jusqu’ au nom de Hegel, tracent autour de la jeunesse française un véritable cordon sanitaire qui doit la préserver de cette maladie de l’ âme qu’ est la métaphysique allemande. Le résultat c’ est, bien entendu, le règne durable de la sottise et un obscurantisme culturel dont le siècle qui commence aura le plus grand mal à émerger. Ce sont les grands textes de la philosophie moderne qui mettent trente, cinquante, soixante-dix ans parfois à être simplement accessibles. C’est la lecture et le commentaire de Nietzsche qui ne concernent longtemps que quelques littérateurs attardés, quelques esthètes réunis autour du Mercure de France, quelques nationalistes d’extrême droite aussi, on va le voir dans un instant.
Ce sont les études hégéliennes durablement discréditées et qui, pendant un demi-siècle au moins, demeureront entre les mains de pionniers isolés (Hyppolite), de marginaux à l’université (Groethuysen), d’étrangers (Koyré, Kojeve). Je n’insiste pas. Car cette histoire est assez bien connue désormais. Nous en avons, de Sartre à Claude Lefort, de Merleau-Ponty à Althusser, d’innombrables témoignages. C’ est l’histoire, en un mot, de notre profonde, tenace xénophobie intellectuelle.
Ce qui est moins connu, en revanche, – et à quoi je voudrais m’ attarder davantage – c’ est la forme très subtile et très diverse que prend cette xénophobie. La façon dont la machine à décerveler s’ adapte à chaque cas et varie, chaque fois, sa méthode de refoulement…
Il y a Kant d’ abord. Le cas le plus simple. Le plus vite (p.156) réglé. Car lui, c’ est le bon Allemand. La classique éxception à la règle d’exclusion. Le seul à être jugé présentable, acceptable, assimilable et assimilé. Le seul, aussi bien, qu’on consente à recevoir, à admettre à sa table et pour qui on entrouvre les portes du club très fermé de l’idéologie nationale. Mais à quel prix justement ! Au prix de quel gâchis, de quel carnage philosophique ! Et dans quel rôle surtout, dans quelle déshonorante livrée ! Il lui faudra, pour remercier de tant de bonté, consentir à s’ enrôler d’ abord dans la croisade anti-hégélienne et à servir de prête-nom pour les douteuses opérations françaises. Courir les écoles normales pour nourrir les futurs instituteurs républicains de ces fortes maximes, épaisses et péremptoires, qu’il sait si bien frapper, n’est-ce pas, au marbre du bon sens. Passer sans transition dans l’Olympe spiritualiste, si fort secoué récemment par « la crise de la science », et qu’il lui appartient de fournir en épistémologies de rechange, lui le grand spécialiste de la distinction entre les « phénomènes » et les » noumènes ». Voler au secours de l’ âme chrétienne aussi, dont la France d’ alors vient à se demander si elle ne l’ a pas trop hâtivement jetée aux poubelles de l’Histoire, et qu’il a sûrement les moyens, avec son » je pense » transcendantal, de renflouer efficacement. Colmater encore la brèche ouverte au flanc du pays par l’ anticléricalisme dreyfusard, en y fichant sa théorie de la » limitation du savoir par la Foi », qui devient chez nos kantiens comme le correspondant métaphysique de la séparation de l’Église et de l’État. . Kant otage. Kant mercenaire. Kant taillable, corvéable à merci. Kant toujours prêt pour toutes les missions impossibles. Ce Kant-à-tout-faire et parfaitement dénaturé illustre la première règle du protectionnisme philosophique : le baptême, la conversion, la naturalis~tion d’un système qui n’ a droit de naviguer qu’en battant pavillon français. (p.157) C’est la même règle apparemment qui vaut dans le cas de Nietzsche. Le vénérable Alfred Fouillée par exemple semble regretter, pour finir, son mot malheureux sur » les folies écrites par un fou « , et croit plus fin, par la suite, d’enrôler la » volonté de puissance » sous la bannière de sa propre – et piètre – » morale des idées-forces ». Un René Berthelot, qu’on verra mieux inspiré en d’ autres circonstances, n’hésite pas, lui, à rapprocher Nietzsche de Poincaré et à faire de sa » philosophie au marteau » la variante germanique d’un » idéalisme dynamique » bien de chez nous, et bien davantage dans la manière de l’Université française.
(p.159) Troisième malfaiteur . Hegel. La partie, cette fois, est infiniment plus délicate. Et nos mandarins s’ avisent vite qu’il faut la jouer autrement. Pas question d’ assimilation en effet : le morceau est trop gros et, comme dit Politzer, il pourrait être mortel à leurs estomacs délicats. Pas question de naturalisation non plus : le bonhomme est coriace, il résiste comme un diable et les pauvres efforts d’un Hamelin pour intégrer la « dialectique » à sa théorie de la « relation » ne convainquent vraiment personne. On se risque bien çà et là, du côté de Boutroux notamment, à lui tailler un peu le nez et les oreilles : mais les nains de la Sorbonne ne valent décidément pas les pygmées de Diderot et l’opération est voyante, légèrement grotesque et, pour tout dire, ratée. On a beau chercher même, fouiller autour de soi, battre le rappel de tous les professeurs, de tous les grands ancêtres qui pourraient attester d’une préhistoire française de l’hégélianisme : on ne trouve rien, on rentre bredouille, il faut trouver autre chose. Oui, il faut se résoudre cette fois à employer les grands (p.160) moyens. A balancer par-dessus bord tout ce grand corps inutile et vraiment trop rétif aux petits trafics philosophiques. A repartir de zéro en quelque sorte et à bâtir dans le dur, dans le neuf, dans l’inédit, de tout autres fondations. En un mot : puisque Hegel s’obstine à ne pas v ouloir être français, on fabriquera de toutes pièces un hégélianisme à la française. Puisque la Phénoménologie de l’esprit est indécrottablement gangrenée de germanisme, on écrira d’autres « phénoménologies « , germanophobie garantie. C’ est le raisonnement canularesque d’ Alfred Jarry, apostrophant de son célèbre « nous vous en referons d’ autres, Môdame » la voisine dont il a manqué assassiner le rejeton. Mais c’ est aussi le très sérieux raisonnement des pontifes de l’Université française face au monstre qui leur vient du froid et qu’il leur faut à tout prix contourner. Leur phénoménologie postiche, elle s’ appellera Matière et Mémoire.
Cet Hegel de remplacement, ils iront le chercher au Collège de France. En un mot, c’ est Henri Bergson. Car qu’ est-ce que l’hégélianisme aux yeux d’un Français de cette époque et bien souvent aussi, je le crains, de la nôtre ? C’est une définition du temps, d’abord, dont on devine vaguement le caractère dynamique, inquiet, « dialectique » : or Bergson ne fait ni ne dit rien d’autre avec sa conception fameuse, et combien plus lumineuse, d’une temporalité vivante, frémissante, indéfiniment dilatée et rendue à la plénitude d’une éternelle présence. C’est une métaphysique aussi, dont le nom même de « dialectique » semble ne rien désigner qu’un vague refus des atomismes, des substantialismes, de tous les êtres clos et refermés sur soi : or l’ « évolution créatrice « , c’ est la forme achevée de cette métaphysique avec, en prime, les belles et claires oppositions de la « matière » et de 1’« esprit « , du « clos » et de 1’« ouvert « , du « mécanique » et du « vivant », du « tout fait » et du « se faisant « , qui l’irradient de leur (p.161) éclat. C’est une théorie de la connaissance, encore, qui sent légèrement le fagot, avec la prescription qu’elle fait de s’unir à cette dialectique, de communier avec son procès, de rompre avec les vues figées que prend l’entendement sur elle . or l’ anti-intellectualisme bergsonien fait, là encore, l’affaire, qui ridiculise mieux que quiconque les « raideurs » conceptuelles, pulvérise lui aussi les prétentions de l’ « intellect », commande d’ « épouser » également la pure » poussée vitale », mais tout cela, grâce au ciel ! dans un climat de » joie », de divine euphorie, si différente de la noirceur d’ âme du maître de Iéna. Tout y est, comme on voit. L’ essentiel des effets du discours hégélien, mais sans leurs troubles et sulfureux présupposés. L’essentiel de ce qu’ on y lit, qu’y lisait déjà Victor Cousin, qu’ on veut y remplacer et que, de fait, on y remplace. Non pas, bien sûr, que l’hégélianisme se réduise à cela. Il va sans dire que cette caricature n’ a à peu près rien à voir avec la lettre de la Grande Logique. Mais c’est ainsi, je le répète, qu’en l’absence des textes justement, les choses sont pour l’ essentiel perçues. Et c’ est sur ce malentendu que peut s’ opérer le tour de passe-passe.
(p.172) Mais n’ anticipons pas. Ce qui ressort pour l’instant de ces quelques remarques c’est qu’au-delà de Marx, on peut très sérieusement douter de l’influence réelle qu’ a exercée la pensée allemande sur la France contemporaine. C’ est que si elle a fini, cette pensée allemande, par tracer ses chemins parmi nous, c’ est tard, très tard, au terme de longues décennies où se sont amoncelés sur sa route tous les obstacles imaginables. C’est qu’elle n’ a pu franchir ces obstacles qu’ en passant chaque fois (p.173) sous les fourches caudines d’un étrange discours, en acceptant de parler une drôle de langue, en adoptant un très bizarre accent, bref en se faisant ventriloque, bien souvent, de l’idéologie française elle-même. Hegel, gardien de camps ? Nietzsche, père de nos antisémites ? Marx, maître à penser de nos totalitaires ? Encore faudrait-il que Hegel, Nietzsche, Marx il y eût, au paradis des camps, de l’antisémitisme et du totalitarisme français. Encore faudrait-il qu’on les entende, qu’on les entende vraiment eux, et non pas derrière eux, en voix de basse, d’ autres musiques dont ils constituent l’alibi. Resterait à expliquer par quels mystères une culture qui s’ est si longtemps donné pour but de contenir leur invasion en eût pu être si profondément, si organiquement contaminée. Par quel miracle une Grande Logique qui n’eut guère en un siècle plus de quelques milliers de lecteurs serait davantage présente dans nos consciences que ce péguysme par exemple qui a formé dans le même temps des générations de professeurs. Par quels prodiges encore, des textes dont la lettre même, en 1980, n’est pas toujours accessible, seraient comptables d’oeuvres dont d’autres textes, immensément diffusés, seraient a priori innocents. La vérité, on commence de le comprendre, c’ est que le fascisme français parle français, toujours et constamment français, – même, et surtout peut-être, quand il a l’air de parler allemand…
(p.175) LE ROUGE ET LE BRUN
On le comprend, mais il est surtout possible de commencer de le vérifier. De la mettre à l’épreuve, cette idéologie française, de l’histoire la plus concrète de notre modernité. D’ en éprouver la cohérence sur. Un exemple au moins, que je crois, de nouveau, éminemment significatif. Je veux parler de ce P.C.F. dont on a vu comment, une fois déjà, il aspira à devenir le premier parti pétainiste de France, – et dont on va voir à présent pourquoi il est, de bout en bout, et jusqu’aujourd’hui, le plus digne fleuron de notre pensée réactionnaire.
(p.179) Curieux, vous ne trouvez pas, cette procession d’intellectuels savamment, méthodiquement abattus ? D’ où vient-il, cet acharnement à briser des hommes qui, aussi différents soient-ils, ont au moins ce point commun d’être tous d’ authentiques intellectuels, et, de surcroît, marxistes ? Il vient de ce que le P.C.F. n’a que faire de l’authenticité de ses intellectuels. Il vient de ce qu’un spectre hante le P.C.F., et que ce spectre c’est, comme jadis, la « pensée allemande ». Il vient de ce que Duclos, Thorez et Marchais sont peut-être finalement moins proches d’Engels ou de Gramsci que de Boutroux et Ravaisson, – éternels pygmées coupeurs de tête ou pères Ubu décerveleurs.
/Le PC/, (p.180), l’une des figures centrales, la figure centrale sans doute du national-socialisme à la française. Car alors tout devient clair. Son histoire tout entière s’ éclaire. Des pans entiers de notre histoire réapparaissent au grand jour. Et on comprend notamment pourquoi c’ est au sens strict, pas du tout par abus de langage, pas le moins du monde en jouant sur les mots, qu’il est, notre P.C.F., un authentique parti d’extrême droite. Tout se joue, une fois de plus, au tournant des années 30. Dans le grand délire nationaliste qui, à la veille du Front populaire, sur fond d’éloge de Jeanne d’ Arc, de culte du drapeau, et de mythologies celtiques, nous renvoie l’ écho des accents les plus chauvins de la droite d’ avant 14. Dans les appels du comité centrai à (p.181) « continuer la France « , à défendre la « France éternelle « , à demeurer « attaché à cette sélection de grâce et de mesure qui s’ appelle la politesse française ». Dans la xénophobie qui imbibe les textes de Vaillant-Couturier, responsable aux intellectuels, chantant les rudes vertus de militants « profondément enracinés au sol » et dont « les noms dit-il, ont la saveur de nos terroirs » . Dans la singulière conception du « service de l’esprit » qui commande sa croisade – je le cite encore – contre la littérature « pourrie et pornographique » et motive ses appels à un « retour à l’art sain ». C’est l’époque où, selon le mot de Koestler, le Parti a ses « aryens » qui pensent la lutte des classes sur le modèle et dans les schémas du vieux discours racial. Où des chefs communistes monnaient leur internationalisme en une volonté de « défendre la famille française » et d’« hériter « , le jour venu, d’un « pays fort « , d’une « race nombreuse’,. Où Maurice Thorez lui-même confie à Aragon, « avec un certain sourire « , que si Tolstoï n’a rien compris au grand Napoléon c’est « parce qu’il était Russe » et qu’ « il y a des choses qu’un Russe ne peut pas comprendre’,. Pourquoi « refouler », ajoute-t-il, selon Aragon toujours, « l’amour de notre merveilleux pays? » Qu’il se rassure, il est là, le refoulé. Il est tout entier là, le refoulé pestilentiel. Le racisme, la xénophobie, la cocarde et la connerie. Le travail, la famille, la patrie et la France profonde. Les germes de ce qui va venir et les fruits de ce qui a été semé. Le P.C.F., a-t-on dit, n’est pas à gauche mais de l’est ; je dirais plutôt, moi : le PCF n’est pas à l’est, mais à droite.
A l’ est ? A droite ? Prenons un autre exemple. Le cas le plus fameux, le plus incroyable, de délire. Celui où on a pris l’habitude de voir la marque même du dogmatisme léniniste. Je veux parler de l’ affaire Lyssenko qui, née à Moscou, gagna très vite Paris et valut au (p.182) P.C. ces quelques années d’ obscurantisme culturel qui restent parmi les taches les plus sombres de son histoire. Or, ce qui est étrange, c’ est qu’il y eut au même moment à Paris, mais sans intervention soviétique, une autre crise de folie et d’obscurantisme culturel, tout à fait analogue dans ses formes, mais venue par de tout autres voies. Une non moins incroyable affaire qui, dans le droit fil de l’ esprit des années 30 et de la ligne Vaillant-Couturier, lança le Partis dans une nouvelle croisade contre » l’ art décadent, dégénéré, cosmopolite, antinational » et, en un mot, étranger. Une campagne par exemple, dont Aragon se fit le héraut, en faveur du » vers français », du sonnet » traditionnel », de la poésie » propre et classique », menacés, à l’ en croire, par les » tenants de la décomposition du vers « , les apôtres de l’ « anarchie dans la technique » et les fourriers de la » dénaturalisation de la culture » . Des textes, des conférences, où le même Aragon chante les vertus du » roman » parce qu’il porte, dit-il, » un nom de l’ ancienne langue française » comme pour mieux affirmer » qu’il est une chose de France, une invention de chez nous » parfaitement harmonique à notre » génie » et à nos « climats ». D’autres encore où, face à l’invasion de l’art abstrait, – bientôt ce sera le jazz – il exalte le regain du » paysage » dans la peinture qui s’explique – je le cite toujours – par un » mouvement profond du patriotisme français, soucieux de l’indépendance de notre pays dans les conditions de l’occupation américaine « .
Tous ces textes – et bien d’autres, signés Thorez ou Casanova par exemple – ne sont pas seulement accablants de nullité et de sottise. C’est peu de dire qu’ils témoignent, chez leurs auteurs, d’une conception douteuse, sinon grotesque, de l’art et de la culture. Il serait presque trop facile de les rapprocher de telles citations de Maulnier ou de Massis, tenant le même discours, (p.183) mais du point de vue de l’ Action française. Car l’ essentiel c’est qu’on voit se mettre en place là un barbelé politique qui, opposant la France et l’ anti-France, vaut bien l’autre, qui oppose au même moment l’art bourgeois et prolétarien. C’ est qu’ entre ces deux terrorismes, dont l’un venait de Moscou et l’ autre de Paris et qui, parfois, inévitablement, eurent à se disputer la préséance, le Parti, pour finir, a fréquemment opté pour le second. Mieux : que le premier, pour fonctionner, eut parfois à emprunter les sillons déjà tracés par l’autre, comme on voit, par exemple, dans un article où, pour dire la louange d’un tableau de « réalisme socialiste », Aragon croit nécessaire d’invoquer le très français « principe de crédibilité » de Paul Bourget. Et il est dommage alors que l’on parle tant de l’un et si peu, finalement, de l’ autre. Que l’ on oublie que Lyssenko fut aussi, en France, le nom d’un nom commun dont Aragon fut le synonyme. Que l’ on passe sous silence ce lyssenkisme à la française dont l’ auteur ne fut pas un obscur savant soviétique, mais l’un de nos plus éminents poètes et romanciers. Qu’on ait si vite effacé cette forme pure, sans mélange, du délire qui jaillissait des terroirs et des cervelles nationales. Car la preuve y est faite que, seul, comptant sur ses propres forces, nourri aux seules ressources de l’idéologie française, le Parti pouvait accoucher d’un stalinisme sans Staline, – dont on peut parier sans risque qu’il a, lui, survécu jusqu’ aujourd’hui.
Aujourd’hui ? Parlons donc d’ aujourd’hui. De son analyse du gaullisme par exemple qu’il hésitera, vingt ans durant, à qualifier de « progressiste » parce que « national « , ou de «réactionnaire » parce que « ami du gros argent » : c’ est celle de Barrès, face à la République radicale, opposant, on s’ en souvient, le « menu peuple » et le « peuple gras ». Des accents qu’il retrouve, à la fin des années 70, pour décrire la couche (p.184) de « parasites » qui sucent le sang du peuple ou pour opposer « Dassault ou la nation, Rothschild ou le peuple, les barons de l’acier ou les Français » : c’est la voix de Drumont dressé contre la « haute finance » et la poignée d’ accapareurs, juifs évidemment, qui affament l’ensemble du peuple. De Georges Marchais, reprenant à son tour l’antienne de « Jeanne la paysanne », et disant son « souci de la santé morale de notre peuple » et ailleurs, plus tard, celui de la santé physique d’une jeunesse musclée dans les « stades » : il peut bien parler depuis Moscou et au lendemain du coup de Kaboul, c’est péguy qu’on croit entendre, ou Maurras couvrant pour la Gazette de France les premiers jeux Olympiques de 1896. Et quand il lance enfin le thème de ce fameux «communisme aux couleurs de la France » où les naïfs ont voulu voir un progrès dans la voie du socialisme à visage humain, il faut être sourd pour ne pas entendre l’ écho d’un autre projet, beaucoup plus ancien, et passablement inquiétant : celui de Georges Sorel et de ses amis appelant, on s’en souvient, à l’avènement d’un socialisme gaulois, tricolore et patriote. Sorel, Maurras, Péguy, Drumont… La famille, décidément, est réunie au grand complet. Les parrains sont tous là, qui veillent mieux que jamais sur le berceau du socialisme national continué. Et c’ est ici, essentiellement ici, qu’il faut aller chercher les sources où puisent nos nouveaux communistes.
(p.186) Qu’on m’entende bien. Je ne suis pas en train de nier les incontestables liens que le P.C.F., comme tous les partis frères, noue depuis des dizaines d’années avec ses maîtres de Moscou. Il n’est pas question d’oublier ce qu’ ont pesé ces liens chaque fois que, de Prague à Varsovie, de Hanoï à Kaboul, de Phnom-Penh à Buenos Aires, le parti de la classe ouvrière a choisi de se ranger aux côtés des assassins. Trop jeune pour avoir pu lire, au moment de leur parution, les singuliers messages d’ exil que Thorez, en 1940, adressait aux Français, j’ai vu son successeur, en revanche, en direct de Moscou, nous dire sa certitude obscène d’ appartenir dès aujourd’hui au parti des vainqueurs de demain. (p.187) Tout cela donc est vrai. Le P.C.F. est à la botte, c’est entendu. Aujourd’hui comme avant-hier un parti de collabos, c’ est entendu aussi. Mais ce que je dis simplement, c’est qu’il ne faut pas entendre que cela. C’est que rien ne serait plus faux que de réduire ses dirigeants à de simples pantins, au fond irresponsables, dont on tirerait de loin les ficelles. C’est que rien ne serait plus périlleux, peut-être même, que d’y voir une assemblée d’ acteurs, de pures voix de leurs maîtres, dont la parole serait soufflée, le rôle ailleurs prescrit, dérisoires ventriloques d’un texte toujours étranger. Georges Marchais par exemple, quand il se produit à la télévision, me fait rarement rire. Elle ne me fait pas rire non plus, cette classe politique munichoise qui commente ses facéties le lendemain, comme on commenterait un numéro de cirque sans conséquence. Car j’ ai tendance à penser plutôt que tout cela est sérieux. Terriblement sérieux. Infiniment plus sérieux qu’ on ne veut bien le croire. Et que tant de vulgarité, de bassesse, de fascisme larvé sonnent beaucoup trop juste pour n’ être que récités. En un mot, je crois qu’il est trop facile de ne voir en toute cette abjection qu’une forme de « stalinisme » justement.
Car que signifie-t-il ce « stalinisme » dont chacun, aujourd’hui, se gargarise ? J’ ai cru devoir rappeler ailleurs que cette notion qui se veut radicale est surtout et d’ abord une invention des staliniens eux-mêmes. J’en déduisais alors que ce concept à prétention « scientifique » était un asile d’ignorance, une pure fiction verbale, un simple nom de code pour maquiller de bienséance une bien réelle et bien concrète horreur. Mais je puis ajouter à présent, fort des remarques qui précèdent, que cette épithète qui se veut accablante est aussi formidablement complaisante, quand elle s’ applique à un parti comme le Parti français… Elle lui fait tout le crédit du monde en effet, en le supposant étranger, incompétent de ce qu’il dit et fait. (p.188) Elle sous-entend qu’il lui faudrait peu, très peu de chose, un peu de maturité encore, un sain sursaut de révolte peut-être, pour devenir un parti comme les autres. Elle implique nécessairement qu’un parti communiste français est concevable qui, continuant d’être ce qu’il est, de tenir le même discours, mais s’émancipant de ses tuteurs et de ses allégeances anciennes, deviendrait brusquement, par on ne sait trop quel miracle, un parti démocratique. L’idée même lui échappe alors qu’il puisse y avoir en ce que dit Marchais, dans ce que disait Thorez, dans la lettre de leur discours et la structure de leur pensée, quelque chose de fondamentalement, d’ originellement inacceptable et qui demeurerait tel jusque dans l’hypothèse d’un improbable schisme du mouvement ouvrier international. L’ anti-stalinisme, au fond, c’ est une manière d’anticommunisme primaire. La forme la plus primaire de l’anticommunisme primaire. Mais primaire en ceci qu’il demeure en surface des choses. Qu’il reste muet sur l’ essentiel. Qu’il nous rend aveugles, je le répète, à ce vieux fonds fasciste, – qui n’ a hélas rien à voir avec la fameuse « main » de Moscou.
D’ autant qu’il y a une question que les tenants de la main de Moscou répugnent curieusement à poser. C’ est celle de savoir d’où vient que tant de collets, justement, aient si volontiers consenti à la main diabolique. Ou, plus exactement, de ce que représente, de ce qu’ a représenté Moscou pour les consciences du siècle, – et notamment pour les plus grandes, les mieux armées d’ entre elles, je veux dire les intellectuels ralliés ou sympathisants… Je ne referai pas en quelques lignes, bien sûr, l’histoire des compagnons de route. Mais je voudrais qu’ on se rappelle au moins le cas de ces Clérambault vieillis, s’ en allant, après Rolland, retremper (p.189) une vitalité chancelante auprès de ces forbans, de ces barbares au sourire que sont les communistes russes. Celui de Gide déplorant moins, à son « retour », une terreur et des camps qu’il avait d’avance acceptés qu’une société de médiocres, de philistins, de bureaucrates, si loin de l’idéal rêvé d’une communauté d’élan, d’ardeur et de mouvement. L’exemple d’Aragon encore, racontant comment, tels les détenus de la colonie pénitentiaire de Bielomorstroï, il avait réchappé aux bas-fonds surréalistes, pour se mettre à l’école du monde réel, de la vie concrète et jaillissante, d’une société régénérée. Tant d’autres encore, jusques et y compris ceux – dont je faillis être – qui, à Pékin, nouveau Kremlin, ne virent rien d’un socialisme réel, mais un mirage de pureté, une illusoire et glorieuse ascèse, et comme un angélisme guerrier enfin tombé du ciel.. Ils ne sont pas très loin, les barbares de Rolland, du héros barrésien. Bergson n’eût peut-être pas raisonné autrement que Gide en sa nostalgie de l’élan vital. Péguy eût pu, lui aussi, se comparer à un impur réchappé des bas-fonds et glorieusement régénéré. Sorel surtout aurait eu de la sympathie pour les maoïstes français et leurs mythes de jouvence et d’ ascèse. Car Moscou, à Paris, n’ a jamais été dans Moscou. Mais dans les têtes. Dans les textes. Dans les fabuleuses et inépuisables cavernes, toujours, de nos ali-baba idéologues.
(p.190) Raymond Aron a eu raison d’insister, depuis trente ans, sur l’étrange cécité qui ferme la classe politique française à l’irréductible spécificité du totalitarisme rouge : mais je crois qu’il faut ajouter que cette cécité n’ est pas de hasard ; qu’ elle est structurée comme un regard; et que ce regard c’ est celui, encore une fois, que n’ a cessé, depuis bien plus longtemps, de la droite à la gauche, de porter sur le monde le grand oeil cyclopéen de l’idéologie française.
(p.192) Le marxisme, c’ est vrai – et c’ est grave – a toujours manifesté un souverain dédain pour ce qu’il appelle les « libertés formelles » : mais l’idéologie française, c’est non moins vrai – et c’est plus grave encore – a toujours affiché une haine de la « forme » en tant que telle, de la « liberté » en tant que telle et, donc, de la forme en soi de la liberté en soi. L’ orthodoxie marxiste, c’ est indéniable, porte une lourde responsabilité dans la disqualification des droits de l’homme, cette séquelle de la « pensée bourgeoise » . mais la vulgate française, c’ est également indéniable, y eut sa part de responsabilité en instruisant le procès du Droit, de l’Homme, et de tous leurs corrélats d’ anémie et de décadence. Toutes ces valeurs au nom desquelles les dissidents par exemple se battent aujourd’hui et qui sont toutes les armes qui leur restent au fond de leur malheur, un Marx ou un Lénine les ont certes décrétées obsolètes, dialectiquement dépassées par leur socialisme scientifique, même si, une fois, jadis, elles eurent, disent-ils, leur positivité : mais nos maîtres à penser nationaux ont fait mieux, ont fait pire, pour en étouffer la voix puisqu’ils les ont décrétées ontologiquement insensées, métaphysiquement condamnées, et qu’ils tiennent, à peu près tous, qu’ elles n’ eurent jamais, en aucun lieu, en aucun temps, de valeur que négative et ruineuse pour la » vie ».
(p.193) Bref, que si le fascisme n’a jamais qu’un visage, il a toujours des relais, en revanche, par où il pénètre les cervelles, adhère dans les consciences et travaille à se légitimer. Et toutes les analyses qui précèdent n’avaient d’autre but que d’isoler ces rel’ais, ces légitimations, ces travaux de la barbarie dans les têtes, – dont je crois le temps venu, simplement, d’admettre, à l’égal du marxisme par exemple, la haute teneur en totalitarisme.
(p.199) (LE FASCISME AUX COULEURS DE LA FRANCE)
Ainsi, pour commencer, de ce paradoxe simple, le plus simple de tous assurément, et qui est celui, comme on dit, de la « gauche » et de la « droite »… Qui se (p.200) risquerait à affirmer en effet qu’un Barrès est plutôt « de droite » et un Péguy plutôt « de gauche » ? Faut-il tenir la thèse national-socialiste psalmodiée à deux voix par le gauchiste Sorel et le monarchiste Maurras comme un produit » réactionnaire » ou un effet de » progressisme » ? Comment lire à Esprit, à Ordre nou veau et ailleurs la folle circulation de ces énoncés qu’ on a vus si aisément passer d’un bord à l’ autre, de ce cours-ci à ce cours-là, et puiser indifféremment aux deux sources de la religion politique moderne ? Vichy, notre Vichy national, où tant de » révolutionnaires » vinrent rejoindre, on s’ en souvient, les ombres les plus notoires de la mémoire « réactionnaire», de quel côté faut-il le placer de la classique et fatidique barrière ? Aujourd’hui encore, que penser de ces troubles convergences, tantôt discrètes, tantôt claironnées, entre une » nouvelle droite » qui renaît spectaculairement de ses cendres et une nouvelle gauche qui, parfois, vient présider à son baptême ? D’ où vient même, de quelle obscure ruse de la raison, de quelle fabuleuse erreur de calcul historique, que ce soit dans les rangs de certaine ultragauche que se recrutent, au même moment, les » historiens » les plus empressés à » réviser » l’histoire du nazisme et celle de l’holocauste ? On s’en tire généralement en invoquant de commodes palinodies par quoi de tristes sires changeraient soudainement de camp. On nous brosse de belles typologies des tempéraments politiques, tracées au cordeau de la logique, avec, à tout hasard, ici ou là, quelques improbables gués pour rendre compte des migrations. Pis, on nous ressert périodiquement les banalités d’usage sur les extrêmes qui se rejoignent et la mystérieuse attraction qu’ exerceraient l’un sur l’autre les antipodes de la pensée. Et il y a une chose, étrangement, que presque personne ne semble vouloir envisager : c’ est que le problème n’ est tout simplement pas là; que, face à des (p.201) phénomènes de ce type, c’est la manière même de poser les questions qu’il faut savoir réformer ; que cette géo- graphie consacrée, c’ est très exactement ce qui vole en éclats au premier contact, au premier choc totalitaires ; qu’on reconnaît le fascisme, autrement dit, à ceci précisément que sa première manifestation est peut-être de brouiller ces signes politiques et d’invalider d’un seul coup leurs partages institués.
(p.207) Ainsi, une troisième amphibologie, qui se résout de la même façon et qui concerne le dilemme très ancien, mais qu’on aurait tort de croire pour autant dépassé, de la Nation d’un côté et des rêves qu’ on y oppose de supranationalité… Le nationalisme en effet est-il toujours et nécessairement, comme on a un peu vite tendance à l’ affirmer, générateur de fascisme ? En un sens oui, si l’ on songe à sa fortune aux temps du pétainisme; à son indéniable insistance dans les textes de Barrès, Maurras et les autres ; à ses douteuses résurgences, à gauche comme à droite, dans le discours cocardier de nos partis les plus évidemment réactionnaires. Mais en un autre, non, puisque c’ est au nom de la Nation que se battait aussi Zola, au moment de l’ affaire Dreyfus; au nom de la France que tant de partisans, en 40, marchèrent au combat et parfois au supplice; (p.208) derrière le drapeau tricolore que d’ autres partisans, demain, pourraient avoir à se rassembler et à résister à nouveau. L’internationalisme, inversement, est-il toujours, obligatoirement, et presque par vocation, suppôt d’ antifascisme ? Assurément oui, quand il vient contrarier chez un Benda le chauvinisme et la xénophobie ambiante. Quand, chez Breton de nouveau, il permet de faire figurer à l’exposition surréaliste de 1938 des proscrits allemands et italiens que rejette et condamne l’ essentiel de la presse et de la classe politique du moments ; quand, dans le Paris de 1968 encore, il inspire le magnifique « Nous sommes tous des juifs allemands « , lancé comme une gifle à la face de l’ autre France, celle des crétins et des canailles qui préféraient crier, eux, « Cohn-Bendit à Dachau ». Mais non, en même temps, assurément et paradoxalement non, puisqu’il est là aussi, cet internationalisme, dans le patrimoine de cette autre France ,. que c’est au nom de l’Europe par exemple, et de « l’Europe contre les patries », que Drieu, dès la fin des années 20, engage explicitement son combat, et que c’est à l’Europe de nouveau, jamais à la nation, qu’ en appellent, dans le Paris de 1980, les nouveaux tenants de l’internationale noire et les nostalgiques de l’empire hitlérien… Le fascisme, autrement dit, est indifféremment nationaliste et anti-national. Également, tour à tour, cosmopolite et anti-cosmopolite. Comme s’il s’ agissait, de nouveau, d’un faux débat et d’un clivage illusoire. Ou mieux : que, sous le pavillon des mots, circulaient des valeurs et des contenus différents.
(p.237) Car enfin est-on bien sûr que notre pays ait depuis quelques décennies tant changé qu’ on le dit ? N’est-il pas troublant que lorsqu’un hebdomadaire commande, en 1980, un sondage sur le racisme des Français, on retombe peu ou prou, concernant le racisme anti-arabe, sur les mêmes chiffres que ceux de l’enquête conduite par Vichy, en 1942, sur le racisme antijuif ? Faut-il tenir pour rien qu’il se trouve, au pays de Giscard et de Marchais, plus d’un citoyen sur deux pour estimer que les métèques y sont démesurément nombreux, et qu’il s’en trouvait un sur deux déjà sous Laval et Pétain, pour répondre « non » à la question « aimez-vous les juifs»? Mieux, quand on découvre que c’ est dans les rangs du Parti communiste que se recrutent le plus volontiers ces nouveaux xénophobes, peut-on s’ empêcher de songer que les traditions ont décidément la vie dure qui, enjambant le pétainisme lui-même, nous reconduisent au bon vieux temps, dont j’ ai parlé plus haut, où le racisme naissait aussi à gau- che ? Les situations, bien entendu, sont largement incomparables. Les juifs, quant à eux, ont toutes raisons, paraît-il, de pavoiser, puisqu’il ne se trouve plus – selon le même sondage toujours – qu’un Français sur huit pour souhaiter qu’ils disparaissent du paysage.
(p.246) Car le fascisme, paradoxalement, commence toujours, avant de donner la mort, par proclamer sa foi en la Vie. Avant d’ être l’ appareil mortifère que l’ on sait, il est toujours et premièrement une grande et bruyante célébration vitaliste. Il ne peut tuer, plus exactement, et tuer de sang-froid, qu’ après qu’il a décrété que je ne suis, moi, sa victime, rien que du vivant.
(p.314) Voltaire, Traité de métaphysique, oeuvres complètes, Éditions Moland, t. XII, p. 210. Cf. aussi, ibid., p. 192 : « Les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crins et les hommes sans barbe, ne viennent pas du même homme. » Et encore, dans l’Essai sur les moeurs et l’esprit des nations . il « n’est permis qu’à un aveugle de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos /…/ sont des races entièrement différentes » (ibid., t. XI, p. 7). Ces textes, et d’autres, que j’utilise plus bas, sont cités par Léon Poliakov dans son très beau Mythe aryen, Calmann-Lévy, 1972. |
|
|
|
Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, éd. Flammarion, 2006
(p.77) Et l’horreur est sans limites : en mars 1793, à La Rochelle, « des sans-culottes, hommes et femmes, se saisissent de prêtres réfractaires prisonniers, les lynchent, les éventrent et les démembrent puis se promènent dans la ville en arborant des restes humains, têtes, organes internes, testicules3 ».
(p.78) Tout cela aux accents d’un discours qui exclut déjà l’adversaire du genre humain, et dont le XIXe siècle offre maints exemples : c’est Dumas fils qui parle des communardes comme de « femelles » qui ne ressemblent à des femmes que lorsqu’elles « sont mortes ». C’est le langage méprisant d’une partie des élites sur les classes laborieuses, dont Eugen Weber donne des illustrations saisissantes dans sa Fin des terroirs : en 1831, le préfet de l’Ariège déclare que la population des vallées pyrénéennes est aussi « brutale que les ours qu’elle élève». En 1840, selon un officier d’état-major, les Morvandiaux poussent « des hurlements aussi sauvages que ceux des bêtes ». Au début de 1860, les habitants de la Sarthe sont des « sauvages » qui vivent comme des « troglodytes » et dorment « sur des bottes de bruyères comme des chats sur des copeaux». En Bretagne, les enfants qui, en 1880, entrent à l’école « sont comme ceux des pays où la civilisation n’a pas pénétré : sauvages, sales, ne comprenant pas un mot de la langue ». « Ses vêtements sont sordides ; sous sa peau épaisse et tannée on ne voit pas le sang circuler. Le regard sauvage et morne ne trahit pas le mouvement d’une idée dans le cerveau de cet être, atrophié moralement et physiquement. » Description raciste d’un Algérien par un officier de l’armée d’Afrique ? Non ! portrait d’un paysan du Limousin, dressé en 1865, par une propriétaire terrienne, tandis que, pour un fonctionnaire de la Sarthe, les populations vivant (p.79) près du Mans ne sont qu’un ramassis d’ignorants qui « n’ont aucun scrupule en matière de tromperie et de fraude ».
Et l’on surprendra sans doute bien des Repentants en citant ce spécialiste du folklore français, Sylvain Trébucq, lequel, après avoir parcouru les provinces de l’Ouest, de la Vendée aux Pyrénées, se félicite de ce que les « sauvages » de ces régions montrent un goût prononcé du rythme ‘ : comme les Noirs, en somme ! Les Algériens ne sont donc ni les premiers ni les seuls à peupler le bestiaire des élites ; Blancs de Vendée et communards de Paris, paysans et ouvriers de France ont aussi illustré quelques pages de ce triste album. La colonisation n’a décidément rien inventé à cet égard !
Si, dans la guerre qui oppose les armées révolutionnaires à la Vendée puis à la chouannerie, on trouve, de part et d’autre, toutes les horreurs que l’on nous dit propres à la conquête de l’Algérie, c’est parce que bien des similitudes rapprochent ces deux conflits. S’interrogeant sur les origines de cette violence révolutionnaire, Jean-Clément Martin, dans un essai essentiel, propose cet élément d’explication, parfaitement transposable à l’Algérie : « Ignorants des intentions de leurs adversaires vus comme des êtres pernicieux, perdus dans
1. Cité par Eugen Weber, La Fin des terroirs, Fayard, 1983, p. 19. |
|
|
|
Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, éd. Flammarion, 2006
(p.84) Comme les Vendéens ou les paysans français, les Espagnols sont rejetés aux franges de l’humanité par les officiers qui traversent le pays : « Ces Espagnols toutefois étaient d’une saleté repoussante. Chez eux, nul bien-être, une nourriture épouvantable, un abêtissement complet ; ils vivaient couverts de vermine sous le même toit que leurs animaux ; nulle instruction, nul développement de l’intelligence ; les prêtres et les moines régnaient en maîtres sur cette population superstitieuse et sans libre arbitre2. »
Avant les méthodes mises en œuvre par Bugeaud en Afrique, Soult décide, « pour dompter toute résistance dans l’Aragon et purger les montagnes de toute guérilla », de mettre sur pied des colonnes mobiles, « unités de composition variable, créées à la demande, qui ont pris en Espagne, dans cette guerre fluide et vaporeuse, une importance croissante »3. Le général Thiébault, gouverneur de Bur-gos, qui recourt avec succès à ce système, en élabore même un véritable mode d’emploi : « À force de marches et de contremarches, de crochets,
1. J.-L. Reynaud, Contre-guérilla en Espagne, 1808-1814, Economica, 1992, p. 31. 2. Témoignage du capitaine Aymonin rapporté in G. Bapst, Le Maréchal Canrobert, p. 87. 2. J.-L. Reynaud, Contre-guérilla en Espagne, 1808-1814, p. 98.
(p.85) de ruses, d’embuscades, en faisant des trajets réputés impossibles, grâce au secours de quelques espions et […] au soin que je prenais de tromper jusqu’à mes aides de camp et mes secrétaires sur mes moindres projets, je ne marchais jamais contre ces guérillas sans les joindre, sans les battre1. »
La prise de Saragosse, à laquelle Bugeaud, qui n’était encore que chef de bataillon, participe, donne lieu à des combats tout aussi intenses et tout aussi meurtriers que ceux de Constantine : après cinquante-deux jours d’un terrible siège, commencé le 20 décembre 1808, le premier assaut est donné le 11 janvier 1809. Mais pour conquérir la ville, vingt-trois jours de combats, rue par rue, maison par maison, sont encore nécessaires. Le 21 février, les derniers défenseurs capitulent. Près de 60 000 Espagnols sont morts, dont un grand nombre de civils. Un dernier rapprochement : le général Loison, qui fit massacrer, en 1808, la population de la ville d’Evora, au Portugal, devient un véritable croquemitaine pour les Espagnols.
1.Mémoires du général baron Thiébault, t. IV, Pion, 1896, p. 357. |
|
|
|
Jules Gritti, Déraciner les racismes, SOS Ed. 1982
PHILOSOPHIE RACISTE Le Bon et le Mauvais Sauvage à la française: (p.155) “Voltaire a jeté sur les “arpents de terre” du Canada, des mots définitivement malheureux.” (concernant les Hurons et les Iroquois)
LITTERATURE RACISTE (p.155-156) Chateaubriand: Natchez (1805) et Atala (1806) Description d‘ une bataille: “Cris” des Indiens contre “voix” des Français, “l’assaut” tumultueux des premiers contre la “barrière” des seconds – image constante depuis la bataille de Poitiers jusqu’ aux modernes westerns – et en définitive les “torrents” contre la “mer”, font que tôt ou tard force restera aux Français.” (p.156) De génération en génération, au Québec comme en France, toute une tradition catholique, cléricale, de la confrontation Blanc-Indien va se transmettre.”
(p.159) “L’on trouve chez Léon Ville /auteur d’ innombrables romans de série sur (NDLR espèce de western à la française) l’aventure française dans le Nouveau Monde, mais aussi sur la … pénétration du Maghreb et de l’Afrique Noire, …/ et les romanciers de son genre une abondante nomenclature de noms totémiques animaliers qui a servi de modèle pour les pratiques d’initiation dans les mouvements de jeunes ou les bandes d’adolescents.”
(p.204) “Le roman anti-juif dispose d’ auteurs prestigieux: Céline, les frères Tharaud, Drieu La Rochelle, Marcel Jouhandeau, Roger Martin du Gard. Ces écrivains perpétuent, ravivent l’image de la laideur physique du juif.”
(p.202) “Au XIIIe siècle, à la suite du IVe Concile de Latran, les Juifs sont astreints à des vêtements et signes distinctifs. En France, ce sera le port de la “rouelle”, tissu circulaire de couleur jaune.” |
|
|
|
Michel Taube, Tristan Mendès France, Emmanuel Maistre, Mémoire / L’article I du code noir contre Dieudonné …, LB 17/03/2005
IL EXISTE UN MOYEN TRÈS SIMPLE DE CLOUER le bec à tous les Dieudonné qui essaient de mettre en concurrence et d’opposer les porteurs de mémoires des génocides et autres crimes contre l’humanité. Il suffit de relire l’article 1 du code noir par lequel, en 1685, Louis XIV, le prétendu « Roi Soleil », instaura l’esclavage dans le royaume de France. Ce texte concerne, nous direz-vous, les Noirs et autres indigènes des colonies que la France allait conquérir 1 Relisons son article 1: « Voulons que l’édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père,. du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. »
L’acte même de fondation de l’esclavage intégra donc les Juifs dans la communauté des exclus. Ce texte nous apprend ce que savent la majorité des Juifs: les victimes des horreurs criminelles de l’Occident furent, sont et seront toujours solidaires par le fait même de leurs victimes et par respect mutuel entre elles. Devons-nous rappeler qu’en 2004, l’une des institutions les plus engagées dans la commémoration du génocide du Rwanda fut le Centre de documentation juive contemporaine ?
Le comportement de l’enragé Dieudonné pose également problème par les références qu’il convoque à tout-va dans son délire croissant: il nous parle de Luther King alors que celui-ci disait en 1968 « Lorsque les gens critiquent le sionisme, ils veulent dire les Juifs. Il s’agit d’antisémitisme ». Il prétend préparer un film sur le code noir? Compte-t-il censurer l’article 1 dans son travail de réécriture de l’histoire?
En cette année de commémoradon des 60 ans de la libération des camps de la Shoah et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous appelons à un redoublement des efforts de partage des mémoires et d’entraide entre les victimes des crimes contre l’humanité dont se rendit complice notre civilisadon et au rejet vigilant des communautaristes. Nous le disons fièrement: nous sommes tous des Juifs noirs! L’article 1 du code noir nous le rappelle: celles et ceux qui, comme Dieudonné, ne se sentent pas cette double attache n’ont rien compris à l’histoire…
|
|
|
|
P. Fabien Deleclos, Quand les catholiques ignorent l’Histoire, LB 13/04/2007
Bossuet qualifiait les juifs de ‘peuple monstrueux, devenu la fable et la haine du monde … »
|
|
|
|
Reynaert François, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.95) /Saint Louis/
Il y a la politique conduite dans le royaume contre les Juifs. Louis IX n’est pas le seul à s’être livré au terrible antijudaïsme qui devint peu à peu la règle dans presque toute la chrétienté au Moyen Age. On reviendra également sur ce sujet. Mais il y eut sa part : des chrétiens accusent le Talmud, le grand livre de la sagesse juive, de contenir des passages infâmes contre le Christ. Après un simulacre de controverse, il fait brûler des charretées entières des précieux ouvrages en place de Grève. La dernière année de son règne, pour suivre les consignes d’un concile que d’autres princes préfèrent ignorer, il oblige ses sujets juifs à porter la rouelle, une pièce de tissu, un signe distinctif et humiliant inventé pour les mettre à l’écart de la société des hommes. Je sais, (p.96) il faut se garder, en histoire, de trop mélanger les époques : les télescopages brutaux n’ont pas grand sens. Tout de même, savoir que le grand Saint Louis est aussi celui qui, en France, promut l’ancêtre de l’étoile jaune, comment dire ? Sur les blancs revers de son manteau d’hermine, cela fait tache.
|
|
|
|
Reynaert François, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.304) Abordons l’esclavage non par sa fin mais par un autre grand jalon qui marque son officialisation dans notre histoire : le Code noir. C’est aussi un texte de loi. Il nous raccroche à l’époque d’où nous sortons : il est de 1685 et fut signé par Louis XIV lui-même, comme tous les actes promulgués sous son règne, il est vrai. Pendant très longtemps, il est, lui aussi, tombé dans l’oubli. Sans doute nos lecteurs d’aujourd’hui ont-ils au moins entendu mentionné son nom. Il est réapparu sur notre scène nationale à la fin du XXe siècle lors du grand débat mémonel conduit entre autres par la députée de la Guyane Christiane Taubira pour aboutir à cette mesure de justice : faire reconnaître l’esclavage pour ce qu’il est, un crime contre l’humanité. Le Code noir, quand on le lit, est un texte assez étonnant. Il vise à régenter la vie des esclaves dans les colonies d’outre-mer qui en possèdent et commence par régler d’autres obsessions de (p.306) l’époque. Dès ses premiers articles, il ordonne par exemple l’expulsion des Juifs des Antilles et insiste ensuite sur l’interdiction faite aux protestants de participer à ce commerce d’humains : il serait trop navrant que ces réprouvés soient tentés de convertir les « Nègres » à leur hérésie. Pour autant, au milieu d’un amoncellement de dispositions qui nous semblent complexes, il sait montrer sa vraie nature. Retenons l’article 44, il résume la philosophie de l’ensemble. C’est donc Louis XIV lui-même qui parle. Ecoutons sa parole très officielle, en 1685 : « Déclarons les esclaves être [des] meubles. » Ainsi fut aussi le Grand Siècle, tutoyant le sublime dans les vers de Racine, portant au plus haut le raffinement et la civilisation sous les ors de Versailles, et capable, dans le même temps, de mettre des êtres humains au niveau des fauteuils.
|
|
|
|
Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, éd. Flammarion, 2006
(p.199) À mort les Christos !
L’image d’une immigration spécialement discriminée, parce qu’elle est d’origine coloniale et pour une large part de confession musulmane, occupe une place centrale dans la mythologie de la Repentance car elle sert à justifier le continuum entre la période coloniale et aujourd’hui. Ce double stigmate l’opposerait aux travailleurs venus d’Europe, lesquels auraient pu aisément se fondre dans la société française, s’assimiler, étant blancs et chrétiens. Dans un ouvrage paru en 2005, Dominique Vidal, rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, invoquant Pascal Blanchard, ne dit rien d’autre : « Pas un immigré colonial ne peut rêver d’intégration au cours de ces années où la colonisation est le système dominant. En revanche, nombre d’immigrés européens pensent y parvenir ‘. »
1. D. Vidal et K. Bourtel, Le Mal-Etre arabe, Enfants de la colonisation, Agone, 2005, p. 82.
(p.200) Cette affirmation péremptoire témoigne d’une singulière ignorance des conditions dans lesquelles l’intégration dans la population française des « Cloutjes » (Belges), des « Christos », « Ritals » et autres « Polaks » s’est opérée. Elle témoigne aussi du refus de voir que l’intégration des Arabes et des Noirs est en marche. La nier ou en minimiser l’importance conduit à freiner cette évolution plus qu’à l’accélérer, car cela persuade ces populations que la République s’est définitivement fermée à elles et qu’il leur faut donc chercher ailleurs les voies de leur réussite.
Invoquer l’assimilation aisée des immigrés européens – pour l’opposer aux échecs subis par les « indigènes » des colonies — revient à évoquer un passé mythique, à procéder à une reconstruction imaginaire. Cette fiction repose, d’abord, sur une absurdité méthodologique car, pour témoigner de cette assimilation réussie, on invoque l’exemple de ceux qui, justement, ont réussi à s’intégrer. Mais la masse de ceux qui n’y sont pas parvenus est escamotée. Or, si l’on peut estimer « à 3 500 000 l’effectif des migrants transalpins qui ont pris, entre 1870 et 1940, le chemin de la France […] le nombre de ceux qui ont fait souche ne dépasse guère 1 200 000 ou 1 300 000 personnes ‘ ». Autrement dit, malgré tous les facteurs de proximité entre les deux peuples latins, que l’on
1. P. Milza, Voyage en Ritalie, rééd. Petite Bibliothèque Payot, 2004, p. 323.
(p.201) met en avant pour expliquer la facilité avec laquelle les migrants italiens se seraient intégrés dans la société française, près des deux tiers ont été ou se sont sentis rejetés. Les Polonais n’ont pas connu un sort très différent : pour 466 000 entrées enregistrées entre 1920 et 1939, les statistiques françaises recensent 42 % de rapatriements. Il s’en faut donc de beaucoup que tous les immigrés européens se soient fondus dans le creuset français.
Et pour ceux qui y sont parvenus, le chemin n’a pas été aussi facile ni aussi rapide qu’on veut bien le dire. Il suffit de mettre ses pas dans ceux de Pierre Milza, et de le suivre dans son beau Voyage en Ritalie, pour se convaincre des obstacles que les Italiens ont dû surmonter, des préjugés qu’il leur a fallu renverser, de la ténacité et de la patience dont ils ont dû faire preuve. À la lecture de ce livre, on mesure l’ampleur des manifestations xénophobes qui, trois quart de siècle durant, accompagnent leur présence en France, et qui culminent durant les périodes de dépression économique : celle qui marque la fin du XIXe siècle, dont les Cloutjes et les Ritals sont les principales victimes ; celles des années 1930, au cours desquelles tous les étrangers sans distinction sont perçus comme des concurrents et des indésirables. Michelle Perrot, qui a relevé 89 incidents xénophobes entre 1867 et 1893 ‘, s’est dite frappée « du pouvoir mobilisateur
1. M. Perrot, Les Ouvriers en grève (1870-1890), Mouton, 1974, p. 170.
(p.202) de ces manifestations [qui] se transforment aisément en mouvement populaire de milliers de personnes l ». Les humiliations subies par les migrants européens annoncent celles infligées au gone du Chaâba. Le rejet se manifeste d’abord au sein du monde du travail, où l’étranger est perçu comme un concurrent d’autant plus dangereux que, se contentant de peu, il serait moins exigeant sur le salaire et les conditions de travail.
À Aiguës-Mortes, en août 1893, se joue un drame sans équivalent dans l’histoire contemporaine de l’immigration. Près de la petite cité du Gard, les Salins du Midi exploitent des marais salants. L’été est la saison des gros travaux. Pour y faire face, la Compagnie embauche entre 900 et 1 200 journaliers. Les habitants du pays sont ulcérés par l’arrivée massive des Italiens, qui vont accaparer leurs emplois et faire baisser les salaires. Le climat est lourd. Les incidents se multiplient. Dans l’après-midi du 16, un premier heurt sérieux se produit. Selon les rapports de la gendarmerie consultés par Pierre Milza, une cinquantaine d’ouvriers italiens auraient agressé, à l’heure de la sieste, une vingtaine de leurs camarades français, qui doivent fuir en emportant avec eux cinq blessés
1. M. Perrot, « Les rapports entre ouvriers français et étrangers (1871-1893) », Bulletin de la Société d’histoire moderne, 1960.
(p.203) légers. À Aiguës-Mortes, la rumeur court qu’il y a eu des morts et une expédition punitive est organisée. Toute la population masculine de la ville s’attroupe devant la mairie au cri de : « À mort les Christos ! » Armée de fourches et de manches de pioche, la foule se répand dans les rues et fait une chasse aux Italiens dans ce qu’on pourrait appeler une véritable « ritalonnade ». Malgré l’arrivée de gendarmes à cheval, dépêchés de Nîmes, l’émeute reprend le lendemain. Trois cents personnes, armées de gourdins, se rendent dans les marais et se lancent à l’assaut d’un baraquement où se sont réfugiés 80 Transalpins. Les gendarmes parviennent à dégager les Italiens et à leur faire prendre la route d’Aigues-Mortes pour les évacuer par le train. En chemin, le cortège se heurte à une colonne venue de la ville, forte de cinq à six cents hommes armés de matraques et de fusils.
Le rapport du procureur de la République sur la violence qui se déchaîne alors est éloquent : « Au moment où le capitaine croyait mettre en sûreté à Aiguës-Mortes ceux qu’il protégeait, la population de la ville, échauffée par le vin et la colère, se porta à sa rencontre et attaqua les Italiens par-devant, tandis que la bande qui les suivait les frappait par-derrière. Malgré les pierres qui pleuvaient, ce lamentable convoi peut enfin pénétrer dans la ville, mais à ce moment les actes de barbarie redoublent. À chaque instant des Italiens tombent sans défense sur le sol, des forcenés les frappent à coups de (p.204) bâtons et les laissent sanglants et inanimés […]. Pour échapper aux coups, ces malheureux se couchent sur le sol les uns au dessous des autres, les gendarmes leur font un rempart de leurs corps, mais les pierres volent et le sang ruisselle1.» Ailleurs, place Saint-Louis, deux Italiens sont reconnus, frappés à coups de bâton. « L’un est tué, l’autre grièvement blessé. » Les 18 et 19 août, la chasse à l’homme se poursuit dans les marais. Au total, le bilan officiel fait état de huit morts et de dizaines de blessés, dont certains très gravement.
Ce pogrom n’a rien d’un événement isolé. D’autres se sont produits auparavant. À Grenoble, en 1862, les ouvriers déclenchent une grève pour s’opposer à l’embauche de Piémontais. Sur le chantier du chemin de fer Alès-Orange, en 1882, les terrassiers chassent les Italiens à coups de pioche. En 1892, à Drocourt, dans le Pas-de-Calais, la population manifeste violemment contre la présence des Belges, qui représentent 75 % de la main-d’œuvre des mines locales. L’ampleur du mouvement est telle qu’ils sont obligés de regagner leur pays dans la précipitation, abandonnant leur mobilier sur place. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, « le nord de la France est le théâtre de bien d’autres scènes du même genre2». En juin
1. Cité par P. Milza, Voyage en Ritalie, p. 136. 2. G. Noiriel, Le Creuset français, Histoire de l’immigration, XDf-XX? siècles, Le Seuil, rééd. 2006, p. 258.
(p.205) 1897, les habitants de Barcarin, dont beaucoup sont employés à l’usine Solvay, poursuivent des heures durant les Italiens, frappent à coups de gourdin et de pierres ceux qu’ils attrapent et en jettent quelques-uns dans le Rhône. En avril 1900, à Arles même, des batailles rangées opposent ouvriers français et italiens au cri de : « À la porte les Italiens ! Faisons comme à Aiguës-Mortes ! » Jamais aucune immigration « coloniale » n’a été la cible de tels débordements de violence populaire.
Les déchaînements xénophobes ne se limitent pas seulement à des rivalités de travail. Ils se produisent aussi au nom de considérations politiques, notamment dans les moments de fortes tensions nationalistes. Le 17 juin 1881, les troupes coloniales défilent à Marseille, de retour de Tunisie où elles ont imposé le Protectorat français. Quelques coups de sifflet se mêlent aux acclamations d’une foule en liesse. Immédiatement, les Italiens sont mis en cause. Le Club nazionale italiano, dont le siège est rue de la République, n’a-t-il pas jugé inutile — tout comme le consulat italien – d’arborer un drapeau, alors que tous les bâtiments alentour sont pavoises ? Dès la fin du défilé, une dizaine de milliers de personnes manifestent devant le club leurs sentiments anti-italiens. Une première fois, la gendarmerie parvient à ramener le calme. Mais le lendemain, des bandes de nervis — jeunes voyous armés d’un nerf de bœuf – se lancent dans une (p.206) chasse au faciès. Dans la soirée du 19, une bataille rangée oppose un groupe d’Italiens à de jeunes Marseillais. Un jeune Italien est bastonné à mort, un Marseillais est grièvement blessé d’un coup de couteau. Les incidents se poursuivent toute la journée du lendemain et seule l’intervention énergique de l’armée, qui dégage la Canebière, baïonnette au canon, permet d’éviter un bain de sang. Le bilan de ces Vêpres marseillaises est lourd : trois morts et quinze blessés parmi les ouvriers italiens.
Le 24 juin 1894, l’assassinat à Lyon du président de la République, Sadi Carnot, par un anarchiste italien, Santé Caserio, déclenche de nouveaux troubles xénophobes. Deux jours durant, on s’attaque sans discernement à tout ce qui est, ou paraît être, italien. Les boutiques et les cafés sont mis à sac et incendiés tandis que les rues de la ville sont le théâtre d’une chasse à l’homme. Selon le Courrier de Lyon, « tout flambe à la Guillotière et aux Brotteaux ; pas une rue où ne s’élève un immense brasier où brûlent soit les marchandises des négociants, soit les ménages de pauvres diables innocents du crime commis ‘ ». Au cours des années 1930, la dépression économique d’abord, puis l’afflux des réfugiés consécutif à l’accession de Hitler au pouvoir, en janvier 1933, à la guerre civile espagnole et aux victoires de la junte militaire, à partir de 1936, conduisent à de
1. Cité par P. Milza, Voyage en Ritalie, p. 139.
(p.207) nouvelles vagues de protestations xénophobes. Mais, plus surprenant encore, de nombreux témoignages attestent qu’au cœur des années 1950, en période de pleine expansion économique, le rejet des étrangers est encore fréquent. Pour beaucoup, les affronts subis dans l’enfance sont encore vivaces, toujours douloureux. Agnès Cagnati est née à Monclar d’Agenais. Dans le récit qu’elle livre, la romancière, d’origine italienne, s’efface devant l’écolière : « À l’école, le monde a basculé. Je ne comprenais rien à ce que l’on me disait, je ne pouvais même pas obéir, je ne savais pas ce que l’on me voulait. Les Français n’avaient plus rien de fascinant. Leur monde était hostile, agressif, ils ne nous voulaient pas […]. Les autres enfants manifestaient aussi leur aversion, par la dérision, les injures, les poursuites. Mais nous nous battîmes bien sûr […] Françaises contre étrangères1. » Georges Lopez se souvient d’avoir été un écolier malheureux, longtemps avant de devenir l’instituteur de campagne le plus célèbre de France : « Nous aussi, les fils d’Espagnols, subissions la xénophobie et, certains jours, la sortie de l’école était pour nous une fuite. Sans tourner la tête je pédalais de toutes mes forces sur mon petit vélo pour échapper aux jets de pierres et aux coups de
1. A. Cagnati, «Je suis restée une étrangère», Sud-Ouest Dimanche, 16 mars 1985> citée par P. Milza, Voyage en Ritalie, p. 327-328.
(p.208) roseau. Les plus grands restaient en arrière pour me protéger. À bout de souffle, je ne m’arrêtais que lorsque mes camarades me rejoignaient. J’écoutais le récit de leur victoire mais je ne me réjouissais pas trop à l’idée qu’un jour ou l’autre je me trouverais seul contre tous. J’entends encore crier ce mot : Espanyolâs !, insulte majeure chargée de mépris qui m’a poursuivi dans ma scolarité primaire, en dépit des leçons de morale qu’on nous dispensait ‘. » II faudrait des volumes entiers pour éditer l’anthologie — ou plutôt le sottisier — des articles, discours, images qui disent le mépris ou la haine de l’autre. Ce qui frappe, c’est leur manque de variété : au fond, les clichés que l’on imagine forgés pour stigmatiser les Nord-Africains ressemblent beaucoup à ceux dont on affublait les migrants européens, une ou deux décennies plus tôt.
L’entassement dans des ghettos urbains de populations repliées sur elles-mêmes ? C’est Le Cri du Peuple, journal socialiste, qui, en mars 1885, évoque les conditions d’existence des raffineurs de sucre italiens de Paris en ces termes: « Ils vivent entre eux, ne se mêlant pas à la population, mangent et couchent par chambrées ainsi que des soldats qui
1. G. Lopez est l’instituteur du film Etre et avoir. La citation est extraite de ses souvenirs, Les Petits Cailloux. Mémoires d’un instituteur, Stock, 2005, p. 52-53.
(p.209) campent en pays ennemi […]. Ils se mettent à huit, dix, quinze dans une chambre ; l’un d’eux est chargé du ménage. La même chambre loge deux chambrées ; une de jour et une de nuit. » Dans l’Ariège, le préfet observe le même phénomène : « En général, les conditions d’hygiène dans lesquelles vivent les travailleurs étrangers sont assez élémentaires. Il est vrai que leurs exigences sanitaires sont loin d’être excessives. Beaucoup de travailleurs louent en commun des pièces où ils sont entassés]. »
Bien avant un Jacques Chirac que l’on a connu mieux inspiré, une certaine presse dénonce l’odeur insupportable que dégagent les foyers des étrangers. Un journal lorrain, L’Etoile de l’Est, décrit, dans son numéro du 24 juillet 1905, « les vieilles sordides à la peau fripée et aux cheveux rares, qui font mijoter des fritures étranges dans des poêles ébréchées. Toute cette cuisine diabolique passe encore sous le ciel bleu de l’Italie, et fait d’ailleurs partie de la couleur locale des quartiers pauvres de Rome ou Naples. Mais il en est tout autrement en Lorraine où la saleté chronique et la façon de vivre déplorable des Italiens font courir de sérieux dangers de contamination à la population indigène ». La saleté du logement ? Jacqueline Moran, dans La Lumière du 18 mai 1935 : « Logez confortablement des émigrés italiens et ils sauront donner à
1. Cité par R. Schor, L’Opinion française et les étrangers, 1919-1939, Publications de la Sorbonne, 1985, p. 423.
(p.210) leur village ce débraillé, cette turbulence, cette malpropreté qui les caractérisent. » Le manque d’hygiène ? L’avis du préfet de la Gironde, en mars 1925, est sans appel : « L’étranger professe un dédain profond pour l’hygiène. Il serait plus exact de dire qu’il en ignore les règles les plus élémentaires ‘. » Point de vue partagé par Georges Mauco, pour lequel les Espagnols ignorent « les règles les plus élémentaires d’hygiène et la mortalité infantile est terrible2 ».
Mais comme les Repentants veulent à tout prix prouver que seuls les coloniaux sont stigmatisés, ils ne se privent pas, à l’occasion, de solliciter, voire de détourner les citations qu’ils présentent à l’appui de leur obsession. Le lecteur du Paris arabe en aura une preuve accablante, avec cet extrait (p. 101) d’un article publié le 2 septembre 1930 par un journal d’extrême droite de grande diffusion, L’Ami du peuple : « II y a actuellement dans l’agglomération parisienne 70 000 Nord-Africains. La presque totalité est hérédo-syphilitique. Après avoir introduit inconsidérément ces épaves en France, il nous faut à présent les soigner. » Mais, pour parvenir à cette conclusion, nos rigoureux moralistes n’ont pas hésité à se livrer à une petite opération de ciseaux, et deux coupures subrepticement opérées dans ce texte en tordent le sens. Le
1. Cité in ibïd. 2. G. Mauco, Les Etrangers en France, p. 423.
(p.211) voici complété, avec en italiques les passages qui ont été les victimes de leur censure : « II y a actuellement dans l’agglomération parisienne 70 000 Nord-Africains. Une formidable proportion de ces malheureux déracinés est atteinte de tuberculose ; la presque totalité est hérédo-syphilitique. Après avoir introduit inconsidérément ces épaves en France, il nous faut à présent les soigner. // en va de même pour les étrangers. Aucune préoccupation d’ordre sanitaire ne figure dam les dispositions relatives au séjour en France de ces gens-là. »
Pourquoi avoir fait disparaître la référence à la tuberculose ? Serait-ce parce qu’il s’agit d’une maladie moins infamante que la syphilis ? Pourquoi avoir retranché la fin de l’article, sinon parce qu’elle dément l’affirmation d’une vindicte spécifique à l’égard des coloniaux ? Décidément, les régimes totalitaires, qui effaçaient des photographies officielles les personnalités tombées en disgrâce, n’ont pas le monopole d’Anastasie, mais il est vrai que les mauvaises causes appellent toujours de mauvais procédés. Le propos — dans sa version non censurée — de L’Ami du peuple reflète un sentiment très répandu, d’ailleurs, y compris chez les scientifiques, à en juger par les observations de deux médecins publiées dans le Bulletin de l’Académie de médecine en 1926 : à l’issue d’une enquête conduite à Paris et dans les grands ports, Marseille, Le Havre, Rouen, Bordeaux, ils concluent que « les indigènes (p.212) et les étrangers contribuent pour une part qui est loin d’être négligeable, à entretenir et à propager la syphilis en France ‘ Pauvres étrangers… Les Polonais, pourtant blancs et chrétiens, sont considérés comme irrémédiablement inassimilables car « un mur invisible » les sépare des Français, au cœur même des corons, sur le carreau ou dans les galeries des mines où ils se côtoient tous les jours. « Un bref salut, et c’est tout… La réponse est nette : aucune assimilation. » La faute, d’ailleurs, leur en incombe car, pour le commissaire spécial de Nantes, « ils n’ont à aucun degré le don de l’assimilation ». Ils sont, en outre, intellectuellement bornés, et il faut les diriger de près : laisser au Polonais « trop d’initiative, c’est s’exposer à voir devenir stériles ses qualités les meilleures ».
C’est vrai aussi des Hongrois, « grands gaillards robustes et sains, d’aspect un peu frustre »2, que cette définition rapproche de celle que la littérature raciste donne parfois du Noir. Qui croit que l’Arabe jouant du couteau constitue une image originale se trompe encore. La sauvagerie des Italiens, leur esprit sanguinaire, leur traîtrise sont fréquemment évoqués dans les rubriques des faits divers.
1. Cité par R. Schor, L’Opinion française et les étrangers, p. 419. 2. Cité in ibid., p. 144, 145 et 146.
(p.216) Combien de fils, ou petit-fils de Rital, de Polack, de Cloutje, de Pingouin et de Portos se reconnaîtront dans ces quelques mots qui disent, sans pathos, la dureté d’une jeunesse de labeur ? Combien d’enfants du Limousin – ces bouffeurs de châtaignes – ou de Bretagne – Bretons têtes de c… ! — arrachés à leur terre par l’exode rural peuvent y lire leur propre histoire ?
(p.220-221) Comment nier, cependant, ces propos du fondateur de la Ve République, prescrivant à son
ministre de la Justice de limiter « l’afflux des Méditerranéens et des Orientaux », car sa France « c’est un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, de religion chrétienne » ? N’est-ce pas la preuve, pour les auteurs de La République coloniale ‘ que pour le général de Gaulle, qui n’imaginait pas que son village pût s’appeler Colombey-les-deux-Mosquées, la France devait tenir à l’écart l’immigration coloniale ou post-coloniale ? Deux citations isolées de leur contexte et tout est dit.
Inutile, donc, d’évoquer cette clause des accords d’Évian qui étend aux Algériens, devenus des étrangers avec l’indépendance de leur pays, les privilèges accordés deux ans auparavant aux ressortissants des colonies d’Afrique noire et de Madagascar : la faculté de s’installer librement en France et d’y jouir de tous les droits des citoyens français à l’exception des droits politiques ; le droit de faire reconnaître, à tout moment, leur nationalité française. Inutile de rappeler que 400 000 Algériens prennent le chemin de l’ancienne métropole coloniale entre 1962 et 1972, tandis que s’amorce également, en ce début des années 1960, une immigration noire, notamment en provenance des anciennes colonies d’Afrique.
1.N. Bancel, P. Blanchard et F. Vergés, La République coloniale, p. 40-41. |
|
|
1733 |
correspondance de Voltaire (t. IX édition Pléiade, fév.1733) (dans un dialogue imaginaire où il s’en prend notamment à l’esclavagisme) :
|
|
|
1876 |
Forest Philippe, 50 mots clés de la culture générale contemporaine, éd.Marabout, 1991
Racisme (p.264) Sans crainte de se discréditer, le philosophe français Ernest Renan pouvait ainsi écrire, en 1876, dans sa « Préface aux dialogues et fragments philosophiques » : «La meilleure base de la bonté, c’est l’admission d’un ordre providentiel, où tout a sa place et son rang, son utilité, sa nécessité même. Les hommes ne sont pas égaux, les races ne sont pas égales. Le nègre, par exemple, est fait pour servir aux grandes choses voulues et conçues par le Blanc. »
|
|
1940-45 |
Adler Laure, Dans les pas de Hannah Arendt, éd. Gallimard, 2005
(p.165) VI PARIA Les camps de la honte
Ils tenaient la France pour le pays de la justice, de l’égalité, de la fraternité. Ils avaient vécu l’exil comme une obligation de survie, une possibilité de lutte et de résistance contre le nazisme, un déchirement aussi. Brecht l’a exprimé, au nom de tous, dans un de ses poèmes : Nous sommes expulsés, nous sommes des proscrits Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer mais l’exil1. Le traitement infligé aux réfugiés allemands en France figure depuis peu dans les livres d’histoire. Il constitue une sorte de trou noir, une zone d’effacement de la mémoire collective. Une fois la guerre déclarée, le 3 septembre, ces émigrés deviennent du jour au lendemain des ressortissants d’une puissance ennemie. Ils ont vingt jours pour se présenter au commissariat de leur résidence. Sur les colonnes Morris, de grandes affiches les invitent à le faire au plus vite. Ceux qui tardent seront arrêtés.
Deux policiers arrivent ainsi chez un réfugié antinazi. « Suivez-nous, c’est pour une vérification. […] Prenez donc un pull-over. Les nuits sont fraîches. Emportez aussi une couverture, une fourchette, une cuillère. » Cet homme a déjà entendu ce genre de conseils. Ce sont ceux dont on a gratifié son père quand les nazis sont venus le chercher à Berlin2. Il (p.166) s’appelle Claude Vernier. Sans nouvelle de son père, face à la montée du péril nazi, il a choisi la France comme terre d’asile et havre de paix. Il sera embarqué manu militari pour le stade de Colombes, où Heinrich Blücher se trouve déjà en compagnie de Walter Benjamin et de plus de vingt mille autres réfugiés. Ils ont droit à une fourchette et un couteau. La plupart pensent qu’ils vont y rester quelques heures. À Hannah, Heinrich écrit : « J’ai trouvé ici tous les copains y compris le malheureux Benji. » Certes les nuits sont fraîches, mais il pense à elle en regardant les étoiles. Il se montre rassurant : « Tous les militaires et les agents sont pleins de gentillesse. Il ne manque rien sauf mon couteau, mon briquet et toutes mes allumettes. » II ne sait rien : Y aura-t-il permission de visite, possibilité d’envois de paquets ? « […] foule énorme, conditions précaires, ma petite, fais de ton mieux, je vais le faire aussi3. »
La solidarité s’installe. Les plus vaillants s’occupent des plus faibles, leur donnent des couvertures, se chargent de la corvée d’eau, parlent sans s’arrêter pour leur remonter le moral. Si Heinrich est porté par la force de son amour et son désir de se marier — ils viennent de déposer aux autorités françaises leur demande —, Benjamin, fatigué, déprimé, réagit mal psychologiquement et physiquement.
À Adrienne Monnier, son amie qui l’a toujours soutenu et l’a hébergé dans sa librairie, il écrit : « Nous tous, nous nous trouvons frappés avec la même vigueur par l’horrible catastrophe. Espérons que les témoins et les témoignages de la civilisation européenne et de l’esprit français survivent à la fureur sanglante de Hitler4. »
Dans le stade de Colombes, plus de vingt mille personnes vivent dans des conditions difficiles. Certains sont entassés debout, dans les virages, d’autres campent dans les tribunes. Les chanceux, comme Heinrich et Benji, se font une place sur la pelouse. Matin, midi et soir, on leur donne du pain et du pâté. Les installations sanitaires du stade étant fermées à clef, il faut se mettre à deux pour permettre aux plus âgés de monter sur des tonneaux à bord tranchant pour satisfaire leurs besoins. Interdiction de se laver. Impossible de se changer puisque les colis ne sont pas remis.
(p.167) Seuls les hommes, parmi les réfugiés, ont été arrêtés. Par des camarades d’exil, Hannah apprend où est enfermé Hein-rich. Elle apporte des lainages, des boîtes de sardines, et reste des heures entières avec ses camarades. Des milliers de conserves et de tablettes de chocolat, des centaines d’écharpes de laine seront déposées aux portes du stade et jamais distribuées. Le soir, pour se réchauffer, Heinrich chante avec les copains La Marseillaise dans les allées cendrées. Interdiction est faite aux médecins réfugiés de soigner leurs compagnons de détention. La nuit, ils tentent de dormir, surveillés à la lampe torche par des gardes mobiles qui les frappent à coups de crosse à la moindre protestation.
Le 18 septembre, Heinrich est envoyé dans le Loir-et-Cher dans le camp de rassemblement de Villemalard, avec entre autres ses amis Peter Huber et Erich Cohn-Bendit. Il peut écrire à Hannah. « C’est pas pour le grand voyage. Pour une fois ça ira. » II a le droit de recevoir un paquet. Elle lui enverra une malle de chandails, de livres et deux pipes. Elle s’inquiète de l’état de santé de Heinrich, lequel tente, dans son mauvais français, de la rassurer : « Je ne suis pas bavard parce ce qu’il n’y a pas lieu en temps de guerre pour la bavar-derie. Surtout il ne faut pas faire tant de bruit de soi-même5. » II ne lui parle ni de son séjour à Blois et de leur installation précaire dans les roulottes du cirque Amar, ni des nuits sous la pluie dans les bottes de foin. Il ne lui raconte pas sa rage d’être enfermé dans ce camp où ils vivent dans un état de complète passivité. Il n’évoque pas les insultes de ses gardiens, qui considèrent ces réfugiés allemands comme des ennemis vaincus. Il lui cache le désespoir qui le saisit, lui et ses camarades, émigrés politiques, Juifs, antifascistes sans parti, combattants de la guerre d’Espagne, évadés de Dachau, devant l’attitude de la France. Il ne s’étend pas sur ce froid qui commence à habiter son corps, sa fatigue à aller, chaque matin, dans des champs gelés, encadré par des militaires, arracher les betteraves. Il préfère évoquer la beauté du paysage, lui dire qu’il travaille sur Descartes, sur Kant. Malgré tous ses efforts, Hannah ne peut obtenir de droit de visite, au contraire d’Anne Weil, sa meilleure amie, qui vient d’obtenir la nationalité française. Mais elle se bat avec tant d’obstination (p.168) qu’elle finit elle aussi par obtenir l’autorisation de le voir. Le dimanche 15 octobre, elle prend le train pour Blois, puis arrive à Villemalard. Enfin. Hannah et Heinrich tombent dans les bras l’un de l’autre.
Cette visite donne des forces à Heinrich, de plus en plus malade, en proie à des crises de coliques néphrétiques. Ses lettres, empreintes de courage et de fatalité, impressionnent par leur modestie et leur profondeur. Au lieu de gémir, il se porte au secours des plus démunis, soigne son ami Alfred Cohn, se plonge dans les œuvres de Kant sur la morale, conforte ses camarades. Arthur Koestler est interné au camp du Vernet, en Ariège, Walter Benjamin au camp de Saint-Joseph, près de Nevers, les écrivains Alfred Kantorowicz et Lion Feuchtwanger au camp des Milles, d’autres exilés allemands antifascistes à Saint-Cyprien, Angles, Gurs, Rieucrois, Villerbon, Montargis, Mont-bard, Saint-Julien… En novembre 1939, dix-huit à vingt mille hommes sont enfermés dans des camps français au seul prétexte de leur nationalité allemande. Les ennemis les plus farouches de Hitler et du nazisme sont internés parce que la guerre a été déclarée… au dictateur. Tous veulent pourtant le combattre, mais la France ne les autorisera pas à rejoindre les rangs de son armée. Réquisitionnés dans l’urgence, les camps relèvent d’ailleurs du ministère de la Guerre. Aucun n’est destiné à accueillir pendant si longtemps autant de personnes arrivées dans un état de dénuement extrême.
À Villemalard, il n’y a ni électricité ni chauffage. Heinrich, toujours aussi digne, n’évoque pas la dégradation de ses conditions de vie. Tout juste dit-il qu’il fait froid. Avec un peu de chance, écrit-il à Hannah, le beau temps reviendra avec la lune croissante. Il trouve de la force dans leur amour : « Je vois encore dans la lumière de tes yeux le reflet de ce temps et je le sais aussi dans les miens6. » L’hiver arrive. Les maladies se multiplient : tuberculose, fièvres, troubles cardiaques. On ne sait pas encore aujourd’hui combien de réfugiés, hommes, femmes, enfants, sont morts dans ces camps. Les recherches, initiées par Gilbert Badia et Denis Peschanski, ne font que commencer7. Elles révèlent déjà les conditions dramatiques (p.169) qui étaient celles de ces camps de la honte qui, pour les plus importants comme ceux du Vernet, de Gurs ou de Saint-Cyprien, avaient été créés pour recevoir les combattants et les réfugiés de l’Espagne républicaine vaincue. Ils dorment à deux cents dans des baraquements insalubres, sans couverture, sur de la paille humide infestée de vermine. Les « intellectuels » sont plus particulièrement affectés aux corvées de latrines. Dans leurs Mémoires, certains affirmeront que ces camps supportaient la comparaison avec Dachau et Buchenwald8. Heinrich attend l’arrivée d’une commission de criblage, qui doit répartir les étrangers en plusieurs catégories, et espère pouvoir sortir. À Paris, Jules Romains, Paul Valéry, Adrienne Monnier, entre autres, s’agitent pour essayer de les faire sortir. Le Pen Club aussi, qui réussit à faire libérer Alfred Cohn pour cause de maladie. Par décision ministérielle, et grâce à l’opiniâtreté d’Adrienne Monnier, Benji quitte le camp des « travailleurs volontaires » de Nevers fin novembre. Caché à Lourdes, il se réfugie dans ses rêves et aspire à être enterré dans un sarcophage de mousse9. Comme tant d’autres, il enrage de ne pas être plus utile aux adversaires de Hitler. Le Congrès juif mondial s’organise à son tour pour porter secours aux prisonniers, alors que Hannah n’a plus le droit de voir Heinrich. Début novembre, elle obtient néanmoins, par un passe-droit, qu’une de ses amies, Juliette Stern, lui rende visite. Celle-ci lui apporte un sac de couchage et une pleine malle de nourritures. Heinrich partage tout avec ses camarades. Il demande à Juliette de dire à Hannah que tout va bien, alors qu’il souffre terriblement des reins et traverse une période de grave désarroi.
Hannah s’efforce toujours de le faire libérer. Elle débarque à son tour à Villemalard dans la seconde semaine de novembre, et tente d’intercéder auprès des autorités. Déception. Seuls sont autorisés à sortir les Allemands mariés à des Françaises. Hannah essaie alors d’inscrire Heinrich sur la liste des malades, mais ce dernier s’y oppose. Il veut combattre. À cinq reprises, il a signé des papiers attestant sa volonté de remplir ses devoirs militaires envers la France. Il en a le droit (p.170) puisqu’il bénéficie du droit d’asile. « J’espère que notre sort sera décidé par le gouvernement. » II calme l’impatience et l’angoisse de Hannah. « Je t’aime, mon cœur, je t’aime, je ne sais plus dire comment10. »
Hannah va de faux espoirs en déceptions. Le commandant du camp libère les mutilés, pas les malades. De plus en plus faible, Heinrich est hospitalisé à l’infirmerie alors que les rumeurs les plus folles circulent dans les baraquements. L’une d’elles rapporte que les hommes de plus de quarante ans pourraient être libérés et affectés à des travaux d’utilité publique pour le ministère de la Défense nationale. Heinrich croise les doigts. Il a quarante ans depuis dix mois et cela le sauvera. Le 15 janvier 1940, une minorité de réfugiés allemands et autrichiens sont libérés pour cause d’« inaptitude médicale aux camps ». Mais la libération d’un réfugié ne signifie pas forcément sa mise en liberté. Certains, qui ne sont pas considérés comme des civils par le gouvernement français en guerre, sont renvoyés dans d’autres camps en tant qu’« étrangers dangereux et indésirables ».
Grâce à une étude portant sur les camps d’internement11 de septembre 1939 à mai 1940, on sait que, sur les deux cent cinquante-quatre Allemands internés à Villemalard en décembre 1939, quatorze seulement furent libérés début 1940. Heinrich est l’un d’eux. En principe, ces « libérés » pouvaient rejoindre leur lieu de résidence antérieure. En principe seulement, car les militants communistes, les suspects du point de vue national et les « étrangers dangereux et indésirables » sont transférés dans un autre camp. Heinrich, pourtant passible de ces trois chefs d’accusation, échappe à un nouvel emprisonnement et arrive sain et sauf à Paris où l’attendent Hannah et Martha.
La première sortie de Heinrich est pour la mairie. Accompagné de Hannah, il présente ses papiers attestant son divorce et demande l’autorisation de se marier. La cérémonie a lieu le 16 janvier 1940 à la mairie du XVe arrondissement. Sans chichis, et avec une certaine gravité, Hannah et Heinrich se marient juste à temps pour bénéficier du certificat de mariage des réfugiés. Deux mois plus tard, l’administration parisienne refusera de le leur délivrer. Un drame puisque ce (p.171) document était indispensable pour obtenir ensuite le précieux emergency visa, le « visa d’urgence » américain.
Hannah et Heinrich reprennent ensemble leur vie faite d’incertitude et de précarité, et courent à chaque instant le risque d’être de nouveau arrêtés. Pour tenter de l’éviter, ils décident de se mettre sous la protection du Joint Committee, qui finance en France la plupart des organisations de secours juives, et s’est fixé comme but de secourir les populations juives en Europe. Ils espèrent, grâce à l’intervention d’Adrienne Monnier, qui connaît un fonctionnaire important au Quai d’Orsay, quitter le territoire français et partir pour les États-Unis.
Dès la fin janvier, en vue de leur prochain départ, Hannah prend avec Heinrich et Benji des cours particuliers d’anglais. Ils s’inscrivent également sur la liste de l’Emergency Rescue Committee qui s’efforce de venir en aide à des intellectuels antifascistes en tentant l’obtention d’un visa d’urgence. Désormais, il ne suffit plus de franchir les chicanes administratives pour l’obtenir ; il faut encore bénéficier de lettres de recommandation, d’une attestation de ressources, et de la chance d’être inscrit sur la liste des visas hors quota ou d’appartenir à la catégorie des « non-immigrants » ! Heinrich et Hannah lisent Lumière d’août de Faulkner et le Journal de Gide. Ils espèrent chaque jour pouvoir partir et quitter la France où ils sont de plus en plus indésirables, et où leur situation ne cesse de s’aggraver.
La fuite
Le 5 mai 1940, cinq jours avant l’offensive allemande contre la France, ils apprennent par les journaux que le gouverneur général de Paris ordonne à tous les réfugiés allemands de dix-sept à cinquante-cinq ans, hommes et femmes, originaires d’Allemagne ou de Dantzig, de se faire connaître. Les hommes sont conduits à la caserne des Invalides pour être emmenés, le 14 mai, au stade Buffalo. Les femmes le lendemain au Vélodrome d’Hiver.
(p.172) Hannah laisse sa mère, qui a dépassé l’âge limite, dans l’appartement de la rue de la Convention et prend le métro pour se rendre au Vel’ d’Hiv. Elle y restera une semaine, dormant sur une paillasse dans les gradins, auprès de la maîtresse de Fritz Frànkel, Franze Neumann, et de deux autres femmes : on isole les détenues par groupes de quatre pour éviter les mouvements de foule. Parfois, un avion militaire survole la verrière du bâtiment. Des femmes deviennent hystériques. Avec deux cent cinquante internées, Hannah choisit Lotte Eisner comme déléguée pour parlementer avec les officiers français des problèmes de nourriture et d’hygiène. Hannah se porte au secours de toutes ces femmes qui pleurent, sans nouvelles de leurs amis, de leurs maris. Kaethe Hirsch, une de ses amies, confirmera la nervosité collective, l’absence d’informations de l’extérieur. Le 23 mai, des soldats français les transportent en autobus jusqu’à la gare de Lyon. On les insulte : « Ah ! La cinquième colonne. Hitler vous paye bien12?»
Au stade parisien de Buffalo, Heinrich se retrouve en-fertné avec trois mille réfugiés. Des tracts, introduits clandestinement, les informent que le gouvernement français veut les transférer dans des camps du sud de la France. Quelques jours plus tard, par groupes de cent, ils sont emmenés en camion hors de la capitale, sous une sévère surveillance policière. Blücher se retrouve dans un camp d’internement qui sera évacué quand les Allemands entreront dans Paris.
De son côté, Hannah est embarquée dans un train, en direction de Gurs. Il fait horriblement chaud. Les femmes ont soif. À leur arrivée, un scout veut leur donner de l’eau. Une sœur de la Croix-Rouge intervient : « Ne donnez pas d’eau à ces gens-là. Ce sont des gens de la cinquième colonne13. » Hannah arrive à Gurs le 23 juin 1940, le lendemain de l’armistice. Le camp compte alors neuf mille deux cent quatre-vingt-trois détenues. Les conditions d’hébergement sont rudes et les baraques déjà dégradées. Le camp se transforme en bourbier à la première pluie. Condamnées à vivre dans cet environnement, des détenues s’organisent et créent des coopératives d’entraide pour échanger leurs vivres, leurs vêtements et leurs savoir-faire. Hannah participe à cet élan de (p.173) courage et de solidarité et donne toutes ses forces à ce combat collectif des prisonnières. Elle lutte, comme elle le peut, contre la saleté, la misère, l’humiliation. Les détenues sont parquées dans des îlots par groupe de soixante. Son amie Lotte Eisner se trouve dans l’îlot 3, où tous les soirs l’officier responsable vient, avec un fouet, chercher la plus jolie fille. En échange de ses faveurs, il lui donne à manger.
Les responsables de cantine obtiennent bientôt une autorisation quotidienne de sortie par îlot pour aller acheter du lait chez des paysans des environs. Hannah fait partie de celles qui se battent pour de meilleures conditions matérielles et luttent auprès de leurs gardiens pour obtenir un minimum d’hygiène. Elle rejoint un collectif de femmes qui organise des cours d’histoire et de langue. Dans les baraques, chacune aménage son coin du mieux qu’elle peut : elles n’ont pas le droit de se changer et la paille qui sert de litière, vite sale et humide, n’est pas renouvelée. La saleté régnant dans le camp oblige les femmes à conserver la nuit leurs vêtements de jour. De toute façon, elles sont arrivées sans rien et ne peuvent rien se procurer à l’intérieur du camp. Elles ont droit à une douche tous les quinze jours. Dans cet enfer de Gurs, qui l’habitera à tout jamais, Hannah estimera plus tard, en 1941, dans une correspondance inédite14, avoir tous les jours côtoyé la mort et sérieusement songé à se suicider. Vingt-cinq personnes mouraient là quotidiennement, quatre mille enfants tentaient d’y subsister aux côtés des neuf mille femmes et des mille cinq cents hommes de plus de soixante-dix ans, eux aussi soumis à des conditions effroyables.
Confrontée à cet enfer quotidien, Hannah ne cédera pas au désespoir. Au contraire, elle s’engage de plus en plus dans l’action collective et proteste avec ses compagnes d’infortune auprès des soldats français, postés devant la double barrière de barbelés qui les dissuade de toute velléité de fuite, contre cet internement abusif. Elle continue à lutter, malgré la certitude qui l’habite : la France les a enfermés pour les laisser mourir. Comme l’écrira une de ses codétenues, Hanna Schramm : « Nous avions perdu notre passé, nous n’avions plus de patrie, sur notre avenir était suspendu un nuage noir : / l’ombre menaçante de la victoire de Hitler15. » La lutte collective (p.174) se transformera en un violent courage de vivre, et donnera à Hannah un optimisme insensé qui renforcera son désir de chercher à s’enfuir du cloaque16. La Gestapo entre début juillet 1940 dans le camp. Elle vient y chercher les rares internées nazies. Une Allemande d’origine juive prend à part un officier pour lui demander des nouvelles de sa chère Allemagne, et se plaint auprès de lui de la mauvaise nourriture française. La Gestapo n’emmena ce jour-là que celles qui demandaient à retourner en Allemagne, mais elle revint chaque jour chercher des émigrées pour les emprisonner.
Hannah convainc ses camarades de rester mobilisées. Le pire piège est de s’asseoir par terre et de ne plus rien faire, de s’apitoyer sur son sort et de ne pas garder l’espoir de fuir. L’occasion va se présenter, en effet, après le 20 juillet, comme elle le racontera en 1962 au magazine américain Midstream : « Quelques semaines après notre arrivée au camp, la France était battue et toutes les communications interrompues. Dans le chaos qui suivit, nous parvînmes à mettre la main sur des papiers de libération grâce auxquels nous fûmes en mesure de quitter le camp17. » Ce moment de battement ne dura que quelques jours. Ensuite, tout redevint comme avant, et les possibilités d’évasion quasi impossibles.
Hannah, qui avait prévu ce retour à la normale, supplia ses camarades de saisir leur chance et de s’enfuir avec elle. « C’était une chance unique, mais qui signifiait qu’il fallait partir avec pour seul bagage une brosse à dents. » En compagnie de deux cents femmes, Hannah Arendt choisit la liberté. Quelques mois plus tard, sous l’administration de Pétain, les camps deviennent infiniment plus dangereux que sous Daladier. Les opposants à l’Allemagne hitlérienne sont livrés à la Gestapo puis assassinés. À partir du 27 septembre 1940, les autorités allemandes édictent la première ordonnance sur le recensement des Juifs en zone occupée quelques jours avant la loi du 3 octobre 1940 du gouvernement de Vichy portant sur le statut des Juifs et définissant « la race juive », ce que ne faisait pas l’ordonnance allemande. Pleins pouvoirs sont donnés aux préfets pour interner les Juifs étrangers. Le 22 octobre, (p.175) six mille cinq cent quatre Juifs sont expédiés à Gurs avec le concours des autorités françaises. Le camp d’internement, devenu camp de concentration, verra la majorité de ses internés envoyés en camp d’extermination où ils mourront entre 1942 et 1943.
Hannah s’enfuit donc de Gurs à pied avec sa brosse à dents et l’intention de rejoindre son amie Lotte Klenbort, qui avait réussi à s’échapper de Paris occupé et vivait dans une petite maison près de Montauban. La voilà sur les routes, dans cette atmosphère de débâcle, seule, sans nouvelles de son mari. Des centaines de femmes sont dans son cas. On les appelle, dans la région du Sud-Ouest, les « gursiennes ». Hannah envoie des télégrammes dans tous les camps de la France non occupée pour retrouver Heinrich, elle marche des heures, dort dans des fermes où, en échange d’un lit — elle n’a pas un sou —, elle travaille le jour dans les champs. Elle est épuisée, affolée. Toute la région vit dans un état de grande confusion : un décret préfectoral enjoint tous les anciens internés de Gurs de quitter le département des Basses-Pyrénées dans les vingt-quatre heures, sous peine d’être à nouveau emprisonnés, pendant qu’un décret de Vichy interdit à tout étranger de voyager et de quitter son domicile. Hannah est une sans-logis, une sans-papiers, une sans-argent.
Elle parvient finalement à Montauban où elle retrouve Lotte qui la soigne et la nourrit dans sa petite maison de deux pièces, à une dizaine de kilomètres de la ville, où se cachent déjà Renée Barth et sa fille, ainsi que le petit Gaby Cohn-Bendit18. Hannah souffre pendant quelques jours d’un fort rhumatisme dans les jambes, conséquence de sa longue marche, qui la tient alitée. Dès que ses forces reviennent, Hannah part en vélo à Montauban pour tenter d’avoir des nouvelles de Heinrich. La ville est devenue le point de convergence de tous les évadés des camps. Son maire, socialiste, opposé au gouvernement de Vichy, a décidé d’en faire une ville ouverte à tous les réfugiés, à qui il affecte tous les logements laissés vides après la débâcle. |
|
|
1940-45 |
Chronique de la seconde guerre mondiale, éd. Chronique, 1990
Septembre 1941 – p.226« Le Juif et la France » attire les foules Paris, septembre
Au palais Berlitz, l’exposition « Le Juif et la France » connaît depuis le 5 septembre un grand succès. Dénoncé comme l’ennemi juré de l’Europe, le Juif y est décrit à grand renfort d’affiches, de livres, de photographies, de statistiques. Les visiteurs doivent apprendre à reconnaître au premier regard son type physique caractéristique, ou prétendu tel. Le Juif est censé avoir le nez crochu, les yeux humides, l’allure négligée, des mimiques faciales particulières, Les organisateurs ont bénéficié des subventions de l’ambassade d’Allemagne et des conseils des « spécialistes scientifiques » de l’Institut d’ études des questions juives, que dirige un pseudo-ethnologue, le médecin suisse naturalisé français George Montandon. Ce dernier est l’auteur de divers opuscules racistes et antisémites, l’Ethnie française, Comment reconnaître le Juif, qui ne s’embarrassent pas de nuances. Un tel pot-pourri de documents ne peut que rassurer et conforter le « Français moyen » dans son antisémitisme, Un anti-sémitisme qui semble être devenu un devoir civique.
|
|
|
1940-45 |
J. Hislaire, la France malade de son antisémitisme, LB 27/02/1986
(Jean Ferniot, romancier) « Ceux qui nous crachaient au visage,à nous les Juifs, étaient de bons Français. » » C’ est facile de charger les nazis et Pétain de la responsabilité des atrocités dont les Juifs ont été victimes. On oublie qu’ ils ont trouvé parmi les Français des complicités actives. »
|
|
|
1940-45 |
J.-P. de Rijck, Dangers nationalistes, Le Vif, 23/03/1990
(antisémitisme français) « L’ exemple manquant n’ est-il pas cette rafle du juillet 1942, organisée par les pétainistes et non par la Gestapo (plus de sept mille personnes gazées à Auschwitz?) (…) »
|
|
|
1940-45 |
Jacqueline Beaulieu, Des faits occultés durant 50 ans, LS, 20/04/1991
« De 1939 à 1944, la France a eu aussi ses camps de concentration. Une histoire qu’ il faut enfin regarder en face. » (Les camps du silence » en France et sur FR 3 – de Bernard Mangiante) « Dès février 1939 s’ est posé le problème de l’ accueil des républicains espagnols défaits face à Franco. Avec eux, des membres des Brigades Rouges internationales seront regroupés dans des baraquements sur les plages du Roussillon. Au moment du pacte germano-soviétique viendront, en juin 1940, des communistes français emprisonnés à Gurs, Argelès et Saint-Cyprien. » « En octobre de la même année, ce sera le tour des Allemands anti-fascistes ou juifs qui avaient trouvé refuge en France depuis le nazisme. France, terre d’asile! » « Loin de tenter de dissimuler ces hommes, ces femmes et ces enfants menacés de mort par le nazisme, la France va les maintenir dans des camps dans des conditions effroyables. Certes, il n’ est pas question ici comme dans les camps allemands de travail forcé ou de liquidation finale, mais la faim, le froid, le manque d’ hygiène et donc les maladies règnent dans les baraquements sans fenêtres. » « Ce qui fait le plus mal dans le reportage de Mangiante, c’est d’ entendre les anciens détenus parler de leurs gardiens, les Gardes mobiles français. De se rendre compte que la grande majorité d’ entre eux, non seulement acceptaient le rôle de garde-chiourme, mais encore l’accomplissaient en toute vigilance et en toute tranquillité. Et ce jusqu’ au moment d’expédier ces malheureux dans des lieux plus sinistres encore et qui avaient pour noms Buchenwald et Dachau. »
|
|
|
1940-45 |
Jacques Cordy, Jacques Corrèze, de l’ activisme à la multinationale, LS 28/06/1991
Ancien membre de la Cagoule dès 1936 puis de deux mouvements collaborationnistes et antisémites pendant l’ Occupation avant de s’ engager dans la Légion des Volontaires français contre le bolchevisme. La Cagoule, née en 1934 chez des ultras de l’ extrême-droite française, avait pour but, par la violence, d’ abattre 3 ennemis: le bolchevique, le juif et le franc-maçon.
|
|
|
1940-45 |
Jacques Cordy, Touvier: remous pour la libération de l’ ex-milicien « collabo » de Lyon, LS 13/07/1991
Les Accusations précises portées contre lui: . participation à l’ assassinat de Victor BASCH (80 ans), anc. prof. de Sorbonne et prés. de la Ligue des droits de l’ homme et de sa femme en janvier 44 . rafle de 50 réfugiés espagnols, en avril 44 . envoi de 7 otages juifs à lamort en juin 44 . tortures infligées aux résistants Emile Médina et Robert Nant.
condamné à mort par contumace en 1945 et 1947 avait échappé à la justice grâce à l’ aide, d’ abord de l’ archevêché de Lyon puis par une frange de l’ Eglise catholique trouva refuge avec sa famille de couvent en couvent grâcié en 1971 par le président Georges Pompidou arrêté en mai 1989 procès au printemps 1992?
|
|
|
1940-45 |
Jacques Franck, Drieu La Rochelle, fasciste et suicidaire, LB 09/07/1992
« Son journal intime, 1939-1945 la NRF sous l’ Occupation, les lettres de Jean Paulhan éclairent la « collaboration » intellectuelle en France.’ Not. La NRF parut sous contrôle allemand dès décembre 1940, sous la dir. de Drieu La Rochelle, avec la collaboration de Giono, Jouhandeau, valéry, Montherlant, Eluard, … »
|
|
|
1940-45 |
Jean-Claude Broché, Décès d’ un ancien cagoulard, dirigeant du groupe français L’ Oréal, Jacques Corrèze: de l’ activisme à la multinationale, LS, 28/06/1991
‘Arrêté et condamné à la LIbération, pour son appartenance à deux mouvements collaborationnistes eet antisémites sous l’ occupation et son engagement dans le Légion des VOlontaires (LVF) pour combattre sur le frnt russe aux côtés des Allemands. » Après quoi, il était entré à L’ Oréal et y avait effectué une brillante carrière.
|
|
|
1940-45 |
La famille de Serge Gainsbourg subit le racisme de pas mal de citoyens français pendant la guerre 1940-45. (témoignage de ce compositeur)
|
|
1940-45 |
Laure Adler, Dans les pas de Hannah Arendt, éd. Gallimard, 2005
(p.185) Hannah donne alors l’impression de vivre dans un état d’angoisse profonde et de violente révolte contre la France. Comme Heinrich, elle se considère comme une miraculée et évoque d’abord les conditions de son voyage : « Ça s’est passé relativement bien et nous n’avons presque jamais été battus32. » On notera le « presque ». Un même sentiment de culpabilité étreint la petite communauté allemande antifasciste de Lisbonne. La capitale portugaise est devenue le goulet de l’Europe, la dernière porte d’un immense camp de concentration qui s’étend sur tout le Vieux Continent. |
|
|
1940-45 |
Pierre Stéphany, Un peuple se penche sur ses passés, ARTE 21,20.45, LB 22/07/1993
« Le procès de Vichy et de ses dirigeants a été depuis longtemps instruitet le jugement rendu. Restreint alors à faire le procès des Français qui, dans la proprtion de 8 ou 9ou 10,en 1940, donnèrent leur adhéson enthousiaste à un pétainisme légitimé parune Assemblée nationale dûment réunie. »
|
|
|
1940-45 |
Robert Verdussen, Rafle du Vel’ d’ Hiv:mémoire et polémique, LB 18/07/1992
‘La rafle du Vel’ d’ Hiv du 16 juillet 1942 consistait à parquer au Vélodrome d’ Hiver 13.000 juifs dont 400 enfants promis aux camps d’ extermination. Une telle opération n’ a été possible que grâce aux autorités françaises, c’ et-à-dire au régime de Vichy. »
4500 policiers français passèrent à l’ action le 16 juillet dès l’ aube. « Les pressions, ces dernières semaines, ont été vives sur François Mitterrand pour qu’ il reconnaisse officiellement la responsabilité de l’ Etat français dans la persécution des juifs. En particulier de la part d’ un « comité Vel’ d’ Hiv 1942″ rassemblant quelque deux cents intellectuels de tous bords. »
|
|
|
1923 |
Lucretia Stewart, God-kings of Indochina cast their exquisite spell, The European, 23/02/1994
« In 1923 the young André Malraux, later De Gaulle’s minister of culture, made an expedition to Cambodia precisely for the purpose of vandalising the remote temple of Bantaay Srei and selling the tonne of exquisitely sculpted pink sand-stone that he had hacked from the monument. He was arrested leaving Cambodia and sentenced to three years’ imprisonment, but never actually went to jail. Instead, he described the escapade in a novel, La Voie Royale (1930). »
|
|
1961 |
ARTE – mercredis de l’Histoire : 17 octobre 1961, une journée portée disparue (Alexandre Adler)
« La violente répression d’une manifestation d‘Algériens à Paris, en octobre 1961. » |
|
1961 |
in : TV Spielfilm, 1/ März, p.206 Verordnetes Schweigen, WDR 22.30
„Die Story“ über „die blutige Nacht von Paris“ Paris, 17.10.1961 30 000 algerische Franzosen demonstrieren gegen den Kroeg in ihrer Heimat. Brutale Reaktion der Polizei: tausende Algerier werden festgenommen, 200 getötet und in die Seine geworfen. Zeitzeuge Jacques Panijel drehte einen Film über das Massaker, der nie gezeigt werden durfte.
|
|
|
2003 |
Alain Finkielkraut, Au nom de l’Autre, réflexions sur l’antisémitisme qui vient, Gallimard, 2003
(p.9) 1 . Vigilances
Pendant cinquante ans, les Juifs d’Occident ont été protégés par le bouclier du nazisme. Hitler, en effet, avait, comme l’a écrit Bernanos, déshonoré l’antisémitisme. On croyait ce déshonneur définitif. Il n’était peut-être que provisoire. Ce qu’on prenait pour un acquis apparaît rétrospectivement comme un répit. Et c’est en France, le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de Juifs, que la parenthèse se ferme de la façon la plus brutale. Des synagogues sont incendiées, des rabbins sont molestés, des cimetières sont profanés, des institutions communautaires mais aussi des universités doivent faire nettoyer, le jour, leurs murs barbouillés, la nuit, d’inscriptions ordurières. Il faut (p.10) du courage pour porter une kippa dans ces lieux féroces qu’ on appelle cités sensibles et dans le métro parisien; le sionisme est criminalisé par toujours plus d’intellectuels, l’enseignement de la Shoah se révèle impossible à l’instant même où il devient obligatoire, la découverte de l’ Antiquité livre les Hébreux au chahut des enfants, l’injure « sale juif»> a fait sa réapparition (en verlan) dans presque toutes les cours d’école. Les Juifs ont le coeur lourd et, pour la première fois depuis la guerre, ils ont peur.
Peur où se mêlent étrangement les deux sentiments contradictoires de la sidération et de la répétition. On est affolé, mais pas dépaysé car tous ces incidents ont des précédents, toutes ces attaques éveillent un écho et ravivent d’ anciennes blessures; il n’y a rien dans la haine des Juifs qui ne rappelle quelque chose. Gagnés par l’accablement, ses destinataires ont donc tendance à se dire : « Quand c’est fini, ça recommence… Le passé n’était pas dépassé; tapi dans les replis de la doxa, il faisait le mort en attendant des jours meilleurs. Nous y sommes. Les tabous sont renversés, la censure est levée, le verrou saute : après (p.11) cinquante ans, l’enfer sort du purgatoire, le mal s’ ébroue et s’étale à l’air libre. » Vieux démons, nouveaux débats : c’ est le titre tout naturel du grand colloque international sur l’antisémitisme en Occident qu’a organisé à New York, du 11 au 14 mai 2003, l’Institut YIVO de recherche juive. Le texte de présentation de la rencontre enfonce le clou en ces termes : « Pour nombre d’ observateurs, le refoulé a brusquement fait retour. L’Europe politique, sociale, culturelle semble une fois encore défigurée par son préjugé le plus ancien et le plus ignoble. «
Les observateurs ont assurément raison : l’ antisémitisme n’est pas une idée neuve en Europe. Ils font fausse route cependant, et on s’égare avec eux quand on rabat ce qui arrive sur ce qui est arrivé, comme l’expérience historique pourtant engage à le faire. Voir le déjà-vu dans l’événement, c’est, sous l’ apparence de la sagesse, rêver les yeux ouverts. Invoquer l’inconscient et le déchaînement périodique de ses pulsions immuables, c’est se faciliter la tâche. Parler de retour, c’est enfermer les nouveaux démons dans de vieux schémas. Jeunes démons, vieux schémas : si (p.12) nous voulons affronter la réalité, nous devons scier les barreaux de notre prison rétrospective. Les Juifs, ces familiers du pire, ont » une âme insurprenable « , a dit, citant Rebecca West, Leon Wieseltier, le responsable des pages littéraires du magazine The New Republic. C’est là, justement, que le bât blesse : la compréhension du monde qui vient demande une âme surprenable. Il ne suffit pas d’être sans illusions pour accéder au vrai. Le pessimisme n’a pas droit à la paresse : même les mauvaises nouvelles peuvent être nouvelles; même les démons peuvent être dans la fleur de l’âge et piaffer d’innocence.
– Quelles sont les fondations de l’Europe d’aujourd’hui ? Repose-t-elle sur la culture, c’est-à-dire sur une admiration partagée pour quelques immortels : Dante, Shakespeare, Goethe, Pascal, Cervantès, Giotto, Rembrandt, Picasso, Kant, Kierkegaard, Mozart, Bartok, Chopin, Ravel, Fellini, Bergman ? S’inscrit-elle dans la continuité d’une histoire glorieuse ? . Veut-elle faire honneur à des ancêtres communs ? Non, elle brise avec une histoire sanglante et n’érige en devoir que la mémoire du mal radical. Sous le choc de Hitler, (p.13) notre Europe ne s’est pas contentée de répudier l’antisémitisme, elle s’ est comme délestée d’elle-même en passant d’un humanisme admiratif à un humanisme révulsif, tout entier contenu dans les trois mots de ce serment : » Plus jamais ça ! » Plus jamais la politique de puissance. Plus jamais l’empire. Plus jamais le bellicisme. Plus jamais le nationalisme. Plus jamais Auschwitz.
Avec le temps, le souvenir d’Auschwitz n’a subi aucune érosion ; il s’est, au contraire, incrusté. L’événement qui porte ce nom, écrit justement François Furet, » a pris toujours plus de relief comme accompagnement négatif de la conscience démocratique et incarnation du Mal où conduit cette négation « . Pourquoi précisément l’Holocauste ? Pourquoi Auschwitz et non d’ autres carnages doctrinaux, d’autres oeuvres de haine ? Parce que l’homme démocratique, l’homme des Droits de l’homme, c’ est l’homme quel qu’il soit, n’importe qui, le premier venu, l’homme abstraction faite de ses origines, de son ancrage social, national ou racial, indépendamment de ses méri- tes, de ses états de service, de son talent. En proclamant le droit de la race des Seigneurs à purger (p.14) la terre de peuples jugés nuisibles, le credo criminel des nazis, et lui seul, a explicitement pris pour cible l’humanité uni .verselle. Comme l’a écrit Habermas : « Il s’ est passé, dans les camps de la mort, quelque chose que jusqu’ alors personne n’aurait simplement pu croire possible. On a touché là-bas à une sphère profonde de la solidarité entre tout ce qui porte face humaine. » C’ est d’ ailleurs pour cette raison et pas seulement du fait de son engagement dans la guerre contre le nazisme que l’Amérique indemne s’est crue autorisée, comme l’Europe ravagée, à bâtir au coeur de sa capitale un musée de l’Holocauste et à faire de ce musée un point de repère national. L’assaut méthodique et sans précédent contre l’ autre homme dont l’Europe a été le théâtre renvoie à l’Amérique, plus qu’ à toute autre collectivité politique, l’image inversée d’elle-même. La démocratie du Nouveau Continent a ceci de spécifique, en effet, qu’ elle n’est pas seulement constitutionnelle : elle est consubstantielle à la nation. Il n’y a pas de distinction possible, dans cette patrie sans Ancien Régime, entre le régime politique et la patrie : la forme est le contenu du sentiment national ; l’identité s’ incarne dans la statue de la Liberté.
Certes, et c’est le moins qu’on puisse dire, l’Amérique n’a pas (p.15) toujours été à la hauteur de sa définition : un musée de l’Esclavage aurait indubitablement sa place à Washington. Ce serait cependant chercher une mauvaise querelle aux États-Unis que de les soupçonner de vouloir fuir, dans la confortable évocation d’un génocide lointain, la prise en compte de leurs propres turpitudes. Une stupeur sincère et une horreur sacrée ont inspiré l’ édification de ce mémorial. Comme le rappelait fortement le conseil chargé de sa préparation : « Événement à signification universelle, l’Holocauste a une importance spéciale pour les Américains. Par leurs actes et par leurs paroles, les nazis ont nié les valeurs fondatrices de la nation américaine. »
L’ Amérique démocratique et l’Europe démocratique ressourcent leurs principes communs dans la commémoration de la Shoah. Mais il y a une différence : l’ Amérique est victorieuse ; l’Europe cumule les trois rôles de vainqueur, de victime et de coupable. La solution finale a eu lieu sur son sol, cette décision est un produit de sa civilisation, cette entreprise a trouvé des complices, des supplétifs, des exécutants, des sympathi- sants et même des apologistes bien au-delà des (p.16) frontières de l’ Allemagne. L’Europe démocratique a eu raison du nazisme, mais le nazisme est européen. La mémoire rappelle sa vocation à l’ Amérique, et à l’Europe sa fragilité. Elle ratifie le credo du Nouveau Monde et prive l’ancien de toute assise positive. Elle est pour celui-ci un abîme, pour celui-là une confirmation. Elle nourrit simultanément le patriotisme américain et l’ aversion européenne à l’égard de l’eurocentrisme. Ce qui unit l’Europe d’aujourd’hui, c’est le désaveu de la guerre, de l’hégémonisme, de l’antisémitisme et, de proche en proche, de toutes les catastrophes qu’elle a fomentées, de toutes les formes d’intolérance ou d’ inégalité qu’ elle a mises en oeuvre. Tandis que la sentinelle américaine du « Plus jamais ça » se préoccupe des menaces extérieures, l’Europe postcriminelle est, pour le dire avec les mots de Camus, un « juge-pénitent » qui tire toute sa fierté de sa repentance et qui ne cesse de s’avoir à l’oeil. « Plus jamais moi’. » promet l’Europe, et elle se tue à la tâche. L’ Amérique démocratique combat ses adversaires; l’Europe ferraille avec ses fantômes, si bien que l’invitation à la vigilance se traduit là-bas par la défense (parfois peu regardante sur les moyens) du monde libre et ici par l’insubmersible banderole : » Le fascisme ne passera pas. »
(p.20) Ayant évidemment voté avec la majorité républicaine, je partage son contentement. Comme la foule des réfractaires au Matin brun, je suis soulagé et je savoure le triomphe des gens sympas sur les gens obtus, sans toutefois entrer dans la danse, car ce sont les danseurs qui font aujourd’hui la vie dure aux Juifs. Pas tous les danseurs, bien sûr, mais il faudrait avoir une âme obnubilée par les tragédies advenues pour ne pas le reconnaître: l’ avenir de la haine est dans leur camp et non dans celui des fidèles de Vichy. Dans le camp du sourire et non dans celui de la grimace. Parmi les hommes humains et non parmi les hommes barbares. Dans le camp de la société métissée et non dans celui de la nation ethnique. Dans le camp du respect et non dans celui du rejet. Dans le camp expiatoire des « Plus jamais moi ! » et non dans celui – éhonté – des « Français d’ abord ! ». Dans les rangs des inconditionnels de l’ Autre et non chez les petits-bourgeois bornés qui n’aiment que le Même.
(p.24) Or, comme l’ a lumineusement montré le philosophe américain Michael Walzer dans un article (p.25) publié par la revue Dissent et qu’ aucun périodique français n’ a jugé bon de traduire, il n’y a pas une, mais quatre guerres entre Israéliens et Palestiniens : la guerre d’usure palestinienne pour l’ extinction de l’État juif (et dont relèvent aussi bien les attentats-suicides que la revendication du droit au retour), la guerre palestinienne pour la création d’un État indépendant à côté d’Israël, la guerre israélienne pour la sécurité et la défense d’Israël, la guerre israélienne pour le renforcement des implantations et l’ annexion de la plus grande partie possible des territoires conquis en 1967. Il faut que « les gens qui suivent les informations écrites ou télévisées » soient aveugles à cette quadruple réalité (et aux deux batailles internes qui la prolongent) pour que s’étale, sous leurs yeux scandalisés, l’évidence insoutenable et monotone des persécuteurs en action. Grâce à la médiatisation permanente du conflit, ils sont aux premières loges : ils ne ratent aucun épisode, ils voient tout ce qui se passe, et pourtant, à l’instar d’Emmanuel Todd, ils ne voient rien de ce qui est. Ils balayent, comme on enlève la poussière, les événements du regard. Mauvaise volonté ? Frivolité zappeuse ? Non : hantise du mal radical, ferveur égalitaire, culte de la tolérance. C’ est de la part la plus honorable d’eux-mêmes que procède leur insistante ‘illusion d’optique’, (p.29) comme tous les intellectuels juifs, comme tous les Juifs visibles, je reçois, ces temps-ci, des lettres désagréables. Après la manifestation du 7 avril 2002 contre l’ antisémitisme et le terrorisme, une de mes correspondantes, excédée, m’ a écrit ceci : » J’ai dû voir la police fouiller les personnes qui voulaient traverser le cortège des drapeaux israéliens que les jeunes excités en calotte bleu et blanc arboraient sûrs de leur saint droit. Sur la place un petit « beur » d’ à peine dix ans criait à ses copains visiblement apeurés qui le retenaient : « Si seulement j’ avais une kalachnikov, je leur montrerais, moi ! » Et je savais bien que je me sentais plus proche cette fois de la vérité de ce petit miséreux que de tous les jeunes qui triomphaient d’autosuffisance et de passion méprisante et ignare sous leur calotte blanc et bleu. «
(p.30) Le » petit miséreux » en question n’ a pas encore saisi de kalachnikov. Selon toute vraisemblance, il ne le fera pas et en restera au stade de la provocation verbale. Cette perspective, toutefois, n’ est pas vraiment rassurante car la langue qu’il entend autour de lui et qu’il commence à articuler est la langue de l’ islamisme et non celle du progressisme. La lutte des classes ne lui dit rien, le djihad l’enchante. Ses héros sont des figures religieuses, non des icônes révolutionnaires . Saladin plutôt que Spartacus ou Che Guevara. Il vit dans un autre universel et ce qui le fait enrager, d’ ores et déjà, ce n’est pas le joug du capitalisme et de l’impérialisme sur les prolétaires de tous les pays’ c’est l’humiliation des musulmans du monde entier. Conditionné à souffrir d’Israël comme d’une écharde ou d’une morsure dans la chair de l’Islam, il n’est même plus antisioniste : là-bas, ici, partout, les Juifs, à ses yeux et dans ses mots, sont des Juifs et rien d’ autre.
(p.34) (…) il ne faut pas confondre les ressentiments, ni prendre pour une résurgence de l’ antisémitisme français l’ actuelle flambée de violence contre les Juifs en France. Après avoir été passée sous silence précisément parce qu’elle n’était pas imputable aux » petits Blancs » de la France profonde, cette violence (p.35) d’origine arabo-musulmane a trouvé sinon une approbation littérale, du moins une réception positive, une interprétation bienveillante, une traduction présentable chez les Gaudin antichauvins qui scandent aujourd’hui : » Nous sommes tous des immigrés! » ou : » Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français ! », comme ils entonnaient hier : « Nous sommes tous des Juifs allemands!. », et qui ont tiré de l’histoire cette leçon impeccablement généreuse : quoi qu’il arrive, prendre toujours le parti de l’Autre. |
|
|
2007 |
Jean-Marie C(harles) (Hachy), France / La Légion du déshonneur /, DH 24/02/2007
« Ainsi, l’avocat Vuillemin a eu gain de cause contre la morale mondiale. Maurice Papon est parti, avec au col, l’insigne de la suprême reconnaissance française ! Sa condamnation pour des faits de complicité dans des crimes contre l’humanité n’a pas réveillé la conscience d’un seul homme politique français. Quelle insulte pour tous ceux qui ont perdu la vie des suites de la signature mortelle de ce collaborateur officiel de la grande France. La Légion d’honneur vient de perdre ce qu’elle avait de plus grand : son honneur. Espérons, pour tous ces martyrs, que la justice divine sera plus honnête et courageuse que celle de nos Excellences politiques, qui par leur lâche silence ont une deuxième fois crucifié ces milliers de victimes juives. »
|
|
|
2008 |
in : 14-18, le bruit et la fureur, AL 06/11/2008
Voix off : Jean-Jacques Weber Révisionnisme : les Français accueillis à bras ouverts (sic) en Alsace
|
|
2 Documents

1790s - l'abbé Grégoire, apôtre du racisme
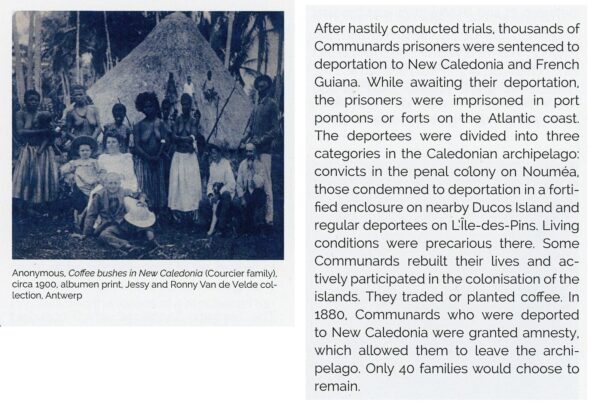
1871- racism in New Caledonia
(1871 – The Commune Paris 1871 Liège 1886, Grand Curtius Exhibition Overview, p.16)
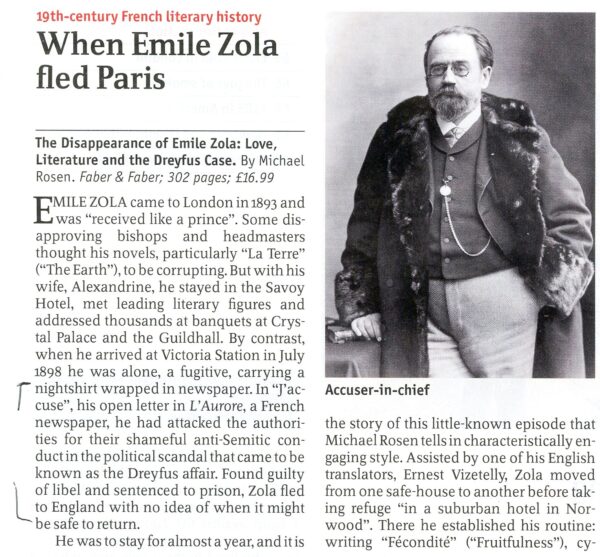
1898 - Emile Zola and the Dreyfus affair
(The Ecojomist, 21/01/2017)

1885 L'artiste françois Bourgona peint l'arrivée à la gare d'Austerlitz d'une immigrée bigoudène, âgée de 15 ans, engagée comme bonne
(Bretagne Magazine Hors Série, nov-déc 2020)

1900s - Des Bretons, ... exposés dans des zoos humains en France
(LB, 10/11/2021)
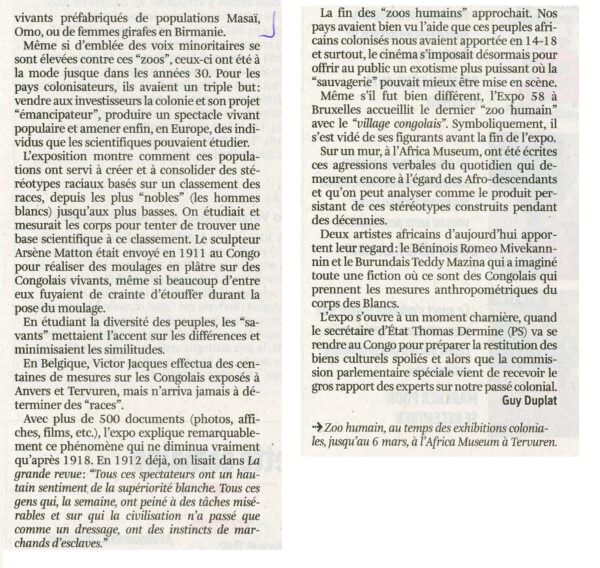
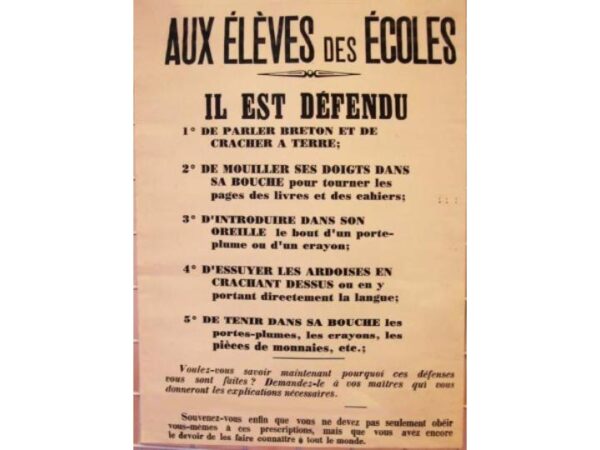
1930s - "Défendu de cracher par terre et de parler breton"

1930s - affiches antisémites en France
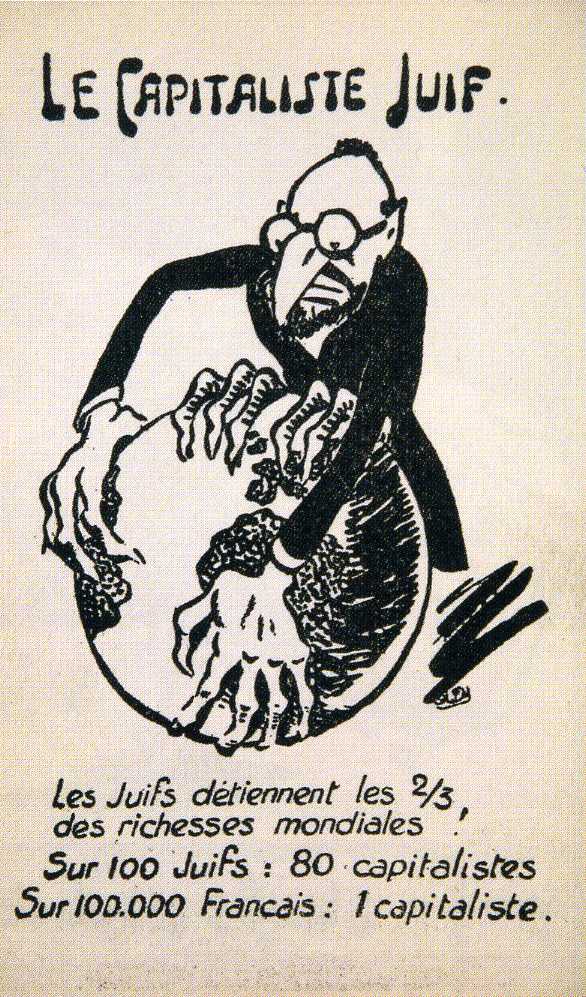

1940s - L'histoire sombre de la police de Vichy
(VA, 19/09/2018)

