
La vérité sur Napoléon, dictateur raciste, voire antisémite
PLAN GENERAL
|
0 Introduction |
|
1 En France |
|
2 Les campagnes |
|
3 Les colonies |
|
4 En Belgique |
|
5 Après Napoléon |
|
6 Bibliographie |
NB Les chapitres de 1 à 6, volumineux, sont traités dans d’autres dossiers. Veuillez cliquer sur la flèche ci-dessus afin de pouvoir les consulter. Merci.
|
0 Introduction |
0.1 Napoléon, un dictateur raciste, un criminel, un despote |
|
|
0.2 un être dépravé, méprisant la femme sexualité: bisexualité, pédophilie, maladies vénériennes |
|
1 En France |
1.0 généralités |
|
|
1.1 le Code Civil |
|
|
1.2 un état policier |
|
|
1.3 une théorie des races |
|
|
1.4 le culte |
|
|
1.5 les Juifs |
|
|
1.6 les déportations: Tziganes, … |
|
|
1.7 la conscription |
|
|
1.8 l’armée |
|
2 Les campagnes |
2.0 sa stratégie militaire |
|
|
2.1 l’Italie |
|
|
2.2 l’Egypte, l’Empire turc |
|
|
2.3 l’Espagne et le Portugal |
|
|
2.4 l’Autriche, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse |
|
|
2.5 la Russie |
|
|
2.6 les pillages |
|
|
2.7 avant, pendant et après Waterloo |
|
3 Les colonies |
3.1 dans les colonies |
|
|
3.2 l’esclavage |
|
4 En Belgique |
4.0 vue générale |
|
|
4.1 la collaboration et la résistance (passive et active) |
|
|
4.2 la conscription et les guerres |
|
|
4.3 un camp de concentration |
|
|
4.4 les réquisitions et les pillages |
|
|
4.5 le marasme économique, la mauvaise gestion et l’endettement |
|
|
4.6 un état policier, la censure et l’injustice |
|
|
4.7 la lutte contre le néerlandais et le wallon |
|
|
4.8 à Waterloo et après Waterloo |
|
5 Après Napoléon |
5.1 Hitler et Mussolini, émules de Napoléon |
|
|
5.2 le mensonge: le culte napoléonien: récupération politique (extrême-droite, …), économique et culturelle > |
|
|
5.3 l’opposition au mensonge, au culte napoléonien > |
> 5.2 le mensonge: le culte napoléonien: récupération politique (extrême-droite, …), économique et culturelle
|
5.2.0 le mensonge: le culte napoléonien |
fanatisme & révisionnisme récupération politique (extrême-droite, …), économique et culturelle |
|
5.2.1 art
|
5.2.1.2 littérature révisionniste 5.2.1.3 peinture révisionniste 5.2.1.4 sculpture révisionniste |
|
5.2.2 patrimoine monumental révisionniste |
|
|
5.2.3 médias
|
5.2.3.1 presse révisionniste 5.2.3.2 film révisionniste 5.2.3.3 articles révisionnistes |
|
5.2.4 mouvements culturels révisionnistes |
|
|
5.2.5 foroms révisionnistes |
|
|
5.2.6 correspondance |
|
|
5.2.7 tourisme révisionniste |
|
|
5.2.8 reconstitutions révisionnistes |
|
|
5.2.9 marches révisionnistes en Entre-Sambre-et-Meuse: hypocrisie & dérives |
5.2.9.1 médias: presse révisionniste; films (vidéos,…) révisionnistes articles révisionnistes |
|
|
5.2.9.2 manifestations révisionnistes irrespect 14-18 & 40-45 |
|
5.2.9.3 commémorations révisionnistes |
|
|
5.2.9.4 embrigadement des jeunes |
|
|
5.2.9.5 drapeaux |
|
|
5.2.9.6 musique |
|
|
5.2.9.7 symboles révisionnistes |
|
|
5.2.9.8 patrimoine monumental révisionniste |
|
|
5.2.9.9 participation à des carnavals; à des meetings politiques |
|
|
5.2.9.10 sites révisionnistes |
|
|
5.2.9.11 agressions physiques & verbales |
> 5.3 l’opposition au mensonge, au culte napoléonien
|
5.3.1 analyses |
|
|
5.3.2 médias |
|
|
5.3.3 manifestations et patrimoine
|
5.3.3.0 parodies 5.3.3.1 commémorations 5.3.3.2 folklore 5.3.3.3 art 5.3.3.4 musées et monuments 5.3.3.5 divers |
|
5.3.4 le vécu
|
5.3.4.1 correspondance 5.3.4.2 justice |
|
5.3.5 actions à méditer
|
5.3.5.1 les symboles du nazisme enlevés 5.3.5.2 les symboles du fascisme toujours en place 5.3.5.3 les symboles du communisme enlevés 5.3.5.4 les symboles du franquisme enlevés 5.3.5.5 les symboles d’une dictature enlevés ailleurs 5.3.5.6 un symbole de l’antisémitisme enlevé en Belgique ? 5.3.5.7 à quand l’enlèvement des symboles rappelant la dictature napoléonienne? |
|
6 Bibliographie |
les livres conseillés |
|
0 Introduction |
0.1 Napoléon, un dictateur raciste, un criminel, un despote |
|
|
0.2 un être dépravé, méprisant la femme sexualité: bisexualité, pédophilie, maladies vénériennes |
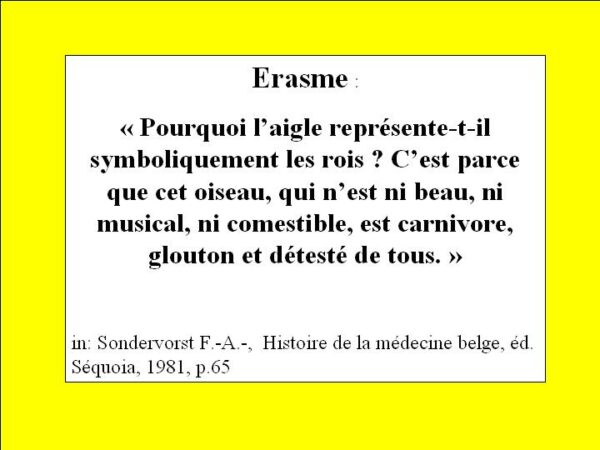
Le philosophe Erasme

Des admirateurs inconditionnels de Napoléon à ceux d'Adolf Hitler...


L'école (francophone) nous a bien menti
(Johan Viroux, in: DH, 19/06/2015)
Napoléon, un dictateur raciste et criminel
En hommage à mes inspirateurs, fidèles à la Belgique, qui ont bien compris le danger de défiler en uniforme du 1er Empire dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, préférant l’uniforme belge ou celui du « 2e Empire »: Philippe Maudoux (Florennes), Claude Mouchet (Morialmé), mon oncle Henri Duchâteau (Le Roux, qui détestait me voir, adolescent, ‘tambourer’ en 1er Empire dans son village) (tous trois anciens prisonniers de guerre), Roger Viroux (mon père), Jean-Claude Rousseau (Biesme), Félix et Marcel Lechat, Fernand Fiévet (Biesmerée), Louis (Boni) Wolf (Haut-Vent), mes professeurs de tambour, et Albert Gosset (Mettet), mon professeur de fifre.
Claude Ribbe (historien français), in: Le crime de Napoléon, éd. Privé 2005
(p.23) Il est temps d’avertir ceux qui, pour les grandes occasions, aiment à s’affubler du bonnet de grognard, qu’il va leur falloir à présent assumer leurs inavouables prédécesseurs.
Jean Baudrillard (sociologue français), in: La société de consommation, ses mythes, ses structures, Folio, 1970
(p.147) Le Néo — ou la résurrection anachronique.
Comme Marx le disait de Napoléon III : il arrive que les mêmes événements se produisent deux fois dans l’histoire : la première, ils ont une portée historique réelle, la seconde, ils n’en sont que l’évocation caricaturale, l’avatar grotesque — vivant d’une référence légendaire. Ainsi la consommation culturelle peut être définie comme le temps et le lieu de la résurrection caricaturale, de l’évocation parodique de ce qui n’est déjà plus — de ce qui est « consommé » au sens premier du terme (achevé et révolu). Ces touristes qui partent en car dans le Grand Nord refaire les gestes de la ruée vers l’or, à qui on loue une batte et une tunique esquimaude pour faire couleur locale, ces gens-là consomment: ils consomment sous forme rituelle ce qui fut événement historique, réactualisé de force comme légende. En histoire, ce processus s’appelle restauration : c’est un processus de dénégation de l’histoire et de résurrection fixiste des modèles antérieurs.
Konrad Lorenz (biologiste autrichien, Prix Nobel de médecine), in: L’agression / Une histoire naturelle du mal, Champs Sciences, 1983
(p.228) ECCE HOMO
Ce sont la déraison et la déraisonnable nature humaine qui font que deux nations entrent en compétition, bien qu’aucune nécessité économique ne les y oblige; ce sont elles qui amènent deux partis politiques ou deux religions aux programmes étonnamment similaires à se combattre avec acharnement, et un Alexandre ou un Napoléon à sacrifier des millions de vies humaines, en essayant d’unir le monde sous leur sceptre. On nous a appris à respecter certains personnages qui ont agi d’une façon aussi absurde, et même à les considérer comme de « grands » hommes. Nous sommes habitués à nous soumettre à la sagesse politique de nos dirigeants et tous ces phénomènes nous sont tellement familiers que la plupart d’entre nous ne se rendent absolument (p.229) pas compte combien le comportement des masses humaines, au cours de l’histoire, est stupide, répugnant et indésirable. (…)
Comme Hegel l’a dit :
« Ce que nous enseignent l’expérience et l’histoire, c’est que ni le peuple ni les gouvernements n’ont jamais appris quoi que ce soit par l’histoire, ou agi selon des principes, déduits de l’histoire. »
Seward Desmond, in: Napoleon and Hitler, 1988
(p.9) (…) undeniably there are resemblances too; their rise – from obscurity, their military domination over Europe, their tyranny and contempt for human life, their megalomania and inability to compromise, their hubris. No one can ever be really sure that a nuclear war or an economic collapse will not occur, creating just the sort of chaos from which their like might emerge again. An examination of the two men’s careers and a pinpointing of the qualities they share may provide a means of identifying future ‘saviours’, as well as casting fresh light on both, and especially upon Hitler.
“Napoléon, bien que mort, garde un service de presse bien organisé”
Julos Beaucarne
Lafont, in: Alain de Benoist, Vu de droite, Anthologie critique des idées contemporaines, 1977, éd. Copernic, p.506
« Quand un folklore devient spectacle, c’est que la tradition est morte.»
Lors d’une conférence à Namur donnée par un admirateur inconditionnel de Napoléon, le professeur Cédric Istasse, une rescapée de 40-45, guide au Musée Rops, m’a félicité pour mon courage (!?) lors d’une mise au point en public concernant l’antisémitisme avéré de Napoléon et encouragé à contacter des responsables de sa communauté à ce sujet.
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014
(p.7) Il y a longtemps que la place prise par Napoléon Bonaparte dans l’imaginaire national m’intrigue. Longtemps que je m’interroge sur la gloire qui s’attache à son nom. Longtemps que je suis frappé par la marque qu’il a laissée dans notre histoire. C’est ce qui m’a incité à écrire ce livre.
0.1 Napoléon, un dictateur raciste, un criminel, un despote
|
Annie Jourdan, Mythes et légendes de Napoléon, éd. Privat, 2004 (p.123) Jacques Godechot, grand spécialiste de l’histoire de la Révolution française, aborde le sujet sous un autre angle. Il passe en revue les diverses fonctions exercées par Napoléon avant de conclure sur les erreurs commises en chaque domaine. Génie militaire, Napoléon? Certes, mais un génie incomplet qui ne sut innover en matière de stratégies et de techniques militaires. Grand politique? Sans doute, mais il fit l’erreur de vouloir rallier l’aristocratie, au lieu de rester au centre gauche; de même, il conclut le Concordat sans parvenir à séduire pour autant le clergé réfractaire. En économie, même reproche. Napoléon n’a rien compris de l’immense révolution qui s’accomplissait dans les domaines industriel et commercial. Du point de vue social, il n’a pas non plus prévu la formation du prolétariat ouvrier, ni la naissance d’une société industrielle. C’était là, il est vrai, beaucoup lui demander, d’autant que la France des années 1800 n’était pas à l’avant-garde dans ces domaines. Plus encore que ses prédécesseurs universitaires, Godechot perçoit en Napoléon un homme du passé et dénonce l’imperfection de son génie, en vue d’anéantir une mythologie.
|
|
Christian Bazin (7506 Paris), Sa gloire a coûté cher à la France, Le Figaro 11/12/2003
La gloire de Napoléon a coûté trop cher, beaucoup trop cher à la France pour que l’on pense à garder son sang-froid. La responsabilité des années 1789 à 1815, dont celles du Consulat et de l’Empire, dans le déclin de la France à partir du XIXe siècle est certaine. Première puissance européenne, voire mondiale, au XVIIIe siècle, la France passe derrière l’Angleterre, première puissance du XIXe siècle. Elle paie ce recul par 2 millions de morts des guerres de la Révolution et surtout de l’Empire, sur une population de 27 millions, proportion beaucoup plus forte que la saignée de 14/18. Elle le paie par sa stagnation économique, individuelle et financière en face de la croissance rapide de sa rivale. Pourquoi célébrer tant de victoires fameuses dans toute l’Europe quand, hélas, Trafalgar et Waterloo en annulent le résultat .
|
|
Claude Ribbe, Le crime de Napoléon, éd. Privé 2005
(p.200) En tant que premier dictateur raciste de l’histoire, Napoléon a sa part de responsabilité, non seulement pour tous les crimes coloniaux ultérieurement commis par la France, mais aussi pour tous ceux du nazisme qui s’est, à l’évidence, inspiré de l’Empereur comme d’un modèle.
(p.201) Au nom de ces héritiers de tous les martyres, restituer aux descendants des victimes de Napoléon la vérité qui leur revient, et qu’on leur refuse depuis deux siècles, c’est une manière de contribuer à en finir un jour avec le fléau du racisme dont Napoléon fut incontestablement, avec Hitler, l’un des plus ardents et des plus coupables propagateurs.
(p.12) Napoléon, hélas, est bel et bien un criminel. Et de la pire espèce encore, car le crime n’est pas mince. Il est contre l’humanité et c’est un triple crime. Qu’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas d’un réquisitoire contre les méfaits d’un homme déjà controversé sur bien assez de points : le nombre de morts laissés sur les champs de bataille, les crimes de guerre systématiquement commis lors des campagnes, les assassinats, l’enrichissement personnel. Des auteurs, des artistes — et non des moindres, parfois : Tolstoï, Goya — ont déjà ouvert ce chemin. Le crime dont je parle est très précisément celui commis à partir de 1802 contre les Africains et les populations d’origine africaine déportés, mis en esclavage et massacrés dans les colonies françaises. Napoléon y a en effet restauré l’esclavage et la traite que la Révolution avait déclarés hors la loi huit ans plus tôt. Et comme la résistance des Haïtiens, après la lutte héroïque des Guadeloupéens, l’a mis dans l’impossibilité d’appliquer son programme dans la principale de ces colonies, celle de Saint-Domingue, il y a perpétré des massacres dont le caractère géno-cidaire, comme on le verra, non seulement ne peut être mis en doute, mais préfigure de manière évidente – notamment par les méthodes employées – la politique d’extermination engagée contre les juifs et les tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale. On sait (p.13) qu’en 1945 les statuts du tribunal militaire international de Nuremberg ont clairement qualifié de crime contre l’humanité la réduction en esclavage ou la déportation des populations civiles et que le concept de génocide, forme limite du crime, a été utilisé pour désigner l’extermination programmée d’un groupe humain. Mais le caractère imprescriptible de l’esclavage et de la traite était déjà perçu depuis longtemps. Dès 1778, un magistrat breton, Théophile Laennec, le père du célèbre médecin, n’hésitait pas, dans un réquisitoire courageux, à dénoncer ce trafic honteux « contre lequel l’humanité réclamera dans tous les temps ses droits imprescriptibles ». Dans le cas de Napoléon, en reprenant la définition de Nuremberg, il s’agit donc bien d’un triple crime puisque le génocide vient s’ajouter à la mise en esclavage et à la déportation. Le crime est si impardonnable qu’il a provoqué plus de deux siècles de mensonge. Car les faits sont bien connus des historiens, mais volontairement passés sous silence : peur de dire la vérité ou pire, approbation. Ni la mise en esclavage et la déportation de citoyens français, ni la mise en esclavage et la déportation d’Africains, ni le génocide engagé contre la population haïtienne ne sont en effet explicitement évoqués dans les livres, dans les manuels d’histoire, dans les œuvres audiovisuelles, dans les expositions ni dans les spectacles consacrés à Napoléon. Et si, d’aventure, le rétablissement de l’esclavage est mentionné, il n’est jamais (p.14) dit que les personnes visées étaient des citoyens français. Quant au génocide commis par Napoléon en Haïti, c’est un tabou absolu.
(p.15) L’idolâtrie bonapartiste atteint naturellement son apogée avec la dictature de Napoléon III. Malgré l’avènement de la République, le pays ne s’est pas relevé de cette maladie. Aujourd’hui des fondations et associations continuent à œuvrer, avec le soutien de l’Université, des fonds publics et de la télévision d’État, pour perpétuer le glorieux souvenir de l’homme qui a rétabli l’esclavage en France. Les sociétés privées ne sont pas en reste. C’est ainsi que le legs de Martial Lapeyre, le roi du bois « exotique », permet de lancer en 1987 la fondation Napoléon qui s’installe dans le somptueux hôtel particulier du mécène. La fondation Napoléon est très active pour perpétuer la mémoire de son héros. Mais les livres et les spectacles auxquels elle attribue des prix ne parlent jamais de crime. Et le mot esclavage y est généralement banni.
(p.16) Le bois était l’une des principales richesses d’Haïti. Aujourd’hui, il n’y reste plus un arbre. Comme tout Français, j’ai été élevé dans le culte de l’empereur et, dans ce cursus, le déficit des exactions impossibles à dissimuler était mis en balance avec le profit des institutions dont il aurait doté la France. On prétendait que, après la période troublée de la Révolution, il aurait permis au pays de se consolider. Et ne cite-t-on pas encore, dans tous les manuels d’histoire, comme l’une des périodes les plus heureuses, l’année 1802, celle de la « paix ». Qui ne se souvient de cette image d’Épinal, illustrant les livres de classe et représentant le Premier consul qui remet l’épée au fourreau, avec, pour toile de fond, le bon peuple laissant éclater sa joie de voir cesser enfin les troubles ? Ainsi chacun est-il persuadé que 1802 fut pacifique, alors que, cette année-là, il y eut une guerre atroce, une folie génocidaire sans précédent ; alors que, cette année-là, deux cent cinquante mille Français furent remis en esclavage par la force. Leurs descendants représentent aujourd’hui une part qu’on pourrait estimer à trois ou quatre pour cent de la population de la France, ce qui n’est pas négligeable. Mais il est convenu de ne pas en parler. De ne parler ni des descendants, ni de leurs ancêtres. Leur histoire est, en effet, l’un des plus grands non-dits français. Comme celle du peuple d’Haïti qui souffre encore dans sa chair pour avoir osé résister (p.17) au rétablissement de l’esclavage, triompher et proclamer son indépendance. En 1802, Haïti, c’était une partie de la France qu’on appelait Saint-Domingue.
(p.23) L’esclavage et la traite sont des crimes contre l’humanité, donc imprescriptibles. Mais pourquoi s’en prendre à Napoléon, qui n’a peut-être fait que rétablir l’état des choses sans rien inventer ? C’est vrai, d’autres pourraient payer, sinon à sa place, du moins avec lui. Napoléon, on aurait presque pu l’oublier si, au fur et à mesure que le racisme est banalisé par l’évolution des techniques de communication ou de propagande, on ne voyait étrangement renaître une ferveur bonapartiste qui coïncide exactement avec l’engouement pour l’extrême droite et l’envolée de ses scores électoraux. La fascination des fascistes pour le dictateur français n’est pas nouvelle. Il est temps d’avertir ceux qui, pour les grandes occasions, aiment à s’affubler du bonnet de grognard, qu’il va leur falloir à présent assumer leurs inavouables prédécesseurs. Car les deux plus grands admirateurs de Napoléon furent Adolf Hitler et Benito Mussolini, dont personne ne saurait ignorer qu’ils firent du racisme, plus qu’une doctrine, un programme.
(p.24) Benito Mussolini s’est distingué en inspirant Il Campo di Maggio, Le champ de mai, une pièce de théâtre à la gloire de Napoléon. Hitler l’a fait traduire en allemand sous le titre Les Cent Jours et représenter avec tout le faste qui convenait. C’est en février 1932, au cours de la première, une grand-messe nazie s’il en fut, qu’il aborde la sœur de Nietzsche en allant lui porter une gerbe de rosés rouges dans sa loge. La pièce est si convaincante, sans doute, qu’Hitler, en 1934, coproduira avec l’Italie une adaptation cinématographique, toujours sous le titre à’Hundert Tage (Les Cent Jours], réalisée par Franz Wenzler, cinéaste nazi travaillant en collaboration avec Goebbels. Mussolini lui-même va participer à la mise en scène de la version italienne, dont son propre fils est le producteur. Il Campo di Maggio, d’après Mussolini, glorification du fascisme où Napoléon est explicitement comparé au Duce, a d’ailleurs été projeté à Ajaccio en grande pompe, le 24 juin 2004, lors du premier salon du livre napoléonien, organisé dans le cadre du bicentenaire du Sacre ! Quelques jours après avoir mis la France hors de combat — pas la France héroïco-fasciste de Napoléon qu’il admirait, mais la France républicaine, parlementaire et « négrifiée » qu’il méprisait — Hitler quitte discrètement la Belgique et se pose au Bourget au petit matin d’un bel été. Le but de ce voyage ? Visiter Paris, dit-on. Certes, il passe à l’Opéra et se (p.25) promène sur l’esplanade du Trocadéro, accompagné de l’architecte Albert Speer, adepte de l’esclavage des juifs, et du sculpteur nazi Arno Brecker. La photo du sinistre moustachu en touriste est célèbre. En réalité, Hitler va réaliser un rêve : s’incliner devant la tombe de son maître, celui qui a remis les « nègres » à leur place, c’est-à-dire dans les fers, le héros qui a livré aux chiens ceux qui résistaient et qui a fermé les frontières à ceux qui étaient libres, l’homme glorieux qui a entrepris l’extermination des récalcitrants en les gazant. En un mot, le précurseur qui, pour la première fois sans doute dans l’histoire de l’humanité, s’est posé rationnellement la question de savoir comment éliminer en un minimum de temps, avec un minimum de frais et un minimum de personnel un maximum de personnes déclarées scientifiquement inférieures.
Sans le précédent de Napoléon, pas de lois de Nuremberg. Hitler le sait. Il sait ce qu’il fera plus tard des juifs, qui, selon lui, descendraient des « nègres » et se serviraient de ces derniers pour corrompre le « sang aryen » qu’il faut à tout prix préserver du mélange. Car « jamais homme un peu instruit n’a avancé que les espèces non mélangées dégénérassent », disait déjà Voltaire, le plus virulent antisémite et négrophobe de la littérature européenne. Hitler, qui l’a lu (ou en a perçu les échos à travers ses vulgarisateurs, les théoriciens du racisme français) fait de ce préjugé une vérité historique : (p.26) « L’histoire établit avec une effroyable évidence que, lorsque l’Aryen a mélangé son sang avec celui des peuples inférieurs, le résultat de ce métissage a été la ruine du peuple civilisateur.l »
C’est pourquoi, ce 28 juin 1940, le Führer endosse sa tenue de parade et, tout de blanc vêtu — un symbole qui en dit long —, il va s’incliner, en surplomb, sur la tombe de l’empereur, l’incompris qui a eu le courage d’instaurer un racisme d’État. Il rend hommage à Napoléon, digne lecteur de Voltaire, et va s’appuyer sur son exemple pour appeler à la purification ce pays rendu décadent par les Rassenmischer, car « si l’évolution de la France se prolongeait encore trois cents ans dans son style actuel, les derniers restes du sang franc disparaîtraient dans l’État mulâtre africano-européen qui est en train de se constituer ». Pour ceux qui n’auraient pas compris ce message pourtant explicite, Hitler fait rapatrier de Schônbrunn, quelques mois plus tard, les cendres de l’Aiglon. La dépouille du fils du criminel franchit à son tour la grille des Invalides, portée par des nazis casqués. Image vraiment inoubliable du culte napoléonien. Le Führer sera imité par des dizaines de milliers de soldats de la Wehrmacht qui viendront en pèlerinage saluer le premier dictateur raciste de tous les temps, au point qu’il faudra installer un faux (p.26) plancher de peur que les bottes nazies n’usent le marbre des Invalides, ce qu’attesté, photos à l’appui, Jean Éparvier, dans un ouvrage paru à la Libération (À Paris sous la botte des nazis). Le fait est que Hitler savait l’histoire de France mieux que beaucoup de Français. La preuve : ordre sera donné de faire disparaître la seule statue de « nègre » qu’on ait jamais vue parader sur une place publique parisienne, celle du général Dumas, héros de la Révolution né esclave en Haïti et premier descendant d’Africains à devenir général de l’armée française. (…)
(p.29) Oui, Dumas est entré au Panthéon sans qu’on daigne rendre à son père l’éclatant hommage qu’il méritait pourtant. Sauf au Sénat, mais bien à l’abri des caméras de la télévision d’État, puisque les Français, disait-on, n’étaient « pas prêts ». Au général Dumas, qui a risqué soixante fois sa vie pour la France, la République a refusé – malgré ma demande — la Légion d’honneur à titre posthume. Il est vrai que la Légion d’honneur a été créée par Napoléon la veille du rétablissement de l’esclavage et que, en bonne logique, la Cinquième République, dont la Constitution, en son article 1er, affirme solennellement la pertinence de la notion absurde de « race humaine », ne saurait décorer un général nègre né esclave, fût-il mort depuis deux cents ans. D’ailleurs, les gardiens du temple napoléonien ont eu soin d’effacer sa mémoire. À lire, par exemple, la plupart des ouvrages consacrés à l’expédition d’Egypte, on peut sérieusement se demander si le général Dumas en a vraiment fait partie et s’il était bien le commandant en chef de la cavalerie d’Orient. Si, par chance, on le cite, pas question d’évoquer ses origines.
(p.35) Même s’il a fallu attendre le 27 juillet 1793 pour la suppression des primes d’encouragement versées par la Nation à la traite négrière, le trafic en direction des Antilles françaises et de la Guyane est officiellement interrompu, pour le plus grand désespoir des « négociants » et armateurs des ports de France. Ce qui n’empêche pas, en 1799, le négrier Jean-François Landolphe, l’ancien commandant du Pérou, parti en 1785 de Rochefort pour le Bénin et qui arrive au Cap avec quatre-vingt-onze captifs vivants sur trois cent treize embarqués, de se reconvertir en explorateur et d’expédier de force dans une « plantation nationale » de Guyane, en qualité de « libres », quelque trois cents esclaves africains capturés sur un navire négrier anglais. Ce sont sans doute ces exploits qui lui valent de donner son nom à une rue d’Auxonne (Yonne) où Napoléon, lorsqu’il y était en garnison, écrivait que ses futurs sujets étaient le « peuple le plus hideux qui ait jamais existé ». Landolphe ! Juste un cas parmi tant d’autres de négrier honoré de nos jours par les Français « bien-pensants ».
(p.36) Quand on sait que les historiens les plus optimistes admettent le chiffre de cinq Africains tués pour un esclave débarqué, on imagine combien lourd est le bilan. En cent cinquante ans, rien que pour la France, près d’un million deux cent mille esclaves et six millions de morts !
(p.45) Tout démontre que l’esclavage est capital dans la pensée économique et géopolitique de Napoléon. Il fait donc nécessairement partie du programme qu’il s’est fixé et qu’il va appliquer peu à peu avec méthode, en géomètre, au fur et à mesure que les circonstances le lui permettront. Sa volonté de faire la paix avec l’Angleterre est principalement motivée
(p.48) Tout commence donc dès le coup d’État. Peu de jours après, Bonaparte songe à faire arrêter Léger Sonthonax, un républicain considéré comme l’instigateur de la liberté des esclaves. Mais il doit se raviser face à l’indignation générale que cette mesure pourrait déclencher. Bientôt, la presse aura la muselière : l’arrêté du 17 janvier 1800 supprimera soixante des soixante-treize journaux parisiens.
(p.51) En attendant le moment favorable pour frapper le grand coup dont il rêve, Napoléon s’entoure méthodiquement des réactionnaires les plus notoirement liés à l’Ancien Régime et de tous les nostalgiques du Code noir qu’il peut trouver. (p.52) Sous la protection discrète du Premier consul, le général Narcisse Baudry des Lozières est chargé d’organiser un véritable bureau de propagande au ministère des Colonies, en association avec l’« historiographe » Moreau de Saint-Méry. (p.53) C’est sans doute alors que Baudry des Lozières a tout le loisir d’entreprendre la rédaction d’un chef-d’œuvre de la pensée pré-nazie, Les Égarements du nigrophilisme, qui sera publié le moment venu et habilement dédié à Joséphine, pour ne pas trop compromettre le grand homme. Au même moment paraît une traduction française du Voyage de Mungo Park, le célèbre explorateur esclavagiste, pour répandre l’idée que les trois quarts des Africains sont, de toute façon, déjà esclaves dans leur pays et que, donc, le passage aux Amériques n’aggrave en rien leur sort. Au contraire. Un vieil argument déjà utilisé par Voltaire et que certains « historiographes » français du XXIe siècle, hélas, n’hésiteront pas à reprendre à leur tour dans le même sens.
De son côté, le négrier Bélu dédie à Bonaparte Des colonies et de la traite des nègres, dans lequel il s’efforce de démontrer que, pour compenser les fatigues du corps, le « repos de l’esprit » des esclaves rend souvent leur condition « égale en bonheur à celle du maître ». C’est en quelque sorte une préfiguration de ce travail forcé « libérateur » qui deviendra le slogan inscrit au fronton des camps d’extermination.
(p.55) Aucun doute, donc : Napoléon, au moment où il s’empare du pouvoir, est bien un esclavagiste convaincu. Mais il est également raciste. Raciste jusqu’à l’aliénation. On connaît sa haine des juifs, que la Révolution vient tout juste d’émanciper. À leur propos, le modèle de Hitler n’hésite pas à déclarer que c’est « une nation à part, dont la secte ne se mêle à aucune autre », une « race qui semble avoir été seule exemptée de la rédemption ». Il trépigne : « Le mal que font les juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple. Ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France !1 » II explique clairement sa politique judéo-
phobe (p.56) à son frère Jérôme : « J’ai entrepris l’œuvre de corriger les juifs, mais je n’ai pas cherché à en attirer de nouveaux dans mes États. Loin de là, j’ai évité de faire rien de ce qui peut montrer de l’estime aux plus misérables des hommes. » Voulant « porter remède au mal auquel beaucoup d’entre eux se livrent », Napoléon multiplie en effet les mesures discriminatoires à l’encontre des juifs, n’hésitant pas à effacer les dettes dont ils sont créanciers ou à les écarter du commerce pour les ruiner et même à leur interdire tout ou partie du territoire. Antisémite notoire, comme Voltaire, Napoléon est naturellement aussi un violent négrophobe. Car l’un ne va jamais sans l’autre.
(p.99) (…) ‘aujourd’hui, bien des Français préfèrent mettre en cause les subalternes du Consulat plutôt que leur chef’. Pour les politiques, c’est aussi un compromis commode: il est plus facile de débaptiser la rue Richepance, comme l’a fait le maire de Paris en 2001, que la rue Bonaparte. Napoléon a toujours pensé à sa légende. Jamais d’écrit pour ordonner l’inavouable. Toujours de l’implicite. Hitler n’oubliera pas la leçon.
(p.102) Un arrêté consulaire rétablit le 16 juillet 1802 l’esclavage à la Guadeloupe.
(p.104) Avec Napoléon, le racisme aidant, on va beaucoup plus loin que sous l’Ancien Régime. L’état civil des esclaves sera tenu à part, pour retirer toute mémoire aux anciens citoyens français devenus, par le caprice d’un petit aventurier raciste, de vulgaires bêtes de somme. On verra désormais des enfants vendus sans leur mère, ce que l’article 47 du Code noir interdisait pourtant de la manière la plus formelle. Ainsi à Basse-Terre, le 19 décembre 1806, la petite Rosé, « âgée d’environ six ans », fille de Praxelle, « marronne depuis longtemps », sera-t-elle, en application du système infernal mis en place par le tyran, publiquement proposée comme « épave » par le directeur des Domaines « au plus offrant et dernier enchérisseur ».
(p.110) Napoléon, après avoir personnellement rédigé le scénario politico-militaire de la campagne de Saint-Domingue, l’expose longuement dans des instructions écrites. Mais les ordres les plus importants, Leclerc les reçoit verbalement : non seulement il devra rétablir l’esclavage coûte que coûte, mais il lui faudra aussi exterminer les citoyens « noirs », dont Napoléon pense — non sans justesse — qu’après huit ans de liberté ils ne pourront être remis en esclavage sans mobiliser des troupes considérables pour les surveiller, ce qui sera impossible à terme, notamment à cause de la fièvre jaune qui frappe sélectivement les nouveaux venus. Mieux vaut donc abattre ce (p.111) « cheptel » contaminé par le virus de la liberté et lui substituer de nouvelles têtes saines importées d’Afrique et prêtes à être dressées comme il convient. Le plan du rétablissement de l’esclavage en Haïti passe ainsi par le massacre d’une bonne partie de la population. Quelques centaines de milliers de morts bientôt remplacés par cinq cent mille Africains. Leclerc, convaincu par Napoléon qu’il va trouver là une « belle occasion de [s’] enrichir », accepte ces ordres déments le 24 octobre 1801.
(p.122) (St-Domingue) C’est devant l’un de ces forts, à Vertières, qu’une des plus grandes batailles de l’histoire va se livrer, le 18 novembre 1803. La particularité de cette bataille, c’est qu’officiellement, en France, elle n’a jamais existé. Aucun livre consacré à Napoléon ne la mentionne. Et pour cause : son existence est incompatible avec la thèse de la fièvre jaune qui, pour les propagandistes de Napoléon, expliquerait seule la débâcle de Saint-Domingue.
(p.124) Non seulement la plus belle (sic) colonie du monde est perdue, après plus d’un siècle de domination française, non seulement pour la première fois dans l’histoire de l’humanité une lutte d’esclaves, commencée presque à mains nues en 1791, conduit à l’indépendance d’un peuple, mais une grande nation colonialiste et esclavagiste essuie sa première défaite. (p.125) Cependant, la bataille de Vertières étant niée par l’historiographie française, aucune leçon n’en sera tirée pour l’avenir. Un siècle et demi après, l’aveuglement raciste entraînera d’autres capitulations : à Diên Bien Phu, en Algérie. La défaite de Vertières n’est que la défaite d’une certaine France : celle qui s’est opposée, et continue encore parfois de le faire, aux principes de la Révolution. Ces principes, la nation haïtienne, en payant le prix du sang, les a rendus universels. Car, après Vertières, qui, hormis Napoléon et ses admirateurs, oserait soutenir que tous les hommes, fussent-ils noirs de peau, ne naissent et ne demeurent pas libres et égaux en droits ? L’armée napoléonienne, elle aussi, connaît sa première grande déroute. Et la plus humiliante de toutes. Napoléon est battu par des « nègres ». Des soixante mille hommes envoyés à Saint-Domingue par le tyran raciste, il en reviendra tout juste quelques centaines, après huit ans de captivité, et dans quel état ! (…)
Les sectateurs racistes de Napoléon ne pardonneront jamais à l’État d’Haïti ce cinglant affront. Pendant deux cents ans, cette mémorable débâcle sera occultée. De nos jours encore, de prétendus « historiens » (p.126) évoquent la fièvre jaune et la malchance. En France, aucun livre ne dit la vérité, qui est pourtant bien simple : Bonaparte voulait rétablir l’esclavage et une nation tout entière s’est levée contre lui, écrasant l’armée de la honte.
(p.127) Le rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe et la tentative de rétablissement en Haïti se sont accompagnés d’actes d’une barbarie inouïe, perpétrés selon les instructions de Napoléon ou avec son approbation. À l’époque, on a peu d’équivalents dans l’histoire de France, et, peut-être, dans l’histoire tout court, d’une pareille sauvagerie. En Guadeloupe, pendant les trois semaines de résistance, Richepance et son complice Gobert ne font pas de prisonniers. Ils fusillent hommes, femmes et enfants sur leur passage. Le 25 mai 1802, lors de la prise du fort de Baimbridge où s’est retranché Ignace, ils exécutent immédiatement près de sept cents patriotes. Des deux cent cinquante qui se sont rendus, on en fusillera cent sur la place de la Victoire. Cent cinquante autres sur la plage de Fouillole.
(p.128) Appliquant une technique qui sera reprise pendant la guerre d’Algérie, les troupes esclavagistes recensent tous les cultivateurs absents sur les habitations et, quelle que soit la raison de cette absence, les déclarent « fellaghas ». Dans chaque commune, des escadrons de la mort sont constitués pour traquer les résistants. Comme on le fait lors des battues aux nuisibles, une somme d’argent est prévue pour (p.129) chaque tête de « nègre » rapportée par les miliciens. Les résistants sont immédiatement fusillés ou pendus. Comme la fièvre jaune fait des ravages parmi le corps expéditionnaire, on va jusqu’à accuser les infirmiers « noirs » ou « de couleur » de l’hôpital de Pointe-à-Pitre d’être responsables de la maladie. Les infirmiers, sous l’accusation d’« empoisonnement », sont tous passés par les armes.
La férocité de la répression occasionne un nouveau soulèvement à Sainte-Anne, dans la nuit du 6 au 7 octobre 1802, aussitôt écrasé. C’est l’occasion, pour Lacrosse, de constituer sur place un troisième tribunal spécial présidé par le chef de bataillon Louis Arnauld, un créole de la Martinique, assisté de l’impitoyable commandant Danthouars. La question n’est plus de savoir si les prévenus seront condamnés, ni quelle peine leur sera appliquée, mais quel supplice leur sera infligé pour les tuer. Le 29 octobre 1802, Lacrosse s’en explique à Arnauld. Le mode d’exécution choisi « doit donner aux malintentionnés l’exemple le plus terrible. Vous penserez donc comme moi, Citoyen, que le supplice de la potence n’expiant pas assez le crime de ceux des assassins que la loi condamne à la peine de mort, ils doivent être rompus vifs et expirer sur la roue. […] Les geôles de Pointe-à-Pitre et du Moule sont déjà encombrées : il faut les déblayer le plus tôt possible. »
(p.130) Arnauld va donc « déblayer » en toute hâte. On pend, on rompt, on étrangle, on brûle. On imagine même une autre forme de mise à mort dont la cruauté laisse perplexe. Le patient est introduit dans une étroite cage de fer et placé à cheval au-dessus d’une lame affilée, tranchante comme un rasoir. En face de lui, une bouteille d’eau et un pain qu’il ne peut pas atteindre. Ses pieds reposent sur des étriers. Tant qu’il le peut, il se tient en suspension. Le condamné est ficelé d’une manière telle qu’il ne puisse tomber que sur le rasoir, ce qui ne manque pas d’arriver lorsque, après quelques heures de privation de nourriture et de sommeil, ses jambes tétanisées finissent par flancher. La première entaille n’est pas fatale. Il est prévu que le prisonnier se relève et s’y reprenne à plusieurs fois pour se couper en deux. Cet instrument atroce est destiné à occasionner jusqu’à quarante-huit heures de tourments.
(p.131) Après une année de génocide ininterrompu, Bonaparte envoie un nouveau représentant, le général Augustin Ernouf, pour promulguer enfin, le 14 mai 1803, l’arrêté consulaire restaurant officiellement le Code noir à la Guadeloupe. Mais Ernouf s’aperçoit que les coureurs des bois résistent toujours. La veille de la proclamation du rétablissement de l’esclavage, il a lancé une proposition d’amnistie, qui ne reçoit qu’un accueil méprisant. Le 3 septembre, il retient alors avec enthousiasme une suggestion sanguinaire du commissaire du gouvernement de Basse-Terre : « La mesure que vous me proposez, citoyen commissaire, de faire brûler, en présence des ateliers, les brigands qui ont refusé de se rendre à l’amnistie que je leur avais accordée et qui seraient arrêtés, est excellente ! En conséquence, je vous autorise à faire exécuter prévôtalement ceux qui tomberaient en votre pouvoir. » Deux mois plus tard, Ernouf recommande par écrit au commandant des Chasseurs des bois de pratiquer l’holocauste sans jugement préalable : « Je (p.132) vous donne l’ordre formel de ne rien envoyer au tribunal spécial, mais de faire brûler sur les lieux les coupables qui seront arrêtés. »
En Haïti, comme en Guadeloupe, les troupes de l’expédition se dispensent de faire des prisonniers : « Sitôt qu’il en tombe à notre pouvoir, nous les fusillons de suite », note dans ses Carnets d’étapes le sergent Philippe Beaudoin. Ces pratiques ne se sont jamais démenties. Ainsi, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1803, Beaudoin monte à l’assaut du fort de Port-de-Paix. « Nous le prîmes en moins d’une demi-heure, se souvient-il, et nous passâmes au fil de l’épée environ six cents hommes dans le fort. » Six cents « nègres » de moins ! Simple routine. La torture est monnaie courante. Le viol aussi, on s’en doute : « II y a de jolies femmes et point difficiles », remarque le même sous-officier. Mais c’est à partir de septembre 1802 que Leclerc, voyant que le rétablissement de l’esclavage est impossible, envisage sérieusement d’appliquer les instructions géno-cidaires qui lui ont été données. Il commence par pratiquer une répression dont la violence s’intensifie graduellement.
(p.135) Au mois de septembre, Leclerc donne l’ordre à Jean-Jacques Dessalines, chef de la quatrième brigade coloniale, de faire égorger trois cents prisonniers. (…) (p.136) Le 17 septembre, Leclerc fait savoir qu’il n’a rien oublié des ordres secrets qui ont été donnés un an plus tôt et qu’il n’hésitera pas à les exécuter jusqu’au bout. « J’aurai à faire une guerre d’extermination », se résigne-t-il. Dans sa dernière lettre, datée du 7 octobre 1802, Leclerc répète de manière incantatoire les instructions négrophobes qui lui ont été données aux Tuileries : « II faut détruire tous les nègres de la montagne, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessous de douze ans, détruire la moitié de ceux de la plaine et ne plus laisser dans la colonie un seul homme de couleur qui ait porté l’épaulette. » Joli programme qui suppose quelques centaines de milliers de morts. Bonaparte l’approuve entièrement. « Croyez que je sens vivement les services que vous avez rendus, répond-il depuis Saint-Cloud, et votre gloire sera entièrement consolidée lorsque, par le résultat de votre seconde campagne, vous aurez rendu la tranquillité à cette belle et vaste colonie, qui est l’objet de la sollicitude et des espérances de tout notre commerce ! » Leclerc a le feu vert, s’il en (p.137) était besoin, et le carnage s’intensifie. À Saint-Marc, le général Pierre Quantin fait exécuter des centaines de « brigands ». Le lendemain, l’amoncellement de cadavres est tel que les habitants n’arrivent plus à ouvrir leurs portes.
De l’exécution des résistants, Leclerc passe bientôt au génocide proprement dit : la « destruction » de tous les « nègres » de la montagne et de la moitié de ceux de la plaine, comme il l’a annoncé. Il ne s’agit plus maintenant de tuer des ennemis, mais d’exterminer une population en seule considération de sa couleur de peau. Le capitaine général commence par se débarrasser d’une partie de ses propres troupes, le 16 octobre 1802. « Pour ne pas trouver les noirs sur son chemin, note un chroniqueur, Leclerc en fit transporter un millier à bord de navires ancrés dans le port ; lorsque la bataille commença et qu’il se vit en danger, il donna l’ordre de les noyer. Ils furent massacrés par les marins qui les jetèrent par-dessus bord. »
(p.139) (…) dès le début de l’offensive des rebelles, Leclerc fait monter à bord des bateaux toutes les troupes « de couleur » dont il dispose. En fait, ces hommes, répartis sur les vaisseaux, sont enfermés dans les cales. Pour les tuer, on va utiliser une méthode tout à fait inédite : les gaz. Comme on le fait pour les fûts des vignerons, les cales des bateaux sont régulièrement désinfectées en faisant brûler des mèches dont la combustion dégage du dioxyde de soufre. L’inhalation de ce gaz à haute dose est mortelle, ce qui a l’avantage de tuer les rats. Plus tard, de la même manière, le Zyklon B sera utilisé comme pesticide dans les navires avant de servir dans les camps de la mort. Le procédé est particulièrement cruel car le dioxyde de soufre, se transformant en acide sulfurique au contact de la moindre surface humide, notamment les yeux, occasionne des brûlures atroces dans une cale remplie d’eau.
Une fois le forfait accompli, les corps inanimés sont remontés sur le pont et les marins s’en débarrassent en leur attachant autour du cou des sacs remplis de sable. Une telle opération ne s’improvise pas. On peut imaginer le temps qu’il faut pour remplir et hisser à bord plus de mille sacs et laisser aérer les cales mortifères avant de pouvoir y pénétrer sans risque.
(p.140) Sur la rade, Fréminville note la présence des vaisseaux Le Duguay-Trouin, L’Hannibalet Le Swiftsure, des frégates La Précieuse, L’Infatigable et La Poursuivante, ainsi que de quelques corvettes et bâtiments de la marine marchande. Il nous certifie que les blancs « noyaient impitoyablement les noirs, sans distinction d’âge et de sexe ». Il ne s’agit plus seulement de troupes coloniales, mais de civils, puisque Rochambeau, poursuivant l’opération commencée par Leclerc et ordonnée par Bonaparte, « avait conçu l’absurde et horrible projet d’anéantir toute la population noire de l’île. C’est pourquoi il faisait mettre à mort, sans exception, tous les nègres, même ceux qui n’étaient aucunement fauteurs de l’insurrection. Ainsi, poursuit Fréminville, il fît conduire en rade, à bord du vaisseau Swiftsure, une grande partie de la garnison nègre de Fort-Dauphin qui était restée fidèle à la France et avait été ramenée au Cap, lors de l’évacuation de ce fort, par le major-général Pamphile Lacroix. » Cette fois, le témoignage de ce dernier met en cause le commandant en chef de l’expédition et, partant, son commanditaire : « Les (p.141) premières paroles que me dit le général Leclerc en m’accueillant, écrit Lacroix, firent saigner mon cœur : « Général, qu’avez-vous fait ? me dit-il. Vous arrivez avec une population de couleur quatre fois plus nombreuse que les détachements européens que vous me ramenez. » » Si le cœur de Lacroix saigne, c’est parce qu’il sait bien que cette population « de couleur » va être aussitôt sacrifiée. « La nuit suivante, témoigne Fréminville, [toute la garnison fut noyée], sans autre forme de procès, par l’équipage [du Swift-sure] qui, sans hésiter, se prêta à cette horrible exécution. Des contingents de noirs furent répartis à bord de nos différents vaisseaux, mouillés en rade. Le général […] donna l’ordre positif à leurs capitaines de noyer ces malheureux après leur avoir attaché au cou un sac rempli de sable. Cet ordre abominable fut accompagné d’une mesure de disgrâce pour tous les contrevenants. Il faut le dire, à leur honte, tous s’y soumirent. Sauf le capitaine Willaumez, commandant la frégate La Poursuivante. Il répondit fièrement : « Les officiers de la Marine française ne sont pas des bourreaux. Je n’obéirai pas ! » »
« Les noyades, continue Fréminville, se faisaient dans la rade même. La mer se couvrit de cadavres en putréfaction. Tantôt, les sacs de sable, attachés au cou des noyés, avaient cédé ; tantôt, le lien qui les amarrait s’était pourri ou rompu. Alors les corps remontaient à la surface. C’était un hideux spectacle. » Lorsque le jeune cadet quitte son bateau pour (p.142) aller en ville, c’est une scène de cauchemar. « Ces promenades, se souvient-il, débutaient pour nous par l’horrible et inévitable vision des cadavres de nègres que nous trouvions sur notre route, entre notre vaisseau et le quai de débarquement. Souvent, le brigadier de notre canot était obligé de les écarter, à coups de gaffe. Autrement, nous les aurions coupés en deux. » La rade du Cap étant submergée de cadavres, Latouche-Tréville demande que l’immersion des victimes se fasse plus discrètement : au large et de nuit. « La crainte d’un redoublement d’épidémie et l’arrivée au Cap de l’amiral Latouche, qui s’indigna du métier de bourreau ainsi infligé à des officiers français, firent changer le mode d’exécution. Il fut décidé que les noyades auraient lieu désormais hors de la rade. On entassait les victimes à bord de la goélette de l’infâme Tombarel qui allait, au-delà des passes, jeter sa cargaison humaine. Ainsi, nous eûmes l’explication de la réponse qu’il fit à la sentinelle du fort Picolet : « Je m’en vais mettre de la morue à la trempe ! » En réalité, il allait noyer des nègres. »
(p.143) Dans son Histoire d’Haïti (1848), l’historien Thomas Madiou confirme l’utilisation des cales des navires pour anéantir la population de l’île. « Dans la grande rade du Port-au-Prince et dans celle du Cap, écrit-il, les navires de guerre étaient devenus des prisons flottantes où étaient étouffés, dans les cales, des noirs et des hommes de couleur. » Victor Schoelcher lui-même, dans sa Vie de Toussaint Lou-verture (1889), se déclare informé de ces techniques d’extermination nouvelles qui allaient, hélas, être développées au XXe siècle par Hitler pour se débarrasser de la population juive. « On inventa, assure-t-il à son tour, des prisons flottantes appelées étouffoirs (p.143) dans lesquelles, après avoir enfermé des nègres et des mulâtres à fond de cale, on les asphyxiait en y faisant brûler du soufre. »
Dans les Souvenirs d’un amiral, publiés en 1872, un autre témoin oculaire, Jurien de La Gravière, à l’époque commandant de La Franchise, donne moins de détails. Mais il évoque cette époque avec un désenchantement qui en dit long : « Je saurais le dissimuler, regrette-t-il, la guerre de Saint-Domingue restera une des plus tristes pages de notre histoire […]. Je voudrais n’avoir jamais été témoin des atroces représailles par lesquelles, dans le cours de ces deux années, on se crut autorisé à répondre […] aux trahisons répétées des rebelles. Grâce à Dieu, je ne suis pas le seul officier de marine qui, au cours de ces déplorables événements, ait mieux aimé braver les lois de la discipline que manquer aux lois de l’humanité. » Jurien cite Latouche-Tréville, le responsable naval de l’expédition, qui, reprenant la politique définie par le Premier consul, déclare sans ambages en février 1803 que le terme de cette guerre doit être « la destruction des nègres ». Et le témoin soupire : « Faut-il s’étonner que cet affreux programme ait pu trouver de nombreux adhérents ? »
(p.147) Après la mort de Leclerc, le génocide continue de plus belle. Napoléon est servi par un exécuteur qu’il a lui-même désigné comme successeur de Leclerc dans ses instructions de l’automne 1802. Ayant étudié chaque dossier avec soin, on peut penser qu’il savait à qui il avait affaire. Donatien de Rochambeau et son adjoint, Louis de Noailles, sont deux véritables bouchers dont la barbarie dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Pour faire des comparaisons avec ce qui est connu au XIXe siècle, l’historien Madiou est embarrassé. Il ne trouve que le prince Vlad l’Empa-leur, alias Dracula. Aujourd’hui il pourrait aussi se référer à la division SS Das Reich et aux bourreaux des camps de la mort.
Tous les ports sont à présent affectés aux gazages et aux noyades. Après Le Cap et Port-au-Prince, « les bâtiments de guerre en station dans la rade des Cayes se remplissaient aussi d’indigènes destinés à être noyés ». C’est aux Cayes que vont tristement s’illustrer le colonel Jacques Berger, dit « le Loup-cervier », assisté de Kerpoisson, le lieutenant du port. Rivalisant d’inhumanité avec les marins, parmi lesquels Tombarel, l’ancien commandant du Gerfaut, se distingue (p.148) particulièrement, d’autres criminels vont affirmer leur vocation de bourreaux et de tortionnaires : le général Pierre Boyer, dit « le Cruel », assisté de l’adjudant-commandant André Maillard, pour ne citer qu’eux. En 1825, l’année où la France reconnaît enfin, moyennant finances, la liberté des Haïtiens, Antoine Métrai, dans son Histoire de l’expédition des Français à Saint-Domingue, révèle l’existence de charniers. « Rochambeau, dit-il, fit mourir, au Cap cinq cents prisonniers. On avait creusé, sur le lieu de l’exécution, un grand fossé pour leur servir de sépulture, de sorte que ces malheureux, qu’on faisait périr par les armes, assistaient, pour ainsi dire vivants, à leurs propres funérailles. » Antoine Métrai confirme, lui aussi, l’utilisation des chambres à gaz : « On variait néanmoins les exécutions. Tantôt on leur tranchait la tête, tantôt un boulet mis à leur pied les entraînait au fond de l’abîme des eaux, tantôt ils étaient étouffés dans les navires par la vapeur du soufre. Lorsque la nuit servait de voile à ces attentats, ceux qui se promenaient le long du rivage entendaient le bruit monotone des cadavres qu’on jetait à la mer. » La folie génocidaire est générale. «Au Cap, au Fort-Dauphin, au Port-de-Paix, à Saint-Marc, au Port-au-Prince et sur tous les rivages, témoigne Métrai, ce n’est plus que fouets, croix, gibets, bûchers, soldats, colons, vaisseaux et matelots occupés à tuer, étouffer ou noyer des créatures (p.149) humaines, dont le seul crime était de ne pas vouloir rentrer dans les fers. »
Témoin oculaire, puisque membre de l’expédition partie de l’île d’Aix à bord de La Vertu, Juste Chan-latte, dans son Histoire de la. catastrophe de Saint-Domingue, publiée à Paris en 1824 par un ancien marin, Jean-Baptiste Bouvet de Cressé, rapporte qu’« au lieu des bateaux à soupape, on en inventa d’une autre espèce, où les victimes des deux sexes, entassées les unes sur les autres, expiraient étouffées par les vapeurs du soufre » et qu’on enveloppait « des enfants dans des sacs où, après avoir été poignardés, ils étaient jetés à la mer ». Selon ce même témoin, les délégués au génocide rationalisent peu à peu leurs techniques, jugeant les « moyens de destruction » précédemment utilisés « d’une exécution trop lente et trop coûteuse ». S’ils avaient pu « à l’aide d’une machine pneumatique, intercepter en un seul instant la respiration de tous les [indigènes], ils 1′[eussent] très certainement exécuté ».
En 1814, le colonel Malenfant, évoquant lui aussi ces « crimes atroces » dans son ouvrage Des colonies et particulièrement celle de Saint-Domingue, n’hésite pas à s’écrier : « Quelle honte pour l’humanité et pour B… ! » Non seulement on va gazer et noyer à la chaîne, non seulement on va optimiser les méthodes, mais on va y prendre plaisir. Des formules convenues et goguenardes sont utilisées. Aux « nègres » et « gens (p.150) de couleur », on fait subir le « coup de filet national » (la noyade collective), quand on ne leur fait pas manger une « salade de chanvre » (la pendaison), qu’on ne les « opère pas chaudement » (le supplice du feu) ou qu’on ne leur « lave pas la figure avec du plomb » (la fusillade). Car ils ont tous la figure sale, n’est-ce pas !
Mais pour ajouter une nouvelle teinte à cette palette macabre pourtant déjà assez variée, Louis de Noailles va chercher à Cuba, au mois de mars 1803, quelque six cents dogues avec l’intention de ne les nourrir que d’indigènes. Le ministre de la Marine en est informé par une lettre de l’amiral Latouche-Tréville du 9 mars. Les bêtes et leurs nouveaux maîtres défilent en triomphe au Cap. Renouant avec la tradition des sévices imposés aux premiers chrétiens, Rochambeau a fait construire un cirque à l’entrée du palais national où il réside. Un poteau est destiné aux suppliciés. Des gradins munis de confortables banquettes sont dressés pour les spectateurs « blancs ». Pour inaugurer ce spectacle d’un nouveau genre, le général Boyer livre un de ses jeunes domestiques auquel il n’a à reprocher que sa couleur de peau. On lâche les chiens affamés. L’assistance applaudit. Cependant, moins cruels que certains bipèdes, les dogues se contentent de flairer leur victime. Boyer bondit et, tirant son sabre, il éventre le jeune homme. Malgré la vue et l’odeur du sang, les chiens ne bougent pas. Alors Boyer, frénétique, traîne l’un (p.151) des molosses par le collier jusqu’à sa victime et lui frotte la gueule sur ses entrailles, jusqu’à ce qu’il accepte de les dévorer. Les autres chiens se décident à la curée. Il ne restera que des os ensanglantés. Finalement, le public est horrifié. Mais le spectacle recommence tous les après-midi. On évite le quartier. Les voisins déménagent. Beaucoup de colons quittent l’île, craignant les représailles que de telles exactions peuvent entraîner.
Le général Jean-Pierre Ramel, commandant l’île de la Tortue, n’en revient pas de recevoir un ordre écrit daté du 5 avril 1803 et signé de la main de Rochambeau : « Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de cent cinquante hommes de la garde nationale du Cap. Il est suivi de vingt-huit chiens bouledogues. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu’il ne vous sera pas passé en compte ni ration, ni dépense pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner à manger des nègres. Je vous salue affectueusement, Donatien Rochambeau.1 » Jurien de La Gravière, lui aussi, a vu les chiens lors de l’attaque du Petit-Goâve au printemps 1803. Il confirme formellement qu’on leur donnait de la nourriture humaine. Voici son témoignage : « On
(p.152) embarqua aussi, je rougis de le dire – sur deux goélettes qui nous furent adjointes — deux divisions de chiens achetés à grands frais à La Havane. Ces chiens étaient, assurait-on, de la race employée jadis par les conquérants espagnols pour suivre les Indiens à la trace. Chaque division se composait de soixante-quinze chiens que l’on nourrissait avec de la chair de nègres et que l’on rendait plus voraces encore en les affamant. C’est avec ces horribles auxiliaires que nous partîmes de Port-au-Prince. » Cependant, pendant l’attaque, Jurien s’aperçoit que les mâtins deviennent incontrôlables. Moins racistes, apparemment, que leurs maîtres, « ces chiens, qui ne devaient dévorer que les nègres, se jetaient indistinctement sur tout homme à terre, que cet homme fût noir ou blanc ». Le journal de l’amiral Latouche-Tréville nous apprend par ailleurs que, le 26 juin 1803, deux cents autres chiens furent transportés en renfort au Cap, par un brick espagnol en provenance de La Havane, ce qui porte leur nombre à huit centsl. On reste un peu abasourdi par l’importance de cette meute dont il est confirmé qu’elle ne se nourrit que de chair humaine. Car, sachant qu’un dogue consomme au minimum un kilo de viande par jour, s’ils ont été
(p.153) utilisés jusqu’à la capitulation de novembre, ils ont pu dévorer plus de trois mille personnes. En ajoutant à ce chiffre le nombre de rebelles fusillés, le nombre de civils gazés et noyés, on aboutit très certainement à plusieurs dizaines de milliers de morts. Certains avancent, pour ce génocide, le chiffre de cent mille victimes, soit près de vingt pour cent de la population d’origine africaine peuplant alors Haïti.
(p.154) Même si l’on a peu d’estime pour Napoléon, de toutes les lettres qu’il a écrites, on souhaiterait que celle qu’il adresse à Donatien de Rochambeau le 4 février 1803 ne soit qu’une hallucination. Mais elle existe cependant et elle est si accablante qu’elle ne laisse aucun doute sur la culpabilité de Bonaparte pour chaque goutte de sang versée. « Le ministre de la Marine, écrit le commanditaire de ces monstruosités, m’a communiqué vos dépêches du 23 frimaire [14 novembre 1802]. J’ai vu avec plaisir la reprise du Fort-Dauphin ; je veux directement vous assurer de l’entière confiance que le Gouvernement a en vous, et de son approbation des mesures de rigueur que les circonstances vous obligent ou vous obligeraient de déployer. * » L’approbation du génocide est totale, indéniable, obscène.
(p.156) Un général lorrain, Humbert, proteste avec dégoût. Il refuse de participer aux exactions commises lors de l’attaque du Cap. En représailles, Boyer, l’homme qui éventrera son domestique pour appâter les chiens, l’accuse alors d’avoir des « relations avec les chefs de brigands ». Leclerc, de son côté, écrit au Premier consul qu’Humbert est un « faiseur d’affaires sales ». Il était pourtant mal placé pour porter ce genre d’accusations.
Le 17 octobre 1802, Humbert est embarqué à bord d’un navire de commerce. Il parvient au Havre au début du mois de décembre. Son arrivée ne passe pas inaperçue, comme en atteste la note d’un espion au préfet de police du 15 décembre : « Le bruit s’est répandu aujourd’hui dans Paris, écrit l’argousin, qu’un navire arrivé au Havre a amené le général Humbert, qu’il apporte au gouvernement des détails sur les nouveaux désastres de la colonie. On dit que les noirs ont recouru aux armes, que six mille blancs se sont joints à eux, que les généraux qui étaient avec Toussaint et qui avaient fait leur paix ont imité leur exemple. Enfin on regarde la situation de la colonie comme désespérée. Les bons citoyens sont désolés et les malveillants ne dissimulent pas leur (p.157) joie. » Nul doute qu’Humbert a cherché à informer Bonaparte de ce qu’il croyait être une désobéissance de Leclerc aux ordres de Paris. Comme tant d’autres, le pauvre général se faisait encore des illusions. Il est cassé le 13 janvier par arrêté du tyran avec ordre de quitter immédiatement la capitale et « de se rendre dans sa commune ». Mais il n’obéit pas tout de suite.
(p.157) Par Humbert, au moins, Napoléon, s’il avait été ignorant de la situation, aurait pu être informé. Mais la manière dont il le destitue et l’acharnement avec lequel il le persécutera pendant près de dix ans montrent (p.158) assez qu’il était non seulement au courant mais coupable au premier chef. Il n’y a donc pas à s’étonner qu’il écrive à Rochambeau pour l’encourager dans la mise en œuvre de la solution finale. « Rien n’intéresse davantage la nation que l’île de Saint-Domingue, affirme-t-il. Soyez-en le restaurateur et inscrivez votre nom parmi le petit nombre de ceux que le peuple français n’oubliera jamais et que la postérité révérera, parce que ceux qui les ont portés n’auront été animés que par le sentiment de la vraie gloire. Il est probable que, quand vous aurez reçu cette lettre, la Légion d’honneur sera organisée. Vous y serez placé au rang des grands officiers. »
Pour Napoléon, la « vraie gloire » dépasse l’apparente infamie qui ne vaut que pour le commun des mortels. Le grand homme est au-dessus de la morale. Un crime peut trouver son sens pour la postérité. On peut comprendre que Hitler, le 28 juin 1940, s’incline, tête nue. Napoléon est bien son maître et son dieu. Certes, Hitler fera beaucoup « mieux », en valeur absolue, mais les principes et les méthodes demeurent les mêmes.
En recevant la lettre d’approbation de Napoléon, à la fin du mois de février 1803, Rochambeau a carte blanche. Il peut faire ce qu’il voudra. On le couvrira toujours, à la seule condition qu’il exécute les ordres. Malheureusement pour lui, il capitulera (p.159) devant les « nègres ». Napoléon ne le lui pardonnera pas.
Comme en Guadeloupe, Rochambeau organise des corps francs pour faire la chasse aux « nègres ». Ils se distinguent par leur coiffure : un chapeau colonial à la Henri IV relevé sur le côté, comme en porteront les troupes françaises en Indochine et en Algérie.
(p.160) Pour ces héritiers des « nègres mauvais sujets », il est en effet nécessaire, aujourd’hui encore, de se procurer une autorisation spéciale visée par le préfet. Une fois ce précieux sésame délivré, le passager haïtien, parti de l’aéroport Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, n’est pas au bout de ses émotions. Quand il mettra le pied dans ce département français d’outre-mer où l’esclavage a été rétabli par Victor Hugues le 25 avril 1803, il s’apercevra que l’aéroport international de Cayenne porte le nom de Rochambeau.
(p.161) Si à la Guadeloupe, comme en Haïti, les ordres de Napoléon ont été d’exterminer les masses, ils étaient aussi de déporter tous les « nègres » et hommes « de couleur » qui ont porté l’épaulette, qu’ils aient joué ou non un rôle dans la résistance à l’esclavage.
(p.162) (…) Napoléon a fait déporter des milliers de Guadeloupéens et d’Haïtiens. Il y en aurait eu bien davantage sans la reprise des hostilités avec les Britanniques en mai 1803. Ces déportations, uniquement fondées sur la couleur de peau des victimes, constituent — au sens de la définition donnée par le tribunal de Nuremberg – un autre volet du crime de Napoléon. Alors, erreur grossière ou oubli volontaire ? On ne sait trop. Il est quand même (p.163) difficile de penser que des spécialistes de la période ont pu oublier un personnage comme Toussaint Louverture, dont on ne peut nier qu’il a été déporté et qu’il n’avait rien à voir avec la machine infernale.
En ce qui concerne Saint-Domingue, les ordres écrits remis à Leclerc sont là, signés de Napoléon le 31 octobre 1801 : « Tous les noirs qui se sont bien comportés, mais que leur grade ne permet plus de laisser dans l’île, seront envoyés à Brest. Tous les noirs ou hommes de couleur qui se sont mal comportés, de quelque grade qu’ils soient, seront envoyés dans la Méditerranée et déposés dans un port de l’île de Corse. » Lacrosse puis Richepance ont reçu des instructions analogues pour la Guadeloupe.
(p.164) Quelques mois plus tard, Richepance, conformément aux instructions qu’il a reçues, renvoie Pelage et trente-cinq autres hommes « de couleur ». En même temps, il constitue un camp de concentration improvisé sur l’îlot de Terre-de-Haut aux Saintes. Plus de trois mille soldats de la République y sont abandonnés, presque sans nourriture. On tente ensuite de les vendre à Carthagène puis à New York, non seulement pour assurer une caisse noire à (p.165) l’armée, mais aussi pour le profit personnel de certains officiers. Napoléon ne peut pas ignorer ces procédés. D’autant que, les destinataires n’en ayant pas voulu, cela donne lieu à des incidents. La frégate La Cocarde est victime d’une avarie. Les Britanniques, constatant que la cale est pleine de Quadeloupéens, visiblement destinés à être vendus, la remorquent jusqu’au Cap où elle arrive courant août. Leclerc est très ennuyé en voyant arriver ce bateau chargé de patriotes qui ont lutté pour la liberté et dont la présence est extrêmement dangereuse à Saint-Domingue. Une cinquantaine de Quadeloupéens réussissent à plonger dans la mer et à nager jusqu’aux côtes haïtiennes, malgré la grêle de plomb qui, comme on s’en doute, s’abat sur eux. Ces compagnons de Delgrès vont le venger. En prévenant les Haïtiens que l’esclavage vient d’être rétabli à la Guadeloupe et les résistants massacrés, ils donnent le signal de l’insurrection générale. C’est en partie à cause de cette évasion, spectaculaire trait d’union entre la résistance de la Guadeloupe et la révolution haïtienne, que Napoléon a perdu Saint-Domingue.
(p.166) Les Antillais qui arrivent en France sont souvent moitié moins nombreux qu’à l’embarquement. La consigne est en effet de les transporter enchaînés à fond de cale, dans l’obscurité, les pieds dans l’eau, (p.167) avec les rats. Les esclaves africains, eux, ont au moins droit à l’entrepont. Mais ceux-là étant des révoltés, il est normal qu’ils paient le prix fort. D’où une mortalité impressionnante. Plus de deux mille déportés — militaires ou civils — vont arriver vivants jusqu’à un port français. Certains y resteront, pour servir de plongeurs affectés au renflouement des épaves. Les autres seront embarqués sur des navires, incorporés dans des bataillons disciplinaires ou internés. Bonaparte n’en veut pas sur le territoire national, pour ne prendre aucun risque de « mélange des sangs ». Aucun de ces déportés ne sera jamais jugé. Quelques Haïtiens évadés reverront leur île natale. Les autres, quelle que soit leur affectation, mourront généralement dans les cinq ans.
(p.169) À la fin de 1802, on transforme la caserne de Pontanezen, dans les faubourgs de Brest, en camp de triage. Bien sûr, rien n’est prévu pour chauffer les locaux. On prend du temps pour faire le tri. C’est difficile, car « ils se ressemblent tous ». Les plus mauvais sujets sont destinés aux camps. Six cent dix-neuf Quadeloupéens sont mis de côté pour l’armée. Mais, dix jours plus tard, ils ne sont déjà plus que cinq cent neuf. « Ce climat froid et humide est délétère à ces habitants des pays chauds », glousse Decrès, le ministre des Colonies. C’est vrai qu’on a oublié de leur donner des vêtements et qu’il fait plutôt frisquet, à Brest, en ce mois de janvier 1802. On ne saurait penser à tout ! Les Quadeloupéens échappent finalement au camp de triage pour être installés dans les casernes de la Recouvrance où ils sont enfin habillés. Napoléon suit de près les déportés. « Mon intention, écrit-il au ministre de la Marine le 18 avril, est que les noirs qui sont à Brest, hormis le petit nombre d’ouvriers qui, par leur habileté, sont nécessaires aux constructions, sans excéder le nombre de cent hommes, soient mis à la disposition du ministre de la Guerre. […] Car je porte un grand (p.170) intérêt à ce que Brest et les environs soient urgés de ces individus. »
(p.171) Le Premier consul change finalement ses ordres et, après avoir fait transiter les « brigands » par Bastia, il les expédie à l’île d’Elbe, qu’il vient d’annexer. Un camp de concentration pour « nègres » est spécialement créé à Porto-Ferrajo. Parmi les déportés de l’île d’Elbe, l’ex-député à la Convention Jean-Louis Annecy, âgé de quarante-neuf ans, qualifié de « moteur de l’insurrection par ses discours ». Il est entouré d’officiers supérieurs. Beaucoup de ces déportés sont déjà âgés et souffrent de blessures ou d’infirmités : Annecy est asthmatique et la plupart de ses compagnons sont criblés de plombs ou estropiés. Mais tous sont mis aux travaux forcés et employés aux fortifications. Bien entendu, la majorité meurent à la tâche en moins de cinq ans.
Napoléon installe un second camp de concentration pour « nègres » dans son île natale. La Corse, nation indépendante et démocratique, s’est affranchie de Gênes grâce à Pascal Paoli. Mais Choiseul l’a rattachée par la force en 1769, l’année où le futur despote est censé naître (en fait, il aurait falsifié son état civil pour entrer à l’École militaire). Bonaparte, après avoir vainement offert ses services à Paoli contre les Français, a changé de camp. « Questa birba Napoleone!» s’écrie Paoli avec dégoût. «Cette crapule de Napoléon ! » Né « dans la fange du despotisme » ! C’est ainsi que le héros corse considère le (p.172) fils de Carlo Buonaparte. Une allusion aux relations de cette famille, et notamment de Letizia, la mamma, avec le gouverneur français Marbeuf. La « crapule » déteste son pays natal et l’a renié depuis longtemps. « Questo paese non e per noi ! » (« Ce pays n’est pas pour nous ! ») explique-t-il aux siens en 1793 lorsqu’il décampe, chassé par les indépendantistes qui mettent à sac sa maison. Les cahiers du général Bertrand montrent qu’en 1821, à la veille de mourir, il n’a pas changé d’avis. « La Corse est un inconvénient pour la France, s’écrie le renégat. C’est une loupe qu’elle a sur le nez ! […] Choiseul disait que si, d’un coup de trident, on pouvait la mettre sous la mer, il faudrait le faire. Il avait raison. » Comme il ne veut pas de « nègres » en France pour éviter la contamination « raciale », Napoléon jubile à l’idée d’en expédier en Corse, où la contamination — il est bien placé pour le savoir — ne date pas d’hier. En 1802, la Corse, française depuis trente-trois ans seulement, n’est guère plus soumise que Saint-Domingue. Napoléon aura donc la perversité, pour se débarrasser des « nègres » qu’il s’est fait renvoyer parce qu’il était dangereux de les tuer sur place, de s’en « défaire » en les attelant à la construction d’une route entre Ajaccio et Corte destinée au transport de troupes affectées à la « pacification » de l’île.
(p.174) Une partie des déportés sont détenus dans le camp de concentration proprement dit. Ils sont aux Capucins d’Ajaccio et couchent nus sur le sol « d’une église extrêmement malsaine ». Tous sont astreints aux travaux forcés pour construire la route ou pour aller couper des mâts de navire dans les forêts d’Aïtone ou de Vizzavona et les transporter, malgré la difficulté du relief, jusqu’à Ajaccio. Avec le froid, les travaux publics en altitude sont meurtriers. Quatre-vingts déportés tombent la première année. Mais douze courageux résistants guadeloupéens et haïtiens, dont une femme, réussissent en juillet de l’année suivante à s’évader et à gagner la Sardaigne à bord d’une mauvaise barque. Les effectifs s’amenuiseront tout au long de l’Empire. Après 1814, on perd leur trace. Ceux qui n’ont pas réussi à s’évader sont morts.
(p.183) Peu après le rétablissement de l’esclavage, Napoléon prend, le 29 niai 1802, trois arrêtés secrets et distincts. L’un visant les militaires « de couleur », l’autre les militaires « noirs », le troisième organisant les compagnies « noires » auxiliaires. Il faut savoir qu’une averse d’arrêtés individuels a déjà réformé — ou va réformer — tous les militaires « noirs » ou « de couleur » se trouvant sur le territoire métropolitain. Il n’y en aura plus en service sauf les simples soldats répartis dans trois compagnies auxiliaires de cent hommes. Chacune de ces compagnies est stationnée sur une île pour éviter toute « contamination » : Hyères, Aix et Oléron. Bien entendu, l’arrêté précise qu’elles seront commandées par trois (p.184) « officiers blancs ». Si Napoléon ne veut pas de « nègres à épaulettes » en Haïti ni à la Guadeloupe, ce n’est pas pour en avoir chez lui. Toussaint a déjà été secrètement exclu de l’armée française en mars 1801. Le général Dumas ne va pas tarder à avoir son tour. C’est l’occasion de régler de vieux comptes.
Par un autre arrêté, toujours du 29 mai 1802 (9 prairial an X), tout militaire « de couleur » — même réformé — se voit obligé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Premier consul, de résider en dehors des communes de la première région militaire, qui comprend la Seine, la Seine-et-Marne, l’Aisne, la Seine-et-Oise, l’Oise, le Loiret et l’Eure-et-Loir.
Les mesures sont plus dures pour ceux qui ont la peau plus foncée (les « nègres »). Ceux-là, spécifiquement visés par un troisième arrêté pris le même jour, « seront tenus de prendre leur domicile dans le département des Basses-Pyrénées ou des Alpes-Maritimes ». C’est ainsi que, par la fantaisie du despote, aucun militaire « de couleur » n’est admis à résider à moins d’une centaine de kilomètres de Paris. Bayonne — où la famille de Toussaint va être assignée à résidence – et Nice deviennent des villes pour officiers nègres. Ces mesures ouvertement racistes sont sans doute destinées à éviter toute possibilité de « complot » intérieur. D’aucuns diraient aujourd’hui que c’est pour prévenir le « racisme antiblancs ».
(p.185) Le 2 juillet (13 messidor an X), un nouvel arrêté, publié celui-là, va plus loin. Il ne sera rapporté que le 5 août 1818. Reprenant en quelque sorte une déclaration royale du 9 août 1777, il interdit aux « noirs, mulâtres et autres gens de couleur d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la République ». Tous les contrevenants seront arrêtés et détenus jusqu’à leur déportation. Mais la différence entre cet arrêté et la déclaration de 1777, c’est que cette dernière, pour être appliquée, devait être enregistrée par chaque parlement, ce que plusieurs refusèrent de faire. L’arrêté du Premier consul, au contraire, n’étant exposé à aucun contre-pouvoir, est immédiatement applicable. Pour les « noirs » et les « gens de couleur », la monarchie valait peut-être mieux que la dictature. Plusieurs intéressés – dont la compagne de Delgrès sur l’échafaud – ne se priveront pas de le dire. Grâce à Napoléon, on réactive dans les ports les « dépôts de nègres » de l’Ancien Régime, ce qui équivaut à un camp de concentration de plus dans chaque port. Les textes prévoient en effet que « tout individu noir ou de couleur […] sera, par les ordres du préfet maritime ou du commissaire de la Marine, placé dans un dépôt d’où il ne sortira que pour être renvoyé par le bâtiment qui l’aura amené ou par toute autre voie plus prompte s’il est possible ». Dans la pratique, on réexpédiera les indésirables par le premier bateau partant pour n’importe quelle (p.186) colonie française où l’esclavage est en vigueur (c’est-à-dire autre qu’Haïti). À leur arrivée sous les tropiques, les contrevenants seront vendus au profit de l’État.
La mesure sera sévèrement appliquée et la chasse au « nègre » ouverte sur le territoire français. En 1804, les préfets sont invités « sans éclat » à dresser « l’état de tous les noirs ou hommes de couleur sans aveu […] que l’oisiveté, le vagabondage ou le défaut de moyens d’existence rendent dangereux pour la tranquillité publique ». Le ministre de la Guerre indique « l’intention du gouvernement d’affermir la sûreté intérieure par toutes les voies possibles et d’utiliser dans un service public cette classe d’individus ». En 1807, on invitera les préfets à « faire rechercher tous les individus de cette espèce qui s’introduiraient dans l’intérieur, après avoir trompé la surveillance des autorités à leur débarquement ou après s’être échappés des dépôts ». En 1807 encore, Napoléon, pris d’une nouvelle crise de paranoïa négrophobe, songe à faire carrément expulser tous les « noirs » de France. Il demande à ses préfets de lui faire une liste. L’idée est d’éliminer les « nègres sans fortune dont la présence ne peut que multiplier les individus de sang-mêlé ». Il va sans dire que les élèves « noirs » ou « de couleur » des écoles sont exclus de leurs établissements.
(p.187) Dans le même esprit, intervient en octobre de la même année la fermeture définitive de l’Institution nationale des colonies où se trouvaient les enfants — de toutes couleurs — des familles aisées d’outre-mer (et en particulier, depuis 1797, les jeunes Louver-ture). Cet établissement avait succédé à l’école de Liancourt, installée dans l’Oise par le duc de La Rochefoucauld. La mesure est grave car Napoléon a également fait fermer toutes les écoles des colonies rebelles. Dorénavant, les colons enverront leurs enfants s’instruire en France. Les autres resteront ignorants. Même s’ils sont libres, ils ne peuvent plus entrer en métropole. Les conséquences de cette mesure sont encore perceptibles non seulement en Haïti, qui compte soixante pour cent d’analphabètes, mais, hélas, dans certains départements d’outre-mer.
(p.188) Mais ce n’est pas tout. Dans sa fureur d’apprendre la perte de Saint-Domingue, Napoléon décide d’interdire, sur le territoire métropolitain, les mariages entre personnes à la couleur de peau différente. On lui fait remarquer que c’est contraire au Code civil. Peu lui importe. C’est lui le maître. La loi, c’est lui. Le gouvernement, c’est lui. La France, c’est lui. Plus de « nègres » ! Finis les « nègres » ! À mort les « nègres » ! Le ministre de la Justice, Ambroise Régnier, déjà complice de la loi sur le rétablissement de l’esclavage, a l’idée de faire passer la mesure sous forme de circulaire adressée aux préfets de tous les départements. Fier de l’idée, il signe son chef-d’œuvre le 8 janvier 1803 (18 nivôse an XI) : « Je vous invite, citoyen préfet, à faire connaître dans le plus court délai aux maires et adjoints, faisant les fonctions d’officiers de l’état civil, dans toutes les communes de votre département, que l’intention du gouvernement est qu’il ne soit reçu aucun acte de mariage entre des blancs et des négresses ni entre des nègres et des blanches. Je vous charge de veiller à ce que ses intentions soient exactement remplies et de me rendre compte de ce que vous aurez fait pour vous en assurer. »
C’est ainsi que, dans chaque département, au début de 1803, chaque préfet a adressé à son tour une circulaire à chaque maire, pour que de telles unions soient proscrites. On se doute que de semblables mesures laissent des traces dans les mentalités, (p.189) au fond des provinces, au fond des campagnes, longtemps après qu’elles ont été abrogées. En l’occurrence, rien ne laisse penser que cette initiative de Napoléon a été rapportée avant le règne de Charles X.
(p.193) Ainsi, en 1802-1803, sur les ordres de Napoléon, deux cent cinquante mille Français, principalement antillais, guyanais, et réunionnais, ont été mis en esclavage. Parmi eux, cent mille Quadeloupéens et Guyanais qui étaient effectivement reconnus comme citoyens, cent cinquante mille Martiniquais, Réunionnais et Mauriciens qui ne l’étaient que sur le papier, grâce à un texte admirable que Napoléon n’a jamais, même dans ses rêves, envisagé de leur appliquer. Bonaparte, engageant sciemment un véritable génocide, a fait tuer en Guadeloupe et en Haïti au moins cent mille personnes d’origine africaine : non seulement ceux qui ont résisté, les armes à la main, au rétablissement de l’ordre esclavagiste, mais plusieurs dizaines de milliers de civils, sans distinction d’âge ni de sexe, torturés, violés, gazés, noyés, fusillés, roués, crucifiés, égorgés, étranglés, pendus, affamés, (p.194) empoisonnés, brûlés ou dévorés vifs, simplement à cause de leur couleur de peau.
Plusieurs milliers d’Antillais, appartenant pour la plupart à l’élite de la Guadeloupe et d’Haïti, ont trouvé la mort en déportation dans des conditions abominables, simplement pour avoir dit non à l’inacceptable. À cause de Bonaparte, soixante-dix mille Français européens ou d’origine européenne — soixante mille soldats et marins et près de dix mille civils — sont morts, eux aussi, à l’occasion des opérations de rétablissement de l’esclavage.
(p.195) À cause de lui, au moins deux cent mille Africains seront déportés dans les colonies françaises et un million d’autres perdront la vie à l’occasion de ces opérations de déportation, si l’on retient le chiffre de cinq Africains morts pour un esclave débarqué aux Antilles.
Un million cent soixante-dix mille victimes, dont cent soixante-dix mille Français ! Quatre cent cinquante mille esclaves ! Et tout cela pour un peu de sucre ! Même d’un point de vue colonialiste, c’est un échec : la France a perdu sa colonie de Saint-Domingue et même la Louisiane, que Napoléon vendit, de rage, pour une bouchée de pain, aux Américains en 1803, abandonnant tous les Français qui s’y trouvaient et qui ne le lui pardonnèrent pas. Il est vrai que la France esclavagiste rentrera dans ses frais en extorquant à l’Etat haïtien une indemnité de quatre-vingt-dix millions de francs or, qui correspond à peu près à la valeur des esclaves perdus.
(p.199) Plus tard, une fois la traite et l’esclavage définitivement supprimés, les fanatiques, à court d’arguments pour défendre l’homme qui a rétabli et aggravé le Code noir, souligneront que Napoléon a quand même aboli la traite le 25 mars 1815, oubliant de préciser que cette mesure avait déjà été imposée par le traité de paix du 30 mai 1814 et que celui du 20 novembre 1815 ferait de même, sans trop se soucier, d’ailleurs, de l’initiative hypocrite de Bonaparte, qui n’a jamais trompé personne. Outre que l’abolition de la traite de 1815 n’est pas assortie de l’abolition de l’esclavage ni de la réglementation « raciale » napoléonienne et que cette décision tardive n’efface en rien le crime de 1802, il faut savoir que cet argument ne démontre nullement que l’Empereur, sur le tard, aurait eu le moindre remords ni le moindre regret. L’homme des Cent-Jours n’a fait que prendre une mesure sans incidence concrète puisque, n’ayant plus de colonies ni de marine, ce geste n’était, à l’évidence, destiné qu’à flatter les Anglais qui, eux, avaient aboli la traite dès 1807. Par ailleurs, le sucre commençant à être exploité à partir de la betterave grâce à la raffinerie installée à Passy par Delessert, Napoléon avait prohibé l’importation du produit de la canne dès le 1er janvier 1813. Tout en invoquant, donc, Joséphine, les colons, l’opinion française, Toussaint, la malchance, la fièvre jaune, les subalternes, jamais une fois Napoléon ne (p.200) s’est remis en cause. Il s’est contenté de dire qu’il a simplement maintenu l’esclavage où il existait déjà et qu’il n’a jamais donné l’ordre positif de le rétablir à Saint-Domingue. Le crime appelle toujours le mensonge. Et naturellement, il n’a jamais pu s’expliquer sur la Guadeloupe ni sur la Guyane, dont il se moquait bien, du reste.
(p.200) En tant que premier dictateur raciste de l’histoire, Napoléon a sa part de responsabilité, non seulement pour tous les crimes coloniaux ultérieurement commis par la France, mais aussi pour tous ceux du nazisme qui s’est, à l’évidence, inspiré de l’Empereur comme d’un modèle. Le crime de Napoléon a causé à la France des blessures d’autant plus profondes qu’il a été occulté. Elle subit tous les jours encore les effets du racisme d’État mis en place à cette époque. Des exactions aussi effroyables que celles accomplies sur ordre par les soldats de Bonaparte, des textes aussi monstrueux que ceux qu’il a signés ou ordonnés, des théories aussi abominables que celles qu’il a encouragées au sein même de son université impériale, véritable machine à contrôler la pensée, laissent des séquelles durables. Et si l’esclavage a été aboli en 1848, le racisme est toujours là, aussi hideux, aussi stupide. En ce sens, tant qu’il n’est pas dénoncé, le crime de Napoléon continue à se commettre.
(p.201) Il ne s’agit pas d’instruire un procès contre un homme qui n’est plus là pour se défendre, mais d’imposer à ceux qui s’obstinent à le glorifier aveuglément, et qui considéreront sans doute tout ce qui vient d’être évoqué comme un simple « point de détail », le minimum de respect dû aux descendants des victimes antillaises et africaines de Bonaparte. Les offenser, c’est offenser aussi les martyrs de tous les crimes contre l’humanité, une et indivisible. Les Haïtiens, en souvenir de leur propre génocide, ont tenu à figurer, durant la Seconde Guerre mondiale, parmi les rares peuples à accorder l’asile et la nationalité à tous les juifs persécutés qui en faisaient la demande. En méditant cet exemple, les héritiers de tous ceux qui ont subi la déportation, l’humiliation, la déshu-manisation, l’extermination — quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit l’époque du crime, quelle qu’en soit l’ampleur – ne doivent jamais oublier qu’ils sont liés, non seulement par la fraternité naturelle de l’humanité, mais aussi par une fraternité de souffrance que l’histoire leur a imposée.
(p.201) Au nom de ces héritiers de tous les martyres, restituer aux descendants des victimes de Napoléon la vérité qui leur revient, et qu’on leur refuse depuis deux siècles, c’est une manière de contribuer à en finir un jour avec le fléau du racisme dont Napoléon fut incontestablement, avec Hitler, l’un des plus ardents et des plus coupables propagateurs.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.22) In May 1786 he seriously contemplated suicide. He still hated the French, lamenting that his fellow-Corsicans were suffering beneath ‘the oppressors’ hand’ and how ‘I am compelled by duty to like people whom it is natural for me to hate’.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.103) His sole Ianguages were French and Italian. According to Chaptal, who is borne out by Mme de Rémusat, he spoke neither well – ‘When he was talking French one could easily see that he was a foreigner! His secretaries read extracts from the British and German newspapers to him, but he was unable to pronounce properly a single word of English or German. When he met Goethe he called him Monsieur Goet.’
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.103) His most unpleasant indulgence was his temper. Bourrienne tells us, however, that even at the beginning of the Consulate his insults, epithets and outbursts of rage were all carefully calculated. Yet he often lost control of himself, as when during the same period he kicked the senator Volney – a trusted friend from Corsican days – in the stomach, knocking him to the ground. (Volney had to stay in bed for a few days.) The worshipping Baron Méneval has to admit that his face ‘grew terrible’ when he was angry. He could lose his temper with the humblest people, such as Josephine’s unfortunate milliner, Mlle Despeaux, at whom he is recorded as ‘yelling like a maniac’. (Though the fact she was a notorious lesbian may hâve been partly responsible.) When he quarrelled with his wife he would smash the bedroom furniture. Giuseppina Grassini, who had also shared a bedroom with him, says he could ‘pass abruptly from the intoxication of love to that of wrath and fury – it was volcanic, Etna roaring while covered in flowers’. These fits of fury made dangerous enemies, such as the row when he called Talley- rand ‘shit in a silk stocking’ or at the crucial meeting with Metternich at the Marcolini Palace in 1813 at Dresden in which by Metternich’s own account he grossly insulted him. He was capable of publicly hitting a general in the face, as he did during the German campaign of that year.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.105) Nevertheless, he was not popular with everybody. A jingle circulated in Paris at this time: On loans and alms I long supported life, I fawned on Barras, took his drab to wife; I strangled Pichegru, shot Enghien down, And for so many crimes, received a crown.’
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.219) The Emperor grew steadily more dictatorial. He was obsessed by power, would not share it, would brook no criticism, let alone opposition. The Tribunate, the last consultative institution to remain from Sieyès’s constitution, was reduced to a tame shadow, then finally abolished in 1807. The Senate was too cowed to question Impérial decrees. Ministers were deliberately prevented from working together as a body; to divide them still further, they were encouraged to compete for his favour. Men of genius like Talleyrand, Fouché and Chaptal who expressed réservations about his policies were eventually dismissed. In conséquence there was much confusion, with considérable duplication of effort. From the very beginning he set out to create a numbing atmosphere of fear and distrust. Even under the Consulate, during a visit to Paris in 1801, the Rev. Jackson, Dean of Christchurch, received the strong impression that Bonaparte’s ‘great end is to diffuse suspicion everywhere, considering it his best hold’. Napoleon himself declared, ‘I reign only through the fear I inspire.’ Not just France but the entire Grand Empire became increasingly fearful as the years went by. (p.227) The police were ubiquitous, constantly raiding the most inoffensive gatherings; hunting horns might not be blown in taverns, women had to obtain a licence if they wished to dress like men and a curfew was enforced. There were agents provocateurs everywhere, stirring up discontent in order to identify potential enemies of the regime who were then arrested at midnight, brutally interrogated, and imprisoned or executed.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.232) A Naumburg journalist called Palm published anonymously a pamphlet entitled Germany In Her Deep Humiliation. Napoleon ordered all booksellers stocking it to be shot; Palm, who lived on neutral territory, was grabbed by a troop of gendarmes and sent before a firing-squad. Andreas Hofer, who led 40,000 mountaineers against the transfer of his native Tyrol from Austria to Bavaria, was hunted down and executed, Colonel Dornberg, trying unsuccessfully to seize Cassel, met a similar fate. The Prussian Colonel Schill – without his King’s permission – invaded Westphalia with his regiment but was driven off, cornered at Stralsund and slaughtered with his men.
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.404) Bonaparte peut se montrer sur certains sujets d’une grande étroitesse d’esprit : c’est lui qui insiste pour qu’on inscrive dans le Code civil que la femme « doit obéissance » à son mari, quand la Révolution était favorable à une égalité civile entre l’homme et la femme. Il refuse l’éducation publique pour les filles dont le destin, à ses yeux, est fort simple : « Le mariage est toute leur destination. » Enfin il restaure la paix civile, c’est vrai, mais à quel coût ? Le régime qu’il instaure a un nom qui nous est bien connu, la dictature. Dès son arrivée au pouvoir, les élections sont truquées. Le vote se pratique à livre ouvert. À chaque consultation, on doit écrire publiquement son choix en face de son nom. Et si ça ne suffit pas, les préfets bien intentionnés se chargent de rectifier les décomptes. L’Empereur, avec ses plébiscites, prétend s’appuyer sur l’assentiment du peuple. On voit le cas qu’il en fait.
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.405) Les bulletins de la Grande Armée qui chantent les ‘ triomphes de l’Aigle indomptable sont lus dans les écoles, sur les scènes et dans les prêches, avec cette obsession du bourrage de crâne qu’on ne retrouvera à ce niveau que dans les régimes les plus sinistres du XXe siècle.
L’ogre et les grognards
Tout de même !, s’exclamera-t-on. Et la gloire, les victoires, toute cette épopée qui fit tant rêver les générations qui suivirent ? Et la grandeur de la France, rendue à son sommet ? Vraiment ?
Le premier revers de cette belle médaille qui vient à l’esprit est évidemment son coût humain. Un million de morts français selon la plupart des estimations, trois millions de victimes au total, cela fait cher payé le défilé sous l’Arc de Triomphe. On dira que la critique n’est pas neuve. C’est exact. Elle apparaît dès la restauration sur le trône des Bourbons, pour saper le souvenir de celui que la propagande royaliste nomme le « boucher ». Dès la fin de son règne, dans les campagnes, en murmurant, on l’appelait l’« ogre », parce que ses besoins en hommes étaient tels qu’il faisait enlever les enfants de plus en plus jeunes. Nombreux sont ceux qui refusèrent d’ailleurs de s’enrôler. Vers la fin du régime, on comptait plus de 100 000 réfractaires cachés dans les forêts et les montagnes pour échapper à ce qui ressemblait à un voyage vers l’abattoir. On , reste à s’interroger sur les motivations des centaines de milliers d’autres qui y sont allés. La légende napoléonienne a essayé de (p.406) forger le souvenir des « grognards », ces râleurs invétérés mais toujours tellement valeureux, prêts à mourir pour leur empereur. Sans doute y en avait-il. Et combien d’autres, pauvres gosses emmenés de force, à qui on a fait parcourir l’Europe à la marche, les pieds saignant dans de mauvaises chaussures, écrasés par un barda, pour finir fauchés par une fusillade dans ces batailles terribles qui laissaient, au soir, 20 000 ou 25 000 cadavres sur un champ d’herbe, sans autre dernier hommage que la visite des détrousseurs. Morts pour quoi, morts pour qui ? Et après ? diront les cocardiers, finissons-en avec cette vieille chanson de pacifistes d’arrière-garde chantée cent fois ! L’Empereur a quand même fait beaucoup pour la France. Ce point-ci est important, tant il passe pour une évidence. C’est en effet une évidence, mais elle joue à l’inverse : si l’on s’en tient à un seul point de vue patriotique, le bilan de l’Empire est clair, c’est un désastre. Napoléon a beaucoup gagné, c’est vrai, mais il n’a su consolider aucune conquête et a tant perdu au final qu’il laisse la France beaucoup plus petite qu’il ne l’a trouvée. Le Directoire, en partie grâce à lui d’ailleurs, avait agrandi considérablement le territoire et constitué autour de la République une ceinture de « républiques soeurs » qui la protégeaient. Quinze ans plus tard, les conquêtes sont parties en fumée. Nice et la Savoie sont perdues, elles ne redeviendront françaises qu’en 1860. Le Rhin, pour les révolutionnaires, faisait partie des « frontières naturelles » de la France, exactement comme le sont toujours pour nous les Pyrénées ou l’Atlantique. La France ne reprendra jamais pied sur sa rive gauche. Enfin, tout à ses chimères de domination de l’Europe, dans le vague espoir de s’attirer le soutien des Américains contre l’ennemi anglais, Bonaparte a commis ce qui peut sembler une erreur incroyable : il a vendu aux Etats-Unis, et pour une bouchée de pain, l’immense Louisiane – environ le quart du territoire américain actuel. Nous parlions du rayonnement de notre pays. Imagine-t-on sa puissance si cette gigantesque province était restée pendant quelques décennies encore notre cousine ?
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.114) « Un million d’ hommes, par sa grâce, mourront, …, dans les carnages de sa « gloire ». Et le malheur de mon pays fut que ce météore (« incomparable météore », dit Jacques Bainville), pour ses interminables razzias, s’était procuré, comme tueurs, les conscrits français. »
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.152) « L’ immense mérite de /Napoléon/ Bonaparte c’ est celui que lui reconnaissaient très justement, Necker le banquier et sa fille; il avait fermé, une bonne fois, l’ épouvantable parenthèse ouverte par le 10 août, quand écrira Mme de Staël – « la révolution changea d’ objet », quand « les gens de la classe ouvrière s’ imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. » Il avait ramené la canaille au chenil et même, coup d’ éclat, en lui inspirant, sous l’uniforme – un « bienfait » sans nom, ce déguisement perpétuel des prolétaires en soldats! – de l’ enthousiasme, de la passion. Quel repos pour les gens de bien! » « J’ai rétabli la propriété et la religion », prononce Bonaparte, résumant son oeuvre, à Sainte-Hélène, le 13 août 1817. »
(p.153) « Quant aux menus détails que j’ ai jugé bon de rapporter sur M. Bonaparte lui-même, sa personne et son »âme », si ce n’ est pas très beau, ce n’ est pas à moi qu’ il faut s’ en prendre; « c’ est la vérité qui est coupable », disait déjà Robespierre. mais quand elle déplaît à certains, elle perd pour eux le droit d’ exister. »
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.7) Je n’avais pas choisi d’étudier Bonaparte. Cette enquête m’a été demandée. Je l’ai entreprise et je l’ai menée de mon mieux, m’apercevant, en cours de route, que mes observations rejoignaient celles de certains hommes peu négligeables, comme Lamartine et comme Michelet. Et je viens, cette année, de constater que quelqu’un d’autre aussi, dont je savais peu de choses, Tolstoï, avait eu les mêmes sentiments que moi. Réflexe du Slave devant l’homme de Borodino, l’agresseur de son pays ? Non ; car il suffit de bien lire La Guerre et la Paix pour voir que les sévérités de Tolstoï n’épargnent aucun conquérant ; et il y a dans son livre, sur les mobiles des généraux (des généraux russes comme des autres) un paragraphe trop peu connu, et qui en dit long. Simplement, Tolstoï avait compris — ouvrez son Journal, 1857 ; le récit de sa visite aux Invalides —, il avait compris, après s’être informé, ce qu’était, au vrai, l’homme proposé à l’admiration de l’univers dans son sarcophage de porphyre rouge; et il l’écrit en toutes lettres : un « bandit » ; terme dont la traduction littérale, en anglo-américain d’aujourd’hui, est gangster.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.9) Paoli, en 1769, subit une lourde défaite, et doit s’expatrier. Carlo Buonaparté, aussitôt, change de camp, passe du côté des vainqueurs, collabore avec eux, et ferme en souriant les yeux sur la liaison affichée de sa très jeune femme, Letizia, avec le gouverneur français Marbeuf — un homme de plaisir que Paoli traitait de « pacha luxurieux ». Il est vrai que Paoli manquait, paraît-il, de moyens. Napoléon racontera lui-même, gaillard, que sa mère (cette « femme de Plutarque », selon M. Louis Madelin) riait beaucoup de Paoli, dans sa jeunesse ; galant, certes, Paoli, disait-elle, mais incapable.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.11) A seize ans, Buonaparté (qui cache son prénom inusuel ; ses camarades de Brienne ont été grossiers à ce sujet, traduisant son « Napoléoné » en « La-paille-au-nez » ; il signe donc « C [pour Carlo, sans doute] de Buonaparté ») est nommé sous- lieutenant au régiment dit « de la Fère », dont une partie tient garnison à Valence. « Dans cette armée de l’ancien régime, énonce avec majesté M. Jacques Bainville, tout était sérieux ». J’en veux pour preuve, en effet, que, sous Louis XVI, la moitié — je dis bien : la moitié — du budget de la guerre était absorbée par la solde des officiers. Quant aux sous- lieutenants de seize ans, je doute un peu de l’ascendant que pouvaient exercer sur la troupe, en dépit de leur particule et de la morgue requise, ces garni- nets à épaulettes, et surtout le Carlo-Napoléoné, de taille brève ( lm 64) et court de pattes. Mais l’usage, chez ces jeunes gens (on le constate en examinant la carrière militaire d’un sous-lieu tenant du même âge, François René de Chateaubriand), l’usage de ces messieurs était de multiplier les absences. L’officier Buonaparté sera pratiquement un éternel permissionnaire.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.13) /Car seule la Corse l’intéresse et ce qu’il y manigance depuis des années. Le danger de la Patrie est le moindre de ses soucis, pour la bonne raison que, pour cet officier français, la France — qui l’entretient et le paie — est si peu sa « patrie » qu’il la déteste, qu’il la hait et qu’il travaille en secret contre elle, afin de réussir, en Corse, une opération toute privée./ Aurais-je risqué un mot excessif ? (Ma manie, bien connue, du « pamphlet »). Haine de la France ? Eh bien, lisons. C’est de l’officier en garnison à Auxonne : « Féroces et lâches, les Français joignent […] aux vices des Germains ceux des Gaulois » ; ils constituent « le peuple le plus hideux qui ait jamais existé ». Antérieurement, à Goubico, greffier des Etats de Corse : « Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime ? Continuerons- nous à voir tous les emplois que la nature nous destinait occupés par des étrangers ?» — et des gens, ajoutait-il, très aristocrate, dont, pour la plupart, « la naissance est abjecte ». A son oncle Fesch, le futur cardinal : « Les Français ! Avons-nous assez souffert de leurs vexations ? […] Qu’ils redescendent au mépris qu’ils méritent ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.28-29) Napoléon se vantera, bien entendu, d’avoir lui- même et lui seul, tout conduit, devant Toulon, et le Larousse disait encore, jadis, avec une simplicité confiante : « En 1793, Bonaparte reprit Toulon ». Qu’il ait contribué efficacement à la victoire, je le pense ; il avait du coup d’œil et de la décision. Qu’il ait tout fait, c’est une fable. Dans son rapport à la Convention, après la reprise de la ville (Moniteur du 28 décembre), Dugommier mentionnera son nom et lui décernera des éloges. Agréables, les compliments ; mais Napoléon Bonaparte entend être payé en monnaie plus solide. Deux nouveaux Représentants viennent d’arriver, les députés Barras et Fréron. Le jeune Lucien (Loutchiano, en famille), qui s’était replié à Saint-Maximin, est accouru lui aussi et se distingue dans les vengeances ; il signe « Brutus Bonaparte » et agit en qualité de secrétaire des Jacobins locaux ; il rédige une « adresse » à la Convention qu’il date « du champ de gloire », « marchant, dit-il, dans le sang des traîtres » : « ni l’âge, ni le sexe n’ont été épargnés ; ceux qui n’avaient été que blessés par le canon [car on a tiré au canon sur les prisonniers] ont été dépêchés . par le sabre et la baïonnette « Barras et Fréron réglaient vivement tout cela, assistés par le commandant Napoléon Bonaparte qui les suivait comme leur ombre ; « il ôtait son chapeau devant nous, relatera Barras, et le portait aussi bas que son bras pouvait descendre ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.93) Elle est bien connue, l’interjection de la « mamma » devant la réussite, en France, de son « Nabou » : « Pourvu que ça dure ! » Elle prononçait cela à l’italienne, celle qui devient « Madame Mère », quand le plus débrouillard de ses garçons se hisse, en 1804, carrément, sur le trône de France. Ce n’est pas une vieille dame ; c’est une personne de cinquante-quatre ans, peu bavarde, qui pince les lèvres, et qui garde la tête froide. Inouï, ce qu’il leur arrive à tous, toute la bande ajaccienne, jadis famélique, à présent qui nage dans l’or ! Tellement inouï que ça n’a pas l’air vrai, que ça va peut-être s’évanouir comme un rêve. Pourvu, pourvu qu’une telle félicité n’aille pas soudain disparaître ! Pourvu qu’elle dure, oui, tant c’est merveilleux de se trouver (p.94) ainsi, invraisemblablement, catapulté au sommet de la vie sociale et parmi toutes les jouissances de la terre ! Difficile de croire qu’une pareille aubaine puisse offrir longtemps ses délices. Aussi thésaurise-t-elle, la mamma, avec une parcimonie attentive et méticuleuse. Cette « femme de Plutarque », comme dit l’autre (= /Louis Madelin/) admire le champion de la famille, mais elle n’oublie pas qu’elle est pour quelque chose dans ce prodige de bonheur ; car c’est bien à elle, en dernière analyse, que le clan doit sa fortune ; pas à son mari, le chenapan ; à elle, la petite rusée. Comme elle a bien fait, adultère, de coucher, avec le gouverneur Marbeuf ! Tous les profits de la tribu, au fond, sont sortis de cette alcôve. C’est elle, la poule aux œufs d’or.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.104) Il aura un jour (le 11 février 1809), devant Roederer, une formule qu’il savoure, tant elle lui paraît adéquate : « La France ? Je couche avec elle ; et elle me prodigue son sang et ses trésors1 » ; autrement dit : Elle fait ce que je veux, et elle paie.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.106) Il est vrai qu’aussi les combats lui plaisent ; il l’a dit à Roederer : « C’est le don particulier que j’ai reçu en naissant ; c’est mon habitude ; c’est mon existence » N’oublions pas d’ajouter que la guerre, pour Bonaparte, doit être — et primordialement — une entreprise qui rapporte ; et il s’y entend, à la faire rapporter ; sinon pour l’Etat, du moins pour lui-même ; et d’autres en profitent, qui se loueront ainsi de lui ; « je les connais mes Français », dit-il à Lucien, d’un ton assez crapuleux ; ils adorent d’avoir « à leur tête » quelqu’un « qui les mène voler, de temps à autre, à l’étranger ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.111) /1809/ Il continue à ne pas savoir très bien le français, confondant « session » avec « section » et « amnistie » avec « armistice ». Chateaubriand observera qu’on ne saurait parler sans prudence de son style, car il dicte, la plupart du temps, et prodigieusement vite, laissant le soin à ses secrétaires de mettre en forme ce qu’il débite ; quant à ses fameux bulletins de guerre, ils sont rédigés par des scribes ; (…).
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.118) Le Domaine Extraordinaire de Napoléon Bonaparte, c’est son bien, son trésor, son argent ; dépouilles européennes. Cela même pour quoi, en vue de quoi, il a, depuis vingt ans, tant joué des coudes, tant « combiné » (1) d’abord, et tant tué ensuite ; la garantie de cette opulence, suprême et sans mesure, but unique de sa trajectoire.
(1) Confidence à Roederer: « Pour arriver où je suis arrivé, on ne ait pas ce qu’il m’a fallu de combinaisons. »
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.143) Nous possédons, par bonheur, pour corriger le Mémorial, les journaux de ses auditeurs, celui de Bertrand surtout, le plus complet. L’homme y apparaît dans sa médiocrité navrante ; non pas seulement une âme basse, et à ras de terre, mais qui dégage une odeur putride. Incapable d’élan, étranger à toute idée haute — la nature, les fleurs, la mer, le ciel, ne l’intéressent pas ; il ne les voit point —, haussant les épaules devant ce qui fait (p.144) la noblesse humaine, il est totalement replié sur soi et remâche du matin au soir les épisodes de sa carrière, supputant ce qu’il eût dû faire pour que « ça durât » plus longtemps. Il avait dit, déjà, devant Bourrienne : « Je n’aime personne », et, devant Roederer, le 12 novembre 1813 : « Je suis l’homme du calcul sec » ; (…).
|
|
http://www.africamaat.com/article.php3?id_article=137 NAPOLÉON , GRAND CRIMINEL contre L’Humanité www.africamaat.com Lorsqu’un mortel se prend pour Dieu
Dictateur, tyran, usurpateur, despote, brutal, violent, démolisseur, geôlier de la liberté, meurtrier, tortionnaire, menteur, misogyne, excommunié par le pape ; voici quelques qualificatifs de Napoléon Ier. Ce monstre, d’après une chaîne de télévision, a été élu deuxième personnage historique préféré des Français ! Il est celui qui a commis aussi ce crime contre l’Humanité en rétablissant l’esclavage des Noirs aux Antilles ; celui qui fit mourir de faim et de soif un héros, Toussaint Louverture. Le Général Toussaint Louverture Alors que la France a fêté le 2 décembre 2004 le bicentenaire du sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris. Nous avons entendu et vu dans les médias ce que ce dictateur « Hitler du 19e siècle » avait apporté à la France : création de la Banque de France, création des Lycées, institution de la Légion d’Honneur, publication du Code Civil, création de la Cour des Comptes. Très peu ou pas du tout d’allusions sur la multitude des crimes de Napoléon, encore moins sur les crimes concernant les Noirs. Pourtant cette tragédie (traite et esclavages des Noirs) allait durer quatre siècles et demi ! NAPOLEON LE DICTATEUR, L’ANTÉCHRIST
Le Dictateur Napoléon Napoléon « Empereur des Français » mérite d’être relégué au musée des horreurs. Ce fut le pire ennemi du genre humain. Napoléon a répandu le feu, le sang et la peine dans toute l’Europe mais aussi loin des frontières de l’Europe. Il fut sans conteste l’un des plus grand tyran de France. Il est brutal et dénué de scrupule. A l’étranger, l’époque napoléonienne fut vécu comme une période d’occupation. Les Européens discréditent l’usurpateur. Aucun doute, c’était un dictateur barbare. Il pensait qu’une bonne constitution devait être forcement obscure. Il utilise volontiers la répression : villes pillés et brûlés, exécutions sommaires. L’espionnage, les manipulations, les complots et les dénonciations systématiques sont courantes. Cela se termine par des exécutions (peine de mort), des exiles, des travaux forcés ou des emprisonnements selon l’humeur de l’Empereur. La police napoléonienne est la mère de ces polices totalitaires qui fleuriront au XXe siècle. La police emploie la torture (par exemple dans la division confié à Bertrand). La population est surveillée par des « mouchards » (un réseau d’espions et des proches du dictateur). Des provocations policières sont organisées pour permettre d’éliminer des opposants (ils sont guillotinés) ; par exemple « la conspiration dite des poignards » du 10 octobre 1800, est un piège de la police. Les libertés sont bafouées et la justice est très répressive. Les supplices existent : marquage au fer rouge, amputation, le fouet, la bastonnade, etc. C’est le 18 mai 1804 qu’il est proclamé « Empereur des Français » par le Sénat (qui n’a pas le choix). Et la même année, le 2 décembre, il se couronne lui-même à Notre-Dame car il ne voulut pas être couronné par le pape Pie VII (présent à la cérémonie). A partir de 1806, il se fait vénéré comme un saint. En effet, sur le calendrier apparaît la Saint Napoléon qui est fixée au 15 août (en même temps que Marie, la mère de Jésus). Les prêtres réfractaires aux idées du dictateur, sont arrêtés et exécutés (l’échafaud). Il fait même emprisonné le Pape qui l’avait excommunié (le pape voulait récupéré les États pontificaux). Entre ses mains, les évêques doivent prêter serment de fidélité. Avec les femmes, il est impulsif. Il lui arrive de maltraiter Joséphine. Il méprise les femmes. Pour lui, pour une femme qui lui inspire quelque chose de bien, il y a cent qui lui fait faire des sottises. Il refuse aux femmes d’accéder aux mêmes écoles que les hommes car pour lui elles doivent être élevées pour être des croyantes et non des raisonneuses. L’État doit faire d’elles de bonnes épouses et de bonnes mères. Le tyran n’aime pas les femmes intelligentes.
|
|
L.-E. Halkin, Waterloo: l’anti-Europe de Napoléon, LS, 10/07/1990
« Evoquons les causes profondes de ce désastre. Napoléon rêvait d’une Europe nouvelle, d’une Europe soumise à l’hégémonie d’une seule nation, une Europe française comme l’Europe de Hitler aurait été une Europe allemande. Cette Europe asservie, l’Angleterre, sentinelle de l’équilibre européen, ne peut la tolérer. Après la victoire de sa flotte à Trafalgar, elle instaure le blocus des ports français. A ce défi, Napoléon répond par un autre défi: c’ est le Blocus Continental. Décision lourde de conséquences! » « Sous la flotte française, l’ Europe souffre et espère. » « L’ Europe de Napoléon n’est pas notre Europe. L’Europe que nous attendons ne peut être ni française, ni allemande, ni russe, mais européenne, c’est-à-dire fraternelle, démocratique et pacifique. »
|
|
Luc De Vos, Les quatre jours de Waterloo, 15-18 juin 1815, éd. Versant Sud, 2002
(p.50) La faiblesse de la flotte française ne permettant pas une attaque directe contre la Grande-Bretagne, Napoléon chercha un recours dans la stratégie indirecte. Le blocus continental décrété contre la Grande-Bretagne depuis 1806 devait mettre fin à la prospérité et à la puissance de cet État industriel. Le blocus apparut comme une bévue dans le domaine de la Grande stratégie et il s’avéra un tournant dans la carrière de Napoléon. Non seulement, le blocus était inefficace, mais il était aussi très impopulaire, surtout au Danemark, dans les Pays-Bas, en Italie et en France même, en particulier à Bordeaux, Nantes et La Rochelle. L’extension du blocus au Portugal et à l’Espagne allait mener à une lutte sans fin. Le Portugal refusa d’appliquer les mesures à l’encontre de son vieil allié britannique, tandis qu’une petite armée anglo-portugaise soutenait l’insurrection espagnole dès 1808. Enfin, la Grande- Bretagne trouvait de nouveaux débouchés en se tournant vers le marché latino-américain.
(…) L’absorption des États pontificaux aboutit en 1811 à l’excommunication de l’Empereur. Ce faisant, il dressait contre lui la France rurale encore majoritairement catholique.
|
|
Martin Bril, De kleine keizer, Prometheus Uitg., 2009 (p.139) In de nacht van 12 op 13 april 1814 deed Napoleon in Fontainebleau een zelfmoordpoging. Op het slagveld was het hem eerder dat jaar niet gelukt te sneuvelen. Hij bevond zich op een dieptepunt in zijn leven. In Parijs waren zijn maarschalken met de tsaar, de Pruisen en de Oostenrijkers een wapenstilstand overeengekomen, en de afspraak was nu dat de keizer afstand zou doen van de troon en het land zou verlaten. (p.140) Napoleon probeerde zichzelf te doden door vergif in te nemen. Sinds zijn Spaanse veldtochten droeg hij dat gif onder zijn kleren in een zakje op zijn borst met zich mee. In Spanje was het niet verstandig om in handen van de vijand te vallen. Ook tijdens de Russische veldtocht had de keizer het gif bij zich; het was dus ruim twee jaar oud toen hij het in Fontainebleau innam. Hij werd er alleen maar kotsmisselijk van. Zelfs de dood was hem niet vergund. In L’Absent, een roman van Patrick Rambaud, is de scène uitgebreid en kostelijk beschreven: ‘Sire, quand on veut se tuer on prend un pistolet, et alors la dose est sûre,’ zegt een van de bedienden tegen Napoleon terwijl de ander hem een mooie vaas onder de mond houdt om in over te geven.
|
|
Napoléon vu par Claude Ribbe : « un criminel raciste », in : L’Histoire 61, 2005-2006, p.100-101
Selon l’historien Claude Ribbe, Napoléon est coupable à ses yeux de « l’extermination industrielle d’un peuple ». Dans son dernier livre, il le compare ainsi à Hitler. Après le rétablissement de l’esclavage par la France en 1802, plus d’un million de personnes ont été vouées à la mort selon des critères ‘raciaux’ par Napoléon. « Génocide perpétré en utilisant les gaz, citoyens mis en esclavage (250 000 Français, surtout antillais, guyanais et réunionnais), (…) escadrons de la mort, camps de triage (en Bretagne) et de concentration (sur l’île d’Elbe et en Corse), lois raciales (…).
(p.100) Il n’est pas étonnant qu’il ait servi de modèle à Mussolini qui a écrit une pièce à sa gloire ni sutout à Hitler qui vient le saluer d’un ‘Heil Napoléon’ aux Invalides le 28 juin 1940 », lors de sa visite à Paris.(…) Napoléon a instauré une législation raciale qui annonce les lois de Nuremberg et qui interdisait aux Noirs et gens de couleur d’entrer sur le teritoire français. Napoléon, par une circulaire honteuse du 8 janvier 1803, a interdit les mariages ‘entre un blanc et une négresse ou entre un nègre et une blanche’. Ambroise Régnier, le signataire de ce texte dicté par Napoléon, est au Panthéon.
|
Paul Vaute, Napoléon coupe la France en deux, LB 03/12/2005
L’Empereur belliciste se trouve depuis longtemps au banc des accusés. Un ouvrage consacré au sort des colonies pousse le bouchon encore plus loin. I On y parle de « génocide perpétré en utilisant les gaz »…
Heil Napoléon!
Du côté des contempteurs, on brandit surtout un ouvrage sorti jeudi et qui pousse le bouchon au plus loin. Intitulé « Le Crime de Napoléon » (éd. Privé) et soutenu par des associations de la France d’outre-mer – qui ont annoncé une manifestation ce samedi « contre le révisionnisme historique » -, il dénonce le « rétablissement », en 1802, de l’esclavage (qui avait été aboli, plus formellement que réellement, par la Convention en 1794) ainsi que la répression de la révolte des Noirs d’Haïti, alors colonie française. A en juger d’après le résumé et les extraits donnés par l’agence France-Presse, le réquisitoire fourmille de parallèles avec le nazisme: « Cent quarante ans avant la Shoah, y lit-on, un dictateur, dans l’espoir de devenir le maître du monde, n’hésite pas à écraser sous sa botte une partie de l’humanité. » Il est aussi question d' »une vaste opération de nettoyage ethnique » à Saint-Domingue et même d’un « génocide perpétré en utilisant les gaz », toujours sur l’ordre de celui que Hitler, après la défaite de la France en 1940, alla saluer d’un « Heil Napoléon ! » aux Invalides.
Les guerres dont l’Empereur porta la responsabilité, les exactions des troupes qu’il cautionna de l’Atlantique à l’Oural, son indifférence au coût humain de ses entreprises mégalomanes (« Une nuit à Paris réparera tout cela », déclara-t-il un jour devant un champ de bataille jonché de cadavres)… : ces sombres aspects ont été amplement mis en lumière dans l’historiographie hexagonale des dernières années, sauf exceptions.
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002(p13) On a chanté sa « géniale » campagne d’Italie: c’est faux, ce ne fut pas sa campagne mais celle de Carnot, Bonaparte n’a fait qu’obéir, scrupuleusement, aux ordres stratégiques que lui envoyaient chaque jour ce dernier et le Directoire. On l’a célébré comme l’homme qui a fait signer le traité de Campo-Formio à l’Autriche et mis fin aux guerres de la première coalition: c’est vrai, mais elles se continuèrent par celles de la deuxième coalition, sa réorganisation de l’Italie s’écroula et, tout compte fait, Campo-Formio fut un fiasco. Et ainsi de suite; nous tentons de montrer, dans ce livre, que Napoléon a été un bien mauvais homme de guerre, et qu’on peut lui appliquer, en la renversant, la phrase de de Gaulle sur la défaite de la France, en 1940 : Napoléon a gagné (ou, plus précisément, ses généraux ont gagné) beaucoup de batailles, mais il a perdu toutes ses guerres : la campagne d’Egypte, la guerre d’Espagne, la campagne de Russie et la catastrophique campagne de France. (p.14) Les napoléophiles brandissent alors un autre étendard: celui du législateur, qui a doté la France, entre autres choses, d’un merveilleux Code civil, et celui de l’administrateur civil, créateur des préfets et du Conseil d’État. C’est encore faux: il est vrai que le Code civil des Français est une grande chose… mais Napoléon n’y est à peu près pour rien, comme nous le montrons dans cet ouvrage: il n’a fait qu’organiser sa promulgation ; quant à la réforme administrative sous le Consulat, elle a plus été l’œuvre de Sieyès ou de Daunou que de Bonaparte, qui s’est contenté d’en fixer le caractère centralisateur.
(p.14) Dans la troisième partie, nous analysons les méthodes de ce dictateur que l’Europe appellera « l’Ogre »: la falsification politique, la censure, la propagande et le culte de la personnalité, la police secrète, la coercition, la guerre; nous tentons aussi d’en finir avec les mythes du grand législateur, du grand capitaine et de l’« enfant prodigue de la gloire » comme le surnomme un ancien préfet à Montpellier, J. Costa, dans une chanson en forme d’hymne, assez naïve (pour ne pas dire plus), intitulée non pas la Marseillaise, mais l’Ajaccienne (!) et qui est dans le ton de Maréchal, nous voilà. Avec cependant une différence: dans l’hymne qui lui fut destiné, le vieux maréchal n’était que le « sauveur de la France », dans /’Ajaccienne, l’homme à la mèche et au petit chapeau est dépeint comme un nouveau Jésus-Christ. Ce fut ici [à Ajaccio], nouvelle Rome Que le jour de l’Assomption Une autre fois Dieu se fit homme, Napoléon ! Napoléon ! Pendant dix-huit ans, ce Dieu fait homme supprima toutes les libertés publiques, censura, emprisonna, massacra, fusilla, tortura, vola, fit la guerre à tous les peuples d’Europe, rétablit l’esclavage aux Antilles, énonça des lois racistes (antijuives) : dans la petite armée des dictateurs français, il a droit à un grade bien supérieur à celui de Pétain, et dans celle des dictateurs européens, à compter le nombre de nions que leurs dictatures ont causées, il vient au troisième rang juste après Hitler, avec l’horreur des camps en moins, et après Staline qui, lui, a laissé après sa mort une URSS plus puissante que jamais.
(p.172) LA TRAHISON ?
Trahison. C’est un mot qui peut sembler dur à nos lecteurs, mais comment désigner autrement la conduite d’un homme, qui a toujours protesté de sa fidélité à l’égard d’un autre homme et qui, un beau jour, parce qu’il n’est plus en accord avec lui, au lieu de rompre ouvertement, le dénonce comme un criminel au plus sévère des tribunaux, celui de la Convention ? C’est un peu ce qui s’est produit entre Paoli et Napoléon. La conduite du premier n’a jamais varié : il avait voué sa vie à sa patrie (p.173) corse, il a préféré l’exil à ce qu’il considérait comme la servitude, et il est revenu dans son pays parce qu’il pensait que son nouveau maître – la France de la Révolution – le lui confierait pour qu’y règne, sous sa protection, et dans le respect de la culture corse, la liberté, l’égalité et la fraternité. Dès le 21 juillet 1789, dans une lettre à l’un de ses partisans (l’abbé Andréi, qui sera son secrétaire à Corté), il reprenait sa doctrine passée, que Choiseul avait repoussée : celle d’une Corse autonome, régie par ses propres lois, sous la protection de la France. À la fin de l’année 1789, il avait applaudi au décret de la Constituante proclamant la Corse partie intégrante de l’Empire français : il songeait alors à une sorte d’union fédérale de la Corse à la France, dans laquelle l’île bénéficierait des lois générales en vigueur dans les autres provinces françaises mais en tenant compte « des anciens usages et des modes de vie ». Maintenant, la France de la Convention voulait – pensait-il et écrivait-il – imposer à la Corse une autre tyrannie, non pas celle du bras toujours levé du prince, comme à l’époque de la monarchie, mais celle d’une idéologie et d’une culture unitaire qui n’étaient pas les siennes : il refusait d’avoir à s’y soumettre. Paoli a donc changé d’avis, entre juillet 1789 et décembre 1792, mais non pas comme une girouette : parce que la Révolution elle-même avait changé en devenant jacobine. La conduite du second a été celle d’un spécialiste du double jeu. Bonaparte, qui avait des amis dans les deux camps, qui, après avoir proclamé son patriotisme corse dans ses propos et dans ses écrits (dans la lettre à Buttafuoco, par exemple), agissait maintenant comme le plus sévère des jacobins anti-Corsés et, comble de l’ignominie, il dénonçait Paoli aux plus hautes autorités de l’armée (au général Anselme, au ministre de la Guerre) et aux conventionnels, en leur demandant d’envoyer des députés «pour que l’on punisse les lâches et les traîtres ».
La dénonciation de Napoléon est du 2 mars 1793. Depuis deux mois, la Convention est entrée dans la phase sanglante de son histoire : le roi a été décapité le 21 janvier, la Vendée va s’embraser le 3 mars, le Tribunal révolutionnaire sera créé le 10 mars, avec Fou-quier-Tinville comme accusateur public (il a pour fonction de juger les attentats » contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivibilité de la République »), et, bientôt, la guillotine va couper bien des têtes. Quel va être le sort de Paoli, accusé de comploter contre l’unité et (p.174) l’indivisibilité de la République ? Certes, la Convention n’a pas attendu que Bonaparte dénonce le Babbu pour envoyer des commissaires aux armées en mission à Corté. Dès le 1er février 1793, elle a placé Paoli et les troupes de ligne stationnées en Corse sous les ordres du général de Biron (le duc de Lauzun), commandant l’armée d’Italie (qui vient d’être créée, à la fin de l’année 1792). Le même jour, c’est-à-dire dix-sept jours avant que ne débute l’expédition de La Maddalena, la Convention a dépêché trois commissaires en Corse, pour y enquêter sur la situation (il s’agit de Saliceti, qui est corse, de l’artilleur Lacombe-Saint-Michel et de l’avocat Del-cher). Ces derniers ont écrit à Paoli, de Toulon, le 7 février, l’invitant à les rejoindre pour conférer avec eux de la « mise en défense » de la Corse. Paoli, en fin ancien insurgé qu’il était, a flairé le piège et n’a répondu aux commissaires que le 5 mars (après avoir pris connaissance de la protestation-dénonciation de Napoléon) : il n’est pas question qu’il s’éloigne de Corté, où il est en sécurité, et il refuse leur invitation, invoquant « son âge avancé et ses infirmités » qui » ne lui permettent pas un long déplacement ». Il ne reste plus aux représentants de la Convention qu’à faire le voyage jusqu’à Corté et à négocier avec Paoli ; il leur faut, en effet, éviter qu’aux soulèvements royalistes de Vendée et de Bretagne qui viennent d’éclater, s’ajoute une insurrection séparatiste en Corse, qui risquerait d’y attirer immanquablement les Anglais.
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.367) Notre intention n’est pas ici de conter l’aventure sanglante et lamentable dans laquelle Napoléon entraîna la France et le peuple français et que certains qualifient encore d’ « épopée impériale » ; (…).
(p.369) Le régime institué en 1802 par la Constitution de l’an X, à savoir le consulat à vie, avait deux traits caractéristiques : 1° c’était une monocratie (tous les pouvoirs étant concentrés entre les mains d’une seule personne, le Premier Consul) ; 2° c’était un régime totalitaire, dans la mesure où il interdisait toute opposition, personnelle ou organisée, et, à la limite, tout jugement individuel ou toute critique. Un tel régime ne peut durer qu’en se fondant sur l’action impitoyable d’une police puissante et tentaculaire, une censure rigoureuse et surtout une propagande systématique, qui dépersonnalise l’individu et le rend progressivement incapable de penser ou d’agir, sur le plan politique ou social, autrement que par référence aux normes et aux mythes distillés par cette propagande. Et c’est là (p.370) que le bât blesse l’âne, en l’occurrence Napoléon, du moins en 1800 : cette assistance policière est limitée numériquement, donc elle ne peut pas tout surveiller, et elle manque de moyens de communication et de stockage des informations. On frémit à la pensée de ce qu’auraient pu devenir l’Empire napoléonien, l’Empire soviétique ou le IIIe Reich si ces régimes avaient connu la civilisation électronique : heureusement pour l’Europe, Hitler n’avait à sa disposition que le télégraphe électrique et les ondes hertziennes, et Napoléon qu’une ou deux lignes de télégraphie optique et la rapidité de ses coursiers.
(p.372) À partir de 1804, toute une série de décrets vont créer des titres héréditaires, instituant ainsi une noblesse d’Empire, qui fit longtemps sourire, mais qui avait pour but non seulement de récompenser l’héroïsme des uns ou les services rendus à l’Empire par les autres, mais de cimenter le système : les « nobles » d’Empire et leurs descendants ne deviendraient-ils pas les plus fidèles défenseurs du trône des Bonaparte, tout comme les titulaires de la Légion d’honneur (créée en 1802) ? L’Empereur, Napoléon premier du nom, la Cour impériale et ses dignitaires, la noblesse d’Empire, telle fut la « distribution », le casting comme disent les anglomanes, de cette abominable tragi-comédie européenne que fut la brève histoire (1804-1815) du Premier Empire dont nous allons tenter, dans ce chapitre, de détruire les légendes les plus répandues, qui nous semblent être, toutes, des impostures, mis à part l’héroïsme et la bravoure des centaines de milliers d’hommes qui ont été abusés i par elles jusqu’à en mourir.
Ainsi donc, la France va retrouver, avec Napoléon, un régime monarchique d’un type spécial, celui d’un souverain qui n’a, en face de lui, aucun pouvoir à combattre. Il n’y a plus, comme au temps de la monarchie de droit divin dont Louis XVI avait été, alors, le dernier représentant, de parlements provinciaux, d’évêques, de traditions féodales, de corporations susceptibles de limiter l’omnipotence royale, et les traités signés avant la Révolution ne sont plus en vigueur. Napoléon peut tout dire, tout faire. Il n’a plus besoin de louvoyer, comme au temps du Directoire, et il ne craint plus personne, protégé qu’il est de près par sa garde, de loin par sa police secrète, ancêtre de la sinistre Gestapo1.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.23) La France ne sera jamais pour lui autre chose qu’un champ d’exploitation. Le seul souci du capitaine Bonaparte, en juin 1793, est de se procurer des ressources, et il a son thème : il se pose en victime ; montagnard (de fraîche date ; mais Salicetti est là pour masquer, en haut lieu, son tout récent passé de séparatiste corse), il a tout sacrifié à son idéal ; ses biens ont été confisqués par les réactionnaires paolistes, ces malfaiteurs, ces antipatriotes ; en conséquence, martyr de sa foi, il a droit, et sa famille a droit comme lui, à une indemnisation substantielle.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.28-29) Napoléon se vantera, bien entendu, d’avoir lui-même et lui seul, tout conduit, devant Toulon, et le Larousse disait encore, jadis, avec une simplicité confiante : « En 1793, Bonaparte reprit Toulon ». Qu’il ait contribué efficacement à la victoire, je le pense ; il avait du coup d’œil et de la décision. Qu’il ait tout fait, c’est une fable. Dans son rapport à la Convention, après la reprise de la ville (Moniteur du 28 décembre), Dugommier mentionnera son nom et lui décernera des éloges. Agréables, les compliments ; mais Napoléon Bonaparte entend être payé en monnaie plus solide. Deux nouveaux Représentants viennent d’arriver, les députés Barras et Fréron. Le jeune Lucien (Loutchiano, en famille), qui s’était replié à Saint-Maximin, est accouru lui aussi et se distingue dans les vengeances ; il signe « Brutus Bonaparte » et agit en qualité de secrétaire des Jacobins locaux ; il rédige une « adresse » à la Convention qu’il date « du champ de gloire », « marchant, dit-il, dans le sang des traîtres » : « ni l’âge, ni le sexe n’ont été épargnés ; ceux qui n’avaient été que blessés par le canon [car on a tiré au canon sur les prisonniers] ont été dépêchés . par le sabre et la baïonnette « Barras et Fréron réglaient vivement tout cela, assistés par le commandant Napoléon Bonaparte qui les suivait comme leur ombre ; « il ôtait son chapeau devant nous, relatera Barras, et le portait aussi bas que son bras pouvait descendre ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris
(p.152) Mollien avait articulé, lui aussi, l’exacte sentence: “Il a renversé le gouvernement populaire”; “il a assis (p.153) la bourgeoisie au pouvoir ». M. Bainville était encore plus explicite : « Il a fait cesser la lutte des classes « . D’où l’adjectif, sous sa plume : « bénie », oui, bénie, la superbe époque consulaire. Des guerres, sans doute, à l’extérieur; mais le bienfait suprême de la paix sociale; la tranquillité pour les « honnêtes gens ».
Louis-Philippe savait ce qu’il faisait lorsqu’il organisait, en grande pompe (1840) le «retour des cendres « , dans le temps même où il ceinturait Paris de ces forts dont les canons, dans sa pensée comme dans celle de M. Thiers, serviraient, le cas échéant, à la « dissuasion » de la plèbe.
Quant aux menus détails que j’ai jugé bon de rapporter sur M. Bonaparte lui-même, sa personne et son « âme », si ce n’est pas très beau, ce n’est pas à moi qu’il faut s’en prendre ; « c’est la vérité qui est coupable », disait déjà Robespierre. Mais quand elle déplaît à certains, elle perd pour eux le droit d’exister.
|
|
0.2 un être dépravé, méprisant la femme sexualité: bisexualité, pédophilie, maladies vénériennes |

|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.90) Yet he knew very well how to please. ‘I would kiss a man’s arse if I needed him’, he once remarked. When an erring minister offered him his head he asked ‘Just what do you expect me to do with it?’ Many years later Metternich, of all people, would recall that ‘conversation with him has always had formed a charm difficult to define.’
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.91) His attitude to women would hardly appeal to a modem feminist. Perhaps it was this which antagonized Mme de Rémusat as it had Mme de Staël. She claims with all too much justification that he despised them, ‘regarding their weakness as an unanswerable proof of their inferiority and the power they have in society as an intolérable usurpation’. She blames such an attitude on his spending too much time with adventuresses during the Directory and on the Italian campaign. ‘He took no notice of a woman unless she was beautiful or at any rate young. He would quite probably have been ready to accept the view that in a well-run country we should be slaughtered when we hâve borne our children – just as some insects are destined by nature to a speedy death as soon as they give birth.’ She concédés that he felt genuine affection for Joséphine, and may have been in love two or three times, recording his irritation at Josephine’s jealousy and how he told her she must put up with it – ‘You ought to think it perfectly natural that I allow myself amusements of this kind.’ Admittedly such ‘amusements’ were purely physical, scarcely very romantic. On one occasion he greeted a terrified actress, clutching at the rags of her dignity, with ‘Corne in. Undress. Lie down.’
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.112) If we have little information about the Führer’s sex-Iife, we possess a good deal about his views on women. They are far more complex than might be thought, even though he said, ‘A man has to be able to stamp his imprint on any woman.’ Like Napoleon, he regarded them as an inferior species whose job was to bear children, be good mothers and make homes for men. (Kinder, Kirche, Küche was one of the Nazi slogans.) In his opinion there was ‘no worse disaster than to see them grappling with ideas’. ‘Women who have no children finally go off their heads.’ On the other hand, unlike the Emperor, his personal relationships with them were based on more than physical gratification. ‘What I like best is to dine with a pretty woman,’ he told Bormann. Beyond question he admired feminine beauty and enjoyed féminine company. He also differed from Napoleon – who was frequently rude and even coarse – in being unfailingly charming and gallant with women, including his female staff. When he explained condescendingly that ‘Woman’s universe . . . is man’ he added, ‘She sees nothing else, so to speak, and that’s why she’s capable of loving so deeply.’ He (p.113) accepted the possibility of partnership between the sexes. ‘Marriages that originate only in sensual infatuation are usually somewhat shaky. . . . Separations are particularly painful when there has been a genuine comradeship between man and wife … a meeting between two beings who complete one another, who are made for one another, borders already, in my conception, upon a miracle.’ His interpretation of much of feminine behaviour was characteristically cynical. ‘In the pleasure a woman takes in rig- ging herself out, there is always an admixture of some trouble- making element, something treacherous – to awaken another woman’s jealousy by displaying something that the latter doesn’t possess. Women have the talent, which is unknown to us males, for giving a kiss to a woman-friend and at the same time piercing her heart with a well-sharpened stiletto.’ He justified female pos- sessiveness by his own brutal criteria. ‘The gentlest woman is transformed into a wild beast when another woman tries to take away her man . .. Must one regard this innate savagery as a fault? Is it not rather a virtue?’
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969CH VII L’EPOPEE TOURNE MAL
(p.117) Et rien n’est instructif comme les Cahiers de Bertrand, déposition naïve, irremplaçable; nous ignorerions, sans elle, cette confession joviale de Napoléon sur une de ses constantes méthodes : « Quand j’ai besoin de quelqu’un, je lui baiserais le [censuré] »; il nous manquerait aussi une indication (d’intérêt, il est vrai, secondaire) sur les penchants sexuels de « l’empereur » et leur ambivalence: Gourgaud le fatiguait, sa tendresse étant insatiable. Sur l’éIévation morale du clan Bonaparte, sur le ton de la tribu quand on y était entre soi, et sur son odeur (Talleyrand-le-délicat déplorait les «manières » un peu « sombres » de ces gens), goûtons les propos échangés entre «Nabou » et Loutchiano au sujet de leurs femmes : “Ta putain ! », lui dit Nabou, et l’autre de riposter : “La mienne au moins, elle ne pue pas! ». Telle était, sous leurs habits de cour, la nudité de ces truands. Une des choses les plus drôles concernant Napoléon vu par ses historiographes, c’est le thème, établi comme un dogme, de son indifférence à l’argent. Voyez Bainville (Napoléon, p. 495) : il « tient peu à l’existence, et peu à son trône ; à l’argent, pas du tout » ; et M. Maurois (Historia, juin 1964) : «Jamais homme ne disposa de plus grandes richesses et ne s’en appropria moins.«
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris
(p.140) Le cortège comprend quinze voitures . Bonaparte est dans une « dormeuse » , berline de luxe, avec un lit. Il n’est pas de mauvaise humeur, car il emporte plusieurs millions; et Hortense lui a remis, discrètement, une écharpe où elle a cousu tout un petit stock de diamants; il s’en est fait une ceinture qu’il dissimule sous sa redingote. Une incommodité, néanmoins: un nouvel accident vénérien, suite d’un divertissement mal choisi, ces jours-ci, à Fontainebleau.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.136) /1814 – vers l’île d’Elbe/ Napoléon, M. Bainville nous l’a fait savoir « tenait peu à l’existence ». Avis que pouvaient difficilement confirmer les commissaires alliés qui escortèrent, au mois d’avril 1814, jusqu’à la côte, l’ex-empereur en route vers l’île d’Elbe. Le cortège comprend quinze voitures ; Bonaparte est dans une « dormeuse », berline de luxe, avec un lit. Il n’est pas de mauvaise humeur, car il emporte plusieurs millions ; et Hortense lui a remis, discrètement, une écharpe où elle a cousu tout un petit stock de diamants ; il s’en est fait une ceinture qu’il dissimule sous sa redingote. Une incommodité, néanmoins : un nouvel accident vénérien, suite d’un divertissement mal choisi, ces jours-ci, à Fontainebleau.
|
|
Martin Bril, Napoleons laatste verovering, De Morgen 11/12/2004
De bevrijding van Egypte
Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee. (…) Napoleon kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maitresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een MAAGD VAN TWAALF (= une vierge de 12 ans, a 12-YEAR-OLD VIRGIN), hem aangeboden door de sultan van Caïro.
Martin Bril, /La dernière conquête de napoléon/, De Morgen, 11/12/2004
La libération de l’Egypte
Jusque tard dans le courant du 19e siècle parurent encore des catalogues mentionnant les richesses emportées d’Egypte par les Français. Le Louvre en possède toujours la plus grande partie. (…) Napoléon apprit que Joséphine la trompait. fait plus grave encore, ses lettres exprimant sa colère à ce sujet furent interceptées en mer par les Anglais et publiées dans un journal. En compensation, il prit une maîtresse, qui, déguisée en homme, était partie avec les troupes, après qu’il eut d’abord essayé /de faire l’amour/ avec une VIERGE DE DOUZE ANS, offerte par le sultan du Caire.
|
|
Paul Fleuriot de Langle, Journal du Général Bertrand (Grand Maréchal du Palais), Cahiers de Sainte-Hélène, Janvier 1821 – Mai 1821, éd. Sulliver, Paris, 1949 (p.32) Le fort est que l’Empereur a tout fait pour Bernadotte, parce qu’il aait épousé Désirée Clary qui avait été la première inclination de l’Empereur. Napoléon devait l’épouser quand il étaità Marseille, et quand elle était déjà sa belle-soeur. Elle se cacha un jour sous son lit ; elle était alors fort jeune. Bonaparte en avertit sa mère, m’a-t-il dit autrefois. Aujourd’hui il dit que c’est parce qu’il lui a pris le c… et le p… du c.., qu’il a fait Bernadotte maréchal, prince et roi.
|
|
Paul Fleuriot de Langle, Journal du Général Bertrand (Grand Maréchal du Palais), Cahiers de Sainte-Hélène, Janvier 1821 – Mai 1821, éd. Sulliver, Paris, 1949 (p.104) 9 avril — Antommarchi va à sept heures et demie chez l’Empereur qui se met en grande colère contre lui. « Il devrait être chez lui à six heures du matin : il passe tout son temps chez Mme Bertrand. » L’Empereur fait appeler le Grand Maréchal qui arrive à sept heures trois quarts. Il répète ce qu’il a dit. Il ajoute que le docteur n’est occupé que de ses catins. « Eh bien, qu’il passe tout son temps avec ses catins ; qu’il les foute par devant, par derrière, par la bouche et les oreilles. Mais débarrassez-moi de cet homme-là qui est bête, ignorant, fat, sans honneur. Je désire que vous fassiez appeler Arnott pour me soigner à l’avenir. Concertez-vous avec Montholon. Je ne veux plus d’Antommarchi. »
|
|
Paul Fleuriot de Langle, Journal du Général Bertrand (Grand Maréchal du Palais), Cahiers de Sainte-Hélène, Janvier 1821 – Mai 1821, éd. Sulliver, Paris, 1949
(p.223) Walewska (Marie comtesse) — Marie Leczinska, née à Varsovie en 1789, veuve en 1814 du comte Walewski, remariée à Paris en avril 1816 au général comte d’Ornano eut sa première entrevue avec Napoléon, à Bronie, le Ier janvier 1807. De sa liaison avec l’Empereur, elle eut un fils, Forian-Alexandre-Joseph, né à Walewice (Pologne) le 4 mai 1810 et qui est nommé dans le Testament de l’Empereur. Au retour de la campagne de Russie, Napoléon passant à Lowicz le 11 décembre 1812 aurait voulu se détourner de son chemin pour se rendre au château de Walewice, mais Caulaincourt l’en dissuada.
|

