
Napoléon en France: généralités; le Code Civil: mise au point; un état policier; une théorie des races, l’antisémitisme, des déportations, la conscription, l’armée
| 1.0 généralités |
| 1.1 le Code Civil |
| 1.2 un état policier |
| 1.3 une théorie des races |
| 1.4 le culte |
| 1.5 les Juifs |
| 1.6 les déportations: Tziganes, … |
| 1.7 la conscription |
| 1.8 l’armée |
1.0 Généralités sur Napoléon
| Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.418) Napoléon n’a pas été le général génial qui a fait de la campagne d’Italie un modèle qu’on a longtemps cité en exemple dans les écoles militaires : il a continué d’obéir à ses supérieurs, qui préparaient cette campagne depuis plus de deux ans, et qui le guidaient de Paris. Mais cette campagne l’a révélé et aux autorités en place – les Directeurs – et à lui-même. La France révolutionnaire était en guerre contre l’Europe des rois, et un bon général, suffisamment jeune pour ne pas se fatiguer trop tôt, suffisamment volontaire et méticuleux (car la moindre erreur pouvait coûter très cher à celui qui la commettait en cette époque troublée), pouvait y faire son chemin. Et il est vrai qu’il avait le talent pour le faire. Le talent, mais non pas le « génie ». (…)
Si la carrière de Bonaparte s’était arrêtée là, elle n’aurait été qu’un épisode sans intérêt et sans lendemain de l’histoire de la France. Mais le malheur a voulu que cet opportuniste, ce joueur, gagne sa partie de poker avec la France. Certes, il y a mis les formes, il n’a pas incendié son Reichstag comme le fit Hitler, il a chassé de Paris les députés par la peur, le 18 Brumaire, et de Saint-Cloud par la force des baïonnettes. Il avait raison, Mirabeau, ce 23 juin de l’année 1789, quand il lançait son apostrophe fameuse à Dreux-Brézé : il n’y avait plus de République en France.
(p.419) J’entends d’ici les napoléophiles protester. Oui, l’Empire et ses guerres ont mis la France à bas pour un demi-siècle et elle a perdu, au Congrès de Vienne, ses frontières naturelles, mais le Consulat a accompli, grâce à l’énergie et à l’intelligence du Premier Consul, une grande œuvre juridique, administrative et monétaire qui a offert aux régimes futurs (y compris notre régime actuel) de splendides outils de gouvernement : les préfets et la centralisation administrative, un merveilleux Code civil unifié (et le code criminel qui l’accompagne), une justice à deux degrés (les tribunaux de première instance et les tribunaux d’appel, qui deviendront, en 1804, les cours d’appel), le franc de Germinal, qui est resté intact jusqu’au 25 juin 1928, date à laquelle il fut remplacé par le franc Poincaré, les collèges et les lycées d’État et, plus tard, l’Université impériale. Ces jusqu’au-boutistes de la napoléophilie attribuent à César ce qui ne revient pas à César : – Le fondement de la centralisation administrative est la division de la France en départements (ainsi qu’en arrondissements, cantons et communes), régime qui a été institué par la Constitution de 1791. La Constitution de l’an VIII, instaurant le Consulat, n’a fait que le confirmer. – Le principe d’un administrateur unique, dans chaque département, relayant le pouvoir de l’État et dirigeant les administrations locales, a été affirmé et mis en œuvre par la Convention qui a envoyé dans chaque département des représentants en mission désignés par le Comité de salut public ; il avait été abandonné en 1795 par le Directoire, qui faisait administrer chaque département par un collège de cinq membres, élus et renouvelables par cinquième tous les ans (articles 174 et 177 de la Constitution de l’an III), surveillés par un commissaire représentant le gouvernement central (article 191 de la Constitution de l’an III). Le Consulat a simplement remplacé les commissaires par des préfets, avec des pouvoirs plus étendus, nommés par le chef de l’État, c’est-à-dire, en l’occurrence, par le Premier Consul : – le Conseil d’État est un corps consultatif, créé dans le cadre de la Constitution de l’an VIII, qui n’est autre que le Conseil du Roi de l’Ancien Régime ; (p.420) – le Code civil des Français n’est pas une création du Premier Consul ; il était prêt avant le coup d’État du 18 Brumaire, et il ne restait plus qu’à en préciser la teneur et à le mettre en forme. – Quant au soi-disant «franc de Germinal », ainsi appelé par référence à un décret de la Convention voté le 18 Germinal an III (7 avril 1795), c’est une imposture scandaleuse que d’en faire une création du Premier Consul, qui mérite qu’on en conte l’histoire.
(p.421) Ainsi donc le Premier Consul n’a innové en rien, et la France ne lui doit ni son administration, ni son Code, ni sa justice, ni sa monnaie ; en revanche, son autorité, fondée sur une police impitoyable, que créa et dirigea longtemps Fouché, a permis le rétablissement de l’ordre public et la restauration d’une certaine paix sociale. Mais au prix de l’introduction en France d’un régime policier sans précédent, annonciateur des régimes totalitaires et de l’Europe des dictateurs (voir l’Annexe n° 26, p. 504, sur la police napoléonienne). La seule action qu’on puisse porter véritablement au crédit du Premier Consul, c’est, sur le plan extérieur, d’avoir signé la paix de Lunéville avec l’Autriche (9 février 1801) et la paix d’Amiens avec l’Angleterre (25 mars 1802), et, sur le plan intérieur, d’avoir établi la paix religieuse en signant avec le pape Pie VII le Concordat du 15 juillet 1801. Malheureusement, il n’a pas tardé à gâcher cette œuvre de paix en rompant la paix d’Amiens, et en entreprenant une œuvre de conquête unique dans l’histoire de l’Europe où ) aucun monarque n’avait jamais, avant lui, tenté d’imposer sa loi à » tout le continent, de Gibraltar à Moscou. Le seul chef d’État qui se lancera dans une telle aventure, ce sera Hitler, qui ira beaucoup plus loin que Napoléon dans le sens du despotisme, du policiérisme et du piétinement des droits de l’homme, avec le racisme et l’horreur des camps de concentration et des camps d’extermination en plus. Mais l’homme qui a rétabli j l’esclavage aux Antilles, qui a, qu’on le veuille ou non, pris la res- ! ponsabilité du génocide haïtien, qui a couvert les exactions du général Morand, envoyé en Corse, en 1803, pour y réprimer le nationalisme insulaire, qui a pris contre les « Juifs de France » les « décrets infâmes » du 17 mars 1808, du 16 juin 1808, du 22 juillet 1808 et du (p.422) 19 octobre 1808 (décrets discriminatoires, interdisant aux Juifs d’établir leur domicile dans certains départements, d’exercer certaines professions, limitant certains de leurs droits ; décret instituant un consistoire central et des consistoires départementaux ; etc. ; voir l’Annexe n° 25, p. 498), n’était indiscutablement pas sur la noble voie tracée par l’Assemblée nationale constituante qui avait accordé la citoyenneté française aux Juifs le 27 septembre 1791.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.9) Paoli, en 1769, subit une lourde défaite, et doit s’expatrier. Carlo Buonaparté, aussitôt, change de camp, passe du côté des vainqueurs, collabore avec eux, et ferme en souriant les yeux sur la liaison affichée de sa très jeune femme, Letizia, avec le gouverneur français Marbeuf — un homme de plaisir que Paoli traitait de « pacha luxurieux ». Il est vrai que Paoli manquait, paraît-il, de moyens. Napoléon racontera lui-même, gaillard, que sa mère (cette « femme de Plutarque », selon M. Louis Madelin) riait beaucoup de Paoli, dans sa jeunesse ; galant, certes, Paoli, disait-elle, mais incapable.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.11) A seize ans, Buonaparté (qui cache son prénom inusuel ; ses camarades de Brienne ont été grossiers à ce sujet, traduisant son « Napoléoné » en « La-paille-au-nez » ; il signe donc « C [pour Carlo, sans doute] de Buonaparté ») est nommé sous- lieutenant au régiment dit « de la Fère », dont une partie tient garnison à Valence. « Dans cette armée de l’ancien régime, énonce avec majesté M. Jacques Bainville, tout était sérieux ». J’en veux pour preuve, en effet, que, sous Louis XVI, la moitié — je dis bien : la moitié — du budget de la guerre était absorbée par la solde des officiers. Quant aux sous- lieutenants de seize ans, je doute un peu de l’ascendant que pouvaient exercer sur la troupe, en dépit de leur particule et de la morgue requise, ces garni- nets à épaulettes, et surtout le Carlo-Napoléoné, de taille brève ( lm 64) et court de pattes. Mais l’usage, chez ces jeunes gens (on le constate en examinant la carrière militaire d’un sous-lieu tenant du même âge, François René de Chateaubriand), l’usage de ces messieurs était de multiplier les absences. L’officier Buonaparté sera pratiquement un étemel permissionnaire.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.13) /Car seule la Corse l’intéresse et ce qu’il y manigance depuis des années. Le danger de la Patrie est le moindre de ses soucis, pour la bonne raison que, pour cet officier français, la France — qui l’entretient et le paie — est si peu sa « patrie » qu’il la déteste, qu’il la hait et qu’il travaille en secret contre elle, afin de réussir, en Corse, une opération toute privée./ Aurais-je risqué un mot excessif ? (Ma manie, bien connue, du « pamphlet »). Haine de la France ? Eh bien, lisons. C’est de l’officier en garnison à Auxonne : « Féroces et lâches, les Français joignent […] aux vices des Germains ceux des Gaulois » ; ils constituent « le peuple le plus hideux qui ait jamais existé ». Antérieurement, à Goubico, greffier des Etats de Corse : « Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime ? Continuerons- nous à voir tous les emplois que la nature nous destinait occupés par des étrangers ?» — et des gens, ajoutait-il, très aristocrate, dont, pour la plupart, « la naissance est abjecte ». A son oncle Fesch, le futur cardinal : « Les Français ! Avons-nous assez souffert de leurs vexations ? […] Qu’ils redescendent au mépris qu’ils méritent ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.20) Et voici la dernière pensée de Napoléon sur la Corse ; nous la trouvons dans les Cahiers du général Bertrand, le fidélissime, sous la date du 24 février 1821 : « La Corse est un inconvénient pour la France ; c’est une loupe quelle a sur le nez […] Choiseul disait que si, d’un coup de trident, on pouvait la mettre sous la mer, il faudrait le faire. Il avait raison *.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.23) La France ne sera jamais pour lui autre chose qu’un champ d’exploitation. Le seul souci du capitaine Bonaparte, en juin 1793, est de se procurer des ressources, et il a son thème : il se pose en victime ; montagnard (de fraîche date ; mais Salicetti est là pour masquer, en haut lieu, son tout récent passé de séparatiste corse), il a tout sacrifié à son idéal ; ses biens ont été confisqués par les réactionnaires paolistes, ces malfaiteurs, ces antipatriotes ; en conséquence, martyr de sa foi, il a droit, et sa famille a droit comme lui, à une indemnisation substantielle.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.28-29) Napoléon se vantera, bien entendu, d’avoir lui- même et lui seul, tout conduit, devant Toulon, et le Larousse disait encore, jadis, avec une simplicité confiante : « En 1793, Bonaparte reprit Toulon ». Qu’il ait contribué efficacement à la victoire, je le pense ; il avait du coup d’œil et de la décision. Qu’il ait tout fait, c’est une fable. Dans son rapport à la Convention, après la reprise de la ville (Moniteur du 28 décembre), Dugommier mentionnera son nom et lui décernera des éloges. Agréables, les compliments ; mais Napoléon Bonaparte entend être payé en monnaie plus solide. Deux nouveaux Représentants viennent d’arriver, les députés Barras et Fréron. Le jeune Lucien (Loutchiano, en famille), qui s’était replié à Saint-Maximin, est accouru lui aussi et se distingue dans les vengeances ; il signe « Brutus Bonaparte » et agit en qualité de secrétaire des Jacobins locaux ; il rédige une « adresse » à la Convention qu’il date « du champ de gloire », « marchant, dit-il, dans le sang des traîtres » : « ni l’âge, ni le sexe n’ont été épargnés ; ceux qui n’avaient été que blessés par le canon [car on a tiré au canon sur les prisonniers] ont été dépêchés . par le sabre et la baïonnette « Barras et Fréron réglaient vivement tout cela, assistés par le commandant Napoléon Bonaparte qui les suivait comme leur ombre ; « il ôtait son chapeau devant nous, relatera Barras, et le portait aussi bas que son bras pouvait descendre ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.31) Sous le patronage de Salicetti, Bonaparte va se faire inscrire à la loge maçonnique de Marseille ; appartenance qui peut servir.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.104) Il aura un jour (le 11 février 1809), devant Roederer, une formule qu’il savoure, tant elle lui paraît adéquate : « La France ? Je couche avec elle ; et elle me prodigue son sang et ses trésors1 » ; autrement dit : Elle fait ce que je veux, et elle paie.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.111) /1809/ Il continue à ne pas savoir très bien le français, confondant « session » avec « section » et « amnistie » avec « armistice ». Chateaubriand observera qu’on ne saurait parler sans prudence de son style, car il dicte, la plupart du temps, et prodigieusement vite, laissant le soin à ses secrétaires de mettre en forme ce qu’il débite ; quant à ses fameux bulletins de guerre, ils sont rédigés par des scribes ; (…).
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.146) Des particuliers qui n’ont pas à se plaindre, ce sont les membres de la tribu née de Carlo et de Letizia. La France a vu sa jeunesse fauchée, et les cadavres de ses enfants en pyramides monstrueuses : elle est amputée maintenant de la Sarre et de la Savoie ; elle a 700 000 millions d’indemnité à verser aux envahisseurs qui l’occuperont pendant trois ans. Mais « Nabou » a tout de même joliment bien réussi pour son clan. La Mamma a un palais à Rome, et tous et toutes sont grassement pourvus. La France a payé très cher leur raid, chez elle, de vingt ans et leur pluie de sauterelles, mais quand ils évoquent leur taudis d’autrefois, rue de la Mauvaise Herbe, à Ajaccio, ils ont de quoi jubiler et se frotter les mains. Ils sont « les Bonaparte », . une « grande famille », une très grande famille désormais.
|
|
Christian Bazin (7506 Paris), Sa gloire a coûté cher à la France, Le Figaro 11/12/2003
La gloire de Napoléon a coûté trop cher, beaucoup trop cher à la France pour que l’on pense à garder son sang-froid. La responsabilité des années 1789 à 1815, dont celles du Consulat et de l’Empire, dans le déclin de la France à partir du XIXe siècle est certaine. Première puissance européenne, voire mondiale, au XVIIIe siècle, la France passe derrière l’Angleterre, première puissance du XIXe siècle. Elle paie ce recul par 2 millions de morts des guerres de la Révolution et surtout de l’Empire, sur une population de 27 millions, proportion beaucoup plus forte que la saignée de 14/18. Elle le paie par sa stagnation économique, individuelle et financière en face de la croissance rapide de sa rivale. Pourquoi célébrer tant de victoires fameuses dans toute l’Europe quand, hélas, Trafalgar et Waterloo en annulent le résultat . |
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.405) Les bulletins de la Grande Armée qui chantent les ‘ triomphes de l’Aigle indomptable sont lus dans les écoles, sur les scènes et dans les prêches, avec cette obsession du bourrage de crâne qu’on ne retrouvera à ce niveau que dans les régimes les plus sinistres du XXe siècle.
L’ogre et les grognards Tout de même !, s’exclamera-t-on. Et la gloire, les victoires, toute cette épopée qui fit tant rêver les générations qui suivirent ? Et la grandeur de la France, rendue à son sommet ? Vraiment ? Le premier revers de cette belle médaille qui vient à l’esprit est évidemment son coût humain. Un million de morts français selon la plupart des estimations, trois millions de victimes au total, cela fait cher payé le défilé sous l’Arc de Triomphe. On dira que la critique n’est pas neuve. C’est exact. Elle apparaît dès la restauration sur le trône des Bourbons, pour saper le souvenir de celui que la propagande royaliste nomme le « boucher ». Dès la fin de son règne, dans les campagnes, en murmurant, on l’appelait l’« ogre », parce que ses besoins en hommes étaient tels qu’il faisait enlever les enfants de plus en plus jeunes. Nombreux sont ceux qui refusèrent d’ailleurs de s’enrôler. Vers la fin du régime, on comptait plus de 100 000 réfractaires cachés dans les forêts et les montagnes pour échapper à ce qui ressemblait à un voyage vers l’abattoir. On , reste à s’interroger sur les motivations des centaines de milliers d’autres qui y sont allés. La légende napoléonienne a essayé de (p.406) forger le souvenir des « grognards », ces râleurs invétérés mais toujours tellement valeureux, prêts à mourir pour leur empereur. Sans doute y en avait-il. Et combien d’autres, pauvres gosses emmenés de force, à qui on a fait parcourir l’Europe à la marche, les pieds saignant dans de mauvaises chaussures, écrasés par un barda, pour finir fauchés par une fusillade dans ces batailles terribles qui laissaient, au soir, 20 000 ou 25 000 cadavres sur un champ d’herbe, sans autre dernier hommage que la visite des détrousseurs. Morts pour quoi, morts pour qui ? C Et après ? diront les cocardiers, finissons-en avec cette vieille chanson de pacifistes d’arrière-garde chantée cent fois ! L’Empereur a quand même fait beaucoup pour la France. Ce point-ci est important, tant il passe pour une évidence. C’est en effet une évidence, mais elle joue à l’inverse : si l’on s’en tient à un seul point de vue patriotique, le bilan de l’Empire est clair, c’est un désastre. Napoléon a beaucoup gagné, c’est vrai, mais il n’a su consolider aucune conquête et a tant perdu au final qu’il laisse la France beaucoup plus petite qu’il ne l’a trouvée. Le Directoire, en partie grâce à lui d’ailleurs, avait agrandi considérablement le territoire et constitué autour de la République une ceinture de « républiques soeurs » qui la protégeaient. Quinze ans plus tard, les conquêtes sont parties en fumée. Nice et la Savoie sont perdues, elles ne redeviendront françaises qu’en 1860. Le Rhin, pour les révolutionnaires, faisait partie des « frontières naturelles » de la France, exactement comme le sont toujours pour nous les Pyrénées ou l’Atlantique. La France ne reprendra jamais pied sur sa rive gauche. Enfin, tout à ses chimères de domination de l’Europe, dans le vague espoir de s’attirer le soutien des Américains contre l’ennemi anglais, Bonaparte a commis ce qui peut sembler une erreur incroyable : il a vendu aux Etats-Unis, et pour une bouchée de pain, l’immense Louisiane – environ le quart du territoire américain actuel. Nous parlions du rayonnement de notre pays. Imagine-t-on sa puissance si cette gigantesque province était restée pendant quelques décennies encore notre cousine ?
(p.408) Tchaïkovski écrit son « Ouverture 1812 » pour chanter la gloire de la patrie qui a su résister aux barbares venus de l’ouest. Surtout, et c’est beaucoup plus grave, dans beaucoup d’endroits la haine des Français conduira à la haine des principes qu’ils prétendaient défendre. Voilà bien le reproche le plus lourd que l’on peut faire à l’Empereur : en croyant habile de déguiser ses conquêtes sous le noble masque des idéaux révolutionnaires, il a contribué à les dévaloriser aux yeux de ceux qu’il soumettait. Dans tout le monde allemand, nous explique Joseph Rovan dans son Histoire de l’Allemagne, « la démocratie ou le parlementarisme sont repoussés comme appartenant au monde de l’ennemi ». Par réaction, le nationalisme, que les premiers grands philosophes comme Fichte développent à l’université de Berlin à cette époque, est construit sur d’autres mystiques : l’exaltation du passé germanique, du peuple éternel, le Volk. Bien plus tard, on fera reproche à l’Allemagne de la mauvaise tournure que peut prendre un tel idéal national. Il est juste de ne pas oublier ce qu’il doit à un empereur français.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris.
CH V UN REGIME TONIFIANT
(p.77) COMMENÇAIENT POUR LA FRANCE « quinze ans de régime tonifiant » ; c’est ce que m’enseignait, vers 1920, quand je me préparais au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure, ce M. Madelin que nous devions tenir pour le Docteur suprême, quelqu’un d’équivalent, en Histoire, à ce qu’est saint Thomas en théologie. Le régime que M. Madelin qualifiait ainsi, d’un ton de gourmandise, sans doute n’est-il pas superflu de le regarder d’un peu plus près. Benjamin Constant, un expert, enseignait que la politique est « l’art » , avant tout, « de présenter les choses sous la forme la plus propre à les faire accepter ». (p.78) Autrement dit, le choix du vocabulaire est capital et le meilleur politicien est celui qui se montre capable de faire applaudir par la foule un système où les mots recouvriront le contraire, exactement, de ce qu’ils annoncent. Les Constituants s’étaient montrés très forts à ce jeu-là, avec leur Déclaration des Droits de l’Homme proclamant que tous les individus “naissent et demeurent libres et égaux en droits », déclaration suivie des dispositions pratiques dont nous avons rappelé l’essentiel: silence aux pauvres; pour eux, pas de bulletins de vote (et voilà pour l’égalité); maintien de l’esclavage dans les colonies et de la traite des noirs; interdiction aux travailleurs de s’unir contre l’arbitraire patronal, en matière de salaire (et voilà pour la liberté). Bonaparte est loin, très loin, d’être un imbécile.
(p.86) La Banque en formation, Bonaparte a consenti – consenti n’est pas le mot juste, car Bonaparte était là pour ça; il remplissait le contrat qui lui avait valu son ascension; disons donc plutôt qu’il l’a autorisée – à l’intituler « Banque de France” (ce qui faisait très “national ») afin de donner le change à l’opinion et de faire croire aux Français que cet établissement de finance était leur Banque à eux, la Banque au service de la France. Or il s’agissait d’une maison privée, pareille aux autres, mais dotée, par sa grâce, d’une enseigne frauduleuse; il s’agissait d’une association d’affairistes qui, sous la banderole dont l’ornait un gouvernement suscité en secret par eux-mêmes, allaient pouvoir se procurer ainsi des bénéfices sans précédent.
|
|
Roger Caratini, Napoléon, une imposture, éd. L’Archipel, 2002
La première dictature militaire des temps modernes, la liberté bafouée par une police secrète d’État, la censure de la presse, le rétablissement de l’esclavage aux Antilles, les «décrets infâmes» contre les juifs, la mort de près de deux millions de soldats français, le mensonge du Code civil… Que reste-t-il donc au vaincu d’Arcole dont le plongeon dans F Adige a été transformé en exploit ? Ses victoires, il les dut à ses généraux, mais ses services de propagande lui en attribuèrent la gloire. Toute sa vie, en réalité, ne fut qu’imposture : depuis la comédie du patriote corse – il était génois -jusqu’à ses derniers moments – ses Mémoires, qu’il dicta à Las Cases, sont le tombeau le plus fallacieux qui se puisse concevoir… Et pourtant, alors que son seul nom inspira en son temps l’indignation de toute l’Europe, Napoléon fait encore aujourd’hui l’objet d’un culte déraisonnable dans sa patrie d’adoption. Pourquoi ? C’est tout l’objet de cette étude, dans laquelle Roger Caratini démonte, pièce par pièce, la plus monumentale construction «mythologique» de l’Histoire de France. Né en 1924, philosophe de formation, auteur unique de l’Encyclopédie Bordas (23 volumes parus de 1967 à 1987), Roger Caratini est l’auteur de biographies d’Alexandre le Grand, Attila (Hachette Littératures), Jeanne d’Arc, Jésus, Mahomet (L’Archipel). On lui doit de nombreux essais historiques, dont Les Baïonnettes du 18-Brumaire (L’Archipel, 1999). |
|
Roger Caratini, Paoli, Napoléon, une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.439) annexe n° 4 Lettre à Paoli
Voici, en continu, la fameuse lettre écrite à Paoli par Napoléon, que nous avons commentée paragraphe par paragraphe, p. 123 sq. « Auxonne en Bourgogne, 12 juin 1789 Général, Je naquis quand la patrie périssait. Trente mille Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la Liberté dans des flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Les cris des mourants, les gémissements de l’opprimé, les larmes du désespoir environnèrent mon berceau dès mon enfance. Vous quittâtes notre île et, avec vous, disparut l’espérance du bonheur ; l’esclavage fut le prix de notre soumission : accablés sous la triple chaîne du soldat, du légiste et du percepteur d’impôts, nos compatriotes vivent méprisés… méprisés par ceux qui ont la force de l’administration en main. N’est-ce pas la plus cruelle torture que puisse éprouver celui qui a du sentiment? L’infortuné Péruvien périssant sous le fer de l’avide Espagnol éprouvait-il une vexation plus ulcérante ? Les traîtres à la Patrie, les âmes viles que corrompit l’amour d’un gain sordide, ont, pour se justifier, semé des calomnies contre le Gouvernement national [le gouvernement nationaliste institué par Paoli à Corté] et contre votre personne en particulier. Les écrivains, en les adoptant comme des vérités, les transmettent à la postérité.
En les lisant, mon ardeur s’est échauffée et j’ai résolu de dissiper ces brouillards, enfants de l’ignorance. Une étude commencée de bonne heure de la langue française, de longues observations et des mémoires puisés dans les portefeuilles des patriotes m’ont mis à même d’espérer quelques succès. […] Je veux comparer votre (p.440) administration [la manière dont Paoli a gouverné la Corse} avec l’administration actuelle… je veux, au tribunal de l’opinion publique, appeler ceux qui gouvernent, détailler leurs vexations, découvrir leurs sourdes menées et, s’il est possible, intéresser le vertueux ministre qui gouverne l’État [il s’agit de Necker\\ au sort déplorable qui nous afflige si cruellement. Jeune encore, mon entreprise peut être téméraire, mais l’amour de la vérité, de la patrie [lapatrie corse, évidemment: Bonaparte renie la patrie française], de mes compatriotes, cet enthousiasme que m’inspire toujours la perspective d’une amélioration dans notre état, me soutiendront. Si vous daignez, général, approuver un ouvrage où il sera si fort question de vous ; si vous daignez encourager les efforts d’un jeune homme que vous vîtes naître et dont les parents furent toujours attachés au bon parti, j’oserai augurer favorablement du succès. J’espérai quelque temps pouvoir aller à Londres [où résidait Paoli depuis 1769] vous exprimer les sentiments que vous m’avez fait naître et causer ensemble des malheurs de la Patrie, mais l’éloignement y met obstacle : viendra peut-être un jour où je me trouverai à même de le franchir. Quel que soit le succès de mon ouvrage, je sens qu’il soulèvera contre moi la nombreuse cohorte d’employés français qui gouvernent notre île et que j’attaque : mais qu’importé s’il y va de l’intérêt de la Patrie ! J’entendrai gronder le méchant et, si ce tonnerre tombe, je descendrai dans ma conscience, je me souviendrai de la légitimité de mes motifs, et, dès ce moment, je le braverai. Permettez-moi, général, de vous offrir les hommages de ma famille… Eh ! pourquoi ne le dirai-je pas… de mes compatriotes. Ils soupirent au souvenir d’un temps où ils espérèrent la liberté. Ma mère, Mme Letizia, m’a chargé de vous renouveler le souvenir des années écoulées à Corté. Je finis avec respect, général, votre très humble et très obéissant serviteur. napoléon buonaparte. » Paoli reçut cette lettre à Londres, où il vivait, et il ne prit pas la peine d’y répondre. Il suivait attentivement les événements de France, où l’assemblée des États généraux du royaume s’était autoproclamée Assemblée constituante le 17 juin 1789 et, en fin politique qu’il était, il voyait dans les difficultés de la monarchie française les signes avant-coureurs de ce qui pourrait être la libération de sa patrie corse. Toutefois, la lettre du jeune Bonaparte, « le fils de Carlo » comme il l’appellera plus tard, était trop flagorneuse pour être sincère, et il ne se risqua pas à servir de (p.441) protecteur à ce jeune ambitieux dans la République des lettres. Quand il rencontrera plus tard Napoléon, en octobre 1792, le courant ne passera pas entre le vieux nationaliste corse et le jeune officier français (voir chapitre VII).
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.105) Napoleon established a new nobility of princes, dukes, counts, barons and knights – not to mention chevaliers of the Legion of Honour. In 1810 all prefects were made counts or barons and told to assume coats-of-arms. ‘I act as a monarch in creating hereditary rank but in a Revolutionary spirit since my nobility is not exclusive.’ He was building ‘an intermediate caste . . . between himself and France’s vast democracy’ while he had to have a Court like every other European sovereign. Admittedly, ‘I created princes and dukes, gave them fortunes and estates, but because of their humble origins I could not make noblemen of them. So I tried as far as possible to marry them into the old families.’ On St Helena General Gourgaud noted resentfully, ‘His Majesty has a weakness for the [old] nobility.’
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.230) While the subject lands, whether occupied territory or client States, produced men and money, the System was inefficient at every level, despite the Emperor’s attempting to supervise it as much as possible, and devoting considerable attention not only to military but to fiscal and économie problems. In particular there was the difficulty of feeding wretchedly paid troops without a proper commissariat. (p.231) Outside France they had to Iive off the country, which meant that food and wine, grain and livestock, were commandeered without compensation, that thatch was torn from roofs to serve as fodder for horses who otherwise grazed in rye or wheat fields – if these had not been flattened by detachments marching or riding over them. There were no military police apart from inadéquate provost marshals, so that drunken, swaggering ruffians were able to rob and to râpe. The ordinary French police who accompanied them behaved as badly, both treating the population as they did Spaniards. (The traditional German dislike of the French dates not from Louis XIV’s devastation of the Palatinate but from the Napoleonic occupation.) There were swingeing levies, grinding taxation, appropriation of raw materials, foodstuffs and luxury goods, confiscation of property, theft of art treasures, and – in Austria and Prussia – extraction of huge indemnities. Another burden was military service. Few of the conscripted came home and those who did brought taies of dreadful suffering.
|
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
(p.558) COMBIEN SONT MORTS?
Trop de soldats de la Grande Armée ont disparu sans laisser de traces pour que le nombre de tués ou mortellement blessés sur les champs de bataille de l’Empire puisse être évalué autrement qu’avec une approximation assez grossière. On convient généralement que les guerres de la Révolution et de l’Empire ont coûté à la France 850 000 tués et 550 000 disparus.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.10) En 1768, Louis XV achète la Corse aux Génois, ce qui met en fureur la plupart des autochtones. On s’accommodait déjà fort mal de la domination génoise, pourtant relâchée ; (p.13) la domination française se révèle autrement lourde, et ces occupants ont un dialecte inintelligible. Résistance. Insurrection.
(p.17) Le danger de la Patrie est le moindre de ses soucis, pour la bonne raison que, pour cet officier français, la France – qui l’entretient et le paie – est si peu sa « patrie » qu’il la déteste, qu’il la hait et qu’il travaille en secret contre elle, afin de réussir, en Corse, une opération toute privée. Aurais-je risqué un mot excessif ? (Ma manie, bien connue, du « pamphlet »). Haine de la France? Eh bien, lisons. C’est de l’officier en garnison à Auxonne : « Féroces et lâches, les Français joignent […] aux vices des Germains ceux des Gaulois» ; ils constituent « le peuple le plus hideux qui ait jamais existé ». Antérieurement, à Goubico, greffier des Etats de Corse: « Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime ? Continuerons-nous à voir tous les emplois que la nature nous destinait occupés par des étrangers?» – et des gens, ajoutait-il, très aristocrate, dont, pour la plupart, « la naissance est abjecte ». A son oncle Fesch, le futur cardinal : « Les Français ! Avons-nous assez souffert de leurs vexations? […] Qu’ils redescendent au mépris qu’ils méritent ».
(p.18) “Les dispositions réelles du jeune Bonaparte à l’égard de la France sont celles du colonisé de fraîche date qui profite de l’oppresseur, qui s’est fait, pour vivre, et cachant son jeu, mercenaire à son service, mais ne songe qu’à tirer parti contre lui des avantages dont il lui est redevable.”
CH II ESCALADE EN FRANCE
(p.32) Napoléon se vantera. bien entendu, d’avoir lui-même et lui seul, tout conduit, devant Toulon, et le Larousse disait encore, jadis, avec une simplicité confiante : « En 1793, Bonaparte reprit Toulon ». Qu’il ait contribué efficacement à la victoire, je le pense; il avait du coup d’oeil et de la décision. Qu’il ait tout fait, c’est une fable.
(p.33) Le jeune Lucien (Loutchiano, en famille), qui s’était replié à Saint-Maximin, est accouru lui aussi et se distingue dans les vengeances; il signe « Brutus Bonaparte » et agit en qualité de secrétaire des Jacobins locaux ; il rédige une « adresse » à la Convention qu’il date « du champ de gloire », « marchant, dit-il, dans le sang des traîtres » : « ni l’âge, ni le sexe n’ont été épargnés ; ceux qui n’avaient été que blessés par le canon [car on a tiré au canon sur les prisonniers] ont été dépêchés par le sabre et la baïonnette ».
(p.38) La lettre à Moltedo était du 23 septembre. Le 21, un nouveau représentant, Turreau, avait été désigné pour les fonctions de commissaire auprès de l’armée d’Italie. Turreau vient de se marier et cette nomination lui permet d’offrir à sa jeune épouse (Félicité, 24 ans) un voyage de noces sur la Côte d’ Azur. Il arrive, et Bonaparte entreprend aussitôt auprès de Mme Turreau la campagne séductrice – à l’intention du mari – qu’il a déjà menée auprès de Mmes Carteaux et Ricord et qu’il reprendra plus tard auprès de Mme Carnot. On ne se battait plus, sur les Alpes, et la charmante jeune femme s’en désolait, elle qui s’était attendue, frétillante, à voir (de loin) « parler la poudre ». Afin de calmer sa déception, Bonaparte organise pour elle un petit spectacle de massacre. « Il en coûta la vie à quatre ou cinq soldats », pas plus, racontera-t-il, bonhomme, à Bertrand, au mois d’octobre 1818. Schérer, le général en chef, a mal apprécié l’épisode, et il tient à l’oeil le redoutable auxiliaire qu’il a là. Mais « j’étais bien avec les Représentants », dira « l’empereur » ; ce qui lui paraissait l’essentiel.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
CH V UN REGIME TONIFIANT (p.77) COMMENÇAIENT POUR LA FRANCE « quinze ans de régime tonifiant » ; c’est ce que m’enseignait, vers 1920, quand je me préparais au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure, ce M. Madelin que nous devions tenir pour le Docteur suprême, quelqu’un d’équivalent, en Histoire, à ce qu’est saint Thomas en théologie. Le régime que M. Madelin qualifiait ainsi, d’un ton de gourmandise, sans doute n’est-il pas superflu de le regarder d’un peu plus près. Benjamin Constant, un expert, enseignait que la politique est « l’art » , avant tout, « de présenter les choses sous la forme la plus propre à les faire accepter ». (p.78) Autrement dit, le choix du vocabulaire est capital et le meilleur politicien est celui qui se montre capable de faire applaudir par la foule un système où les mots recouvriront le contraire, exactement, de ce qu’ils annoncent. Les Constituants s’étaient montrés très forts à ce jeu-là, avec leur Déclaration des Droits de l’Homme proclamant que tous les individus “naissent et demeurent libres et égaux en droits », déclaration suivie des dispositions pratiques dont nous avons rappelé l’essentiel: silence aux pauvres; pour eux, pas de bulletins de vote (et voilà pour l’égalité); maintien de l’esclavage dans les colonies et de la traite des noirs; interdiction aux travailleurs de s’unir contre l’arbitraire patronal, en matière de salaire (et voilà pour la liberté). Bonaparte est loin, très loin, d’être un imbécile. |
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.86) La Banque en formation, Bonaparte a consenti – consenti n’est pas le mot juste, car Bonaparte était là pour ça; il remplissait le contrat qui lui avait valu son ascension; disons donc plutôt qu’il l’a autorisée – à l’intituler « Banque de France” (ce qui faisait très “national ») afin de donner le change à l’opinion et de faire croire aux Français que cet établissement de finance était leur Banque à eux, la Banque au service de la France. Or il s’agissait d’une maison privée, pareille aux autres, mais dotée, par sa grâce, d’une enseigne frauduleuse; il s’agissait d’une association d’affairistes qui, sous la banderole dont l’ornait un gouvernement suscité en secret par eux-mêmes, allaient pouvoir se procurer ainsi des bénéfices sans précédent.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
CH VI LA BOUTIQUE DE CESAR
(p.103) Une cour, à Paris. On juge de la bousculade, dans la belle société, pour en être, et d’autant plus que les « charges » n’y vont point sans émoluments.. Chateaubriand, qui rage un peu – car il a fait un pas-de-clerc, juste avant la proclamation de l’empire – racontera avec aigreur, dans ses Mémoires d’Outre-Tombe: ce n’était qu’excuses et gémissements chez les aristocrates; on n’avait pas pu se défendre; on avait été contraint, sous la menace, forcé, d’appartenir à cette Cour usurpatrice; « et l’on ne forçait, paraît-il, que ceux qui avaient un grand nom et une grande importance ; si bien que chacun, pour prouver son importance et ses quartiers, obtenait d’ étre forcé à force de sollicitations »
(p.108) “Il aura un jour (le 11 février 1809), devant Roederer, une formule qu’il savoure, tant elle lui paraît adéquate: “La France? Je couche avec elle; et elle me prodigue son sang et ses trésors” (= Journal du comte Roederer (1909), p.240); autrement dit: Elle fait ce que je veux, et elle paie.”
(p.110) N’oublions pas d’ajouter que la guerre, pour Bonaparte, doit être – et primordialement – une entreprise qui rapporte; et il s’y entend, à la faire rapporter; sinon pour l’Etat, du moins pour lui-même; et d’autres en profitent, qui se loueront ainsi de lui ; « je les connais mes Français », dit-il à Lucien, d’un ton assez crapuleux ; ils adorent d’avoir « à leur tête » quelqu’un « qui les mène voler, de temps à autre, à l’étranger ». Je sais des gens, en toute bonne foi, qui vous disent encore : « Si Napoléon a passé son temps à faire la guerre, ce n’est absolument pas sa faute; l’Europe se jetait sans cesse contre lui… ». Et je revois ce professeur (mais qui avait des raisons privées, et fortes, de déployer le plus grand zèle bonapartiste) me conjurant de me rendre à l’évidence, de ne point répercuter des sottises: « C’est la vérité, me disait-il, la vérité bien établie; aucun historien sérieux ne saurait le nier. Napoléon a toujours voulu la paix; il a toujours été l’agressé et non pas l’agresseur… ». Tiens donc ! C’est l’Espagne, peut-être, qui s’est jetée sur lui ? Et c’est la Russie, spontanément, en 1812, qui s’est ruée sur la France ? Soyons « sérieux », en effet, et regardons les choses comme elles furent. La paix de Lunéville, en 1801, avec l’Autriche, répète, en l’aggravant, Campo Formio . et Bonaparte l’avouait à Roederer, fin 1800 : la paix que je vais signer ne peut pas, c’est impossible, être durable; pourquoi ? parce que « nous possédons trop de choses »; parce que la France, sous la poussée des Girondins qui voulaient de l’argent (« la guerre est indispensable à nos finances « , s’était écrié publiquement Brissot, le spécialiste des mots-de-trop; et Narbonne, ministre de la guerre, le 14 décembre de la même année 1791, avait déclaré à la tribune: la guerre, il nous la faut : « le sort des créanciers de l’Etat en dépend »), la France est devenue annexionniste, envahissante. Elle a rompu l’équilibre européen ; et (p.112) Bonaparte n’a fait qu’accentuer, décupler la politique vorace – et condamnée à terme, fatalement condamnée – des pillards à la carnot.”
(p.114) Le fier-à-bras avait clamé, le 29 octobre 1803: « Je planterai mon drapeau sur la tour de Londres, ou je périrai”. Il ne plantera jamais son drapeau sur la tour de Londres et mourra paisiblement dans son lit. Mais un million d’hommes, par sa grâce, mourront d’une autre manière, dans les carnages de sa « gloire”. Et le malheur de mon pays fut que ce forban (« incomparable météore », dit Jacques Bainville), pour ses interminables razzias, s’était procuré, comme tueurs, les conscrits français.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.130) Bonaparte ayant voué au saccage et au feu les objets de consommation, d’origine anglaise, qu’il avait pu saisir à Francfort et à Leipzig, les industriels et négociants français ont d’abord été remplis d’enthousiasme devant ces brimades à la concurrence; la Chambre de Commerce d’ Agen en devenait lyrique: « Les cendres de ces bûchers, disait-elle, fertiliseront le sol français ». (p.131) Mais bientôt les effets du Blocus et le manque de matières premières auront de cruelles incidences sur les bénéfices habituels de ces honnêtes gens; et les rapports des préfets deviennent fâcheux; à Marseille, “l’activité du port est nulle » ; à Bordeaux, “agitation; placards dans les rues basses : du pain ou la mort! » ; « les suicides sont fréquents”, signale la préfecture. Bulletin de police, Lyon, 14 décembre 1810: « Cinq à six mille ouvriers canuts sont dans le plus grand dénuement”. Le Conseil Général des Manufactures – quelque chose comme la Confédération Générale du Patronat – réclame un Code Manufacturier portant des stipulations précises et énergiques “pour maintenir l’ordre et la subordination, et garantir les fabricants des manoeuvres coupables » auxquelles pourraient songer leurs ouvriers. Les prix s’élèvent dans de telles proportions que les marges bénéficiaires s’en ressentent; et beaucoup d’industriels trouvent odieuses ces taxes à l’importation qu’impose à l’empereur sa vaine politique anti-anglaise d’ asphyxie commerciale. Napoléon vend bien des « licences » – entorses officielles au Blocus (1) – mais il les vend à prix d’or. (1) Cette “contrebande officielle » qu’organise Napoléon lui-même, à son profit, se double d’une énorme contrebande cachée dont ,tels généraux tirent, privément, des bénéfices notables: ainsi Brune, à Hambourg, Bernadotte en Poméranie et Masséna en Italie. |
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.131) / le blocus continental/ Chômage dans les ports tels que Bordeaux et Marseille; hausse spectaculaire des prix. « Napoléon vend bien des « licences » – entorses officielles au Blocus – mais il les vend à prix d’ or. » (Note: « Cette « contrebande officielle » qu’ organise Napoléon lui-même, à son profit, se double d’une énorme contrebande dont tels généraux tirent, privément, des bénéfices notables: ainsi Brune, à Hambourg, Bernadotte en Poméranie et Masséna en Italie. »
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.20) Et voici la dernière pensée de Napoléon sur la Corse ; nous la trouvons dans les Cahiers du général Bertrand, le fidélissime, sous la date du 24 février 1821 : « La Corse est un inconvénient pour la France ; c’est une loupe quelle a sur le nez […] Choiseul disait que si, d’un coup de trident, on pouvait la mettre sous la mer, il faudrait le faire. Il avait raison *. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.23) La France ne sera jamais pour lui autre chose qu’un champ d’exploitation. Le seul souci du capitaine Bonaparte, en juin 1793, est de se procurer des ressources, et il a son thème : il se pose en victime ; montagnard (de fraîche date ; mais Salicetti est là pour masquer, en haut lieu, son tout récent passé de séparatiste corse), il a tout sacrifié à son idéal ; ses biens ont été confisqués par les réactionnaires paolistes, ces malfaiteurs, ces antipatriotes ; en conséquence, martyr de sa foi, il a droit, et sa famille a droit comme lui, à une indemnisation substantielle. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.69) Le 18 Brumaire, c’est le vrai retour à l’ordre, si gravement endommagé depuis le 10 août 92 ; c’est la populace contenue comme il faut, dupée comme il faut (Bonaparte a toujours préféré la ruse à la force). On criera « Vive la République » pour étrangler la République. Et ce sera enfin la paix du cœur pour les possédants, les fournisseurs et les banquiers, à l’abri désormais, sous un sabre, de toute entreprise délétère. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.126) Mais bientôt les effets du Blocus et le manque de matières premières auront de cruelles incidences sur les bénéfices habituels de ces honnêtes gens ; et les rapports des préfets deviennent fâcheux ; à Marseille, « l’activité du port est nulle » ; à Bordeaux, « agitation ; placards dans les rues basses : du pain ou la mort ! » ; « les suicides sont fréquents », signale la préfecture. Bulletin de police, Lyon, 14 décembre 1810 : « Cinq à six mille ouvriers canuts sont dans le plus grand dénuement ». Le Conseil Général des Manufactures — quelque chose comme la Confédération Générale du Patronat — réclame un Code Manufacturier portant des stipulations précises et énergiques « pour maintenir l’ordre et la subordination, et garantir les fabricants des manœuvres coupables » auxquelles pourraient songer leurs ouvriers. Les prix s’élèvent dans de telles proportions que les marges bénéficiaires s’en ressentent ; et beaucoup d’industriels trouvent odieuses ces taxes à l’importation qu’impose à l’empereur sa vaine politique anti-anglaise d’asphyxie commerciale. Napoléon vend bien des « licences » — entorses officielles au Blocus (1) — mais il les vend à prix d’or. ([1]) Cette « contrebande officielle » qu’organise Napoléon lui-même, à son profit, se double d’une énorme contrebande cachée dont tels généraux tirent, privément, des bénéfices notables : ainsi Brune, à Hambourg, Bemadotte en Poméranie et Masséna en Italie. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.146) Des particuliers qui n’ont pas à se plaindre, ce sont les membres de la tribu née de Carlo et de Letizia. La France a vu sa jeunesse fauchée, et les cadavres de ses enfants en pyramides monstrueuses : elle est amputée maintenant de la Sarre et de la Savoie ; elle a 700 000 millions d’indemnité à verser aux envahisseurs qui l’occuperont pendant trois ans. Mais « Nabou » a tout de même joliment bien réussi pour son clan. La Mamma a un palais à Rome, et tous et toutes sont grassement pourvus. La France a payé très cher leur raid, chez elle, de vingt ans et leur pluie de sauterelles, mais quand ils évoquent leur taudis d’autrefois, rue de la Mauvaise Herbe, à Ajaccio, ils ont de quoi jubiler et se frotter les mains. Ils sont « les Bonaparte », . une « grande famille », une très grande famille désormais. |
|
Jean Burnat, G.H. Dumont, Emile Wanty, Le dossier Napoléon, éd. Marabout, 1962 (p.126) Il n’y a plus de Constitution. Cependant, l’esprit inquiet du Premier Consul s’irrite bientôt des obstacles qu’il trouve à l’exécution de ses projets. L’opposition raisonnée et salutaire du Tribunat à quelques lois lui déplaît. Les plaintes portées à la Commission du Sénat pour la liberté individuelle et les réclamations de la Commission l’importunent. Il supprime le Tribunat, et me dit le soir même — Dès ce moment, il n’y a plus de Constitution. Il organise une force militaire qui exécute ses décrets sans observation ; et ses ministres, que les formes constitutionnelles entravaient dans leur marche, exécutent ses décrets sans opposition. Les consuls n’étaient nommés que pour dix ans ; il les fait nommer à vie. Quelque temps après, peu content du titre de Premier Consul, il aspire à se placer parmi les souverains et à établir sa dynastie. On s’étonnera peut-être de la facilité qu’on lui a laissée pour opérer tous ces changements, contraires à la liberté publique. Mais l’étonnement cessera lorsqu’on réfléchira qu’il y avait alors un engouement général pour sa personne, lorsqu’on verra que ses armées étaient constamment victorieuses et que l’opinion publique le proclamait comme le seul homme capable de nous faire respecter au-dehors et de comprimer les factions mal éteintes du dedans. |
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014 (p.95) L’expérience de l’État modèle sera pourtant conduite à l’échec. En effet, l’Etat est pressuré financièrement par la France et la moitié des terres domaniales est donnée en propre à l’Empereur (pour doter ses grands serviteurs (…).
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.418) /après la campagne d’Italie/ Si la carrière de Bonaparte s’était arrêtée là, elle n’aurait été qu’un épisode sans intérêt et sans lendemain de l’histoire de la France. Mais le malheur a voulu que cet opportuniste, ce joueur, gagne sa partie de poker avec la France. Certes, il y a mis les formes, il n’a pas incendié son Reichstag comme le fit Hitler, il a chassé de Paris les députés par la peur, le 18 Brumaire, et de Saint-Cloud par la force des baïonnettes. Il avait raison, Mirabeau, ce 23 juin de l’année 1789, quand il lançait son apostrophe fameuse à Dreux-Brézé : il n’y avait plus de République en France. |
|
Roger Caratini, Paoli, Napoléon, une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.439) annexe n° 4 Lettre à Paoli Voici, en continu, la fameuse lettre écrite à Paoli par Napoléon, que nous avons commentée paragraphe par paragraphe, p. 123 sq. « Auxonne en Bourgogne, 12 juin 1789 Général, Je naquis quand la patrie périssait. Trente mille Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la Liberté dans des flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Les cris des mourants, les gémissements de l’opprimé, les larmes du désespoir environnèrent mon berceau dès mon enfance. Vous quittâtes notre île et, avec vous, disparut l’espérance du bonheur ; l’esclavage fut le prix de notre soumission : accablés sous la triple chaîne du soldat, du légiste et du percepteur d’impôts, nos compatriotes vivent méprisés… méprisés par ceux qui ont la force de l’administration en main. N’est-ce pas la plus cruelle torture que puisse éprouver celui qui a du sentiment? L’infortuné Péruvien périssant sous le fer de l’avide Espagnol éprouvait-il une vexation plus ulcérante ? Les traîtres à la Patrie, les âmes viles que corrompit l’amour d’un gain sordide, ont, pour se justifier, semé des calomnies contre le Gouvernement national [le gouvernement nationaliste institué par Paoli à Corté] et contre votre personne en particulier. Les écrivains, en les adoptant comme des vérités, les transmettent à la postérité. En les lisant, mon ardeur s’est échauffée et j’ai résolu de dissiper ces brouillards, enfants de l’ignorance. Une étude commencée de bonne heure de la langue française, de longues observations et des mémoires puisés dans les portefeuilles des patriotes m’ont mis à même d’espérer quelques succès. […] Je veux comparer votre (p.440) administration [la manière dont Paoli a gouverné la Corse} avec l’administration actuelle… je veux, au tribunal de l’opinion publique, appeler ceux qui gouvernent, détailler leurs vexations, découvrir leurs sourdes menées et, s’il est possible, intéresser le vertueux ministre qui gouverne l’État [il s’agit de Necker\\ au sort déplorable qui nous afflige si cruellement. Jeune encore, mon entreprise peut être téméraire, mais l’amour de la vérité, de la patrie [la patrie corse, évidemment: Bonaparte renie la patrie française], de mes compatriotes, cet enthousiasme que m’inspire toujours la perspective d’une amélioration dans notre état, me soutiendront. Si vous daignez, général, approuver un ouvrage où il sera si fort question de vous ; si vous daignez encourager les efforts d’un jeune homme que vous vîtes naître et dont les parents furent toujours attachés au bon parti, j’oserai augurer favorablement du succès. J’espérai quelque temps pouvoir aller à Londres [où résidait Paoli depuis 1769] vous exprimer les sentiments que vous m’avez fait naître et causer ensemble des malheurs de la Patrie, mais l’éloignement y met obstacle : viendra peut-être un jour où je me trouverai à même de le franchir. Quel que soit le succès de mon ouvrage, je sens qu’il soulèvera contre moi la nombreuse cohorte d’employés français qui gouvernent notre île et que j’attaque : mais qu’importé s’il y va de l’intérêt de la Patrie ! J’entendrai gronder le méchant et, si ce tonnerre tombe, je descendrai dans ma conscience, je me souviendrai de la légitimité de mes motifs, et, dès ce moment, je le braverai. Permettez-moi, général, de vous offrir les hommages de ma famille… Eh ! pourquoi ne le dirai-je pas… de mes compatriotes. Ils soupirent au souvenir d’un temps où ils espérèrent la liberté. Ma mère, Mme Letizia, m’a chargé de vous renouveler le souvenir des années écoulées à Corté. Je finis avec respect, général, votre très humble et très obéissant serviteur. napoléon buonaparte. » Paoli reçut cette lettre à Londres, où il vivait, et il ne prit pas la peine d’y répondre. Il suivait attentivement les événements de France, où l’assemblée des États généraux du royaume s’était autoproclamée Assemblée constituante le 17 juin 1789 et, en fin politique qu’il était, il voyait dans les difficultés de la monarchie française les signes avant-coureurs de ce qui pourrait être la libération de sa patrie corse. Toutefois, la lettre du jeune Bonaparte, « le fils de Carlo » comme il l’appellera plus tard, était trop flagorneuse pour être sincère, et il ne se risqua pas à servir de (p.441) protecteur à ce jeune ambitieux dans la République des lettres. Quand il rencontrera plus tard Napoléon, en octobre 1792, le courant ne passera pas entre le vieux nationaliste corse et le jeune officier français (voir chapitre VII).
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.220) It is also often said that Napoleon got his scientists to invent the process of turning beetroot into sugar. The (highly crédible) argument is that, faced with a British blockade of his ports and a self-imposed ban on importing British sugar – his Blocus Continental – Napoléon looked to home-grown solutions for sweetening his coffee and crème brûlée.*
In fact, the extraction of sugar from vegetables dates back to 1747, when the process was developed by a German scientist called Andréas Sigismund Marggraf. One of his students, a man called Franz Karl Achard, began selectively breeding sugar beets, and opened a sugar refinery in 1801, sponsored by one of Napoleon’s enemies, Friedrich Wilhelm III of Prussia. When the Blocus Continental took effect, and sugar supplies were further depleted by a revolt of France’s slaves in Haiti, Napoleon offered a one million franc grant for the development of sugar-beet technology in France, and in 1812 issued a decree ordering farmers to plant beets, a dictatorial move that has earned him an unwarranted place in the heart of every Frenchman with a sweet tooth.
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.230) In December 1813, Joseph Lainé, the MP for the Gironde in south-western France, made a daring speech in parliament complaining that ‘trade has been destroyed, and industry is dying. What are the causes of this unspeakable misery? A vexatious administration, excessive taxation . . . and crueller still, the way our armies are recruited.’ Lainé represented the Bordeaux region, which was suffering more than most from Napoleon’s droits réunis, a VAT-style duty on everyday goods to raise money for his warmongering. Wine was taxed at a staggering 94.1 per cent. Not only that, Napoleon had forbidden the region’s ports from selling wine to their traditional buyers, the thirsty Brits.
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.238) The fall of Napoleon also ushered in a new period of cultural freedom in France, rather in the way that the end of L Cromwell’s puritan regime did in England. Even if Napoleon had inspired foreign artists like Beethoven, Byron and Hegel while he was in power, at home he had overseen a period of cultural austerity. As a general, Napoleon had spent a lot of his campaign time looting foreign museums of their treasures, but as Emperor he had been fonder of the beauty of a well-expressed regulation. His only real artistic creativity was directed towards portraits of himself in heroic mode, grandiose self-aggrandising monuments, uniforms and propaganda. Under Napoleon, theatres were unable to decide their own programmes, and the anti-elitist satire that had grown out of the Revolution was well and truly stifled. Art had to be officially sanctioned.
(p.239) To get an idea of Napoleon’s view of culture, one only / has to look at the regime he devised for the management of France’s national theatre, the Comédie Française. In 1812, while in Moscow, he took time out from chasing the Czar to dictate a decree that turned French actors into a sort of army. The Comédie Française, he ordered, would be ‘placed ‘ under the surveillance and direction of the Superintendent of our theatre’. (By ‘our’, of course, Napoleon was referring to himself.) ‘An Imperial Commissioner, named by us, will be responsible for transmitting the Superintendent’s orders to the actors.’ Actors had to sign up for twenty years, and obey strict rules of behaviour – they could be excused from performing if they were declared officially sick, but if seen out walking in the Street or going to see a show while on the sick list, they would be fined.
There was little room for art or inspiration in all this – tragic actors were forbidden to play comedy, and roles were attributed according to seniority rather than talent. Only plays approved unanimously by nine committee members (p.240) (named by the State) could be performed. Napoleon’s list of rules ends chillingly: ‘Our Ministers of the interior, of police, of finance and the Superintendent of our theatre are all given responsibility for the execution of the present decree.’
|
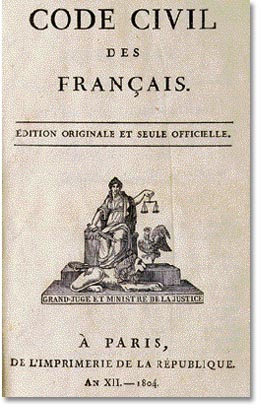
1.1 Le Code Civil de Napoléon: mise au point
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.14) Les napoléophiles brandissent alors un autre étendard: celui du législateur, qui a doté la France, entre autres choses, d’un merveilleux Code civil, et celui de l’administrateur civil, créateur des préfets et du Conseil d’État. C’est encore faux: il est vrai que le Code civil des Français est une grande chose… mais Napoléon n’y est à peu près pour rien, comme nous le montrons dans cet ouvrage: il n’a fait qu’organiser sa promulgation ; quant à la réforme administrative sous le Consulat, elle a plus été l’œuvre de Sieyès ou de Daunou que de Bonaparte, qui s’est contenté d’en fixer le caractère centralisateur.
|
| Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.354) l’imposture du « code napoléon »
L’imposture la plus patente, la plus grossière, que nul n’a curieusement jamais relevée, pas même les plus acharnés des napoléo-phobes, concerne la paternité du Code civil, que tous les historiens du droit, sans exception aucune, lui attribuent. Voici la version « officielle » de cette aventure que l’on enseigne encore dans tous les manuels scolaires aux candidats au baccalauréat et dans tous les précis d’histoire du droit : « Aussitôt qu’il eut créé les nouveaux instruments de gouvernement [la Constitution de l’an VIII)et procédé à la réorganisation de l’État, le Premier Consul s’occupa d’ordonner (p.355) l’œuvre sociale de la Révolution en faisant réunir, dans un recueil unique, l’ensemble des lois qui régissent les rapports des particuliers dans la société nouvelle. La rédaction d’un Code avait été ordonnée dès 1799 par la Constituante ; la Convention, les Cinq-Cents avaient préparé plusieurs projets : aucun n’avait abouti. Au mois d’août 1800, Bonaparte institua une commission de six membres, choisis dans tous les partis : Tronchet, l’un des avocats de Louis XVI, Bigot de Préameneu, royaliste avéré, Portalis, déporté par le Directoire, et trois conventionnels, trois anciens montagnards, Merlin de Douai, l’un des organisateurs du Tribunal révolutionnaire, Berlier et Real. Le rôle principal appartint à Tronchet, le président de la Cour de cassation. En quatre mois, la commission établit un projet nouveau. Soumis d’abord à l’examen des tribunaux, ce projet fut ensuite revu par le Conseil d’État1. Le travail de révision dura deux ans. Le Premier Consul, assisté de Cambacérès, présida toutes les séances – certaines se prolongèrent pendant vingt heures – ; il prit la part la plus active aux discussions et surprit maintes fois les juristes par son sens juridique et sa connaissance du droit. […]. » (Albert Malet, Manuel d’histoire de la classe de Première, Paris, Hachette, 1918, y édition, dont le texte est resté inchangé jusqu’aux éditions actuelles.) Or, nous Talions démontrer rigoureusement dans les pages qui suivent, cette version est totalement fausse, mensongère même, car son auteur, professeur agrégé d’histoire au lycée Louis-le-Grand de Paris, se devait de le savoir ; il a menti sciemment, comme tous les autres historiens, et même les spécialistes de l’histoire du droit. Ouvrons donc ici le dossier de cette imposture majeure que tous les historiens français ont accréditée. Le Code civil des Français a été promulgué le 21 mars 1804 (le jour de l’exécution du jeune duc d’Enghien, accusé de conspiration monarchiste, deux mois avant la proclamation de l’Empire). C’est
1 L’une des trois assemblées prévues par la Constitution de l’an VIII, dont le rôle était de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique sous la direction des Consuls ; ses 29 membres étaient nommés par le Premier Consul, qui avait aussi le droit de les révoquer.
(p.356) un corps de lois fondant les rapports juridiques de tous les citoyens français entre eux, décrites par 2 281 articles, rangés méthodiquement sous 35 Titres (un Titre par loi), répartis en trois Livres et précédés d’un Titre préliminaire concernant la publication, les effets et l’application des lois en général. La totalité des historiens du droit, des autres historiens, des utilisateurs du droit et des politiques, même les napoléophobes, affirment et écrivent depuis deux siècles que Napoléon a été non seulement le chef d’État qui l’a promulgué, mais aussi l’inspirateur et le guide (mot qui se dit en allemand fûbreret en italien duce) qui en a surveillé, pas à pas, toute l’élaboration et la rédaction. Voici par exemple, l’opinion de Monsieur Thiers, l’un de ceux qui ont ensanglanté les égouts de Paris en 1871, qui écrit, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire: « Tout le bien accompli, on l’attribua au Premier Consul, et on avait raison [c’est nous qui soulignant, car, d’après le témoignage de Cambacérès, il dirigeait l’ensemble, soignant lui-même les détails, et faisait encore plus dans chaque partie que ceux à qui elle était spécialement confiée. » Voici un autre témoignage de Cambacérès, Deuxième Consul, qui aurait bien embarrassé Monsieur Thiers : il disait un jour à un conseiller d’État, à propos d’une observation maladroite de Bonaparte que le Premier Consul « raisonnait comme des avocats de l’audience de sept heures » (l’audience des menus litiges, que plaidaient des avocats inexpérimentés ou besogneux), et comme Bonaparte riait de sa remarque, Cambacérès ajouta : ‘ « Vous êtes bien le maître d’établir un nouveau système, mais vous ne contesterez pas que la jurisprudence n’y soit contraire. On ne nous persuadera pas qu’après trente ans d’études et d’expériences nous soyons des ignorants et des imbéciles. » Après le Versaillais, voici un brave professeur de droit à la faculté de Poitiers, un certain H. Savatier, qui écrit, en 1927 : « On ne peut guère feuilleter Locré [le rédacteur des procès-verbaux de 106 séances du Conseil d’État consacrées à l’examen du Code civiR et Thibaudeau [conseiller d’Étaf) (p.357) sans être, comme Taine, comme Albert Sorel, frappé par le côté réaliste et puissant de cette magnifique intelligence, besognant dans le domaine du droit. […] Bien souvent, d’ailleurs, le Conseil d’État s’inclina devant l’opinion de Bonaparte qui fit remanier beaucoup de textes et souvent de façon heureuse. » (H. Savatier, Le Code civil, Poitiers, 1927.) Ce professeur Savatier est un menteur (mais paix à son âme) car il est bien évident qu’il n’a jamais feuilleté les cinq gros volumes in-quarto de Locré : il aurait pu constater que cette « magnifique intelligence » ne s’est à peu près jamais exprimée au cours de la centaine de séances du Conseil d’État et que nul n’a pu percevoir « le reflet d’acier de sa parole de maître » (cette audacieuse image est du professeur Savatier !) ; ou bien il n’a fait que les feuilleter sans les lire. Nous envisageons de montrer ici : 1° que Napoléon a indiscutablement eu la volonté de promulguer un Code civil des Français, mais que l’idée n’a jamais été de lui : c’était l’obsession des rois de France depuis François Ier, puis des pouvoirs révolutionnaires qui s’étaient succédé depuis 1789 ; 2° que l’initiative, en la matière, a été prise non pas par Bonaparte, mais par les Assemblées révolutionnaires ; 3° que la mise en œuvre de cette initiative a été le fait de la Convention qui a créé en son sein, dès le mois de juin 1793, un comité de législation chargé d’élaborer un projet de Code civil et qu’il en est résulté trois projets, d’ailleurs imparfaits (le dernier datant de juin 1795), mais que ces travaux sont restés en sommeil durant tout le Directoire ; 4° que Bonaparte a simplement relancé les travaux en signant l’arrêté du 24 Thermidor an VIII (12 août 1800), rédigé par Camba-cérès, nommant une commission de quatre membres chargée d’établir un nouveau projet de Code, projet qui a été rédigé en quatre mois, totalement en dehors de lui ; 5° que c’est ce projet, dit « projet de l’an VIII », qui a été discuté, article après article, par le Conseil d’État pendant trente-deux mois, entre le 17 juillet 1801 et le 19 mars 1804 (il a fallu huit fois plus de temps pour le discuter que pour le rédiger !), que Bonaparte n’a joué qu’un rôle d’observateur quasi muet au cours des séances du Conseil d’État pendant ces trente-deux mois… quand il était présent . (p.358) Le « Code civil des Français » sera finalement promulgué le 21 mars suivant par Napoléo, encore Premier Consul.
(p.360) Le « Projet de l’an VIII »
La Constitution substituant le régime dit du Consulat à celui du Directoire fut promulguée le 15 décambre 1799, mais le changement (p.361) de régime n’interrompit pas pour autant les travaux du comité de législation (d’autant que le Deuxième Consul était Cambacérès). Avant que ce Comité ne se sépare, il lui fut demandé de présenter un résumé des travaux accomplis, ce qui fut fait, en six jours à peine, par l’avocat Jacqueminot, député au Conseil des Cinq-Cents et rallié au nouveau régime : le 21 décembre, il présenta aux Consuls un inventaire simplifié de la législation civile issue de la Révolution, qu’on appela le « Code Jacqueminot1 ». Puis Bonaparte part pour l’Italie faire la guerre aux Autrichiens, qu’il bat à Marengo (grâce à Desaix) le 14 juin 1800 ; quand il revient, il s’inquiète de l’état des travaux sur le Code, engage Cambacérès à mettre les bouchées doubles et promulgue le fameux arrêté du 24 Thermidor an VIII (12 août 1800), rédigé, d’ailleurs, par Cambacérès lui-même, instituant une commission de quatre membres chargée de rédiger un ultime projet de Code civil en 697 articles, à partir des travaux antérieurs, accomplis, pour l’essentiel, sous la Convention. Pour rédiger cette dernière version préparatoire du Code civil, qu’on appelle usuellement le « Projet de l’an VIII », Cambacérès nomme quatre hauts magistrats : Tronchet (président de la Cour de cassation), Bigot de Préameneu (commissaire près la Cour de cassation), Jacques de Malleville (conseiller à la Cour de cassation) et Portalis (commissaire près le Conseil des Prises, organisme chargé de statuer sur les prises maritimes). Il ne les a pas choisis au hasard : à l’exception de Bigot de Préameneu, qui est un défenseur du droit coutumier, ces magistrats sont tous des partisans du droit romain, qui est un droit écrit, bannissant les particularismes juridiques. Pendant quatre mois, ces juristes se retrouvent, tous les jours, au domicile de Tronchet, président de la Commission, 82, rue Saint-André-des-Arts, près de la place Saint-Michel ; ils prennent comme base de leur travail le projet de 697 articles que Cambacérès avait présenté à la Convention en 1793 et qui avait été remanié par la commission de législation, et le Code Jacqueminot de 1799 : à la fin du mois de décembre 1800, la rédaction du « Projet de l’an VIII » est terminée. Il n’est pas inutile de souligner que Bonaparte ne parut jamais rue Saint-André-des-Arts : il ne joua rigoureusement aucun
1 Que l’on trouve dans toutes les grandes bibliothèques.
(p.362) rôle ni dans la conception, ni dans la préparation, ni dans la réalisation de ce travail préliminaire fondamental, qui fut achevé d’imprimer le 21 janvier 1801. On lit dans l’excellent Dictionnaire de Napoléon, publié sous la direction de Jean Tulard, à l’article Code civil (article sans nom d’auteur), que ce projet fut « établi avec une rapidité que l’on ne devait jamais revoir ni en France, ni ailleurs •>; c’est, à notre avis, une erreur de jugement. La commission Tronchet a été très rapide, c’est vrai, mais sa tâche se bornait à une mise en ordre et une mise en forme d’environ 2 000 articles, soit, en moyenne, une vingtaine d’articles par jour, de quelques lignes pour chacun : le travail de compilation, de synthèse et de normalisation de la législation préexistante avait commencé en 1793, huit ans plus tôt.
5. La discussion au Conseil d’État
Jusqu’à ce stade de l’élaboration du Code, le rôle de Bonaparte s’est limité à signer l’arrêté du 24 Thermidor et à demander une ou deux fois à Cambacérès de se dépêcher : c’est bien peu de chose, pour un nouveau Solon ! Il va avoir une autre occasion de se rendre utile en présidant, quand il le pourra et quand il le voudra, la section de législation du Conseil d’État qui doit examiner le Projet de l’an VIII et ce ne sera pas une mince tâche, car s’il avait fallu huit ans pour préparer le projet, et quatre mois pour le rédiger, il va falloir environ trois ans pour le discuter (du 17 juillet 1801 au 19 mars 1804). Les séances d’examen du Projet de Code civil eurent lieu aux Tuileries, où se tenait le Conseil d’État. Y assistaient : les membres de la section de législation, qui comptait quatre anciens avocats (Boulay de la Meurthe, Berlier, Thibaudeau, Emmery), un ancien procureur, qui avait été aussi policier (Real) et Bigot de Préameneu, déjà nommé ; le ministre de la Justice (le grand juge Régnier) et son prédécesseur (Abrial). Elles étaient présidées soit par le Premier Consul, quand il était à Paris, soit par Cambacérès, Second Consul ; le conseiller Locré, secrétaire général du Conseil d’État, établissait le procès-verbal de chaque séance. Le protocole était simple. Les membres de la section de législation étaient assis autour d’une table en forme de fer à cheval ; le ou les Consuls étaient sur une estrade ; Abrial, Régnier et Locré disposaient (p.363) d’une petite table à part. Chacun parlait de sa place, sans aucun document écrit. Locré prenait tout en note et rédigeait le procès-verbal de chaque séance ; ces documents ont été réunis, imprimés et édités. Imprimés, ils forment cinq gros volumes in-quarto, chacun d’environ cinq cents pages ; chaque procès-verbal ressemble à un dialogue de théâtre : le nom des orateurs et des intervenants est indiqué. En les examinant méthodiquement, on constate d’abord que Locré annonce 102 séances, mais, en les comptant, on en trouve 106 (la plupart des ouvrages généraux se fient aux dires de Locré… ce qui prouve qu’ils ne sont pas allés aux sources et qu’ils perpétuent ainsi une erreur). On remarque ensuite que le Premier Consul est présent, en moyenne, une fois sur deux : nous avons relevé 55 fois sa présence sur 106 séances, ce qui est d’ailleurs beaucoup, car elles étaient longues et les journées de Bonaparte étaient chargées ; cela signifie aussi qu’il prenait un grand intérêt à entendre parler de droit. Il est intéressant de signaler qu’en particulier il a été absent : – aux séances concernant l’état civil, la paternité, la filiation, la minorité, la jouissance ou la privation des droits civils, les successions ; – aux séances concernant le mariage, le divorce, l’adoption et la puissance paternelle (contrairement à la légende, largement colportée par quelques juristes féministes qui n’ont pas pris la peine de consulter les procès-verbaux de Locré et qui parlent ou écrivent sans connaître les sources, et qui voudraient qu’il ait réellement fait pression sur les législateurs pour faire adopter des lois antiféministes) ; – aux séances concernant les contrats de mariage, le droit de propriété et les lois sur les biens. S’il a été absent à ces séances, sans doute parce qu’il faisait la guerre quelque part en Europe, cette simple observation tend à montrer qu’il n’était pas présent lorsque le Conseil d’État a discuté les articles du Code relatifs au divorce : lorsqu’on accuse Napoléon du péché capital – à notre époque – de « machisme », en invoquant ses interventions sur l’adultère (dans l’ancien droit français, l’adultère du mari n’est une cause de divorce que s’il est pratiqué au domicile conjugal, tandis que l’adultère de la femme est une cause de divorce quel que soit le lieu où il est consommé), on est donc peut-être injuste, puisqu’il n’a pas pu intervenir (… mais il a pu chapitrer les conseillers à l’avance, quand il était présent !).
(p.364) La lecture de ces procès-verbaux va nous permettre de mesurer, au sens strict, l’importance relative du rôle de Bonaparte dans l’élaboration du Code civil. Nous avons eu la curiosité – et la patience -de compter le nombre de lignes que représentaient ses diverses interventions pendant trois ans : le nombre total de lignes que nous avons relevées (avec certainement quelques erreurs de comptage) correspond à environ vingt-huit ou vingt-neuf pages sur les deux à trois mille que représentent les cent six procès-verbaux de Locré. Le détail statistique est donné au tableau de l’Annexe n° 22, p. 479 : il montre, d’une manière péremptoire, que Napoléon, si fougueux et si prolixe lorsqu’il parlait, n’a pratiquement pas dit un mot au Conseil d’État au cours de ces trois années de délibérations. Mais, dira-t-on, s’il n’a rien dit, sans doute a-t-il inondé de notes et de lettres le président (c’était Boulay de la Meurthe) ou les membres de la commission de législation : il faut le voir pour le croire, mais, sur les quelque 35 000 pièces que contiennent les trente-trois volumes (in-quarto) de sa Correspondance (éditée par les soins de Napoléon III), il n’y en a pas une seule qui soit relative au Code civil qu’on baptisera de son nom. La conclusion est inévitable, et il faut s’y résoudre, le Code civil n’est, en aucune façon, l’œuvre de Napoléon: 1° l’idée de bâtir un Code civil unique pour tous les Français était une idée politique d’une banalité extrême, que les jurisconsultes et les empereurs romains (Théodose, Justinien) avaient d’ailleurs admirablement réalisée, et qui avait pris corps sous la monarchie, depuis François Ier, et toutes les assemblées nées de la Révolution la considéraient comme primordiale pour souder juridiquement la société française ; ce n’a jamais été une idée originale de Napoléon ; 2° les décisions qui sont à l’origine de l’élaboration d’un Code civil des Français n’ont pas été prises par Napoléon, mais par la Constituante ; l’acte initial qui en a promu la réalisation est la motion du 16 août 1790, votée par cette Assemblée, appelant à réaliser un « Code général des lois », confirmée par la motion du 24 août 1790, intégrée dans la Constitution des 3-4 septembre 1791 (la première véritable Constitution de l’histoire de France) ; 3° la création du comité de législation, chargé de cette réalisation et présidé par Cambacérès, a été le fait de la Convention, en juin 1793 (à ce moment, Bonaparte s’enfuyait précipitamment de Corse avec sa famille, poursuivi par les sbires de Paoli) ; 4° les travaux de ce comité n’ont pas cessé, (p.365) entre juin 1793 et août 1800, tant sous la Convention que sous le Directoire et au début du Consulat ; 5° ce n’est que le 27 février 1800 que Bonaparte, Premier Consul depuis deux ou trois mois, s’enquiert auprès de Cambacérès, Second Consul, de l’état des travaux du comité de législation : c’est sa première intervention en matière de Code civil, elle a lieu sept ans après le début des travaux du comité de législation créé par la Convention, qui n’avaient jamais cessé ; 6° l’arrêt de Thermidor an VIII, rédigé par Cambacérès et signé par Bonaparte, n’a rien d’extraordinaire en soi, il institue une commission chargée de faire la synthèse des travaux du comité de législation, synthèse connue sous le nom de Projet de l’an VIII; 7° ce Projet a été ensuite soumis à l’examen des magistrats qui allaient devoir appliquer le futur Code civil, c’est-à-dire à la Cour de cassation et aux différents tribunaux d’appel de France ; 8° enfin, comme l’exigeait la Constitution de l’an VIII, le Projet et les observations de ces tribunaux furent étudiés par le Conseil d’État, examen qui a duré trois ans, au cours duquel, nous l’avons montré, Bonaparte n’est pratiquement jamais intervenu; 9° les trente-six lois générales composant le Code civil des Français ont enfin été proposées, morceau par morceau, aux assemblées législatives (le Tribunal et le Corps législatif) qui les votèrent avec une assez grande rapidité. Nous pouvons donc renvoyer dos à dos les napoléophobes et les napoléophiles : les premiers ont tort de lui reprocher un certain nombre de dispositions du Code (sur la propriété, sur la famille, sur les droits de la femme, etc.) ; il n’est en rien l’auteur du Code, il n’a fait que le promulguer, comme l’aurait fait n’importe quel autre chef d’État à cette époque de l’histoire de France ; les seconds ont tort eux aussi, qu’ils lisent l’Annexe n° 22, p. 479, pour s’en rendre compte. Quant à Thiers, aux innombrables professeurs de droit qui propagent scandaleusement la légende depuis deux siècles, nous leur opposons notre approche cliométrique, que rien ne peut contredire. Ajoutons une précision ultime, qui n’est pas sans intérêt. En 1804, on parlait couramment, dans les milieux juridiques comme dans la presse hautement surveillée du Consulat et de l’Empire naissant, du « Code Napoléon », ce qui n’a rien pour nous étonner : une propagande acharnée rapportait tout ce qui se passait en France au divin césar du moment (césar : nom tout ce qu’il y a de (p.366) commun : Napoléon, le « césar », n’a rien à voir avec le grand César romain ; l’un fut constructeur, Bonaparte fut un petit césar destructeur). En 1852, Napoléon III publie une nouvelle édition, révisée, du Code promulgué par son oncle un demi-siècle plus tôt, mieux adaptée à la société industrielle et bourgeoise naissante ; il l’ouvre sur un décret de son cru qui lui attribue officiellement et légalement (c’est l’article 1 du Code révisé) la dénomination « Code Napoléon », pour, dit le décret, « rendre hommage à la vérité historique » (!), à » l’énergique impulsion » que son oncle a donnée à la rédaction et à la publication du Code, ainsi qu’à sa propre participation. Tuez les légendes, elles renaissent toujours.
|
|
Conférence de Mme Lenoble-Pinson (professeur émérite des Facultés St-Louis (Bruxelles)) à Saint-Hubert, le 7 juin 2019
Code civil remarquable. Clarté et concision. Mais le droit des femmes est bafoué. Elle doit obéissance à son mari. « Il vaut mieux qu’elles travaillent de l’aiguille que de la langue. »
|
|
13/04/2018 FB Didier Putman A noter, au passage, que le statut d’infériorité juridique contre lequel ce sont battues les féministes a été créé par un certain Napoléon Bonaparte qui n’était pas vraiment une grenouille de bénitier…L’interdiction de participation active à la vie politique des femmes a, elle, été votée par la Convention en 1793 suite au rapport du député Amar, un athée qui était un fervent partisan de la politique de déchristianisation. Leur place était, selon lui, à la maison à s’occuper du ménage et des enfants du citoyen.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.100) Il est vrai que les « mangeurs » ont de quoi être satisfaits quant au dressage des « mangés ». On la mène dur, la canaille travailleuse, sous le Protecteur brumairien. Ce Code civil que Napoléon Bonaparte s’attribue pour avoir seulement modifié et cravaché la Commission depuis des aimées, et bien avant lui, à l’œuvre, ce Code dont il ne s’est personnellement occupé que pour le divorce et l’adoption, d’une part (des sujets sur lesquels il nourrit des arrière-pensées concernant sa propre carrière), d’autre part et surtout pour l’affaire essentielle, celle des remparts, jamais assez hauts, jamais assez puissants, autour de la fortune acquise, deux articles y sont inclus, dans la ligne bourgeoise de la loi Le Chapelier (1791), rigides et réconfortants : Article 415 : « Toute coalition d’ouvriers dans le dessein d’enchérir leur travail [c’est-à-dire pour une augmentation de salaires] sera passible d’un mois de prison au minimum et d’un emprisonnement de deux à cinq ans pour les instigateurs ». (p.101) Article 1781 : « Dans toute contestation au sujet des salaires, c’est l’employeur qui sera cru sur sa parole, laquelle fera foi sur la quotité des gages ».
|
|
François Reynaert, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, éd. Fayard, 2010-12-26
(p.404) Bonaparte peut se montrer sur certains sujets d’une grande étroitesse d’esprit : c’est lui qui insiste pour qu’on inscrive dans le Code civil que la femme « doit obéissance » à son mari, quand la Révolution était favorable à une égalité civile entre l’homme et » la femme. Il refuse l’éducation publique pour les filles dont le destin, à ses yeux, est fort simple : « Le mariage est toute leur destination. » Enfin il restaure la paix civile, c’est vrai, mais à quel coût ? Le régime qu’il instaure a un nom qui nous est bien connu, la dictature. Dès son arrivée au pouvoir, les élections sont truquées. Le vote se pratique à livre ouvert. À chaque consultation, on doit écrire publiquement son choix en face de son nom. Et si ça ne suffit pas, les préfets bien intentionnés se chargent de rectifier les décomptes. L’Empereur, avec ses plébiscites, prétend s’appuyer sur l’assentiment du peuple. On voit le cas qu’il en fait.
|
|
Roger Caratini, Paoli, Napoléon, une imposture, éd. L’Archipel, 2002 p.479) ANNEXE n°22 Les interventions de Napoléon lors de la discussion du Code Civil
(p.490) 4. bilan
Napoléon a assisté à 34 séances sur 84 ; mais ses interventions sont négligeables : elles représentent, au total, 28 ou 29 pages sur les 2 575 pages de procès-verbaux. On peut donc affirmer qu’il n’a joué qu’un rôle dans l’histoire du Code civil : celui de signer la loi le promulguant. C’est mieux que rien, mais cela ne lui donne aucun droit de paternité sur le Code.
|
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014 (p.39) D’ailleurs, si la femme est une mineure dans le Code civil, elle l’est aussi, pour l’Empereur, dans la société ou dans la sphère de l’esprit. Les filles et les femmes n’auront pas accès au lycée et à l’université sous l’Empire. Aucune femme ne sera jugée digne de recevoir la Légion d’honneur. Sans doute n’y pensa- t-on même pas, alors qu’on ouvrait des maisons pour l’éducation des tilles de légionnaires.
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.212) The only excuse for withdrawing this inalienable right to property was l’utilité publique, which today explains how French railways and motorways get built so fast – a Frenchman’s home is no longer his château if the State decides to demolish it ‘for the public good’.
(p.213) In the Code Napoléon, women were described as ‘minors’, incapable of managing their own affairs. A wife could only work if she had her husband’s permission, and her wages would be paid to him. Women were not allowed to vote or sign contracts, and apparently did not need éducation beyond primary school. They were free to be prostitutes and sleep with married men, whose wives couldn’t sue for divorce unless the man actually invited his other sexual partner to live in the family home. Just sleeping around was no grounds for divorce – unless you were a woman, of course: your husband could get rid of you for the slightest infidelity.
|

Joseph Fouché
1.2 Un Etat policier sous Napoléon
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.301) vers brumaire
La Révolution française n’a pas été, fondamentalement, une révolution politique, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Elle a simplement substitué à la « tyrannie » du monarque, la « tyrannie » de l’État et à la suprématie des nobles la suprématie des bourgeois enrichis. Contrairement à ce que l’on pense classiquement, le pouvoir du souverain était bien loin d’être absolu, et confronté à plusieurs contre-pouvoirs : ceux des lois fondamentales du royaume de France quant à la transmission du pouvoir monarchique, et ceux des Parlements, des jurandes et des corporations, de l’Église et des Universités, des communes (« l’air des villes rend libre », disait-on déjà au Moyen Âge). Quant à la « tyrannie » de l’État, c’est celle d’une majorité (ne fût-elle que d’une voix) sur une minorité ; elle s’exprime par des lois (constitutionnelles, civiles, pénales, commerciales) votées par les représentants du peuple et par des règlements d’administration.
(p.323) Les hommes de la Révolution lui ayant montré la route, le Premier Consul n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Sous prétexte de préserver le secret des opérations militaires et d’empêcher les journaux d’attaquer de manière inconséquente les nations et les gouvernements européens avec lesquels la République voulait se réconcilier, il promulgua le décret du 27 Nivôse an VIII (17 janvier 1800) sur la presse. Avant le 18 Brumaire (8 novembre 1799), il paraissait à Paris soixante-treize journaux ; deux mois plus tard, en vertu de ce décret, seuls treize titres furent autorisés à paraître ; ils furent bientôt réduits à dix, et les rescapés furent sévèrement surveillés par une censure préventive policière. Voici les principales mesures décidées par Bonaparte dans les semaines qui suivirent son installation au Luxembourg : – limitation du nombre de titres autorisés (quotidiens) à neuf, en sus du Moniteur, qui était en quelque sorte le « Journal officiel » de la République consulaire (décret du 28 décembre 1799) : Le Journal des débats, Le Journal de Paris. Le Publiciste, La Clef du cabinet, Le Citoyen français La Gazette de France, Le Journal du soir, Le Journal des défenseurs de la Patrie, La Décade philosophique; (p.324) – création d’un Bureau de la presse au ministère de la Police, avec mission de surveiller non seulement les journaux autorisés, mais aussi l’édition de livres et de périodiques; – défense d’afficher sur les murs de Paris sans autorisation préalable du préfet de police ; – défense aux marchands de journaux, fixes ou ambulants, de crier aucun titre de journaux ou de pamphlets sans un permis spécial délivré par le préfet de police ; – défense aux marchands de gravures et d’estampes de rien exposer qui soit contraire aux bonnes mœurs et aux principes du gouvernement (on appréciera l’association des bonnes mœurs aux principes politiques) ; – défense d’annoncer, par voie d’affiches ou par tout autre moyen, une pièce de théâtre au public sans la permission du ministre de l’Intérieur, accordée expressément au directeur du théâtre concerné ; – à Paris, défense de représenter une pièce de théâtre nouvelle sans l’autorisation du ministre de l’Intérieur ; – en province, défense de représenter une pièce de théâtre sans l’autorisation du préfet, qui devra la soumettre d’abord au ministre de l’Intérieur si elle est nouvelle ; – obligation, pour les directeurs de théâtre de Paris et de province, de soumettre au ministre de l’Intérieur leurs répertoires de pièces anciennes, qui devront être approuvés par le ministre. Le Premier Consul lui-même était tenu au courant de toutes les publications, dans la presse ou l’édition, par deux collaborateurs spécialement attachés à son cabinet : son bibliothécaire personnel, Louis-Madeleine Ripault, qui lisait tout ce qui paraissait, et par Joseph Fiévée, son conseiller. Ce dernier avait débuté dans la vie comme imprimeur, à l’époque de la Révolution (il publiait une feuille de tendance girondine, La Gazette de France, ce qui lui valut d’être arrêté au début de la Terreur, le 20 septembre 1793), puis il avait publié un roman satirique sur les mœurs du Directoire et il devint par la suite le pamphlétaire à gages de Bonaparte, comme l’écrit Tulard ; on lui doit ce mot fameux : « La politique, même dans les gouvernements représentatifs, est ce qu’on ne dit pas. » Le Premier Consul, qui trouvait ses idées trop libérales, le remplacera en 1804 par l’abbé Dubois.
(p.325) LA PROPAGANDE COMME FORCE POLITIQUE
La censure a pour but de museler l’opinion et de faire taire les adversaires du pouvoir ; elle a comme complément la propagande, dont le but est de susciter l’adhésion d’un groupe à une action, à un homme, à une idéologie non point par la coercition, mais par une sorte d’intoxication subtile des consciences, en utilisant des moyens divers qui, tous, aboutissent à la création de mythes. Le premier exemple que l’on peut donner de cette puissante arme psychologique est celui des monarques mésopotamiens et égyptiens, qui furent les premiers souverains de l’histoire humaine. Le pateshi de Sumer, le roi akkadien ou babylonien, le pharaon égyptien et plus tard le Roi des rois des Perses s’affirment tous comme d’ascendance divine aux yeux de leurs peuples ; les stèles, les colonnes, les pyramides qu’ils font élever, couvertes d’inscriptions commémorant leurs victoires et leurs hauts faits, sont les formes les plus marquantes, on pourrait dire les plus écrasantes, de la propagande de cette époque. Plus tard, tous les aèdes, les rhapsodes de l’Hellade, qui allaient, de village en village, chanter les colères du bouillant Achille et les courroux de Poséidon, ont été, sans le savoir, les agents d’une propagande qui a fortifié la solidarité de tous les peuples hellènes – Mycéniens, Ioniens, Éoliens, Doriens – contre les non-hellènes, les barbares. L’instrument de la propagande est alors l’art oratoire, aussi bien celui des poètes de VIliadeç\\. de [‘Odyssée que celui de Démos-thène vaticinant contre Philippe de Macédoine dans les Philippiques. La Rome antique, sous la République et sous l’Empire, concevra une propagande plus pratique, plus terre à terre ; elle inventera l’art de la propagande électorale, puisque toutes les charges publiques étaient électives, et celui des combines et de la fraude qui en est l’adjuvant inéluctable. C’est Jules César qui transformera ce « bouche à oreille » en propagande officielle, assurée par un remarquable réseau de communication, matérialisé par les innombrables voies romaines. Après l’écroulement du monde romain, l’Église prendra le relais et mettra en œuvre des moyens puissants, allant du prédicateur en chaire à la construction de temples plus riches, plus beaux, plus nombreux que les pyramides ou les (p.326) temples grecs, à l’organisation de processions et de pèlerinages, dont les Croisades sont un exemple démesuré. Les découvertes techniques qui vont se multiplier à partir du XVe siècle, de l’imprimerie à la radio, la télévision et la communication électronique, élargiront encore le champ de la propagande, qui deviendra de plus en plus efficace au fur et à mesure que se développeront les sciences et les techniques de la communication. La Révolution française a utilisé systématiquement tous les moyens de propagande qui étaient à sa disposition en 1789 : les proclamations, la diffusion de brochures, les manifestations de masse, les slogans, les fêtes nationales, les serments solennels, les journaux, les modes vestimentaires même (les sans-culottes, les incroyables et les merveilleuses), les coiffures (l’abandon des perruques, les cheveux longs et flottants des sans-culottes et de Bonaparte jeune par exemple), etc. En matière de propagande, Bonaparte se savait l’héritier de la Révolution ; il connaissait son importance et sut utiliser le façonnement de l’opinion publique comme soutien de son action. Déjà, lors de la campagne d’Italie, il avait fondé ses propres journaux, qui vantaient ses mérites et le présentaient comme un surhomme. Quand il partit pour l’Egypte, il emmena avec lui non seulement une commission de savants, comme c’était la coutume au xvme siècle, mais des journalistes et des presses à imprimer, avec des jeux de caractères romains, arabes et grecs. Il créera une imprimerie nationale au Caire, où il publiera Le Courrier d’Egypte. Devenu le maître absolu de la France, il va se comporter comme les pharaons, construire lui-même son mythe, appliquant à la lettre avec deux siècles d’avance cette consigne que donnait l’ignoble Goebbels aux membres du parti nazi dans son discours du 6 septembre 1934, à Nuremberg : « La propagande politique, c’est-à-dire l’art de faire pénétrer solidement dans les masses les choses de l’État, de telle sorte que le peuple tout entier s’y sente lié profondément [ne peut pas] rester un simple moyen pour la conquête du pouvoir; [il faut qu’elle devienne] un moyen de développer et d’approfondir le pouvoir une fois conquis. » Napoléon a compris que la propagande qu’il devait mettre en œuvre devait avoir pour but non pas de convaincre le peuple qu’il (p.327) allait le bien gouverner, mais de le rendre incapable, psychologiquement, de le critiquer, de le contredire, de médire de lui, autrement dit de créer son propre mythe. Déjà en 1797, dans les journaux qu’il avait édités pendant la campagne d’Italie (voir p. 232), il modèle son image ; ainsi ce portrait de l’artiste par lui-même qu’il trace, en 1797, dans son Courrier de l’armée de l’Italie : « Bonaparte vole comme l’éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout : il est l’envoyé de la Grande Nation […]. Il sait qu’il est des hommes dont le pouvoir n’a d’autres bornes que leur volonté quand la vertu des plus sublimes vertus seconde un vaste génie. » Bonaparte fait ses premiers pas dans la carrière de chef, mais il sait déjà comment faire pour le rester. Les principaux éléments du mythe ont été élaborés par lui bien avant qu’il ne devienne Premier Consul : l’affection des soldats pour leur général, le surnom de « Petit caporal » que lui auraient donné ses hommes de l’armée d’Italie au soir de la bataille de Lodi (une légende, selon Tulard), son courage indomptable, les blessés mourants qui se dressent sur les champs de bataille pour l’acclamer, sa résistance à la fatigue, ses proclamations, son allure même (le fameux petit chapeau a été créé par le chapelier Poupart). Le mythe est aussi idéologique : bien qu’il ait fait table rase de tous les principes révolutionnaires, il se fait passer pour le continuateur de la grande Révolution française. Aussi n’oublie-t-il pas, dans les innombrables brochures qu’il fait circuler, de faire préciser que la Révolution de 1789 a révélé la « nation », mais que celle de Brumaire en a fait une « Grande Nation » (avec des majuscules). On retrouvera tous ces thèmes dans les vers de mirliton des chantres posthumes comme Béranger ou Costa, l’auteur de l’inénarrable Ajaccienne. La propagande bonapartiste, puis napoléonienne, s’adapte à toutes les classes de la société. Au peuple en général, par les slogans et les anecdotes ; aux paysans (plus des trois quarts de la population de la France), par le maintien des importantes réformes du Directoire – celles de François de Neufchâteau – relatives aux statistiques départementales et au cadastre ; aux bourgeois et aux notables, plus difficiles à duper, par des mesures financières concrètes : la garantie du droit de propriété, la confirmation des (p.328) acquisitions de biens nationaux, une législation très favorable aux industriels, aux financiers (aux « capitalistes ») et aux grandes sociétés commerciales. Le principal moyen de cette propagande est la presse ; les fêtes nationales, qui plaisaient tant aux hommes de la Révolution, et / autres cérémonies du même genre passent au second plan. (…) Les buts assignés par le Premier Consul à cette presse sont ceux que lui assigneront tous les dictateurs futurs, construire et maintenir son image mythique de surhomme génial, exalter ses succès et présenter ses défaites comme des victoires.
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.369) Le régime institué en 1802 par la Constitution de l’an X, à savoir le consulat à vie, avait deux traits caractéristiques : 1° c’était une monocratie (tous les pouvoirs étant concentrés entre les mains d’une seule personne, le Premier Consul) ; 2° c’était un régime totalitaire, dans la mesure où il interdisait toute opposition, personnelle ou organisée, et, à la limite, tout jugement individuel ou toute critique. Un tel régime ne peut durer qu’en se fondant sur l’action impitoyable d’une police puissante et tentaculaire, une censure rigoureuse et surtout une propagande systématique, qui dépersonnalise l’individu et le rend progressivement incapable de penser ou d’agir, sur le plan politique ou social, autrement que par référence aux normes et aux mythes distillés par cette propagande. Et c’est là (p.370) que le bât blesse l’âne, en l’occurrence Napoléon, du moins en 1800 : cette assistance policière est limitée numériquement, donc elle ne peut pas tout surveiller, et elle manque de moyens de communication et de stockage des informations. On frémit à la pensée de ce qu’auraient pu devenir l’Empire napoléonien, l’Empire soviétique ou le IIIe Reich si ces régimes avaient connu la civilisation électronique : heureusement pour l’Europe, Hitler n’avait à sa disposition que le télégraphe électrique et les ondes hertziennes, et Napoléon qu’une ou deux lignes de télégraphie optique et la rapidité de ses coursiers.
(p.372) À partir de 1804, toute une série de décrets vont créer des titres héréditaires, instituant ainsi une noblesse d’Empire, qui fit longtemps sourire, mais qui avait pour but non seulement de récompenser l’héroïsme des uns ou les services rendus à l’Empire par les autres, mais de cimenter le système : les « nobles » d’Empire et leurs descendants ne deviendraient-ils pas les plus fidèles défenseurs du trône des Bonaparte, tout comme les titulaires de la Légion d’honneur (créée en 1802) ? L’Empereur, Napoléon premier du nom, la Cour impériale et ses dignitaires, la noblesse d’Empire, telle fut la « distribution », le casting comme disent les anglomanes, de cette abominable tragi-comédie européenne que fut la brève histoire (1804-1815) du Premier Empire dont nous allons tenter, dans ce chapitre, de détruire les légendes les plus répandues, qui nous semblent être, toutes, des impostures, mis à part l’héroïsme et la bravoure des centaines de milliers d’hommes qui ont été abusés par elles jusqu’à en mourir. Ainsi donc, la France va retrouver, avec Napoléon, un régime monarchique d’un type spécial, celui d’un souverain qui n’a, en face de lui, aucun pouvoir à combattre. Il n’y a plus, comme au temps de la monarchie de droit divin dont Louis XVI avait été, alors, le dernier représentant, de parlements provinciaux, d’évêques, de traditions féodales, de corporations susceptibles de limiter l’omnipotence royale, et les traités signés avant la Révolution ne sont plus en vigueur. Napoléon peut tout dire, tout faire. Il n’a plus besoin de louvoyer, comme au temps du Directoire, et il ne craint plus personne, protégé qu’il est de près par sa garde, de loin par sa police secrète, ancêtre de la sinistre Gestapo1.
1 Abréviation de Geheimnisstaatspolizei, « police secrète d’État ». |
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.504) annexe n° 26 La police sous l’Empire
Fouché a créé la police moderne, aussi bien politique que criminelle. Sous son premier aspect, elle sera imitée, au xixc et au début du XXe siècle, par la Russie des tsars et par l’Autriche impériale, puis dans les années 30, par Mussolini, Hitler, Franco et autres assassins du genre humain ; Lénine et Staline ne copièrent pas Napoléon, ils se servirent de l’organisation que leur avaient laissée les tsars. Le système existe aussi dans nos modernes démocraties, amplifié par les progrès de l’informatique, mais il est plus feutré. Ils ont raison, les napoléophiles : Napoléon nous a laissé un bel héritage.
(p.505) 2. LA POLICE SECRÈTE
Ce fut l’institution la plus ignoble de l’Empire et l’on peut la comparer à la Gestapo allemande, aussi bien par son importance et ses ramifications, que par la nature de ses activités, qui consistaient en une inquisition systématique concernant non seulement les citoyens en vue – les politiques, les militaires, les fonctionnaires, les ecclésiastiques, les industriels, les financiers ou les intellectuels par exemple – mais aussi les particuliers, aussi insignifiants fussent-ils. Nous en connaissons bien les méthodes et leurs résultats par le patient et monumental travail accompli par Ernest d’Hauterive qui a publié les bulletins quotidiens que Fouché établissait pour l’Empereur (E. d’Hauterive, La Police secrète (p.506) du Premier Empire, bulletins quotidiens adressés par Fouché à l’Empereur, Paris, 1908-1964, 5 gros volumes dont les deux derniers ont été publiés par Jean Grassion) : ils contiennent près de 4 000 synthèses policières (une par jour pendant dix ans), portant sur des centaines de milliers de personnes ou d’affaires. La Grande Armée qui partit mourir en Russie comptait peut-être 700 000 ou 800 000 hommes ; Fouché disposait, lui aussi, d’une Grande Armée de l’ombre, composée de dizaines de milliers de policiers, d’inspecteurs, de limiers, d’informateurs, d’indicateurs, d’espions, de mouches, professionnels ou collaborateurs occasionnels, qui, dans chaque rue de Paris, dans chaque commune aussi petite fût-elle, dans tous les lieux publics, chez tous les grands de l’Empire, dans les consulats et dans les ambassades, à l’étranger comme en France, observaient, guettaient, notaient tous les événements, suspects ou non, auxquels ils assistaient, écoutaient les propos des dîneurs dans les restaurants, des buveurs dans les cafés, et, inlassablement, rédigeaient d’innombrables fiches de police qui prenaient le chemin des gendarmeries dans les campagnes, des commissariats dans les villes et qui finissaient sur les bureaux du préfet de police à Paris, des secrétaires généraux des trois autres arrondissements policiers de la France. Toutes ces informations, convenablement mises en ordre, rapprochées et comparées faisaient, chaque jour, l’objet d’un rapport de synthèse de la part du préfet de police, des conseillers d’État chargés des arrondissements de police, des colonels de gendarmerie, des commissaires spéciaux ; la synthèse finale parvenait entre les mains de Pierre-Marie Desmaret, un curé défroqué qui était devenu le chef de la Sûreté, c’est-à-dire de la division de la police secrète, au ministère de la Police générale, qui y apportait quelques perfectionnements, quelques touches personnelles, et venait les proposer à Fouché. La minute, ainsi corrigée, était recopiée en deux exemplaires : l’un restait au ministère de la Police, l’autre était porté à la secrétairerie d’État impériale et remis en mains propres, par Fouché lui-même, au secrétaire d’État impérial, c’est-à-dire au chef de cabinet de Napoléon, Hugues-Bernard Maret, où qu’il soit, à Paris ou à Dresde, à Saint-Cloud ou à Milan. C’est ainsi que tous les soirs, l’Empereur pouvait prendre connaissance de cette feuille, appelée Bulletin de Police. À vrai dire, Fouché avait eu l’idée du Bulletin lors de son premier passage au ministère de la Police, avant 1802, mais il n’avait pas eu le temps, à l’époque, de constituer cette énorme chaîne d’informateurs et d’espions à laquelle nous venons de faire allusion ; à partir de juillet 1804, il allait pouvoir constituer de fabuleuses archives politiques et policières.
|
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
(p.286) / 1810, la paix/ Sur cette France énorme règne un despote. Devant lui tout tremble, y compris sa famille gorgée d’honneurs. André Castelot a raconté comment, un jour, Napoléon insulta tous ses collatéraux : « Lucien est un ingrat, Joseph un Sardanapale, Louis un cul-de-jatte, Jérôme un polisson!» Puis, traçant un cercle avec sa main: «Quant à vous, mesdames, vous savez ce que vous êtes.» Personne ne broncha. Personne ne bronche en France. Le brillant de l’épopée légendaire fera oublier le régime policier.
Les décrets de 1810 n’autorisent qu’un journal par département et quatre à Paris, et l’un de ceux-ci, le Journal de l’Empire, ôté à ses fondateurs, est dirigé par le ministre de la police. Chacune des branches de l’administration a une partie qui la subordonne à la police. Fouché, hostile au mariage autrichien, a été remplacé par Savary et, pour plus de sûreté (Fouché avait été trop puissant), Napoléon a voulu, hors du ministère de la police, une police particulière à chacun des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la Guerre, de la place de Paris; plus la police particulière de l’Empereur, des agents qui ne servent que lui, sans intermédiaire. Il y a certes des opposants, des mécontents, mais ils parlent bas, car on sait que se trouvent dans les prisons d’État de Vincennes, du Mont Saint-Michel, de Joux, de Lourdes, du château d’If, des gens qui ont été poussés là sans jugement.
Tout cela n’empêche pas que le 20 mars 1811, lorsque Ie canon commence à tonner à Paris, « la capitale retient son souffle ». Si Marie-Louise donne le jour à une fille, vingt-et-un coups de canon; si c’est un garçon, cent un coups. Au vingt-deuxième coup, à Paris, les gens s’embrassent dans les rues, et partout en France, la nouvelle connue, les gens poussent des hourras. Les Français – d’autres peuples aussi – ont toujours préféré les souverains qui les ont tenus à leur botte, leur laissant des souvenirs glorieux et leurs yeux pour pleurer. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.69) Le 18 Brumaire, c’est le vrai retour à l’ordre, si gravement endommagé depuis le 10 août 92 ; c’est la populace contenue comme il faut, dupée comme il faut (Bonaparte a toujours préféré la ruse à la force). On criera « Vive la République » pour étrangler la République. Et ce sera enfin la paix du cœur pour les possédants, les fournisseurs et les banquiers, à l’abri désormais, sous un sabre, de toute entreprise délétère.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.78) La « restauration de l’Etat » (style Madelin), comment s’accomplit-elle ? La Constitution de l’an VIII a ceci de particulier que le peuple, désormais, et de par la loi, n’a plus la parole. Le Premier Consul détient la plénitude de l’exécutif. Le peuple n’élit plus de représentants. On prie simplement les gens les plus distingués du pays — c’est-à-dire les plus riches [1] — de proposer, de recommander, des listes de notables parmi lesquels sont choisis les membres des deux assemblées maintenues en trompe-l’œil. (p.79) Le personnel de ces Conseils sera recruté par un Sénat, lui-même composé par les soins exclusifs du Premier Consul. Le Tribunat pourra discuter les projets de loi (dont l’initiative appartient à Bonaparte, et à lui seul). Discuter, non pas voter ; ses parlotes, en conséquence, seront dénuées de tout effet. Le Corps législatif, lui, devra voter, mais non discuter. Pure chambre d’enregistrement. Et si, par impossible, le Corps législatif votait mal, le Sénat est là pour intervenir, car il a la garde de la Constitution et du bien de l’Etat. C’est la disparition radicale de la République, le régime républicain étant celui, spécifiquement, où la nation gère ses affaires. La nation n’a plus désormais qu’à se taire, exception faite des quelques « notables » autorisés à exprimer des vœux concernant, sans plus, le choix des serviteurs que désignera le maître pour l’approbation officielle de ses actes. De la Constitution-Robespierre à la Constitution-Bonaparte, abolition de la démocratie. C’est le couvercle qui retombe, avec un poids accru, sur le Quatrième Etat, la masse des Français, travailleurs des champs et des manufactures dont le destin, confirmé, est de poursuivre sa mission : « nourrir », dans le mutisme et le labeur, les privilégiés de ce « petit nombre » béni par Voltaire. « Despotisme éclairé » à la mode consulaire. Les disciples de l’Encyclopédie sont aux anges ; et Cabanis le voltairien, qui avec ses collègues Monge, Berthollet, Volney, Laplace, se déclare « patriote conservateur », (p.80) Cabanis applaudit ardemment à l’ordre nouveau, car, dit-il avec force, la « classe ignorante » ne doit exercer « aucune influence ni sur la légis- lation ni sur le gouvernement ». Le « régime tonifiant » mis en place par Bonaparte forme un système pyramidal ; la nation est organisée comme une caserne ; le 17 février 1800, Bonaparte jette sur la France son filet de rétiaire : dans chaque département, son homme à lui, nommé par lui, responsable devant lui : l’œil du maître, le préfet. Au-dessous du préfet, les sous-préfets, également nommés par lui. Et au-dessous des sous-préfets, les maires, également encore nommés par lui. La presse ? L’arrêté du 17 janvier a supprimé soixante journaux sur soixante-treize. Il n’en reste donc que douze (le treizième étant le Moniteur) qui ne publient rien sans le contrôle de la police. Quant à l’ordre judiciaire, le 26 juin 1804, à Saint-Cloud, Bonaparte sera péremptoire : les juges ? Leur devoir est d’obéir aux volontés du gouvernement.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.93) Elle est bien connue, l’interjection de la « mamma » devant la réussite, en France, de son « Nabou » : « Pourvu que ça dure ! » Elle prononçait cela à l’italienne, celle qui devient « Madame Mère », quand le plus débrouillard de ses garçons se hisse, en 1804, carrément, sur le trône de France. Ce n’est pas une vieille dame ; c’est une personne de cinquante-quatre ans, peu bavarde, qui pince les lèvres, et qui garde la tête froide. Inouï, ce qu’il leur arrive à tous, toute la bande ajaccienne, jadis famélique, à présent qui nage dans l’or ! Tellement inouï que ça n’a pas l’air vrai, que ça va peut-être s’évanouir comme un rêve. Pourvu, pourvu qu’une telle félicité n’aille pas soudain disparaître ! Pourvu qu’elle dure, oui, tant c’est merveilleux de se trouver (p.94) ainsi, invraisemblablement, catapulté au sommet de la vie sociale et parmi toutes les jouissances de la terre ! Difficile de croire qu’une pareille aubaine puisse offrir longtemps ses délices. Aussi thésaurise-t-elle, la mamma, avec une parcimonie attentive et méticuleuse. Cette « femme de Plutarque », comme dit l’autre (= /Louis Madelin/) admire le champion de la famille, mais elle n’oublie pas qu’elle est pour quelque chose dans ce prodige de bonheur ; car c’est bien à elle, en dernière analyse, que le clan doit sa fortune ; pas à son mari, le chenapan ; à elle, la petite rusée. Comme elle a bien fait, adultère, de coucher, avec le gouverneur Marbeuf ! Tous les profits de la tribu, au fond, sont sortis de cette alcôve. C’est elle, la poule aux œufs d’or.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.95) Au lendemain de Brumaire, il avait réduit à treize, y compris le Moniteur, les journaux autorisés. Insuffisant. En 1803, il a ramené leur nombre à huit ; ces huit journaux totalisent 18 630 abonnés, sur 27 à 28 millions de Français. Telle est la diffusion de la presse, sous le Maître. Encore, cette vaste presse, convient-il de la contrôler de très près. Note de « l’empereur » à Fouché, le 18 avril 1805 : « Il n’y a plus en France qu’un seul parti [le mien] et je ne souffrirai pas que mes journaux disent autre chose que ce qui sert mes intérêts ». L’imprimé même, tout ce qui peut s’imprimer sans que le texte en ait été dicté, ou revu, par lui-même ou ses sbires, lui est suspect. Et c’est à propos d’un innocent bulletin de la Chambre de Commerce de Paris que Napoléon aura, le 26 mars 1806, cette phrase remarquable : (p.96) « Une chose imprimée [seuls mon ordre ou mon visa], par le seul fait quelle est imprimée et quelle constitue un appel à l’opinion, n’en est plus un à l’autorité ».
|
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014
(p.7) I1 y a longtemps que la place prise par Napoléon Bonaparte dans l’imaginaire national m’intrigue. Longtemps que je m’interroge sur la gloire qui s’attache à son nom. Longtemps que je suis frappé par la marque qu’il a laissée dans notre histoire. C’est ce qui m’a incité à écrire ce livre.
(p.21) L ’Empire, un régime despotique et policier Le pouvoir bonapartiste naît d’un coup d’État indolore contre un régime corrompu, discrédité et faible, au cœur duquel il a bénéficié de complicités. Il suffit à ce pouvoir d’être résolu, rigoureux à l’intérieur et craint à l’extérieur pour être accepté et solide. Il l’est. Pourtant, le nouveau régime ne s’en tient pas là. Il devient très vite despotique et policier. Tout joue. La personnalité du chef : un soldat passionné, impérieux, impatient et qui ne supporte pas l’opposition. L’empreinte de pratiques autoritaires récentes, celles de la monarchie absolue puis de la dictature du Comité de salut public sous la Convention. La crainte d’un peuple turbulent qui vient de faire la Révolution. La volonté d’avoir le pays tout entier sous contrôle au moment de faire la guerre. Loin du règne des libertés annoncé par la Révolution à ses débuts, l’Empire sera despotique et même, selon nos termes d’aujourd’hui, dictatorial.
(p.21) Lorsque la menace pour le régime et son chef se fait directe et physique, la réplique est brutale. Le 24 décembre 1800, une « machine infernale » destinée au Premier consul explose et tue. Les « Jacobins » sont accusés, bien que les auteurs de l’acte – Fouché, le chef de la police, le sait – soient royalistes. Bonaparte n’en a cure et, au-delà de l’exécution des coupables, fait déporter sans instruction ni jugement cent trente personnalités, le plus souvent des anciens révolutionnaires (p.22) estimés hostiles. Cet épisode, dit des déportés de nivôse, est révélateur des méthodes de Bonaparte et du caractère que prend son pouvoir. Il l’est sur le fond, puisque des innocents (les « Jacobins ») sont condamnés ; dans la forme, puisqu’ils sont condamnés sans preuve et sans jugement ; dans l’état d’esprit, empreint de rancune, puisque les survivants, lorsqu’ils rentreront en France, seront brimés. (p.23) Le pouvoir est tout aussi implacable face à la protestation sociale. A Caen, en 1812, les prix du grain augmentant trop, des moulins sont pillés par la foule. Personne n’est brutalisé ou blessé, mais quatre mille soldats sont envoyés sur place, quatre émeutiers (dont deux femmes) sont passés par les armes. D’autres sont condamnés aux travaux forcés. Le contrôle sur la presse est absolu. Napoléon déteste la liberté de la presse et méprise les journalistes. Indépendants, ils lui déplaisent ; serviles, ils sont jugés sans intérêt. La presse, en particulier parisienne, est donc l’objet d’une rigueur constante. Nombre de feuilles sont interdites, d’autres sont victimes de regroupements forcés. Bien que leurs tirages soient très faibles, compte tenu du public de l’époque, les journaux inquiètent. On taille dans leur nombre : il y en avait soixante-dix à Paris en 1799, il n’en restera que quatre en 1814 ! En province, les préfets sont aussi sévères. La censure, supprimée par la Constituante, rétablie sous la Convention et théoriquement abolie par le Directoire, est officialisée par le Consulat et « perfectionnée » sous l’Empire. Elle n’épargne même pas les journaux favorables au pouvoir. Elle est à la fois préventive et répressive ; chaque journal a son censeur. Pour l’Empereur, il ne s’agit pas seulement d’interdire et de contrôler, il faut aussi que la presse soit son porte-voix. Ce sera le rôle du Moniteur. Cet organe, hiersubventionné par le Comité de salut public, puis contrôlé par le Directoire, est mis dans la main de Bonaparte qui en revoit tous les textes importants. A partir de 1807, il est spécifié que les journaux et gazettes locaux devront tirer leurs informations exclusivement du Moniteur. Ce véritable «journal de l’Empire» sera également diffusé hors de France. La même attitude vaut pour l’édition. Là aussi la censure, abolie en 1789, avait été rétablie en 1793. Bonaparte, dès son arrivée au pouvoir, impose à l’imprimerie et à la librairie une censure répressive inflexible. Justine de Sade, Les Martyrs de Chateaubriand, De l’Allemagne de Mme de Staël feront l’objet des plus célèbres interdictions. Un décret de 1810 précise qu’il « est défendu de rien imprimer et de faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l’intérêt de l’État». À l’instar des « sujets » – notons qu’on ne parle plus ici de citoyens -, les éditeurs, comme les journalistes, n’ont le choix qu’entre l’éloge ou le silence. (p.24) La propagande est là pour indiquer la voie. Bonaparte en a compris très tôt l’importance, en fait dès qu’il s’est posé la question de la conquête du pouvoir. Lors de la campagne d’Italie, en 1796, le jeune général utilise les bulletins de l’armée d’Italie et ses comptes rendus au Directoire comme autant de proclamations à sa gloire destinées à séduire l’opinion publique en France. Cela l’aidera à supplanter ses rivaux, autres généraux victorieux, notamment ceux de la campagne d’Allemagne prêts eux aussi à offrir leur personne, quand le Directoire aux abois et Sieyès rechercheront « une épée ». Napoléon va aller plus loin que Bonaparte. Par tous les instruments à sa disposition – la presse, le livre, l’affiche l’enseignement, l’Église, l’armée, les beaux- arts ou l’opéra – il se fait glorifier : il est l’héritier d’une Révolution qu’il a su clore, le rempart contre les Bourbons, l’homme providentiel garant de l’ordre en France, le héros de la « Grande Nation » vouée à la conquête. On attribue l’ascendant exercé par Napoléon sur le peuple à un charisme personnel et à une autorité naturelle. Ils sont réels. Mais on oublie que ce charisme est méthodiquement construit avec tous les moyens de l’époque. On est déjà dans la légende… Le travail de glorification de Napoléon ne néglige ni l’enseignement ni les arts. Dans les lycées, les professeurs sont astreints à des obligations de fidélité à l’Empereur et à la monarchie impériale. On est loin du libre exercice de la raison prôné par les hommes des Lumières ! L’obéissance fait partie du statut des enseignants, et les plus importants d’entre eux doivent rester célibataires, comme si aucune vie de famille ne devait les distraire de leur mission qui est d’enseigner et de servir. (p.25) L’art aussi est enrôlé. L’Empire met de l’ordre dans les Salons de peinture, et l’Empereur fait savoir son désir de voir les artistes contribuer à la glorification du règne. En 1808, Napoléon vient au Salon et décore lui- même David et Gros, dont certaines des œuvres, il est vrai, l’ont bien servi. Dans la sculpture, les commandes officielles se multiplient et les artistes se plient au goût de Napoléon pour la grandeur et à sa préférence pour l’uniforme sur le nu. L’Opéra n’est pas oublié. L’Empereur y fait des apparitions théâtrales. S’il s’y endort parfois, lui qui aime surtout, hors les marches militaires, la musique italienne, il apprécie qu’on le flatte et, à défaut, y veille. Le Triomphe de Trajan, de Lesueur, représenté en octobre 1807 avec un grand succès, est un hymne à l’Empereur tiré de l’histoire antique. Dans Y Alceste de Gluck, une scène à la gloire de la dynastie est ajoutée à sa demande. Mais la gloire, l’autorité et la propagande ne suffisent pas. Le régime utilise systématiquement la police à des fins politiques. On a souvent associé à Fouché la création et l’expansion du système policier sous l’Empire. C’est mérité. Fouché, en 1793, s’était signalé à Lyon, avec Collot d’Herbois, comme représentant en mission de la Convention, en organisant des massacres, et il avait irrité Robespierre. Il se cache. 11 fréquente les couloirs du Comité de salut public pour apporter des renseignements aux nouveaux amis que sont pour lui Barras, Tallien et Carnot, et contribue à la chute de Robespierre. Ce sera en quelque sorte son initiation policière. Inquiété (pour un curieux rapprochement avec Babeuf), amnistié après l’insurrection du 13 vendémiaire réprimée par le jeune général Bonaparte, Fouché rentre en grâce et est nommé ministre de la Police générale par le Directoire. (p.26) Napoléon Bonaparte, qu’il a aidé lors du coup d’Etat de brumaire, le conserve comme ministre de la Police sous le Consulat. Sa mission première est de surveiller l’opinion, grâce à la police politique. Il la perfectionne et se rend indispensable à Napoléon – qui pourtant se méfie de ses intrigues. Parfois démis, bientôt rétabli, il est, après la chute de l’Empire, fugitivement ministre de la Police aux Cent-Jours, puis l’est à nouveau, sous Louis XVIII. Il a incarné l’âme policière du régime impérial. Mais ce recours à la police politique n’est pas propre à Fouché. Savary, à qui l’Empereur avait un temps confié le commandement de la gendarmerie d’élite, sa garde personnelle, et qui sera l’agent actif de l’exécution- assassinat du duc d’Enghien, agit pareillement. Il manifeste le même zèle que Fouché, dans un style moins oblique et plus brutal, quand il le remplace au ministère de la Police générale. Napoléon Bonaparte partage leur inclination. Il est un lecteur attentif des bulletins de la police qui lui sont quotidiennement adressés par le ministre et qui montrent comment est assurée la surveillance de la vie politique et sociale. Il maintient la pratique, héritée de l’Ancien Régime, de ce qu’on a appelé le « Cabinet noir ». Ce véritable bureau de police politique, indépendant du ministère de la Police générale, est rattaché à la Poste. Son directeur général, totalement dévoué à l’Empereur dont il est le neveu, dirige personnellement cette officine qui pratique activement le viol des correspondances. Ce sera d’ailleurs un trait constant du courant (p.27) bonapartiste de mêler le culte de la gloire et l’attrait pour les opérations de basse police. D’où la tradition de certains « cabinets noirs »… Il ne faut naturellement pas se représenter le régime politique napoléonien sous son seul angle policier. Son assise sociale sera longtemps assurée et ses soutiens politiques seront nombreux tant que son chef apparaîtra comme un vainqueur. (p.28) L’Empire va durcir la législation du travail. Le livret ouvrier, dont le titulaire ne doit pas se séparer, s’il se déplace – sous peine d’être accusé de vagabondage -, est rétabli. Le Code civil précise qu’en cas de litige sur les gages, « le maître est cm sur ses affirmations ». Les ouvriers sont soumis à leurs patrons. (p.37) Troisième catégorie de prébendiers : les grands maréchaux ou généraux d’Empire. Napoléon tient à s’assurer de leur fidélité sans faille. Beaucoup sont depuis le début ses compagnons d’armes. Les titres, les gratifications de terres et les riches émoluments les combleront. Surtout, ils ont été invités à s’enrichir de leurs conquêtes. Dans sa célèbre déclaration du 27 mars 1796, le jeune chef de guerre de l’armée d’Italie avait dit à ses soldats : « Je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesses. » C’était une véritable invitation au pillage ! Ainsi, au classement des chefs militaires en fonction de leur bravoure, de leur habileté au combat ou de leurs hauts faits pourrait s’ajouter une autre hiérarchie, celle de leurs pillages. Si Suchet et Davout furent sans doute à la fois les meilleurs soldats et les plus honnêtes, Soult et Masséna furent parmi les plus discutés et les plus corrompus. (p.39) D’ailleurs, si la femme est une mineure dans le Code civil, elle l’est aussi, pour l’Empereur, dans la société ou dans la sphère de l’esprit. Les filles et les femmes n’auront pas accès au lycée et à l’université sous l’Empire. Aucune femme ne sera jugée digne de recevoir la Légion d’honneur. Sans doute n’y pensa- t-on même pas, alors qu’on ouvrait des maisons pour l’éducation des tilles de légionnaires. (p.68) Pour notre pays et pour le politique Bonaparte, tes conséquences de cette campagne vont être majeures. Le 23 août 1799, jugeant qu’il n’a plus de véritable intérêt à rester avec ses hommes, Bonaparte reprend la mer et, le 8 octobre, il débarque à Fréjus, auréolé d’un prestige que sa propagande a soigneusement servi. C’est la première fois qu’il abandonne ses soldats dans un moment difficile. Il le refera deux fois : en Espagne, au cœur d’une impasse, et en Russie, lors d’une tragédie. Il place ses ambitions politiques avant ses devoirs de soldat. Un mois à peine après son retour à Paris, grâce (p.73) Les prises artistiques – et l’on sait ici le rôle joué par Vivant Denon – sont également emblématiques. L’enlèvement des chefs-d’œuvre dans les pays conquis était d’usage courant et il a duré fort longtemps. Les musées européens sont chargés d’œuvres qui proviennent des butins des guerres sur le continent comme des razzias coloniales. Déjà, le Directoire avait prélevé des chefs-d’œuvre en Belgique, puis en Italie. Nos musées et les salons avaient fait une place nouvelle aux pièces des écoles flamande et italienne acquises gratuitement. Le Consulat et l’Empire enrichiront ces collections, année après année, au rythme des conquêtes. Le musée Napoléon, nom donné après coup au Muséum français ouvert au Louvre en 1793, (…).
(p.74) Un chef peu soucieux de ses hommes Dans un régime tourné vers la guerre et au sommet duquel Napoléon entend décider de tout – les historiens précisent qu’il aimait entrer dans le moindre détail -, il n’est pas fortuit que l’administration militaire soit si défaillante. Cela veut dire qu’elle intéresse peu Napoléon. Si les payeurs sont intègres et protègent leurs caisses, même près des combats, les commissaires de guerre n’ont ni leur zèle ni leur intégrité. Ils sont chargés des approvisionnements, de la mise en place des hôpitaux, des convois militaires, de l’habillement, des vivres. Leur rôle est donc essentiel. Or, il y a parmi eux beaucoup de concussionnaires et des fortunes sont édifiées qui coûteront des milliers de morts. Le soldat napoléonien est constamment mal nourri, mal vêtu, mal soigné et même mal armé. D’où la soupape de sécurité du pillage. Napoléon semble avoir pris son parti de tout cela. La priorité va au combat et à la recherche de la victoire. Le reste importe peu. L’affection et la sollicitude de Napoléon pour ses soldats relèvent de la légende – une légende systématiquement et adroitement entretenue -, et non de la réalité, beaucoup plus crue, plus froide. Si Napoléon paye de sa personne, s’expose sans précaution quand l’examen d’une position ou le suivi de ses ordres l’y conduisent, s’il sait faire des gestes qui galvanisent, il n’a guère le souci des hommes. (p.75) La condition du soldat n’est pas sa préoccupation. Son exigence est d’avoir des soldats à l’heure pour la bataille. Son mode de combat fondé sur le mouvement et la rapidité, servi par des décisions d’exécution prises aussi tard que possible (pour intégrer les choix de l’ennemi et s’adapter à des situations changeantes), impose souvent aux combattants de longues marches forcées accomplies le ventre creux. Étrangement, l’état dans lequel ces hommes arrivent au feu n’est pas, semble-t-il, pris en compte. L’intérêt peu marqué porté par Napoléon au service de santé de ses armées est également révélateur. Certes, il faut avoir à l’esprit la faiblesse des connaissances médicales de l’époque : on ne sut qu’en 1909, par exemple, que le typhus se transmettait par le pou. Ce mal sera le compagnon constant de la Grande Année et il se répand de façon foudroyante après la retraite de Russie. La majeure partie des morts des guerres de l’Empire n’est pas survenue sur les champs de bataille mais à cause des blessures terribles dues à l’usage massif de l’artillerie de part et d’autre ou aux maladies contractées et propagées dans des hôpitaux de fortune aux conditions hygiéniques effroyables. Cela aussi, c’est mourir à la guerre… (p.76) Percy, homme courageux et esprit indépendant, est successivement chargé des services de santé militaire de la République et de l’Empire. jusqu’en 1809. Son souci majeur est de sauver les blessés (en 1800, il fait proposer en vain aux Autrichiens l’inviolabilité des ambulances). Il suggère à Napoléon une meilleure organisation de la chirurgie aux armées, sans être écouté. Larrey organise les ambulances volantes qui sillonnent les champs de bataille pour ramener les blessés vers l’arrière afin de les opérer et de les soigner. En 1805, l’Empereur lui interdira toute évacuation avant la fin de l’action ! Coste, qui s’est battu pour le maintien des hôpitaux militaires, introduit la variolisation aux armées. Mais il le réalise sans véritable soutien de l’Empereur. (p.95) L’expérience de l’État modèle sera pourtant conduite à l’échec. En effet, l’Etat est pressuré financièrement par la France et la moitié des terres domaniales est donnée en propre à l’Empereur (pour doter ses grands serviteurs (…).
|
|
Poggio-di-Nazza, in: Corse-Matin, 29/07/2013
XVIIIe siècle. Sous la férule du général Morand, la « pacification » est terrible en Corse, y compris à Poggio où un rapport envoyé à Napoléon en 1803 précise qu’il ne reste plus rien du village incendié . |
|
San Gavinu di Fiumorbu, in : Corse-Matin, 28/07/2013
1808. Le général Morand décide de déporter 170 personnes. 15 sont exécutées à Bastia. Les autres ne revirent jamais leur terre.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988
(p.94) It is too easily forgotten that the Consulate was a police state from the very beginning. On 26 Brumaire, a week after the coup, 59 Jacobins were proscribed; 22 were sent to a species of concentration (p.95) camp on the Ile d’Oléron, and 37 were transported to the Iiving hell of Guiana. The machinery of repression was constantly reinforced. Admittedly, Bonaparte had inherited much of it from the Directory, and could not survive without such repression. He was menaced by royalists, the ‘Chouan’ guerrillas of Brittany and the Vendée against whom he sent troops. The Comte de Frotté was lured into an ambush by the promise of a free pardon, and sum- marily shot. ‘I didn’t order it but I can’t say that I’m sorry for his execution’ was Napoleon’s comment. Although most of the Chouan leaders surrendered in 1801, the irreconcilables went underground, posing an even worse threat, since they concen- trated on the assassination of the First Consul; among their allies were a whole host of returned émigrés and royalist sym- pathizers, while they included some leaders of real distinction – notably Georges Cadoudal. There were also many Jacobins, former terrorists, who were no less determined to bring down the régime, which would not be really secure until the victory at Marengo in the summer of 1800. Stendhal believed that Bonaparte hated the Jacobins more than anyone else – though he had once been a Jacobin himself. He survived largely because Fouché ran an extremely efficient security service, employing not only police but a swarm of spies, informers and secret agents. He used money, free pardons and countless other inducements, just as he did midnight arrests, brutal interrogation and the threat of transportation, the guillotine or the firing squad. He had two gifted assistants in the ex- Jacobins Charles Desmarets, a former seminarian who was his police chief, and Pierre-François Réal; both had a genius for extracting confessions, the former by blandly questioning, the latter by less gentle means. The First Consul had a very high opinion of Réal in particular. (p.98) He soon found the Constitution of 1799 far too liberal. Sieyès and his friends were powerless to stop him, and he grew more like a monarch every day. Court dress reappeared, with knee-breeches and cocked hats for men who had only recently affected the trousers of sans-culottes. However, he wanted the substance as well as the trimmings of authority. In 1801 the legislative chambers opposed a bill against ‘anarchists’ which would hâve enabled him to arrest anyone he chose. Even after new élections had been rigged to make them more biddable, they refused to appoint him First Consul for Iife, offering ten years instead. Although it had no constitutional right to do so, the régime held a plebiscite – ‘Is Napoléon Bonaparte to be made Consul for Iife?’ After a well-organized vote in favour – and not uninfluenced by the sight of grenadiers ringing the Luxembourg – the Senate surrendered; in addition it gave him the right to appoint his fellow-Consuls and to nominate his successor, together with machinery for suspending the Constitution and overturning legal rulings by the courts. He now possessed absolute power, civil and military, and was above the law.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988
(p.105) (…) For all his self-confidence, the Emperor used every means available to bolster up his regime and discourage dissent. The Church was forced into yet more humiliating compliance. (Cardinal Caprara, the Papal Nuncio, was sweetened by the gift of a palace in his diocese of Bologna.) A servile catechism taught French Catholics that they owed Napleon ‘love, respect, loyalty,military service and the taxes specified for the maintenance of the Emperor and his throne’, that those failing to do so ‘resist the order laid down by God and render themselves worthy of eternal damnation.’ The feast-day of St Napoleon, a ‘Roman officer and martyr’ who never existed,was introduced into the litugical calendar.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988
(p.228) Needless to say, everything was much worse in the conquered territories than in France. Brute force was used to cow initial opposition to French occupation, calculated atrocities subsequently holding down the population. Napoleon welcomed shows of defiance since it enabled him to identify opponents and break their résistance. The rising in Madrid in 1808 and Murat’s savage suppression of it was exactly what he wanted. The same year he informed his brother Joseph, who he had installed as King of Naples, ‘I would like the Neapolitan mob to try a rébellion. So long as you haven’t set an example you won’t be their master. Every conquered country should hâve its rising.’ Spanish résistance was met with savage reprisals, even subjugated areas seeing the ghastly executions of the sort portrayed in Goya’s horrible drawings. The French conquerors were scarcely less brutal in Southern Italy, hanging, burning and looting even if Napoleon’s gauleiters – his brother Joseph and Murat, whom he made kings – did not impose a new French nobility as he wished. Plunder was on a vast scale in Spain, Portugal and Naples, marshals such as Soult anticipating Goering in their greed for works of art.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.98) « Les jacobins sont éliminés. ( » des gens à pisser dessus », disait « l’empereur » dans ce langage élégant qui lui était ordinaire), … »
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris
(p.122) Le « régime tonifiant » se perfectionne. Le nombre des journaux autorisés, ramené à treize en 1800 et à huit en 1803, descend à quatre en 1811. Si la presse s’étiole, les prisons, en revanche, prolifèrent; quatre de plus, dites ouvertement « prisons d’Etat « , apparaissent en 1810; ce sont des « internements administratifs » qui les peuplent, sans explication ni jugement; faits du prince. La France est régie, sous l’Empire, par une «loi des suspects » non écrite; et Napoléon Bonaparte utilise également les maisons d’aliénés pour y faire disparaître sans bruit ceux qui le gênent ou l’inquiètent.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.122) Le royaume d’Italie rapportait à son souverain 30 millions par an, inscrits au budget français ; mais ce n’était là que chiffres officiels. Napoléon a fait d’Eugène, son beau-fils, le vice-roi de l’Italie ; Eugène est un timide qui n’ose « réquisitionner » dans ce pays qu’il administre, et Napoléon le rudoie, le 22 septembre 1805 : qu’est-ce que c’est que ces scrupules imbéciles ? Des réquisitions ? Mais parfaitement ! « j’en fais bien en Alsace ». La suite est magnifique : « tout est si cher qu’il ne faut pas songer à payer ». Allez ! Allez ! Prenez ! « on crie, mais c’est sans importance ». Lorsque l’on remuait sous sa botte, il donnait des coups de talon ; le 26 août 1806, il a fait fusiller un libraire de Nuremberg, Palm, coupable de diffuser des brochures en faveur de la résistance ; et, quinze jours après avoir nommé Joseph roi de Naples, il lui écrivait (2 mars 1806) : « Mettez bien ceci dans vos calculs que [d’un moment à l’autre] vous aurez une insurrection ; cela se produit toujours en pays conquis » ; mais quand on sait s’y prendre, les émeutes de mécontents, cela s’écrase sans peine ; quelques exemples, des représailles, deux ou trois Oradour et c’est réglé. Tenez, i lui dit-il, moi, « Plaisance s’étant insurgé, j’ai envoyé l’ordre de faire brûler deux villages et de passer par les armes les chefs, y compris six prêtres ; le pays fut soumis, et il le sera pour longtemps ». Vos révoltés de Calabre, faites-en exécuter (p.123) « au moins 600 » ; « faites brûler leurs maisons, faites piller cinq ou six gros bourgs ». Voilà la méthode, bien simple. Un document vient de m’être mis sous les yeux ; c’est une lettre de Berthier, « prince de Wagram et de Neufchâtel », au maréchal Soult, 7 septembre 1807 : « L’empereur me charge […] de vous expédier un courrier extraordinaire pour vous faire connaître l’événement arrivé à Koenigsberg où deux comédiens, paraissant sur le théâtre en officiers français, ont été sifflés. Sa Majesté a fait demander satisfaction de cette insulte au roi de Prusse, et que les deux principaux coupables soient fusillés ». « L’épopée » napoléonienne, gluante de sang, ne revêt toute sa dimension que si des chiffres l’accompagnent. Austerlitz ? 23 000 morts ; mais, quand on a le cœur bien placé, les cadavres d’Austerlitz disparaissent dans le soleil du même nom. Eylau ? 50 000 hommes tombent. Wagram ? Napoléon y bat son propre record (55 000 tués), qu’il surpassera à Borodino, gala qui coûte aux deux armées quelque 80 000 soldats. Sur les services sanitaires dans l’armée impériale, il faut lire le journal du chirurgien Percy : le matériel est dérisoire, le personnel presque inexistant ; les amputations se pratiquent sans anesthésie ; la gangrène s’installe ; le blessé grave, dans la Grande Armée, est un condamné à mort ; Napoléon a interdit, du reste, de relever, pendant l’action, les hommes qui s’écroulent ; il se méfie des déserteurs, dont le nombre se multiplie. Mais (p.124) ne ternissons pas avec d’aussi misérables détails la « Chanson de geste » chère à M. Louis Madelin, lequel déclarait, dans son grand ouvrage « La France de l’Empire », réédité en 1960 par le Cercle Historia : « Mêlées, blessures, pour le soldat de l’empereur, tout cela n’est rien ; la bataille est une fête ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.69) Le 18 Brumaire, c’est le vrai retour à l’ordre, si gravement endommagé depuis le 10 août 92; c’est la populace contenue comme il faut, dupée comme il faut (Bonaparte a toujours préféré la ruse à la force). On criera « Vive la République » pour étrangler la République. Et ce sera enfin la paix du cœur pour les possédants, les fournisseurs et les banquiers, à l’abri désormais, sous un sabre, de toute entreprise délétère.
|
|
Jean Burnat, G.H. Dumont, Emile Wanty, Le dossier Napoléon, éd. Marabout, 1962
(p.333) Comme tous les dictateurs, Napoléon a la passion du décorum, de la mise en scène, et il s’y entend à flatter la vanité des hommes sur lesquels il doit pouvoir compter. La création de la Légion d’Honneur, « troupe d’élite » du régime, en témoigne à suffisance. A l’origine, le Premier Consul et les six grands officiers qui l’assistent commandent les « cohortes » de légionnaires, notables qui se sont signalés par des services exceptionnels. Mais la Légion ne tarde pas à devenir un ordre parmi d’autres avec ses grands cordons, ses colliers, ses croix. Aux membres du Conseil d’Etat qui lui reprochent de reconstituer ainsi des inégalités, Bonaparte répond sans ambages : « Je défie qu’on me montre une république ancienne ou moderne dans laquelle il n’y ait pas de distinctions. On appelle cela des hochets ! Eh bien ! c’est (p.334) avec des hochets que l’on mène les hommes ! Je ne dirais pas cela à une tribune; mais dans un conseil de sages et d’hommes d’Etat, on doit tout dire. Je ne crois pas que le peuple français aime la liberté et l’égalité,.. Il leur faut des distinctions. Voyez comme le peuple se prosterne devant les décorations des étrangers ; ils en ont été surpris ; aussi ne manquent-ils pas de les porter». Pendant le Consulat et l’Empire, quelque quarante-huit mille « hochets » seront distribués. Des hochets pour les adultes. Et pour la jeunesse des lycées, des uniformes bleus, des marches militaires et des tambours ! Tout le personnel de ces lycées, créés en 1802, est nommé par l’Etat et hiérarchisé sous le contrôle d’administrateurs particuliers. Programmes et horaires — ceux-ci réglés au tambour — sont identiques dans l’ensemble des établissements. Le dessein de Napoléon est évidemment la création d’un monopole d’Etat, mais ses ennuis financiers l’obligent à limiter ses ambitions à cet égard. Il doit laisser subsister de nombreux établissements privés, les écoles secondaires à charge des municipalités et l’enseignement des petits séminaires.
Le succès de ceux-ci inquiète Bonaparte qui entend fortifier l’esprit laïque. Le 17 décembre 1807, il écrit à Fouché : « Vous vous concerterez avec le sieur Portalis sur les moyens de dissoudre la Congrégation des Pères de la Foi, en cherchant les plus doux mais en même temps les plus efficaces ; étendes cette mesure à tout l’Empire. Vous aurez soin que ces individus n’aient aucun point de réunion et je vous rends responsable de l’existence de toute société de ces religieux. Serions-nous donc dans les temps de faiblesse et d’inertie où les volontés de l’administration ne pourraient être exécutées ?… Je ne veux pas de Pères de la Foi ; encore moins qu’ils se mêlent de l’instruction publique pour empoisonner la jeunesse par leurs ridicules principes ultramontains. » Mais la concurrence aux lycées n’en continue pas moins. Ne pouvant obtenir le monopole, Bonaparte recourt à la hiérarchisation de toute l’instruction publique. En 1808, il crée l’Université impériale placée sous l’autorité d’un Grand Maître dépendant directement de lui. Trois ordres d’enseignement sont instaurés — le primaire, le secondaire et le supérieur — et l’Empire est divisé en académies que dirigent des recteurs assistés d’inspecteurs et de conseils académiques. (p.335) Tout est prévu pour chacun : le grade, le costume, le traitement, les peines disciplinaires… Même l’instituteur est désormais nommé par l’Etat, sur proposition du conseil municipal. Ce détail de la centralisation pourrait faire croire à de la sollicitude à l’égard de l’enseignement primaire. En réalité, Napoléon ne se soucie pas de l’instruction du peuple et, à quelques exceptions près, les petites écoles ne seront pas plus fréquentées en 1815 qu’en 1789. C’est sur l’enseignement secondaire, celui destiné aux fils de la bourgeoisie, que veille surtout l’Empereur. Il en attend des fonctionnaires capables de peupler la hiérarchie administrative. Et il croit y parvenir en renforçant l’enseignement du latin et du grec, et en réduisant la philosophie à la seule logique…
|
|
Jean Burnat, G.H. Dumont, Emile Wanty, Le dossier Napoléon, éd. Marabout, 1962
(p.368) NAPOLEON ET LA LIBERTE INDIVIDUELLE
AU GENERAL BERNADOTTE Commandant en chef de l’armée de l’Ouest Milan, 15 Prairial an VII (4 juin 1800). « … Prenez mort ou vil ce coquin de Georges (Cadoudal). Si vous le tenez une fois, faites-le fusiller vingt-quatre heures après, comme ayant été en Angleterre après la capitulation. « Bonaparte »
AU CITOYEN ABRIAL Ministre de la Justice (Paris, 13 Brumaire an X (4 novembre 1801).
« Le Premier Consul me charge, citoyen ministre, de vous faire connaître de nouveau ses intentions à l’égard du citoyen Ducancel, défenseur officieux dont la conduite auprès du tribunal de Metz a été contraire au respect que les défenseurs doivent aux lois. « II vous invite à mander le citoyen Ducancel, à lui manifester le mécontentement du gouvernement et à lui enjoindre de ne plus porter la parole en présence d’aucun tribunal.
DECISION
A l’occasion d’un rapport sur l’acquittement, par le tribunal criminel de Loir-et-Cher, de dix-sept accusés que le commissaire du gouvernement a fait réintégrer dans la maison d’arrêt jusqu’à la décision ultérieure de l’autorité suprême. Saint-Cloud, 12 Vendémiaire an XII (5 octobre 1803). « Demander l’opinion du président et faire venir la procédure. En attendant les condamnés seront retenus en prison comme y ayant contre eux de nouvelles charges. On avisera ensuite aux moyens de porter l’affaire devant un autre tribunal.
« Bonaparte »
AU CITOYEN REGNIER
Paris, 17 Germinal an XII (7 avril 1804). « Vous trouverez, citoyen ministre, un rapport du citoyen Portails, relatif à des mouvements que se sont donnés plusieurs prêtres rebelles au moment même où se tramait une conspiration contre nous, mais les renseignements du citoyen Portalis sont loin d’être complets. Je sais que dans la Vendée il y a un certain nombre de prêtres qui ont refusé de reconnaître le Concordat, et je me rappelle que l’évêque de La Rochelle en avait dénoncé rleuf ou dix. « Dans le diocèse de Liège, il faut également prendre des renseignements et faire arrêter dix des principaux prêtres. Prenez aussi des mesures pour faire arrêter les prêtres qui sont portés dans les rapports du citoyen Portalis. Je veux bien être indulgent et consentir à ce que ces prêtres soient transportés à Rimini, mais je désire que vous me fassiez (p.370) connaître la peine qu’encourt un prêtre en place qui se sépare de la communion de son évêque et abjure un serment prêté. Dieu le punira dans l’autre monde, mais César doit le punir aussi dans celui-ci…
« Bonaparte »
AU MARECHAL SOULT
Commandant le camp de Saint-Cloud Saint-Cloud, 29 Prairial an XII (18 juin 1804).
« Le procès des conspirateurs a beaucoup excité le bavardage dans la ville de Paris. La sentence plus qu’indulgente qu’a rendue le faible tribunal de la Seine sera exécutée aussitôt que les délais du pourvoi en cassation seront expirés. Quoique j’aie fait grâce à plusieurs individus, il restera une douzaine de brigands qu’il n’est pas possible de gracier et qui devront subir leur sentence. Quant au général Moreau, s’il n’a pas été condamné à mort, il a eu un jugement flétrissant1.
« Napoléon »
A M. CAMBACERES
Lyon, 25 Germinal an XIII (15 avril 1805). « Mon cousin, je vous envoie un rapport très important qui m’est fait par le ministre de la police. J’ai donné ordre qu’on arrêtât tous les prévenus, qu’on mit des inscriptions sur leurs biens et le séquestre sur leurs magasins. Je désire savoir quelle loi les condamne et ce qu’il y a à faire pour les mettre en jugement ». Ces affaires sont d’une extrême importance. Ces messieurs faisaient la contrebande presque publiquement. « Napoléon »
A M. FOUCHE Rambouillet, 23 août 1806.
« Ecrivez au général Menou que lorsqu’il arrive qu’un homme arrêté pour avoir tenu des propos contre le gouvernement ou tenté de troubler la tranquillité générale est acquitté par les tribunaux,, il le fasse sur-le-champ écrouer de nouveau et vous en rende compte.
« Napoléon »
1. Deux ans de prison qui auront leur épilogue, en 1S13, à Leipzig. 2. Les italiques sont de la rédaction du Dossier.
(p.371) NAPOLEON ET LA LIBERTE D’EXPRESSION
AU CITOYEN FOUCHE Ministre de la police générale Paris, 15 Germinal an VII (5 avril 1800).
« L’intention des consuls de la république, citoyen ministre, est que le journal le Bien-Informé, celui des Hommes libres et celui des Défenseurs de la Patrie, ne paraissent plus, à moins que les propriétaires ne présentent des rédacteurs d’une moralité et d’un patriotisme à l’abri de toute corruption…
« Bonaparte »
AU CITOYEN FOUCHE Ministre de la police générale Paris, 18 Thermidor an IX (6 août 1801).
« Le Premier Consul désire, citoyen ministre, que vous lassiez connaître aux journalistes tant politiques que littéraires, qu’ils doivent s’abstenir de parler de tout ce qui peut concerner la religion, ses ministres et ses cultes divers. (Par ordre du Premier Consul). L’idée est plus forte que l’épée.
« Napoléon »
« Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement. Napoléon à Cambacérès.
A M. FOUCHE Stupinigi, 2 Floréal an XIII (22 avril 1805).
« Réprimez un peu les journaux, faites-y mettre de bons articles, faites comprendre aux rédacteurs des Débats et du Publiciste, que le temps n’est pas éloigné où, m’apercevant qu’ils ne me sont pas utiles, je les supprimerai avec tous les autres, et n’en conserverai qu’un seul ; que puisqu’ils ne me servent qu’à copier les bulletins que les agents anglais font circuler sur le continent, qu’à faire marcher sur la foi des bulletins les troupes de l’Empereur de Russie en Pologne, à contremander le voyage de l’Empereur d’Autriche en Italie ; à l’envoyer en Courlande pour avoir une entrevue avec l’Empereur de Russie ; puisqu’ils ne me servent qu’à cela, j’y mettrai bon ordre. (p.372) « Mon intention est donc que vous fassiez appeler les rédacteurs du journal des Débats, du Publiciste, de la Gazette de France qui sont, je crois, les journaux qui ont le plus de vogue, pour leur déclarer que s’ils continuent à n’être que les truchements des journaux et des bulletins anglais, et à alarmer sans cesse l’opinion, en répétant bêtement les bulletins de Francfort et d’Augsbourg sans discernement et sans jugement, leur durée ne sera pas longue, que le temps de la révolution est fini et qu’il n’y a plus en France qu’un parti ; que je ne souffrirai jamais que les journaux disent ni fassent rien contre mes intérêts ; qu’ils pourront faire quelques petits articles où ils pourront mettre un peu de venin, mais qu’un beau matin on leur fermera la bouche.
« Napoléon »
A M. FOUCHE Stupinigi, 4 Floréal an XII (24 avril 1805;.
« Toutes les nouvelles de mer sont bonnes. Faites imprimer quelques articles habilement faits, pour démentir la marche des Russes, l’entrevue de l’Empereur de Russie avec l’Empereur d’Autriche, et ces ridicules bruits nés de la brume et du spleen anglais. Remuez-vous donc un peu plus pour l’opinion. Dites aux rédacteurs que quoique éloigné je lis les journaux et que s’ils continuent sur ce ton je solderai leur compte ; qu’en l’an VIII je les ai réduits à quatorze. Je pense que ces avertissements successifs, aux principaux rédacteurs, vaudront mieux que toutes les réfutations. Dites-leur que je ne les jugerai point sur le mal qu’ils auront dit, mais sur le peu de bien qu’ils n’auront pas dit. Quand ils représenteront la France vacillante, sur le point d’être attaquée, j’en jugerai qu’ils ne sont pas français ni dignes d’écrire sous mon règne. Ils auront beau dire qu’ils ne donnent que leurs bulletins, on leur a dit quels étaient ces bulletins, et puisqu’ils doivent dire de fausses nouvelles, que ne les disent-ils à l’avantage du crédit et de la tranquillité publique? Oiseaux de mauvais augure, pourquoi ne présagent-ils que des orages éloignés ? Je les réduirai de quatorze à sept et conserverai non ceux qui me loueront, je n’ai pas besoin de leurs éloges, mais ceux qui auront la touche mâle et le cœur français, qui montreront un véritable attachement pour moi et mon peuple..,
« Napoléon »
A M. FOUCHE Milan, 30 Floréal an XIII (20 mai 1805).
« M. Fouché, mon intention est que désormais le Journal des Débats ne paraisse pas avant qu’il n’ait été soumis la veille à une censure. Vous nommerez un censeur qui soit un homme sûr, attaché et ayant du tact, auquel les propriétaires du journal donneront 12.000 francs d’appointements. C’est à cette seule condition que je permettrai que ce journal continue de paraître… Faites connaître cette mesure aux journaux, et prévenez-les que s’ils s’avisent de débiter des nouvelles par trop bêtes et dans de mauvaises intentions, j’en ferai autant de leurs feuilles.
« Napoléon »
A M. FOUCHE Bologne, 4 Messidor an XIII (25 juin 1805).
« Je vous prie de me faire connaître ce que c’est qu’une pièce de Don Juan qu’on veut donner à l’Opéra et sur laquelle on m’a demandé l’autorisation de la dépense. Je désire connaître votre opinion sur cette pièce sous le rapport de l’esprit public.
« Napoléon »
|
|
Martin Bril, De kleine keizer, Prometheus Uitg., 2009
(p.49) de Napoleonsbaan op de westelijke Maasoever tussen Maaseik en Blerick, vlak bij Venlo De weg is een kilometer of zestig lang. Hij werd door Spaanse krijgsgevangenen van Napoleon aangelegd om Noord- en Zuid-Limburg met elkaar te verbinden en het is nog steeds de belangrijkste route tussen de twee provinciehelften. Hij voert langs dorpen met stugge namen als Heide, Haelen, Neer, Hei en Kessel, van die plaatsen waar de huizen zijn opgetrokken uit donkerbruine bakstenen en voorzien van donkerbruine, metalen rolluiken.
|
|
Napoleon und seine Zeit, 1769-1821, in: Geo Epoche, 55, 2012
(S.70) Frankreich wird zum Überwachtungsstaat.
Denn ob nun von rechts oder von links: Er will jede Bedrohung möglichst früh ersticken. Und so verbietet er bereits gut zwei Monate nach seinem Staatsstreich auf einen Schlag 60 der 73 in Paris erscheinenden Zeitungen. Die Begründung: Die fünf Dutzend Publikationen seien allesamt ,,Werkzeuge in der Hand der Republikfeinde ». Seinen Polizeiminister Fouché lässt der Despot ein Netz von Informanten aufbauen. Bald sitzen die Spitzel in jeder Stadt, in jedem Dorf. Sie belauschen ihre Sitznachbarn in den Cafés, berichten von Kneipengesprächen, in denen Berauschte über das Regime schimpfen, beschatten Verdächtige und spionieren einflussreiche Personen aus. Agenten öffnen und lesen jedes Jahr Tausende Briefe und verschliessen sie wieder.
Von seinem Polizei-Hauptquartier an der Seine gegenüber dem Louvre orchestriert Fouché den Überwachungsapparat: Bald besitzt er ausführliche Dossiers über allz, die in Frankreich etwas zu sagen haben: Offiziere, Staatsbeamte, Minister, ja angeblich sogar über Bonaparte selbst.
Der Diktator, laut Fouché ,,der misstrauischste Mann, der je gelebt hat », schreckt auch vor offenem Gesetzesbruch nicht zurück, um seine Gegner auszuschalten.
So lässt er im Januar 1801 mehr als 90 Jakobiner ohne Verfahren in die Kolonien nach Übersee verbannen: als Vergeltung fur ein Bombenattentat, dem er am Weihnachtsabend 1800 nur knapp entkommen ist; er stoppt die Aktion auch nicht, aïs Fouché Beweise vorlegt, dass es in Wirklichkeit royalistische Regimegegner waren, die den Anschlag verübt haben.
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.120) During the Revolution, Fouché had suppressed an uprising in Lyon by having more than 1,600 locals lined up and blown to pieces by cannon fire, arguing that the guillotine would have been too slow. (Even Robespierre expressed his horror at the slaughter, which was a bit like Jean-Paul Sartre accusing someone of being too intellectual.) Fouché had defended himself by saying that ‘the blood of crime fertilises the soil of liberty’, which was the kind of slogan that went down well during the French Revolution.
|
|
www.clionautes.org/spip.php?article1518
Jean-Paul BERTAUD Quand les enfants parlaient de gloire, l’armée au cœur de la France de Napoléon mardi 21 août 2007, par Guillaume Lévêque
Ces enfants hantés par la gloire de leurs devanciers, ce sont ceux qui, frappés par la malédiction d’être nés trop tard, constitueront la phalange romantique. Jean-Paul Bertaud, universitaire spécialiste des soldats de la Révolution et de l’Empire, a voulu mettre en perspective cette nostalgie guerrière et en décrypter les racines. Cet ouvrage est le fruit de ses investigations. L’évidence d’une France napoléonienne où priment les militaires pourrait sembler borner le propos à une simple production commémorative, dans le flux d’un bicentenaire d’ailleurs d’autant plus occulté en France qu’il fait événement à l’étranger. La réflexion des futurs historiens des commémorations à la française s’annonce riche en paradoxes passionnants ! Or, au-delà de ces contingences, la synthèse proposée par Bertaud, qui fait le point sur les acquis de l’histoire socio-culturelle des armées impériales, a également le grand mérite de prendre le pouls de l’imprégnation de la société civile par les valeurs, les représentations et les rythmes du monde militaire. La rue, l’école, les loisirs, les cultes et les arts se mettent alors tous à marcher au pas cadencé des grognards. Professeur émérite à la Sorbonne, J.P. Bertaud est un des meilleurs spécialistes actuels de la Révolution et de l’Empire. Il a consacré une partie importante de ses travaux à l’armée qui est, de longue date, un de ses champs de prédilection. Ses travaux sur les soldats de la Révolution et de l’Empire sont d’ailleurs des références historiographiques incontestées. Élargissant cet angle d’approche, son dernier ouvrage en date est une synthèse envisageant la militarisation de la société française et de ses valeurs sous le Premier Empire. Il est placé sous le signe du spleen de la génération romantique, dont témoignent les élans mélancoliques d’un Vigny ou d’un Hugo. Leurs états d’âme ne sont-il pas le fruit du regret d’être restés en marge, parce que trop jeunes, de la grande épopée de leur siècle ? Thème rebattu, supposera-t-on, eu égard à la saturation séculaire du culte éditorial de Napoléon et de ses braves, relancé par le contexte du bicentenaire. Or, combinant ici les apports de la recherche récente et de références documentaires encore inédites puisées dans les archives et les imprimés d’époque, J.P. Bertaud parvient à élargir le prisme d’un chantier a priori saturé.
L’adhésion à un chef de guerre repose en bonne partie sur le lien rhétorique. Le rapport de Napoléon à la paix et à la guerre à travers ses discours de légitimation est donc le premier champ analysé. Puis, c’est la société militaire qui est ensuite passée au crible. La gratification est à la mesure des périls s’agissant des maréchaux, généraux et officiers. Leurs perspectives de carrière, leurs risques et pratiques de la guerre, leur système de l’honneur et la place globalement avantageuse qui leur est faite dans la pyramide sociale sont évoqués tour à tour. Ce tableau a pour contrepoint le regard jeté sur les hommes de troupe, au détriment de qui la balance est foncièrement défavorable. Au fardeau de la conscription et aux périls de la guerre, s’ajoutent les enjeux du retour à la vie civile, entre difficultés de réadaptation, réinsertion matrimoniale, statut précaire de « l’armée morte » des invalides, infirmes et déments de guerre, sans oublier le cas des veuves et des orphelins. Ce propos, très maîtrisé et très balisé par l’appui d’une historiographie étoffée, est le socle d’un panorama plus inédit brossant l’imprégnation du monde civil par les références guerrières.
Car l’horizon belliqueux qui est celui du système napoléonien nécessite un appui social constant et à la mesure des besoins humains et matériels croissants de l’effort de guerre. Pour ce faire, se déploie tout un éventail de modèles, discours et formes. Les modèles, ce sont d’abord ceux du culte de l’honneur, dans la perspective duquel la création de l’illustre décoration éponyme est conçue comme un paradigme de référence autant que comme une récompense. Ce sont aussi ceux de la pédagogie militarisée des lycées impériaux, viviers de futurs serviteurs de l’état. Les cérémonies de remise des prix s’avèrent de redoutables communions civiques et patriotiques. Les discours sont ceux de la propagande anglophobe (où Albion s’incarne en nouvelle Carthage) et de la « théologie de la guerre » professée unanimement par tous les cultes, à la fois reconnus et asservis. Les célèbres Bulletins de la Grande Armée, que Bertaud interprète judicieusement comme une Illiade napoléonienne, sont le vaisseau amiral d’une profusion d’écrits de presse empressés et de pensums de littérature sous les armes. Le théâtre se mue en un véritable « ministère de la gloire », où la guerre et la vie des camps sont des thèmes ou des décors fréquents du spectacle. Le quotidien se meuble d’objets en uniforme : petits soldats en papier pour les enfants (instruments des premières exaltations des jeunes Alfred et Victor ?), objets décoratifs ou utilitaires à motifs militaires, sans négliger le premier « jeu de guerre » sur plateau, conçu par l’éditeur parisien Cramer !
La mobilisation par les formes prend de multiples apparences. Les parades et défilés militaires qui arpentent l’espace public, mais aussi les cortèges d’ennemis captifs, métaphores vivantes de la gloire des armées françaises, en sont une déclinaison. Musique militaire, montreurs d’images et chants populaires assurent l’omniprésence sonore de la geste guerrière nationale. « Ministre de la gloire », Vivant Denon incorpore les arts au service de l’épopée et de l’empereur. Les peintres des batailles sont patronnés par le pouvoir mais, en contrepartie, leur pinceau est lié par des consignes esthétiques qui escamotent l’horreur sous le sublime. Musée et Salons sont d’accès libre et drainent tambour battant des foules de toute origine sociale venues s’imprégner de ces reflets de guerre. Publications critiques et gravures en assurent la diffusion vers la province. Architecture et sculpture sont aussi enrôlées pour dédier des lieux de mémoire à l’héroïsme national. Il en demeure quelques monuments parisiens marquants (Panthéon, Arc de Triomphe, Colonne Vendôme) et quelques tombes du Père Lachaise, ouvert en 1804.
Cette militarisation de l’imaginaire public, mi-spontanée (dans le sillage de l’élan patriotique révolutionnaire) mi-construite, a cependant ses réfractaires. C’est sur cette résistance que se conclut l’ouvrage : insoumission, désertion, démotivation de l’opinion face à la guerre perpétuelle et enfin la fragilité de l’adhésion aux Cent Jours en sont les symptômes. Ce choix reflète bien les sentiments avec lesquels l’historien Bertaud, bon médiateur de la sensibilité actuelle, contemple l’instant napoléonien : un mélange indissociable de répulsion, face à une mécanique de coercition et de mort, et de fascination, inspirée par le souffle intense d’un moment de grandeur confinant au mythe. L’amplitude novatrice du propos, la richesse de ses exemples, la clarté de la pensée et de la rédaction confèrent à ce volume tout à la fois les qualités d’une synthèse de référence et celles d’un ouvrage grand public. Les étudiants en feront un profit évident, dont les enseignants ne peuvent eux aussi que tirer parti. Ils y vérifieront combien, portée par les passions, la guerre est un fait de société total bien avant les conflits de masse de l’ère industrielle.
|
[1] Attention toutefois, prescrivait le Maître, à leurs opinions ; exclure, le cas échéant, et si elles sont mal ralliées, les grandes familles royalistes.

Napoléon et la Berezina de la liberté (Jean-Paul Marthoz)
(Le Soir, 19/06/2015)
1.3 une théorie des races
|
Yves Benot, La démence coloniale sous Napoléon, La découverte, 2006 (p.211) La formation de l’idéologie des « races humaines »
On l’a déjà constaté, il n’est pas indispensable de se réclamer du racisme pour justifier l’esclavage. Inversement, il arrive parfois que l’on élabore toute une idéologie raciste, sous couvert de science, tout en se déclarant opposé à l’esclavage : tel est le cas de Virey en 1801, au beau milieu d’un livre consacré à l’établissement de la hiérarchie des « races humaines ». Mais il est généralement plus commode, une fois que l’on est entré dans le cycle infernal de la traite et de l’esclavage des Noirs, d’acquérir une bonne conscience en les classant dans une catégorie inférieure de l’humanité, à supposer que ce soient vraiment des êtres humains. Or, la constitution d’une prétendue connaissance scientifique des races humaines — et non plus de « variétés de l’espèce humaine », comme disait Buffon —, avec leur hiérarchisation, est de nature à se mettre au service de nombreuses formes de domination, s’entend de la domination européenne sur les autres continents. Elle peut évidemment servir l’esclavagisme, mais elle n’est pas non plus liée nécessairement à cette seule forme d’exploitation coloniale. Elle ne concerne pas exclusivement les Noirs, elle pourra toujours servir en Asie comme en Australie, elle pourra servir la colonisation qui prendra tout son essor après l’abolition de la traite et de l’esclavage, et elle sera en effet largement utilisée à cette fin jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il en subsistera encore beaucoup de relents après que l’écroulement de l’Allemagne nazie eut rendu difficile le recours direct à une théorie ouvertement raciste. En ce sens, cette élaboration, qui est l’œuvre de (p.121) chercheurs respectés en leur temps, et même bien après, médecins, biologistes notamment, a malheureusement exercé une influence durable, parce que, sous ce couvert scientifique, elle a fini par s’installer dans les manuels scolaires, devenir pour longtemps matière d’enseignement au même titre qu’un théorème de géométrie.
(p.219) Lacépède contre les Noirs La théorie des races dispose déjà d’un porte-parole bien plus en vue, en la personne du naturaliste Lacépède, qui sera de surcroît un haut dignitaire de l’Empire, sénateur, grand chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur. Le titre du discours d’ouverture de son cours de zoologie de 1800-1801 indiquerait, semble-t-il, une incertitude de vocabulaire puisqu’il s’intitule : Sur l’histoire des races ou principales variétés de l’espèce humaine. En fait, c’est bien de races distinctes, et non de variétés, qu’il s’agit. Il n’y en a plus que quatre : « Celle que nous avons nommée arabe-européenne, la mongole, l’africaine et l’hyperboréenne. » Cependant, où classera-t-on les Indiens d’Amérique qui font difficulté? Lacépède hésite entre un rameau de la « race mongole » ou des aborigènes — ce qui ferait une cinquième race —, ou une combinaison des deux. Bien que Lacépède ait annoncé que les traits caractéristiques, et donc distinctifs, des races humaines « se trouvent principalement dans les dimensions des pièces les plus remarquables de la charpente osseuse du corps humain », il faut croire que ses recherches, si recherches il y eut, ne lui ont pas fourni de données expérimentales permettant de classer les humains selon les dimensions de leur squelette. Le volume du cerveau ni l’angle facial ne paraissent jouer ici leur rôle de discriminant. Mais ce sont, une fois encore, des considérations de moraliste ou une description sommaire de sociétés — qu’il ne connaît pas réellement — qui donnent au naturaliste l’occasion de s’acharner particulièrement sur la « race africaine ». La nature, à l’en croire, lui a tout donné, « la fertilité du territoire… l’abondance du gibier, la facilité de la pêche, la fécondité des troupeaux… ». Et qu’en font-ils ? Ils chassent, pèchent, bâtissent des villes, font du commerce et même « connaissent une subordination politique » — ce qui est une bonne chose aux yeux du sénateur Lacépède, subordonné à Napoléon. Oui, mais ils n’ont pas d’arts d’agrément, pas de peintres, pas d’architectes, pas de musiciens, pas de sculpteurs, pas de mathématiciens, pas de métaphysiciens, peut-être pas de religion. Alors? Ces nations sont « dénuées encore de la faculté de concevoir avec force, de réfléchir avec persévérance, de comparer avec discernement, de raisonner avec profondeur […] ne jouissant pas même des vrais (p.220) éléments des sciences sans lesquels nous ne pouvons ni évaluer les rapports des quantités, ni distinguer les propriétés des êtres qui nous environnent ; divisées en esclaves avilis et en maîtres barbares… » Bref, moins que rien. Aussi, Lacépède qui salue le travail de la Société des observateurs de l’homme, qui a joué quelque rôle dans l’initiative du voyage de Baudin dans les mers du Sud, est-il partisan qu’on — les Européens, de préférence Français — aille « fonder une nouvelle Colchide sur les bords africains16… ». L’infériorité de la race africaine, vue par Lacépède des bords de la Seine, ne repose pourtant pas sur des caractéristiques physiologiques indélébiles, mais sur ce qu’il sait, ou croit savoir, de l’état présent des sociétés africaines. On est pris dans une contradiction habituelle chez les racistes entre la prétention d’établir un classement fondé sur des déterminants objectifs, scientifiquement, ici physiologiquement démontrés, et l’utilisation d’apparences, voire de réalités culturelles jugées à l’aune d’une autre culture, d’une autre organisation sociale. Le postulat selon lequel des données physiologiques immuables détermineraient à elles seules le caractère moral de tel ou tel groupe n’est même pas appliqué. La grande tirade de Lacépède, dont nous n’avons donné que quelques fragments, n’est rien d’autre que la traduction de tout ce que les esclavagistes ont avancé pour justifier le trafic du « bois d’ébène ». En fait, ces classifications variables ont une base fixe : l’opposition entre Noirs et Blancs, qui traduit en jargon scientifique le problème politique essentiel. Pour le reste, on hésite. Et que Lacépède reprenne la répartition en quatre races déjà formulée par Cuvier en 1798 (Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux) tandis que Virey en trouve cinq, ne change rien à la dévalorisation des Noirs. Le « péril jaune » ne viendra que beaucoup plus tard. On sait qu’au cours du xix« siècle, en s’appuyant sur l’angle facial, complété par des considérations sur le volume et le poids du cerveau, d’autres naturalistes s’efforceront de donner un peu plus d’apparence scientifique à la thèse de l’infériorité des Noirs. En ce sens, Virey va plus loin que Lacépède, alors même qu’il est plus contradictoire et un peu moins acharné. Bory de Saint-Vincent intervient aussi dans ce débat alors que son objet est de redécouvrir une race disparue, celle qui peupla l’antique Atlantide et dont les Canariens massacrés par les Européens au xv< siècle auraient été les derniers descendants. Pour lui aussi, aucun doute : « Dès que l’homme n’est qu’une créature parmi d’autres, pourquoi dans son genre n’existerait-il pas plusieurs espèces, comme il s’en trouve dans la plupart de ceux que nous offre le tableau des êtres ? Le genre humain duquel nous sommes peut venir de différentes racines confiées à différents climats. Ce n’est pas la température des lieux qu’ils habitent qui cause seule tant de variétés parmi les hommes ; sur le même parallèle où se trouvent les Noirs lolofs existent aussi des rouges, des olivâtres, et même des blancs purs, qui de temps immémorial ont conservé leur teinte et la conserveront probablement toujours17. » II y a au moins un petit progrès dans la mesure où il est reconnu que la théorie du climat n’explique pas grand-chose. Mais Bory de Saint-Vincent ne dit pas clairement sur quels critères il se fonde pour affirmer l’existence de races distinctes. Pour lui, il y aurait une même race dans toute l’Europe, la Laponie et la petite Tartarie exceptées, dans la partie occidentale de l’Asie, y compris les Mongols, l’Afrique du Nord et les peuples qui vont jusqu’aux sources du Nil ; ce qui correspond, en l’élargissant, à la race arabe-européenne de Lacépède. Tartares, Chinois, Japonais, Cochinchinois et Tunquinois forment une seconde race. Les Lapons et les peuples de l’Arctique en forment évidemment une autre, les Noirs une autre encore. Mais, si Bory de Saint-Vincent, qui n’est pas un chercheur naturaliste, témoigne de l’influence déjà acquise par la notion de races humaines distinctes, avec des origines géographiques différentes, du moins n’entreprend-il pas de les hiérarchiser et d’en fixer l’ordre de subordination. En 1814, suprême curiosité de la théorie, un vieil émigré rentré avec la première Restauration, Peyroux de la Coudrenière, annonce qu’il a reconnu sept espèces d’hommes, « savoir trois espèces de nègres, trois espèces d’Indiens et une espèce d’hommes blancs et barbus ». Les trois espèces de nègres comprennent une espèce dans le Pacifique, qui avait été un peu oubliée jusque-là, il faut l’avouer, les Boschimans et Cynocéphales, et (p.222) les grands nègres à traits d’Européens (sic). Parmi les Indiens, il y a ceux d’Amérique, qui sont aborigènes selon lui, une autre en Asie, Laponie, Groenland, puis les Quimos de Madagascar, qui ressuscitent ici. Restent les hommes blancs descendants des Atlantes, aussi bien Européens que Berbères. Comme il ne s’agit que d’une même race sur les deux rives de la Méditerranée, il n’est plus si facile de démontrer la supériorité des Européens, mais l’auteur l’affirme sans hésiter. Quoi qu’il en soit des bizarreries de cette typologie, comme d’ailleurs de toutes les autres, l’objectif de ce Peyroux est avant tout de préserver la pureté de l’espèce blanche et de lui faire recouvrer son antique perfection. Comment est-elle donc menacée ? Par les femmes de couleur (dans un sens très général qui englobe Noires et mulâtres) et les mariages ou amours mixtes. Conclusion logique, mais inattendue : il faut se hâter d’abolir effectivement la traite des Noirs et l’esclavage, non certes pour des motifs humanitaires, mais dans l’intérêt bien compris de l’« espèce blanche18 ». Comme on commençait à s’en douter, les théories racistes s’accommodent d’applications concrètes singulièrement divergentes, comme si la théorie prise en elle-même était pratiquement neutre et indifférente aux conclusions que chacun en tire. Bien entendu, on ne saurait s’arrêter à cette impression. (p.223) Pour une bonne part, les thèses de Voltaire, son polygénisme, sont issues de sa volonté de démolir les dogmes des Églises chrétiennes, et tout ce qui découle du récit de la Genèse érigé en vérité historique ; mais elles prennent place tout autant dans sa conception du monde, fondée sur l’infinie liberté du Créateur, Buffon, également détaché de l’orthodoxie, s’efforce de montrer comment le type unique de l’espèce s’est modifié, dégénérant ici, se perfectionnant ailleurs. Dans les deux cas, qui sont tout de même très représentatifs du xvni’ siècle français, un point de référence s’impose: celui de l’homme blanc européen — d’une Europe au demeurant partielle, géographiquement parlant —, de son mode de vie et de sa civilisation. Ce dernier terme revêt, dès le milieu du siècle, le double sens de processus qui transformerait sauvages ou barbares en membres d’une société policée, et de l’état d’une société perfectionnée. Sans entrer plus avant dans l’examen de thèses évidemment beaucoup plus complexes, il ressort de ce bref rappel que l’on a pu trouver dans les textes des Lumières, y compris, selon certains, ceux de J.-J. Rousseau, suffisamment d’éléments probants pour soutenir que le racisme moderne y a ses racines et que la vision du monde des Lumières est au fond eurocentrique19. Si l’on adopte ce point de vue, on en viendra à se demander s’il y a vraiment quelque chose de nouveau avec l’idéologie des « races humaines » dans les années napoléoniennes, et si ce ne sont pas les philosophes d’avant 1789 qu’il faudrait mettre en accusation ; on l’a d’ailleurs fait, et justement à propos de l’esclavage et de la colonisation. Ce qui est beaucoup moins clair, c’est l’idéal que ces critiques opposent à celui des Lumières. Veulent-ils laisser entendre qu’il aurait mieux valu que les diverses cultures et sociétés humaines restent comme elles étaient, que l’Europe aurait dû les respecter et s’en tenir là? En dehors du simple fait que l’histoire ne se refait pas, la question reste de savoir si ce n’est pas en réalité à la notion de progrès humain qu’ils voudraient s’en prendre. Ou bien, pour reprendre un mot créé par Rousseau — mais non l’idée —, leur bête noire ne serait-elle pas la perfectibilité humaine ? Bonaparte, qui avait rencontré le mot dans Madame de Staël, l’avait décrété incompréhensible ; et, en effet, il ne s’accordait pas avec son mépris des hommes et des peuples. Il y a donc dans ce fort actuel débat un certain degré d’ambiguïté (p.224) qui oblige à repartir des définitions. Ce qui caractérise l’idéologie des « races humaines », c’est que, sous couvert d’un matérialisme qui prétend les distinguer selon des différences structurelles internes, il est affirmé que les capacités intellectuelles et morales des « races » sont elles aussi différentes, et, plus grave encore, qu’elles le demeurent. Ce dernier point est décisif: ces « races » cessent d’être des « variétés » d’une même espèce pour être enfermées dans leur nature, donnée une fois pour toutes. De passagères références à la perfectibilité chez Virey ne sont que concessions verbales à une tout autre conception. La théorie des climats, si vivement critiquée par Helvétius, prend l’allure d’une chape de plomb retenant chacune des races dans son être et à jamais. C’est à partir de cet enfermement que la domination de l’Europe — et non plus le progrès matériel accompli dans cette partie du monde — est non pas seulement justifiée, mais ouvertement prônée. On peut évidemment juger dérisoires les prétentions à la scientificité de cette idéologie, puisque, en fait de différences structurelles, les « races humaines » sont caractérisées par des descriptions d’individus selon leur aspect extérieur. Considérer la couleur de la peau comme l’unique donnée structurelle discriminatoire (et c’est en effet à quoi on s’attelle avec acharnement, en concentrant tout l’effort sur cette couleur noire qui est celle des esclaves des colonies européennes devenus, à leur insu, la véritable et seule raison d’être de ladite idéologie) est tout de même insuffisant. Les théoriciens se rabattent sur les crânes et leur forme ou leur volume. La vogue de la « craniologie », mise à la mode par les leçons de Gall à partir de 1806, s’inscrit dans cette tendance à vouloir trouver un système de classement et de hiérarchisation des groupes humains. La forme du crâne en est un qui est à la portée de tout un chacun. Et l’on sait quel usage en ont fait les romanciers comme Balzac croyant pouvoir suggérer un portrait moral par une description physique, de même que les théoriciens suggèrent l’immoralité d’un Noir de la même manière — le jugeant laid en fonction de leurs propres critères esthétiques. Mais aurait-on découvert une de ces fameuses différences structurelles — restées introuvables parce que inexistantes — que l’on n’en aurait pas été plus avancé, parce qu’elle n’aurait pas suffi à prouver l’absence de capacités intellectuelles ou morales. Or, c’est sur ce dernier postulat que repose toute l’idéologie en question. (p.225) L’Europe des idéologues racistes napoléoniens n’est plus ce monde travaillé de violents conflits internes, mais une perfection uniforme, comme si la Révolution française, ou ce que le régime consent à en conserver, avait tout changé, en un bloc et d’un coup. Et c’est là une première rupture avec les Lumières, et fort importante. (…) (p.226) L’idéologie raciste brise avec l’ambivalence du commerce prévalant chez les Lumières : « échange de marchandises » et « échange d’idées, d’informations, de conceptions du monde et de la morale ». L’idéologie raciste n’institue que l’échange inégal, qui existait avant elle, mais qu’elle théorise et magnifie. (…) L’important, c’est que pour les idéologues à la Virey, le seul progrès concevable est celui que les Européens blancs sont encore capables d’accomplir, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. (p.229) Nous ne sommes, sous l’Empire, qu’au début de la formation de cette idéologie qui devait servir d’instrument et de justification plutôt à la colonisation post-esclavagiste du partage du monde par les impérialismes européens qu’à la colonisation des plantations — et des mines — fondée sur l’esclavage des Noirs, déjà sur son déclin. Mais les traits essentiels en sont tracés, et les distances bien prises avec les Lumières. Est-il excessif de parler de régression ? |
|
Léon Poliakov, Le mythe aryen, éd. Calmann-Lévy, 1971 (p.31) Telle est la puissance du mythe franc sous cette forme carolingienne, que dans les langues slaves, roi se dit « korol » ou « kral », c’est-à-dire se dérive à partir du nom germanique de Karl (ainsi, si le Slave est l’« esclave » des langues occidentales, l’empereur occidental est le « roi » des langues slaves), Napoléon, pour mieux asseoir son « Premier Empire », se pose en successeur de Charlemagne (certains de ses décrets débutaient par la formule : «Attendu que Charlemagne, notre prédécesseur…»).
(p.173) LES ANTHROPOLOGUES EXTRÉMISTES (LE POLYGÉNISME)
(p.180) Une recherche plus approfondie que la nôtre montrerait peut-être qu’au lendemain de 1815, les extrémistes des théories raciales en France se recrutaient parmi les bonapartistes plutôt que parmi les partisans des Bourbons. De ce point de vue, il serait intéressant de comparer entre elles plus systématiquement que nous ne saurions le faire, deux grandes encyclopédies de sciences naturelles, publiées toutes les deux à partir de 1816 à Paris. L’une, le Dictionnaire des sciences naturelles, était dirigée par le baron de Cuvier (personnage hautement officiel), assisté de « plusieurs naturalistes du Jardin du Roi »; l’autre, le Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, par Jean-Joseph Virey (qui venait de démissionner de l’armée), assisté d’une « société de naturalistes et d’agriculteurs ». Certes, à l’article « Homme », les races de couleur se trouvaient malmenées dans l’un comme dans l’autre, mais au ton relativement mesuré du comte de Lacépède dans la première encyclopédie s’opposaient les outrances de la seconde, où on retrouvait, sous la signature de Virey lui-même, les fables relatives au commerce amoureux des Nègres avec les singes, à leur sang et à leur cerveau noirs, et ainsi de suite. Pour mieux marquer que le Noir n’était pas un homme, Virey avançait, entre autres arguments, celui du pediculus nigritarum. « Ajoutons une induction, qui n’est pas sans importance, et qui m’a été communiquée par notre savant entomologiste Latreille; savoir que comme chaque espèce de mammifère, d’oiseau, etc., a souvent ses insectes parasites, qu’on ne trouve que pour elle seule, il en est de même du nègre; il a son pou qui est tout différent de celui du blanc. Le pediculus nigritarum (Fabricius, Syst. antr., Brunsw. 1805, p. 340) a la tête triangulaire, le corps rugueux et une couleur noire, ainsi que le nègre… (p.256) L’exaltation patriotique des guerres napoléoniennes, la glorification de la langue, de la religion ou du sang des Germains, trouvait son terrain le plus favorable dans les universités, et dans les milieux révolutionnaires, qui rêvaient d’une Allemagne unifiée, dont seraient exclus les allogènes, c’est-à-dire les Welches et les Juifs, déjà boycottés par la plupart des corporations estudiantines. (…) . De ce fait, de nombreuses voix réclamèrent, (p.257) tout au long du XIXe siècle, le retrait des droits civiques aux Juifs. La querelle, qui fit surtout rage en 1815-1830, faisait pendant à sa manière à la querelle française des deux races; comme cette dernière, elle avait des soubassements (ou des prétextes) d’ordre économique. Si, en France, la « force pécuniaire », selon Saint-Simon, était détenue par les Gaulois, un chœur de voix s’élevait en Allemagne pour déplorer la mainmise des Juifs sur cette force, et en ce sens, Karl Marx, dans sa Question juive, ne faisait que refléter une opinion largement répandue. |
| Patrice Bret, Annales historiques de la Révolution française, 340, Comptes rendus
(http://ahrf.revues.org/document2025.html) Orientales I. Autour de l’expédition d’Égypte Zusammenfassung Henry LAURENS, Orientales I. Autour de l’expédition d’Égypte, Paris, CNRS Éditions (Coll. Moyen-Orient), 2004, 306 p., ISBN 2-271-06193-8, 24 €.
Quelques articles ont été légèrement remaniés. C’est le cas de celui sur « Le projet d’État juif en Palestine attribué à Bonaparte » (pp. 121-143), l’un des principaux de la deuxième partie (« Napoléon et l’Islam ») et un bel exemple de construction et de détournement de l’histoire à d’autres fins. Initialement publié dans la Revue d’études palestiniennes en 1989, il a été mis à jour à l’occasion d’une traduction en arabe et pour répondre à l’ouvrage de Jacques Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte (Fayard, 1992) qui tentait d’en infirmer les conclusions. Laurens a enquêté sur une éphémère rumeur qui parcourut l’Europe en 1799 pour être tirée de l’oubli un siècle plus tard et posée en fait établi par le mouvement sioniste autour de la Grande guerre, puis devenir, par contrecoup, un argument de l’historiographie arabe pour démontrer l’existence d’un complot occidental permanent des Croisades à nos jours. La thèse de l’existence de ce projet d’État juif repose sur quelques articles de l’époque et sur deux documents dont des traductions ont été mises au jour en 1940 par un juif autrichien : une proclamation de Bonaparte, datée de Jérusalem (où les Français ne sont pas allés…), et une lettre du grand rabbin de la ville sainte à cette époque. De fait, outre quelques vagues mentions dans Le Moniteur, un article de la Décade philosophique en avril 1798 (un mois avant l’embarquement à Toulon et un an avant la campagne de Syrie), « un certain LB. qui pourrait être Lucien Bonaparte lui-même » selon Laurens (selon M. Regaldo, il s’agit en fait de Joachim Le Breton, de l’Institut national), propose de régénérer l’Égypte et la Syrie en appelant en Palestine les juifs qui « ont participé aux lumières de l’Europe » et « accourront des quatre parties du monde, si on leur donne le signal ». Quant à la proclamation du général en chef et à la lettre du grand rabbin de Jérusalem appelant à combattre pour l’Éternel et pour Bonaparte, ce sont des faux, rédigés dans le milieu messianique juif frankiste, né autour de Jacob Frank (1726-1791) dans la région de Francfort, avec des ramifications en Bohême et jusqu’à Paris. Avec la destruction de l’ordre d’Ancien Régime, les guerres et l’expulsion du pape de Rome, puis l’expédition d’Égypte qui rend possible le retour en Palestine, la Terre sainte redevient un enjeu géopolitique. « La tourmente révolutionnaire en Europe a intensifié parallèlement les deux courants apocalyptiques protestant et juif en leur permettant de croire que la fin des temps était proche. […] Bonaparte, tout en accomplissant le programme révolutionnaire de régénération des peuples du monde, véritable fin de l’histoire pour les Idéologues de la Révolution finissante, se prenait pour le Mahdi des Musulmans. Pour les protestants anglais, il était l’Antéchrist, et pour les messianistes juifs, l’exécuteur de la volonté divine » (pp. 142-143).
Les autres articles de cette partie – dans laquelle les rapports de la Révolution française avec l’Islam et avec l’Empire ottoman ont toute leur place (pp. 67-85) – soulignent la cohérence de Bonaparte dans ses rapports avec l’Islam, ce qui n’exclut pas son opportunisme : « La reconnaissance de cette double dimension permet de dépasser le débat déjà ancien sur l’existence ou non d’un rêve oriental. » (p. 145). Sur le terrain, cet imaginaire et la rivalité des puissances européennes font émerger le Grand Jeu évoqué par Kipling, avec sa multiplicité de dimensions, politique, économique, culturelle, et la figure nouvelle de l’aventurier assis « entre deux cultures et surtout deux loyautés » (p. 168), depuis Lascaris, chevalier de Malte qui suit Bonaparte en Égypte après la prise de l’archipel, jusqu’à Lawrence d’Arabie (« Le chevalier de Lascaris et les origines du Grand Jeu » (pp. 167-183).
« La postérité de l’expédition d’Égypte », objet de la troisième partie, porte essentiellement sur la longue durée. Le mythe politique de l’expédition, en France et en Égypte, du XIXe siècle à nos jours, « informe plus sur l’état des relations entre les deux pays que de l’apport de l’expédition » (p. 205). La comparaison de deux articles rédigés en 1990 et en 1998 montre d’ailleurs la détérioration de la perception de l’Occident en Égypte dans la dernière décennie, probablement accrue depuis le 11 septembre 2001. Suivent un volet français et un volet égyptien. Ce dernier porte sur la modernisation accomplie par Muhammad Ali et ses successeurs (Élites et réforme dans l’Égypte du XIXe siècle », pp. 231-243) et sur « La naissance de la nation égyptienne » (pp. 245-251). Le premier concerne la politique française au Levant, jusqu’au projet de royaume arabe de Syrie (« Napoléon III et le Levant », pp. 255-265) – la suite se trouve dans les deux autres volumes. Retenons un document important retrouvé naguère par Laurens et publié par lui dans les Annales islamologiques en 1987. Second volet de la première mission de Sébastiani à Constantinople, destinée à ratifier les préliminaires de paix entre la France et la Porte, et de préparer le traité définitif, ce document donne toute la mesure et l’ambiguïté de la politique orientale du Premier Consul, pour ne pas dire son double jeu, un an après l’évacuation de l’Égypte (« L’Égypte en 1802 : un rapport inédit de Sébastiani », pp. 187-204).
Avec deux articles seulement, la dernière partie, « Race et histoire », pourrait être le parent pauvre de l’ouvrage. Il n’en est rien. Le mythe-histoire de la Raison, fondateur de l’expédition, s’accompagne de la genèse d’un autre mythe des origines, qui émerge en parallèle en puisant notamment dans le comparatisme linguistique, celui des aryens, qui crée une culture commune entre l’Inde et l’Europe, posant les fondements d’une ethnologie linguistique et la question de ses liens avec l’anthropologie physique. « Le mythe aryen, malgré tout son romantisme inquiétant, est le produit des méthodes mises au point par les Lumières finissantes », précise Henry Laurens (p. 284). Les hommes de la Révolution ne sont pas absents des premiers débats. Bailly postule l’existence « d’un peuple détruit et oublié qui a précédé et éclairé les plus anciens peuples connus », de l’Inde et la Chaldée (Lettres sur l’origine des sciences et sur celle des peuples de l’Asie, adressées à M. de Voltaire, 1777 ; Lettres sur l’Atlantide de Platon et sur l’origine des sciences, 1779). Rabaut de Saint-Étienne imagine un peuple original du Gange au Danube à l’écriture allégorique réduite par l’invention de l’alphabet au rang de mythologie (Lettres à Sylvain Bailly sur l’histoire primitive de la Grèce, 1787). Volney, enfin, importe du comparatisme linguistique allemand l’idée d’une « nation scythique » s’étendant par vagues successives des plaines du Gange aux îles britanniques (1818). « Ainsi, une nouvelle généalogie de l’Europe se dessine : la théorie germanique était l’apanage de l’aristocratie, l’indo-germanique ne la concerne plus seulement, elle porte sur l’ensemble des populations de l’Europe, une race en tant que telle qui va se poser en aristocratie par rapport au reste du monde et dont l’origine est à rechercher en Asie » (p. 288). Les Indo-Européens sont nés, suivis dès les années 1840 par les Sémites, « la seconde race nécessaire pour la compréhension historique de l’état du monde » (p. 289). |
1.4 Napoléon et le culte
| Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.345) Dès le début de ce qu’on pourrait appeler « sa carrière », Bonaparte s’est affirmé comme un héritier de l’athéisme et de l’anticléricalisme révolutionnaires. Comme la quasi-totalité des membres de l’Institut dont il fait partie depuis 1797, comme la plupart des intellectuels de son temps et de nombre de politiques, comme les anciens révolutionnaires, il méprise la religion : « Craignez les prêtres, éloignez-les des fonctions publiques », déclarent-ils dans un discours public à Milan pendant la campagne d’Italie ; •< Je méprise cette prêtraille qui prêche l’assassinat le poignard et le crucifix à la main », écrit-il dans une lettre au philosophe Joubert ; la manière dont il a traité les églises et leurs prêtres pendant la campagne d’Italie est bien connue aussi ; quand il parle de Pie VI, qu’il dépouille d’Avignon et du Comtat venaissin et dont il vole les vieux manuscrits, les tableaux et les œuvres d’art, c’est pour le nommer « ce vieux renard », et, pour beaucoup de catholiques, il est, depuis 1795, le général assassin de Vendémiaire. Cependant, en prenant de l’âge, tout en restant athée, il prend conscience de l’importance sociale du phénomène religieux. Puis, en Egypte, il s’initie au 1 Date que donne le Dictionnaire Napoléon de Tulard, et qui semble la plus fiable. (p.346) Coran et cette religion, nouvelle pour lui, l’attire (pendant quelques semaines), sans doute par son exotisme, mais, revenu sur les champs de bataille européens, il applaudit les troupes françaises qui expulsent le « citoyen pape » (Pie VI) du Vatican pour le séquestrer à la chartreuse de Florence, à Valence puis à Dijon, où il finit par mourir. Petit à petit, l’anticléricalisme de Bonaparte s’estompe. En vieillissant, il s’aperçoit que l’Église romaine est une grande et riche puissance, et qu’elle est la seule organisation européenne qui n’ait pas vacillé depuis près de deux mille ans : les Croisades lui ont conféré le rôle de puissance internationale, les guerres de religions n’ont point réussi à l’affaiblir et partout ses richesses monumentales sont immenses. En France, où presque toutes les institutions de l’Ancien Régime se sont écroulées, seule l’Église a survécu à l’ouragan révolutionnaire et l’un des premiers actes politiques importants des constituants de 1789, ce fut de voter le décret instituant la Constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790, réorganisant le clergé de France. Il n’y a donc pas lieu de s’extasier si, devenu le maître presque absolu de la République, et après les exactions anticléricales de la Terreur, le premier souci de Bonaparte ait été de rétablir la paix religieuse dans le pays et d’instaurer la coexistence pacifique, au sein de la République, de l’Église et de l’État par la convention appelée Concordat. En revanche c’est une imposture que de lui attribuer le mérite de l’avoir réalisée ; nous venons de voir que cet accord fondamental, qui a maintenu la paix religieuse en France jusqu’en 1905 (année où le Concordat de 1801 a été remplacé par la loi sur la séparation de l’Église et de l’État), s’il a été voulu par Napoléon et, empressons-nous de le dire, par la plupart des hommes politiques et des religieux de l’époque, a été l’œuvre patiente et difficile de personnalités suivantes (par ordre d’entrée sur la scène de la genèse du Concordat, entre novembre 1800 et juillet 1801) : Mgr Spina, le père Caselli, l’abbé Bernier, Mgr Livio Palmoni, le député François Cacault, le cardinal Maury et, surtout, le cardinal Consalvi. Le Premier Consul n’est jamais intervenu dans les travaux ou dans les débats de ces sept coauteurs du Concordat de 1801. Voilà pourquoi c’est un imposture que d’attribuer à Napoléon aussi bien la décision d’instituer un concordat avec le pape que le contenu de cet accord. (p.347) Il n’en a pas eu l’idée, il n’en a pas débattu les articles, il s’est contenté d’entériner les « travaux d’Hercule »… Consalvi. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.97) « Nabou » surpasse même ce Charlemagne auquel il se réfère par-dessus les siècles ; Charlemagne s’était rendu, petitement, chez le Pape ; pour le caïd corse, c’est le Pape, au coup de sifflet, qui se déplacera. Et il se déplace, en effet. Il dit, à Notre- Dame : « Dieu tout-puissant et étemel, qui avez répandu l’onction sainte sur les têtes de Saiil et de David, répandez par mes mains le trésor de Vos grâces et de Vos bénédictions sur Votre serviteur [sic] Napoléon que Nous consacrons aujourd’hui empereur en Votre nom » Et ledit Napoléon à son tour : « Je jure de faire respecter les lois du Concordat […], l’égalité des droits, [sic] la liberté civile et politique [sic] et l’irrévocabilité de la vente des biens nationaux ». Un peu inattendue, cette allusion mercantile dans la bouche de l’Oint du Seigneur ; mais rassurante et nécessaire pour sa clientèle de base, les nantis de Thermidor et les paysans. Sa Sainteté desséchait de se faire rendre au moins une partie des provinces que l’Oint du Seigneur lui avait volées pour les annexer à son Royaume d’Italie. Mais l’Oint lui fera répondre, en pouffant, que, « protecteur d’un Etat étranger », il ne se reconnaissait pas « le droit d’en diminuer le territoire ». Et pourtant on avait eu, autour du pape, une idée que l’on avait cru séduisante : la canonisation d’un certain Pierre Bonaventure Bonaparte qu’il y avait moyen de faire passer pour un ancêtre de l’empereur. Et, comme disait la chancellerie romaine, « une canonisation est toujours, de la part de Rome, (p.98) une faveur ; elle ne saurait être mieux placée qu’ici ». On vend ce qu’on peut. Désappointement. Tout « sacré » qu’il fût, l’empereur était resté insensible à ce projet d’une promotion céleste dans sa famille. Du moins décide-t-on, à Rome, qu’au 15 août, dorénavant, la naissance de Napoléon éclipsera la « glorieuse assomption de la Sainte Vierge ». Le légat trouvera la formule appropriée, décrétant que, « de par l’autorité apostolique, la fête de l’assomption de la Sainte-Vierge et celle [c’est la fête seule- lement, bien entendu, qu’il veut dire] de saint Napoléon seront unies à perpétuité. » A perpétuité ! On ne lésine pas, à Rome, sur le temps puisque c’est de l’éternité qu’on dispose. Rien n’y fait. Pas la plus minime restitution territoriales. Le caïd est dur en affaires. |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.119) Il a des ennuis avec le Pape qui a prétendu l’excommunier (défense de le dire !) après l’occupation de Rome par les troupes françaises ; mais il ne désespère pas de l’amadouer ; il voudrait l’avoir à Paris, sous la main, et faire de ce Bonze- en-chef, en même temps que le chapelain de la Cour, une espèce d’archichancelier pour les affaires ecclésiastiques. Le « catéchisme impérial » reste en vigueur ; le légat Caprara l’a déclaré « conforme à la doctrine catholique » et tous les enfants de France doivent en savoir par cœur les articles essentiels que voici : « D. — Quels sont nos devoirs envers Napoléon Ier, notre empereur ? r. — Nous devons à Napoléon Ier, notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le service militaire et les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l’Empire et du trône. D. — Mais n’y a-t-il pas de motifs particuliers qui doivent nous attacher plus spécialement à Napoléon Ier, notre empereur ? r. — Oui, car il est celui que Dieu a suscité dans des circonstances difficiles pour rétablir la religion sainte de nos pères et pour en être le protecteur ; et, par la consécration qu’il a reçue du Saint Pontife, il est devenu l’Oint du Seigneur. Comblant notre empereur de ses dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, Dieu l’a rendu ministre de sa puissance et son image sur la terre. D. — Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leurs devoirs envers Napoléon Ier, notre empereur ? R. — Selon l’apôtre saint Paul, ceux qui résisteraient à l’ordre établi par Dieu se rendraient passibles de la damnation étemelle ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris. CH V UN REGIME TONIFIANT (p.91) S’il est tout petit garçon, Napoléon Bonaparte, devant les banquiers, il se rattrape devant « la prêtraille ». M. Thiers nous enseigne cependant que Bonaparte était “porté aux idées religieuses par sa constitution morale elle-même » ; et Gabriel Hanotaux, émouvant, pénétré, affirmait : « Rien n’ est plus à l’honneur de cet homme surhumain [sic] que son souci d’une règle supérieure à l’homme. L’inquiétude du divin le tourmentera jusqu’ à sa mort ». Le « divin », Napoléon Bonaparte s’en est toujours soucié à peu près autant que d’une guigne, ou d’une prune pourrie. C’est un réaliste. Les billevesées métaphysiques ne l’amusent même pas; elles l’agacent; zéro; temps perdu. Mais comme sont encore nombreux les crétins qui croient, dur comme fer , à leur Bon Dieu et leur Jésus-Christ (quelqu’un, ce Jésus, dira « l’empereur » à Sainte-Hélène, qui probablement, n’a jamais existé), il est important (p.92) de s’annexer ces gens-là par le moyen de leurs « fakirs »; et ce qu’il avait entrepris avec les « muphtis » d’Egypte, il va maintenant l’appliquer à ceux de France -, et de Rome. Bonaparte s’en explique, en toute simplicité ricanante, devant Roederer: «la religion, ce n’ est pas pour moi le mystère de l’incarnation ; c’est le mystère de l’ordre social » ; les curés doivent être là pour prêcher la résignation aux pauvres; des colonnes de l’ ordre; l’ordre au profit des « mangeurs ». Bonaparte est absolument d’accord avec Voltaire, lequel déclarait : « Il est fort bon de faire accroire que l’âme est immortelle et qu’il existe un dieu vengeur qui punira mes paysans s’ils veulent me voler mon blé. » Et il complète sa pensée devant Roederer encore: ma politique religieuse est bien simple, « mahométan au Caire, papiste en Italie et en France, si je gouvernais un Etat juif, je commencerais par rétablir le temple de Salomon. » (p.93) La légende veut – une fois de plus écoutons Louis Madelin – que Bonaparte ait «restauré les autels » et « rendu la liberté au culte ». Son concordat ? « La plus belle bataille qu’il lui ait été accordé de gagner ». Et voici M. Adrien Dansette, dans son Histoire religieuse de la France contemporaine (tome 1, p. 231) ; « Quels que furent les limites et le prix de cette restauration, [par Bonaparte, de l’Eglise en France] , elle lui a acquis des titres éternels à la reconnaissance catholique ». Vraiment ? Le tout est de s’entendre, je pense, sur le sens des (p.93) mots , du mot « restauration » et du mot « catholique ». Bonaparte aurait relevé les autels ? Mais ils étaient parfaitement relevés avant lui. En 1799, 40 000 paroisses avaient retrouvé leurs desservants (1). Il a libéré le culte ? La vérité est littéralement l’antithèse de cette assertion. Le culte était libre; la Constitution civile du clergé, oeuvre des notables de la Constituante pour avoir des prêtres payés par eux et à leur service, elle était morte, par bonheur. Mais c’est une nouvelle Constitution civile du clergé que Bonaparte veut établir, et dans le même dessein, afin de procurer à son pouvoir une armée de prêtres fonctionnaires, des prêtres qu’il tiendra aussi fermement « dans sa main » que lui-même est « dans la main » des financiers. Le pape renâclera ? On saura le contraindre, et même lui faire bénir l’opération; c’est un prince temporel, le Pape, par conséquent, vulnérable; il n’est que de le menacer dans ses possessions territoriales et il filera doux. Sans ambages, Bonaparte a exposé son plan à La Fayette, un affranchi comme lui, un voltairien comme lui: « Je mettrai les prêtres encore plus bas que vous ne les avez laissés », avec votre Constitution civile; sous moi « un évêque se tiendra honoré de dîner chez le préfet ».Bonaparte a du coup d’oeil ; s’il ne croit pas au 1, Les survivants, parfois très nobles, de l’Eglise « constitutionnelle, » ne mettaient pas en cause l’autorité suprême du Pape en matière de foi. (p.94) Fouché va faire connaître aux évêques, par une circulaire, ce qu’il attend d’eux : « Il y a un rapport, Messieurs, entre mes functions [lui, c’est la police] et les vôtres. Notre but commun est la sécurité du pays, au sein de l’ordre et des vertus ». Et l’abbé Maury, l’un des ténors de l’extrême-droite à la Constituante, cet abbé qui ne sortait jamais sans ses pistolets (il les appelait « mes burettes »), et qui se vantait, en riant, de ne jamais mentir, “sauf en chaire », Maury – que Napoléon fera cardinal – pensait tout à fait comme Fouché et déclarait en propres termes : « Une bonne police et un bon clergé, avec ça, on a la tranquillité publique”. La hiérarchie se précipita, à peu d’exceptions près, avec transport, dans la voie où l’appelait le Consul. Il y aurait un florilège admirable, écoeurant, à réunir avec les dithyrambes concordataires des prélats. Le Consulat et l’Empire seront le règne du cléricalisme incroyant – façon Vigny 1848, façon Maurras un peu plus tard. (p.95) Le résultat, trop prévisible ? Quand Napoléon disparut, l’Eglise de France n’était plus qu’une institution dérisoire et flétrie, sans souffle et sans âme. |
|
in : Philippe Maudoux, Saint-Job remis à l’heure, s.d. (p.10) Notons qu’en 1806, le catéchisme impérial disait : « Il faut inculquer aux jeunes Français le respect absolu de l’Empereur. » |
|
Annie Jourdan, Mythes et légendes de Napoléon, éd. Privat, 2004
(p.29) Le sacre du 2 décembre 1804 eut pour effet immédiat de rallier la plupart des prêtres à l’Empire. Mais celui-ci n’en fut pas pour autant une « monarchie chrétienne », dans le sens strict du mot, en ce sens que Napoléon n’eut de cesse d’invoquer sa légitimité divine pour imposer à Rome et au clergé catholique sa politique. En témoignent plus particulièrement la création du Catéchisme impérial et la fête de la Saint-Napoléon de 1806, qui visent à déifier de son vivant le nouvel Empereur. Si l’on en croit l’étude de latreille sur le sujet, la curie, qui les examine quelque temps après leur élaboration mais trop tard pour les empêcher d’être diffusées en France, juge les deux créations trop politiques et irrespectueuses de la religion. Dans le Catéchisme, Napoléon avait ajouté de sa griffe qu’il fallait le considérer comme « l’image de Dieu et le dépositaire de sa puissance sur terre ». Mais outre cette prétention à poser l’Empereur en représentant de Dieu, le Catéchisme, qui devait être imposé à l’ensemble du clergé de l’Empire, aurait été destructeur de l’autorité religieuse, propagateur d’un « dangereux» esprit de tolérance et aurait exalté par trop la puissance civile. C’était là bien évidemment son intention. Portalis le confirme quand, en mai 1807, il écrit à Napoléon: « Tout est calme, tous les évêques français ne sont occupés qu’à remplir les vues supérieures de Votre Majesté en facilitant de toute l’influence de leur ministère les opérations politiques de la conscription. » la leçon VII, en effet, prônait les devoirs des sujets dans l’ordre temporel, au nom de la volonté divine: « C. – Pourquoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre empereur? « R. – C’est, premièrement, parce que Dieu qui crée les empires et les distribue selon sa volonté, en comblant notre Empereur de dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l’a établi notre souverain, l’a rendu le ministre de sa puissance et son image sur la terre. Honorer et servir notre Empereur est donc honorer et servir Dieu même. Secondement, parce que Notre Seigneur JésusChrist, tant par sa doctrine que par ses exemples, nous a enseigné lui-même ce que nous devons à notre souverain 6 […] » 6- André Latreille, Le Catéchisme impérial, Paris, Les Belles Lettres, 1935. Sur Portalis, voir p. 174. Sur le Catéchisme, voir pp. 80-81
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.94) Being, but whatever he claimed at certain times, he was in no sense a Christian. (Although he once remarked, ‘I know men and I tell you Jesus Christ was not a man.’) Mme de Rémusat tells us, ‘I do not know whether he was a Deist or an atheist but in private conversation he constantly ridiculed everything concerned with religion.’ However, she adds, ‘Bonaparte made use of the clergy even if he disliked priests.’ He recognized that the vast majority of the French were Catholics, and saw religion as a stabilizing force which could be useful to him. He observed, ‘If you take away faith from the people, you’re going to end up with nothing but highway robbers.’ He wanted to make the Roman Church a buttress of the régime he planned – just as he had used the mullahs in Egypt. By doing so he would deal the royal-ist cause a mortal blow; everyone was convinced that Catholicism could only return with the monarchy, and the devout were ail supporters of Bourbons. He knew that Pius VII and his advisers were badly shaken, that it might be possible to transform them into pliant instruments of government. In July 1801 he signed a concordat with Pius; France was to hâve ten archbishops and fifty bishops nominated by the First Consul, and be paid salaries by the State. In April the following year the concordat was approved by a plébiscité, Bonaparte attending a Mass of thanksgiving at Notre-Dame on Easter Sunday; a canopy was carried over him, just as formerly one had been carried over the Kings of France on similar occasions. Many republican officers disapproved; General Delmas grumbled, ‘Ail that was missing was those hundred thousand Frenchmen who died to be rid of all this.’ Nevertheless, Napoleon had his way. For the moment Pope and clergy were profoundly thankful, amazed at being rescued by a son of the Revolution.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005 (p.31) Sous le patronage de Salicetti, Bonaparte va se faire inscrire à la loge maçonnique de Marseille ; appartenance qui peut servir.
|
|
Jean Burnat, G.H. Dumont, Emile Wanty, Le dossier Napoléon, éd. Marabout, 1962
NAPOLEON ET L’EGLISE
Napoléon est l’auteur du Concordat qui « rendit » au Pape 30 millions de Français. Il ne faut pas l’oublier en se rappelant ses démêlés avec la Papauté qui rappellent la tradition des Philippe le Bel et des Henri IV d’Allemagne. Il ne faut pas l’oublier non plus en lisant les lettres ci-dessous.
A M. FOUCHE Trêves, 15 Vendémiaire an XII (7 octobre 1804).
« J’ai lu avec attention le rapport du Préfet de Police sur l’exécution du décret du 3 Messidor an XII, relatif aux corporations religieuses. Mon but principal a été d’empêcher les Jésuites de s’établir en France. Ils prennent toutes sortes de figures. Je ne veux ni Cœur de Jésus, ni Confrérie de Saint-Sacrement, ni rien de ce qui ressemble à une organisation de milice religieuse, et, sous aucun prétexte, je n’entends faire un pas de plus ni avoir d’autres ecclésiastiques que des prêtres séculiers. (p.374) « Mon intention également est de ne point vouloir de couvents de religieuses, mais, sur ce point, je ne vois point d’inconvénients à ce que les anciennes religieuses finissent leur vie en commun et portent sur elles les habits qu’elles veulent, mais qu’elles ne fassent pas de novices et n’aillent point dans la rue avec leurs habits ; j’en excepte les sœurs de charité, je les autorise même à établir des noviciats pour s’y recruter. «Il y a donc deux précautions à prendre pour ces religieuses ; pour la première de les connaître et de les bien surveiller pour s’assurer qu’elles ne sont point dirigées par des prêtres qui ne sont pas dans la communion de leur évêque, car toute société qui s’écarterait de cette voie doit être frappée impitoyablement, elle est dans le chemin du crime; elle est dans les mains des scélérats, et il y a tout à craindre de la part de filles mal conduites. La seconde est de veiller à ce qu’elles ne fassent pas de novices et cela a quelques difficultés. Je vois, par exemple, que les religieuses de la Miséricorde, rue de Lachaise n° 529, forment des élèves. Comment distinguer une élève d’une novice ? « Mon intention est qu’on assure : 1° Que les élèves ne puissent porter un habit religieux et soient vêtues d’un habit ordinaire. 2° Qu’elles ne puissent pas avoir au-delà de dix-huit ans. Toutes celles donc qui auraient plus de dix-huit ans doivent être renvoyées de ces maisons. Mon intention est qu’on les prévienne de sortir sous six mois, sous peine de voir la maison fermée et l’établissement dispersé.
« Napoléon »
A M. TALLEYRAND Trêves, 15 Vendémiaire an XII (7 octobre 1804).
«Je désire que vous écriviez en Espagne pour faire connaître que je verrais avec peine le rétablissement des Jésuites ; que je ne le souffrirai jamais en France, ni dans la république italienne ; que j’ai lieu de penser, d’après la nature de nos relations, que l’Espagne restera ferme dans les mêmes principes, mais que je désire en avoir l’assurance. Ecrivez la même chose à la reine d’Etrurie.
« Napoléon »
AU CARDINAL FESCH Munich, 7 janvier 1806.
«Le pape m’a écrit, en date du 13 novembre, la lettre la (p.375) plus ridicule, la plus insensée : ces gens me croyaient mort. J’ai occupé la place d’Ancône parce que, malgré vos représentations, on n’avait rien lait pour la défendre et que d’ailleurs on est si mal organisé, que quoi qu’on eût fait, on aurait été hors d’état de la défendre contre personne. Faites bien connaître que je ne souffrirai plus tant de railleries ; que je ne veux point à Rome de ministre de Russie ni de Sardaigne. Mon intention est de vous rappeler et de vous remplacer par un séculier. «Puisque ces imbéciles ne trouvent pas d’inconvénient à ce qu’une protestante puisse occuper le trône de France, je leur enverrai un ambassadeur protestant. Dites à Consalvi1 que s’il aime sa patrie, il faut qu’il quitte le ministère ou qu’il fasse ce que je demande ; que je suis religieux, mais ne suis point cagot ; que Constant! sépara le civil du militaire et que je puis aussi nommer un sénateur pour commander en mon nom dans Rome. Il leur convient bien de parler de religion, eux qui ont admis les Russes et qui ont rejeté Malte et qui veulent renvoyer mon ministre. Ce sont eux qui prostituent la religion. Dites à Consalvi, dites même au pape que puisqu’il veut chasser mon ministre de Rome, je pourrai bien aller l’y rétablir. « On ne pourra donc rien faire de ces hommes-là que par la force? Ils laissent périr la religion en Allemagne, ne voulant rien terminer par le Concordat, ils la laissent périr en Bavière, en Italie, ils deviennent la risée des cours et des peuples. Ils croyaient donc que les Russes, les Anglais, les Napolitains auraient respecté la neutralité du pape ? Pour le Pape je suis Charlemagne parce que comme Charlema-gne je réunis la couronne de France à celle des Lombards, et que mon empire confine avec l’Orient. J’entends donc qu’on règle avec moi sa conduite sur ce point de vue. Je ne changerai rien aux apparences si l’on se conduit bien ; autrement, je réduirai le Pape à être évêque de Rome… Il n’y a rien en vérité d’aussi déraisonnable que la cour de Rome.
« Napoléon »
A SA SAINTETE LE PAPE Paris, 13 février 1806.
« …Toute l’Italie sera soumise sous ma loi. Je ne toucherai rien à l’indépendance du Saint-Siège ; je lui ferai même
(p.376) payer les dépenses que lui occasionneraient les mouvements de mon armée, mais nos conditions doivent être que Votre Sainteté aura pour moi, dans le temporel, les mêmes égards que je lui porterai pour le spirituel et qu’elle cessera des ménagements inutiles envers des hérétiques ennemis de l’Eglise et envers des puissances qui ne peuvent lui faire aucun bien. Votre Sainteté est souveraine dans Rome, mais j’en suis l’Empereur. Tous mes ennemis doivent être les siens. Il n’est donc pas convenable qu’aucun agent du roi de Sardaigne, aucun Anglais, aucun Russe ou Suédois réside à Rome ou dans vos Etats, ni qu’aucun bâtiment appartenant à ces puissances entre dans vos ports…
« Napoléon »
DECISION
En réponse à un rapport qui commençait ainsi : « Sire, plusieurs évêques de l’Empire m’ont adressé des représentations sur la manière peu décente avec laquelle on chôme dans certaines communes les fêtes consacrées par le Concordat… »
Osterode, 5 mars 1807.
« II est contraire au droit divin d’empêcher l’homme qui a des besoins, le dimanche comme les autres jours de la semaine, de travailler le dimanche pour gagner son pain. « D’ailleurs, le défaut du peuple en France n’est pas de trop travailler. La police et le gouvernement n’ont donc rien à faire là-dessus. « Dieu a fait aux hommes une obligation de travail, puisqu’il n’a permis qu’aucun des fruits de la terre leur fût accordé sans travail. Il a voulu qu’ils travaillassent chaque jour, puisqu’il leur a donné des besoins qui renaissent tous les jours. Il faut distinguer, dans ce qui est prescrit pari le clergé, les lois véritablement religieuses et les obligations qui n’ont été imaginées que dans la vue d’étendre–l’autorité des ministres du culte. « La loi religieuse veut que les catholiques aillent tous les dimanches à la messe, et le clergé, pour étendre son autorité, a voulu qu’aucun chrétien ne pût, sans sa permission, travailler le dimanche. Cette permission, il l’accordait ou la refusait à son gré pour constater son pouvoir, et l’on sait que, dans beaucoup de pays, on l’obtenait avec de l’argent. (p.381) Encore une fois, ces pratiques étaient superstitieuses et plus faites pour nuire à la véritable religion que pour la servir. « N’est-ce pas Bossuet qui disait : « Mangez un bœuf et soyez chrétien ? » L’observance du maigre le vendredi et celle du repos le jour du dimanche ne sont que des règles très secondaires et très insignifiantes. Ce qui touche essentiellement aux commandements de l’Eglise c’est de ne pas nuire à l’ordre social, c’est de ne pas faire mal à son prochain, c’est de ne pas abuser de la liberté. Il ne faut pas raisonner mais se moquer des prêtres qui demandent de tels règlements. «Puisqu’on invoque l’Autorité sur cette matière, il faut donc qu’elle soit compétente. Je suis l’autorité et je donne à mes peuples, et pour toujours, la permission de ne point interrompre leur travail. « Si je devais me mêler de ces objets, je serais plutôt disposé à ordonner que le dimanche, passé l’heure des offices, les boutiques fussent ouvertes, et tous les ouvriers rendus à leur travail.
« Napoléon »
|
|
Luc De Vos, Les quatre jours de Waterloo, 15-18 juin 1815, éd. Versant Sud, 2002
(p.50) (…) L’absorption des États pontificaux aboutit en 1811 à l’excommunication de l’Empereur. Ce faisant, il dressait contre lui la France rurale encore majoritairement catholique.
|

(Pierre Birnbaum / L’aigle et la synagogue, Napoléon, les Juifs et l’Etat)

(Général Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène)

(Napoléon: propos antisémite à Sainte-Hélène)
1.5 Napoléon et les Juifs: son antisémitisme avéré
Fait curieusement « oublié » par nos professeurs d’histoire, Napoléon était bien un antisémite.
Il fut bien le modèle de Hitler.
NAPOLEON, un dictateur antisémite
PLAN
0 INTRODUCTION
1 Etude de Pierre Birnbaum : Napoléon et les Juifs
2 Autres études
in : Béatrice Philippe, Roger Caratini Etre Juif dans la société française du Moyen Age à nos jours, éd. Complexe, 1997
in : Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
3 Analyses diverses
dont celle du Rabin Ken SPIRO
0 INTRODUCTION
0.1 Esquirol – Sujet: Re: Le statut des Juifs de Napoléon Ier à Napoléon III
La vérité historique ne va pas surgir d’un savant dosage de mythe napoléonien et de légende noire. Il faut au contraire se débarrasser de ces deux visions partisanes pour pouvoir s’approcher de cette vérité.
(in : FORUM des Amis du Patrimoine napoléonien, Mar 29 Jan 2008)
0.2 Claude Ribbe, Le crime de Napoléon, éd. Privé 2005
(p.55) Aucun doute, donc : Napoléon, au moment où il s’empare du pouvoir, est bien un esclavagiste convaincu. Mais il est également raciste. Raciste jusqu’à l’aliénation. On connaît sa haine des juifs, que la Révolution vient tout juste d’émanciper. À leur propos, le modèle de Hitler n’hésite pas à déclarer que c’est « une nation à part, dont la secte ne se mêle à aucune autre », une « race qui semble avoir été seule exemptée de la rédemption ». Il trépigne: « Le mal que font les juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple. Ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France !1 » II explique clairement sa politique judéophobe (p.56) à son frère Jérôme : « J’ai entrepris l’œuvre de corriger les juifs, mais je n’ai pas cherché à en attirer de nouveaux dans mes États. Loin de là, j’ai évité de faire rien de ce qui peut montrer de l’estime aux plus misérables des hommes. »
Voulant « porter remède au mal auquel beaucoup d’entre eux se livrent », Napoléon multiplie en effet les mesures discriminatoires à l’encontre des juifs, n’hésitant pas à effacer les dettes dont ils sont créanciers ou à les écarter du commerce pour les ruiner et même à leur interdire tout ou partie du territoire. Antisémite notoire, comme Voltaire, Napoléon est naturellement aussi un violent négrophobe. Car l’un ne va jamais sans l’autre.
1 Propos tenus devant Mathieu-Louis Molé le 7 mai 1806 et cités notamment par Hubert de Noailles dans Le Comte Molé, sa vie, ses mémoires, Paris, 1922-1930. Sur l’antisémitisme de Napoléon, voir aussi Philippe Bourdrel, Histoire des juifs de France, Paris, 1974.
1 Extraits de :
Pierre Birnbaum, L’Aigle et la Synagogue, Napoléon, les Juifs et l’Etat, éd. Fayard 2007 (à lire absolument)
(p.8) / Lors de la commémoration de la création du Grand Sanhédrin 200 ans auparavant,/ Jean Kahn /président du Consistoire central français / prend la parole en évoquant la « défiance », ou encore la « méfiance » de Napoléon à l’égard des Juifs qui représentaient « un défi, celui de la complexité face à la simplicité des casernes ». Malgré les « décrets populistes » qui annulent les dettes ou instituent une patente pour les seuls Juifs, il estime que le Sanhédrin a facilité « l’épanouissement du judaïsme français moderne » ; à ses yeux, par son antique devise,- « Religion et patrie » -, le Consistoire créé par Napoléon a rendu possibles « la pérennité du judaïsme ainsi qu’une citoyenneté pleinement assumée ». De cette manière équilibrée, le président du Consistoire central considère que les Juifs ont réussi, dans ce cadre, à « marquer leur volonté d’intégration sans renoncer à une once de leur identité ‘ ».
Le ton laudateur de Jean Kahn ne saurait masquer une certaine réserve qui s’exprime ici, de manière mesurée, publiquement, en présence des hauts représentants de l’État. À vrai dire, dans des notes préparatoires à son discours, le président du Consistoire central, institution autrefois bâtie par l’Empereur, écrivait même : « Nous ne commémorons pas aujourd’hui un Sanhédrin qui a voulu rabaisser les Juifs et les obliger à se renier », avant d’évoquer les aspects positifs de ce « statut » des Juifs qui a donné naissance aux consistoires, lesquels ont favorisé l’épanouissement du judaïsme français quoiqu’il n’ait pas su, par exemple, « recevoir les Juifs de l’Est avec le cœur qu’il fallait2 ». Ces considérations plus acerbes ont disparu de son discours officiel lors de la commémoration. Elles se sont pourtant exprimées, ouvertement cette fois, dans son allocution d’inauguration de l’exposition sur le Sanhédrin organisée quelques jours plus tôt, le 25 février, par le Consistoire central, dans ses propres locaux, loin des fastes de l’Etat.
(p.23) Les charges véhémentes coexistent ainsi avec des appréciations enthousiastes les plus inattendues venant de tous bords. Quelle cacophonie ! Quelles divergences radicales dans l’interprétation du moment napoléonien par les divers porte-parole du judaïsme français ! Le Roi des Juifs se voit fréquemment détrôné; rien à voir avec la belle unanimité des antisémites célébrant le souvenir de l’Empereur. La persistance d’une posture plus que négative à l’égard de Napoléon surprend néanmoins par son ampleur : il nous faudra l’explorer aussi de manière systématique tant elle va à l’encontre des idées reçues quant à la nature d’un franco-judaïsme assimilationniste, chantre de l’Empereur, de l’Aigle aux ailes protectrices, célébré par tant d’odes dithyrambiques. Elle remet en question un franco-judaïsme qui instaure une continuité entre 1791 et 1806, avide d’abandonner toute identité collective au nom d’une citoyenneté enfin régénérée, supposé avoir été comblé par les institutions consistoriales, « heureux enfin comme Dieu en France ». Se pencher à nouveau sur la figure de l’Empereur comme sur cet événement clé que constitue le Sanhédrin permet, en définitive, de relire l’histoire à travers les mémoires juives ou non juives successives et contradictoires, du début du XIXc siècle à nos jours.
(p.24) L’AFFAIRE ANCHEL
Les Juifs sont les seuls, ou presque, à se souvenir de cet aspect particulier du moment napoléonien. L’historiographie française demeure, en effet, étrangement silencieuse qui l’évoque, au mieux, au détour d’un paragraphe en quelques lignes ou, exceptionnellement, en quelques paragraphes d’une étonnante banalité. Le sujet n’intéresse pas, il rebute même, comme si planait sur lui une « conjuration du silence 1 ».
1 Maximilien Vox, Napoléon, Paris, Le Seuil, 1969, p.99
(p.28) Mais si nombre de grands historiens français de tous bords ont eux aussi préféré ignorer ces questions, certains francs-tireurs brisent pourtant, dès le tournant du siècle dernier, ce quasi-consensus et protestent vigoureusement contre les projets napoléoniens. En 1884, Paul Fauchille, un avocat docteur en droit qui ne se montre guère favorable aux Juifs, considère néanmoins que, avec le décret de mars 1808, « Napoléon frappait les Juifs de flétrissure en les soumettant à des règles rigoureuses et exceptionnelles. C’était de sa part faire un exercice inconstitutionnel du pouvoir législatif et violer ouvertement tous les principes posés par les lois et les constitutions […]. N’était-ce pas, en effet, blesser le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi que d’établir entre les Français des distinctions basées sur le culte et sur le domicile 3 ? » En 1899, Léon Kahn se montre tout aussi critique : pour lui, avec le décret de mars 1808, « le grand Napoléon venait de violer la loi constitutionnelle, la loi humaine […]. Napoléon, âme subtile et rusée, cachait sous une apparente bienveillance la perversité dans le dessein, la cruauté dans le but. Il s’était proposé la perte des juifs ; il y porta ses efforts ». Avec le décret de 1808, « il souffletait la Révolution à laquelle il devait tout […]. Napoléon s’était rabaissé au niveau des rois du moyen âge 4 ». Au tour nant du siècle, Albert Lemoine n’y va pas, lui non plus, par quatre chemins :
1 Robert Byrnes, Antisemitism in Modern France : the Prologue to the Dreyfus Affair, New Jersey, Rutgers University Press, 1950 ; Robert Paxton, La France de Vichy, Paris, Le Seuil, 1973.
2 La quasi-totalité des très nombreuses biographies anglo-saxonnes de Napoléon ne consacre pratiquement pas une ligne à ce thème. Même récemment, Steven Englund ignore purement cette question : Napoléon. A Political Life, New York, Scribner, 2004, tout comme Alistair Horne, The Age of Napoléon, New York, Modem Library, 2004 ; Geoffrey Ellis, Napoleon, Londres, Longman, 1997 ; Martyn Lyons, Napoleon Bonaparte and the Legacy of French Revolution, New York, St Martin’s Press, 1994 ; Alan Scham, Napoleon Bonaparte, New York, Harper Collins, 1997, ou encore Robert Asprey, The Rise and Fall qf Napoleon Bonaparte, Londres, Little, Brown and Co., 2001, et J.M. Thompson, Napoleon Bonaparte, Oxford, Blackwwell, 1988. Susan Conner consacre dans son livre deux paragraphes à ce thème en considérant simplement que, avec les décrets de mars 1808, Napoléon confirme « son souhait de traiter de manière humaine et équitable des Juifs de France » (The Age of Napoléon, Westport, Greenwood Press, 2004, p. 40).
3 Paul Fauchille, La Question juive en France sous le Premier Empire, Paris, A. Rousseau, 1884, pp. 61 et 64.
4 Léon Kahn, Les Juifs de Paris pendant la Révolution, Paris, Paul Ollendorf éd., 1899, pp. 325, 327, 337 et 349.
(p.29) « le décret de 17 mars 1808 divise la nation française en deux classes : le peuple juif et le peuple non juif; celui-ci, non pas libre car personne ne l’est alors, mais possédant la plénitude de ses droits civils ; celui-là frappé d’une suspicion permanente de friponnerie et soumis aux inégalités les plus humiliantes […]. Napoléon a fait contre les Juifs, que la Constituante avait émancipé, une contre-révolution. Par ses lois d’exception, il a fait revivre pour eux l’ancien droit ». Une telle dénonciation, aussi explicite, semble rarissime1. Peu après, Philippe Sagnac, le spécialiste de la Révolution française si attaché au libéralisme, publie plusieurs articles savants et prudents sur ce thème, qui feront référence2. Au même moment, un Ernest Lavisse, le chantre de la République, éloigné du catholicisme tout comme du marxisme, fait paraître sous sa direction plusieurs ouvrages qui abordent au contraire sans détour ces aspects de l’histoire nationale. Dans l’un d’entre eux, à travers une description argumentée et précise des événements, on note que Napoléon «résolut d’étouffer l’esprit particulariste [des Juifs], de les forcer de renoncer aux avantages et aux contraintes de leur religion » en créant un système consistorial qui les rattache à l’État3 ; dans un autre, rédigé par G. Pariset, plus d’une dizaine de pages sont consacrées à la Révolution française, à Napoléon et les Juifs. Après avoir exposé de manière précise les mesures décidées par l’Empereur à la fin du Sanhédrin, l’auteur estime simplement :
« les Israélites étaient donc placés sous un régime d’exception […]. C’est ainsi que Napoléon accomplit son coup d’État dans la question juive […]. Au lieu de traiter la maladie, il ordonna d’assommer le malade […]. Ce ne fut pas seulement le Code civil qui fut violé par le décret : les principes fondamentaux de la constitution furent brutalement foulés par cette suspension de l’égalité civile, établie par l’acte d’émancipation de 1791. La plupart des citoyens français d’origine juive furent privés, pour une période de dix ans,
- Albert Lemoine, Napoléon et les Juifs, Paris, Fayard, 1900, pp. 325 et 381. Voir aussi l’ouvrage d’Eugène Sraer, Les Juifs de France et l’égalité des droits civiques, Paris, Charles Petit, 1933. L’auteur écrit, par exemple : « il paraît inique que le pouvoir sévisse contre toute une classe de citoyens en raison des abus commis par certains de ses membres » (p. 65).
- Philippe Sagnac, « Les Juifs et Napoléon (1806-1808) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, janvier-février 1901.
- Ernest Lavisse et Pombaud (dir.), Histoire générale du rf siècle à nos jours, 1896-1905, t. 9, p. 421. Dans un manuel scolaire destiné aux classes du certificat d’études, Lavisse écrit par ailleurs : « Napoléon supprima toute liberté […] le pouvoir absolu fut k cause de sa perte et de nos malheurs », Livret d’histoire de France, Paris, A. Colin, 1894, p. 39.
(p.30) de la liberté de choisir leurs professions, de la liberté de se déplacer et beaucoup d’entre eux furent même dépouillés de leurs droits de propriété personnels […]. L’affront moral infligé par le décret à un peuple qui venait d’être émancipé par la Révolution, qui avait perdu beaucoup de ses forces dans la lutte pour la liberté et pas mal de vies humaines dans les entreprises guerrières de Napoléon, fut d’ailleurs ressenti par les Juifs beaucoup plus durement et douloureusement que les pertes matérielles. Le décret du 17 mars passa dans l’histoire sous le nom de « décret infâme 1 » ».
On ne saurait mieux dire les choses, mieux mettre en lumière le caractère dégradant et inique des mesures napoléoniennes. Ce texte constitue peut-être la première condamnation radicale des violences subies par les Juifs à cette époque, formulée par des tenants incontestables de l’historiographie française la plus légitime. Qu’elle s’inscrive dans la démarche si favorable à la construction d’un ordre républicain d’un Ernest Lavisse, qu’elle relève par conséquent des valeurs essentielles du prophète officiel de la IIP République qui se construit difficilement dans un combat contre les défenseurs d’un ordre catholique traditionnel, mais aussi contre l’hostilité émanant d’un mouvement ouvrier d’inspiration socialiste ou marxiste trouvant de nombreux relais sur la scène universitaire, voilà un constat, aujourd’hui encore, de première importance. Reste que ce grand instituteur de la République a quelque peu échoué dans son entreprise puisque son point de vue parvient à peine à se faire entendre parmi les grands ténors de l’historiographie inspirés fréquemment par un économisme sommaire d’inspiration souvent marxiste, qui les éloigne des questions culturelles et les incite même parfois à faire leurs des points de vue très hostiles aux Juifs. Reste aussi que ces rares audacieux qui ne mâchent pas leurs mots et dénoncent vivement les décisions de l’Empereur ne paraissent guère entendus et demeurent relégués à la périphérie de l’historiographie.
L’affaire Anchel
Un détour par l’affaire Robert Anchel s’impose. Issu des milieux juifs de Metz et rattaché par sa famille tant à des rabbins qu’à des savants comme les frères Darmesteter, profondément intégré également, par ses deux épouses successives, aux milieux juifs, Robert Anchel devient élève
- G. Pariset, Le Consulat et l’Empire, dans Ernest Lavisse (dir.), Histoire de la France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919, Paris, Hachette, 1921, pp. 300-303.
(p.31) de l’Ecole des chartes avant de rejoindre, plus tard, les Archives nationales. En 1928, il soutient à la Sorbonne une thèse de doctorat intitulée « Napoléon et les juifs. Essai sur les rapports de l’État français et du culte israélite de 1800 à 1815 ». Pour la première fois, ce sujet se trouve traité de manière quasi exhaustive dans le cadre solennel d’une thèse présentée devant un jury où siège Albert Mathiez, son directeur de thèse. Pour David Feuerweker, l’un des meilleurs spécialistes contemporains de cette question, ce travail « peut être considéré comme une des plus importantes contributions à l’histoire des Juifs de France dans les vingt-cinq dernières années ‘ ». Pourtant les choses vont mal se passer : l’impétrant n’obtient, à la quasi-unanimité, qu’une pâle mention honorable qui lui barre définitivement la route vers les rares emplois de professeur d’université. Anchel doit faire face à l’une de ces gigantesques colères dont Mathiez se montre si souvent familier. Il est vrai qu’il manque de prudence, que son vocabulaire est parfois rude à l’égard de l’Empereur. Ironiquement, il écrit par exemple : « C’est ainsi que, par un dimanche de printemps, Napoléon et Molé s’entretenaient du Talmud qu’ils n’avaient apparemment lu ni l’un ni l’autre2 » ; Anchel souligne la « malveillance » des questions posées à l’Assemblée des Notables3, les « idées préconçues de Molé qui pose en principe que la Bible a enseigné la haine du prochain4 », il dénonce les « erreurs » de Napoléon5, sa « contradiction singulière », lui qui « voulait que les Juifs devinssent frères des Français » et qui « ordonne des mesures spéciales d’exception et d’oppression 6 » ; il voit dans le règlement organique du culte juif imposé au Sanhédrin « un acte d’oppression tyrannique contre la liberté de conscience7» et, dans le décret de mars 1808, «un grand mépris du droit, […] un décret aussi arbitraire que draconien » instaurant un véritable « régime d’oppression8 » qui « heurte les idées modernes par les atteintes qu’il porte à l’égalité civique9 ».
- David Feuerweker, «Robert Anchel (1880-1951)», Revue des études juives, janvier-décembre 1953, p. 58. De même, Georges Weil considère qu’Anchel était « un historien objectif et scrupuleux », Encyclopedia Judaica, p. 940. Il estime aussi que sa thèse a été « injustement accueillie par la critique universitaire », « Les Juifs d’Alsace, cent ans d’historiographie », Revue des études juives, CXXXIX, janvier-septembre 1980, p. 103.
- Robert Anchel, Napoléon et les Juifs, op. cit., p. 93. ; 3. Ibid., p. 169. Voir aussi p. 181. ; 4. Ibid., p. 183.; 5. Ibid., p. 188.; 6. Ibid., p. 213.; 7. Ibid., p. 238.; 8. Ibid., p. 280 et chap. 9. ; 9. Ibid., p. 351.
(p.32) Afin de démonter l’argumentation solidement construite d’Anchel, Mathiez s’appuie sur les travaux de Philippe Sagnac, le successeur d’Aulard à la Sorbonnel, alors titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution française auquel il vient de succéder brièvement, un Sagnac issu d’une autre tradition intellectuelle que la sienne et qui a travaillé autrefois sous la direction d’un Ernest Lavisse incarnant les valeurs républicaines. (…) À vrai dire, l’analyse de Sagnac, tout à fait exceptionnelle chez un historien non juif, peut satisfaire plus aisément Mathiez car, tout libéral qu’il soit, ce dernier ne cesse de justifier la politique de Napoléon, qui trouve grâce à ses yeux. Si Sagnac souligne, contrairement à Mathiez, la rupture entre la Constituante et Napoléon en écrivant que Napoléon « n’hésite pas à placer les Israélites dans une classe d’exception et à détruire ainsi les effets du grand décret de l’Assemblée constituante3 », il adopte néanmoins, sans y prendre garde, un vocabulaire particulièrement sévère à l’égard des Juifs que l’on trouve davantage sous la plume de leurs adversaires ou même sous celle de… l’Empereur. À ses yeux, les Juifs pratiquent l’usure en Alsace avec « âpreté et insolence », les jeunes israélites se dirigent vers la banque et le commerce « où les porte leur penchant héréditaire » ; pour lui, comme une « bande » de 20 000 Juifs exploite l’Alsace, on comprend que Napoléon ait voulu rassurer les chrétiens « victimes de la rapine juive4 ».
(…) 4. Philippe Sagnac, « Les Juifs et Napoléon (1806-1808) », op. cit., pp. 461, 463, 466 et 475. Notons que si Mathiez passe sous silence le rétablissement de l’esclavage des Noirs des colonies, Sagnac considère que leur révolte peut être assimilée à… la contre-révolution ! Voir Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, op. cit., p. 212.
(p.36) La conclusion s’impose d’elle-même : Anchel ne peut devenir un véritable historien, car il n’a pas su « s’extérioriser ». Vient enfin le coup de grâce, repris à l’identique dans le rapport écrit comme dans le texte publié par les Annales historiques de la Révolution française : « M. Anchel a sans doute une excuse. Il appartient à la race des persécutés. Il a cru faire œuvre pie en s’instituant non seulement leur historien mais leur vengeur2. » On se frotte les yeux, on se demande quelle mouche a piqué Mathiez, le grand historien de la Révolution française, le chantre de Robespierre qui vient juste de quitter le Parti communiste. A-t-il jamais dans son œuvre comme dans ses divers articles utilisé l’expression de « race » qui jure avec ses interprétations en termes de classes, expression lourdement chargée de sens durant cet entre-deux guerres où s’exacerbent, en France, les préjugés antisémites et les actes xénophobes et qu’il semble être le seul, parmi tous les historiens de cette époque, à utiliser, du moins une fois, en cette occasion précise ?
- Albert Mathiez, « Robert Anchel, « Napoléon et les Juifs » », op. cit., pp. 377, 379, 381, 383 et 384. P. Leuilliot approuve les critiques de Mathiez. Voir « Quelques textes en marge d’une thèse : l’usure judaïque sous l’Empire et la Restauration », Annales historiques de la Révolution française, 1930, t. 7, pp. 231-250.
- Ibid., pp. 381-382.
- A. Aulard, La Révolution française, janv.-décembre 1928, pp. 269-270. La « méthode historique, écrit-il, semble appliquée avec le soin le plus heureux », (p. 268).
- Edouard Driault, « Napoléon et les Juifs », Revue historique, mai-août 1928, p. 284 et 296. L’auteur considère, par exemple, que le régime imposé par Napoléon aux Juifs ne constitue pas un « régime d’oppression », comme le pense Anchel, mais seulement un « régime d’exception » (p. 293). Notons que Driault, dans un court article nécrologique consacré à Mathiez, écrit : « Dans la révolution, il ne voyait que Robespierre […] il ne nous pardonnait pas d’avoir obtenu du gouvernement de la République la commémoration solennelle du centenaire de la mort de Napoléon. Conséquence : il y vit une manifestation bonapartiste du fascisme avant la lettre. Il ne s’en tint pas à cette intransigeance et, par intervalles, il vit quelque chose de la pensée de Robespierre dans les réalisations de Napoléon », Revue des études napoléoniennes, mai 1932, p. 319.
(p.40) En 1968, dans son Napoléon, il consacre quelques pages au déroulement de l’Assemblée des notables et du Sanhédrin, examine de manière précise le décret de 1808, sans aucun autre commentaire que le suivant : « II n’est pas douteux que, par ces textes, Napoléon ait hâté l’émancipation et l’assimilation des Juifs. Mais il pouvait se croire désormais le chef de la religion juive comme il pensait l’être des Églises protestantes et catholiques3. »
- Jacques Godechot, « Les Juifs de Nancy de 1789 à 1795 », Revue des études juives, LXXXV, 1928. Voir le compte rendu qu’en donne Albert Mathiez dans Annales historiques de la Révolution française, 1929, t. 6, pp. 306-308.
- Jacques Godechot, Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1951, pp. 627 et 632-633. Il reprend les mêmes termes – « caractère discriminatoire et parfois vexatoire » — dans son livre L’Europe et l’Amérique à l’époque napoléonienne, Paris, PUF, 1967, p. 91.
- Jacques Godechot, Napoléon, Paris, Albin Michel, 1968, pp. 180-181.
(p.47) Le 28 janvier 1806, Napoléon reçoit les plaintes des « chrétiens d’Alsace » contre les agissements des Juifs, point de départ qui l’incite à prendre des mesures exceptionnelles contres les « corbeaux », contre « l’hydre » qui pourrait « répandre son venin destructeur sur le sol de la fertile Alsace. »
(p.48) Le 19 février 1806, un décret précise que « la fête de saint Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique seront célébrées, dans toute l’étendue de l’Empire, le 15 août de chaque année, jour de l’Assomption et époque de la conclusion du Concordat » ; (…).
(p.49) Le 17 mars 1807 sont signés par l’Empereur les trois décrets, dont le décret « infâme », qui représentent une formidable atteinte à la simple citoyenneté des Juifs.
(p.50) Déclaration de Napoléon au Conseil d’Etat (16/08/1800) : « Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l’être. C’est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C’est en me faisant catholique que j’ai gagné la guerre en Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Egypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si ! je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. »
(p.51) « Une foi, une loi, un roi », tel était le mot d’ordre qui justifiait autrefois le combat contre les protestants ainsi que la révocation de l’édit de Nantes4. La Révocation qui marque dramatiquement le refus de l’Autre en tant que protestant se produit en 1685, la même année, curieusement, où se trouve promulguée l’ordonnance royale qui sera connue sous le
- Barry O’Meara, Napoléon dans l’exil, Paris, Fondation Napoléon, 1993, t. 1, p. 187. Voir Didier Le Gall, Napoléon et le Mémorial de Sainte-Hélène. Analyse d’un discours, Paris, Kimé, 2003, p. 73.
- Henri-Gratien Bertrand, Cahiers de Saint-Hélène, janvier-mai 1821, vol. 3, Paris, Albin Michel, 1959, p. 105. Sur ce point, Antoine Casanova, Napoléon et la pensée de son temps, op. cit., chap. 1.
- Rodney Dean, L’Eglise constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801, Paris, R.J. Rodney, 2004, p. 711. Curieusement, l’auteur ajoute : « L’accord avec les protestants rendait impossible les guerres de religion ; l’Édit de Nantes et sa révocation étaient tacitement effacés. Celui avec les juifs montrait l’esprit tolérant et éclairé du nouveau régime », p. 711.
- Elisabeth Labrousse, Une foi, une loi, un roi ? La Révocation de l’édit de Nantes, Paris, Genève, Labor et Fidès, 1985.
(p.52) nom de Code noir. Or ce texte, qui régit la vie des esclaves des plantations des îles avec une violence telle qu’elle la transforme en un calvaire, qui nie radicalement l’identité des Noirs lesquels néanmoins « seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine » (art. 2), ce texte donc, document destiné à organiser minutieusement l’esclavage des Noirs, déclare, dans son article premier, de manière incongrue et surréaliste : « Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à peine de confiscation de corps et de bien1.» Les îles tout comme la métropole ne doivent ainsi connaître qu’une foi, une loi, un roi : si les esclaves noirs, tenus dans l’esclavage le plus rigoureux, peuvent néanmoins devenir catholiques à l’image de leurs maîtres, les Juifs quant à eux s’en trouvent purement et simplement chassés.
(p.60) Passé le temps du culte de la Raison et de la déchristianisation qui voit toutes les religions combattues et délégitimées, les églises de même que les temples et les synagogues étant souvent vandalisés ou occupés, par exemple, par les armées, une fois la Terreur abolie, c’est, sans aucun doute, le Concordat qui représente l’étape cruciale durant laquelle se trouve à nouveau abordée cette question jamais résolue du catholicisme ou du christianisme comme religion dominante jusqu’au cœur d’une nation de citoyens désormais égaux. Cette fois, c’en est terminé de la Constitution civile du clergé : l’Église retrouve toute sa place au sein de
la nation ; en revanche, les Juifs en sont de nouveau quasi exclus.
(p.62) Le retour en grâce du catholicisme2 va ainsi de pair avec une critique du judaïsme accusé de conserver ses propres règlements, ceux « sous lesquels il a toujours vécu », critique qui annule implicitement les acquis de 1791 et l’entrée des Juifs au sein de l’espace public, impliquant la soumission aux lois communes. Ce regard très sévère sur une émancipation qui n’aurait pas porté ses fruits, dans la mesure également où les Juifs demeureraient un « peuple » à l’écart de leurs concitoyens, prend de plus place, soulignons-le, au moment même où, en mai 1802, l’Em-
j-pereur rétablit l’esclavage qui avait été aboli en février 17943. De nouveau, la remise en question du sort des Juifs émancipés en septembre 1791, qui laisse prévoir les mesures exceptionnelles de mars 1808, correspond à la dramatique détérioration du destin des Noirs
des îles d’Amérique, soumis au bon vouloir des colons blancs.
- Jean Baubérot soutient, au contraire, que le Concordat constitue la « première laïcisation », Vers un nouveau pacte laïque, Paris, Le Seuil, 1990, pp. 33 et suivantes.
- Carolyn Fick, « The French Revolution in Saint-Domingue », in David Barry Gaspar et David Patrick Geggus (dir.), A Turbulent Time, op. cit. Jean Daniel Piquet, L’Emancipation des Noirs dans la Révolution française (1789-1795), Paris, Karthala, 2002. Yves Benot et Marcel Dori-gny (dir.), Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises ; ruptures et continuités de la politique coloniale française, aux origines d’Haïti, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003.
(p.63) Si les protestants bénéficient d’un statut définitivement acquis, quoique l’un des leurs ne puisse devenir consul, les Juifs, tout comme les Noirs, voient implicitement s’écrouler la législation révolutionnaire qui les reconnaissait comme citoyens égaux aux autres en droits et privilèges. La régression napoléonienne dans ces deux domaines est immense. Si le sort des Juifs est infiniment moins cruel puisqu’ils ne retournent pas à l’esclavage, mais simplement à leur condition antérieure à 1789, ils sont désignés, comme autrefois, comme un peuple qui, ayant préservé son identité et ses lois au sein de la nation, souhaite demeurer à l’écart en n’ayant que Dieu pour législateur. Ce statut dérogatoire annonce les mesures exceptionnelles que l’Empereur va prendre contre eux dès 1806, soit quatre ans plus tard. À tel point qu’en 1802, à l’égard des Noirs, tout comme, en 1807-1808, vis-à-vis des Juifs, on redoute la dégradation du «sang français » et on limite aussi sévèrement, pour les uns comme pour les autres, la liberté de circulation sur certaines parties du territoire.
Portalis entend respecter l’« éternité » du « peuple » juif, autant dire le tenir à l’écart : on ne prétend plus le régénérer, intégrer individuellement ses membres, les élever à la dignité d’une Grande Nation qui retrouve ses rêves d’unité religieuse en s’éloignant des idéaux universalistes de 1789. Le Concordat, pas décisif vers l’instauration de cette « monarchie chrétienne », annonce les mesures discriminatoires prises bientôt à l’égard des Juifs qui s’entêtent à préserver leurs croyances au sein d’une nation qui, comme autrefois, les a reconnus égaux à l’instar des autres religions.
(p.71) /En 1806,/ en février, Bonald publie son article « Sur les Juifs », qui exerce une telle influence sur Napoléon que ce dernier en reprend plus tard certaines images. Pour Bonald, « les Juifs ne peuvent pas être, et même, quoiqu’on fasse, ne seront jamais citoyens (p.72) sous le christianisme sans devenir chrétiens. […] Je pense qu’un gouvernement qui a l’honneur de commander à des Chrétiens, et le bonheur de l’être lui-même, ne doit pas livrer ses sujets à la domination de sectateurs d’une religion ennemie et sujette du christianisme : les Chrétiens peuvent êtres trompés par les Juifs, mais ils ne doivent pas êtres gouvernés par eux1 ». Remarquons qu’à l’autre extrême de l’échiquier politique, l’abbé Grégoire, qui défend inlassablement leur cause, n’en est pas moins implicitement d’accord sur ce point avec Bonald et, par conséquent, avec l’Empereur dont il critique pourtant la politique hostile aux Juifs. Déjà en 1787, dans son fameux Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, Grégoire écrivait : « Lions-les à l’État par l’espérance de la considération publique et le droit d’arriver à tous les offices civils dans les diverses classes de la société. Une loi fondamentale de quelque pays exclut des charges ceux qui ne sont pas de la religion dominante : cette proposition sévère est-elle toujours juste ? Nous ne proposons pas d’admettre les Juifs à être procureurs ; on sent pourquoi […] il serait toutefois abusif que, par leur disposition dans la société, ils puissent influer sur une religion dont ils naissent ennemis déclarés2. » En ce début de l’année 1806, lorsque l’Empereur songe à appliquer aux Juifs des mesures spécifiques, il s’entretient à Saint-Cloud avec le très conservateur et catholique Molé. Il a retenu la leçon de Bonald mais également peut-être celle de Grégoire : « Je ne prétends pas, dit-il, dérober à la malédiction dont elle est frappée cette race qui semble avoir été seule exceptée de la rédemption, mais je voudrais la mettre hors d’état de propager le mal qui ravage l’Alsace et qu’un Juif n’eût pas deux morales, l’une dans ses rapports avec ses frères, l’autre dans ses rapports avec les Chrétiens3. » Entre 1787 et 1806, en dépit des mesures d’émancipation de 1791, peu de choses ont donc changé. Au début de l’année 1806, à la suite de la grande discussion au Conseil d’État où se trouvent examinées les mesures à prendre contre les Juifs, Napoléon, « après être revenu de la messe », s’interroge à haute voix devant Mole : « Jusqu’à quel point, lance-t-il, des gouvernements éclairés et chrétiens pourraient-ils le [le peuple juif] relever quelque peu de son abaissement4 ? »
- Louis de Bonald, « Sur les Juifs », Mercure de France, 8 février 1806, pp. 260 et 265.
- Abbé Grégoire, Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs, Paris, Flammarion, « Champs », 1988, pp. 155-156.
- Marquis de Noailles, Le Comte Mole, 1781-1855, Paris, H. Champion, 1922, t. 1, p. 98.
- Ibid., t. 1, p. 97.
(p.74) Alors que se met en place, au même moment, une noblesse d’Empire pourvue de biens, de revenus et de titres glorieux qui, quoique fondée sur le mérite et distincte en cela de la noblesse féodale, symbolise la naissance d’un ordre social proche, par certains aspects, de celui de l’Ancien Régime, avec ses fiefs, son apparat, ses costumes flamboyants, symboles de puissance sociale, ses châteaux, on mesure mieux la fragilité de ces notables juifs au statut incertain. Le contraste est sans mesure entre la magnificence du régime qui s’installe, ses ors et ses dorures, les diamants et les diadèmes, la splendeur des réceptions, des habits ou encore des vaisselles2, et, à l’exception de quelques-uns d’entre eux, leur profonde marginalité sociale. Une chose est claire : leur destin n’est en rien comparable à celui de cette nouvelle noblesse d’Empire qui fusionne avec l’ancienne aristocratie au moment même où leur sort va se jouer. Tout les sépare de ces « masses de granit » sur lesquelles Napoléon Bonaparte entend construire l’ordre nouveau dont ils se trouvent, de fait, exclus3.
- Voir le catalogue Napoléon, Bernard Chevallier (dir.), Tennesse, Wonders, 1993, ainsi que le catalogue Napoleone et il su tiempo, Carrara, Sociéta Editrice Buonaparte, 2001.
- Jean Tulard, Napoléon et la noblesse d’Empire, Paris, Tallandier, 1979. Natalie Petiteau, Élites et mobilités : la noblesse d’Empire au XIXe siècle (1808-1914), Paris, La Boutique de l’Histoire, 1997. Sur les représentations picturales de la noblesse d’Empire, Yveline Cantarel-Besson, « La société », in Yveline Cantarel-Besson, Claire Constans et Bruno Foucart, Napoléon. Images et Histoire, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2001.
(p.78) le rapport de l’abbé Grégoire, violemment critique à l’encontre des patois (sic) comme marque d’attachement à des identifications régionales, ou encore celui de Barère hostile à l’allemand ou à l’italien, à toutes les langues étrangères qui freinent l’intégration à la nation 1.
- Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois (sic), Paris, Gallimard, 1975
(p.79) En 1803, Karl Wilhelm Grattenauer, dans son essai intitulé Contre les Juifs, qui connaît un tel succès de vente qu’il provoque à son tour un immense débat, appréhende lui aussi les Juifs comme des Orientaux étrangers, une race vouée à l’esclavage comme dans l’Egypte ancienne : dans cette logique, leur donner des droits civiques s’apparente à un « blasphème jacobin », à du « sansculottisme ‘ ».
C’est dire à quel point tous ces auteurs rejettent le rêve émancipateur’ de la Révolution française, incompatible avec la nature fondamentalement orientale des Juifs. En France également, au même moment, la négativité de l’Orient demeure grande en dépit de rêves de domination de ces contrées lointaines : pour tous, ou presque, l’Orient c’est le passé, la dégénérescence, la faiblesse. En 1806, le vicomte de Bonald publie, cette fois dans le camp réactionnaire, son article incendiaire, « Sur les juifs », dans lequel il se réfère explicitement aux observations d’Herder concernant le caractère asiatique des Juifs et évoque leur « marche insensible d’Asie vers l’Europe », instaurant un lien explicite avec ces théoriciens allemands de l’orientalisme juif2. Dès la première page de ce pamphlet venimeux qui justifie la remise en question des mesures d’émancipation de septembre 1791, il estime que « ce peuple voyageur, dans sa marche insensible de l’Asie vers l’Europe, a dû s’arrêter d’abord aux contrées européennes plus voisines de l’Orient et des lieux qui ont été son berceau3». Que l’on se déclare courageusement en faveur de leur émancipation ou, au contraire, que l’on souhaite leur expulsion
- Ibid., chap. 5. Voir aussi Peter Erspamer, The Elusiveness of Tolerance : the «Jewish Question » from Lessing to the Napoleonic Wars, Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1997, et Dominique Bourel, « La judéophobie savante dans l’Allemagne des Lumières : Johann David Michaelis », in Ilana Zinguer et Sam Bloom (dir.), L’Antisémitisme éclairé, Leiden, Brill, 2003.
- Louis de Bonald, « Sur les Juifs », Mercure de France, 8 février 1806, p. 266.
- Ibid., p. 249.
(p.80) d’une nation chrétienne, les Juifs se trouvent donc chaque fois associés à l’Asie comme forme extrême d’orientalisme, d’étrangeté, d’éloignement. Bonald en est à ce point convaincu qu’il ne recule devant aucune fantasmagorie propre à frapper ces concitoyens : il s’attarde ainsi longuement à décrire « à quelles horribles extrémités les Juifs devenus les maîtres se sont portés envers les Chrétiens en Chypre et en Afrique ‘ », autant de contrées exotiques qui incarnent elles aussi, à des degrés divers, cet Orient que tout distingue de l’Europe chrétienne.
Attentif aux discours de Bonald et aux plaintes des « chrétiens d’Alsace » qui n’ont que faire de ces étrangers envahissants, Napoléon fait sienne cette orientalisation des Juifs qui lui a été soufflée par les divers et nombreux partisans du renouveau d’un christianisme militant, tant en France qu’en Allemagne, vision négative qui ne peut que susciter un regard profondément hostile à leur encontre. La France chrétienne en pleine renaissance semble s’éloigner de la France révolutionnaire qui a eu le tort d’accueillir ce « peuple venu d’Asie ». Tournant de ce point de vue radicalement le dos à 1789, l’Empereur partage davantage les préjugés du jacobin antisémite Hell que la générosité de l’abbé Grégoire ou encore celle de Robespierre. Hell, l’adversaire résolu des Juifs, le député de l’Alsace où l’antisémitisme se révèle à son paroxysme, avait pris à leur égard une position extrême, en décembre 1789, lors du débat décisif où l’on avait examiné l’accès aux fonctions de l’Etat des adeptes des religions minoritaires. Cherchant à présenter ces Juifs si détestés par les populations chrétiennes locales, peu importe, avait-il dit à l’Assemblée nationale, « que les juifs d’Alsace sont ou ne sont pas des juifs de Jérusalem, ceux d’Alexandrie ou de ceux d’une autre partie de l’Asie ». Là encore, pour faire prendre conscience à ses collègues de l’étrangeté des Juifs qui n’ont décidemment rien à voir avec les populations rurales et chrétiennes d’Alsace ou d’ailleurs, c’est bien la mystérieuse Asie qui se trouvait sollicitée comme image/repoussoir par excellence2. Napoléon se révèle le fidèle héritier de ce jacobin antisémite tout comme celui de Saint-Just, l’archange de la Terreur, qui, toujours en Alsace, « donna satisfaction aux bourgeois de Strasbourg par sa conduite antisémite3 » :
- Ibid., p. 266.
- Archives parlementaires, 24 décembre 1789, p. 778. En septembre 1837, en Alsace, on retrouve cette image des Juifs ayant conservé leurs caractères orientaux et qui doivent, du même coup, demeurer à l’écart de la société chrétienne dans un rapport du conseil municipal d’Altkirch qui s’oppose, pour cette raison, à la transformation du statut de l’école juive en école communale. Cité par Michael Robert Shurkin, French Nation Building, Libéralisation and the Jews of Alsace and Algeria, 1815-1870, Ph.d. Yale University, 2000, p. 102.
- Albert Ladret, Saint-Just ou les vicissitudes de la vertu, Lyon, PUL, 1989, p. 218.
(p.81) à travers les préjugés de Napoléon s’expriment donc aussi bien les valeurs de certains révolutionnaires que celles de Bonald, le contre-révolutionnaire.
Son langage, les métaphores, les images dont il use tout au long de sa vie pour désigner les Juifs se révèlent en tout point semblables à ceux de Hell ou de Bonald : c’est bien parce qu’ils viennent de loin que, à ses yeux, les Juifs font figure de dégénérés, d’Orientaux menaçants que l’Europe doit tenir à l’écart. Le 30 avril 1806, Napoléon préside une séance du Conseil d’État où l’on discute de la légalité des mesures exceptionnelles à prendre envers les Juifs pour répondre aux plaintes venues d’Alsace. Après avoir entendu, de la bouche de Beugnot, des paroles favorables au maintien des principes universalistes sur lequel repose le droit, il prend à son tour la parole et, fort en colère devant la pusillanimité de Beugnot, façonnée par l’idéologie des droits de l’homme qu’il abhorre, déclare durement :
« La législation est un bouclier que le gouvernement doit porter partout où la propriété publique est attaquée. Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les deux beaux départements de l’ancienne Alsace ; il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C’est une nation dans la nation ; je voudrais leur ôter, au moins pendant un temps déterminé, le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs ; ils ont remplacé la féodalité ; ce sont de véritables nuées de corbeaux. On en voyait aux combats d’Ulm qui étaient accourus de Strasbourg pour acheter des maraudeurs ce qu’ils avaient pillé.
« II faut prévenir, par des mesures légales, l’arbitraire dont on se verrait obligé d’user envers les Juifs, ils risqueraient d’être massacrés un jour par les chrétiens d’Alsace, comme ils l’ont été si souvent, et presque toujours par leur faute.
« Les Juifs ne sont pas dans la même catégorie que les protestants et les catholiques. Il faut les juger d’après le droit politique, et non d’après le droit civil, puisqu’ils ne sont pas citoyens.
« II serait dangereux de laisser tomber les clefs de la France, Strasbourg et l’Alsace, entre les mains d’une population d’espions qui ne sont point attachés au pays. Les Juifs autrefois ne pouvaient pas même coucher à Strasbourg ; il conviendrait peut-être de statuer aujourd’hui qu’il ne pourra pas y avoir plus de cinquante mille Juifs dans le Haut et le Bas-Rhin ; l’excédent de cette population se répandrait à son gré dans le reste de la France. »
(p.82) « On pourrait aussi leur interdire le commerce, en se fondant sur ce qu’ils le souillent par l’usure, et annuler leurs transactions passées comme entachées de fraude.
« Les chrétiens d’Alsace et le préfet de Strasbourg m’ont porté beaucoup de plaintes contre les Juifs lors de mon passage dans cette ville ‘. »
La charge est d’une violence extrême : les Juifs font figure, par vocation, de traîtres, de pilleurs qui ne sont « pas de la même catégorie que les catholiques et les protestants », et encore moins que les « Gaulois » qui, eux, savent défendre avec la vigueur qui est la leur la patrie contre tous ses ennemis venus de l’étranger2, ces mêmes Gaulois dont se réclamaient, eux aussi, les sans-culottes en lutte contre l’étranger3. Aux yeux de l’Empereur, ils forment toujours « une nation dans la nation » qui menace à tout moment de trahir la France en ouvrant à l’ennemi les portes de Strasbourg, une « nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses », d’autant plus qu’elle forme dorénavant une nouvelle « féodalité ». Cette image fera fureur et, tout au long du XIXe siècle, on verra d’innombrables caricatures intitulées « Les nouveaux féodaux », représentants des Juifs aux traits physiques profondément sémites, triomphants, chevauchant, avachis, le dos des nobles portés à leur tour par de vigoureux paysans qui croulent, ou presque, sous le poids. Par un renversement inattendu, les Sémites venus d’Orient, aux traits grossiers et bestiaux, menacent ainsi de prendre littéralement le dessus, de constituer une nouvelle féodalité avide à exploiter, comme autrefois, le peuple chrétien, innocent et laborieux, qui appelle au secours son empereur.
Un peu plus tard, le 7 mai, toujours dans le cadre de l’enceinte solennelle du Conseil d’État, l’Empereur reprend la parole :
« On me propose d’expulser les Juifs ambulants qui ne justifieront pas du titre de citoyens français, et d’inviter les tribunaux à employer contre l’usure leur pouvoir discrétionnaire ; mais ces moyens seraient insuffisants. La nation juive est constituée, depuis Moïse, usurière et oppressive ; il n’en est pas ainsi des chrétiens : les usuriers font exception parmi eux et sont mal notés.
- Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon sur divers sujets, Paris, Firmin Didot Frères, 1833, pp. 214-215. Ces textes de Pelet de la Lozère sont repris dans Napoléon, ses opinions et jugements sur les hommes et sur les choses, recueillis par ordre alphabétique avec une introduction et des notes par Jean-Joseph Damas-Hinard, Paris, Dutey, 1838, t. 2, pp. 11-13.
- Sur la présence du thème des « Gaulois » dans le discours de Napoléon, Didier Le Gall, Napoléon et le Mémorial de Sainte-Hélène. Analyse d’un discours, Paris, Kimé, 2003, pp. 146-147, 245.
- Bronislaw Baczko, « Le calendrier républicain. Décréter l’éternité », m Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984, p. 83.
(p.83) Ce n’est donc pas avec des lois de métaphysique qu’on régénérera les Juifs ; il faut ici des lois simples, des lois d’exception ; on ne peut rien me proposer de pis que de chasser un grand nombre d’individus qui sont hommes comme les autres ; la législation peut devenir tyrannique par métaphysique comme par arbitraire. Les juges n’ont point de pouvoir discrétionnaire ; ce sont des machines physiques au moyen desquelles les lois sont exécutées comme l’heure est marquée par l’aiguille d’une montre : il y aurait de la faiblesse à chasser les Juifs ; il y aura de la force à les corriger. On doit interdire le commerce aux Juifs, parce qu’ils en abusent, comme on interdit à un orfèvre son état lorsqu’il fait du faux or. La métaphysique a égaré le rapporteur au point de lui faire préférer une mesure violente de déportation à un remède plus efficace et plus doux. Cette loi demande à être mûrie ; il faut assembler les états généraux des Juifs, c’est-à-dire en mander à Paris cinquante ou soixante, et les entendre ; je veux qu’il y ait une synagogue générale des Juifs à Paris, le 15 juin. Je suis loin de vouloir rien faire contre ma gloire et qui puisse être désapprouvé par la postérité, comme on me le fait entendre dans le rapport. Tout mon conseil réuni ne pourrait me faire adopter une chose qui eût ce caractère ; mais je ne veux pas qu’on sacrifie à un principe de métaphysique et d’égoïsme le bien des provinces. Je fais remarquer de nouveau qu’on ne se plaint point des protestants ni des catholiques comme on se plaint des Juifs ; c’est que le mal que font les Juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple : ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France1. »
En dépit de son vocabulaire ostracisant, cette déclaration repose, par certains aspects, sur des perspectives émancipatrices clairement exprimées : pour l’Empereur, il ne faut pas « chasser » les Juifs ni les « expulser », mais simplement « corriger » leurs mœurs. Napoléon voit bien que des mesures exceptionnelles pourraient porter atteinte « à sa gloire » et « être désapprouvées par la postérité ». Cet enjeu minuscule mérite donc de la prudence, du doigté, du savoir-faire. Car si l’on condamne les principes métaphysiques protecteurs de l’égalité des citoyens, si l’on entend prendre en considération surtout « le bien des provinces » dont les porte-parole se plaignent de l’activité économique des Juifs, comment éviter, pour autant, de sévir en recourant à des dispositions contraires au droit ? Cette mise au point de l’Empereur est révélatrice de son état d’esprit au moment même où il convoque le Sanhédrin en l’invitant à prendre des mesures pour réduire « le mal » que répandent « ces chenilles, ces sauterelles qui ravagent la France », image qui provient, en droite
1 .Ibid., pp. 216-217.
(p.84) ligne, du discours révolutionnaire xénophobe qui accusait déjà les étrangers de l’intérieur de trahir le paysl et que fait sien Napoléon quand il soutient que « le plus grand de tous les crimes est d’introduire l’étranger l au sein de la patrie2 ». En usant d’un tel vocabulaire animalier, l’Empereur est-il influencé par des métaphores chrétiennes, qui qualifient facilement les Juifs de serpents, de vipères ou encore de scorpions, de chacals et de vermine3 ? Dans quelle mesure, en usant d’un tel langage animalier pour dénoncer le danger que représente leur présence en France, se trouve-t-il aussi influencé par la tradition révolutionnaire qui dévalorise ses adversaires en recourant également à des associations avec les animaux les plus repoussants, des monstres qui pillent et dévorent, telle la bête de Gévaudan, des hyènes, des loups mais aussi des porcs immondes qui souillent la société française innocente4 ? L’Empereur, qui a vécu le moment révolutionnaire jacobin, caricature à son tour les Juifs comme des animaux dépourvus de scrupules dont les traits repoussants trahissent non seulement la volonté de détruire mais aussi celle de trahir, pour peu , qu’ils résident en Alsace ; si on leur abandonne « les clefs de la France », ils ouvriront toutes grandes ses portes à ses pires ennemis. Le mal qui menace, complote, trahit la France est incarné désormais non par la noblesse mais bien par les Juifs qui servent, tout comme elle autrefois, des intérêts étrangers à la nation. Un peu plus tard, dans une lettre à Champagny, Napoléon reprend cette image, si connotée, de nouveaux féodaux, estimant qu’il importe d’« arracher plusieurs départements à l’opprobre de se trouver vassaux des Juifs ». L’empereur ajoute : « Lorsqu’on les soumettra aux lois civiles, il ne leur restera plus, comme Juifs, que des dogmes, et ils sortiront de cet état où la religion est la seule loi civile, ainsi que cela existe chez les Musulmans et que cela a toujours été dans l’enfance des nations5. » Si l’Empereur souligne, au cours de
- Ainsi, à l’époque de la Terreur, on peut lire dans un rapport : « Oui, sans doute, les orages partis de l’Autriche ou des côtes britanniques ont amené sur notre terre des insectes destructeurs mais dans ce gouffre d’abus que la Révolution a découvert, combien de reptiles impurs nous appartiennent ? » Cité par Sophie Wahnich, L’Impossible Citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1997, p. 119.
- Cité par Didier Le Gall, Napoléon et le Mémorial de Sainte-Hélène, op. cit., p. 125.
- Moshe Lazar, « The lamb and the Scapegoat », in Sander Gilman et Steven Katz (dir.), Antisemitism in time of crisis, New York, New York University Press, 1991, p. 55.
- Antoine de Baecque, Le Corps de l’histoire. Métaphores et politique (1770-1800), Paris, Cal-mann-Lévy, 1993, pp. 198-211 et, du même auteur, La Caricature révolutionnaire, Paris, Presses du CNRS, 1988. Sur la dénonciation de l’adversaire, Jacques Guilhaumou, L’Avènement des porte-parole de la République (1789-1792) : essai de synthèse sur les langages de la Révolution française, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1998.
(p.85) cette discussion du Conseil d’État, le 21 mai, « qu’aucune religion ne craint de ma part une persécution », ses préjugés n’en sont pas moins exprimés avec force, d’autant plus que, lors de la discussion du rapport Beugnot au Conseil d’État au début de l’année 1806, il accentuait son point de vue en déclarant : « Je dois la même protection à tous les Français et je ne puis regarder comme Français ces Juifs qui sucent le sang des véritables Français 1. » On ne saurait aller plus loin dans la remise en cause de leur citoyenneté, niée au nom d’un racisme biologique qui étonne chez cet homme influencé par les Lumières, bien que ce même racisme biologique qui dénonce les « races impures », celle des aristocrates au sang vicié, dégénéré, se soit fait aussi jour dans le discours révolutionnaire, par exemple sous la plume de Pétion ou encore de Robespierre2. Napoléon se montre décidé à recourir aux moyens extrêmes : en 1810, visitant les provinces du Brabant et de la Zélande, alors qu’il complimente les pasteurs, il s’en prend avec véhémence aux curés qui font allégeance au pape et s’exclame curieusement : « Si vous êtes de bons citoyens, je vous protégerai ; sinon, je vous chasserai de mon empire, je vous dissiperai comme des Juifs3. » L’idée de l’envahissement se révèle tenace : dans une lettre adressée à Jérôme, roi de Westphalie, l’Empereur ne se prive pas de lui dire qu’à ses yeux « rien n’est ridicule comme votre audience aux Juifs […]. J’ai entrepris de corriger les Juifs, mais je n’ai pas cherché à en attirer de nouveaux dans mes États. Loin de là, j’ai évité de faire rien de ce qui peut montrer de l’estime aux plus méprisables des hommes4 ». Plus tard encore, loin du pouvoir, en exil cette fois, l’Empereur déchu évoque de nouveau sa politique sévère à l’égard des Juifs en la justifiant par des raisons militaristes : de façon obsessionnelle, il revient sur l’idée d’envahissement, sur leur nombre élevé qu’il associe, de manière tout aussi fantasmatique, à leur supposée grande richesse dont il convient de profiter, appréciation qui relève purement et simplement des préjugés solidement ancrés : « Les Juifs, dit-il, étaient très nombreux dans les pays sur lesquels je régnais. […] J’aurais
- Cité in Marquis de Noailles, Le Comte Molé, 1781-1855, Paris, H. Champion, 1922, t. 1, p. 97.
- Antoine de Baecque, « Les discours anti-nobles (1787-1792). Aux origines d’un slogan : « Le peuple contre les gros » », Revue d’histoire moderne et contemporaine, janv.-mars 1989, pp. 19 et suivantes. Voir aussi Lucien Jaume, Le Discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1989.
- Cité m « L’origine et la signification de la loi du 18 Germinal An X », Bulletin de la S.H.P.F., 1902, p. 298.
- L. Lecestre, Lettres inédites de Napoléon 1er, Paris, Pion, 1897, t. 1. Lettre du 6 mars 1808, pp. 158-159.
(p.86) amené de grandes richesses en France parce que les Juifs sont très nombreux et qu’ils seraient accourus en foule1. » Du XIXe siècle à nos jours, dans l’imaginaire antisémite qui se réclame fréquemment de l’Empereur, cette image des Juifs venus de l’Orient lointain, « en foule », pour envahir et dénaturer l’Hexagone se répète inlassablement2.
(…) On peut néanmoins se demander dans quelle mesure Napoléon a aussi conservé en mémoire une image folklorique et orientaliste des Juifs de Palestine du temps de sa campagne d’Egypte, dont il rapproche parfois explicitement les mœurs de ceux des musulmans, demeurés, comme eux, en « enfance4 ». (…) En réalité, on ignore si Bonaparte a rencontré des Juifs durant son séjour en Palestine, lors, par exemple, de sa « visite aux fontaines de Moïse », de son entrevue avec « les pestiférés de Jaffa » ou encore, au moment des combats de Nazareth ou de Saint-Jean-d’Acre, épisodes illustrés par tant
1.Correspondance de Napoléon, t. 13, lettre du 25 nov. 1806, Paris, Gallimard, 1943.
—
- Barry O’Meara, Napoléon dans l’exil, Paris, Fondation Napoléon, 1993, t. 1, p. 166.
- Voir chap. 7.
- Edward W. Said, L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, Paris, Le Seuil, 2003. Said revient à plusieurs reprises sur l’expédition de Bonaparte en Egypte, première entreprise d’orien-talisation du monde musulman. Voir sa première partie, chap. 3 et 4, ainsi que sa deuxième partie, pp. 145 et suivantes. L’ouvrage de Said a suscité une littérature considérable. Voir récemment Robert Irwin, For Lust of Knowing. The Orientalists and their enemies, Londres, Allen Lane, 2006. Voir aussi David G. Jefireys (dir.), Views of Ancient Egypt since Napoleon Bonaparte : imperialism, colonialism and modem appropriations, London, UCL Press, 2003.
- Sur la campagne d’Egypte comme « rêve oriental », Jean Tulard, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, Fayard, 1977, chap. 5.
(p.87) de représentations picturales, très « couleur locale »1. Il a du moins une conscience minimale de leur existence puisque, dans sa correspondance, on trouve cet ordre adressé au général Destaing, en janvier 1799 : « Vous ferez prendre chez l’aga des janissaires les nommés : Haslan, Ibrahim, Yousuf, Chemali, Cader, la femme Settouts, la femme Mahekeké, tous Juifs. Vous ferez couper le cou aux cinq premiers et jeter dans l’eau des deux derniers2. »
- Yveline Cantarel-Besson, « Les campagnes », in Y. Cantarel-Besson, C. Constans et B. Fou-cart (eds.), Napoléon, images et histoire : peintures du château de Versailles (1789-1815), Paris, Réunion des Musées nationaux, 2001, pp. 130 et suivantes.
- Napoléon Bonaparte, Correspondance générale. La campagne d’Egypte et l’avènement, 1798-1799 (t. II), Paris, Fayard, 2005, p. 815.
(p.88) Napoléon semble partager la plupart des stéréotypes des antisémites de son époque, qu’ils appartiennent à la réaction ou, parfois, au camp révolutionnaire. À ses yeux, et son séjour en Palestine n’a pu que le conforter dans son opinion, les Juifs demeurent un peuple dégénéré, qui n’a pas encore accès à la civilisation occidentale ; en un mot, qui appartient toujours à cet Orient aux mœurs troubles. Ajoutons que l’Empereur qui, en 1802, vient de rétablir l’esclavage des Noirs aux îles en imposant par une féroce répression l’ordre impitoyable qui régnait avant février 1794 ne cache pas non plus, au même moment, ses préjugés à l’égard de cet autre « Oriental » qu’est le Noir africain. Un peu à la manière de Michaelis, il réunit, dans un même rejet de la dégénérescence orientale, les Juifs et les esclaves noirs des colonies, ceux précisément d’Haïti où Michaelis entend déporter les Juifs allemands pour les réduire à un esclavage conforme à leur véritable nature d’hommes du Sud.
(p.89) Talleyrand, son plus proche conseiller et qui exprime sa pensée intime, accentue encore cette vision raciste des Noirs, de « ces peuplades sauvages qui, par leurs mœurs féroces et leurs usages barbares, sont devenues étrangères au système de la civilisation. […] L’existence d’une peuplade nègre armée et occupant les lieux qu’elle a souillés par les actes les plus criminels est un spectacle horrible pour toutes les nations blanches2 ». (…)
Certes, il n’est pas question d’envoyer les armées « corriger » à leur manière, comme aux colonies3, les Juifs d’Alsace, pour le plus grand bienfait des « chrétiens d’Alsace ». Le projet invraisemblable, proprement
- Cité par Yves Benot, La Démence coloniale sous Napoléon, Paris, La Découverte, 1991, p. 89. ; 2. Ibid., p. 123.
- Yves Benot et Marcel Dorigny (dir.), Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises ; ruptures et continuités de la politique coloniale française, aux origines d’Haïti, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003. Thierry Lentz et Pierre Branda, Napoléon, l’esclavage et les colonies, Paris, Fayard, 2006.
(p.90) stupéfiant, de convoquer un Sanhédrin s’inscrit pourtant dans cette logique : à grand « mal », grand moyen. L’idée de participer à un tel Sanhédrin a dû paraître bien saugrenue aux yeux des notables juifs, mais aussi des rabbins convoqués par l’Empereur. On ignorera toujours qui a véritablement soufflé cette idée à Napoléon, d’où lui vient cette incroyable décision de faire revivre le Sanhédrin d’autrefois, avant la destruction du Temple et la dispersion. Le vocable lui-même, qui entre dans le discours politique durant plusieurs mois, symbolise ces contrées lointaines où, à l’abri du Temple, régnaient les grands prêtres. Par son étrangeté, par le mystère qu’il véhicule, il rejette les Juifs vers leur lointaine histoire mais aussi vers leurs contrées exotiques, au-delà de la Méditerranée, loin des terres chrétiennes. Napoléon veille à tous les détails : des ordres sont donnés qui imposent le port d’un étrange chapeau ou celui d’un costume, produits d’une imagination orientale dont on ne connaît pas l’auteur. Quelle image des Juifs des temps anciens se sont donc faites les collaborateurs de l’Empereur chargés de cette mise en scène ?
(p.93) Dans le tableau Le Grand Sanhédrin, les membres de cette assemblée, revêtus d’étranges accoutrements, se tiennent presque tous courbés, voûtés, aucune noblesse ni droiture n’émane de leur corps dont la posture évoque la soumission, la faiblesse, mais aussi le mystère, avec leurs longs vêtements noirs, leurs grandes barbes blanches qui tranchent dans cet ensemble baignant dans le gris, le passé, l’obscurité. Tous sont revêtus d’un costume qu’ils doivent porter impérativement pour entrer dans la salle, prescrit par le règlement officiel qui « consiste en un habillement complet en noir, manteau de soie de même couleur, chapeau à trois cornes et rabat3 ». Au centre, se faisant face, deux officiels habillés à la mode, jeunes, élégants, sans chapeau ni kippa, accentuent le contraste avec cette assemblée d’hommes de l’ombre. Sintzheim, portant le bicorne, siège à droite. Nul turban ni keffieh, forme habituelle de l’orientalisation symbolisant le monde arabe fort en vogue depuis l’expédition d’Egypte, n’est visible dans cette gravure ni dans aucune autre4. Les postures de soumission des membres du Sanhédrin détonnent dans une France de citoyens debout, avides de liberté et de fierté, et prennent une signification plus forte encore.
Témoigne aussi de cette orientalisation des Juifs la gravure célèbre de François Louis Couché, Napoléon le Grand rétablit le culte des Israélites, le 30 mai 1806, reproduite de manière répétitive, par exemple dans les livres scolaires, et qui a dû contribuer grandement à cette perception des Juifs comme profondément différents et étrangers. Chaque détail de cette gravure évoque immédiatement leur nature exotique. Napoléon, tel
- Diogène Tama, Collection des procès-verbaux et dérisions du Sanhédrin, Paris, 1807, p. 46.
- Ivan Davidson Kalmar, «Jésus did not Wear a Turban : Orientalism, the Jews and Christian Art », in I. D. Kalmar et D. Penslar (dir.), Orientalism and the Jews, op. cit.
(p.94) Moïse, tient les nouvelles Tables de la Loi, en pierre, de forme rectangulaire et non arrondie comme elles se présentent habituellement et sur lesquelles on peut lire, en français : « Lois données à Moïse ». Un personnage féminin symbolisant la Synagogue, figure alanguie, presque sensuelle, fragile, féminine à souhait, tient de sa main gauche les anciennes Tables de la Loi aux caractères hébraïques visibles, dont les deux parties, comme décalées, donnent l’impression d’êtres brisées. Ces Tables sont presque renversées, gisant sur la terre, abaissées. Cette allégorie dirige vers Napoléon son bras droit dans une attitude d’imploration qui témoigne aussi de sa volonté d’être relevée par l’Empereur quand il le jugera bon ; son identité est mise en évidence par un chancelier à sept branches ainsi que d’autres objets de culte qui figurent derrière elle. Cette figure de la soumission incarne un peuple juif passif, étranger à la force qui émane de l’empereur des Français. On la retrouve à l’identique dans plusieurs médailles où Napoléon, droit et majestueux, remet les nouvelles Tables de la Loi à un personnage courbé, plié en deux, les anciennes Tables, plantées dans la terre, étant toujours comme penchées, abandonnées1. Dans la gravure de Couché, le contraste entre Napoléon, puissant, triomphant, qui donne la vie, revêtu de ses riches habits d’empereur, portant de manière fort visible la couronne ainsi que les attributs de la Légion d’honneur, et cette femme dont l’attitude de soumission paraît comme renforcée par celle des Juifs suppliants, courbés, mendiants presque, agenouillés, est frappant. Il met en scène l’autorité, soulignée par la verticalité des traits qui encadrent l’Empereur, opposée à la servitude, la passivité, la lascivité, l’horizontalité que soulignent l’attitude implorante des bras tournés vers lui. Le spectateur se trouve renforcé dans ses convictions : Napoléon apporte la lumière régénératrice à un peuple avachi, étranger, surgi inchangé des contrées lointaines de l’Orient. D’autant plus qu’à ses côtés, symbolisant le corps rabbinique, implorant presque lui aussi, légèrement penché comme l’indiquent les plis de son habit, la posture des deux mains indiquant une recherche d’équilibre, unique personnage revêtu de noir, se tient Sintzheim en Moïse respectueux qui va transmettre la vérité aux membres du Sanhédrin que lui délivre Napoléon, dont l’éclatante blancheur accentue le contraste, lourd de symboles. Personnage de grand prêtre, il porte un
- D.M. Friedenberg, Jewish Medals : From the Renaissance to the Fall of Napoleon (1500-1815), New York, Clarckson N. Potter Publisher, 1970. Sarah Lawrence, « Napoleonic Medals of Jewish Emancipation in the Collection of the Jewish Museum, New York », in M. Buora (dir.), La tradizione dassica nella Medaglia d’Arte del rinascimento al Neoclassico, Triste, E.R., 1999.
(p.95) bonnet à deux cornes en hauteur aux connotations négatives qui évoquent, comme le notent Renée Neher-Bernheim et Elisabeth Revel-Neher, la figure de Satan, renforçant ainsi l’identification des Juifs au Mal, au Diable, au mystère étranger, en ce moment de forte régénération de la France sous la direction de son empereur1.
Parfois, les Juifs se moquent de l’image que Napoléon se fait d’eux. Selon la légende, sur le mode humoristique, des Juifs de Posen se déguisent ainsi en Turcs pour se distinguer des Polonais mais préviennent l’Empereur, en chuchotant : « Ne craignez rien, Votre Majesté, nous ne sommes pas turcs ! C’est seulement nous, les Juifs de Posen2. » II n’en reste pas moins que cette association des Juifs à l’Asie ou encore à l’Afrique, qui revient fréquemment dans les écrits et les discours, en ce moment charnière, entre Orient et modernité occidentale, éclate au grand jour dès les premières réunions du Sanhédrin et suscite l’étonnement, sinon la colère cachée, de ses membres. Les participants à l’Assemblée des notables l’appréhendent de façon purement négative. On le perçoit, en particulier, dès leur réponse à la première question qui leur est posée par l’Empereur : « Est-il licite aux Juifs d’épouser plusieurs femmes ? » Cette question en elle-même charrie tout un univers d’associations renvoyant les Juifs à leur orientalisme : elle revêt une importance telle dans l’idée que Napoléon se fait des Juifs qu’elle figure étrangement en tête de ce questionnaire destiné à déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent ou non prétendre à s’intégrer à la nation française. La polygamie représente une coutume associée indéniablement à l’Orient musulman, à la Turquie, aux harems des contes et légendes : elle hante une large partie de la littérature française du xvme siècle et structure sa vision orientaliste3. Même si Napoléon ne cache pas la « sympathie » qu’il ressent vis-à-vis du monde musulman4, s’il ne dédaigne pas de
- On s’inspire ici largement de l’analyse qu’elles donnent de cette gravure. Voir Renée Neher-Bernheim et Elisabeth Revel-Neher, « Une iconographie juive de l’époque du Grand Sanhédrin », in Bernhard Blumenkranz et Albert Sohoul (dir.), Le Grand Sanhédrin de Napoléon, Toulouse, Privât, 1970, ainsi que Renée Neher-Bernheim, « Les Juifs en France sous la Révolution française », in Le Tournant décisif. Les Juifs en France sous la Révolution et l’Empire, op. cit. Voir aussi Ronald Schechter, Obstinate Hebrews. Représentations ofjews in France, 1715-1815, Berkeley, Califomia University Press, 2003, pp. 207-209.
- Samuel Zanvel Pipe, « Napoléon in Jewish Folklore », YIVO Annual ofjeunsh Social Science, 1946, p. 296.
- Lisa Lowe, Critical Terrains. French and British Orientalisms, Ithaca, Cornell University Press, 1991, p. 56.
- Antoine Casanova, Napoleon et la pensée de son temps : une histoire intellectuelle singulière, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2000, pp. 91 et 104-105.
(p.96) « flirter1 » avec lui et exprime ouvertement son admiration à l’égard de Mahomet qui était « un grand homme » s’adressant malheureusement à « des peuples sauvages, pauvres, manquant de tout, fort ignorants2 », sa vision globale de l’Orient, en dépit du mirage égyptien, demeure profondément négative. Elle témoigne de la prétention de l’Occident à régénérer cet Orient malade, indolent, féminin en le modernisant par l’exportation des valeurs occidentales. Comme le souligne Jean-Richard Bloch, dans un article curieux et méconnu, Napoléon incarne, dans ce sens, « l’homme moderne », celui de la vitesse, non de la méditation ; en dehors de son entreprise conquérante qui l’a mené en Egypte, « il est probablement celui qui s’est le moins intéressé au monde oriental […]. Napoléon représente le premier exemple d’un grand homme entièrement cynique, dépourvu de tout respect à l’égard de l’Orient, ne ressentant aucune anxiété à l’égard du verbe oriental, c’est-à-dire chrétien3 ». Si l’on peut contester ce dernier point, ne peut-on voir dans l’attitude de Napoléon vis-à-vis des Juifs une conséquence de sa vision négative de l’Orient ? En définitive, il importe de moderniser, d’occidentaliser les musulmans d’Orient tout comme les Juifs d’Occident qui ont préservé leurs croyances issues de cette culture.
L’Empereur ne cache pas son aversion à l’égard des coutumes orientales, des mœurs en tout point opposées à celles régies par le Code civil. (…) Que la question de la polygamie ait pu être d’emblée posée aux notables juifs presque tous déjà profondément assimilés, en ce début du xixe siècle, révèle un degré d’ignorance et de fantasme rare qui les renvoie à cet Orient lointain et à jamais dissemblable. Ces notables ont certainement été ébahis, stupéfaits et probablement humiliés par une telle
- François Charles-Roux, « La politique musulmane de Napoléon », Revue des études napoléoniennes, janvier-juin 1925. Mary Katryn Cooney, « Egypt worth a Turban : Bonaparte’s Flirtation •with Islam », in A. Shniuelevitz (éd.), Napoleon and the French in Egypt and the Ho/y Land, Istanbul, The Isis Press, 2002.
- Correspondance de Napoleon, tome XXXX, pp. 569-570.
- Jean-Richard Bloch, « Napoleon, the Jews and the Modem Man », Menorah Journal, mars 1930, pp. 211 et 214.
(p.97) interrogation, par sa prééminence au sein de ce questionnaire qui véhicule tant d’incompréhension et de préjugés. Que les Juifs de Bordeaux, de Bayonne, d’Avignon, de Nancy ou de Metz, qu’ils soient sépharades ou ashkénazes, puissent être soupçonnés de polygamie, quatorze ans après leur émancipation par la Révolution prouve aussi la méconnaissance profonde de l’Empereur, révèle les préjugés de ses conseillers et probablement aussi l’image que l’Empereur s’est faite des Juifs lors de ses campagnes d’Egypte et de Palestine.
(p.102) Les vues de Bonald correspondent sans doute davantage à l’air du temps, comme le montre également le texte de L. Poujol, Quelques observations concernant les Juifs en général et plus particulièrement ceux d’Alsace paru lui aussi au début de l’année 1806. La dimension impressionnante fait de son texte véritablement un ouvrage clé, d’une rare violence, écrit en accord avec des députés alsaciens hostiles aux Juifs et qui mérite d’être lu de près. Pour Poujol, « le Juif, souple et adroit et dans la seule vue apparente de porter un secours charitable », pratique une usure éhontée au détriment des « classes les plus intéressantes de la société » et, principalement, des paysans trompés et sans défense. « Aux approches de la nuit », ils exercent donc impitoyablement l’usure comme un indispensable « devoir religieux », car le Talmud leur impose « de tromper » les non-Juifs en jouant sur leur « bonhomie et leur crédulité » ; échappant au service militaire, « ils sont les ennemis les plus dangereux des États » et servent même constamment d’espions. Dédaignant, de plus, les métiers utiles, telle l’agriculture, « ils n’ont fait aucun usage utile du droit de citoyen » ; dès lors, « le droit de citoyen conféré aux Juifs, bien loin de concourir à leur régénération, ne cessera d’y mettre un obstacle invincible3 ». La conclusion de cette longue diatribe s’impose d’elle-même :
- L. Poujol, Quelques observations concernant les juifs en général et plus particulièrement ceux d’Alsace, Paris, 1806 ; BNF, MFICHE 8 LD 184-64, pp. 43, 51, 54, 56, 66 et 73. Ces textes sont souvent cités mais ne sont guère lus attentivement. Voir R. Anchel, Napoléon et les Juifs, Paris, PUF, 1928, pp. 69 et suivantes.
(p.103) « Comment pourrait-on défendre aux Juifs de prêter à des cultivateurs, à des artisans, à des fils de famille ou à des militaires, sans détruire, à leur égard, la législation générale qui, comme citoyen, leur accorde la faculté indéfinie de passer avec toute espèce de personnes les actes et obligations qu’autorisé la loi ? Comment pourrait-on forcer les Juifs à se livrer à telle ou telle industrie, à donner telle ou telle éducation à leurs enfants et à faire tout ce que peut réclamer d’eux le bien et l’intérêt général, sans enfreindre ni violer, à leur égard, cette latitude et cette liberté que notre législation laisse à tous les citoyens ? Comment pourrait-on prendre des mesures plus sévères pour réprimer leurs délits, l’habitude qu’ils ont de receler les effets volés, d’altérer et de falsifier la monnaie ainsi que les matières premières d’or et d’argent, de faire l’espionnage, la contrebande, sans les soumettre à des lois d’exception ? […] Mais si en leur étant le droit de citoyen, on les place dans une classe d’exception […] le gouvernement pourra prendre contre eux toutes les mesures que commande l’intérêt général pour les rendre dignes un jour de ce titre si honorable […]. Il faut donc tirer cette conséquence qu’on ne peut prendre de mesures particulières contre eux sans leur ôter au moins temporairement le droit de citoyen1. »
Tout s’éclaire donc : il faut revenir sur les « lois imprudentes de l’Assemblée nationale », comme l’estime Bonald, remettre en question la citoyenneté que celle-ci a finalement accordée aux Juifs, les soumettre à des mesures d’exception pour transformer radicalement leur personnalité. Dans cet esprit, il s’agit bien de leur retirer la citoyenneté, de revenir sur leur émancipation, de leur imposer un statut dérogatoire qui les exclut de l’espace public, un peu comme le souhaitait déjà Portalis dans la conclusion de son rapport sur le Concordat2. L’Empereur, pourtant héritier de la Révolution, s’empresse de suivre à la lettre ces conseils profondément réactionnaires. Il retient la leçon de Poujol qui lui a fait parvenir deux exemplaires de son ouvrage, tient compte de ses recommandations, à savoir « anéantir les créances dues aux juifs », les contraindre à envoyer leurs enfants dans les écoles publiques, les empêcher de manger des produits kocher et d’étudier l’hébreu, ce «jargon» qui leur permet de
- Ibid., pp. 78-79. Diogène Tama s’élève immédiatement contre la proposition de Poujol de remettre en question temporairement la citoyenneté accordée aux Juifs en 1791. n considère que « la pensée du sieur Poujol réunit tous les vices » et ajoute : « Pourquoi donc faudrait-il, pour corriger des citoyens quelconques, ou pour les rendre meilleurs, remonter jusqu’au pacte social, l’annuler, l’abolk en ce qui les concerne et les rejeter avant tout dans le néant politique de l’abandon ». Collection des Actes de l’Assemblée des Israélites de France et du Royaume d’Italie, Paris, 1807, pp. 47 et 56.
- Edith Thomas estime que Napoléon partageait le « racisme » de Portalis ainsi que son « antisémitisme ». « Les décrets de 1808 », Évidences, 1959, n° 77, p. 28.
(p.104) « frauder », les obliger à se marier avec des chrétiens, réformer également leur religion en « en supprimant tout ce qui, n’étant que purement civil, n’appartient qu’à la législation civile, trouver enfin un moyen de contrôler les rabbins afin d’atteindre ainsi les fidèles ‘ ».
Pour commencer, Napoléon se propose de prendre un décret qui exclut pendant dix ans les Juifs du droit commun. Le 6 mars 1806, il dicte cette note destinée au Conseil d’État :
« La section de législation examinera :
1° S’il n’est pas convenable de déclarer que toutes les hypothèques prises par les Juifs faisant l’usure sont nulles et de nul effet.
2° Que d’ici dix ans, ils seront inhabiles à prendre hypothèque.
3° Qu’à dater du 1er janvier 1807, les Juifs qui ne posséderont pas une propriété seront soumis à une patente et ne jouiront pas des droits de citoyen.
Toutes ces dispositions peuvent être particulièrement appliquées aux juifs arrivés depuis dix ans et venus de Pologne ou d’Allemagne2. »
Ce texte se trouve longuement examiné par les sections compétentes de l’intérieur et de la législation du Conseil d’État. Napoléon assiste aux séances où l’on discute cette note, écoute le rapport de Jean-Claude Beugnot, hostile à des mesures discriminatoires, contre lequel il s’emporte durement en dénonçant les Juifs, « la nation la plus vile », qui « ont remplacé la féodalité » et auxquels, en tant qu’espions, on ne peut « laisser tomber les clefs de Strasbourg3 ». Puis il demande à entendre le rapport de Mole, un proche de Bonald, « très hostile aux Juifs », lequel est hé au courant catholique réactionnaire et a rédigé un long rapport, Recherches sur l’état politique et religieux des Juifs depuis Moïse jusqu’au temps présent*, que l’on peut considérer, d’après le chancelier Pasquier lui-même, comme « un acte d’accusation contre la nation juive5 ». À cette occasion, Napoléon laisse éclater, on s’en souvient, ses préjugés, sa vive hostilité contre
- L. Poujol, Quelques observations concernant les juifs en général et plus particulièrement ceux d’Alsace, op. cit., pp. 96, 119, 135, 142 et 145.
- Correspondance de Napoléon I », Paris, Imprimerie impériale, t. 12, n° 9930.
- Voir notre chap. ni. Pelet de la Lozère donne la présentation la plus complète de cette scène, dans Opinions de Napoléon sur divers sujets, Paris, 1833, p. 213. De même, Comte de Ségur, Histoire des Juifs, Paris, 1827. Marquis de Noailles, Le Comte Mole, Paris, H. Champion, 1922, t. 1, pp. 91-92. Voir, de manière plus systématique, M. Liber, « Napoléon I » et les Juifs », op. cit., ainsi que R. Anchel, Napoléon et les Juifs, op. cit., pp. 75 et suivantes.
- Rapport Mole au Conseil d’État, « Recherche sur l’état politique et religieux des Juifs depuis Moïse jusqu’à présent », Le Moniteur, 25 juillet 1806. Mole souligne à plusieurs reprises « le mal qu’ils font aux chrétiens » (par exemple p. 948).
- Mémoires du Chancelier Pasquier, 1893, pp 272 et 275. Voir Israël Lévi, « Napoléon l » et la réunion du Grand Sanhédrin », Revue des études juives, 1894, t. 28, pp. 265-280.
(p.105) les Juifs, « qui ont remplacé la féodalité » et « ne sont pas des citoyens ». Il importe, affirme-t-il fortement, de prendre contre « ces juifs qui sucent le sang des véritables Français » des mesures coercitives, au moins de nature « temporaire », car « ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France ». Au terme de cet affrontement avec la plupart des conseillers d’État et face à la levée de bouclier de nombreux membres de son Conseil attachés à la dimension universaliste et égalitaire du droit, face à cette quasi-révolte de l’État en tant qu’institution légale contre l’Empereur, sur laquelle on reviendra plus loin1, il accepte néanmoins de limiter à une année ces mesures dérogatoires au droit commun qui accordent un sursis aux débiteurs des Juifs des provinces de l’Est. C’est également au cours de cette discussion au Conseil d’État que l’Empereur révèle son projet de convoquer « une assemblée des états généraux des juifs, c’est-à-dire en mander à Paris cinquante ou soixante et les entendre, je veux qu’il y ait à Paris une synagogue générale des juifs le 15 juin ».
(p.112) /Le commisaire Molé s’exprime:/
(…) Questions adressées à l’assemblée des Juifs par S.M. l’Empereur et Roi pour traiter des affaires qui les concernent :
1° Est-il licite aux Juifs d’épouser plusieurs femmes ?
2° Le divorce est-il permis par la religion juive ? Le divorce est-il valable sans qu’il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français ?
3° Une Juive peut-elle se marier avec un Chrétien, et une Chrétienne avec un Juif ? Ou la loi veut-elle que les Juifs ne se marient qu’entre eux ?
4° Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils étrangers ?
5° Dans l’un et dans l’autre cas, quels sont les rapports que la loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ?
6° Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l’obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d’obéir aux lois et de suivre les dispositions de Code civil?
7° Qui nomme les rabbins ?
(p.113) 8° Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?
9° Les formes d’élection, cette juridiction de police sont-elles voulues par leurs lois ou seulement consacrées par l’usage ?
10° Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende ?
11° Leur défend-elle de faire l’usure à leurs frères ?
12° Leur défend-elle, ou leur permet-elle de faire l’usure aux étrangers1 ? »
- Diogène Tama, Collection des actes de l’Assemblée des Israéltes, de France et du Royaume d’Italie, Paris, 1807, p.130-133.
(p.137) Retraçons maintenant le déroulement du Sanhédrin. On a déjà évoqué son exotisme, les costumes portés par ses membres, le pseudo-orientalisme qui en émane et, pour tout dire, le caractère comme étranger des participants qui sont pourtant français ou issus de l’Empire1. Le décorum, les attitudes respectives des membres du Sanhédrin et des représentants de l’Empereur renforcent implicitement l’idée qu’il s’agit bien d’une rencontre entre les Français et les Juifs, non d’une réunion entre concitoyens de religions différentes conviés pour examiner ensemble des questions qui les concernent au même titre les uns et les autres, telle la logique du Concordat qui pourrait être étendue aux citoyens juifs, ou encore le devenir de la laïcisation de la société transformée récemment en « monarchie chrétienne ». Rien de tel. Si Napoléon « n’exige des Juifs ni l’abandon de leur religion ni aucune modification qui répugne à sa lettre ou à son esprit », il attend néanmoins du Sanhédrin une soumission exemplaire à des mesures exceptionnelles dérogatoires au droit commun.
(p.154) /décret du 17 mars 1808/
Comme l’observe Simon Dubnow, avec ce décret du 17 mars, « Napoléon accomplit son coup d’État dans la question juive […]. Au lieu de traiter la maladie, il ordonna d’assommer le malade […]. Ce ne fut pas seulement le Code civil qui fut violé par le décret : les principes fondamentaux de la Constitution furent brutalement foulés aux pieds par cette suspension de l’égalité civile, établie par l’acte d’émancipation de 1791J ». En soulignant l’« affront moral » ressenti, Dubnow touche juste. Il est vrai que, contre toute attente, le décret napoléonien tape fort, à la mesure peut-être de la volonté opiniâtre des membres de l’Assemblée et, plus encore, du Sanhédrin, de se réfugier, en tant que citoyens, derrière les principes protecteurs et universalistes de la loi pour ne rien entendre qui y soit contraire. Le décret du 17 mars énonce, en effet :
« Art. 1er. À compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806 pour le paiement des créances des Juifs est levé […].
- Tout engagement pour prêt fait par des Juifs à des mineurs sans l’autorisation de leur tuteur; à des femmes, sans l’autorisation de leur mari ; à des militaires, sans l’autorisation de leur capitaine, si c’est un soldat ou sous-officier, et du chef des corps, si c’est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s’en prévaloir et nos tribunaux autoriser aucune action ou poursuite.
- Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse souscrits par un de nos sujets non commerçants au profit d’un Juif ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude […].
- Désormais et à dater du premier juillet prochain, nul Juif ne pourra se livrer à un commerce, négoce ou trafic quelconque sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises, et que sur un certificat, 1° du conseil municipal constatant que ledit Juif ne s’est livré ni à l’usure ni à un trafic illicite ; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite attestant de sa bonne foi et sa probité.
- Cette patente sera renouvelée tous les ans.
- Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes par une déclaration spéciale de la cour toutes
- Simon Dubnow, Histoire moderne du peuple juif, Paris, Cerf, 1994, pp. 164-165.
(p.155) les fois qu’il sera à leur connaissance qu’un Juif patenté fait l’usage ou se livre à un trafic frauduleux. […]
- Aucun Juif non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et du Bas-Rhin ne sera désormais admis à y prendre domicile.
Aucun Juif non actuellement domicilié ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de l’Empire que dans le cas où il y aura fait l’acquisition d’une propriété rurale et se livrera à l’agriculture sans se mêler d’aucun commerce, négoce ou trafic.
- La population juive dans nos départements ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription ; en conséquence, tout Juif conscrit sera assujetti au service personnel.
- Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans ; espérant qu’à l’expiration de ce délai et par l’effet des diverses mesures prises à l’égard des Juifs, il n’y aura plus alors aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre Empire ; sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l’exécution pour tel temps qu’il sera jugé convenable.
- Les Juifs établis à Bordeaux et dans les départements de la Gironde et des Landes, n’ayant donné lieu à aucune plainte et ne se livrant pas à un trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret1. »
Fidèle à ses préjugés du début 1806, l’Empereur remet même en cause le décret de mai 1806, jugé maintenant trop timoré, et revient à celui élaboré en mars de la même année. Il ne tient plus compte des avis défavorables de son Conseil d’État qui lui avait déconseillé, à l’époque, certaines de ces mesures extrêmes, incompatibles avec les principes universalistes du droit. Cette fois, le sursis de dix ans se trouve bel et bien imposé : l’Empereur y songeait depuis longtemps déjà et n’avait reculé que face aux réactions hostiles du Conseil d’État. La mesure figure maintenant en toutes lettres, dès l’article premier du décret : c’est dire son importance. Les cinq articles qui suivent accentuent encore la suspicion à l’égard des Juifs prêteurs, désignés sous cette forme lapidaire à plusieurs reprises comme si, implicitement, leur était toujours déniée la qualité de citoyen. L’article 7 est d’une violence extrême puisqu’il va de soi que les divers conseils municipaux renâcleront à accorder ces patentes, eux qui, dans les régions de l’Est, demeurent à la pointe de l’antisémitisme. Accorder ainsi un tel privilège à cet échelon local qui proclame souvent, de manière ouverte, sa sympathie avec les préjugés de la population de ces départements revient à priver presque automatiquement les citoyens
- D. Tama, Collection des procès-verbaux et décisions du Grand Sanhédrin, op. cit., pp. 12-16.
(p.156) juifs de ces départements de toute activité commerciale. Les articles qui suivent accentuent encore une telle quasi-exclusion. L’article 16 est dans la même veine : de manière étonnante, il restreint purement et simplement la liberté d’aller et venir reconnue à tous depuis la Révolution française, interdiction radicalement attentatoire à la liberté et qui ramène brusquement ces citoyens juifs à des époques qu’ils croyaient révolues.
Attentif aux rumeurs et aux exagérations concernant la croissance de la population juive dans l’est de la France, l’Empereur prend des mesures radicales pour en prévenir l’extension1. L’article 17 est tout aussi fidèle à sa volonté maintes fois exprimée auparavant : Napoléon interdit tout remplacement et impose la conscription à tous les Juifs, qui deviennent les seuls citoyens à ne pas bénéficier de cette possibilité. Eux qui sont nombreux à mourir sur les champs de bataille napoléoniens ont dû apprécier cette profonde marque de défiance. Certes, l’Empereur a un besoin urgent de soldats et ne recule pas devant les mesures les plus coercitives pour imposer une conscription systématique que nombre de jeunes gens tentent d’éviter ; sa décision à l’encontre des Juifs n’en est pas moins exceptionnelle2. Et pour montrer que, cette fois, le temps des négociations, du dialogue, des subtilités, des invocations juridiques est définitivement passé, l’Empereur menace de prolonger au-delà de dix années ces mesures qui, dix-sept ans après l’émancipation révolutionnaire, soit presque le temps d’une génération, remettent fondamentalement en cause le statut de citoyen que les Juifs prennent tant de soin à préserver. Comme le note fortement Léon Kahn, « en cherchant à les atteindre dans leur dignité, à les compromettre dans l’estime de leurs concitoyens, en espérant qu’il les rejetterait au-delà de la solennelle journée de l’émancipation, Napoléon s’était rabaissé au niveau des rois de moyen âge. Il n’avait pas compris que nul ne pouvait désormais remonter le cours de la Révolution3 ».
- Dans la France des limites de 1815, on compte 47 166 Juifs, soit 0,16 % de la population. Ils constituent 3 % de la population en Alsace où ils se concentrent surtout dans un nombre limité de villes et de villages. Dans ces départements, la population juive est de 19 707 personnes ; elle a augmenté de 24 % depuis 1784. S. Posener, « Les Juifs sous le Premier Empire. Les enquêtes administratives », Revue des études juives, XCV, 1933, p. 157.
- Pour une synthèse sur cette question de la conscription, Isser Woloch, The New Régime. Transformations ofthe French Civic Order, 1789-1820, New York, Norton, 1995, chap. 13.
- Léon Kahn, Les Juifs de Paris pendant la Révolution, op. dt., pp. 349-350.
(p.160) Selon Metternich, « l’impulsion est donnée ; les Israélites de tous les pays ont les regards tournés vers le Messie qui semble les affranchir des jougs sous lesquels ils se trouvent […]. L’Empereur s’est très adroitement servi de ce moyen pour se créer des partisans en pays étrangers, pour infiltrer son influence dans tous les canaux de la Sociétél ». Mais, en Europe orientale, c’est davantage l’hostilité qui prévaut : en Moravie, les Juifs se montrent hostiles au Sanhédrin et ne désirent pas abandonner le Talmud (« ce n’est que l’épée à la main qu’on pourrait les y contraindre ») ; le gouverneur de Galicie souligne que « aussi bien les orthodoxes que les Hassidim sont absolument stupides et attachés à la Torah et au Talmud et ne voient dans le Sanhédrin que le tombeau du Judaïsme2 ». Napoléon reçoit ainsi un accueil plus qu’hostile de la plupart des mouvements hassidiques indifférents aux réformes de la haskalah.
- N.M. Gelner, «La police autrichienne et le Sanhédrin de Napoléon», Revue des études juives, 1972, 83, pp. 136 et 138.
2 .Ibid., pp. 123 et 131. Abram Léon Sachar analyse de son côté l’influence de Napoléon sur les Juifs allemands dans A History of the Jews, New York, A. Knopf, 1964, p. 283. De même, Aubrey Newman souligne son influence sur les penseurs de la Réforme, « Napoleon and the Jews», EuropeanJudaism, n° 2, Hiver 1967. Isaac Altéras écrit de son côté, en sous-estimant la résistance à l’Empereur : « Comme le Sanhédrin a adhéré au principe de séparation entre la religion et la politique au sein du judaïsme, il a accéléré l’assimilation non seulement en France mais aussi en Europe centrale et aux États-Unis. Cela dépasse sans aucun doute les espérances de Napoléon », « Napoléon and thé Jews », Midstream, juin-juillet 1980, p. 42. Dans le même sens, Ben Weider estime que Napoléon s’est montré « tolérant » à l’égard, des Juifs en Europe et en Palestine, qu’il n’a jamais caché sa « sympathie » à leur égard, « Napoléon and the Jews », Conférence à l’International Congress of the International Napoleonic Society, Alessandria, Italie, juin 1997, p. 7. Pour une interprétation contraire, Barbara Sapinsley, « Napoléon and thé Jews », Midstream, février 1993, p. 20.
(p.164) Certes, l’autoritarisme napoléonien dans ce qu’il a de plus excessif rencontre assez vite des limites. En dehors des Juifs de Bordeaux et des Landes, d’autres évitent assez rapidement les rudes conditions que leur impose le décret de mars 1806 : à partir des rapports de préfets qui leur sont fréquemment favorables, les habitants de nombreux départements bénéficient d’une exemption. Les Basses-Pyrénées, la Seine, le Doubs, les Vosges, la Haute-Garonne, l’Aude, le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes2 ainsi que, en Italie, Pô, Marengo, Sésia et Gênes échappent ainsi assez vite à l’application du décret infâme. Il n’empêche qu’en 1810 encore de très nombreux départements vivent toujours sous ces mesures discriminatrices évitées seulement par un sixième de la population juive de l’Empire3.
- Sur l’exemple des Alpes-Maritimes, département où les Juifs bénéficient, grâce à l’intervention favorable du préfet, d’une exemption rapide, voir G.D. Scialtiel, « Les Juifs de Nice et le décret de 1808 », Revue des études juives, janvier 1914, LXVIII.
- Robert Anchel, Napoléon et les Juifs, op. cit., p. 374.
(p.187) On le constate, alors que l’Empereur entend sévir contre les seuls Juifs accusés d’usure, plusieurs de ses préfets n’hésitent pas à souligner, dans leur missive, qu’en réalité les chrétiens se rendent plus souvent coupables de cette pratique qui « ruine le peuple ». En 1808 également, de nombreux préfets prennent la défense des Juifs de leur département pour demander qu’ils ne soient pas concernés par l’application des décrets de mars 1808, à l’instar des Juifs de Bordeaux. Le préfet du Mont-Tonnerre note que « la mauvaise foi des cultivateurs entraînera infailliblement la ruine de tous les Juifs du département […]. Le Juif va succomber sous le poids des procès qui vont fondre sur lui » ; pour éviter de telles extrémités, il demande, tout comme le préfet de la Moselle, que le décret du 17 mars soit levé, car « beaucoup de familles juives sont près d’être (p.188) ruinées (…).
(p.192) On le constate, les Juifs du Bas-Rhin ne se font que peu d’illusions sur leur sort puisqu’ils n’évoquent même pas la possibilité de l’exception dont bénéficient maintenant nombre de leurs coreligionnaires : ils demandent simplement, du moins, une application juste du décret de mars 1807. En réalité, ce sont presque tous les Juifs des départements de l’Est qui voient leurs demandes rejetées ou négligées.
(p.196) Une loi universelle et identique pour tous, vraiment ? En l’espèce, les hauts fonctionnaires de son État ne ratifieraient guère un tel jugement et se dissocieraient de la politique illégitime et illégale de leur empereur. Comment encore peut-on voir seulement en Napoléon « un libéral qui s’efforce, à l’aide d’un système légal et de diverses institutions, d’éviter de profonds conflits politiques » et qui s’inspire non de considérations ethniques mais bien des « principes universalistes du droit romain, lorsque le « nous » absorbe les « autres »2 » ? Cet État n’a évidemment rien d’hitlérien3, et l’on comprend mal que cette comparaison anachronique, dépourvue de toute valeur, puisse être tentée de manière déraisonnable, d’autant plus que l’État du moment napoléonien se rebelle, comme on vient de le montrer, contre les mesures discriminatoires et quelque peu réactionnaires de son empereur. En ce sens, de manière paradoxale, cet État administratif que Napoléon a tant contribué à créer, en donnant une telle prééminence aux institutions administratives les plus prestigieuses car dotées d’un pouvoir incontestable, semble, au contraire, se retourner contre son zélateur, au nom de la défense de valeurs universalistes. Cet aspect de l’épisode napoléonien de l’histoire des Juifs de France mérite d’autant plus qu’on s’y attarde que, plus tard, c’est bien le renoncement de la plupart de ces mêmes hauts fonctionnaires qui choque : souvent infidèles, cette fois, à leur rôle, ils se retourneront souvent contre les Juifs, les laissant désormais sans défense.
- François Furet, « Bonaparte », in F. Furet et M. Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 224.
- Steven Englund, Napoléon, A Politicat Life, op. cit., p. 466.
- Ibid. Englund le note justement et avec force en prenant implicitement position contre une certaine vogue actuelle, qui se marque, par exemple, par la publication du pamphlet de Claude Ribbe, Le Crime de Napoléon, Paris, Éditions Privé, 2005.
(p.199) Comme les Juifs en tant que minorité persécutée, les protestants perçoivent le pouvoir royal comme le meilleur rempart contre les poussées populaires hostiles – dans la mesure, du moins, où le Roi ne touche pas à leurs valeurs religieuses.
(p.219) Ces odes et prières à l’Empereur que tous – catholiques, protestants / ou Juifs – célèbrent avec passion n’ont qu’un temps. Dès la chute de l’Empire et la première Restauration, le vent tourne rapidement et les « girouettes » abondent de toutes parts, dont les volte-face relèvent souvent, surtout pour les élites politiques toujours prêtes à retourner leur veste, de raisons purement militaristes qui incitent au rapide ralliement au nouveau pouvoir2. Les milieux religieux s’adaptent eux aussi.
(p.255) chapitre VIII Le prince des antisémites
D’un siècle à l’autre, les antisémites se félicitent de cette atteinte à la légalité étatique dont se rend responsable Napoléon, au grand dam de beaucoup de ses hauts fonctionnaires et des Juifs eux-mêmes, déçus par leur roi : ils transforment donc l’Empereur en un de leurs héros qui partagent leurs préjugés. Ils s’en régalent, citent à tout bout de champ ses textes hostiles aux Juifs, les brandissent inlassablement à l’appui de leurs propres dénonciations. Que Napoléon ait déclaré qu’ils se comportent comme « de véritables nuées de corbeaux », qu’il ait vu en eux « des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France », qu’il puisse avancer sans détour que « nous devons considérer les Juifs non seulement comme une race distincte mais comme un peuple étranger, ce serait une humiliation trop grande pour la nation française d’être gouvernée par la race la plus basse du monde », qu’il estime encore qu’il ne peut « regarder comme des Français ces Juifs qui sucent le sang des véritables Français », voilà qui, inéluctablement, réjouit la foule des nationalistes antisémites, d’Edouard Drumont à Céline jusqu’aux thuriféraires du régime de Vichy. Napoléon, héros du camp antisémite, voilà un aspect de l’histoire de la France moderne qui n’a pas retenu l’attention de l’historiographie. Et pourtant, telle une litanie sans fin, à peu près tous les ténors de l’antisémitisme, de Toussenel à Xavier Vallat, se réclament ouvertement de ce précurseur1.
Dès 1846, Alphonse Toussenel ne cesse de tirer à boulets rouges contre les Juifs et l’Angleterre qui eurent l’audace de se coaliser contre Napoléon, « gloire de la France » ; au nom de la défense du peuple, il fustige la féodalité financière contre laquelle l’Empereur avait engagé le
- On comprend donc difficilement que Maximilien Vox puisse considérer que « l’antisémitisme classique n’a pas cherché à tirer argument » de l’attitude hostile de l’Empereur à l’égard de l’usure attribuée aux seulsjuifs. Napoléon, op. cit., p. 100.
(p.256) combat, lui qui « avait deviné juste » en s’attaquant à la haute banque : pour le peuple, « Mort au parasitisme ! Guerre aux Juifs ! Voilà la devise de la révolution nouvellel ». La leçon de populisme – l’idée que le peuple entend se lever contre les Juifs en retrouvant l’ambition de Napoléon — ne sera pas oubliée, d’hier à aujourd’hui. À tout seigneur, tout honneur ; Drumont ouvre, comme toujours, le bal. Dans le best-seller absolu qu’est La France juive (1886), il consacre un long chapitre à l’Empereur. Infatigable lecteur tout à sa tâche, Drumont cite le rapport Porta-lis, évoque Mole, utilise même le Tama pour démontrer la duplicité des Juifs et clamer qu’ils ont enfin trouvé un maître en Napoléon : « La lutte contre le Sémitisme, écrit-il, n’en tint pas moins une place considérable dans le règne de Napoléon. […] Le petit sous-lieutenant d’artillerie avait soudain fait place à un chef d’empire. […] Ce parvenu, on est forcé de l’avouer, est le dernier souverain qui ait réellement gouverné la France […]. Il était exclusivement frappé du péril que faisait courir au pays cette infiltration incessante dans l’organisme social d’un élément de décomposition et de trouble2. » Drumont applaudit au décret de mars 1808 qui permet à Napoléon de « voir ses Juifs. […] Tout Juif qu’on voit, tout Juif avéré est relativement peu dangereux ». Hélas, ceux-ci parviennent, malgré tout, à contourner les mesures sévères de contrôle imposées par le décret et affrontent maintenant l’Empereur en aidant de toute leur puissance financière l’Angleterre ennemie, la traîtresse, l’instrument privilégié du capitalisme apatride. Napoléon est perdu : « Quand le Juif est contre eux, chef d’empire ou simple individu, journaliste ou chanteur d’opérette se sentent soudain pris par mille fils lilliputiens qui les empêchent d’avancer […]. Il faut, pour braver cette puissance occulte, devant laquelle Bismarck a reculé, des hommes comme Napoléon », lui qui « personnifiait le contraire de l’esprit juif». Qu’importent son courage, son dévouement à l’égard du peuple, sa volonté de sauver la France des griffes de l’ennemi, Rothschild vole au secours de l’Angleterre, l’emporte, Napoléon est battu. Waterloo, c’est la défaite de l’Empire mais \\ cette bataille représente surtout, aux yeux de Drumont, la victoire des Juifs qui prennent ainsi leur revanche contre les mesures décidées à leur encontre par l’Empereur : désormais « peuples et rois n’étaient plus que des marionnettes dont ils tenaient les fils3 » en ignorant les intérêts du
- Alphonse Toussenel, Les Juifs, rois de l’époque, Paris, 1846, t. 2, pp. 100, 131, 213 et 297.
- Edouard Drumont, La France juive, Paris, 1886, p. 250.
- Ibid., pp. 262-264. À ses yeux, Napoléon a « muselé » les Juifs (La Libre Parole, 14 décembre 1897). Voir aussi l’article de F. Bournand dans le numéro du 10 Janvier 1898.
(p.257) peuple qui pleure Napoléon et vénère sa mémoire à travers tant de fêtes populaires qui ponctuent le siècle. C’en est fait de la France, la chute de Napoléon mène irrémédiablement, pour Drumont, à la IIe République, la « République juive » par excellence, objet qu’il désigne à la vindicte de tous les mouvements populistes et antisémites.
La forte poussée antisémite liée au scandale de Panama mais aussi, et surtout, à l’affaire Dreyfus constituent, pour Drumont et ses amis, l’occasion d’alerter le peuple contre la domination juive qui s’exerce à ses dépens en regrettant l’échec de l’Empereur, incapable de livrer cette bataille décisive afin d’éviter l’abaissement durable de la France. Dans La Libre Parole, Drumont évoque sans cesse les mânes de Napoléon dont « l’œil perçant » et « la main de fer » sont parvenus à « arrêter un instant » la « conquête » et « l’invasion » juives *. Au nom de « La France aux Français », les millions de brochures et de tracts distribués par les militants des ligues antisémites, animées par Drumont ou Guérin, décrivent en permanence la horde de Juifs « ramassant dans le sang de Waterloo ses premiers millions tandis que les soldats de la Vieille Garde, stoïques, bravaient la mitraille anglaise2 ». Traîtres à la nation qu’ils ne défendent pas les armes à la main, s’efforçant d’échapper à la conscription que voulait leur imposer l’Empereur, profiteurs de mèche avec l’ennemi qui sucent le sang de la nation, les Juifs ne sauraient, dans l’esprit même de l’héritage napoléonien tel qu’il se trouve systématisé et comme radicalisé par les mouvements antisémites, être considérés comme des Français.
Une lecture attentive du Monument Henry en fournit une nouvelle preuve décisive. Lancé par Drumont aux lendemains du suicide du commandant Henry, le responsable au premier chef des manipulations justifiant l’arrestation du capitaine Dreyfus, et qui vient de se suicider après la découverte du faux qu’il a confectionné, cet appel à contribution financière pour aider sa veuve dans le besoin suscite un engouement tel que La Libre Parole publie, jour après jour, la liste des donateurs assortie presque toujours de leurs commentaires. « On demande un Napoléon », disent plusieurs d’entre eux ; « Seul un Napoléon saura faire respecter la France, seul un César saura écraser la vermine juive », écrit un autre. Innombrables sont les « Vive l’Empereur ! » ou encore les « Vive Napoléon ! » qui accompagnent les dons. « Qu’il vienne le sauveur, vive l’Empereur ! », « Allons Bonaparte, dépêchons-nous, il est temps », « Un qui
- La Libre Parole, 30 janvier 1901. Voir aussi Jacques de Biez, La Question juive. La France ne peut pas être une terre promise, Paris, Flammarion, 1886, p. 306.
- « La mainmorte juive ». AN F7 12459.
(p.258) n’oublie pas Napoléon », ou encore « Un allumeur de gaz bonapartiste », « Un dix-huit brumaire guérirait la France », « Qui fera un 18 Brumaire contre la canaille ? », « Vive l’Empereur ! en voilà un qui n’aurait pas toléré ce qui se passe actuellement », « Un pur bonapartiste qui n’aime pas les Juifs », « Un Petit caporal et un 18 Brumaire, svp », « En souvenir d’un Messin passionné de Napoléon Ier », « un curé de campagne petit-fils d’un soldat de l’Empereur », « Un ancien soldat de Crimée, fils d’un capitaine d’artillerie de l’Empire », « La petite-fille d’un soldat du Ier Empire décoré de la médaille de Sainte-Hélène », « Un fils de soldat de Napoléon Ier qui aime l’armée », telles sont quelques-unes des remarques accompagnant ces dons que l’on peut relever dans ces listes sans fin qui paraissent à la une de La Libre Parole1. Le souvenir de Napoléon semble particulièrement vivace chez les militants nationalistes antidreyfusards qui en appellent souvent à lui pour lutter contre ce qu’ils perçoivent comme un complot juif mené contre l’armée. À cette époque, pour beaucoup, comme chez Drumont, les actions de Joseph Reinach qui tente de venir en aide au capitaine
Dreyfus évoquent les malversions de Rothschild « trafiquant sur les cadavres de Waterloo2 ». Le camp nationaliste et populiste ne fait donc pas mystère de sa passion envers l’Empereur, encensé pour ses préjugés antisémites.
- Voir, en particulier, le mois de décembre 1898 de La Libre Parole ou encore celui de janvier 1899.
- Le Péril juif. AN F 12463. Voir aussi, par exemple, le Bulletin officiel de la Ligue antisémitique de France du 1″ janvier 1898. AN F7 12459.
(p.259) sans l’Église. Seule l’Église peut reprendre en sous-œuvre l’édifice de concorde […]. Quelle heureuse chose pour la société lorsqu’on dira : les Israélites et les autres peuples sont frères, non sous des apparences civiles, mais pour de bon1. » L’abbé Lémann entend donc reprendre le combat napoléonien contre les Juifs, mais en le menant cette fois sous les seuls auspices de l’Église. Et d’apostropher Napoléon, l’antisémite timoré : « Vous ne saviez pas ce que le Sanhédrin avait commis contre Jésus-Christ ! il ne s’est rencontré personne, ni dans votre entourage ni dans votre clergé, pour avertir Votre Majesté que les paroles de son commissaire avaient une odeur de Julien l’Apostat ! […] La fusion des cœurs s’obtiendra-t-elle? Non, évidemment puisque l’examen de la vérité en religion ou de la vraie religion ne faisait point partie du programme du Sanhédrin. Le mur de séparation subsistera entre chrétiens français et israélites français2. » Plus que chez Drumont, au catholicisme peu militant et qui cherche davantage le triomphe d’une race, celle des Aryens, triomphe que n’a malheureusement pas su imposer l’Empereur, c’est ici au nom du catholicisme que l’on entend faire disparaître la présence juive, en menant cette fois à son terme l’entreprise napoléonienne demeurée, en dépit du bon sens, à mi-parcours. L’antisémitisme catholique rejoint ici l’antisémitisme racial pour regretter la pusillanimité d’un Napoléon qui n’a pas su venir à bout de l’identité juive, n’usant que de mesures insuffisamment répressives, à tel point que « les débris » l’ont finalement emporté en imposant leur cruelle domination sous la IIIe République. À ses yeux, malheureusement, en dépit de ses bonnes intentions, « l’Empereur a consolidé, enrégimenté les juifs, leurs droits, leurs synagogues, leurs rabbins, leurs consistoires, en vertu des idées d’égalité, de liberté de conscience, de liberté des cultes, principes de la Révolution […]. À partir de ce moment, installés comme citoyens et, en quelque sorte, habillés de neuf par Napoléon, ils vont se mouvoir et opérer3 ».
- Abbé Joseph Lémann, Napoléon I » et les Israélites, Paris, Librairie Victor Lecobbre, 1894, p. il
- Ibid., pp. 112 et 114.
- Ibid., pp. 261-262.
(p.260) « La France s’est donc incorporée les juifs avec insouciance, avec confiance. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Voici qu’un feu inconnu, étrange, a circulé dans ses veines ; ce feu, les ardeurs de la soif d’or, l’animosité contre la religion chrétienne, contre les Ministres de Dieu, contre les vierges pures […]. Comment se débarrasser des Juifs ? L’inexorable logique dit : c’est impossible. Impossible, puisque l’Assemblée constituante a voté l’égalité, égalité devant la loi, égalité de tous les citoyens, sans distinction de cultes. Impossible, puisque sous le régime du Code Napoléon les intérêts français se sont enveloppés des intérêts hébreux ; ils se sont enlacés par des liens inextricables ; sur la fortune et les destinées de la France s’est collée la tunique de Sem : on ne l’arrachera qu’en arrachant la chair ! Mais alors n’y aurait-il pas quelque remède ? oui, vraiment, il existe un remède. Sur la race juive, il y a le sang de Dieu : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! Lorsque, des deux côtés, ce sang sera invoqué comme un miséricordieux et divin remède, tout pourra s’apaiser et se guérir’. »
Fouetté par un Drumont déchaîné, l’appel à la vengeance la plus sanguinaire, énoncée à partir d’une logique eschatologique ou, au contraire, purement raciale, comme chez un Jules Soury, s’impose en cette France fin de siècle : elle seule, davantage encore que les mesures répressives décidées par l’Empereur, peuvent venir à bout d’un ennemi commun qui ne recule devant rien. L’ouvrage d’A. de Boisandré, Napoléon antisémite, publié un peu plus tard (en 1900), développe lui aussi cette vision d’un Napoléon ennemi intraitable des Juifs. « En écrivant Napoléon antisémite, j’ai eu pour but, dit-il, de montrer que le vainqueur d’Iéna avait deviné la race fatale, que les Antisémites peuvent hardiment le revendiquer comme un ancêtre et que les bonapartistes, s’ils veulent rester fidèles à la mémoire du grand Homme, ne devront jamais séparer ces deux cris qui retentissent dans leurs réunions : « Vive l’Empereur ! » et « À bas les Juifs2 ! » Boisandré confesse lui-même qu’il appartient « à cette génération éclose pour ainsi dire à la vie intellectuelle, il y a quatorze ans, en lisant La France juive3 ». Il en reprend point pour point la même démonstration, retrace, de manière encore plus savante, en utilisant même les Mémoires du chancelier Pasquier, l’affrontement devant le Conseil d’Etat, souligne la bonne volonté de l’Empereur qui entend, grâce au Sanhédrin, intégrer ses Juifs, les assimiler, et termine en soulignant la mauvaise foi de ces derniers, les manœuvres auxquelles ils se
- Ibid., p. 124.
- A. de Boisandré, Napoléon antisémite, Paris, Librairie antisémite, 1900, p. xxi.
- Ibid., p. xy.
(p.261) livrent pour demeurer une nation dans la nation en contournant les objectifs intégrateurs de l’Empereur. Dans ce sens, en dépit de sa dureté, le décret de mars 1808 est lui aussi inopérant : « Pas plus que le premier, ce second « coup de sabre » ne tuera Shylock […]. Le reptile juif fait peau neuve : Shylock, père de l’Usure, va s’effacer devant Rothschild, roi de l’Agio *. » L’histoire est donc simple qui mène des petits usuriers dénoncés par les « chrétiens d’Alsace » aux maîtres du capitalisme international opprimant davantage encore le bon peuple français.
- Ibid., p. 25.
(p.264) Le mouvement nationaliste et antisémite qui déferle sur cette France des années quatre-vingt-dix donne de nouveaux espoirs aux nostalgiques de l’Empereur. La Ligue de la Patrie française, le fer de lance de ce mouvement, que rejoignent tant de grands noms de la littérature, tant de personnalités de l’époque et qui rassemble, derrière Déroulède, une armée de militants décidés à renverser la République parlementaire considérée comme vendue aux Juifs, se réclame donc fréquemment de Napoléon pour justifier son entreprise de rénovation nationale. Maurice Barrés, son porte-parole le plus célèbre qui prononce des discours antisémites enflammés à Nancy, dans le cadre des élections législatives, ne cache pas son admiration à l’égard de l’Empereur. Dans Les Déracinés, ouvrage qui relate justement le destin de sept jeunes Lorrains perdus et dévoyés dans la capitale, la visite au tombeau de l’Empereur est un moment essentiel de recueillement : « Nos études vont se terminer. Nous contenterons-nous d’exploiter nos titres universitaires ? Serons-nous de simples anonymes dans notre époque ? […] Dans cette masse encore (p.265) amorphe qu’est notre génération, il y a des chefs en puissance, des têtes, des capitaines de demain. Si quelque chose nous avertit que nous sommes ces élus de la destinée, ne cherchons pas davantage, croyons-en le signe intérieur : camarades, nous sommes les capitaines ! Au tombeau de Napoléon, professeur d’énergie, jurons d’être des hommes1.» Comme dans l’œuvre de Barrés à l’antisémitisme déchaîné, le souvenir de l’Empereur est sans cesse présent, il hante ce mouvement nationaliste comme un appel à l’action, au recours légitime à la violence afin de rendre à la nation son énergie détournée par l’Argent et les Juifs. (…)
Entre Drumont, Barrès et Vichy, le lien se trouve réalisé, comme on peut s’y attendre, par Céline lui-même. La lecture de Bagatelles pour un massacre est, de ce point de vue, édifiante. La IIe République haïe n’a rien perdu de son pouvoir malfaisant, le peuple français se révèle toujours plus dégénéré, abaissé, dominé par les Juifs à travers un régime parlementaire dont ils sont incontestablement devenus les maîtres inflexibles, dans la suite logique de leur manipulation de la Révolution qui a fait d’eux, comme le disait l’Empereur, les nouveaux « vassaux » d’une féodalité encore plus oppressive à l’égard du peuple innocent. La rhétorique de Drumont, à peine poussée à l’extrême, atteint maintenant des sommets
- Maurice Barrès, Les Déracinés, Paris, H. Champion, 2004, p. 254. Sur l’antisémitisme de Barrès, Zeev Stemhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Bruxelles, Éditions Complexe, 1988 (nouv. éd. Paris, Fayard, 2000), et Pierre Birnbaum, Le Moment antisémite, op. cit., chap. 3.
(p.266) exceptionnels de virulence. Les leçons du maître ont été bien apprises. Pour Céline, le lien est clair entre Napoléon, Dreyfus et la France du Front populaire. Publié en 1937, Bagatelles énonce sans détour que «le capitaine Dreyfus est bien plus grand que le capitaine Bonaparte. Il a conquis la France et il l’a gardée ‘ ». Napoléon a été, au contraire, « sanhédrinisé », neutralisé par les Juifs qui ont su remettre en question son pouvoir, détourner sa politique en renforçant même leur emprise :
« Mais le Sanhédrin, […] Napoléon en est précisément crevé ! Ce fut le Sanhédrin bel et bien qui aura Napoléon ! Pas Wellington ! Pas Nelson ! Non Napoléon ne serait pas mort à Sainte Hélène si Napoléon n’avait jamais sanhédrinisé. Sanhédrin ! mais voici l’artisan majeur de toute la débâcle napoléonienne, de la catastrophe. C’est par le Sanhédrin, ce grand Consistoire juif, que fut sauvagement sabotée la suprême tentative d’unification aryenne de l’Europe2. »
Hier comme aujourd’hui, on ne peut pour Céline que difficilement résister à la puissance internationale d’Israël qui a su vaincre Napoléon, le héros des Aryens. Adepte enthousiaste des Protocoles des Sages de Sion qui connaissent en son temps une immense diffusion, il ajoute :
« Savez-vous que le pouvoir de toute la juiverie mondiale s’appelle le « Kahal » ? Assemblée des Sages d’Israël ? […] Vous souvenez-vous que Napoléon, inquiet du pouvoir universel juif, tenta de capter les forces du Kahal à son profit, de faire servir le Kahal à sa propre politique mondiale napoléonienne, de le fixer tout d’abord en France, ce Kahal, sous le nom de Grand Sanhédrin […] et qu’il échoua, Napoléon, piteusement, très fatalement dans cette entreprise (il y avait tout de même quelque chose de cocu dans Napoléon) […]. Nous qui ne sommes pas Napoléon, notre sort encore plus que le sien dépend entièrement du bon vouloir des grands Juifs, des « grands occultes »3. »
La conclusion s’impose d’elle-même. Pour vaincre cette hydre que même Napoléon n’a pu abattre, pour venir à bout du traditionnel ennemi anglais vendu aux Juifs, une seule solution s’impose, Hitler. Et Céline d’ajouter, apocalyptique :
- Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, Paris, Denoël, 1937, p. 199.
- Utid., p. 152.
- Ibid., p. 174.
(p.267) « Vous verrez Hitler ! La mesure du monde actuel, ce sont des mystiques mondiales dont il faut se prévaloir ou disparaître […]. Napoléon l’avait bien compris. Le grand secret de la jungle, de toutes les jungles, la seule vérité des hommes, des bêtes et des choses. « Être conquérant ou conquis », seul dilemme, ultime vérité. Tout le reste n’est qu’imposture, falsifis, troufignoleries, rabâcheries électorales. Napoléon a fait tout son possible, des prodiges, pour que les blancs ne cèdent pas l’Europe aux nègres et aux asiates. Les Juifs l’ont vaincu. Depuis Waterloo, le sort en est jeté. À présent, le coup n’est plus le même, ils ne sont pas chez nous, les Juifs. C’est nous qui sommes chez eux1. »
Céline donne un caractère apocalyptique au racisme débridé de Drumont et, comme lui, voit dans Napoléon un héros malheureusement vaincu par les Juifs qu’il a su affronter mais non dominer. L’antisémitisme de Céline s’ancre, comme chez Drumont ou Barrés, dans un hymne à l’Aryen, à l’homme blanc dont Napoléon aurait été l’archange, le héros dont l’ambition était justement d’unifier cette Europe blanche contre ses ennemis africains ou asiates, cette Europe mythologique dont se réclame Hitler. Et de rapprocher à son tour, comme il le fait fréquemment, les Juifs des Noirs, afin d’accentuer leur orientalisme, leur étrangeté, leur appartenance à un monde dégénéré et menaçant. Waterloo symbolise toujours ce moment du triomphe des Juifs agissant de concert avec les Anglais. Ce lien, au premier abord incongru, entre Napoléon et Hitler, va s’imposer chez les penseurs nationalistes, rapprochement étrange quand on sait que l’un prétend unifier l’Europe au profit de la France tandis que l’autre entend mettre l’Europe au service de l’Allemagne. Qu’importé cette contradiction : tous deux, en dépit de leurs visées antagonistes, se voient appréhendés en tant que dirigeants d’une Europe aryenne qui s’est enfin débarrassée de ses Juifs. Au fond, si Napoléon a échoué face aux «débris » qui l’ont emporté, c’est pour ne pas avoir été assez sévère, pour avoir cru possible d’intégrer, au besoin par l’usage de la contrainte, les Juifs à la nation française en laminant leur personnalité. De Drumont à Céline, on ne cesse de gémir devant la timidité d’une telle approche, on regrette cette perspective intégrationniste trop aimable qui, par la mise en place des consistoires, institutionnalise l’existence juive au lieu de la détruire définitivement. Tel est le but que se propose de mener à son terme, à sa manière impitoyable, le nouvel empereur allemand qu’il importe donc de servir, en collaborant par conséquent
- Ibid., p. 42.
(p.268) avec les Allemands engagés de manière plus efficace dans ce combat à mort contre les Juifs.
Une littérature antisémite considérable, durant ces années, cherche elle aussi son inspiration du côté de l’Empereur. Cette filiation surprenante demeure peu connue. À travers elle, le message antisémite trouve une légitimité incontestable tant est encore vivace la légende de Napoléon. Dans 1’entre-deux-guerres, Roger Lambelin publie de nombreux ouvrages très informés dans lesquels il évoque les interventions de Regnaud et de Beugnot puis celle, violemment opposée, de Napoléon qui lance : « Je ne puis regarder comme des Français ces Juifs qui sucent le sang des vrais Français. » Et de conclure : « Le rêve napoléonien ne devait pas se réaliser. Les mesures administratives prises à l’égard des israélites furent sans effet. […] Elles ne les empêchèrent pas d’avoir deux morales et de continuer à se montrer des agents de corruption et de désordreJ. » Lambelin regrette, par conséquent, « la fâcheuse inspiration » qui incita l’Empereur à fonctionnariser le culte israélite en estimant ainsi pouvoir le contrôler : « L’idée du péril juif traversa son puissant cerveau comme un éclair mais sans laisser de traces de son passage2. » H. de Vries de Heckelingen, dans le même sens, s’étonne de « la lourde faute » de l’Empereur qui a voulu régénérer les Juifs : « II crut protéger la société française et dissoudre le peuple juif. Son œuvre a été stérile, et le contraire de ce qu’il voulait atteindre est arrivé3. » Nombreux sont ceux qui, comme René Gontier, regrettent cette faiblesse inexplicable de l’Empereur qui avait « toutes les qualités et les travers de la race blonde […]. À la vérité, le Celte devait ressembler un peu à ces grognards, vieux grenadiers de l’Empire, aux moustaches gauloises, qui protestaient mais marchaient quand même. […] Les goûts militaires du Français lui viennent des Subnordiques celtes. Je suis frappé du nombre de Subnordiques parmi nos grands capitaines, depuis Turenne jusqu’à Napoléon et Pétain4. »
Cette fois, Napoléon se trouve plébiscité au nom de la race blonde subnordique dont il incarne les vertus guerrières. Tout l’oppose donc
- Roger Lambelin, Le Péril juif. L’impérialisme d’Israël, Paris, Grasset, 1924, pp. 206-207 et 211.
- Roger Lambelin, Le Péril juif. Les victoires d’Israël, Paris, Grasset, 1928, p. 71. Voir Georges Saint-Bonnet, Le Juif ou l’internationale du parasitisme,^ Paris, Éditions Vita, 1933 ou L. Fry, Le Retour des flots vers l’Orient. Le Juif, notre maître, Paris, Éditions RISS, 1931, p. 31. Dans le mêmes sens, Robert Launay cite favorablement les commentaires de Portalis contre les Juifs, Figures juives, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1921, p. 8.
- H. de Vries de Heckelingen, Israël, son passé, son avenir, Paris, Pétrin, 1937, pp. 136 et 138.
- René Gontier, Vers un racisme français, Paris, Denoël, 1939, pp. 90-91.
(p.269) aux Juifs qui pervertissent la race française : du coup, « en leur qualité de Blancs métissés de sang nègre et jaune, le mélange des Juifs avec les Français est à réprouver […]. Aussi devra-t-on déclarer les Juifs racialement inassimilables. […] S’il eût été logique avec lui-même, Napoléon eût abrogé le décret d’émancipation. Il se borna à prendre des demi-mesures. Il crut avec candeur discipliner les juifs. […] N’étant plus retenus par aucun frein et livrés à l’instinct de conquête de leur race, les Juifs n’ont cessé de prendre une importance de plus en plus grande dans les destinées du pays1. »
Quel dommage que Napoléon, conscient du péril juif, n’ait pas su l’affronter de manière radicale en éliminant une bonne fois pour toutes ces « blancs métissés de sang nègre », ces Orientaux que l’Empereur combattait déjà lui-même !
Il est grand temps de régler enfin cette question dans l’esprit de l’Empereur, mais en employant cette fois la manière forte face à un ennemi si retors. Henry Coston, devenu le directeur de La Libre Parole, en est convaincu ; en 1938, il confirme la prédiction de Drumont concernant la conquête juive de la France : en 1938, « la France de Jeanne d’Arc, de Louis XIV et de Napoléon est devenue un véritable dominion d’Israël2 ». Ce tract largement diffusé propose à ses lecteurs, en gros caractères, de se procurer Les Protocoles des Sages de Sion mais également l’ouvrage d’A. de Boisandré, Napoléon antisémite. En cette même année, d’autres tracts sont distribués s’efforcent de montrer l’ampleur de la domination juive sur chacune des provinces, concluant par une citation de Napoléon : « C’est la France qui se renie. Écoutez Napoléon : « Ce serait une humiliation trop grande pour la nation française d’être gouvernée par la race la plus basse du monde. » C’est fait3. » Le 17 février 1939, l’antisémitisme culmine en un numéro d’une violence extrême de Je suis partout dirigé par Robert Brasillach et Lucien Rebatet, les ténors de la haine antijuive. Dans un interminable article consacré à « La Révolution et la France », ce dernier décrit longuement le projet de Napoléon en concluant que « la juiverie s’emparait avec allégresse des avantages accordés, jouait la comédie du loyalisme mais les désirs de Napoléon n’avaient aucune prise. Il était impérialement roulé ». Tout comme Dru-mont et la plupart des auteurs qui s’en inspirent, Rebatet souligne les « illusions » de Napoléon et regrette que l’Empereur n’ait pas tout simplement « exclu les Juifs de la communauté civique des Français.
- Ibid., pp. 81 et 236-237.
- « La France envahie ». BNF. 4° Ld 583 46.
- La Vieille France, 1er mars 1938. Tracts antisémites. BNF. 4°Ld 183. 46.
(p.270) En centralisant et en consacrant l’organisation religieuse des Juifs, il les a pourvus au contraire d’un puissant instrument d’unité et d’activité nationale ‘ ».
Quelques années plus tard, pour certains, curieusement, la défaite de la France face à Hitler est l’occasion rêvée pour reprendre, sans illusion cette fois, le dessein de Napoléon en allant jusqu’au bout de son projet d’exclusion. La presse vichyste se réfère inlassablement à l’Empereur : « Qu’aurait fait Napoléon ? », s’interroge Candide2. André Castelot souligne pour sa part, dans La Gerbe, à quel point Napoléon est « unique », Paris-Soir évoque le souvenir des combats de l’Empereur contre les Anglais tandis que, dans le même sens, le journal Les Nouveaux Temps publie une « Lettre ouverte de Napoléon aux Anglais » ou encore un article intitulé « Napoléon et l’économie dirigée : le Ier Empire contre la City » ; Je suis partout compare la guerre de l’Allemagne contre les Russes avec celle menée par la Grande Armée ou publie un article de Pierre-Antoine Cousteau, un auteur antisémite proche de la tradition Drumont, sur « La fortune des Rothschild : le vrai vainqueur de Napoléon » ; Gringoire nous donne « une leçon d’histoire » de Jean Mistler sur « La tragédie de Napoléon », Le Matin évoque lui aussi dans ce contexte le passage de la Bérézina, Pierre Costantini signe de son côté d’innombrables articles sur Napoléon dans L’Appel tandis que Robert Brasillach rappelle, dans Le Petit Parisien, l’efficacité de la police de l’Empereur dont la France de Vichy aurait le plus grand besoin3. En réalité donc, très nombreux sont les articles qui font allusion à l’Empereur, à son génie, à ses guerres, ses idées ou encore son apport à la culture. De même, à cette époque, les films produits évoquent souvent, avec émotion, le souvenir de l’Empereur qui ne s’en est pas laissé conter par l’ennemi anglais4. Napoléon constitue un sujet à la mode en ces années vichystes où la France se considère comme menacée surtout par l’ennemi anglais et ses suppôts juifs, collaborant sans retenue avec l’Allemagne nazie pour en venir à bout. Ainsi, le 21 mars 1941, Au pilori ! publie un grand article intitulé « Napoléon et les Juifs » qui reprend les analyses de Boisandré et de Céline : on y justifie d’autant
- Je suis partout, 17 février 1939.
- Candide, 4 février 1942.
- La Gerbe, 19 mars 1940. Paris-Soir, 22 mai 1942. Les Nouveaux Temps, 4 septembre et 24 octobre 1942. Je suis partout, 19 mars et 22 octobre 1943. Gringoire, 4 juin et 13 décembre 1943. Le Matin, 17 mars 1943. L’Appel, 2 septembre et 16 décembre 1943. Le Petit Parisien, 28 juin 1943.
- Gérard Gengembre, Napoléon, Paris, Larousse, 2001, pp. 301 et suivantes. David Chante-ranne et Isabelle Veyrat-Masson, Napoléon à l’écran, Paris, Nouveau Monde éditions et Fondation Napoléon, 2003.
(p.271) plus la collaboration avec l’Allemagne que « les vautours » juifs ont trahi « l’aigle » en se mettant, hier comme aujourd’hui, au service de l’ennemi anglais ‘. Dans le même sens, de nombreux ouvrages paraissent sur Napoléon durant ces années noires, qu’ils soient rédigés par des auteurs français ou parfois, traduits de l’allemand2. Un nouveau timbre est difîusé en l’honneur de la LVF qui représente, en arrière-fond, la Grande Armée, comme pour mieux illustrer cet impensable rapprochement contre l’ennemi anglais mais aussi… russe3. Dès août 1940, le journal violemment antisémite Au pilori ! place à’ plusieurs reprises sa prose sous l’égide de Drumont mais également sous celle de Napoléon en reprenant inlassablement cette phrase qui témoigne de l’humiliation de la France à se trouver gouvernée par « la race la plus basse du monde4 ». Un peu plus tard, le 22 novembre 1941, ce journal de la collaboration militante publie un autre article intitulé « Ce que Napoléon pensait des juifs » évoquant les paroles de l’Empereur : « Ce sont de véritables nuées de corbeaux […] ils ont remplacé la féodalité5. » En bas de page figure en bonne place une caricature représentant les Juifs déséquilibrés par le Statut des Juifs d’octobre 1940 qui les exclut de l’Etat et de nombre de professions, rapprochant implicitement ce statut du décret infâme de 1808. Quelques mois après la parution de ce statut qui remet brutalement en cause un siècle et demi d’émancipation et concrétise enfin tous les espoirs de ceux qui souhaitent l’abandon définitif de la politique d’assimilation des Juifs à l’aide de décisions drastiques, analogues à celles décidées par l’Empereur en mars 1808, se produit un événement qui donne soudain une forte actualité au souvenir de Napoléon. Alors que Hitler s’est rendu brièvement, le 23 juin 1940, aux
- Au Pilori, 21 mars 1941.
- J. Lucas-Dubreton, Napoléon, Paris, Fayard, 1942. Cet auteur se montre d’ailleurs particulièrement courageux, car il écrit à propos de Napoléon et des Juifs que « l’idée de chasser, de déporter des individus « qui sont comme les autres » lui répugnait » (p. 69). Voir aussi Jean Thiry, Le Vol de l’aigle, Paris, Berger-Levrault, 1942, et Les Cent Jours, Waterloo, Paris, Berger-Levrault, 1943. Maurice Muret, France héroïque, Paris, Albin Michel, 1943. Ernest d’Hauterive, Napoléon et sa police, Paris, Flammarion, 1943. En 1942, on annonce un Bertrand de Jouvenel, Napoléon et l’économie dirigée. Philippe Boulher publie Napoléon (traduit de l’allemand), Paris, Grasset, 1942, et écrit qu’« il ne peut échapper à un observateur attentif que bien des idées et des actions de Napoléon ont la même source que celles du Fiihrer» (p. 274). Voir encore Marcel Dunan, Napoléon et l’Allemagne, Paris, Pion, 1942. Ina Seidel, L’Enfant du destin (traduit de l’allemand), Paris, Pion, 1942. Henri Gougelot, De Napoléon à Bismarck, Paris, Lesourd, 1943. La liste est presque sans fin qui comprend aussi des livres sur la vie privée de Napoléon, son action pour la culture, la vie de ses ministres, etc.
- Je remercie Gérard Gengembre de cette information.
- Au pilori !, 2 et 9 août 1940. Voir encore le 4 octobre 1940 ou le 22 mai 1941.
- Au pilori !, 22 novembre 1941.
(p.272) Invalides pour se recueillir seul dans la crypte devant le tombeau de l’Empereur, le 15 décembre, soit un siècle jour pour jour après le retour des cendres de l’Empereur de Sainte-Hélène, on procède, en grande pompe, à celui des cendres de l’Aiglon. Comme le conte avec émotion Jean Bourguignon, le vice-président de l’Institut Napoléon,
« le chancelier d’Allemagne, M. Hitler, a décidé de rendre à la France les cendres de l’Aiglon. On a appris cette nouvelle avec une sympathie d’autant plus vive et plus émue que le temps n’a pas diminué — bien au contraire — le prestige de l’attachante figure de celui auquel la postérité a maintenu le titre choisi par son père, le titre de « Roi de Rome » ».
Cette décision a été annoncée par Otto Abetz lui-même, l’ambassadeur d’Allemagne. En provenance de Francfort, le sarcophage est parvenu à la gare de l’Est, le samedi 14 décembre, à 21 heures, ce sont des soldats allemands qui ouvrent la porte du fourgon, puis, à la lumière de torches, font glisser le cercueil sur un lourd tracteur. Le cortège s’engage sur le boulevard de Strasbourg et se dirige vers la place du Châtelet puis parvient au pont Saint-Michel, avant de prendre la direction des Invalides. Dans la cour, des gardes municipaux portant des torches attendent. Environ sept mille personnes participent à cet hommage public. L’amiral Darlan arrive. Comme le décrit Jean Bourguignon, « une compagnie motorisée s’avance à la hauteur de la grille. Les fronts se découvrent. La prolonge qui porte les Cendres du Roi de Rome s’arrête et vingt bras vigoureux font pivoter, puis glisser le lourd sarcophage de bronze, qui, sur les épaules des soldats allemands, franchit la grille. Les soldats allemands cèdent la place à des soldats français. Une sonnerie de clairon déchire l’heure nocturne. Et, lentement, précédé par trois prêtres en étole, porté cette fois par des bras français, l’Aiglon pénètre dans l’église du DômeJ ».
Le même jour, le maréchal Pétain adresse le message suivant aux Parisiens :
« Le 15 décembre 1840, le prince de Joinville ramenait de France les restes de l’Empereur.
Le 15 décembre 1940 — un siècle plus tard —, les cendres de son fils sont placées sous le Dôme des Invalides à côté de Vauban, de Turenne, de Foch.
L’aigle et l’Aiglon dorment aujourd’hui côte à côte.
- Jean Bourguignon, « Le retour de l’Aiglon », Revue des études napoléoniennes, 1941, p. 41.
(p.273) Je remercie le Chancelier du Reich, chef suprême des armées allemandes, d’avoir, cent ans après le retour de Sainte-Hélène, permis le retour de Vienne […].
Heureuse ou meurtrie, triomphante ou vaincue, la France se recueille avec foi devant ceux qui furent, au cours des siècles, les artisans de sa gloire1. »
Une plaque commémorative, placée sous les ailes d’un aigle impérial, se trouve inaugurée à Courbevoie, la ville ayant décidé de donner à son vieux port le nom de place Napoléon. Sur cette plaque, on peut lire : « Ici le 15 décembre 1840, selon le désir exprimé par l’Empereur, cette rive accueillait les cendres de Napoléon. Commémoration du centenaire ». Philippe Sagnac, président de l’Institut Napoléon, qui a succédé, en 1936, à Edouard Driault2, publie lui-même un article où il écrit : « Dans les conjonctures présentes, il paraîtrait étrange que l’Institut Napoléon, ne rappelât pas le geste dramatique qui amena auprès de son héros, sous le haut dôme des Invalides, l’enfant que le grand Empereur ne vit que pendant quelques années : l’Aigle et l’Aiglon, enfin réunis, dans la sérénité de la mort3. » L’événement est surtout largement commenté par la presse collaborationniste. Pierre Costantini, le chef de la très extrémiste Ligue française, fait ainsi distribuer un tract où l’on peut lire :
« La grande pensée de Napoléon — l’Europe unie — renaît de la conjonction sacrée de ces cendres. L’Archiduc blanc repose désormais auprès de son Père, sous le dôme des Invalides, symbole de paix entre la France et l’Allemagne, point de départ d’une Europe réconciliée. Chloroformés par des gouvernants judéo-maçonniques au service de l’Angleterre, nous avions oublié la grandeur de notre histoire. Par son geste simple et grandiose, Adolf Hitler nous la rappelle. »
On le voit, sans cesse Napoléon et l’Aiglon se trouvent ainsi mobilisés dans le gigantesque combat à mort contre les Juifs et leurs alliés anglais qui, hier comme aujourd’hui, menacent la France.
C’est à la même époque que s’ouvre aussi, au palais Berlitz, sur les Grands Boulevards, l’exposition imaginée dans l’esprit de Drumont, « Les Juifs et la France ». Inaugurée le 5 septembre 1941, elle dure jusqu’en
- Revue des études napoléoniennes, 1941, p. 43.
- On se souvient que Mathiez se référait aux travaux de Ph. Sagnac pour critiquer la thèse de Robert Anchel qui trouvait, au contraire, largement grâce aux yeux d’Edouard Driault. Voir notre chap. i™.
- Philippe Sagnac, « Un centenaire : les Invalides et Versailles (1840-1940) », Revue des études napoléoniennes, 1941. Dans ce même numéro, Ph. Sagnac rend compte de manière élogieuse du livre de Jean Bourguignon, Le Retour des cendres, Paris, Pion, 1941.
(p.274) juin 1942 ; près de 300 000 personnes s’y rendent pour contempler les documents qui y sont présentés, à l’initiative de Théo Dannecker, chef de la section des affaires juives de la Gestapo en France. D’apparence purement française mais imaginée par les nazis, cette exposition se présente comme la meilleure manière d’identifier l’ennemi juif à l’aide de la forme de ses oreilles, de son nez, de ses lèvres, de ses cheveux. D’immenses portraits de Juifs célèbres sont là pour témoigner de leur domination de la société française. La presse nationale (Le Matin, L’Œuvre, Paris Soir ou L’Illustration) rend compte de cet événement en publiant ces documents et ces photos, ainsi diffusés par millions d’exemplaires. Or si l’on examine attentivement les photos qui illustrent le déroulement de cette exposition, on s’aperçoit que, rédigé en lettres géantes sur un panneau élevé qui accueille pour ainsi dire les visiteurs tant il se trouve mis au premier plan, on peut lire le texte suivant : « Dagobert, Saint Louis, Philippe le Bel, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon Ier furent parmi les précurseurs qui reconnaissent et combattent le péril juif. » De nouveau, la référence explicite à Napoléon si incontournable, d’autant plus que l’Empereur s’impose probablement comme le plus familier, celui auquel il est facile de s’identifier. Sa caution suffit à elle seule à emporter l’adhésion. Sur un autre panneau, très visiblement, on lit : « Napoléon, en 1807 et en 1808, leur donna toute liberté. L’émancipation juive devenait un fait. Elle a exactement concordé avec l’emprise des puissances économiques anonymes et occultes sur la Nation1.» Conçue par l’Institut d’études de la Question juive, cette exposition emblématique de la politique antisémite de Vichy confère donc une place de choix à l’Empereur dans sa lutte acharnée contre les Juifs.
Avec Vichy, la référence à Napoléon est partout. Georges Montandon, l’ami de Céline qui se voit confier sous Vichy la tâche de reconnaître les Juifs en fonction de leur anatomie et dont le verdict entraîne fatalement leur déportation, lui qui sait « comment reconnaître le Juif », ne manque pas de souligner que « Napoléon les haïssait du plus profond du cœur » ; il s’appuie, par ailleurs, sur le rapport de Kellerman à l’Empereur qui relate « les maux résultant de l’usure et de la mauvaise foi des Juifs2 ». À la même époque, Henry-Robert Petit évoque lui aussi les paroles de Napoléon au Conseil d’État – « Ce serait une humiliation trop grande pour la nation française d’être gouvernée par la race la plus basse du
- Le Juif et la France au Palais Berlitz. Documents du CDJC. 82.
- George Montandon, Comment reconnaître et expliquer le Juif ?, Paris, Nouvelles Éditions françaises, 1942, .pp. 46 et 67.
(p.275) monde1 » -, tandis que Gabriel Malglaive, dans un livre préfacé par Xavier Vallat, consacre de longues pages à l’histoire du Sanhédrin ; à ses yeux, « Napoléon n’était pas antisémite mais il le devint […]. L’Empereur leur devint hostile. Tout est là. On veut les assimiler et l’on constate qu’ils sont inassimilables. On veut les comprendre et l’on est amené à les combattre. C’est l’histoire de Napoléon […]. Il fut vaincu par le mensonge car il devina trop tard les replis intimes de l’âme juive ». Et Malglaive de citer le rapport de Portalis qui souligne que « les Juifs forment une nation dans la nation ; ils ne sont ni Français ni Allemands ni Anglais : ils sont Juifs ». Près d’un siècle et demi après le moment napoléonien, Malglaive peut conclure de la manière suivante : « Quel lecteur, en parcourant ces lignes, les imaginerait vieilles de cent cinquante ans ? Elles sont plus vraies, plus actuelles que jamais. C’est que le Juif n’a pas changé. Le Juif est inassimilable2. » Pour venger l’Empereur, il faut donc, comme le conseillaient Drumont et Céline, éviter sa pusillanimité et, cette fois, frapper fort. On évoque donc sans cesse les mânes de l’Empereur pour justifier la politique drastique de Vichy, pour rappeler aussi son échec dramatique face à l’Angleterre, à Waterloo, cette Angleterre et ses alliés juifs que la France éternelle incarnée par Vichy affronte toujours vaillamment3. Pour le comte A. de Puységur, « à Waterloo, l’Empereur a été battu […]. Rothschild, en cachant la vérité», a fait fortune et les Juifs avec lui : « Ont-ils conquis une place assez importante dans la Nation, ceux que Napoléon forçait à prendre un nom pour pouvoir mieux les surveiller? […] L’affaire Dreyfus une fois terminée, le plan de prise de possession des fameux leviers de commande fut repris […]. Les Juifs gouvernent la France4. » Dans ce sens très particulier, le régime de Vichy est bien la revanche sur Dreyfus, car il met un terme à cette « république juive » que Napoléon, dans sa naïveté, n’a pas su tuer dans l’œuf. Il est temps de reprendre sérieusement la tâche.
- Henry-Robert Petit, Le Juif au pouvoir, Paris, Centre de documentation et de propagande, 1942, p. 37.
- Gabriel Malglaive, Juif ou Français, Paris, Éditions C.P.R.N., 1942, pp. 92-93 et 100-101. Voir aussi André Broc, La Qualité de Juif, Paris, PUF, 1943, p. 17, ou André Chaumet et R. Beflanger, Les Juifs et Nous, Paris, Jean Renard, 1941, p. 37.
- Georges Batault, Le Problème juif, Paris, Pion, 1921, p. 50.
- Comte A. de Puységur, Qu’était le Juif avant la guerre ? Tout. Que doit-il être ? Rien, Paris, Éditions Baudinières, 1941, pp. 33 et 53.
(p.278) La suite va de soi : si Napoléon lui-même a échoué avec toute la force dont il disposait, Vichy doit se préparer à utiliser une contrainte encore plus formidable pour venir à bout d’une population juive de l’ordre désormais de 300 000 personnes. En cette année 1942 où les déportations s’accélèrent, menées par les forces policières de Vichy, la référence à Napoléon semble incontournable dans les prises de position de l’organe officiel de l’institution chargée de régler cette « question » : elle légitime les mesures radicales que n’a malheureusement pas osé prendre l’Empereur, en dépit de ses préventions, que partagent sans réserve les zélateurs de Vichy. Le « sang » juif dénoncé par l’Empereur justifie cette fois une politique d’exclusion ou même d’extermination à laquelle se refusait l’Empereur, soucieux de sa gloire future. Autre époque, autres mœurs : (p.279) contre cette « tribu » qui « campe » en France, ces étrangers venus d’Orient, il est grand temps de sévir impitoyablement.
En 1943, alors que le vent tourne, que le régime affronte de grandes difficultés, que les Anglo-Saxons prennent lentement le dessus sur les nazis, que les déportations de Juifs se trouvent néanmoins menées tambour battant, Pierre Costantini, l’un des dirigeants les plus radicaux des milices de Vichy, qui célébrait le retour des cendres de l’Aiglon comme une contribution essentielle au combat contre l’Angleterre et ses alliés français judéo-maçonniques, se lance de nouveau dans un long hommage poétique à Napoléon dont il évoque les mânes pour inciter le peuple de France à s’engager dans cette lutte à mort contre les mêmes ennemis qu’affrontait déjà autrefois l’Empereur :
« Salut ! Grand mort figé dans ton masque de pierre
Et dans la loi d’orgueil,
De tes yeux clos, tournés vers l’ultime prière
Qui brûle notre deuil.
Ô Corse au regard clair, que la France était laide
Et comme elle était basse
Quand sous les coups anglais, elle attendait ton aide
Et l’appui de ton bras.
(…)
(p.280) Les grenadiers, debout à l’appel du poète,
Vois-les surgir, sans peur,
Des tombeaux, tes grognards, criant à perdre tête :
Vive notre Empereur !
(…)
Ô ma France, prends garde ! Écoute encore ma voix,
Du fond de mon tombeau je hais ce qui t’arrive,
Je vois fondre sur toi les hordes d’autrefois :
Les bavards, les Anglais — horreur ! — la peste juive !
(…) La liberté n’est pas ce que le siècle pense,
Elle est dans le travail et dans l’indépendance,
Dans la réalité, non dans les mots trompeurs,
France réveille-toi ! Écoute l’Empereur1 ! »
L’appel au peuple, sommé de se réveiller en mémoire de l’Empereur pour affronter enfin « la peste juive » et les Anglais, tourne court. Rien n’y fait. L’écroulement du régime de Vichy est pour bientôt. La IVe République lui succède. Pour certains thuriféraires de l’Empereur déjà fort actifs pendant Vichy, rien n’a changé. Xavier Vallat reprend ainsi du service en évoquant de nouveau le souvenir de l’Empereur et,
- Pierre Costantini, Ode au masque de Napoléon, Paris, Éditions Baudinière, 1943. BNF 16 YE Pièc.e-10.
(p.281) fidèle à ses idées, fait allusion à son « hostilité » à l’égard des Juifs1. À l’époque contemporaine, ce sont toujours les partisans du Front national qui saluent avec le plus
d’enthousiasme le souvenir de l’Empereur, l’homme d’ordre2. Le souvenir de sa politique à l’égard des Juifs joue-t-il un rôle dans cette perception si favorable, qui tranche avec celle de leurs concitoyens ?
- Xavier Vallat, Le Nez de Cléopâtre. Souvenirs d’un homme de droite. 1919-1944, Paris, Éditions Les quatre fils Aymon, 1957, p. 230.
- Jean-Pierre Rioux, « Pour ou contre Napoléon », L’Histoire, juillet-août 1989, p. 6.
2 Autres études
2.1. Philippe Béatrice, Etre Juif dans la société française du Moyen Age à nos jours, éd. Complexe, 1997
(p.167) Napoléon n’était pas (sic), comme on a pu le dire, un ennemi acharné des juifs ; pragmatique, jacobin, il ne veut pas ignorer l’importance de la population juive ni l’isoler du reste des Français. Son intention est de transformer, bon gré mal gré, la mentalité de cette population et de l’assimiler totalement, au besoin par des mesures d’autorité. C’est le sens du discours qu’il prononce dès le lendemain devant le Conseil d’Etat. (…)
(p.173) Un an après la dissolution du Sanhédrin, le 17 mars 1808, étaient promulgués les décrets qui allaient régir la vie des juifs de France. (…)
(p.174) Le fameux décret infâme met à nouveau les juifs hors du droit commun pendant une période transitoire de dix ans. Il prévoit en effet une série de cas, pouvant entraîner l’annulation des créances que des chrétiens ont pu contracter auprès de juifs. Toute délivrance de patente à un juif est subordonnée à une autorisation préalable. Le décret interdit en outre une nouvelle immigration juive en Alsace, et surtout il oblige tous les juifs à partir pour l’armée, sans possibilité de se faire remplacer, comme c’était le cas pour les autres citoyens. (…)
(p.175) Une fois encore, ce sont les plus pauvres et les moins proches du pouvoir qui sont touchés par cette nouvelle loi d’exception du 17 mars 1808, ce qui est bien dans la logique de Napoléon. (…) Qui est à éduquer, qui est à transformer, qui est gênant dans la société française, si ce n’est la communauté d’Alsace et de Lorraine, engluée dans un langage et des coutumes inacceptables pour l’ordre impérial ? /Car tous les juifs de France ne furent pas (mal)traités de la même façon. (cf ce livre)/
Napoléon exclu définitivement de la scène politique, Louis XVIII désireux de se rallier tous les Français ne prorogera pas en 1818 les mesures discriminatoires du « décret infâme ». (…)
2.2 Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
Etre Juif dans la société française du Moyen Age à nos jours, éd. Complexe, 1997
(p.498) ANNEXE n°25
LES DECRETS CONTRE LES JUIFS
(p.499) La généreuse Révolution vota, le 26 août 1789, les droits de l’homme ~ pour tous… sauf pour les Juifs, séfarades ou ashkénazes ; la Constituante ne les leur accorda, après beaucoup d’hésitation, que trois jours avant de se séparer, le 27 septembre 1791 : à partir de cette date, les Juifs devenaient des citoyens français comme les autres, nantis des mêmes droits et des mêmes devoirs. Ce statut social était unique en Europe à cette époque, et, hors d’Europe, il n’existait qu’aux jeunes États-Unis. Mais Napoléon, de même qu’il avait rétabli l’esclavage aux Antilles, où il avait pourtant disparu, rétablit des lois discriminatoires contre les Juifs qui, sans avoir eu les conséquences funestes des lois de Vichy du 3 octobre 1940 et du 14 juin 1941, sur le statut des Juifs en France, en sont déjà les annonciatrices : ce sont le règlement du 10 décembre 1806 (loi sur l’usure ne concernant que les Juifs, donc discriminatoire), les trois décrets du 17 mars 1808 (les plus importants, le premier a été appelé « le décret infâme »), le décret du 16 juin 1808 (sur les Juifs de Livourne) et le décret du 20 juillet 1808 (autre décret « infâme »). Ces textes sont fort longs, nous en extrayons ici les passages les plus significatifs.
1 Premier décret du 17 mars 1808 (4, Bull., 186, n°3210)
Les Juifs n’étaient pas les seuls ) prêter sur intérêt ; les banquiers ou assimilés ; catholiques ou protestants, le faisaient aussi. Le décret est discrimnatoire dans la mesure où il ne s’applique qu’aux Juifs. Par ailleurs, seuls les Juifs patentés (article 7) peuvent se livrer au commerce ou à d’autres négoces ; or ce type d’activités était le plus répandu parmi les Juifs, notamment en Alsace et en Lorraine : l’article 7 du décret leur ôtait tout moyen légal d’existence. L’article 16 est particulièrement « infâme » :
(…) « titre II
- Désormais, et à dater du 1er juillet prochain, nul juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises, et que sur un certificat : 1° du conseil municipal, constatant que ledit juif ne s’est livré ni à l’usure, ni à un trafic illicite ; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.
- Cette patente sera renouvelée tous les ans.
- Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes, par une décision spéciale de la cour, toutes les fois qu’il sera à leur connaissance qu’un juif patenté fait l’usure, ou se livre à un trafic frauduleux.
- Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur. »
« titre III
- Aucun juif non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et du Bas-Rhin ne sera désormais admis à y prendre domicile.
Aucun juif non actuellement domicilié ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de notre empire, que dans le cas où il y aura fait l’acquisition d’une propriété rurale, et se livrera à l’agriculture, sans se mêler d’aucun commerce, négoce ou trafic.
Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d’une autorisation spéciale émanée de nous.
- La population juive, dans nos départements, ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription : en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel. »
- deuxième décret du 17 mars 1808 (4, Bull, 187, n° 3237)
Ce décret organise le culte juif et les communautés juives de l’Empire français, à l’image des cultes catholique et protestant, avec une différence (p.501) importante : les prêtres catholiques et les pasteurs protestants étaient payés par l’État, mais non point les rabbins. Dans chaque circonscription territoriale est institué un consistoire, subordonné à un Consistoire central, installé à Paris. Dans tous les cas, ce sont des assemblées de notables.
« Art. 1er. Il sera établi une synagogue et un consistoire Israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.
- Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu’il en faudra pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population Israélite sera la plus nombreuse.
- Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d’une synagogue consistoriale par département.
- Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n’en est faite par la synagogue consistoriale à l’autorité compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l’autorité compétente.
- Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale. […]
- Tout Israélite qui voudra s’établir en France ou dans le royaume d’Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
- Les fonctions du consistoire seront :
1° De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ;
2° De maintenir l’ordre dans l’intérieur des synagogues, surveiller l’administration des synagogues particulières, régler la perception et l’emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières ;
3° D’encourager, par tous les moyens possibles, les israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles, et de faire connaître à l’autorité ceux qui n’ont pas des moyens d’existence avoués ;
4° De donner, chaque année, à l’autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription. »
(p.502) 3. troisième décret du 17 mars 1808 (4, BulL, 187, n°3238)
Décret administratif, prévoyant la distribution des synagogues dans l’Empire et la nomination des notables qui en seront les administrateurs.
- décret du 16 juin 1808, qui excepte les juifs établis À livourne du DÉCRET N° 1 PRÉCÉDENT
- Art. Ier. Les juifs établis à Livourne, ne se livrant à aucun trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions prescrites par notre décret du 17 mars 1808, contre les juifs de quelques parties de l’empire.
- L’exception accordée par l’article 19 dudit décret aux juifs de Bordeaux, leur est applicable.
- Notre ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret. »
- DÉCRET DU 20 JUILLET 1808 CONCERNANT LES JUIFS QUI N’ONT PAS DE NOMS DE FAMILLE ET DE PRÉNOMS FIXES (4, Bull, 198, n° 3589)
– Art. Ier. Ceux des sujets de notre empire qui suivent le culte hébraïque, et qui jusqu’à présent n’ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d’en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d’en faire la déclaration par-devant l’officier de l’état civil de la commune où ils sont domiciliés.
- Les juifs étrangers qui viendraient habiter dans l’empire, et qui seraient dans le cas prévu par l’article Pr, seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.
- Ne seront admis comme noms de famille aucun nom tiré de l’Ancien Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms ceux autorisés par la loi du 11 germinal an II.
- Les consistoires, en faisant le relevé des juifs de leur communauté, seront tenus de justifier et de faire connaître à l’autorité ceux des juifs de leur communauté qui auraient changé de nom sans s’être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an II.
- Seront exceptés des dispositions de notre présent décret les juifs de nos États ou les juifs étrangers qui viendraient s’y établir, lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus, et qu’ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien Testament ou des villes qu’ils ont habitées.
- Les juifs mentionnés à l’article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d’en faire la.déclaration, savoir: les juifs de nos États, par-devant la (p.503) mairie de la commune où ils sont domiciliés ; et les juifs étrangers, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile : le tout dans le délai porté en l’article Ier.
- Les juifs qui n’auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l’empire : à l’égard de ceux qui, dans quelque acte publié ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s’être conformés aux dispositions de la loi du II germinal, ils seront punis conformément aux lois, et même comme faussaires, suivant l’exigence des cas.
- Notre grand-juge, ministre de la justice, et nos ministres de l’intérieur et des cultes, sont chargés de l’exécution du présent décret. »
3 Autres analyses
3.1 http://judaisme.sdv.fr/histoire/historiq/napo/napoleon.htm
3.1.1 NAPOLEON et les JUIFS de l’ EMPIRE
Médaille du Grand Sanhédrîn . Napoléon 1er donne les Tables de la Loi à Moïse ; 30 mai 1906 – Bronze, Coll. Musée d’Israël
par Francis WEILL
Pour nos coreligionnaires, Napoléon 1er a été un grand Empereur, très souvent comparé au Messie
Nous savons tous que Napoléon est à l’origine de la convocation – en 1807 – du Grand Sanhédrîn qui a conduit à la création du Consistoire Central des Israélites de l’ Empire, donc au-delà du simple territoire de la France contemporaine. Cette création devait conduire à l’organisation administrative des Juifs, afin d’avoir un meilleur contrôle sur eux et surtout assurer leur soumission à l’ Empereur et à sa famille, puisque plusieurs frères et beaux-frères régnaient sur différents pays d’ Europe. Je ne reviendrai pas sur l’ organisation administrative du judaïsme, en général elle est assez connue de tous et n’a peu changée depuis sa mise en place.
Par contre, ce que nos coreligionnaires savent moins c’est que Napoléon 1er ne s’est pas arrêté à cette seule organisation. D’ autres mesures avaient été prises par lui, certaines se perpétuent encore de nos jours, d’autres ont disparues.
PRISE de NOMS des JUIFS :
Par le Décret de Bayonne du 28 juillet 1808, Napoléon imposa à tous les juifs de l’ Empire de prendre un » nom définitif » !
Les Juifs étaient accusés d’avoir des noms changeants à chaque génération, ce qui ne permettait pas de retrouver des gens et encore moins de fixer les liens de parentés à l’ intérieur d’ une même famille et entre descendants et ascendants. En plus, il était interdit de prendre des noms hébraïques en tant que patronymes, mais également comme prénoms. Cependant on constatera que cette interdiction ne sera pas respectée. Les patronymes que les Juifs d’ Europe occidental portent de nos jours ont ainsi été pris de façon définitive en 1808. De nombreux pays d’ Europe, au-delà de l’ Empire, prendront la même décision par la suite.
Bien que les Juifs d’ Alsace aient été plus spécialement visés, puisqu’ ils représentaient la moitié de la population juive de France, il était faux de prétendre qu’ ils n’ avaient pas de noms de famille. Les : Bloch, Dreyfuss, Kahn, Lévy, Weill, etc… avaient bien un nom de famille en usage depuis des siècles , mais comme en général ils étaient assimilés à des parias on ne les connaissaient que sous leur sobriquet ou leur prénom, si ce n’est sous le prénom du père associé à celui du fils ou inversement. Là, nos compatriotes chrétiens d’ Alsace étaient encore aimables, car trop souvent on connaissait nos coreligionnaires sous leur prénom complété par « Judt « , par exemple : der Judt Leibele (le juif Yehouda). En recherchant des actes notariés d’ avant 1808, on retrouve dans les index des registres de notaires: un prénom hébraïque complété par « Judt ».
Or, en recherchant l’acte lui-même, on constate que la signature apposée en fin d’ acte précise le prénom suivi du nom de famille, d’autant moins sujet à caution que cette signature est écrite en caractères latins, éventuellement en gothique. Lorsque le juif en question est moins lettré, sa signature est en caractères hébraïques où le patronyme apparaît entièrement et souvent suivi par le lieu d’habitation (mi…..) .
Donc, en 1808, les Juifs d’ Alsace feront enregistrer les patronymes qu’ ils avaient depuis longtemps, et ceux dont le patronyme indiquait le lieu d’ origine de leur ancêtre le plus lointain conserveront ce nom. Par exemple : Worms ou Wormser . Dans d’ autres cas, certains profiteront de l’ occasion pour changer de nom de familles. Le plus connu est le cas de Wintzenheim (Haut-Rhin) où il y avait de très nombreux Lévy. Les détenteurs de ce nom se sépareront en : Lévy pour une part, en Meyer ou en Epstein. Comment firent-ils pour choisir ces noms ? Nous n’ en savons rien, mais on constate qu’ il existait des Epstein en Europe de l’Est et que ceux-ci étaient aussi des Lévy ! Hégenheim se distinguera aussi par des choix assez particulier pour cacher les origines lévites. On connaît aussi d’ autres exemples de changement : des Lévy qui deviendront des Weill, rares cas de Weill ayant des origines lévites.
Dans le nord de l’ Alsace, il se trouvera un employé d’état-civil qui se permettra d’affubler les juifs de la commune avec des noms et des prénoms à consonance italienne: Levino, Longini, Norphuro, Philanthropos, etc….
Dans le choix d’autres patronymes, ils prendront leur nom hébraïque transformé en allemand, exemple : Benyamin deviendra Wolff. Les Nephtali deviendront, selon le cas, Hirsch, Hirtz, Cerf, Zvi ou encore Zivy, avec toutes les autres variantes possibles. D’autres encore prendront leur profession comme patronyme, par exemple : des chantres deviendront Singer (abréviation de Vorsinger), des sophers seront des Schreiber, des relieurs se transformeront en Binder, un marchand de rubans choisira de se faire appeler : Bendelmann.
Comment se fit le choix du nom à travers les familles ? Nous ne le savons pas très bien, mais il est toutefois surprenant de constater que des familles relativement dispersées géographiquement adopteront le même patronyme. Il faut donc croire qu’ il y eu au préalable une profonde concertation , bien que le téléphone n’existait pas à l’époque, ni les transports en commun autres que la diligence.
CERTIFICATS de NON-USURE :
De nombreux chrétiens se plaignaient d’ être victimes de l’ usure pratiquée par les juifs. Il est vrai qu’ auparavant, lorsque les dettes vis à vis des juifs étaient devenus trop importantes, la solution utilisée était de les expulser de la cité, de la province ou même du pays. La dette s’annulait automatiquement, puisque le juif créancier avait disparu de l’ horizon. C’est ce qui explique toutes les expulsions qu’on connues nos ancêtres à travers les siècles.
De ce côté l’ Alsace n’ était pas en reste, la plus importante expulsion fut celle de 1349, les juifs étant accusés d’avoir empoisonné les puits, lors de la peste noire.
L’ Alsace avait perdu près de 30 % de sa population à la suite de la guerre de Trente Ans (1618-1648), au point que Louis XIV – nouveau souverain – avait dû faire appel à des populations étrangères (d’Allemagne, de Suisse, d’ Autriche plus de Huguenots Français) pour repeupler la province. C ‘est à ce moment que de nombreux juifs rhénans vinrent aussi s’ établir en Alsace et y accroître la communauté juive. Ce qui fait que les Juifs avaient pratiquement autant d’ancienneté en Alsace que les chrétiens. Ils avaient en plus la reconnaissance du souverain, car ils avaient aidés les troupes royales – par leur fournitures aux armées – à combattre l’ ennemi, en l’ occurrence la Maison d’Autriche.
En quoi consistait l’ usure ? Comme les banques n’ existaient pas à l’époque, c’était le marchand juif – essentiellement le marchand de chevaux ou de bétail – qui devait faire crédit à son client paysan lorsqu’il lui fournissait des animaux ou encore lorsqu’il revendait une terre ou une ferme. Le paysan assurait le paiement essentiellement à la fin des récoltes et plus particulièrement à la St-Martin. Lorsque la récolte était mauvaise, le paysan n’ avait plus qu’un recours : ne plus payer « son juif ». On retrouve aux archives des commerçants juifs qui n’étaient pas encore payés au bout de trois, voire huit ans ! Or, lorsqu’ il y avait un crédit d’effectué, cela devait se faire par acte notarié sous peine que la créance ne soit pas reconnue juridiquement. Par les actes notariés on retrouve les taux d’ intérêts qui étaient demandés : en général 5%.
Un taux plutôt léger à l’heure actuelle !
Devant les récriminations d’être exploités par les juifs, Napoléon 1er prendra une disposition qui a été nommé : le « Décret infâme « . En 1809, il impose à tous les juifs – et ceci aux seuls juifs – exerçant une profession commerciale ou industrielle, l’ obligation d’obtenir un certificat de non-usure, afin de recevoir leur patente. Ce certificat, renouvelable chaque année, devra leur être remis par le maire de leur localité d’ habitation.
Ce sera une occasion extraordinaire pour les maires d’ assouvir leur supériorité sur leurs administrés juifs , voire même une possibilité de se venger contre le juif devenu trop riche ou trop important à leurs yeux. On retrouve les dossiers, cité par cité, avec les commentaires du magistrat municipal. Ainsi à Muttersholtz (Bas-Rhin) par exemple, le maire traite 95 % de ses administrés juifs d’ « usuriers ». 95 % des commerçants juifs de cette ville devront donc arrêter l’exercice de leur profession de marchands de bestiaux ou de boucher. De quoi vont-ils pouvoir subsister ? Pour Mutzig, qui était le siège de rabbinat des Terres de l’ Évêché de Strasbourg, sept commerçants vont se voir refuser le précieux document. Les sept vont faire un recours auprès du Préfet de Strasbourg. Un autre juif, industriel, fait aussi une pétition. Il indique que son entreprise d’ orfèvrerie emploie 400 (quatre cents) personnes qui vont être sans emploi si le certificat ne lui est pas accordé.
Comme dans les familles juives des fils auront reçu ce certificat de non-usure, alors que leur père ne l’aura pas obtenu, il va se créer des difficultés relationnelles. Toutefois, comme les personnes qui auront été écartées d’une obtention de patente ne voudront pas mourir de faim, il ne leur restera plus qu’ à exercer leur activité professionnelle sans payer leur patente.
L’animosité des maires, contre leurs administrés juifs du Bas-Rhin, sera tellement importante que le ministre des Finances de l’ Empereur – le Baron Louis – s’ adresse au Préfet pour avoir des explications sur la chute importante des rentrées d’ impôts. Le préfet transmet au président de la Chambre de Commerce qui avoue que de très nombreux Maires ont refusé les « certificats de non-usure » par vengeance personnelle, bien que l’ usure n’ était pas avérée. Cette obligation de certificat sera supprimée, puisque trop coûteuse en pertes fiscales pour l’Empire.
SERVICE MILITAIRE :
Souvenir du numéro de tirage au sort du conscrit Léopold Bauer, incorporé dans Shiviti (décoration murale, pour indiquer la direction de la prière) – Strasbourg 1885, Gouache et encre sur papier, Coll. Musée Alsacien, Strasbourg
A l’époque napoléonienne on n’était incorporé dans les armées que si on avait tiré un « mauvais numéro » lors de la conscription. Chaque appelé en puissance devait tirer un numéro, genre de loto, dont certains étaient dispensés de service militaire et d’ autres devaient l’effectuer. Le « mauvais numéro » était celui qui vous obligeait d’aller à l’armée, le « bon numéro » vous en dispensait.
Par contre quand on avait tiré le « mauvais numéro » et lorsqu’ on avait des moyens financiers relativement importants, il était possible de s’acheter un remplaçant, c’est à dire se faire remplacer contre monnaie sonnante et trébuchante par un conscrit dispensé du service armé – ayant tiré un « bon numéro » l’exemptant de service. Ceci à condition que le remplaçant fut dans le besoin, ou veuille guerroyer.
Ce procédé de remplacement était courant et les classes plus aisées en profitaient pour que leurs enfants n’aient pas à participer aux guerres de l’ Empire. Ceci était la règle générale.
Toutefois, il était interdit aux juifs malchanceux de se faire remplacer ; ils devaient partir à la guerre . Finalement après de nombreuses demandes pour bénéficier des mêmes conditions que leurs concitoyens, et par mesure disons de « bienveillance », Napoléon 1er accepta que les conscrits juifs puissent se faire remplacer, à une seule condition : que le remplaçant fut juif !
On voit ainsi, dans les exemples qui précèdent, que Napoléon 1er, bien qu’originaire d’ une région où les Juifs n’ avaient jamais vécu, s’acclimata très rapidement à toutes les récriminations populaires contre les Juifs.
3.1.2 LES JUIFS D’ALSACE SOUS L’EMPIRE
(Extrait d’une thèse consacrée par l’auteur aux Juifs d’Alsace)
A la veille de la Révolution, l’Alsace comptait 20 à 25 000 Juifs répartis dans 200 villages et bourgades. C’était sans doute la population la plus misérable de France; sauf une poignée d’industriels et fournisseurs des armées, ils vivaient au jour le jour de petit commerce, colportage et prêts d’argent. La situation s’était un peu améliorée au point de vue légal grâce aux ordonnances de 1784; mais ils auraient été condamnés à végéter longtemps dans l’ignorance et la pauvreté si l’Empire n’avait entrepris d’accélérer leur évolution par des mesures autoritaires. En l’espace d’une génération une communauté de parias était intégrée civiquement à la société française.
Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirmait que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public (article X), et, après une lutte acharnée, il avait été décidé définitivement, le 27 septembre 1791, de faire bénéficier tous les Juifs de France de la citoyenneté. Toutefois, la théorie devance souvent la pratique ; et c’est ce qui se passa, notamment là où l’admission des Juifs dans la société n’était pas seulement une affaire de principe, mais un élément de la vie quotidienne, en tout premier lieu en Alsace et en Lorraine, où un abîme sépara pendant quelques années l’égalité proclamée de la situation réelle.
Cet abîme apparut dans toute son ampleur quinze ans plus tard, lorsque Napoléon 1er entreprit, par le décret du 17 mars 1808, de réduire les droits des Juifs, sous les réclamations incessantes de la population alsacienne et de ses porte-paroles contre les Israélites, et surtout contre les agissements de ceux d’entre eux qui exerçaient le prêt à intérêt. Malgré tout ce qui a été écrit contre cette mesure arbitraire et malgré le fait qu’elle est incontestablement contraire aux principes de la démocratie, elle avait des aspects et elle eut des effets bienfaisants. En imposant des restrictions draconiennes à une partie des citoyens en raison de leur appartenance ethnico-religieuse, elle voulait les défaire de certaines habitudes acquises, nuisibles à eux-mêmes autant qu’à autrui. Bonaparte avait l’esprit unificateur et n’hésitait pas à forcer les structures qui y résistaient. Mais, du moins en ce qui concerne la place des Israélites dans la société française, c’est, sous le rapport de l’avenir, un service que l’empereur a rendu aux Juifs.
Le seul argument qu’on peut valablement opposer à ces considérations, c’est que sans coercition, la même évolution se serait produite tout de même. La question reste alors de savoir si le gain d’une génération valait les vexations subies. Nous penchons pour l’affirmative. Toujours est-il que cet acte impérial mit durement à l’épreuve le statut nouveau et fragile des Juifs de France. En confiant aux conseils des villages où habitaient la plupart des Israélites en Alsace, le droit de décider qui obtiendrait l’autorisation de s’adonner au commerce, les autorités fournissaient l’occasion d’exprimer toutes sortes d’opinions et de sentiments. C’est en effet ce que nous révèlent les dossiers des patentes du département du Bas-Rhin.
Les préjugés à l’égard des Juifs se manifestent évidemment un peu partout, soit pour des raisons d’intérêt — pour se débarrasser de concurrents gênants — soit par conviction plus ou moins sincère de l’infériorité des Juifs, conviction si répandue dans le monde chrétien et apparemment justifiée par les dehors souvent sauvages et insolites de nos ancêtres à cette époque. Toutes les accusations classiques contre la «race maudite», sa paresse, sa cupidité, sa fourberie, figurent en bonne place dans les observations des conseils municipaux (1).
La protection de la Loi assurée à tous les Français
Par contre, nous avons de nombreuses preuves de l’existence d’une tendance opposée chez un nombre appréciable de non-Juifs. L’expression la plus marquante de cette attitude se trouve dans les lettres circulaires des «magistrats de sûreté», juges affectés à la direction de la police, et notamment de celui de l’arrondissement de Strasbourg, Loyson. Ce dernier, dans sa circulaire imprimée du 1er juillet 1808, adressée à tous les juges de paix, officiers de polices. maires adjoints, etc., expose sa position sans la moindre équivoque dans les termes suivants «M. le Procureur général en la Cour de Justice criminelle du département du Bas-Rhin, informé que dans quelques communes du ressort on s’appuie sur le décret impérial du 17 mars dernier pour exercer des vexations contre les sectaires de la loi mosaïque, me charge de prendre toutes les mesures nécessaires pour neutraliser une pareille malveillance et atteindre ceux qui, abusant des dispositions bienfaisantes dont le seul but est de réprimer l’usure et de réparer en partie les maux qu’elle a causés, se permettent d’attenter à la sûreté individuelle que la loi assure à chaque sujet de l’Empire… Lors même qu’un Juif n’obtiendrait pas la patente que l’article 7 du décret lui rend indispensable pour continuer son commerce, il ne perd point par là son droit à la protection que la loi assure à tout Français… »
Répondant à la même invitation du Procureur général, le magistrat de sûreté de l’arrondissement de Sélestat, Beaudel, écrit dans sa circulaire « S’il était vrai (comme M. le Procureur général me fait l’honneur de marquer l’avoir appris avec inquiétude) que l’exécution du décret impérial du 17 mars dernier ait dans quelques communes de cet arrondissement été le prétexte de certaines menaces et vexations contre les Juifs, je vous prie de me faire parvenir de suite les procès-verbaux que vous avez dû dresser ou que vous dresserez dans la suite contre les ennemis de l’ordre qui ont osé ou oseraient sous quelque prétexte que ce soit, se permettre de le troubler.
Si l’ignorance ou la méchanceté avaient insinué que les sectaires de la loi de Moïse pouvaient plus impunément être molestés que tout autre citoyen, empressez-vous de détruire cette impression aussi absurde en répondant que les Juifs n’ont pas plus cessé que nous d’être citoyens français et sous la sauvegarde des mêmes lois. Celle du 17 mars dernier, loin d’autoriser le moindre genre d’oppression contre les Juifs, montre, au contraire, la bienfaisante intention de notre auguste Empereur d’amener cette portion de son peuple à un sort meilleur.
Quant à nous, Messieurs, nous ne devons jamais faire attention à l’espèce de religion que professe celui qui réclame justice, nous la devons également et en vertu des mêmes lois provoquer pour tous, et accorder même dans nos fonctions d’officiers de police judiciaire une protection encore plus spéciale à ceux de nos concitoyens qui se trouveraient dans des conditions à en avoir momentanément un besoin plus particulier.»
Rigueur et libéralisme des Municipalités
Nous possédons aussi de remarquables témoignages de considérations pour les Juifs de la part de membres de conseils municipaux.
L’un des plus impressionnants est constitué par les observations du maire de Sarre-Union, Petermann, au bas de la liste des Israélites proposés pour la patente. En voici la teneur :
«Le conseil municipal a voté eu faveur de 16 Juifs, dont 6 encore garçons. En général, on ne peut rien dire ny contre les uns ny contre les autres parce que leur fortune ne leur permettrait pas de faire un commerce brillant, et que tous ont de la peine à vivre, mais le conseil municipal a donné l’exclusion à 18 autres plus fortunés. Le Sieur Maire ne connaît pas les motifs secrets qui ont décidé la majorité, mais il croit que dans le nombre l’on aurait pu accorder des patentes à (ici, le nom de 13 Juifs). Ceux-ci n’ont pas contre eux la généralité de l’opinion publique. Quant à (ici, le nom de 5 Juifs), ceux-ci sont tarés et prévenus d’usure.
Mais en partant du principe général émis par plusieurs membres que, puisque Sa Majesté Impériale a accordé un délai de dix ans pour la conversion (2) des Juifs, le conseil municipal aurait dû au moins voter pour un an en faveur de tous (ceux-ci) indistinctement. Alors connaissant la conduite que les uns et les autres auraient tenu pendant cette année, il aurait pu à la prochaine séance se décider en connaissance de cause, et alors refuser la patente à celui qui aurait abusé de celle qui pour la première fois lui aurait été accordée. Le Sieur Maire observe au surplus qu’il est dans l’intérêt de la ville de favoriser le marché aux bestiaux qui s’y tient de quinzaine en quinzaine. Il n’est fréquenté que par des Juifs, les uns amenant des bestiaux, les autres les achetant et les transportant dans l’intérieur du département. Les Juifs de Sarre-Union qui, avant le décret du 30 mai 1806, faisaient le commerce d’argent se sont adonnés du (sic) depuis au commerce des bestiaux. Ils cherchent leurs chevaux dans les Ardennes et audelà, ils nourrissent le marché et en vivent. Si donc on leur refuse la patente, alors le marché n’étant plus approvisionné tombera et avec lui la fortune de la plus grande partie de nos cabaretiers, et conséquemment l’estroi municipal. Cette perte ne sera pas la seule, le boucher, le boulanger, le sellier, le tanneur, etc., y seront privés des approvisionnements que l’on faisait chez eux et ainsi l’industrie générale de la ville sera réduite de moitié. Si à ces considérations l’on ajoute que les Juifs sont hommes et pères de famille, Monsieur le Préfet, convaincu que l’Etat qui les a accueillis leur doit cette protection, permettra au Sieur Maire d’émettre le voeu d’accorder des patentes pour la première année à tous les Juifs indistinctement, sauf au bout de l’année à les refuser à ceux qui se seraient rendus indignes de ces principes philanthropiques.»
De même, le maire de Marmoutier (Mauremünster), ajoute au bas de la liste des patentés :
« Le soussigné… est entièrement d’avis que les 23 Juifs portés (sur la liste des Juifs proposés pour l’admission à la patente) en sont dignes, mais qu’encore, parmi les 17 déclarants auxquels on a refusé les certificats, il se trouve douze à quinze qui sont chargés d’enfants et qui n’auront aucun moyen de s’entretenir ; qui, depuis qu’ils sont instruits de refus viennent d’un moment à l’autre à la mairie, tantôt avec leurs vieux père et mère, tantôt avec leurs enfants à pleurer, à crier et à lamenter, parce qu’ils voyent le premier juillet comme leur premier jour sans pain.
Le soussigné croit que c’est un devoir de l’humanité de faire ces observations »
Le conseil municipal du chef-lieu fit preuve aussi dans cette affaire, sinon de sympathie pour les Juifs — nous en sommes loin, et cela n’a pas lieu de nous étonner, si nous nous souvenons de la politique constamment hostile de la municipalité strasbourgeoise depuis l’affaire de l’autorisation de séjour de Cerf Berr à la fin de l’Ancien Régime et pendant toute l’époque révolutionnaire — du moins de respect pour les droits de l’homme à leur égard. Cela ressort clairement du préambule qui figure en tête de la décision d’accorder la patente à certains Israélites de la ville, du 28 juin 1808, et de nouveau dans le préambule de la liste complémentaire du 12 mai 1809.
Dans le premier de ces textes, on lit notamment :
«Le conseil municipal, pénétré de l’importance de l’opération qui lui est déléguée, laquelle sortant du cercle de mes attributions ordinaires le constitue dans les fonctions délicates de jury moral et politique à la fois, considérant que dans le travail dont il est chargé il cherchera à remplir dignement les vues du gouvernement, qui sont de réprimer la corruption et le vice opiniâtre, mais qui sont aussi d’encourager ceux des Juifs qui, sous l’influence de sa protection et des progrès de la civilisation, ont ouvert les yeux à la dignité de citoyen et ont consacré à l’avantage de la société et des moeurs leurs travaux, leur industrie et leur fortune ; qu’en établissant cette distinction en leur faveur, il croit agir avec l’impartialité rigoureuse dont le gouvernement lui-même a donné l’exemple dans son décret impérial, où il a honorablement classé les Juifs de Paris, de Bordeaux et autres lieux… ; et qu’il doit croire, de son côté, que les Juifs de Strasbourg ne tarderont pas à se rendre dignes, à leur tour, de la même exception.», etc.
Les directives préfectorales
Dans le deuxième de ces textes, le conseil réforme favorablement, à titre provisoire pour un an, une décision antérieure à l’égard de quelques candidats, considérant «que les nouveaux renseignements puisés sur leur compte… sont généralement plus en leur faveur aujourd’hui ; qu’il en résulte dès lors la preuve que la mesure sage adoptée par le gouvernement atteint successivement son but qui était de les arracher à des habitudes vicieuses et nuisibles et de les rapprocher de plus en plus de la civilisation moderne» (3).
Cependant, ce ne sont pas toujours les maires qui sont plus tolérants que les autres membres des conseils municipaux. Ainsi, à Balbronn, le conseil avait décidé, le 4 juillet 1808, d’accorder le «certificat de non-usure» à tous les Juifs de la localité, et c’est le maire et son adjoint qui s’y opposent. Toutefois, ils reconnaissent eux-mêmes, à la fin de leur protestation, qu’il ne convient pas d’enlever aux Juifs le pain de la bouche, si bien que leur opposition est peut-être plus théorique que pratique.
Des différences assez nettes subsistent d’un individu à l’autre, même entre deux hauts fonctionnaires, comme le sous-préfet de Sélestat et celui de Saverne. On le voit en comparant les rapports de l’un et de l’autre sur les réclamations nombreuses et justifiées qu’avaient soulevées les arrêts non motivés de plusieurs conseils municipaux. Alors que Reyss, le sous-préfet de Saverne, déconseille vivement d’examiner de trop près les décisions des autorités locales, ce qui d’après lui causerait trop de complications, Cunier, son collègue de Sélestat, tient absolument à sauvegarder la justice.
Il avait adressé au préfet dès le 1er juillet 1808 un rapport circonstancié précédé par des considérations de style ampoulé sur la grandeur de l’impérial législateur et sur les tribulations du peuple d’Israël au cours des âges. Au sujet des Juifs dont les requêtes sont repoussées en bloc, il s’exprimait en ces termes :
«Ceux qui composent cette dernière classe se trouvent dans la position la plus cruelle. Des habitudes de toute la vie ne se changent pas en un instant, des hommes qui ont existé pendant bien des années que dans l’exercice d’une industrie, d’un commerce ou d’une profession, qui ne possèdent aucune propriété rurale, ne deviennent pas en un jour des agriculteurs et des journaliers. Un grand nombre de familles voyant tarir en un moment la source qui les alimentait, mis aux prises avec les plus pressants besoins, l’Administration ne les verrait-elle pas avec inquiétude placés entre le désespoir et le crime ? »
Cunier propose en conséquence d’envoyer sur place des enquêteurs pour tirer au clair les cas contestés. Le préfet se rangea au second avis. Les consignes qu’il donne sont sans équivoque : il s’impose de juger chaque individu à part, et il ne faut lui refuser le certificat qu’en spécifiant les griefs qui sont élevés contre lui. Bien plus, ces griefs seront communiqués à l’intéressé, et il lui sera loisible d’y répliquer. Le dossier ainsi constitué sera déféré au préfet, qui décidera souverainement. Jusque-là, l’autorisation d’exercer son commerce sera rendue provisoire à l’appelant.
Il ne faut donc pas s’étonner de constater que plusieurs conseils municipaux, comme ceux de Dauendorf et de Mutzig, après avoir refusé en bloc toutes les patentes aux Juifs et s’être faits réprimander pour ce fait, aient fait complètement volte-face et accordé, au cours d’une nouvelle délibération, l’autorisation à tous les candidats.
De même, en 1812, en marge d’une pétition de quatre Juifs de Soultz-sous-Forêts, qui demandaient vainement la patente depuis 1808, le préfet écrivait :
«Si le conseil municipal persiste dans son refus, il devra le motiver, autrement, je passerai outre. Ici tout arbitraire serait forfaiture.»
Dans quelle proportion les municipalités ont-elles répondu aux demandes d’une façon positive? Nous connaissons les chiffres de l’année 1809 grâce au Document Consistorial, qui fournit les indications suivantes :
Chefs de famille3 073
Inutile d’ajouter quoi que ce soit,
le tableau est d’une clarté aveuglante
N’ont pas fait la demande1 087
Ont obtenu la patente1 477
Ne l’ont pas obtenue169
3.2
http://rh19.revues.org/document1872.html
2007-35 / La Restauration revisitée – Les formes de la protestation – Une histoire de l’Etat
Nicolas Lyon-Caen
Pierre Birnbaum, L’Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l’État, Paris, Fayard, 2007, 294 p. ISBN : 978-2-213-63211-7. 22 euros.
Pierre Birnbaum prend pour objet les deux assemblées des juifs de l’Empire convoquées par Napoléon, celle des notables (de juillet 1806 à avril 1807), puis le Grand Sanhédrin (du 4 février au 9 mars 1807). Il s’attache également aux différentes mesures visant les juifs et le culte juif prises avant et après elles, le décret de mai 1806 portant convocation de l’assemblée et moratoire des créances détenues par les juifs, et celui de mars 1808 (surnommé décret infâme) confirmant ces mesures et restreignant en outre les libertés et déplacements d’une partie des juifs, auxquels est aussi refusée la possibilité du remplacement au service militaire. Elles sont insérées entre des analyses historiographiques traitant de la mémoire de ces assemblées. Pierre Birnbaum envisage entre autres l’image de la lutte perdue de Napoléon contre les juifs dans l’antisémitisme français et la place de l’événement à diverses étapes de l’histoire du judaïsme français. Immédiatement et diversement discuté au sein du monde juif, comme en témoignent certains contes brodés autour des conséquences du décret infâme, le Sanhédrin ne cesse d’alimenter la polémique. De ce survol un peu rapide se détache le commentaire de la réception de la thèse de Robert Anchel soutenue en 1928. Son travail consacré à Napoléon et les Juifs avait alors mis à jour l’essentiel des sources mais avait surtout fortement critiqué l’attitude de l’empereur. Albert Mathiez, son directeur, pourtant sensibilisé à cet objet au cours de sa vie scientifique, émit de fortes critiques à l’encontre du texte, précisément sur le traitement de Napoléon, s’autorisant même des attaques à l’encontre des origines juives de l’archiviste devenu sous sa plume le « vengeur » de « la race des persécutés ».
Reprenant les analyses d’Anchel et citant abondamment ses sources, Pierre Birnbaum propose cependant une lecture assez neuve du déroulement du Sanhédrin. Le contexte religieux qu’il restitue est moins celui de la réorganisation des cultes de 1801-1802 que celui de l’affirmation, au lendemain du sacre, du caractère catholique du pouvoir et de son « prince chrétien » vers 1806-1808, – affirmation manifestée notamment par la création de la saint Napoléon le 15 août et l’élaboration du catéchisme impérial. Il pointe encore l’hostilité foncière évidente de Napoléon et de quelques proches envers les juifs, tout particulièrement le conseiller d’État Mathieu Molé, un des principaux interlocuteurs des assemblées, peut-être nourri par une image dévalorisante du juif comme oriental (mais les preuves directes manquent). Elle s’inscrit surtout dans le contexte intellectuel d’une polémique ouverte au début de 1806 par des écrits de Bonald et de Poujol dénonçant l’emprise de l’usure juive sur l’Alsace. De fait, du point de vue de Napoléon, la réunion est organisée pour remédier
aux problèmes spécifiques posés par les juifs. Cette hostilité transpire des questionnaires soumis aux assemblées, ouvertement méprisants et remettant directement en cause la citoyenneté des Français juifs. Or, et c’est là la ligne de force du livre, Pierre Birnbaum souligne la résistance courageuse des notables et des rabbins qui réaffirment l’héritage de l’émancipation : ils sont déjà français et citoyens et personne ne peut revenir sur les acquis de l’émancipation dont témoigne leur participation à la conscription. L’acharnement d’une bonne partie d’entre eux les conduit donc à argumenter sur le plan du droit commun de la nation en même temps que s’élaborent aussi des réponses halakhiques articulées sur le principe dina de malkhuta dina (la loi du pays est la loi). L’approche permet ainsi de renouveler une analyse encore tributaire des débats opposant l’assimilation au particularisme, la trahison à la fidélité, et dénonçant la responsabilité du Sanhédrin dans la sclérose intellectuelle du judaïsme occidental. Pierre Birnbaum souligne réciproquement la non moins forte résistance de l’appareil d’État aux projets de l’empereur, appuyée sur des arguments tout à fait similaires. Les membres du conseil d’État n’hésitent pas, à une quasi-unanimité, – Beugnot et Regnaud de St-Jean d’Angely en tête –, à juger les mesures de l’empereur illégales et à exprimer leur indéfectible attachement aux principes universalistes de la Révolution. Revendiquant non seulement l’égalité civile entre tous les citoyens mais encore la liberté des cultes, ils refusent obstinément de distinguer des classes parmi les citoyens. À l’unisson, la plupart des préfets chargés de mettre en place les consistoires et les mesures restreignant les déplacements et activités des juifs n’hésitent pas de leur côté à plaider la cause de leurs administrés auprès du pouvoir.
C’est à cette aune exigeante que Pierre Birnbaum exprime un constat désabusé sur le retour au langage du paternalisme dominateur de l’Ancien Régime pendant et après l’assemblée. Fleurissant dans les louanges flagorneuses décernées à Napoléon et aux Bourbon restaurés, il révèle pourtant probablement moins une lâcheté politique que les ambiguïtés inhérentes à la reconnaissance des identités collectives au sein du monde démocratique à la française. L’organisation des assemblées et le décorum typiquement impérial dont elles s’accompagnent exercent une indéniable séduction sur les participants, même les plus libéraux. C’est qu’elle met en valeur les juifs en tant que nation soudain portée à la lumière et « régénérée » sous l’aile de l’Aigle. La proximité au pouvoir voulue par la résurrection d’une institution immémoriale transforme les juifs en un corps doté d’une dignité et d’un rang dans l’État, une reconnaissance dans l’inégalité. L’évocation de la commémoration officielle du 190e anniversaire du Sanhédrin qui ouvre et clôt l’ouvrage traduit bien ce sentiment de partage, ressenti semble-t-il par Pierre Birnbaum, entre la douceur de l’inclusion communautaire et l’agacement du citoyen épris de laïcité.
Pour citer cette recension
Nicolas Lyon-Caen, «Pierre Birnbaum, L’Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l’État, Paris, Fayard, 2007, 294 p. ISBN : 978-2-213-63211-7. 22 euros.», Revue d’histoire du XIXe siècle, 2007-35, La Restauration revisitée – Les formes de la protestation – Une histoire de l’Etat , [En ligne], mis en ligne le 3 janvier 2008. URL : http://rh19.revues.org/document1872.html. Consulté le 1 juin 2008.
3.3 http://www.lamed.fr/judaisme/Histoire/1417.asp
par le Rabin Ken SPIRO
L’âge de la Raison a donné aux Juifs les droits civils, mais l’accent qu’elle mettait sur une société sans Dieu a entraîné des conséquences dramatiques.
Le milieu du XVIIème siècle a marqué la fin de la Renaissance. La nouvelle idéologie qui a émergé à sa suite et qui s’est inscrite dans ce que l’on a appelé le » siècle des Lumières » continue aujourd’hui encore d’imprégner dans une vaste mesure le monde occidental. Nous devons comprendre cette idéologie et le rapport qu’a entretenu avec elle le peuple juif afin de tenter de rendre intelligible ce qu’il adviendra après dans notre histoire.
Le siècle des » Lumières » (1650 1850) a été caractérisé par des percées réalisées par les systèmes de pensée en s’éloignant de la religion et en se tournant de plus en plus vers la laïcité, l’humanisme, l’individualisme, le rationalisme et le nationalisme.
De tous ces derniers concepts, c’est surtout le rationalisme qui a défini le siècle des » Lumières « , que l’on a aussi appelé » l’âge de la Raison « .
Nous avons vu précédemment que le Moyen Age a été dominé par l’Eglise et par l’idée de l’omniprésence de Dieu. Après lui est venue la Renaissance, avec la primauté accordée à l’homme et l’accent mis sur les arts et les connaissances issues de la culture classique. Les » Lumières » ont poussé plus loin encore la suprématie de l’être humain, en insistant sur son intelligence, sur la pensée rationnelle et sur les sciences empiriques. Avec elles, tout s’est concentré sur l’individu.
Le siècle des » Lumières » a été à l’origine de beaucoup d’idées et d’institutions positives : la démocratie libérale, la révolution scientifique, l’industrialisation. Mais cette importance accordée à l’individu a aussi conduit à des remises en question de certaines institutions fondamentales du monde occidental, et notamment la religion. Celle ci a été considérée par les penseurs du siècle des » Lumières » comme un échec intellectuel qui a été évincé par l’aptitude de la science à expliquer l’inexplicable. C’est ainsi qu’une culture profane a commencé d’émerger comme une très puissante alternative à la religion. L’idée d’un monde sans Dieu prit la racine dans le monde occidental avec de grandes implications tant pour l’Europe que pour le peuple juif.
Si curieux que cela paraisse, moins le monde occidental devenait religieux, mieux il traitait les Juifs. Les fanatiques chrétiens tuaient des Juifs pour les diverses raisons que nous avons vues. Les sécularistes, en revanche, n’avaient aucune raison de les imiter, car les différences dans les appartenances religieuses ne présentaient pour eux aucune importance. Ce qui comptait le plus pour eux, c’était l’identité nationale bien plus que l’identité religieuse.
En même temps que celui de la laïcité, le siècle des » Lumières » a répandu le concept de l’individualisme : Chaque personne prise isolément a de la valeur et de l’importance, d’où le prix croissant attaché aux droits civils.
En apparence, l’accent mis sur les droits civils était favorable aux Juifs. Pour la première fois, le monde occidental commençait de traiter le Juif comme un être humain. Des Edits de tolérance ont été promulgués, accordant aux Juifs certains droits fondamentaux, même si ce n’était pas une égalité complète.
Cependant, de nouveaux problèmes vont surgir, dont les Juifs seront encore une fois les victimes.
La grande différence
Un monde sans référence à Dieu ne peut que se mettre tôt ou tard dans une situation difficile.
Le judaïsme croit que l’accent doit être placé, dans un monde idéal, tant sur Dieu que sur l’homme. Parce que sans référence à Dieu, toutes les valeurs morales deviennent relatives. En quoi cela est il mauvais ? S’il est certes bon d’éprouver du respect pour les droits civils, il se peut qu’il devienne un jour opportun ou nécessaire, pour toutes sortes de raisons politiques ou sociales, de leur accorder une moindre importance. C’est alors que le respect de la vie humaine deviendra une idée démodée. Au contraire, les valeurs données par Hachem sont immuables et ne peuvent jamais devenir démodées. Voilà ce qui fait la grande différence.
Cette grande différence explique comment un personnage essentiel du siècle des » Lumières « , Jean Jacques Rousseau, l’auteur du Contrat Social, qui postulait que les êtres humains sont égaux, a pu être aussi inhumain envers sa propre progéniture. Une jeune lingère a été sa compagne jusqu’à sa mort. Cinq enfants sont nés de ce couple, tous placés par leur père à l’Hospice des Enfants Trouvés. Il a lui même décrit cet établissement dans un de ses ouvrages, notant que les deux tiers des bébés y mouraient à moins d’un an, et que la plupart ne dépassaient pas les sept ans d’âge. Ses nobles idées ne l’ont pas empêché de pratiquer une forme moderne d’infanticide. (Voir The Intellectuals, par Paul Johnson, p. 21 22.)
De la même manière, tous les discours de Voltaire sur l’égalité des hommes ne l’ont pas empêché d’éructer dans son Dictionnaire Philosophique les pires diatribes antisémites, les Juifs y étant définis comme » les gens les plus abominables du monde. » Bien qu’il ne suggérât pas qu’il fallût les tuer, il ne pouvait pas contenir sa haine, mettant en avant » leur avarice, leurs superstitions et la haine qui les animait contre les peuples qui les avaient accueillis « .
En contraste avec la France, la situation a été très différente en Angleterre (où la Révolution puritaine avait exercé une grande influence) et dans le Nouveau Monde, où les Puritains ont joué un grand rôle. La Révolution américaine s’est développée sur le fond d’une synthèse d’idées très religieuses ancrées dans la Bible, introduites par les Pilgrim Fathers ( » Pères pèlerins « , fondateurs des premières colonies européennes en Nouvelle Angleterre) et des principes humanistes, tels que » les droits inaliénables de l’homme « , avancés par John Locke. Nous voyons cela clairement dans les premières phrases de la Déclaration d’Indépendance :
Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles mêmes : que tous les hommes naissent égaux; que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
La Révolution Française, qui a été un mouvement purement séculier, n’a pas opéré cette synthèse. D’où les conflits avec la philosophie du siècle des » Lumières « .
Les réformateurs français, après avoir fait guillotiner le roi Louis XVI et sa femme Marie Antoinette, ont déchaîné le règne de la Terreur, pendant lequel quelque 25 000 » contre révolutionnaires » ont été exécutés d’une manière tout aussi sanglante.
Le règne de la Terreur sonna le glas, pour toutes sortes de raisons, de l’âge de la Raison. La brutalité sanglante montrée par les masses choqua le monde et mit sévèrement à mal la conviction, entretenue pendant le siècle des » Lumières « , selon laquelle l’homme peut se gouverner lui même. Une période d’agitation générale s’ensuivit en France, marquée par la corruption et l’inflation galopante. La Révolution courait au précipice quand Napoléon Bonaparte prit le pouvoir par un coup d’Etat en 1804.
Napoléon et les Juifs
Napoléon Bonaparte (1769 1821), un officier d’origine corse, se couronna Empereur des Français. Pendant les dix années où il détint le pouvoir, il entreprit une série de conquêtes sans précédent par la rapidité de ses mouvements à travers l’Europe. Véritable génie militaire, il engagea des offensives contre les Autrichiens, les Italiens, les Russes. Et il les battit presque tous, devenant le maître du continent et réorganisant toute sa carte.
La cause de sa chute a été l’hiver russe. Lorsque les autres pays européens constatèrent qu’il était vulnérable, ils s’unirent dans une coalition et le battirent, d’abord à Leipzig en 1813, et finalement à Waterloo en 1815. Exilé comme prisonnier de guerre dans l’île de Sainte Hélène, il y mourut d’un cancer en 1821.
Au cours de sa marche à travers l’Europe, Napoléon libéra tous les Juifs de leurs ghettos. L’idée de les libérer et de leur accorder des droits civils l’avait précédé, mais c’est lui qui l’a réellement mise en œuvre.
Napoléon était fasciné par les Juifs, bien qu’il ne les comprît pas. Il voulait qu’ils soient acceptés par le reste de la société européenne, et il pensait que leur rejet ne tenait pas à ce qu’ils étaient différents, mais que s’ils pouvaient ressembler davantage aux autres citoyens, ils seraient mieux acceptés. C’est pourquoi il a voulu aider les Juifs à se débarrasser de tout ce qui les tenait à l’écart. Il a recommandé, par exemple, qu’un tiers de tous les Juifs épousent des conjoints non Juifs.
L’historien Berel Wein, dans son Triumph of Survival, assure que Napoléon n’était pas aussi judéophile que beaucoup de Juifs l’ont cru initialement. Il écrit: L’équité et la tolérance de façade affichées par Napoléon envers les Juifs était basée en fait sur son projet de les faire entièrement disparaître au moyen de l’assimilation totale, des mariages mixtes et des conversions.
A deux reprises, en 1806 et en 1807, Napoléon convoqua des assemblées de notables juifs en vue de promouvoir son dessein de » sauver » les Juifs. Ces dirigeants religieux furent pris de court. D’un côté, ils tenaient à coopérer avec Napoléon et rendre ainsi plus facile la vie des Juifs européens. En revanche, ils ne pouvaient pas acquiescer à celles de ses idées qui auraient conduit à la destruction du judaïsme. Ils lui répondirent aussi diplomatiquement que possible, sans trahir les dispositions de la loi juive.
(Pour d’autres détails sur ce sujet, on pourra se référer à The Jew in the Modern World, par Paul Mendes Flohr, et Jehuda Reinharz, p. 112 132, et à Triumph of Survival, par Berel Wein, p. 69 77.)
Bien que Napoléon ait fini par être vaincu et ait achevé sa vie en exil, le mouvement qu’il a déclenché a fait largement tache d’huile. A la fin du XIXème siècle, il était devenu impossible de refuser aux Juifs la qualité de citoyens, compte tenu de l’environnement plus libéral en Europe.
Au fil des années, les Juifs ont obtenu la citoyenneté dans tous les pays européens. Les deux derniers à l’avoir donnée ont été la Suisse (1874) et l’Espagne (1918).
Cela signifie qu’à la fin du XIXème siècle, les Juifs, qui avaient été économiquement et physiquement marginalisés, qui avait été mis à l’écart de tous commerces et professions, avaient maintenant accès même s’ils n’étaient pas accueillis à bras ouverts à toutes les classes de la société européenne.
Est ce à dire que les » Lumières » avaient mis fin à l’antisémitisme ?
Loin de là.
Elles n’avaient fait que l’intellectualiser.
Le nouvel antisémitisme
Une fois largement ouvertes les barrières des ghettos, les Juifs sont montés rapidement vers les sommets, gagnant prééminence et richesses. Cela ne signifie pas que, malgré leur réussite, ils aient été acceptés dans la société qui les entourait. Les temps avaient changé, mais pas tellement.
Il est vrai qu’il n’y a pas eu au XIXème siècle de pogroms contre les Juifs en Europe de l’ouest. La société issue du siècle des » Lumières » ne faisait pas de telles choses, en tout cas pas en Europe de l’ouest. (Nous parlerons plus loin de l’Europe de l’est, et plus particulièrement de la Russie.)
Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de pogroms que les non Juifs ont soudain commencé d’aimer les Juifs.
Le nouvel antisémitisme de cette époque peut être appelé un » antisémitisme intellectuel « .
C’est ainsi que le baron Lionel Nathan de Rothschild un des Juifs les plus distingués et les plus riches d’Angleterre n’a pas pu occuper son siège au Parlement britannique dont il avait été élu comme membre en 1847 parce qu’il refusait de prêter serment sur une Bible chrétienne. Il a fallu onze ans et le vote du Jewish Disabilities Act pour lever cet obstacle et faire de lui, en 1858, le premier Juif à siéger comme député à Londres.
Benjamin Disraeli, qui a été deux fois Premier Ministre de Grande Bretagne sous le règne de la reine Victoria, n’a pu remplir cette fonction que parce que sa famille s’était convertie à l’Eglise d’Angleterre.
C’est ainsi que les Juifs ont été acceptés dans la société à la condition de ne pas être trop juifs. Si un Juif était prêt à se renier en prêtant serment sur une Bible chrétienne, ou mieux encore, en abjurant sa religion, il était toléré. S’il insistait pour rester fidèle à la Tora et à la Bible hébraïque, on l’invitait à rester dehors.
(Nous examinerons dans le prochain chapitre, quand nous aborderons le mouvement réformiste au sein du judaïsme, la tentative faite par les Juifs allemands pour esquiver ce problème.)
On relèvera que c’est à cette époque marquée par une tolérance sans précédent que le terme » antisémitisme » a été employé pour la première fois. Il a été forgé par un penseur allemand du XIXème siècle, Wilhelm Marr, qui voulait distinguer la haine des Juifs comme membres d’une religion ( » antijudaïsme « ) de celle des Juifs comme membres d’une race/nation ( » antisémitisme « ). Il écrivit en 1879 un livre intitulé Victoire du judaïsme sur le germanisme, qui a connu douze réimpressions en six ans, tellement il a eu la faveur du public.
Un autre penseur important a été Karl Eugen Duehring qui a écrit en 1881 : La question du Juif est une question de race, et qui résume ainsi ce que signifie l’antisémitisme :
La question juive continuerait d’exister même si chaque Juif devait tourner le dos à sa religion et adhérer à l’une de nos grandes Eglises. Oui, je prétends que dans ce cas la lutte entre nous et les Juifs n’en deviendrait que plus urgente. C’est précisément le Juif baptisé qui s’infiltre le plus profondément et sans entraves dans tous les secteurs de la société et de la vie politique. Je retiens par conséquent l’hypothèse que les Juifs doivent être définis seulement en termes de race et non en termes de religion.
Les Juifs qui ont abandonné leur religion et qui se sont hissés au pouvoir et aux richesses n’ont pas porté assez d’attention à ces idées. S’ils l’avaient fait, ils auraient compris que leur escapade ne serait que de courte durée. Parce que, même si des Juifs ont pu échapper à l’antijudaïsme en devenant chrétiens, ou agnostiques, ou même s’ils se sont refaçonnés à l’image de la société qui les entourait, l’antisémitisme, lui, qui n’attachait d’importance ni à ce qu’ils croyaient ni à la façon dont ils se comportaient, mais seulement au fait qu’ils étaient Juifs, allait finir par les rattraper un jour.
Notre prochain chapitre : Le mouvement réformiste.
Traduction et adaptation de Jacques KOHN
3.4 http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/juifs_2007.asp
Le décret du 17 mars 1808, destiné « à la réforme sociale des Juifs », abolit toutes les dettes envers les juifs. Les juifs étrangers ne pourront s’installer sur le territoire français qu’à condition d’acquérir une propriété rurale et de ne pas s’occuper de commerce.
3.5 http://www.uejf.org/tohubohu/histoire/napoleon.html
1/06/2008
Sous Napoléon, les Juifs ne savaient pas sur quel pied danser.
Napoléon et les Juifs : progrès ou progression ?
L’Empire aura été une période contrastée pour les Juifs de France : l’organisation du culte est renforcée à travers la création des consistoires mais le rétablissement d’inégalités juridiques marque une certaine régression.
«Je ne veux pas de religion dominante ni qu’il s’en établissent de nouvelles ; c’est assez des religions catholique, réformée et luthérienne reconnue par le Concordat. » C’est ainsi que Napoléon, par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), organise les cultes catholiques et protestants. S’il n’évoque pas encore la « question juive », celle-ci s’imposera néanmoins à lui lors de son passage à Strasbourg, les 23 et 24 janvier 1806, après la campagne d’Austerlitz. Le préfet, accompagné de notables locaux, vient alors trouver l’Empereur pour se plaindre des intérêts usuraires pratiqués par certains Juifs. Suite à ces attaques, le ministère de l’Intérieur se prononce en faveur d’un sursis pour les débiteurs poursuivis par des créanciers juifs, et le Conseil d’Etat est saisi. Après des débats houleux en séance plénière le 30 avril 1806, le Conseil d’Etat estime suffisantes les dispositions en vigueur. Cette décision fera grand bruit et provoquera le courroux de l’Empereur qui assistait à la séance : « Je ne prétends pas dérober à la malédiction dont est frappée cette race qui semble avoir été seule exemptée de la rédemption, mais je voudrais la mettre hors d’état de propager le mal qui ravage l’Alsace… ». L’Empereur ne semble donc pas particulièrement bien disposé à l’égard des Juifs, son antisémitisme est également accrédité par ce passage d’une lettre écrite à son frère Jérôme, roi de Westphalie : « J’ai entrepris de corriger les Juifs, mais je n’ai pas cherché à en attirer de nouveaux dans mes Etats. Loin de là, j’ai évité de faire rien de ce qui peut montrer de l’estime aux plus misérables des hommes. »
Devant cette mise en accusation de l’ensemble des Juifs de France, le préfet Colchen s’inscrit en faux et écrit à l’Empereur : « On leur doit cet éloge que rarement les tribunaux sont saisis de plaintes en escroqueries ou infidélités dans leurs relations commerciales, qu’ils sont d’une chanté exemplaire envers les pauvres de leur nation, et que cette charité s’étend encore aux autres. »
Lors d’une nouvelle réunion plénière du Conseil d’Etat, le 7 mai 1806, Napoléon annonce la prochaine convocation des « états généraux » des Juifs de France, car « il y aurait de la faiblesse à les chasser mais de la force à les corriger », affirme l’Empereur. C’est ainsi que le décret du 30 mai 1806 accorde un sursis aux débiteurs et convoque une assemblée de notables choisis par les préfets parmi les Juifs les plus probes et les plus éclairés. Cette assemblée composée de 111 membres a pour mission « de délibérer sur les (p.2) moyens d’améliorer la nation juive et de répandre parmi ses membres le goût des arts et des métiers utiles ».
Les députés des Juifs de France eurent à se prononcer sur 12 questions touchant notamment au mariage, au divorce, ainsi qu’à l’usure… La formulation des questions trahissait les orientations de l’Empereur et l’Assemblée dut s’y conformer. Lors de la séance de clôture, l’Assemblée annonce la réunion prochaine du Grand Sanhédrin. Napoléon ambitionne donc de restaurer le Conseil suprême des Juifs à Jérusalem, détruit avec le Temple. Il souhaite que ce tribunal, composé aux deux tiers de rabbins, puisse édicter des normes applicables aux Juifs partout dans le monde. Les réponses du Grand Sanhédrin seront globalement les mêmes que celles de l’Assemblée. De cette époque datent notamment l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux et, en dépit des pressions de l’Empereur, l’absence de consécration religieuse pour les unions mixtes.
Les activités des membres de la communauté juive sont réglementées par trois décrets du 17 mars 1808. Les deux premiers instituent le Consistoire central et six consistoires départementaux dont la mission est d’assurer l’exercice du culte et, bien sûr, de promouvoir « les vertus civiques ». Le troisième, plus connu sous le nom de « décret infâme », plaçait les Juifs dans une situation d’inégalité juridique en prévoyant le réexamen des créances juives (voire leur annulation) et en obligeant les commerçants juifs à se munir d’une autorisation préalable.
Jérôme Touboul
3.6. in : FORUM des Amis du Patrimoine napoléonien
Jean-Yves a écrit:
Je ne crois pas que Napoléon ait été, de quelconque manière, contre les juifs.
/un autre intervenant:/
Ce n’est pas vraiment ce qui ressort du livre de Pierre Birnbaum dont voici, semble-t-il, la 4e de couverture :
Citation:
On sait quelle oeuvre pionnière a accomplie la Révolution française en établissant une stricte égalité juridique entre tous les hommes, en donnant aux protestants et aux Juifs la totalité de leurs droits civiques, et le Code civil, promulgué en 1804 par le Premier Consul, passe pour avoir consolidé à jamais ces principes. En ce qui concerne les Juifs, pourtant, c’était sans compter sur les préjugés très prononcés de l’Empereur conseillé par les penseurs catholiques réactionnaires comme Bonald.
Ne se met-il pas en tête, en effet, de convoquer une assemblée de «notables» à qui il enjoint de former un «Grand Sanhédrin» qui se réunit il y a deux siècles, en février 1807, et désignera un Consistoire central, bref des interlocuteurs plus faciles à surveiller auxquels il entend imposer des mesures discriminatrices concernant le mariage, la conscription, la liberté d’aller et de venir ou encore celle de s’établir ? Voilà une entorse de taille aux principes de 89 : les intéressés, feignant de l’ignorer, s’en tiennent au Code civil, désireux qu’ils sont de se conformer seulement à la «loi du pays» qui doit régir de la même manière tous les citoyens. Ils font même assaut d’éloges et célèbrent sans rire… la Saint-Napoléon ou chantent, dans d’innombrables poèmes et odes, la gloire impérissable de l’Aigle dont les ailes sont supposées les protéger.
Mais l’Empereur ne s’arrête pas là. Par une série de décrets pris, en mars 1808, à l’instigation des franges les plus réactionnaires, il leur impose des restrictions juridiques allant à l’encontre de la loi commune, qui dénotent une franche hostilité à l’endroit de ceux qu’il qualifie de «sauterelles», de «corbeaux» ou de «nouveaux féodaux» et autres amabilités qui feront, tout au long du XIXe siècle et jusqu’à Vichy, les délices des pamphlétaires antisémites.
Ce qui est surprenant – réconfortant aussi – c’est d’observer que le haut personnel administratif de l’Etat (Conseil d’État, préfets…) traîne les pieds, voire s’oppose franchement, avec un courage admirable, au «décret infâme» ; c’est probablement même la seule défaite politique interne que l’Empereur ait dû essuyer.
http://www4.fnac.com/Shelf/article.aspx?PRID=1902705
Percy
Sujet: Re: Le statut des Juifs de Napoléon Ier à Napoléon III Jeu 28 Fév – 1:11
Il n’en demeure pas moins vrai que les soldats français manifestaient une certaine réserve, voire une antipathie plus ou moins marquée, à l’encontre des Juifs généralement considérés comme voleurs et âpres au gain.
Les Mémoires du sergent Bourgogne surtout, et dans une moindre mesure ceux de Coignet, en font état.
Les décrets impériaux n’avaient donc pas suffi à éliminer une méfiance instinctive à leur égard…
Esquirol
Sujet: Re: Le statut des Juifs de Napoléon Ier à Napoléon III Ven 29 Fév – 0:44
LULU a écrit: Une question : les usuriers non juifs ont-ils été traités comme les usuriers juifs?
Le décret qui annulait les dettes des usuriers juifs ne s’est appliqué qu’aux usuriers juifs.
De même, les juifs qui tiraient un (mauvais) numéro pour l’armée ne pouvaient pas se faire remplacer parce qu’ils étaient juifs.
Esquirol
Sujet: Re: Le statut des Juifs de Napoléon Ier à Napoléon III Ven 29 Fév – 14:44
Sous l’Ancien Régime, l’Eglise catholique interdisait à ses fidèles de pratiquer le prêt à intérêt, ce qui n’a toutefois pas empêché complètement certains catholiques de créer des banques. Ce fut notamment le cas de nombreux marchands originaires de Lombardie à tel point que le terme « lombard » a fini par désigner les prêteurs sur gage.
Parce qu’ils n’étaient pas soumis aux interdictions de l’Eglise catholique et que d’autres professions leur étaient interdites par les différents Etats d’Europe, de nombreux juifs ont choisi eux aussi de pratiquer le prêt à intérêt.
Etaient-ils en ce domaine plus « rapaces » que les usuriers non juifs ? Il y a lieu de penser qu’une telle affirmation relevait des préjugés « judéophobes » assez largement partagés à l’époque et malheureusement encore bien présents chez un certain nombre de nos contemporains.
Avec la Révolution française, l’activité bancaire et le prêt à intérêt deviennent complètement libre. Napoléon ne remettra pas en question cette situation. Je ne vois donc pas sur quelle base vous pouvez écrire que « pratiquer l’usure était déjà interdit à tous les autres ». La mesure annulant les dettes à l’égard des créanciers juifs ne concernent que les juifs. Il ne s’agit pas véritablement d’une mesure visant à favoriser l’assimilation des populations juives en France, mais d’une mesure visant à apporter une réponse à des manifestations d’antisémitisme, notamment en Alsace. L’interdiction faite aux juifs de s’établir en Alsace relève de la même logique et ce serait commettre un contresens grave que d’essayer de voir dans une telle mesure de toute évidence discriminatoire un moyen de favoriser l’intégration.
Quant à l’interdiction du remplacement, il est un peu spécieux d’argumenter comme vous le faites en avançant que cette pratique est devenue illusoire en 1813, car au moment où la décision a été prise d’interdire ce droit aux juifs, rien ne laissait prévoir qu’elle serait vide de sens quelques années plus tard. Loin donc d’être un moyen pour abolir toute différence entre les juifs et les autres citoyens de l’Empire, il s’agissait au contraire d’introduire une différence entre les juifs et les autres citoyens.
Esquirol
Sujet: Re: Le statut des Juifs de Napoléon Ier à Napoléon III Ven 29 Fév – 23:36
Par quel étrange raisonnement pourrait-on arriver à la conclusion que le problème que les juifs ne bénéficiaient pas dans la réalité des mêmes droits que les autres citoyens français pourrait être résolu en restreignant ces droits par des mesures législatives ?
Les protestants ont également connu une situation difficile en France sous l’Ancien Régime. Peut-être même plus difficile que les juifs puisqu’après la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685, nombre d’entre eux ont été emprisonnés, envoyés aux galères, voire exécutés. Les persécutions à leur encontre se sont terminées sous le règne de Louis XVI, mais c’est seulement après la Révolution qu’ils sont devenus des citoyens français à part entière avec les mêmes droits que les catholiques.
Il aurait pu en être de même pour les juifs dont la majorité s’est parfaitement fondue dans la population française après l’obtention des mêmes droits que n’importe quel citoyen français. Les choses ne se sont malheureusement pas passées ainsi, à cause de la persistance des préjugés à leur égard. Préjugés que partageait Napoléon et qui l’amenèrent à prendre à leur égard des mesures visant selon lui à favoriser leur intégration, mais en réalité visant plutôt à donner des gages à la frange de la population française qui continuait à se montrer hostile à leur égard.
Ces préjugés ont persisté en France pendant tout le 19e siècle auprès d’une part non négligeable de la population (Proudhon était ouvertement antisémite). Ils vont connaître un point culminant avec l’affaire Dreyfus qui constituera une étape fondamentale dans la prise de conscience de l’absurdité et de l’injustice de ces préjugés. Ils ne disparaîtront cependant pas entièrement ensuite, même s’ils seront de plus en plus associés à l’extrême-droite. Après la Seconde Guerre mondiale et la révélation de la Shoah, il devint honteux d’être antisémite. Cela ne fit toutefois pas disparaître complètement les préjugés. Ainsi en novembre 1967, lors d’une conférence de presse, le général de Gaulle eut le malheur de dire que les juifs étaient « un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur », ce qui eut pour effet de provoquer un tollé dans l’opinion française qui se manifesta notamment par une chute de 54 % (en juin 1967) à 30 % (en décembre de la même année) des Français qui approuvaient la politique du général au Proche-Orient.
Esquirol
Sujet: Re: Le statut des Juifs de Napoléon Ier à Napoléon III Lun 3 Mar – 14:51
Nous parlons toujours des juifs. Quand Napoléon décida d’interdire aux juifs la possibilité de faire appel à un remplaçant quand ils ont tiré un mauvais numéro, il savait très bien qu’il introduisait une mesure discriminatoire et il savait également très bien qu’il ne s’agissait pas d’une mesure visant à favoriser une meilleure intégration des juifs dans la société française, mais au contraire d’une mesure visant à donner des gages à ceux qui restaient hostiles aux juifs.
J’ignore si Napoléon a expliqué les raisons de cette mesure, mais il n’est pas très difficile de les deviner.
L’image du juif à l’époque étant très étroitement liée à l’image de l’usurier, il apparaissait (à tort ou à raison) qu’une proportion importante des juifs qui tiraient un mauvais numéro pourraient sans trop de problème racheter leur congé et seraient ainsi dispensés de servir la France. L’interdiction faite aux juifs de pouvoir recourir à cette mesure pouvait donc apparaître comme un rétablissement d’une certaine égalité entre eux et les autres Français, supposés ne pas pouvoir racheter leur congé avec la même facilité.
Cette mesure ne partait donc pas d’une mauvaise intention. Elle n’en est pas bonne pour autant. Dans un véritable esprit d’égalité, il aurait certainement été plus juste d’abolir complètement le système du remplacement. Pourquoi Napoléon ne l’a-t-il pas fait ? Je ne connais pas la réponse.
3.7 Divers
|
Paul Fleuriot de Langle, Général Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène 1818-1819, éd. Albin Michel, 1959
(p.120) » Lorsque M. et Mme B… me présentèrent leur famille, au retour de l’île d’Elbe, j’y vis de jolies demoiselles et me reprochai de ne pas les avoir mariées. J’aurais pu placer quelques-unes de ces jeunes personnes, les établir légalement dans toutes les familles d’Europe avec des primes dotales. Je pouvais ainsi en marier une quinzaine. En général, j’aurais pu faire plus de mariages comme celui du Grand Maréchal, qui étaient un lien, qui m’attachaient des familles et donnaient de l’assise au nouvel ordre de choses. Cependant Mme de Marbeuf, qui venait quelques fois me voir, me dit que j’aurais tort de me mêler de cela, que c’était se donner des embarras, que le Faubourg Saint-Germain n’était rien et qu’il courrait lui-même au devant des mariages et les solliciterait si j’enrichissais ceux que j’élevais, mais qu’il fallait nécessairement que je fisse leur fortune, sans cela, c’était impossible ; que dans tous les temps les nobles avaient recherché la fortune. Laides, juives ou de la dernière classe, peu importe si l’on est riche. Il fallait donc que j’enrichisse les miens. En général je ne les ai pas assez favorisés.
|
|
Jules Gritti, Déraciner les racismes, SOS EDITIONS, 1982
(p.203) NAPOLEON « A partir de la Révolution française et du régime napoléonien, l’émancipation des Juifs s’opère, à des degrés divers en Europe. Napoléon qui s’y emploie activement n’en professe pas moins du dédain pour une « race » « frappée de malédiction » et entend la « mettre hors d’état de propager le mal. »
|
|
Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981 /France/ (p.111) (…) on a l’impression très nette qu’à leur égard le sectarisme du culte de la Raison redoublait de virulence, notamment dans les départements de l’Est, s’alimentant à la sensibilité antijuive traditionnelle. Symptomatique à cet égard est une brochure populaire à la gloire de Marat, le comparant à Jésus, « tombé lui aussi sous les coups du fanatisme, en travaillant de toutes ses forces à opérer le salut du genre humain ». Dans les départements de l’Est se poursuivait une propagande antijuive ouverte. Le conventionnel Baudot, commissaire aux armées du Rhin et de la Moselle, proposait même un nouveau genre de régénération des Juifs, la régénération guillotinière : « … partout, ils mettent la cupidité à la place de l’amour de la patrie, et leurs ridicules superstitions à la place de la raison. Je sais que quelques-uns d’entre eux servent dans nos armées, mais en les exceptant de la discussion à entamer sur leur conduite, ne serait-il pas convenant de s’occuper d’une régénération guillotinière à leur égard ? » A la même époque (brumaire an II), toutes les municipalités du Bas-Rhin recevaient l’ordre « de réunir à l’instant tous les livres hébreux, notamment le Talmuth, ainsi que tous les signes quelconques de leur culte, afin qu’un autodafé fût fait à la Vérité, le décadi de la seconde décade, de tous ces livres et signes du culte de Moïse ». Il semble que cet ordre ne fut pas suivi d’effet, car en pluviôse, c’est-à-dire trois mois plus tard, une autre circulaire portait défense aux « citoyens qui osent ternir le beau nom de citoyen et l’amalgamer avec celui de juif, de s’assembler dans leurs ci-devant synagogues et y célébrer leurs anciennes simagrées, dans une langue inconnue, avec laquelle on pourrait aisément troubler la sûreté générale ». Le II thermidor, enfin, ce n’est plus leur superstition, mais leur agiotage qui était reproché aux Juifs alsaciens, et l’ordre était donné aux municipalités du district « d’avoir sans cesse les yeux fixés sur ces êtres dangereux, qui sont les sangsues dévorantes des citoyens ».
(p.113) A première vue, il semble bien que sur le chapitre des Juifs plus que sur tout autre, Napoléon fut le fils fidèle de la Révolution, et plus spécialement de la Montagne. Il chercha à régénérer les Juifs, c’est-à-dire à les déju-daïser, et il y réussit en partie. Ses jugements sur les enfants d’Israël, principalement inspirés par la pensée déiste de son temps, n’étaient pas tendres, et cet ennemi des « idéologues » ne se souciait guère du problème responsabilités que posait leur condition avilie, en sorte qu’assemblés bout à bout ces jugements fourniraient la matière d’un petit catéchisme antisémite. Ils combinaient (p.114) l’ancien préjugé théologique à la naissante superstition scientiste : « Les Juifs sont un vilain peuple, poltron et cruel. » « Ce sont des chenilles, des sauterelles, qui ravagent les campagnes. » « Le mal vient surtout de cette compilation indigeste appelée le Talmud, où se trouve, à côté de leurs véritables traditions bibliques, la morale la plus corrompue, dès qu’il s’agit de leurs rapports avec les Chrétiens. » II n’en reste pas moins que les Juifs forment pour lui une race, et que cette race est maudite : « Je ne prétends pas dérober à la malédiction dont elle est frappée cette race qui semble avoir été seule exceptée de la rédemption, mais je voudrais la mettre hors d’état de propager le mal… » Le remède, à ses yeux, consiste dans la suppression de la race, qui doit se dissoudre dans celle des Chrétiens. La tâche est ardue : « … le bien se fait lentement, et une masse de sang vicié ne s’améliore qu’avec le temps ». « Lorsque sur trois mariages, il y en aura un entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d’avoir un caractère particulier. » Dans les faits, Napoléon régenta les Juifs d’une main ferme et efficace ; pourtant, ses desseins administratifs et politiques faisaient leur part à des rêves visionnaires, et peut-être aussi à une peur superstitieuse. Dès l’expédition d’Egypte, il lançait une proclamation aux Juifs, leur proposant de s’enrôler sous ses drapeaux pour reconquérir la Terre promise. Mais ceux-ci restèrent sourds à son appel, et le projet peut être rangé parmi ses « mirages orientaux ». Trois ou quatre années ensuite, une fois nommé Premier Consul, Bonaparte entreprenait de régler les questions religieuses. Cependant, la loi du 18 germinal an X sur l’organisation des cultes catholique et protestant laissait le judaïsme à l’écart : « … quant aux Juifs, aurait-il dit, c’est une nation à part, dont la secte ne se mêle avec aucune autre ; nous aurons donc le temps de nous occuper d’eux plus tard. » Ce temps vint sous l’Empire, au printemps 1806, et il semble bien que son intention première ait été de les priver de leurs droits civiques. Mais le Conseil d’Etat, peuplé d’anciens juristes de la Révolution (Regnault de Saint-Jean d’Angely, Beugnot, Berlier), sut exercer une influence modératrice sur lui. En fin de compte, il décidait de sonder auparavant les reins et les cœurs des Juifs, dont il réunissait à Paris les représentants, en une « Assemblée générale ». (p.115) Tenaient-ils à être Français ? Etaient-ils prêts à jeter par-dessus bord, s’il le fallait, la loi de Moïse ? Aux douze questions embarrassantes qui leur furent posées, les délégués répondirent d’une manière on ne peut plus satisfaisante. « Les Juifs… regardent-ils la France comme leur patrie et se croient-ils obligés de la défendre ? » « Oui, jusqu’à la mort ! » s’exclamait l’Assemblée unanime. Mais les nouveaux patriotes redevinrent le peuple à la nuque dure lorsqu’il fut question des mariages mixtes, dont l’Empereur souhaitait que les rabbins les recommandent expressément : sans heurter de front l’autocrate, l’Assemblée réussissait à esquiver la réponse. Dans l’ensemble, elle subit avec succès l’examen, et produisit une impression favorable sur les commissaires (Pasquier, Portalis) désignés par l’Empereur. Encore fallait-il trouver le moyen de lier la population juive bigarrée de l’Empire, des Pays-Bas à l’Italie, par les décisions adoptées par l’Assemblée : les commissaires furent fort surpris d’apprendre qu’il n’existait aucune autorité organisée, aucun gouvernement central, auquel tous les fidèles de Moïse prêtaient allégeance (un étonnement qui est encore parfois partagé, de nos jours). C’est dans ces conditions que naquit l’idée de réunir à Paris un Grand Sanhédrin, qui, à dix-huit siècles de distance, renouerait avec la tradition d’un gouvernement d’Israël. L’idée enflamma aussitôt l’imagination de Napoléon ; au-delà d’un instrument de régénération et de police des Juifs, le génial opportuniste crut pouvoir utiliser un tel organe pour les besoins de sa grande politique. Le projet fut mis au point par lui au cours des derniers mois de l’année 1806, en même temps que celui du blocus continental ; sans doute comptait-il sur la pieuse allégeance des hommes d’affaires juifs pour mieux affamer l’Angleterre. Le nouveau gouvernement d’Israël allait être une réplique fidèle de l’ancien, et compter le même nombre de membres (soixante et onze), revêtus des mêmes titres ; des invitations furent adressées, au-delà des frontières de l’Empire, à toutes les juiveries de l’Europe. L’ouverture s’effectua le 9 février 1807, en grande pompe, dans la chapelle désaffectée Saint-Jean, rue des Piliers, qui fut débaptisée en rue du Grand-Sanhédrin. Mais une telle forme de régénération des Juifs était riche d’associations fâcheuses, voire provocatrices, pour la sensibilité chrétienne. Le Sanhédrin n’était-il pas le tribunal juif qui avait accepté le marché de Judas, et lui (p.116) compta les trente pièces d’argent ? N’était-ce pas là que « se passa cette scène d’outrages sans nom où le Fils de Dieu fut souffleté, couvert de crachats et d’insultes ? » Ne fut-il pas, en un mot, l’organe même du déicide? Dès lors, les imaginations se donnèrent libre cours. La propagande antinapoléonienne à l’étranger exploita vigoureusement et longuement ce thème, qui vint compléter celui de Napoléon l’antéchrist, ainsi que nous allons le voir plus loin. En France, même les catholiques ralliés ne manquèrent pas d’y faire des allusions. « Pour le christianisme, l’état malheureux des Juifs est une preuve qu’on voudrait, avant le temps, faire disparaître… », protestait de Donald, comparant le Sanhédrin des Juifs à la Convention des philosophes. Un pamphlet anonyme, qui fut saisi par la police, représentait Napoléon comme « l’oint du Seigneur, qui sauvera Israël ». Mais ce nouveau messie des Juifs ne serait-il pas lui-même d’origine juive ? C’est ce que L’Ambigu, l’organe des émigrés français à Londres, s’empressa d’affirmer, et cette imputation elle aussi a laissé sa trace dans la mémoire des hommes. Le rapide licenciement du Sanhédrin peut laisser croire que ces campagnes impressionnèrent Napoléon, au point de susciter chez lui également une sorte de peur superstitieuse. En effet, cette assemblée au nom millénaire ne tint que quelques séances, au cours desquelles furent entérinées les décisions antérieurement prises par 1′ « Assemblée générale » ; le 9 mars 1807, un mois après son ouverture solennelle, elle fut dissoute, et il ne fut plus jamais question de la réunir à nouveau. Par ailleurs, non seulement les Juifs des pays étrangers, mais aussi ceux de l’Empire, ne manifestaient pas un enthousiasme excessif pour l’institution appelée à les régir, sous la surveillance impériale. En résultat, et quels qu’aient pu être ses mobiles, Napoléon renonça à son grand plan politico-messianique. En définitive, il se contenta de soumettre les Juifs, par le décret dit « infâme» du 17 mars 1808, à des mesures d’exception partielles, département par département : ceux de la Seine et des départements du Sud-Ouest (auxquels plusieurs autres vinrent se joindre par la suite) gardèrent la plénitude de leurs droits ; ceux des autres départements furent assujettis à des mesures de discrimination qui entravaient leurs déplacements, et l’exercice par eux du commerce. Le décret du 17 mars, qui ruina bien des familles juives, était motivé par la lutte anti-usuraire, (p.117) mais les laborieuses enquêtes sur « les abus des Juifs » prescrites à cette occasion aux préfets nous montrent une fois de plus comment leur mauvaise réputation tenait d’abord à leur qualité de Juifs. (…) Là où les Juifs restaient effectivement nombreux à exercer le métier de Juifs, ainsi que cela était le cas dans les départements rhénans, ils servaient couramment de prête-noms à des Chrétiens qui n’osaient pas juddiser ouvertement. Les rapports des préfets et des maires signalent à de multiples reprises cet état de choses, que le maire de Metz décrivait comme suit : « Les acquéreurs et les soumissionnaires des biens nationaux (p.118) cherchèrent et trouvèrent de l’argent chez les Juifs. Ils l’obtinrent à très haut prix, parce que les Juifs, en ayant peu, se firent pour ces opérations les courtiers des particuliers non juifs, qui voulurent se procurer de gros bénéfices, en conservant les dehors honnêtes sous lesquels ils étaient connus dans la société. Ainsi, l’odieux était pour les Juifs, et le profit revenait à d’autres. La liberté du commerce de l’argent favorisa d’ailleurs l’usure ; on vit à Metz des usuriers dans toutes les classes de la société… » Pourtant, les commissaires de l’Empereur rejetaient le blâme sur les Juifs seuls : « On eût dit que [les Juifs] enseignaient à ceux qu’ils dépouillaient l’oisiveté et la corruption, tandis qu’ils étaient leur moralité à ceux qu’ils ne dépouillaient pas. Des notaires publics, séduits par eux, employaient leur ministère à cacher leur honteux trafics, et des domestiques, des journaliers, leur apportaient le prix de leurs services ou de leurs journées, afin qu’ils le fissent valoir comme leurs propres derniers. De cette] manière, les professions utiles étaient abandonnées par un certain nombre de Français, qui s’accoutumaient à vivre sans travail des profits de l’usure… »
(p.135) Pour entrer dans la grande société, il leur fallait passer d’abord par l’école publique. Chemin de croix pour bien des enfants juifs, les marquant pour le reste de leurs jours. Arrivé au faîte des honneurs, Adolphe Cré-mieux évoquait ce passé : « … je ne pouvais pas traverser les rues de ma ville natale sans recueillir quelques injures. Que de luttes j’ai soutenues avec mes poings ! ». (Pour corriger les effets de cette évocation, l’homme d’Etat ajoutait aussitôt : « Eh bien, peu d’années je faisais mes études à Paris, et quand je rentrais à Nîmes, en 1817, je prenais ma place au barreau et je n’étais plus juif pour personne ! » Ainsi donc, la société nîmoise eut le tact de ne pas voir le Juif en Crémieux ; tel est peut-être le secret de la tolérance française…) Se fondant, on peut le croire, sur ses souvenirs d’enfance, Frédéric Mistral évoquait dans Nerto ces guerres enfantines, à cinquante contre un : « Lou pecihoun ! Lou capeu jaune ! A la jutarié ! que s’encaune ! Cinquante enfant ié soun darrié1… » Tout porte à croire que dans l’est de la France, les brimades, aux rites semblables, étaient tout aussi courantes. Le rabbin de Metz, J.-B. Drach, décrivait l’enfance de son frère « … que ses camarades d’école… poursuivaient au sortir de la classe, l’accablant d’injures, de coups de pierre, et, que pis est, lui frottant les lèvres avec du lard. Malgré les chefs de l’école, qui interposèrent plus d’une fois leur autorité, ces persécutions continuèrent jusqu’à ce que mon frère se fût distingué par ses progrès et les prix qu’il obtenait à la fin de chaque année ; il est maintenant un des meilleurs miniaturistes de sa province ».
1 « Le guenillon ! le chapeau jaune ! A la juiverie ! qu’il se cache ! Cinquante enfants après lui… »
|
1.6 les déportations
Jean Vermeil, Les Bruits du silence, L’autre histoire de France, éd. du Félin, 1993, p.164-170
Les Basques expulsent leurs tsiganes
(p.165) « Séparez les familles ! »
Le général Boniface-Louis-André de Castellane s’installe à la préfecture des Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) en 1802. Il écoute les doléances de ses administrés. Le sénateur Henri Fargues, ancien maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, ancien député au Conseil des Cinq-Cents, ancien député au Conseil des Anciens, se plaint. Les membres du corps législatif, les conseillers d’arrondissement, les commissaires près les tribunaux des arrondissements de Mauléon et de Bayonne se plaignent. Le brigandage sévit dans le département. Ils désignent les responsables : les Bohémiens. Sans rien prouver, mais le préfet sait qu’attirer le soupçon est un trouble suffisant à la tranquillité publique. Le nouveau code civil de l’ordre bientôt napoléonien ne punit certes que les actes, et pas les intentions ni les soupçons. Mais il ne s’applique peut-être pas aux Bohémiens. Le préfet Castellane écrit au ministre de la Police générale : « Leur existence sert de prétexte pour encourager ceux qui ont des dispositions au crime, dans l’espoir que tout sera rejeté sur eux » (28 thermidor an X, 16 août 1802). Il propose une solution : « II serait digne de la sagesse du gouvernement d’envoyer cette caste nomade dans une colonie où elle serait forcée de pourvoir par son travail à sa subsistance […]. C’est au sénateur Henri Fargues que je dois la première idée de cette mesure. »
Le préfet Castellane obtient l’accord verbal du ministre. Il prend ses dispositions, obtient des crédits sur les fonds secrets « pour solder des espions et séduire même quelques chefs ». Il fait établir des listes de Bohémiens dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon et prépare des lieux de détention. Il délègue dans chaque canton des «commissaires à l’effet de procéder aux arrestations». Castellane s’entoure de la gendarmerie et des autorités militaires. La troupe barre la frontière espagnole, camouflée en garde d’honneur censée le saluer dans une tournée d’inspection. Le vice-roi de Navarre, qui réside à Pampelune, et le commandant du Guipuzcoa acceptent de « concourir à une mesure également réclamée par l’intérêt des deux nations amies ».
(p.166) Le 1er frimaire an XI (23 novembre 1802), le préfet Castellane signe une circulaire confidentielle :
« Le préfet des Basses-Pyrénées considérant que les Bohémiens répandus dans les arrondissements des sous-préfectures de Bayonne et de Mauléon, n’ayant ni domicile ni état autre que le brigandage, ne peuvent être considérés comme citoyens, ni jouir des droits attachés à ce titre, arrête :
« Article 1. Les individus connus sous le nom de Bohémiens, leurs femmes et enfants qui seront trouvés dans les arrondissements de Mauléon et de Bayonne seront arrêtés le 15 de ce mois et jours subséquents… Tous ces individus seront provisoirement détenus jusqu’à ce qu’il en ait été autrement arrêté par le gouvernement… »
La « battue » administrative commence dans la nuit du 15 au 16 frimaire an XI (6 au 7 décembre 1802). Les maires, les gardes nationaux, la gendarmerie, les troupes y concourent. Un cordon français, un autre espagnol veillent de part et d’autre de la frontière. Quelques Tsiganes passent au travers. On arrête quatre cent soixante-quinze individus, hommes, femmes, enfants et nourrissons, et d’autres les jours suivants. Ils sont incarcérés à Bayonne, Mauléon et Saint-Jean-Pied-de-Port. Le directeur des fortifications de Saint-Jean-Pied-de-Port refuse de les accueillir. Le préfet Castellane les répartit sous sa propre responsabilité dans la citadelle, dans de « mauvaises prisons » d’un ancien couvent « incommode et peu sûr ».
Le préfet a fait arrêter quelques individus non bohémiens « qui, par divers motifs, ont échappé à la punition qu’ils méritent » et « que les habitants ont unanimement désignés comme dangereux ». Il reconnaît d’avance « quelques erreurs, qui donneront des mises en liberté ». Le gouvernement approuve l’opération. Les Basques aussi. Le Journal des Basses-Pyrénées écrit (5 nivôse an X, 26 décembre 1802) : « La mesure que le préfet vient de prendre… lui assure l’éternelle reconnaissance du Pays basque. » Le conseil général déclare : « Le pays délivré de ces brigands bénit le courageux administrateur qui lui a procuré un si grand bienfait » (séance du 26 floréal an XI, 16 mai 1803).
Les Tsiganes seront bien déportés. La police générale l’a décidé : « Cette population dangereuse sera jetée hors du territoire français et portée au-delà des mers. » Castellane suggère leur envoi en Louisiane, « celle des colonies françaises où leur présence serait la plus utile […]. La qualité des terres qu’on pourrait leur accorder dans cette immense possession, […] les défrichements auxquels ils (p.167) seraient forcés de se livrer […] compenseraient avantageusement les frais de transport et les premières avances ». Le gouvernement manifeste l’intention de séparer les familles. Les hommes seraient aussitôt déportés, les femmes provisoirement retenues dans des maisons de correction pour être déportées plus tard. Les enfants non réclamés seraient « distribués dans les villages et confiés à des cultivateurs ».
Le grand juge suit l’avis du préfet : ne pas séparer les familles. Castellane le leur a promis : « Le premier conseil ni vous, citoyen grand juge, ne voulez la mort des Bohémiens : vous voulez, s’il est possible, les améliorer, les rendre citoyens utiles dans une colonie où la nécessité, la propriété les regénéreraient. » Le grand juge demande l’aide du ministre de la Marine et des Colonies pour rassembler à Bayonne tous les Bohémiens arrêtés et les transférer à Rochefort. Le ministre renâcle : « Dans cette saison, ce ne serait pas sans embarras par mer» (lettre du 23 pluviôse an XI, 12 février 1803). En réalité, c’est parce que la maison d’arrêt et le bagne de Rochefort sont pleins, comme ceux des autres ports. Le ministre de la Marine recommande la voie de terre, du ressort du département de la Guerre.
Au printemps, rien n’a avancé. Les officiers de santé des prisons observent des « fièvres malignes et putrides, dysentériques et vermineuses parmi les enfants, la gale, etc., ce qui ne peut qu’augmenter avec la saison ». Trente-huit Bohémiens sont enrôlés de force dans les troupes coloniales au dépôt de Blaye. Le général commandant la 11e division militaire est invité à leur prodiguer « une surveillance active et particulière jusqu’au moment de leur embarcation, vu leur témérité et leur audace ». Ils partent à pied pour Blaye, attachés par deux à des menottes. Dans un bois avant Mont-de-Marsan, deux inconnus surgissent, désarment les gendarmes et en délivrent six.
Maintenant, il n’y a plus de bateau disponible pour le transport. Le projet de déportation en Louisiane est abandonné. La France concentre ses efforts sur les esclaves insurgés d’Haïti. Napoléon Bonaparte y échoue, et doit vendre la Louisiane aux États-Unis. Le 1er prairial an XI (1er juin 1803), le gouvernement décide d’utiliser les Bohémiens à la mise en valeur du département insalubre des Landes : « II leur sera distribué des terres avec ordre de les cultiver… Tous ceux qui s’éloigneraient de quatre lieues seront arrêtés. On établira des ateliers de travail pour les femmes. » Le ministre de l’Intérieur soulève des objections et consulte le Premier consul qui estime « plus convenable de les diviser sur différents points de la République » et de les employer à de grands travaux. Le 3 messidor an XI (22 juin (p.168) 1803), il signe cet arrêté : «[…] Art. 2. Les enfants au-dessous de douze ans, les femmes, les sexagénaires et les infirmes seront distribués dans les différents dépôts de mendicité de la République ; les jeunes gens de douze à seize ans révolus seront mis à la disposition du ministre de la Marine pour être employés dans les ateliers maritimes en qualité d’apprentis ou comme mousses ou novices sur les vaisseaux de l’État ; les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans, et en état par leur taille et leur constitution de porter les armes, resteront à la disposition du ministre de la Guerre pour être encadrés dans les différents corps de l’armée. À l’égard des hommes mariés et autres en état de travailler, ils seront répartis dans les ateliers ouverts par les canaux d’Arles et d’Aiguës-Mortes et pour la confection des routes dans les départements des Hautes-Alpes et du Mont-Blanc. »
Le projet d’amélioration des Bohémiens par le travail tourne au bagne. Le département de l’Aude doit recevoir soixante hommes. Il n’en arrive que quarante-cinq que le préfet ne trouve pas à utiliser. Ils s’évadent, ils sont rattrapés, s’évadent à nouveau. Reste un certain Larquier : il prouve qu’il est officier de santé breveté, arrêté par erreur. Dans les Hautes-Alpes, les Bohémiens commencent à travailler aux routes. Mais « les frais de surveillance excédant de beaucoup le salaire de leurs journées », ils sont mis en détention. Une dizaine meurent à l’hospice civil de Gap. Plusieurs s’évadent de la prison. Les autres végètent à la prison d’Embrun.
Quatre cent soixante-cinq autres Bohémiens, hommes âgés ou infirmes, femmes et enfants, sont ventilés dans vingt-sept dépôts de mendicité par lot de dix, quinze ou vingt. La plupart des locaux qui les reçoivent sont insalubres. Les maladies sont fréquentes, la mortalité grande. Cinq des treize Bohémiens expédiés à Chalon-sur-Saône meurent : trois femmes et deux petits enfants. La nourriture « se réduit à une portion de mauvais pain », sans soupe ni bouillon. Les femmes ne reçoivent pas de quoi réparer leurs haillons. Elles réclament de sortir en ville pour mendier. À Riom, femmes et enfants travaillent à la filature de coton du dépôt. À Rennes, les familles sont « confondues au milieu des brigands et des prostituées » ; les enfants trouvent refuge à l’hôpital.
Les militaires s’émeuvent les premiers de ces mauvais traitements. Le général de brigade Avril, commandant dans les Basses-Pyrénées, écrit au ministre de la Guerre (floréal an XI) : « Quels crimes ont pu commettre deux ou trois cents femmes et enfants de tout âge qu’on fait périr de misère dans les prisons ? » Des personnes de bonne volonté rédigent des mémoires pour des familles
(p.169) tsiganes. À Lyon, les membres du conseil d’administration de l’hospice de l’Antiquaille attirent l’attention du préfet du Rhône « sur le sort attendrissant d’une troupe de femmes et d’enfants bohémiens détenus dans cet hospice… Le changement de climat et le chagrin d’avoir été enlevés de leurs foyers, rendus plus amers encore par la captivité, et sans doute aussi par la privation d’intelligence d’un autre idiome [que la langue basque], en ayant déjà fait périr une partie, les infortunés qui ont survécu implorent chaque jour leur liberté, avec l’accent de la douleur la plus déchirante ». Dans le département de la Haute-Vienne, le préfet convient de ce « que leurs mœurs et leurs inclinations n’annoncent rien de dangereux pour la société ». Le préfet du Puy-de-Dôme découvre au dépôt de Riom « des enfants qui sont très sages, très respectueux envers leurs mères, dont ils préviennent les besoins et très exacts à remplir les devoirs de la religion ».
Le ministre de la Justice rapporte le 5 messidor an XII (24 juin 1804) au Premier consul l’état de misère des femmes et des enfants détenus au dépôt de mendicité de Caen. Le gouvernement ordonne de les envoyer sous surveillance dans leurs foyers et accorde trois sous par lieue pour leur retour dans les Basses-Pyrénées. Aucune mesure générale n’est prise, chaque cas est résolu dans la discrétion. Ici on donne des vêtements, là une voiture — au moins pour la première étape. La plupart des dépôts sont vidés des familles bohémiennes au cours de l’année 1805. Les deux derniers sont ceux de la Meurthe et de la Moselle (octobre 1806). Là, à Metz, sept femmes et jeunes filles ont « envisagé qu’il ne leur restait ni parents ni asile dans leur pays » et obtiennent leur réintégration volontaire au dépôt « avec toute l’expression de la reconnaissance et de la sensibilité ».
Les hommes sont libérés ensuite. On leur découvre pour l’occasion des origines honorables : vannier, tondeur de mulets, tourneur sur bois, scieur de long, brodeur de filets de pêche, soldat des Chasseurs basques ou engagés dans la marine. En septembre 1805, le préfet des Hautes-Alpes libère les quinze Bohémiens détenus à la prison d’Embrun, non sans leur avoir tenu un généreux discours sur «le bienfait que Sa Majesté venait de leur accorder […]. Ils ne parviendraient à faire oublier les soupçons de vagabondage auxquels ils avaient donné lieu qu’en se livrant désormais à une vie laborieuse et utile […]. Ils ne cesseront d’être sous l’œil de la police ». Le préfet les congédie en toute prudence par paquets de cinq, à intervalle de huit à dix jours. Il leur impose un trajet de retour en n’omettant pas de donner leur signalement aux préfets des départements traversés : la liberté des Bohémiens reste une liberté surveillée. Castellane, le (p.170) préfet des Basses-Pyrénées, proteste. Il craint de la part des Bohémiens les «vengeances qu’ils ont hautement annoncées à leur départ » contre leurs dénonciateurs.
Plusieurs préfets admirent les méthodes de Castellane et l’imitent, comme ceux du Gers, des Landes, du Lot-et-Garonne. Les préfets des Pyrénées-Orientales et du Mont-Blanc réussissent à expulser les Bohémiens hors de l’Empire. Celui du Rhône envoie la gendarmerie contre eux en se justifiant ainsi : « La conduite de pareilles gens ne peut être qu’infiniment suspecte. » Le magistrat de la sûreté du Bas-Rhin écrit à la Police générale : « Je n’ai aucune dénonciation pour délit contre ces individus, mais leur position est telle qu’ils devaient être nécessairement tentés d’en commettre, si l’occasion s’en fut présentée… Ils ne peuvent être que dangereux. » Il demande « si l’on continue encore à envoyer de pareils individus dans les colonies ». Le préfet de l’Ariège propose en vendémiaire an XVI (septembre-octobre 1805) la capture des gitans dans son département. La Police générale le désapprouve : « Cette latitude exprimée par votre ordre peut entraîner beaucoup d’actes arbitraires et des frais considérables. »
1.7 la Conscription
| Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
(p.18) Napoléon n’a rien ignoré de l’impopularité des lois de conscription : « Cette mesure est la plus détestable pour les familles. Mais elle fait la sûreté de l’État. » Il s’en est servi avec maestria et obstination, mais il n’en était pas l’auteur. La conscription est une invention révolutionnaire. Le décret l’instituant est daté du 14 février 1793; ses dispositions ont été complétées par la loi du 25 août 1799, sous Ie Directoire. Service obligatoire pour les célibataires de vingt à vingt-cinq ans, mais on avait une grande chance d’y échapper par le tirage au sort: seulement un sur quinze des conscrits des campagnes était enrôlé et un sur sept de ceux des villes. Durée du service: variant de un à cinq ans en temps de paix; illimitée en temps de guerre. Le conscrit enrôlé pouvait légalement échapper au service en payant un remplaçant; prix à débattre avec lui; de 1803 à la fin de l’Empire, il a varié de 1 800 à 4 000 francs. En fait, seuls les pauvres étaient poussés vers la caserne; on était loin de l’idéal: tous libres et égaux devant la loi. (p.20) Les conscrits, eux, n’avaient pas d’uniforme et souvent on ne leur en donnait un que plus tard, plusieurs mois plus tard, car l’industrie peinait pour fournir de quoi vêtir et chausser cette masse d’hommes, c’était un souci de Bonaparte (les revenants de l’armée d’ Égypte avaient un temps grelotté dans des oripeaux d’Orient; les vainqueurs de Marengo avaient du dévaliser les fourgons autrichiens pour se donner une tenue un peu militaire), ce devait être aussi un souci pour Napoléon empereur, et bien des conscrits de la Grande Armée sont allés au feu, sont allés jusqu’au fond de la Prusse et en Pologne, en blouse de paysan ou d’artisan, chapeau rond, leur état militaire reconnaissable seulement a la giberne à cartouches, au havresac, au fusil. Les anciens revêtus de leurs uniformes étaient des caïds, les conscrits naïfs tirés de leur campagne et de leur atelier n’avaient qu’à se soumettre, risquer leurs derniers sous pour payer à boire, accepter toutes les corvées, accepter les brimades les plus grossières. |
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris. (p.135) Les rois vont faire la sourde oreille, et, ce qui est plus grav’e encore, la classe possédante, en France, s’irrite chaque mois davantage contre un protecteur jadis béni et qui devient, positivement, déplorable. Pour ses levées d’hommes, il a maintenant des façons que l’ on ne saurait tolérer. Les riches peuvent toujours s’acheter des «remplaçants », mais le rachat ne vaut que pour une levée seule, et il faut sans cesse recommencer à payer; le remplaçant, d’ailleurs, profitant de la situation, se fait hors de prix. C’est un scandale. Il y avait aussi ces « exemptions pour raison de santé » que les notables obtenaient, dans bien des cas, aisément, au profit de leurs fils; c’était la solution idéale et gratuite (moins l’ « enveloppe », parfois, bien sûr, au médecin-major du conseil de révision). L’empereur récupère à présent, par légions, ces bienheureux exemptés. Le 11 janvier 1813, il a donné ordre d’en ramasser 100 000 dans les classes de 1809 à 1812, et il est allé jusqu’à incorporer dans la « ligne « , 100 000 gardes nationaux. Or, qu’est-ce la garde nationale ? Des gens de bien, des fils de famille; la garde nationale, c’est l’armée supplétive de l’ordre pour la protection des fortunes. Où va-t-on avec de semblables mesures, qui équivalent à des attentats? Le 3 avril 1813, Napoléon réclame 180 000 hommes de plus, et, (p.136) le 9 octobre, il va lever par anticipation la classe de 1815, avec une ponction nouvelle, qui suscite l’indignation, sur les exemptés et remplacés de toutes les classes depuis 1808. Les insoumis foisonnent. Fin 1808 déjà, le rapport Lacuée a évalué leur nombre à 377 000; parmi ces réfractaires, un nommé J.-B. Vianney à qui l’enfer dont le menace le catéchisme n’a pas fait suffisamment peur, et qui deviendra le curé d’Ars. Et ce Blocus! Et le commerce qui ne va plus! Et les impôts qui vont sûrement augmenter. Mollien constate que la hargne grandit chez les personnes distinguées: « propriétaires et négociants ne voyaient pour eux que la perspective de charges nouvelles ». Déjà 226 faillites ont eu lieu, en 1810, « sur la place de Paris ». |
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.227) The Parisian working class was deliberately pampered by the Emperor – still nervous of revolution after what he had seen as a young man. Nevertheless, with the country people who formed the great bulk of the French population, they suffered savagely in consequence of conscription – ‘the blood tax’. The sons of the rich were allowed to buy themselves out by hiring a replacement, at a price often almost ten times a labourer’s annual wage; as rnany as 9 per cent of the draft did so. Less fortunate young men chopped off thumbs or gouged out eyes to avoid serving. Deserters were hunted down by the gendarmerie, 60,000 being caught during 1812. Many hid in the woods or in cellars, their families having to pay fines for their evasion. Chateaubriand writes of entire villages miserably scanning call-up lists posted at street-corners, of parents arested as hostages for sons in hiding. He also writes of ‘passers-by crowding beneath long lists of those sentenced to death, studying them frantically for the names of chidren, brothers, friends and neighbours.
|
|
Edmond Yernaux, Fernand Fiévet, Montigny, son histoire, 1930 /Montigny sous la domination française/ (p.151-152) LA CONSCRIPTION Avec les guerres de la République et surtout de l’Empire, la conscription, pour la première fois dans l’histoire de notre localité, allait devenir obligatoire. C’était là une des mesures des plus antipathiques qu’un gouvernement pouvait prendre ; car notre population était foncièrement pacifique ; elle détestait les soldats qui n’étaient jamais apparus dans la commune que munis de bulletins de réquisitions. Chaque passage de la soldatesque était marqué par quelque charge financière nouvelle pour la communauté ; par des injures, des coups et parfois le déshonneur pour les familles ; aussi les Montagnards ne voyaient-ils pas d’un bon œil leurs fils faire métier de soudard. Le premier tirage au sort eut lieu le 17 frimaire, an VII, à Châtelet, qui était le chef-lieu du canton. Les conscrits, une quinzaine généralement par classe, se rendaient là-bas avec l’agent municipal Philippe Joseph Georges. Avant et après le tirage, Georges offrait à boire aux conscrits, sur le compte de la commune. Ils faisaient leurs libations au cabaret de l’Espagnol Thibaut. Les conscrits constituaient une bourse commune destinée à être partagée entre ceux qui seraient frappés par le sort. Ils pouvaient mettre 2, 3 ou 4 couronnes, cette mise leur assurait un sixième de la masse s’ils étaient de l’armée, 1/12e s’ils étaient de la réserve ; s’ils mettaient 6, 7 ou 8 couronnes, leur part, en cas de mauvais sort, était doublée. L’an IX, il fallait deux soldats, le sort désigna Pierre Joseph Grimart et André Joseph Pitot. Ce dernier n’ayant rien mis à la masse ne reçut rien. L’argent n’était remis que lorsque le conscrit était entré au service. Outre la masse faite par les conscrits eux-mêmes, la population faisait un pourchas . C’est de ce mot que vient le verbe wallon : pourtchèssî. L’an X, les conscrits avaient une masse de 82 couronnes, la population au pourchas donna 48 florins B.-L., 14 sols et 2 deniers. Il y avait eu 68 souscriptions pour les Trieux et la rue des Grimaux, 85 souscriptions au Village et 78 souscriptions à la Neuve Ville. Parmi les souscripteurs de ce quartier on notait en tête celle du maire Lefèvre.
|
1.8 L’armée napoléonienne
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont (p.21) Les anciens ne se vantaient pas seulement de leur bravoure, de leurs ripailles et orgies, ils faisaient aussi état avec gloire de leur mépris pour les civils; ils se vantaient d’être, loin des champs de bataille et hors des casernes, la terreur de la population, et en vérité ils l’étaient. Pénétrer de force dans les boutiques, les cafés, renverser les verres et les tables, quelles bonnes plaisanteries! Et serrer grossièrement les femmes, et casser la gueule aux bourgeois s’ils protestaient. Les rapports de police sont éloquents : « Le fils du propriétaire du café de Valois a le crâne fendu, un jeune homme est écharpé par un brigadier de chasseurs devant la porte du Sénat; à la barrière de Charonne, des militaires tuent un civil; dans la plaine de Montrouge trois soldats éventrent un inconnu sous Ie prétexte qu’il «les a regardés d’un air insultant.» Les faits de pillage et de destruction sont innombrables, ainsi que les sévices a l’égard des femmes. Un rapport du préfet du 17 septembre 1 804 signalera que six soldats ont abusé d’une jeune fille sur le quai du Port au Blé et l’ont ensuite jetée dans la Seine. Les meurtres et exactions graves n’étaient évidemment pas quotidiens et les anciens ne s’en vantaient pas, mais ils se vantaient des brutalités et brimades qui, elles, étaient fréquentes. Ce genre de récits commençait par choquer la plupart des naïfs conscrits, mais laisser voir une réprobation eût été dangereux, mieux valait feindre d’admirer, et c’est ainsi qu’on finit par admirer vraiment. Les récits de l’épopée; le prestige de l’uniforme et cette soumission morale: le conscrit enrôlé n’était déjà plus le même homme. (p.25) Nombre de vivandières traînaient une marmaille. On en a vu accoucher au pied d’un arbre, puis elles rattrapaient le régiment une ou deux étapes plus loin. Souvent vêtues comme des paysannes; portant parfois des robes de velours ou ornées de fourrure, pillées dans quelque château – et vite maculées par la rude vie des routes et des camps.
(p.474) Plus d’armée d’Angleterre, c’était maintenant la Grande Armée, nom officiel. Deux cent mille hommes marchaient vers le Rhin, selon les sept itinéraires. Tout était prévu, organisé. A une journée devant la troupe, un commissaire des guerres et un officier d’état-major alertaient les fonctionnaires et préparaient le ravitaillement, l’hébergement. La Grande Armée marchait tambour battant, il y avait des tambours en tête et en queue de bataillon. La musique jouait aux étapes. Contrairement à ce que croient beaucoup, nombre de routes françaises de grands itinéraires étaient très larges à l’époque. Les soldats n’avançaient que sur les côtés de la route, laissant le milieu libre, même consigne pour les cavaliers. Les généraux (en voiture) et les colonels (à cheval) s’avançaient en tête de leurs unités. Vitesse horaire, quatre kilomètres à l’heure (3,900 km exactement : une « lieue de poste»); haltes de cinq minutes toutes les heures, halte d’une demi-heure ou d’une heure (« halte des pipes ») au milieu de l’étape. Cent pas de distance entre les bataillons. L’armée parcourait de 35 4 40 km par jour. On quittait l’étape Ie matin de bonne heure, on arrivait à l’étape suivante tôt dans l’aprés-midi et les soldats, par groupes de trois ou quatre, allaient cantonner dans les fermes ou les habitations prévues.
Tout ce que je viens d’écrire, c’est la théorie. Il est généralement convenu que, de Boulogne au Rhin, tout a marché dans la perfection et la bonne humeur, par beau temps, et que les difficultés n’ont commencé qu’en octobre, lorsque le temps s’est gâté. Or la juxtaposition des témoignages des troupiers laisse souvent perplexe. L’un d’eux : «Notre colonne s’étire, ceux dont la famille réside a proximité de la route obtiennent la permission de faire leur tour d’adieu et rattrapent au galop, car personne ne veut manquer la fête du premier coup de canon. Nous sommes enflammés par l’espoir de nous mesurer bientôt dans la bataille, conduits par l’Empereur. Seules les haltes des pipes ponctuent notre cheminement. Nous chantons pour nous entraîner; lorsque nos voix s’éraillent et que nos pas vacillent, les musiciens redoublent leurs fanfares. » Un autre militaire, Grenadier de la Garde, pourtant l’élite de l’armée, s’exprime un peu différemment : « Jamais on n’a fait une marche aussi pénible; on ne nous a pas donné une heure de sommeil, jour et nuit en marche par peloton. On se tenait par rang les uns les autres, pour ne pas tomber; ceux qui tombaient, rien ne pouvait les réveiller. Il en tombait dans les fossés. Les coups de plat de sabre n’y faisaient rien du tout. Sur les minuit, je dérivais à droite sur le pendant de la route. Me voilà renvoyé sur le côté; je dégringole et je ne m’arrête (p.48) qu’après être arrivé dans une prairie. Je n’abandonnai pas mon fusil mais je roulai dans l’autre monde. »
(p.48) Les billets de logement, les cantonnements prévus, c’était bien joli, mais comment trouver les cantonnements quand on arrivait en avance sur les tableaux et ordres de mouvement, quand on arrivait de nuit en pays inconnu ? La Grande Armée ne transportait ni tentes ni abris démontables. Alors la force ou le système D. Forcer, briser les portes des maisons, démolir n’importe quoi pour se faire un abri, nous verrons tout cela.
(p.87) La Grande Armée balayant l’Europe va laisser derrière elle environ un million de.cadavres – sans compter ceux des ennemis. J’ai entendu dire : « En dix ans, c’est peu. » Le trentième environ de la population française de l’époque; il est vrai que nous avons fait mieux en Quatorze-Dix-Huit. Mais la puissance des armes à feu était beaucoup moins grande sous l’Empire, et les effectifs engagés étaient beaucoup moins nombreux.
(p.87) Au soir d’Austerlitz, Napoléon parcourant à cheval le champ de bataille a donné l’ordre aux officiers de sa suite de faire silence pour qu’on puisse entendre mieux les plaintes des blessés. Ces plaintes formaient un immense gémissement lugubre. On devait les entendre encore deux jours plus tard, sur le champ de bataille où les mourants n’avaient pas fini d’agoniser; on devait les entendre dans les maisons où les plus favorisés avaient été transportés – les premiers recueillis avaient été les blessés de la Garde -, et la plupart gisaient dans ces maisons sur de la paille ou à même le sol, souffrant de la soif et de la faim, opérés et soignés par des chirurgiens, aides-chirurgiens et infirmiers, bien trop peu nombreux, débordés et, le plus souvent, manquant d’instruments et de matériel sanitaire parce que, comme l’intendance, le service de santé ne suivait pas. Les blessés de la Grande Armée dont il n’est rien dit dans les manuels scolaires, dont il est dit si peu dans tant de récits de l’épopée, ont été en vérité une autre Grande Armée, une année de peut-être deux millions de martyrs. Voici maintenant comment l’officiel Bulletin de la Grande Armée (n° 31) a raconté l’épilogue d’Austerlitz:
“Le soir de la journée et pendant plusieurs heures de la nuit, l’Empereur a parcouru le champ de bataille et fait enlever les blessés: spectacle horrible s’il en fut jamais! L’Empereur passait à cheval avec la rapidité de l’éclair, et rien n’était plus touchant que de voir ces braves le reconnaltre sur-le-champ; les uns oubliaient leurs souffrances et disaient : Au moins, la victoire est-elle bien assurée? Les autres : Je souffre depuis huit heures, (p.88) et depuis Ie commencement de la bataille je suis abandonné, mais j’ai bien fait mon devoir. D’autres : Vous devez être content de vos soldats aujourd’hui. A chaque soldat blessé, l’Empereur laissait une garde qui le faisait transporter dans les ambulances. Il est horrible de Ie dire : quarante-huit heures après la bataille, il y avait encore un grand nombre de Russes qu’on n’avait pu panser. Tous les Français le furent avant la nuit. » La légende destinée à soutenir le moral de l’arrière s’élaborait à mesure des événements. Le lendemain de la bataille, Napoléon fut effrayé, paraît-il, par l’importance des pertes françaises. On le voit dicter, d’Austerlitz même, des ordres attribuant des pensions aux veuves et aux orphelins. Et ensuite? Ensuite Napoléon doit penser aux conditions d’un armistice avec l’ennemi vaincu et il faut penser plus loin, aux clauses du traité de paix, aux dispositions à prendre pour occuper en sûreté un pays jusqu’à ce que la paix soit vraiment assurée; en vérité un empereur chef de guerre en train de remodeler l’Europe a en tête bien d’autres soucis que le sort des blessés et des malades.
(p.106) /L’armée prussienne/ Ses généraux étaient des vieillards. En face de Napoléon, chef de la Grande Armée, 37 ans, Brunswick, général en chef prussien, en avait 71. Davout, 36 ans; Soult, Lannes, Ney, 37; en face, Hohenlohe, 60 ans; Blücher, 64; Moellendorf 81 ans. Solennité et lenteur. Pour l’armée prussienne, une étape de quatre à cinq lieues est une marche forcée, un exploit. Elle se traîne à l’allure d’escargot de ses innombrables chariots et fourgons de vivres et de matériel. A l’étape, il n’est pas question de cantonner chez l’habitant (ni de démolir un village pour se faire des abris!) : on édifie une véritable ville de tentes qu’on démonte méticuleusement le lendemain. Avant chaque départ, inspection, et le soldat doit se présenter aussi propre, aussi astiqué que pour une revue à Potsdam. La même discipline hiérarchique règne sur le champ de bataille. Les maréchaux et généraux mandarins sont persuadés que le secret de la victoire, enseigné par Frédéric II, consiste en évolutions précises, rigides, impeccables, interminables, la majesté avant tout.
(p.163) /Bataille de Friedland/ La perte “peu considérable” de l’armée française se chiffrait par 7 000 tués ou blessés. L’envers des grandes batailles est toujours le même. Devant une ambulance’ installée «dans une grande maison rouge à portée de canon du champ de bataille on jette à mesure les cadavres des blessés qui meurent en arrivant.» Percy : « Dans la chambre du rez-de-chaussée et derrière la porte, un monceau de membres coupés; le sang ruisselait de toutes parts; on entendait les cris, les gémissements, les hurlements des blessés apportés sur des échelles, des fusils, des perches; tableau déchirant, toujours le même, et auquel je ne puis m’habituer.» Même le Bulletin de la Grande Armée laissait entrevoir le prix de la victoire: “Le lendemain, le jour se leva sur l’un des champs de bataille les plus horribles qu’on put voir.» Il faisait si chaud et les cadavres d’hommes et de chevaux puaient tellement que l’ordre habituel d’enterrer les morts fut rapporté: – Traînez-les tous j usqu’à la rivière et balancez-les.
Avant l’atroce corvée, une généreuse distribution d’eau de vie. Les soldats rirent en voyant les cabrioles des morts sur les pentes du ravin.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.101) In order to impress France with a sense of his semi-royal position Bonaparte held frequent parades on the Carrousel outside the Tuileries, or the Champs-Élysées. Surrounded by a glittering staff and wearing his red velvet uniform of First Consul, he reviewed the Consular Guard from his charger. They marched or trotted past in dazzling yellow uniforms to stirring military music, massed bands playing Partant pour la Syrie or the Chant du Départ (both written by his stepdaughter Hortense de Beauharnais) – though not the Marseillaise, nowadays considered Jacobin and seditious. These men, hand-picked, were fanatically loyal. They were deeply admired by the vast majority of their fellow-countrymen.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988 (p.228) By 1813 the Emperor was recuiting men over sixty and boys under fifteen (the ‘Marie Louises’, so called after his Austrian Empress). On one occasion he described the latter as ‘only fit for filling up the hospitals and roadsides’. The country suffered as much from soldiers who followed the colours as it did from deserters. Paris and every major French town was filled with noisy, swaggering, pugnacious troopers. Frequently drunk, they fought each other, attacked civilians, broke into wineshops and molested women. Not everyone in France was pleased to see the splendidly uniformed soldiers of the Grande Armée.
|
| Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p.18) « Les dispositions réelles du jeune Buonaparte à l’ égard de la France sont celles du colonisé* de fraîche date qui profite de l’oppresseur, qui s’ est fait, pour vivre, et cachant son jeu, mercenaire à son service, mais ne songe qu’ à tirer parti contre lui des avantages dont il lui est redevable. » (* En 1768, Louis XV achète la Corse aux Génois, ce qui met en fureur la plupart des autochtones.) (p.47) « Général, il n’est pas au service de la France, il l’utilise seulement. Seuls pourraient s’étonner de ce qu’ il va faire en Italie ceux qui n’ ont pas compris la simplicité bestiale de son cas. » |
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris (p.127) « L’épopée » napoléonienne, gluante de sang, ne revêt toute sa dimension que si des chiffres l’accompagnent. Austerlitz? 23 000 morts; mais, quand on a le coeur bien placé, les cadavres d’Austerlitz disparaissent dans le soleil du même nom. Eylau? 50 000 hommes tombent. Wagram ? Napoléon y bat son propre record (55 000 tués), qu’il surpassera à Borodino, gala qui coûte aux deux armées quelque 80 000 soldats. Sur les services sanitaires dans l’armée impériale, il faut lire le journal du chirurgien Percy: le matériel est dérisoire, le personnel presque inexistant; les amputations se pratiquent sans anesthésie; la gangrène s’installe; le blessé grave, dans la Grande Armée, est un condamné à mort; Napoléon a interdit, du reste, de relever, pendant l’action, les hommes qui s’écroulent; il se méfie des déserteurs, dont le nombre se multiplie. Mais (p.128) ne ternissons pas avec d’aussi misérables détails la « Chanson de geste » chère à M. Louis Madelin, lequel déclarait, dans son grand ouvrage «La France de l’Empire», réédité en 1960 par le Cercle Historia : “Mêlées, blessures, pour le soldat de l’empereur, tout cela n’est rien; la bataille est une fête». Le 28 janvier 1809, Napoléon Bonaparte, qui croit savoir que Talleyrand a parlé, pendant son absence, de sa succession éventuelle (les opérations militaires, en Espagne tournent mal), fait une scène terrible à « l’ évêque », auquel il reproche – ce qui est pimpant dans sa bouche – d’être « athée » et qu’il compare, le mot est céIébre, à “de la merde dans un bas de soie » ; (p.129) bonne l’image, mais elle convient à Napoléon lui-même au moins aussi exactement qu’à son interlocuteur. (p.130) La France, dit Napoléon Bonaparte, est « un nid de soldats », de soldats gratuits. Que pèse la vie de ces “c. » (encore un mot censuré, du vocabulaire de l’empereur)? L’Angleterre, il l’a déclaré à Mollien (Mémoires T. 111, p. 293), « sera plus vite à son dernier écu que la France à son dernier soldat ». |
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris CH. VIII EXIT “NABOU” (p.133-134) NAPOLÉON BONAPARTE DIRIGE CONTRE LA RUSSIE en 1812 une « croisade européenne » ; c’est sa formule. Sous lui, l’Europe se lève contre « la barbarie Tartare ». L’armée-Babel qu’il a réunie compte près de 700 000 hommes, mais il y a là quelque 400 000 Allemands, Polonais, Italiens, Hollandais, Suisses même. Il s’imagine que ces asservis vont se faire tuer en sa faveur (1) pour alourdir encore leur servage, alors que la plupart n’attendent que l’occasion de briser leurs chaînes. L’énormité des désertions, pendant la campagne de Russie, est passée sous silence par les chantres de « l’épopée », de même que l’illusion dont Mollien (T. 111, p. 67) nous faisait part: franchissant le Niémen, Napoléon croyait tout de bon aller au devant de profits gigantesques; il s’en était ouvert à son trésorier et comptait « lever en Russie autant de contributions qu’il en avait tirées de la Prusse et de l’Autriche », ensemble. (1) Napoléon en était persuadé, estimant que la peur y suffirait. Et il disait, très fier, à Fouché: “Ainsi j’aurai l’extraordinaire politique d’avoir mes ennemis à mon service.” |
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014 (p.68) Pour notre pays et pour le politique Bonaparte, tes conséquences de cette campagne vont être majeures. Le 23 août 1799, jugeant qu’il n’a plus de véritable intérêt à rester avec ses hommes, Bonaparte reprend la mer et, le 8 octobre, il débarque à Fréjus, auréolé d’un prestige que sa propagande a soigneusement servi. C’est la première fois qu’il abandonne ses soldats dans un moment difficile. Il le refera deux fois : en Espagne, au cœur d’une impasse, et en Russie, lors d’une tragédie. Il place ses ambitions politiques avant ses devoirs de soldat.
|
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014 (p.74) Un chef peu soucieux de ses hommes Dans un régime tourné vers la guerre et au sommet duquel Napoléon entend décider de tout – les historiens précisent qu’il aimait entrer dans le moindre détail -, il n’est pas fortuit que l’administration militaire soit si défaillante. Cela veut dire qu’elle intéresse peu Napoléon. Si les payeurs sont intègres et protègent leurs caisses, même près des combats, les commissaires de guerre n’ont ni leur zèle ni leur intégrité. Ils sont chargés des approvisionnements, de la mise en place des hôpitaux, des convois militaires, de l’habillement, des vivres. Leur rôle est donc essentiel. Or, il y a parmi eux beaucoup de concussionnaires et des fortunes sont édifiées qui coûteront des milliers de morts. Le soldat napoléonien est constamment mal nourri, mal vêtu, mal soigné et même mal armé. D’où la soupape de sécurité du pillage. Napoléon semble avoir pris son parti de tout cela. La priorité va au combat et à la recherche de la victoire. Le reste importe peu. L’affection et la sollicitude de Napoléon pour ses soldats relèvent de la légende – une légende systématiquement et adroitement entretenue -, et non de la réalité, beaucoup plus crue, plus froide. Si Napoléon paye de sa personne, s’expose sans précaution quand l’examen d’une position ou le suivi de ses ordres l’y conduisent, s’il sait faire des gestes qui galvanisent, il n’a guère le souci des hommes. (p.75) La condition du soldat n’est pas sa préoccupation. Son exigence est d’avoir des soldats à l’heure pour la bataille. Son mode de combat fondé sur le mouvement et la rapidité, servi par des décisions d’exécution prises aussi tard que possible (pour intégrer les choix de l’ennemi et s’adapter à des situations changeantes), impose souvent aux combattants de longues marches forcées accomplies le ventre creux. Étrangement, l’état dans lequel ces hommes arrivent au feu n’est pas, semble-t-il, pris en compte.
L’intérêt peu marqué porté par Napoléon au service de santé de ses armées est également révélateur. Certes, il faut avoir à l’esprit la faiblesse des connaissances médicales de l’époque : on ne sut qu’en 1909, par exemple, que le typhus se transmettait par le pou. Ce mal sera le compagnon constant de la Grande Année et il se répand de façon foudroyante après la retraite de Russie. La majeure partie des morts des guerres de l’Empire n’est pas survenue sur les champs de bataille mais à cause des blessures terribles dues à l’usage massif de l’artillerie de part et d’autre ou aux maladies contractées et propagées dans des hôpitaux de fortune aux conditions hygiéniques effroyables. Cela aussi, c’est mourir à la guerre…
(p.76) Percy, homme courageux et esprit indépendant, est successivement chargé des services de santé militaire de la République et de l’Empire.jusqu’en 1809. Son souci majeur est de sauver les blessés (en 1800, il fait proposer en vain aux Autrichiens l’inviolabilité des ambulances). Il suggère à Napoléon une meilleure organisation de la chirurgie aux armées, sans être écouté. Larrey organise les ambulances volantes qui sillonnent les champs de bataille pour ramener les blessés vers l’arrière afin de les opérer et de les soigner. En 1805, l’Empereur lui interdira toute évacuation avant la fin de l’action ! Coste, qui s’est battu pour le maintien des hôpitaux militaires, introduit la variolisation aux armées. Mais il le réalise sans véritable soutien de l’Empereur.
|

