
Les campagnes militaires de Napoléon : la vérité
PLAN
| 2.0 sa stratégie militaire |
| 2.1 l’Italie |
| 2.2 l’Egypte, l’Empire turc |
| 2.3 l’Espagne et le Portugal |
| 2.4 l’Autriche, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse |
| 2.5 la Russie |
| 2.6 les pillages |
| 2.7 avant, pendant et après Waterloo |
2.0 La stratégie militaire de Napoléon : vérité
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.367) Notre intention n’est pas ici de conter l’aventure sanglante et lamentable dans laquelle Napoléon entraîna la France et le peuple français et que certains qualifient encore d’ « épopée impériale » ; (…). |
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.397) Reste Marengo : ce fut sa première imposture militaire. Il dormait profondément, à quelques kilomètres de cette plaine, qui semble avoir été créée pour servir de champ de bataille, lorsqu’il fut réveillé par le bruit d’une canonnade : c’étaient les Autrichiens du général Mêlas qui attaquaient. Surpris, car il pensait prendre l’initiative du combat, Bonaparte dut faire face à l’offensive autrichienne (à 14 heures), mais la bataille est perdue et, à 17 heures, il se voit contraint d’ordonner la retraite. Mêlas poursuit mollement Bonaparte et l’armée française en déroute ; mais, à la fin de la journée, Desaix et ses troupes « fraîches » rejoignent le Premier Consul ; et celui-ci se décide alors à livrer aux Autrichiens un combat d’arrière-garde : Desaix est tué d’une balle en plein front mais le général de brigade Kellermann lance une charge vigoureuse et audacieuse sur l’ennemi, et les Autrichiens s’enfuient. Bonaparte est sauvé presque par hasard ; dans le communiqué officiel – qu’il dut remanier quatre fois pour lui donner un semblant de consistance -il présente cette victoire inespérée, due à Desaix et Kellermann, comme une manœuvre géniale de sa part. Mais Desaix était mort : il ne risquait pas de le contredire. La campagne de 1800 est un bon exemple de la manière dont Bonaparte faisait la guerre, qui s’applique à toutes les autres campagnes. Il dispose de troupes nombreuses (800 000 hommes en 1807, par exemple), alimentées par la conscription, que la France est le seul pays en Europe à imposer, la Prusse exceptée (mais elle est beaucoup moins peuplée que la France). Ses divisions sont (p.398) presque à pied d’œuvre, sur le Rhin, en Italie (notamment dans les Républiques sœurs) et dans les Alpes ; elles sont commandées par des généraux jeunes et ambitieux, se déplacent rapidement et vivent sur le pays, selon la méthode Guibert. En revanche, Bonaparte manque d’informations géographiques et climatiques précises sur l’Allemagne, les Balkans, la Pologne et la Russie ; les seules cartes disponibles en France sont celles des frontières et les cartes relevées au cours d’expéditions militaires par les ingénieurs du Dépôt de la Guerre (au temps de la première campagne d’Italie, Napoléon avait remarqué l’efficacité du chef du cabinet topographique, le dessinateur Bâcler d’Albe, dont il fit, en quelque sorte, son géographe personnel : il suivit la Grande Armée à partir de 1805, et il put se procurer à Varsovie, en 1806, lors de la campagne de Pologne, un grand atlas de Russie, qu’il fit reproduire et dont se servit Napoléon en 1812). En général, donc, Bonaparte devait improviser, et l’on ne compte plus le nombre de divisions qui sont arrivées en retard sur le champ de bataille tout simplement… parce qu’elles s’étaient perdues. Il ne peut pas envisager un plan de campagne à long terme, comme celui qui avait été utilisé contre les Piémontais en 1796, fondé sur l’occupation méthodique, jour après jour, des points stratégiques, suivie d’une invasion ; il doit rechercher la bataille décisive, qui anéantit rapidement l’ennemi et lui impose de traiter. Et lorsque le territoire deviendra trop vaste, comme en Russie, et qu’il se trouvera en présence d’un adversaire de la taille de Koutouzov, qui a l’intelligence et la patience – rares chez un chef militaire (et qu’on retrouvera chez certains chefs amérindiens quand ils auront à défendre leurs immenses territoires contre les conquérants américains) – de refuser le combat, et de guetter patiemment sa proie, jusqu’à ce qu’elle tombe d’elle-même, Napoléon y engloutira son immense armée. L’histoire des guerres napoléoniennes et la description, dans leurs moindres détails, des combats et des batailles qui furent livrés par le guerrier ajaccien ont fait depuis deux siècles les délices des stratèges en chambre, des généraux en retraite, des historiographes minutieux qui ont dépouillé des tonnes d’archives. Retenons cependant quelques chiffres, qui, à notre avis, expliquent tout : (p.399) – Napoléon a mené 15 campagnes, en comptant la première campagne d’Italie dont il rut l’exécutant, mais non le promoteur ; – au cours de ces campagnes, lui et/ou ses généraux ont livré 148 batailles (voir l’Annexe n° 23, p. 491), en y comprenant les combats ; lui-même n’a été présent qu’à 43 d’entre elles (toutes les autres ont été l’œuvre de ses généraux); – 23 d’entre elles furent décisives, il les a toutes dirigées lui-même ; – campagnes et batailles ont coûté à la France entre 1300 000 et 1800 000 hommes selon les estimations (qui n’étaient pas tous français, il y avait beaucoup d’étrangers dans les armées françaises). Dans la mesure où le sort de toutes les campagnes napoléoniennes, à l’exception de la première campagne d’Italie, s’est joué sur une ou deux batailles, il est intéressant de savoir pourquoi ces batailles ont été gagnées (ou perdues, dans le cas de la Bérézina ou de Waterloo). En général, les forces en présence étaient à peu près équivalentes et les batailles de Napoléon – qui ont rarement duré plus d’une journée – ont été des succès essentiellement tactiques, (p.400) liés à la réussite d’une manœuvre (exemple, la fameuse manœuvre d’Austerlitz) ou aux erreurs de ses adversaires, dont il a su profiter. On ne peut donc pas parler de son « génie militaire » pour expliquer ses victoires, il est plus juste de les rapporter à son sens de l’à-propos, à la rapidité de ses réactions sur le champ de bataille, ou, souvent, à la chance du joueur invétéré qu’il était. Voici quelques remarques sur quelques-unes de ses grandes victoires décisives (présentées dans l’ordre chronologique). À Rivoli (14 janvier 1797, au cours de la première campagne d’Italie), c’est le général autrichien Alvinczy qui a été l’artisan de sa propre défaite. Son but était de délivrer Mantoue, dont le blocus durait depuis le mois de juin 1796 (voir ci-dessus, p. 250). Alvinczy a commis l’erreur de diviser ses forces en six colonnes, qui devaient converger sur le plateau de Rivoli : quatre colonnes – l’infanterie – devaient passer par les montagnes et deux – la cavalerie et l’artillerie – devaient suivre la rive droite de l’Adige (voir carte p. 237). Renseigné sur les mouvements de l’ennemi, Bonaparte n’eut donc qu’à se placer sur les hauteurs qui commandaient l’accès au plateau, d’où il put empêcher la concentration des troupes autrichiennes. À Marengo (14 juin 1800, au cours de la deuxième campagne d’Italie), nous avons déjà dit (p. 36l, ci-dessus) que le général autrichien Mêlas avait d’abord vaincu Bonaparte et que celui-ci avait déjà ordonné la retraite ; c’est l’arrivée de Desaix qui le sauva, mais le communiqué officiel attribua à Bonaparte toute la gloire de la victoire (Desaix ne risquait pas de protester: il était mort sur le champ de bataille). Austerlitz (2 décembre 1805, lors de la campagne d’Allemagne) est la plus fameuse bataille de Napoléon. La troisième coalition contre la France avait été ouverte par l’accord conclu à Saint-Pétersbourg entre l’Angleterre et la Russie le 11 avril 1805, suivi d’un traité d’alliance entre les deux nations en juillet, alliance que rallia l’empereur autrichien François II en août, ainsi que Naples et la Suède. Napoléon était sur ses gardes : de Boulogne, où il préparait une hypothétique invasion de l’Angleterre, il surveillait les Autrichiens et avait prévu de marcher sur Vienne par deux voies : par la Bavière (nation alliée de la France) et en suivant la vallée du Danube- d’une part, à travers la Bohême-Moravie d’autre part. La (p.401) première bataille importante de la campagne eut lieu à Ulm, où s’était enfermé le général autrichien Mack, qui capitula en octobre 1805 ; mais la bataille décisive eut lieu à Austerlitz (entre Prague et Vienne). Le champ de bataille d’Austerlitz, choisi par Napoléon, était une vaste plaine, bordée par un ruisseau (le Gold-bach), avec, au centre, un plateau (le plateau de Pratzen) dominant la plaine d’environ deux cents mètres. Le 29 novembre, au lieu de s’installer sur le plateau, Napoléon l’abandonne aux Austro-Russes, feint de battre en retraite et déploie son armée en arrière du Gold-bach. Son plan était le suivant : inspirer aux alliés ennemis le projet de tourner l’armée française par sa droite, pour lui couper la route de Vienne (vers le village de Telnitz), ce qui les obligerait à dégarnir le plateau de Pratzen et à se diriger vers Telnitz. Les Autrichiens tombèrent dans le piège, quittèrent le plateau central et allèrent défendre la route de Vienne, tandis que les Russes, commandés par Koutouzov, occupaient le plateau le 30 novembre ; le 2 décembre, vers sept heures du matin, les Autrichiens se ruèrent à l’attaque de Telnitz et des villages voisins (tenus par Davout) et, pendant ce combat, Napoléon, profitant du brouillard très dense qui noyait la petite vallée du Goldbach et les flancs du plateau de Pratzen, envoyait Soult sur le plateau vers huit heures et demie : à neuf heures le brouillard d’Austerlitz commençait à se dissiper et les Austro-Russes découvrirent qu’ils avaient perdu le centre du champ de bataille, occupé maintenant par les Français. Ils essayèrent de reconquérir Pratzen, mais n’y parvinrent pas : à 16 heures, la nuit tombait et Napoléon avait gagné la bataille d’Austerlitz. Mais comment ? Par un « coup de poker », comme l’écrit Jacques Garnier, spécialiste de l’histoire des batailles napoléoniennes. Car la manœuvre d’Austerlitz (laisser le plateau à l’ennemi, l’attirer à Telnitz et profiter du brouillard) ne pouvait réussir que sous plusieurs conditions : 1° que les Austro-Russes tombent dans le piège qui les attirait à Telnitz et dégarnissent le plateau ; 2° que le brouillard fasse son apparition au bon moment ; 3° qu’il persiste suffisamment longtemps, pour permettre aux Français d’escalader les flancs du plateau sans être vus. Quelle pythonisse pouvait prévoir tout cela ? À Austerlitz, Napoléon n’a pas fait preuve de génie, il a simplement joué au loto et gagné le gros lot. Encore fallait-il avoir le cran de miser. (p.402) La victoire d’Iéna (14 octobre 1806, au cours de la campagne de Prusse) ne fut pas due à un pari, comme celle d’Austerlitz, mais à un coup de malchance pour les Prussiens. Le 13 octobre, Napoléon et son armée, au grand complet, atteignaient Iéna, juste en arrière des positions prussiennes ; il ignorait que le roi de Prusse et ses généraux, craignant d’être cernés, avaient décidé la retraite et que l’armée prussienne s’était divisée en deux colonnes, l’une sous le commandement du duc de Brunswick, l’autre commandée par Hohenlohe. Croyant donc avoir toute l’armée ennemie devant lui, il décide de l’enfoncer de front et d’envoyer Davout la tourner par Auerstedt, à vingt kilomètres au nord. La bataille a eu lieu, et Napoléon écrase sans mal Hohenlohe, qui n’a avec lui qu’une partie de l’armée prussienne. Le même jour, Davout sera vainqueur à Auerstedt. La campagne de Pologne contre les Russes, en 1806-1807, fut mal préparée. Eylau (8 février 1807) fut une boucherie inutile (le mot est de Napoléon lui-même) ; Friedland (14 juin 1807) fut une bataille improvisée, offensive, mais parfaitement réussie (les Russes étaient dans une position dangereuse, le dos à une rivière) ; huit jours après, les Russes demandaient l’armistice et le tsar Alexandre Ier rencontra Napoléon sur un radeau lancé au milieu du Niémen : la paix fut signée à Tilsit le 8 juillet 1807, c’était un traité napoléonien, c’est-à-dire une simple trêve, lourde de guerres futures (il prévoyait le démembrement de la Prusse et la résurrection partielle de la Pologne à laquelle la Russie ne risquait pas de souscrire). Après la campagne de Pologne, Napoléon décide d’asphyxier économiquement l’Angleterre en organisant le blocus continental, initiative qui l’entraîna dans une politique de guerres et d’annexions, en particulier à deux interventions militaires qui devaient lui être fatales : au Portugal (en 1807) et en Espagne (1808). Il détrôna les dynasties régnantes, nomma son frère Joseph roi d’Espagne et dut faire face alors, dans la péninsule Ibérique, à une longue guérilla qui, soutenue par un corps expéditionnaire anglais (commandé par Wellington), eut enfin raison de Napoléon. La campagne de 1809, en Autriche et en Allemagne, a été marquée par les batailles d’Essling (21-22 mai) et de Wagram (4-6 juillet). La première fut perdue par Napoléon, qui cherchait un passage sur le Danube, à l’est de Vienne (qu’il occupait), pour (p.403) débusquer le prince Charles et son armée. Il choisit d’utiliser l’île de Lobau, sur le fleuve, fait construire rapidement un pont, franchit le Danube, est repoussé par les Autrichiens à Essling, et doit se replier avec son armée dans l’île (où il se retrancha). Sa défaite était due principalement à la crue du Danube, pourtant prévisible à cette époque de l’année. Quarante jours plus tard, c’était la décrue, Napoléon et son armée purent quitter l’île de Lobau et l’Empereur offrit la bataille à l’archiduc Charles dans la plaine dominée par le plateau de Wagram (4-6 juillet 1809), qui opposa l’armée française (190 000 hommes) à l’armée autrichienne (220 000 hommes). La victoire revint à Napoléon et à ses généraux (Masséna, Bernadotte, Oudinot, Davout), mais elle ne fut suivie d’aucun résultat tactique, puisque l’archiduc Charles put s’échapper et se replier en Bohême. Elle fut cependant suivie de la signature du traité de Vienne (14 octobre 1809)… et du mariage de Napoléon avec la fille de l’empereur autrichien, Marie-Louise, destiné à fonder une dynastie Bonaparte, puisque Joséphine n’avait pas donné d’héritier à l’Empereur (il divorça le 16 décembre 1809, le mariage religieux fut annulé le 9 février 1810, et Napoléon épousa Marie-Louise le 1er avril 1810 ; un enfant, le roi de Rome, devait naître de cette union le 20 mars 1811). La rupture de l’alliance franco-russe qui avait été conclue à Erfurt fut la conséquence d’une part du rapprochement franco-autrichien après Wagram, d’autre part de la création du grand-duché de Varsovie, par Napoléon, en 1807, qui laissait présager une renaissance de l’État polonais que s’étaient jadis partagé la Russie et l’Autriche. Contre Napoléon, le tsar noua donc une même coalition avec les Anglais et la guerre éclata au mois de juin 1812. Une Grande Armée de près de 800 000 hommes partit, à pied, de Paris pour Moscou ; on sait qu’il n’en revint que quelques milliers. L’inefficacité totale de Napoléon en matière de stratégie se manifesta cruellement dans cette campagne de Russie ; il y fit les mêmes erreurs que Hitler plus d’un siècle plus tard : il partit avec une armée sans service sanitaire, sans train des équipages, presque sans service d’intendance, sans information géographique certaine (son meilleur instrument, en la matière, était un atlas de la Russie qu’avait rapporté Bâcler d’Albe de Varsovie en 1807), avec l’intention de vivre sur le pays, mais en ignorant à peu près tout et de ses ressources, et de son peuple. Il n’avait pas prévu ni (p.404) la stratégie de la terre brûlée adoptée par les généraux russes (notamment par Barclay de Tolly, qui fait le vide devant lui), ni l’extraordinaire stratégie de Koutouzov qui suivait la Grande Armée en attendant son heure, ni le froid russe, ni le dégel, ni qu’il prendrait une capitale en ruine, vidée de ses habitants et brûlée, ni la Bérézina. Le flambeau du guerrier Napoléon, qui avait fait illusion pendant dix-neuf ans, était éteint. Le désastre de Russie était, selon le mot célèbre de Talleyrand, « le commencement de la fin ». |
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.106) Il est vrai qu’aussi les combats lui plaisent ; il l’a dit à Roederer : « C’est le don particulier que j’ai reçu en naissant ; c’est mon habitude ; c’est mon existence » N’oublions pas d’ajouter que la guerre, pour Bonaparte, doit être — et primordialement — une entreprise qui rapporte ; et il s’y entend, à la faire rapporter ; sinon pour l’Etat, du moins pour lui-même ; et d’autres en profitent, qui se loueront ainsi de lui ; « je les connais mes Français », dit-il à Lucien, d’un ton assez crapuleux ; ils adorent d’avoir « à leur tête » quelqu’un « qui les mène voler, de temps à autre, à l’étranger ».
|
|
Roger Caratini, Paoli, Napoléon, une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.491) annexe n° 25 Batailles du Consulat et de l’Empire Contrairement à ce qu’on pourrait croire, Napoléon n’a pas livré lui-même toutes les batailles dont on lui attribue la gloire. De 1796 à 1815, les armées françaises ont livré 148 combats et batailles : Napoléon n’a été présent qu’à 43 d’entre elles (il était absent pour toutes les autres). Dans le tableau ci-dessous, nous avons imprimé en gras les noms des batailles auxquelles il a été présent ; mais il ne faut pas oublier que, même dans ces batailles, ses généraux (Murât, Masséna et les autres) ont souvent agi sans instruction, de leur propre initiative : sans eux, on ne parlerait pas aujourd’hui de la plupart des victoires de Napoléon.
|
|
« Die grossen Schlachten », ARD MO. 30 Okt. 2006
1813 zwingt die europäische Allianz das napoleonische Heer in die Knie. „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ läutet Napoleons Ende ein. Es ist die bis dahin grösste Schlacht aller Zeiten gewesen.
|
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
(p.21) Les anciens ne se vantaient pas seulement de leur bravoure, de leurs ripailles et orgies, ils faisaient aussi état avec gloire de leur mépris pour les civils; ils se vantaient d’être, loin des champs de bataille et hors des casernes, la terreur de la population, et en vérité ils l’étaient. Pénétrer de force dans les boutiques, les cafés, renverser les verres et les tables, quelles bonnes plaisanteries! Et serrer grossièrement les femmes, et casser la gueule aux bourgeois s’ils protestaient. Les rapports de police sont éloquents : « Le fils du propriétaire du café de Valois a le crâne fendu, un jeune homme est écharpé par un brigadier de chasseurs devant la porte du Sénat; a la barrière de Charonne, des militaires tuent un civil; dans la plaine de Montrouge trois soldats éventrent un inconnu sous Ie prétexte qu’il «les a regardés d’un air insultant.» Les faits de pillage et de destruction sont innombrables, ainsi que les sévices a l’égard des femmes. Un rapport du préfet du 17 septembre 1 804 signalera que six soldats ont abusé d’une jeune fille sur le quai du Port au Blé et l’ont ensuite jetée dans la Seine. Les meurtres et exactions graves n’étaient évidemment pas quotidiens et les anciens ne s’en vantaient pas, mais ils se vantaient des brutalités et brimades qui, elles, étaient fréquentes. Ce genre de récits commençait par choquer la plupart des naïfs conscrits, mais laisser voir une réprobation eût été dangereux, mieux valait feindre d’admirer, et c’est ainsi qu’on finit par admirer vraiment. Les récits de l’épopée; le prestige de l’uniforme et cette soumission morale: le conscrit enrôlé n’était déjà plus le même homme.
(p.25) Nombre de vivandières traînaient une marmaille. On en a vu accoucher au pied d’un arbre, puis elles rattrapaient le régiment une ou deux étapes plus loin. Souvent vêtues comme des paysannes; portant parfois des robes de velours ou ornées de fourrure, pillées dans quelque château – et vite maculées par la rude vie des routes et des camps. (p.474) Plus d’armée d’ Angleterre, c’était maintenant la Grande Armée, nom officiel. Deux cent mille hommes marchaient vers le Rhin, selon les sept itinéraires. Tout était prévu, organisé. A une journée devant la troupe, un commissaire des guerres et un officier d’état-major alertaient les fonctionnaires et préparaient le ravitaillement, l’hébergement. La Grande Armée marchait tambour battant, il y avait des tambours en tête et en queue de bataillon. La musique jouait aux étapes. Contrairement à ce que croient beaucoup, nombre de routes françaises de grands itinéraires étaient très larges à l’époque. Les soldats n’avançaient que sur les côtés de la route, laissant le milieu libre, même consigne pour les cavaliers. Les généraux (en voiture) et les colonels (à cheval) s’avançaient en tête de leurs unités. Vitesse horaire, quatre kilomètres à l’heure (3,900 km exactement : une « lieue de poste»); haltes de cinq minutes toutes les heures, halte d’une demi-heure ou d’une heure (« halte des pipes ») au milieu de l’étape. Cent pas de distance entre les bataillons. L’armée parcourait de 35 4 40 km par jour. On quittait l’étape Ie matin de bonne heure, on arrivait à l’étape suivante tôt dans l’après-midi et les soldats, par groupes de trois ou quatre, allaient cantonner dans les fermes ou les habitations prévues. Tout ce que je viens d’écrire, c’est la théorie. Il est généralement convenu que, de Boulogne au Rhin, tout a marché dans la perfection et la bonne humeur, par beau temps, et que les difficultés n’ont commencé qu’en octobre, lorsque le temps s’est gâté. Or la juxtaposition des témoignages des troupiers laisse souvent perplexe. L’un d’eux : « Notre colonne s’étire, ceux dont la famille réside a proximité de la route obtiennent la permission de faire leur tour d’adieu et rattrapent au galop, car personne ne veut manquer la fête du premier coup de canon. Nous sommes enflammés par l’espoir de nous mesurer bientôt dans la bataille, conduits par l’Empereur. Seules les haltes des pipes ponctuent notre cheminement. Nous chantons pour nous entraîner; lorsque nos voix s’éraillent et que nos pas vacillent, les musiciens redoublent leurs fanfares. » Un autre militaire, Grenadier de la Garde, pourtant l’élite de l’armée, s’exprime un peu différemment : « Jamais on n’a fait une marche aussi pénible; on ne nous a pas donné une heure de sommeil, jour et nuit en marche par peloton. On se tenait par rang les uns les autres, pour ne pas tomber; ceux qui tombaient, rien ne pouvait les réveiller. Il en tombait dans les fossés. Les coups de plat de sabre n’y faisaient rien du tout. Sur les minuit, je dérivais à droite sur le pendant de la route. Me voila renvoyé sur le côté; je dégringole et je ne m’arrête (p.48) qu’après être arrivé dans une prairie. Je n’abandonnai pas mon fusil mais je roulai dans l’autre monde. » (p.48) Les billets de logement,. les cantonnements prévus, c’était bien joli, mais comment trouver les cantonnements quand on arrivait en avance sur les tableaux et ordres de mouvement, quand on arrivait de nuit en pays inconnu ? La Grande Armée ne transportait ni tentes ni abris démontables. Alors la force ou le système D. Forcer, briser les portes des maisons, démolir n’importe quoi pour se faire un abri, nous verrons tout cela.
(p.87) La Grande Armée balayant l’Europe va laisser derrière elle environ un million de.cadavres – sans compter ceux des ennemis. J’ai entendu dire : « En dix ans, c’est peu. » Le trentième environ de la population française de l’époque; il est vrai que nous avons fait mieux en Quatorze-Dix-Huit. Mais la puissance des armes à feu était beaucoup moins grande sous l’Empire, et les effectifs engagés étaient beaucoup moins nombreux.
(p.87) Au soir d’Austerlitz, Napoléon parcourant à cheval le champ de bataille a donné l’ordre aux officiers de sa suite de faire silence pour qu’on puisse entendre mieux les plaintes des blessés. Ces plaintes formaient un immense gémissement lugubre. On devait les entendre encore deux jours plus tard, sur le champ de bataille où les mourants n’avaient pas fini d’agoniser; on devait les entendre dans les maisons où les plus favorisés avaient été transportés – les premiers recueillis avaient été les blessés de la Garde -, et la plupart gisaient dans ces maisons sur de la paille ou à même le sol, souffrant de la soif et de la faim, opérés et soignés par des chirurgiens, aides-chirurgiens et infirmiers, bien trop peu nombreux, débordés et, le plus souvent, manquant d’instruments et de matériel sanitaire parce que, comme l’intendance, le service de santé ne suivait pas. Les blessés de la Grande Armée dont il n’est rien dit dans les manuels scolaires, dont il est dit si peu dans tant de récits de l’épopée, ont été en vérité une autre Grande Armée, une année de peut-être deux millions de martyrs. Voici maintenant comment l’officiel Bulletin de la Grande Armée (n° 31) a raconté l’épilogue d’Austerlitz: “Le soir de la journée et pendant plusieurs heures de la nuit, l’Empereur a parcouru le champ de bataille et fait enlever les blessés: spectacle horrible s’il en fut jamais! L’Empereur passait à cheval avec la rapidité de l’éclair, et rien n’était plus touchant que de voir ces braves le reconnaître sur-le-champ; les uns oubliaient leurs souffrances et disaient : Au moins, la victoire est-elle bien assurée? Les autres : Je souffre depuis huit heures, (p.88) et depuis le commencement de la bataille je suis abandonné, mais j’ai bien fait mon devoir. D’autres : Vous devez être content de vos soldats aujourd’hui. A chaque soldat blessé, l’Empereur laissait une garde qui le faisait transporter dans les ambulances. Il est horrible de le dire : quarante-huit heures après la bataille, il y avait encore un grand nombre de Russes qu’on n’avait pu panser. Tous les Français le furent avant la nuit. » La légende destinée à soutenir le moral de l’arrière s’élaborait à mesure des événements. Le lendemain de la bataille, Napoléon fut effrayé, paraît-il, par l’importance des pertes françaises. On le voit dicter, d’Austerlitz même, des ordres attribuant des pensions aux veuves et aux orphelins. Et ensuite? Ensuite Napoléon doit penser aux conditions d’un armistice avec l’ennemi vaincu et il faut penser plus loin, aux clauses du traité de paix, aux dispositions à prendre pour occuper en sûreté un pays jusqu’à ce que la paix soit vraiment assurée; en vérité un empereur chef de guerre en train de remodeler l’Europe a en tête bien d’autres soucis que le sort des blessés et des malades.
(p.106) /L’armée prussienne/
Ses généraux étaient des vieillards. En face de Napoléon, chef de la Grande Armée, 37 ans, Brunswick, général en chef prussien, en avait 71. Davout, 36 ans; Soult, Lannes, Ney, 37; en face, Hohenlohe, 60 ans; Blücher, 64; Moellendorf 81 ans. Solennité et lenteur. Pour l’armée prussienne, une étape de quatre à cinq lieues est une marche forcée, un exploit. Elle se traîne à l’allure d’escargot de ses innombrables chariots et fourgons de vivres et de matériel. A l’étape, il n’est pas question de cantonner chez l’habitant (ni de démolir un village pour se faire des abris!) : on édifie une véritable ville de tentes qu’on démonte méticuleusement le lendemain. Avant chaque départ, inspection, et le soldat doit se présenter aussi propre, aussi astiqué que pour une revue à Potsdam. La même discipline hiérarchique règne sur le champ de bataille. Les maréchaux et généraux mandarins sont persuadés que le secret de la victoire, enseigné par Frédéric II, consiste en évolutions précises, rigides, impeccables, interminables, la majesté avant tout.
(p.163) /Bataille de Friedland/
La perte “peu considérable” de l’armée française se chiffrait par 7 000 tués ou blessés. L’envers des grandes batailles est toujours le même. Devant une ambulance, installée « dans une grande maison rouge à portée de canon du champ de bataille, on jette à mesure les cadavres des blessés qui meurent en arrivant. » Percy : « Dans la chambre du rez-de-chaussée et derrière la porte, un monceau de membres coupés; le sang ruisselait de toutes parts; on entendait les cris, les gémissements, les hurlements des blessés apportés sur des échelles, des fusils, des perches; tableau déchirant, toujours le même, et auquel je ne puis m’habituer.» Même le Bulletin de la Grande Armée laissait entrevoir le prix de la victoire: “Le lendemain, le jour se leva sur l’un des champs de bataille les plus horribles qu’on put voir.» Il faisait si chaud et les cadavres d’hommes et de chevaux puaient tellement que l’ordre habituel d’enterrer les morts fut rapporté: – Traînez-les tous jusqu’à la rivière et balancez-les.
Avant l’atroce corvée, une généreuse distribution d’eau de vie. Les soldats rirent en voyant les cabrioles des morts sur les pentes du ravin.
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.232) Que disent en effet la plupart des historiens (et en particulier les historiens militaires) au sujet de cette campagne par laquelle Bonaparte est entré en fanfare dans l’Histoire? Que, dans l’esprit du Directoire (et surtout de Carnot), cette guerre d’Italie devait être une opération de diversion, destinée à permettre aux grandes armées d’Augereau et de Jourdan, qui opéraient en Allemagne, d’atteindre Vienne par la Bohême et par la vallée du Danube et qu’elle n’avait d’autre but que l’occupation du Piémont et du Milanais, mais que, grâce au « génie » de Bonaparte, ce fut l’Italie qui devint le théâtre principal de cette guerre. Or cette thèse quasi unanime, que l’on peut qualifier d’officielle, qui a été établie par Napoléon lui-même et soutenue par la quasi-totalité des historiens est fausse : on peut le montrer aisément en se référant aux instructions communiquées par les Directeurs au commandant en chef de l’armée d’Italie (et dont certaines lui furent portées à Paris, avant son départ) et au Recueil des actes du Directoire exécutif, publié par Antoine Debidour entre 1910 et 1917. Dans la campagne d’Italie, comme nous allons le voir, Bonaparte n’a pas « désobéi avec génie » aux instructions du Directoire ; bien au contraire, il les a suivies pas à pas avec rigueur et efficacité, et ce fut là son talent. Le reste n’est que légende et propagande, une propagande que Napoléon s’est empressé de diffuser par ses Relations aux Directeurs (précurseurs de ses Bulletins de la Grande Armée), par ses proclamations et, à partir du moment où il prit conscience du fait que ses succès militaires pouvaient déboucher sur des succès politiques, par des journaux qu’il fit publier dès l’été 1797 (par exemple : Le Courrier de l’armée de l’Italie, fondé le 20 juillet 1797 ; La France vue de l’armée de l’Italie, fondé le 10 août 1797 ; Journal de Bonaparte et des hommes vertueux, fondé en 1797, avec un premier numéro qui porte l’épigraphe suivante, digne d’un publicitaire moderne : « Annibal dormit à Capoue. Mais Bonaparte actif ne dort pas à Mantoue »). (p.238) La « manœuvre » de Montenotte n’a donc pas été une opération stratégique pensée et voulue par Bonaparte, qui aurait été destinée à enfoncer le centre des forces ennemies et à séparer les Sardes des Autrichiens, repoussant les premiers vers Turin et les seconds vers Milan, action que ce dernier aurait décidée en désobéissant – « avec génie » chantent ses thuriféraires aveugles – au Directoire : ce fut la réaction inévitable du général en chef à cette attaque-surprise, montée de toutes pièces par les Autrichiens pour empêcher les Français de progresser vers Ceva. Bonaparte a su y faire face avec sang-froid : le danger passé, il est revenu au plan des stratèges parisiens et il n’a jamais renvoyé les Impériaux vers Milan et les Piémontais vers Turin.
Les louanges qu’on lui tresse quant à la suite des opérations entretiennent l’imposture. Après avoir prétendu, au mépris des faits et des textes, que Bonaparte a enfoncé « génialement » le centre des forces ennemies à Montenotte pour les séparer, les napoléophiles affirment qu’il a désobéi une seconde fois au Directoire, après Montenotte, toujours avec autant de « génie », en laissant les Autrichiens se replier et en se retournant contre les Piémontais, qu’il est allé assiéger à Ceva. Or, bien au contraire, après Montenotte – qui a été interprété par Napoléon lui-même et par le Directoire comme un événement « imprévu » – Bonaparte a appliqué les directives du Bureau parisien qui lui avaient été confirmées le 7 mars (voir ci-dessus, p. 236) : ne rien faire d’essentiel qu’il n’ait d’abord pris Ceva.
Il obéit donc et ne prend aucune autre initiative. Le lendemain de Montenotte, il ordonne la reprise de la marche sur Ceva, par la vallée du Tanaro et par Millésime, comme le lui a préconisé le Directoire. Si Montenotte avait été une manœuvre soi-disant géniale, Bonaparte aurait exploité sa victoire et poursuivi les Autrichiens ; en fait, il se contente simplement de faire prendre Dego par Masséna (14-15 avril), pour couper les communications entre les Impériaux, qui sont au-delà de Dego, et les Sardes, qui sont à Ceva (voir la carte : la route la plus courte, en provenance de Dego et dans la direction de Ceva, et qui passe par Millésime, est donc interdite aux deux alliés, qui doivent utiliser, pour communiquer, la route de la plaine piémontaise, qui va jusqu’à Turin).
Quant à Ceva, vers laquelle Bonaparte fonce le 16 avril, le Directoire, qui avait primitivement envisagé son siège (voir dans (p.239) l’Annexe n° 10, p. 452, le Mémoire militaire constituant le document n° 2 cité ci-dessus), a formellement annulé cette instruction : « … Il ne doit être entrepris aucun siège avant que l’ennemi, qui pourrait l’inquiéter, ne soit totalement en déroute et hors d’état de rien tenter, et dans tous les cas, le général en chef doit bien se garder de porter sa grosse artillerie sur un point quelconque, où, par un léger succès des ennemis, elle pourrait être compromise. » (Debidour, op. cit., I, p. 722.)
Pour un officier d’artillerie comme Bonaparte, cet ordre est une absurdité. Mais il obéit encore et tente d’enlever Ceva à la baïonnette, le 16 avril : il subit un échec cuisant. Que faire ? Le dieu des guerriers le tire de ce mauvais pas : le 17 avril, le commandant en chef de l’armée sarde, le général Colli, évacue la place et n’y laisse qu’une petite garnison qui capitulera quelques jours plus tard. Ensuite, tout se passe comme par miracle : Bonaparte n’a plus qu’à lire l’Instruction qui lui a été remise le 7 mars et que nous avons citée plus haut. Elle lui laisse beaucoup plus de latitude pour agir que les deux premiers Mémoires pour l’armée d’Italie : au cas où les ennemis (les Piémontais) se retireraient vers Turin, le Directoire, dit cette Instruction, autorise le général en chef « à les suivre, à les combattre à nouveau, et même à bombarder cette capitale si nécessaire ».
(p.240) Autrement dit, sur le plan stratégique (marche des armées, déroulement chronologique des opérations) et logistique (pourvoir aux besoins des armées), il n’a été qu’un bon exécutant et il a suivi rigoureusement le plan des Directeurs, qui se disaient sans doute, déjà, que la guerre était une chose trop sérieuse pour en laisser les initiatives aux militaires ; (…).
|
2.1 La campagne d’Italie de Napoléon: vérité
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.44) Sa proclamation aux bandes qu’il va déchaîner sur la plaine du Pô, la célébrité que lui a conférée l’Histoire n’en efface pas le sens précis : « Soldats, vous êtes nus, mal chaussés, mal nourris. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur [sic], gloire et richesse ! » Deux fois les mots clés : « riches », « richesse ». On ne peut être plus clair dans le banditisme. Hardi, mes tueurs ! Voyez un peu, à notre portée, ce butin ! Les bombances que nous allons faire ! Hold-up géant ; fric-frac énorme. Ce qui s’est abattu sur l’Italie en la personne de Bonaparte, c’est très exactement un vampire. Et les neutres même — à Gênes, à Parme, à Modène, à Venise — doivent payer pour être épargnés. (un nom pour cela aussi : racket). Lettre du 9 mai 1796, Bonaparte à Carnot : « Ce que nous avons déjà pris est incalculable », et, dans cet idiome qui est le sien : « J’espère que les choses vont bien, pouvant vous envoyer une douzaine de millions » ; il ajoute qu’il lui expédie, ce jour, « quelques tableaux des premiers maîtres : Le Cor-
1. Péguy, dans sa Jeanne d’Arc de 1897 (Deuxième pièce, deuxième partie, acte II) met dans la bouche de Gilles de Rais ces paroles mêmes de Bonaparte*; Jeanne, alors : « Messire, écoutez bien ; savez-vous ce que c est que celui qui dit ça? » Gilles de Rais : « C’est le bon capitaine, celui qui parle ainsi » ; et Jeanne : « Non, Messire ; celui qui parle comme cela, c’est le dernier des hommes. »
(p.45) — car, écrit sans rire M. Louis Madelin, dans son ouvrage classique de 1935 : « Partout grand capitaine, Bonaparte agit aussi en artiste ». Entendez que, partout, il fond sur les caisses. Le 23 juin 1796, après son invasion partielle des Etats du Pape, il exige de lui, pour ne pas aller plus loin (je te prends ceci ; verse-moi telle somme ou je continue), il se fait compter, net, 21 millions d’un seul coup.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.46) Soulèvements. Répressions sauvages. Le 25 mai, Lannes est chargé de mettre le feu à toutes les maisons de Binasco, car on y a bougé contre le nouvel occupant. A Pavie, se sont réfugiés dix mille paysans fuyant les horreurs de la conquête. Ils font mine de créer là une résistance ; charges de cavalerie ; le canon tire à mitraille dans les rues. La troupe demande qu’on lui livre la ville. Accordé. Douze heures pour la mise à sac. Avis du 28 mai : « Tout village où sonnera le tocsin sera, sur-le- champ, incendié ». Massacres à Faenza, à Imola, à Vérone. Bien sûr que les envahisseurs trouvent des collaborations! Mais Bonaparte sait à quoi s’en tenir. Lettres à Paris des 26 septembre et 10 octobre 1797 : « Ces peuples nous haïssent » ; « qu’on ne s’exagère pas l’influence des prétendus patriotes piémontais, cisalpins, génois ; si nous leur retirions, d’un coup de sifflet, notre appui militaire, ils seraient tous égorgés ».
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris.
CH III LE PÔ, LE NIL, L’INDUS
(p.49) Le 23 Juin 1796, après son invasion partielle des Etats du Pape, il exige de lui, pour ne pas aller plus loin (je te prends ceci; verse-moi telle somme ou je continue), il se fait compter, net, 21 millions d’un seul coup. … La bonne méthode : « parler paix, et agir guerre ». De fait, les pauvres gens avaient cru voir surgir en Italie, avec l’armée « républicaine », des auxiliaires armés contre l’oppression des notables associés aux Autrichiens. Bonaparte les a rapidement mis au pas. C’est sur les notables qu’il s’appuie, les grands possédants toujours prêts à caresser ceux qui les protègent contre les misérables.
(p.50) A Pavie, se sont réfugiés dix mille paysans fuyant les horreurs de la conquête. Ils font mine de créer là une résistance; charges de cavalerie; le canon tire à mitraille dans les rues. La troupe demande qu’on lui livre la ville. Accordé. Douze heures pour la mise à sac. Avis du 28 mai : « Tout village où sonnera le tocsin sera, sur-le-champ, incendié ». Massacres à Faenza, à Imola, à Vérone. Bien sûr que les envahisseurs trouvent des collaborations. Mais Bonaparte sait à quoi s’en tenir. Lettres à Paris des 26 septembre et 10 octobre 1797: « Ces peuples nous haïssent » ; « qu’on ne s’exagère pas l’influence des prétendus patriotes piémontais, cisalpins, gênois ; si nous leur retirions, d’un coup de sifflet, notre appui militaire, ils seraient tous égorgés ».
(p.51) Note 1. On cite trop peu, dans les manuels, les instructions de Carnot, dès 1794 (et contre la volonté de Robespierre) à Jourdan et à Pichegru: “Montrez à vos hommes les richesses d’ l’Allemagne”; “En Belgique, prenez tout; il faut vider le pays.”
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.122) Le royaume d’Italie rapportait à son souverain 30 millions par an, inscrits au budget français ; mais ce n’était là que chiffres officiels. Napoléon a fait d’Eugène, son beau-fils, le vice-roi de l’Italie ; Eugène est un timide qui n’ose « réquisitionner » dans ce pays qu’il administre, et Napoléon le rudoie, le 22 septembre 1805 : qu’est-ce que c’est que ces scrupules imbéciles ? Des réquisitions ? Mais parfaitement ! « j’en fais bien en Alsace ». La suite est magnifique : « tout est si cher qu’il ne faut pas songer à payer ». Allez ! Allez ! Prenez ! « on crie, mais c’est sans importance ». Lorsque l’on remuait sous sa botte, il donnait des coups de talon ; le 26 août 1806, il a fait fusiller un libraire de Nuremberg, Palm, coupable de diffuser des brochures en faveur de la résistance ; et, quinze jours après avoir nommé Joseph roi de Naples, il lui écrivait (2 mars 1806) : « Mettez bien ceci dans vos calculs que [d’un moment à l’autre] vous aurez une insurrection ; cela se produit toujours en pays conquis » ; mais quand on sait s’y prendre, les émeutes de mécontents, cela r s’écrase sans peine ; quelques exemples, des représailles, deux ou trois Oradour et c’est réglé. Tenez, i lui dit-il, moi, « Plaisance s’étant insurgé, j’ai envoyé l’ordre de faire brûler deux villages et de passer par les armes les chefs, y compris six prêtres ; le pays fut soumis, et il le sera pour longtemps ». Vos révoltés de Calabre, faites-en exécuter (p.123) « au moins 600 » ; « faites brûler leurs maisons, faites piller cinq ou six gros bourgs ». Voilà la méthode, bien simple.
Un document vient de m’être mis sous les yeux ; c’est une lettre de Berthier, « prince de Wagram et de Neufchâtel », au maréchal Soult, 7 septembre 1807 : « L’empereur me charge […] de vous expédier un courrier extraordinaire pour vous faire connaître l’événement arrivé à Koenigsberg où deux comédiens, paraissant sur le théâtre en officiers français, ont été sifflés. Sa Majesté a fait demander satisfaction de cette insulte au roi de Prusse, et que les deux principaux coupables soient fusillés ». « L’épopée » napoléonienne, gluante de sang, ne revêt toute sa dimension que si des chiffres l’accompagnent. Austerlitz ? 23 000 morts ; mais, quand on a le cœur bien placé, les cadavres d’Austerlitz disparaissent dans le soleil du même nom. Eylau ? 50 000 hommes tombent. Wagram ? Napoléon y bat son propre record (55 000 tués), qu’il surpassera à Borodino, gala qui coûte aux deux armées quelque 80 000 soldats. Sur les services sanitaires dans l’armée impériale, il faut lire le journal du chirurgien Percy : le matériel est dérisoire, le personnel presque inexistant ; les amputations se pratiquent sans anesthésie ; la gangrène s’installe ; le blessé grave, dans la Grande Armée, est un condamné à mort ; Napoléon a interdit, du reste, de relever, pendant l’action, les hommes qui s’écroulent ; il se méfie des déserteurs, dont le nombre se multiplie. Mais (p.124) ne ternissons pas avec d’aussi misérables détails la « Chanson de geste » chère à M. Louis Madelin, lequel déclarait, dans son grand ouvrage « La France de l’Empire », réédité en 1960 par le Cercle Historia : « Mêlées, blessures, pour le soldat de l’empereur, tout cela n’est rien ; la bataille est une fête ».
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p13) On a chanté sa « géniale » campagne d’Italie: c’est faux, ce ne fut pas sa campagne mais celle de Carnot, Bonaparte n’a fait qu’obéir, scrupuleusement, aux ordres stratégiques que lui envoyaient chaque jour ce dernier et le Directoire. On l’a célébré comme l’homme qui a fait signer le traité de Campo-Formio à l’Autriche et mis fin aux guerres de la première coalition: c’est vrai, mais elles se continuèrent par celles de la deuxième coalition, sa réorganisation de l’Italie s’écroula et, tout compte fait, Campo-Formio fut un fiasco. Et ainsi de suite; nous tentons de montrer, dans ce livre, que Napoléon a été un bien mauvais homme de guerre, et qu’on peut lui appliquer, en la renversant, la phrase de de Gaulle sur la défaite de la France, en 1940 : Napoléon a gagné (ou, plus précisément, ses généraux ont gagné) beaucoup de batailles, mais il a perdu toutes ses guerres : la campagne d’Egypte, la guerre d’Espagne, la campagne de Russie et la catastrophique campagne de France. |
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.232) Que disent en effet la plupart des historiens (et en particulier les historiens militaires) au sujet de cette campagne par laquelle Bonaparte est entré en fanfare dans l’Histoire? Que, dans l’esprit du Directoire (et surtout de Carnot), cette guerre d’Italie devait être une opération de diversion, destinée à permettre aux grandes armées d’Augereau et de Jourdan, qui opéraient en Allemagne, d’atteindre Vienne par la Bohême et par la vallée du Danube et qu’elle n’avait d’autre but que l’occupation du Piémont et du Milanais, mais que, grâce au « génie » de Bonaparte, ce fut l’Italie qui devint le théâtre principal de cette guerre. Or cette thèse quasi unanime, que l’on peut qualifier d’officielle, qui a été établie par Napoléon lui-même et soutenue par la quasi-totalité des historiens est fausse : on peut le montrer aisément en se référant aux instructions communiquées par les Directeurs au commandant en chef de l’armée d’Italie (et dont certaines lui furent portées à Paris, avant son départ) et au Recueil des actes du Directoire exécutif, publié par Antoine Debidour entre 1910 et 1917. Dans la campagne d’Italie, comme nous allons le voir, Bonaparte n’a pas « désobéi avec génie » aux instructions du Directoire ; bien au contraire, il les a suivies pas à pas avec rigueur et efficacité, et ce fut là son talent. Le reste n’est que légende et propagande, une propagande que Napoléon s’est empressé de diffuser par ses Relations aux Directeurs (précurseurs de ses Bulletins de la Grande Armée), par ses proclamations et, à partir du moment où il prit conscience du fait que ses succès militaires pouvaient déboucher sur des succès politiques, par des journaux qu’il fit publier dès l’été 1797 (par exemple : Le Courrier de l’armée de l’Italie, fondé le 20 juillet 1797 ; La France vue de l’armée de l’Italie, fondé le 10 août 1797 ; Journal de Bonaparte et des hommes vertueux, fondé en 1797, avec un premier numéro qui porte l’épigraphe suivante, digne d’un publicitaire moderne : « Annibal dormit à Capoue. Mais Bonaparte actif ne dort pas à Mantoue »).
(p.238) La « manœuvre » de Montenotte n’a donc pas été une opération stratégique pensée et voulue par Bonaparte, qui aurait été destinée à enfoncer le centre des forces ennemies et à séparer les Sardes des Autrichiens, repoussant les premiers vers Turin et les seconds vers Milan, action que ce dernier aurait décidée en désobéissant – « avec génie » chantent ses thuriféraires aveugles – au Directoire : ce fut la réaction inévitable du général en chef à cette attaque-surprise, montée de toutes pièces par les Autrichiens pour empêcher les Français de progresser vers Ceva. Bonaparte a su y faire face avec sang-froid : le danger passé, il est revenu au plan des stratèges parisiens et il n’a jamais renvoyé les Impériaux vers Milan et les Pié-montais vers Turin. Les louanges qu’on lui tresse quant à la suite des opérations entretiennent l’imposture. Après avoir prétendu, au mépris des faits et des textes, que Bonaparte a enfoncé « génialement » le centre des forces ennemies à Montenotte pour les séparer, les napoléophiles affirment qu’il a désobéi une seconde fois au Directoire, après Montenotte, toujours avec autant de « génie », en laissant les Autrichiens se replier et en se retournant contre les Piémontais, qu’il est allé assiéger à Ceva. Or, bien au contraire, après Montenotte – qui a été interprété par Napoléon lui-même et par le Directoire comme un événement « imprévu » – Bonaparte a appliqué les directives du Bureau parisien qui lui avaient été confirmées le 7 mars (voir ci-dessus, p. 236) : ne rien faire d’essentiel qu’il n’ait d’abord pris Ceva. Il obéit donc et ne prend aucune autre initiative. Le lendemain de Montenotte, il ordonne la reprise de la marche sur Ceva, par la vallée du Tanaro et par Millésime, comme le lui a préconisé le Directoire. Si Montenotte avait été une manœuvre soi-disant géniale, Bonaparte aurait exploité sa victoire et poursuivi les Autrichiens ; en fait, il se contente simplement de faire prendre Dego par Masséna (14-15 avril), pour couper les communications entre les Impériaux, qui sont au-delà de Dego, et les Sardes, qui sont à Ceva (voir la carte : la route la plus courte, en provenance de Dego et dans la direction de Ceva, et qui passe par Millésime, est donc interdite aux deux alliés, qui doivent utiliser, pour communiquer, la route de la plaine piémontaise, qui va jusqu’à Turin).
Quant à Ceva, vers laquelle Bonaparte fonce le 16 avril, le Directoire, qui avait primitivement envisagé son siège (voir dans (p.239) l’Annexe n° 10, p. 452, le Mémoire militaire constituant le document n° 2 cité ci-dessus), a formellement annulé cette instruction : « … Il ne doit être entrepris aucun siège avant que l’ennemi, qui pourrait l’inquiéter, ne soit totalement en déroute et hors d’état de rien tenter, et dans tous les cas, le général en chef doit bien se garder de porter sa grosse artillerie sur un point quelconque, où, par un léger succès des ennemis, elle pourrait être compromise. » (Debidour, op. cit., I, p. 722.)
Pour un officier d’artillerie comme Bonaparte, cet ordre est une absurdité. Mais il obéit encore et tente d’enlever Ceva à la baïonnette, le 16 avril : il subit un échec cuisant. Que faire ? Le dieu des guerriers le tire de ce mauvais pas : le 17 avril, le commandant en chef de l’armée sarde, le général Colli, évacue la place et n’y laisse qu’une petite garnison qui capitulera quelques jours plus tard. Ensuite, tout se passe comme par miracle : Bonaparte n’a plus qu’à lire l’Instruction qui lui a été remise le 7 mars et que nous avons citée plus haut. Elle lui laisse beaucoup plus de latitude pour agir que les deux premiers Mémoires pour l’armée d’Italie : au cas où les ennemis (les Piémontais) se retireraient vers Turin, le Directoire, dit cette Instruction, autorise le général en chef « à les suivre, à les combattre à nouveau, et même à bombarder cette capitale si nécessaire ».
(p.240) Autrement dit, sur le plan stratégique (marche des armées, déroulement chronologique des opérations) et logistique (pourvoir aux besoins des armées), il n’a été qu’un bon exécutant et il a suivi rigoureusement le plan des Directeurs, qui se disaient sans doute, déjà, que la guerre était une chose trop sérieuse pour en laisser les initiatives aux militaires ; (…).
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.397) Reste Marengo : ce fut sa première imposture militaire. Il dormait profondément, à quelques kilomètres de cette plaine, qui semble avoir été créée pour servir de champ de bataille, lorsqu’il fut réveillé par le bruit d’une canonnade : c’étaient les Autrichiens du général Mêlas qui attaquaient. Surpris, car il pensait prendre l’initiative du combat, Bonaparte dut faire face à l’offensive autrichienne (à 14 heures), mais la bataille est perdue et, à 17 heures, il se voit contraint d’ordonner la retraite. Mêlas poursuit mollement Bonaparte et l’armée française en déroute ; mais, à la fin de la journée, Desaix et ses troupes « fraîches » rejoignent le Premier Consul ; et celui-ci se décide alors à livrer aux Autrichiens un combat d’arrière-garde : Desaix est tué d’une balle en plein front mais le général de brigade Kellermann lance une charge vigoureuse et audacieuse sur l’ennemi, et les Autrichiens s’enfuient. Bonaparte est sauvé presque par hasard ; dans le communiqué officiel – qu’il dut remanier quatre fois pour lui donner un semblant de consistance -il présente cette victoire inespérée, due à Desaix et Kellermann, comme une manœuvre géniale de sa part. Mais Desaix était mort : il ne risquait pas de le contredire.
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.456-457) annexe n° 11 Le pillage de l’Italie
Nous avons tenté de démontrer, dans ce livre, que la brillante et victorieuse campagne d’Italie est à porter au crédit de Carnot et des Directeurs, qui la dirigèrent à distance, et non pas à Bonaparte, qui ne fit qu’exécuter docilement les ordres reçus. C’est aussi le Directoire qui ordonna le pillage méthodique de l’Italie, crime de guerre dont Bonaparte ne fut que l’exécutant. Voici l’ordre (cynique) qu’il reçut à cet effet, daté du 7 mai 1796 (il le reçut le 14 ou le 15 mai). Le texte est extrait de Debidour, op. cit., II, p. 333. Il n’est pas impossible que l’idée de voler les richesses artistiques italiennes ait d’abord germé dans l’esprit de Bonaparte et que cette lettre soit, non pas un ordre, mais une autorisation de pillage. « Le Directoire exécutif est persuadé, citoyen général, que vous regardez la gloire des beaux-arts comme attachée à celle de l’armée que vous commandez. L’Italie leur doit en grande partie ses richesses et son illustration ; mais le temps est arrivé où leur règne doit passer en France pour affermir et embellir celui de la liberté. Le Musée national [l’ancêtre de notre musée du Louvre, créé en 1793 et installé dans la grande galerie du Louvre] doit renfermer les monuments les plus célèbres de tous les arts, et vous ne négligerez pas de l’enrichir de ceux qu’il attend des conquêtes actuelles de l’armée d’Italie et de celles qui lui sont encore réservées. Cette glorieuse campagne, en mettant la République en mesure de donner la paix à ses ennemis, doit encore réparer les ravages du vandalisme en son sein et joindre à l’éclat des trophées militaires le charme des arts bienfaisants et consolateurs.
Le Directoire exécutif vous invite donc à rechercher, à recueillir et à faire transporter à Paris les objets de ce genre les plus précieux et à donner des ordres précis pour l’exécution éclairée de ces dispositions dont il désire que vous lui rendiez compte. letourneur, carnot, la révellière-lépeaux » |
|
Silvia Dell’ Orso, Ritornano in Italia le opere d’arte trafugate all’ estero, in : Gente, 14/12/2006, p.84-88
(p.88) Non è una novità che tanti capolavori d’arte vengano rubati e trafugati. I furti e le esportazioni clandestine sono una piaga antica e non solo in Italia: dalle opere d’arte sottratte corne bottino di guerra alle razzie napoleoniche (l’Incoronazione di spine di Tiziano, proveniente da Santa Maria delle Grazie a Milano e la Madonna della Vittoria del Mantegna, da Mantova, testimoniano ancora oggi al Louvre la consistenza di quelle spoliazioni), razzie compiute con una sistematicità non dissimile da quelle effettuate dai tedeschi nell’ultima guerra, fino a portarsi via straordinar! capolavori con la motivazione di poterli tutelare meglio.
|
|
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988
(p.51) In testimony of this fraternity, and to fulfil the solemn pledge of respecting property, this very proclamation [of Milan] imposed on the Milanese a provisional contribution to the amount of twenty millions of livres, or near one million sterling; and successive exactions were levied on that single state to the amount, in the whole, of near six millions sterling. The regard to religion and to the customs of the country were manifested with the same scrupulous fidelity. The churches were given up to indiscriminate plunder. Every religious and charitable fund, every public treasure was confiscated. The country was made the scene of every species of disorder and rapine. The priests, the established form of worship, all the objects of religious reverence, were openly insulted by the French troops …
The Prime Minister continued: But of all the disgusting and tragical scenes which took place in Italy, in the course of the period I am describing, those which passed at Venice are perhaps the most striking. He accused the French of deliberately goading the Venetians into rising against them and into issuing a proclamation hostile to France, Napoléon had then invaded Venice, installing a govern- ment on the ‘démocratie’ French model, which he guaranteed with a treaty. Pitt States, accurately, that as soon as the treaty had been signed the French sacked and plundered the Arsenal and the Doges’ Palace, besides demanding huge sums in cash from the inhabitants.
(p.52) Understandably, the Directory were extremely uneasy about General Bonaparte. Not only was he hero-worshipped but he had shown alarming independence, ignoring its instructions – as when he demanded the surrender of Lombardy by the Austrians or declared war on Venice. Not only had he kept semi-regal state in his headquarters in the castle outside Milan, dining in public and never emerging without an escort of 300 lancers, but he had paid journalists to project his image to the French at home as well as among his men in the field. The Courrier de l’Armée d’Italie (on sale in Paris, and distributed free to soldiers) praised the exploits and personality of ‘The First General of the Great Nation.’ Other newspapers which he subsidized wrote in the same strain.
|
| Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
(p. 126-127) Après avoir nommé Joseph roi de Naples en 1806, il lui écrivit: « Vos révoltés de Calabre, faites-en exécuter « au moins 600 »; « faites brûler leurs maisons, faites piller cinq ou six gros bourgs. »
|
2.2 Napoléon à la conquête de l’Egypte et de l’Empire turc: vérité

(Stern, 22/01/2015)
|
Guy Duplat, Bonaparte et le flop d’Egypte, in : LB 10/01/2009
/Au Caire, / la fronde est écrasée, Bonaparte faisant foudroyer une mosquée par ses canons. (…) A Jaffa, les combats contre les troupes ottomanes sont rudes. De rage, les Français égorgent 3 000 prisonniers sans défense. (…) Si, sur le plan militaire, ce fut un désastre (11 000 morts et blessés), Napoléon s’emploiera avec succès à transformer ces années en épopée.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969
LE NIL, L’INDUS
(p.52-53) “Le sort de la France, nous le savons, n’a d’intérêt pour lui qu’en fonction de ses profits personnels.”
(p.57) (…) mais je sais aussi que telle lettre, intime, de Talleyrand à Mme Grand – celle que Napoléon l’obligera à prendre pour femme contient cette indication curieuse : l’affaire égyptienne est montée « pour favoriser mes amis anglais » (les « faveurs » de Talleyrand sont chaque fois payées leur prix, qui est cher). Et comment expliquer la note secrète du ministre de Prusse à Paris, signalant à son gouvernement, le 22 février 1798, que les Anglais – il le tient de Talleyrand lui-même – n’enverront pas de bateaux pour couper à Bonaparte le chemin de l’Egypte? D’où, effectivement, la traversée « miraculeuse » du général.
CH IV LE COUP DE BRUMAIRE
(p.59) LES ANGLAIS AVAIENT DONC LAISSÉ PASSER LA FLOTTE française amenant en Egypte le corps expéditionnaire, mais pour enfermer ces soldats dans une souricière. Le 1er août 1798, devant la rade d’Aboukir, Nelson anéantit l’armada (miniature) de Bonaparte, lequel ne s’en trouble pas beaucoup; il n’a pas l’intention de regagner la France. Page tournée, son séjour chez les Gaulois. Ses convoitises ont maintenant pour objet les trésors de l’Asie. Il a maté les Egyptiens par les moyens usuels: bombardement de la mosquée du Caire, exécutions persuasives en série (parfois seulement « pour avoir mal parlé des Français»), répression foudroyante d’un mouvement de fellahs.
(p.66) Bonaparte a convoqué Kléber à Aboukir pour le 24 août, parce qu’il a décidé de s’embarquer lui-même, en tapinois, le 23. Quand KIéber arrive au rendez-vous, le 24, plus de général en chef. Il est parti; mais en lui laissant – témoignage de confiance – les pleins pouvoirs, à sa place (il les lui délègue fraternellement), en Egypte, à la tête d’une armée coincée, délabrée par les ophtalmies purulentes et la dysenterie amibienne, sans parler du reste, déçue et hargneuse dans un pays qu’on a déjà trop pressuré et qui est prêt à la révolte. KIéber, on le sait, s’y fera égorger l’année suivante. (p.67) Aucun intérêt: ou plutôt, c’est fort bien. Mais le « désordre » de l’Etat ? Mais l’ « anarchie » endémique ? Mais l’expansion industrielle stoppée? Chacun sait, d’après les bons historiens, que, si Bonaparte ne fût point survenu, tout allait à l’abîme. Or, en 1799, précisément, la balance commerciale de la France s’établissait comme suit : importations: 253 millions; exportations: 300 millions. Et en ce qui concerne l’anarchie, écoutons Napoléon Bonaparte en personne (à Bertrand, 22 décembre 1816); Bertrand, qui répète les propos convenus, disait: Sans votre retour d’Egypte, n’est-ce pas, Sire, la France était perdue ? et « l’empereur » en veine de sincérité – tout cela est loin, maintenant! – l’éclaire: Mais non! Mais pas du tout!
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.54) Le 20 février 1819, il ne cachera point à Bertrand qu’il vivait, là-dessus, d’illusions : « Je n’aurais pas fait l’expédition d’Egypte si je n’avais pas été trompé sur les richesses du pays. Je croyais trouver là trois cents millions, et tout le monde le croyait comme moi ; les savants même n’y sont venus que dans cette pensée ». Laissons à Bonaparte la responsabilité de ce mot de la fin. Agir pour autre chose que le profit est pour lui incompréhensible et par conséquent irréel.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.55) Il a maté les Egyptiens par les moyens usuels : bombardement de la mosquée du Caire, exécutions persuasives en série (parfois seulement « pour avoir mal parlé des Français »), répression foudroyante d’un mouvement de fellahs. Bonaparte a fait venir du Delta des sacs remplis de têtes coupées que l’on (p.56) déverse, au Caire, sur la Grand-Place, pour l’édification des spectateurs et de manière à leur inspirer, à l’égard de l’occupant, la docilité et l’amour. Les mameluks étant les exploiteurs locaux, le général les dénonce comme des sangsues à la population mais les remplace par ses propres percepteurs, et ordonne l’établissement d’un cadastre qui lui permettra de taxer, sans rien omettre, la propriété foncière. Il s’est jovialement amusé à faire le musulman pour tenter d’avoir avec lui ces prêtres qu’écoutent volontiers, dans tous les pays du monde, les imbéciles. Le Moniteur du 27 novembre 1798 rapportera ses paroles : « Le divin Koran fait les délices de mon esprit et l’attention de mes yeux. J’aime le prophète et je compte, avant qu’il soit peu, aller voir et honorer son tombeau dans la ville sainte de La Mecque […]. Malheur, trois fois malheur à ceux qui recherchent les richesses périssables et qui convoitent l’or et l’argent, choses semblables à la boue […] Muphtis, imans, ulémas, derviches, instruisez le peuple d’Egypte. Encouragez-le à se joindre à nous; favorisez le commerce des Francs dans vos contrées [Talleyrand lui a confié quelques sommes à faire fructifier de la sorte] et leur entreprise pour parvenir d’ici à l’ancien pays de Brahma [nous y voilà !] »
|
|
in : Guy Tholl, Napoléon Bonaparte en Egypte, Le feu et la lumière, LW 01/07/2010
« La mosquée Al-Azhar n’échappe pas à la profanation et au saccage. » « Si les Cairotes avouent que certains travaux améliorent leur vie, ils condamnent ceux qui entraînent la destruction de monuments anciens, dont des mosquées. »
|
|
Napoleon und seine Zeit, 1769-1821, in: Geo Epoche, 55, 2012
/Ägypten/ (S.51) Einige Tage nach der Landung bricht Bonaparte in Richtung Kairo auf. Bereits auf diesem ersten Marsch durch die Wùste erdulden seine Soldaten Strapazen, die ihnen als Warnung dienen vor den zukünftigen Härten des Feldzuges. Um auch seinen Kàmpfern keinerlei Hinweis auf das Expeditionsziel zu liefern, batte Bonaparte keine Wasserflaschen an die Truppen ausgeben lassen. In wollenen Uniformen schleppen sich die Mànner nun durch den Sand. Bald schieften sich die ersten Verzweifelten eine Kugel in den Kopf, andere stûrzen sich beim Anblick des Nil ins Wasser und ertrinken unter ihrer schweren Ausrùs-tung. Nachzügler werden von Beduinen angegriffen.
(S.53) Die französischen Soldaten zollen den jahrtausendealten Monumenten /= die Pyramiden/ wenig Respekt. Sie ritzen ihre Namen in den Kalkstein, rollen Blöcke von den Pyramiden, um zu sehen, wie weit sie fallen. Einige versuchen, ihre Pferde bis zur Spitze zu reiten, andere fuernmit Waffen auf die Monumente. (…)
Die Soldaten der Revolutionsarmee treffen in Kairo auf strenggläubige Mus-lime. Und europäische Frauen auf eine rigide Moral: Hunderte Franzôsinnen sind mit der Armée nach Ägypten gekommen, zumeist Wascherinnen und Näherinnen, aber auch Ehefrauen und Matressen von Offizieren. Unverschleiert laufen sie herum, reiten gar auf Pferden und Eseln; schon beginnen einige ägyptische Töchter, die Fremden nachzuahmen. Auch Bonapartes Reitersoldaten erregen Unmut in ihren grûnen Uniformen – der Farbe, die dem Propheten und seinen Nachfahren vorbehalten ist. Da nützt es wenig, dass Bonaparte in seinen Ansprachen an die Ägypter aus dem Koran zitiert und die einheimischen Religionsgelehrten an der Hauptmoschee untersuchen lässt, wie er und (S.54) seine Armee zum Islam übertreten könnten, ohne sich beschneiden lassen und auf Alkohol verzichten zu müssen.
Denn hart lässt er gleichzeitig die Wohlhabenden besteuern. Damit der Verkehr besser fliesst und seine Soldaten sich bei Gefahr schneller durch die Stadt bewegen können, reissen seine Leute die traditionellen Tore zwischen den Stadtvierteln Kairos ein. Unterdessen ruft der Sultan von Konstantinopel zum Heiligen Krieg gegen die Eindringlinge auf. Seine Botschaft verkünden die Imame jeden Freitag in den Moscheen. Jeder kann es hören. Doch als der Aufstand am 21. Oktober losbricht, sind die Franzosen unvorbereitet. (…) Denon zerschmettert einige Steinfliesen der Terrasse, um mögliche Eindringlinge damit zu erschlagen. Endlich beginnen die Kanonen von der nahen Zitadelle zu schiefien, wo französische Soldaten stationiert sind: Bonaparte lässt die Viertel um die grosse al-Azhar-Moschee zerstören, zum Schluss das Gotteshaus selbst stürmen und die dort verschanzten Aufstàndischen tôten. Ei- nige Savants schleichen sich im Getümmel in die Moschee, uni wenigstens ein paar kostbare Koranausgaben zu retten. Nach zweitägigem Kampf sind 300 Europäer und rund 3000 Ägypter tot. Die Rebellion hat den Franzosen unmissverständlich klargemacht, wie die meisten Einheimischen sie sehen: nicht als Befreier, sondern als Besatzer.
|
|
Napoleon: a paedophile / Napoléon: un PEDOPHILE / Napoleon een pedofiel (in: De Morgen)
Bril Martin, Napoleons laatste verovering, De Morgen 11/12/2004 De bevrijding van Egypte
Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee. (…) Napoleon kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maitresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een MAAGD VAN TWAALF (= une vierge de 12 ans, a 12-YEAR-OLD VIRGIN), hem aangeboden door de sultan van Caïro.
Bril Martin, /La dernière conquête de napoléon/, De Morgen, 11/12/04 La libération de l’Egypte Jusque tard dans le courant du 19e siècle parurent encore des catalogues mentionnant les richesses emportées d’Egypte par les Français. Le Louvre en possède toujours la plus grande partie. (…) Napoléon apprit que Joséphine la trompait. fait plus grave encore, ses lettres exprimant sa colère à ce sujet furent interceptées en mer par les Anglais et publiées dans un journal. En compensation, il prit une maîtresse, qui, déguisée en homme, était partie avec les troupes, après qu’il eut d’abord essayé /de faire l’amour/ avec une VIERGE DE DOUZE ANS, offerte par le sultan du Caire.
|
|
Paul Fleuriot de Langle, Général Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène 1818-1819, éd. Albin Michel, 1959
(p.305) » Je n’aurais pas fait l’expédition d’Egypte si je n’avais été trompé : 1° — Sur les richesses du pays : Je croyais trouver là 300 millions, plus de richesses qu’en Italie. Tout le monde le croyait. Les savants eux-mêmes n’y sont venus que dans cette persuasion. Qui n’aurait pas cru Magallon qui avait résidé vingt ans dans ce pays? Alexandrie n’était pas beau, mais Damanhour me frappa d’étonnement, lorsqu’on me conduisit dans l’écurie où était Desaix :
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.294) (…), le comportement de Bonaparte en Egypte mérite qu’on s’y arrête. La proclamation à son armée, qu’il rédigea à bord de l’Orient le 22 juin 1798 (voir Annexe n° 16, p. 467) est une merveille d’hypocrisie. Il y expose les raisons officielles de l’expédition : détruire la puissance des 470 beys mamlouks, qui favorisent exclusivement le commerce anglais (l’Egypte était une province de l’Empire ottoman ; les beys étaient des gouverneurs de provinces appartenant à l’ancienne dynastie turque des mamlouks) ; mais surtout il prodigue à ses soldats des conseils sur la manière de se comporter avec des musulmans qui ne manquent pas d’intérêt.
|
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.295) Enfin, il faut dire deux mots des savants et des artistes que Bonaparte emmena avec lui sur les bords du Nil. Les napoléophiles s’extasient sur cette initiative ; la première du genre remontait à Alexandre le Grand, elle n’avait rien que de très banal à l’époque ; quant à la plupart des grandes expéditions commerciales ou militaires du XVIIIe siècle, qui fut le siècle de la glorification de la science, ont eu leurs cohortes de géographes, de linguistes, de botanistes, de zoologistes, de géologues, de médecins, de dessinateurs ; l’originalité de l’expédition de 1798 fut d’avoir été une expédition militaire, financée par l’État, donc disposant de moyens importants, que n’avaient ni les Cook, ni les Bougainville, ni les Lapérouse. Mais, bien que la création de l’Institut d’Egypte par Napoléon fût une décision culturelle majeure, il est faux de dire que l’égyptologie est née avec la campagne d’Egypte. Les Anciens s’étaient déjà extasiés sur les temples et sur les pyramides, et, en ce qui concerne le déchiffrement des hiéroglyphes, il a commencé vers 1650, avec les travaux du jésuite allemand Athanase Kircher ; l’expédition d’Egypte a tout simplement fourni aux orientalistes une documentation plus abondante, qui leur a permis de percer les secrets de l’écriture des anciens Égyptiens, qui intriguait tant les Grecs. (p.296) Oublions les massacres, les pestiférés de jaffa euthanasiés à l’opium (…). |
|
Yves Benot, La démence coloniale sous Napoléon, La découverte, 2006
(p.20) Kléber, écrasant l’armée turque à Héliopolis en mars 1800
|
|
Martin Bril, Napoleons laatste verovering, De Morgen 11/12/2004
De bevrijding van Egypte
Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee. (…) Napoleon kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maitresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een maagd van twaalf, hem aangeboden door de sultan van Caïro. |
|
Arturo Pérez-Reverte, Una intifada de navaja y macetazo, EP 20/04/2008
Guerre de la independencia – La sublevación del 2 de mayo
|
|
Martin Bril, Napoleons laatste verovering, in: De Morgen 11/12/2004
Met is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte zich tot keizer van de Fransen kroonde. Kort daarop lag Europa aan zijn voeten. Tien jaar later ging de kleine keizer bij Waterloo ten onder en de rest van zijn leven sleet hij op Sint-Helena. Martin Bril had nooit iets met het verleden, tot hij toevallig een boek over Napoleon las. Hij werd getroffen door zijn grote aspiraties, daadkracht, eenzaamheid en militair vernuft en ging op zoek naar de sporen van Napoleon in het moderne Europa. Na een museum wilde hij er nog tien zien, na een slagveld wilde hij alle slagvelden bekijken, na tien boeken over Napoleon wilde hij alles over Napoleon lezen. Over zijn passie doet hij een jaar lang verslag.
De bizarste episode in het verhaal van Napoleon is zijn verblijf in Egypte, een land waar ik zelf ook graag naartoe zou willen. In gezelschap van een groot aantal wetenschappers, artsen, historici, taalkundigen, ingenieurs en 30.000 soldaten liet Bonaparte zich in het najaar van 1797 de Middellandse Zee overvaren om dat land te veroveren, of, zoals hij het liever noemde: te bevrijden.
Er waren verschillende redenen voor de Egyptische expeditie. Ten eerste was Egypte strategisch gelegen. Met de verovering van het land hoopten de Fransen de Engelsen een hak te zetten. Vanuit Egypte kon doorgestoten worden naar India, waar de basis van Engelands rijkdom lag. Door eventueel een kanaal te graven (het Suezkanaal), dat er later pas kwam) kon Engelands hegemonie op zee worden gebroken. Ten tweede was er voor Napoleon in Frankrijk even niets te doen. Hij was een uiterst populaire generaal, de held van de Italiaanse campagnes en de man die de revolutie had gered, maar nog niet populair (en georganiseerd] genoeg om een coup te plegen. Zijn tegenstanders in de regering wilden van hem af, hijzelf wilde elders, en het liefst zonder veel moeite, nieuwe overwinningen boeken. Ten derde had Napoleon een zwak voor het geheimzinnige Midden-Oosten, de Oriënt met zijn sultans, pasja’s, islam en raadselachtige vrouwen. Zijn grote held Alexander de Grote had er zijn triomfen gevierd. Dus hij voer uit. En kwam aan.
Het kostte het Franse expeditieleger nog niet eens zo heel veel moeite om Egypte onder de knie te krijgen, al was de dorst onvoorstelbaar. Volledig bepakt en gekleed op een Europese winter sjouwden de Franse soldaten door de Egyptische woestijn, zonder water en met alleen droge biscuits om te eten. Velen werden krankzinnig, anderen schoten zichzelf dood, maar Napoleon hield het hoofd koel. Door dorst voortgedreven kregen zijn mannen de stad Alexandria binnen een dag op de knieën en Caïro viel na de beroemde slag bij de piramiden (« veertig eeuwen geschiedenis kijkt op jullie neer! », spoorde Bonaparte zijn troepen aan). Amper binnengetrokken in de hoofdstad liet de overwinnaar aan de bevolking weten dat hij de islam eerbiedigde, al kon hij zijn troepen het eten van onrein vlees niet verbieden, laat staan dat hij al zijn mannen kon laten besnijden.
Er volgde een periode van rust. De wetenschappers in het gezelschap van Napoleon (« burgers en ezels in het midden », riepen de soldaten aïs ze werden aangevallen en ter verdediging hun beroemde carrés vormden) gingen aan de slag. Ze bouwden ziekenhuizen, legden rioleringen aan, ontmantelden piramiden op zoek naar sarcofagen en hiërogliefen, brachten het land in kaart, ontwierpen een nieuw bestuurlijk systeem en verzamelden alles wat los en vastzat. Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee.
Voor Napoleon persoonlijk was er slecht nieuws. Hij kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maîtresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een maagd van twaalf, hem aangeboden door de sultan van Cairo.
Toen kwamen de problemen. Allereerst waren er de problemen in het thuisland: Frankrijk was opnieuw in oorlog verwikkeld. Dat was nog tot daar aan toe, maar de Turken maakten van de gelegenheid gebruik om de Fransen in Egypte aan te vallen. Ten derde was Napoleons vloot door de Engelsen vernietigd, zodat hij Egypte niet meer kon verlaten. Nou ja, hijzelf en een handjevol getrouwen nog wel, maar zijn leger niet meer. De meest directe dreiging vormden de Turken, en aïs verdediging koos Napoleon voorde aanval. Hij verwachtte de vijand op twee fronten, over zee en via Syrie en Palestina. Om ze het hoofd te bieden trok hij hen tegemoet, door de Sinaïwoestijn, Gaza en verder noordwaarts tot Jaffa en de voet van de Golanhoogte.
De tocht was een nachtmerrie. Geen water. Geen paarden. Kamelen die doodgingen. Geen eten. Honderden soldaten stierven, of pleegden zelfmoord, wederom. In het noorden van Gaza moesten ze een fort belegeren dat zich maar niet overgaf, wat oponthoud opleverde dat later dramatisch uit zou pakken. Jaffa namen de Fransen moeiteloos in, maar alle vierduizend Turken die zich overgaven, liet Napoleon executeren, omdat hij zogenaamd geen eten voor hen had. Om munitie te sparen moest het gebeuren met de hand en de bajonet. Soldaten dreven vrouwen en kinderen de zee in tot ze verdronken. De dag daarna strafte God de Fransen met een pestepidemie: duizenden soldaten werden ziek, honderden stierven.
Om het moreel van zijn troepen op te krikken bezocht Napoleon na een paar dagen het pesthuis. Hij stond erop te assisteren bij het afvoeren van een soldaat die zojuist overleden was. Hij praatte met andere patiënten, hij raakte ze aan, hij gaf ze water. De officieren van zijn staf die hem vergezelden, waren ontzet en verbijsterd. Ze wisten zeker dat ze binnenkort geen generaal meer hadden, maar Napoleon kreeg natuurlijk niets. Het bezoek aan de pestkolonie in Jaffa resulteerde later in een beroemd schilderij, van Gros, als ik me niet vergis, waarop Bonaparte bijna aïs een soort Jezus staat afgebeeld Jezus bij de lepralijders, Jezus die Lazarus uit de dood wekte en over water kon lopen.
In de weken daarop leverden de Franse troepen verbeten slag om een iets noordelijker gelegen havenstad, Acre. Ze kregen de stad niet in handen omdat de Engelsen van uit zee het garnizoen steunden. Intussen rukten vanuit Syrie de Turken op die Napoleon een paar keer moeiteloos versloeg, bijna tussen de bedrijven door, maar toch voerde hij een verloren oorlog, en uiteindelijk brak hij het beleg van Acre op en trok hij zijn troepen terug naar Egypte. De soldaten die aan de pest leden en in Jaffa zaten, liet hij een genadeschot geven, en niet veel later ontvluchtte hij in zijn eentje zijn geliefde Oriënt om net op tijd in Frankrijk terug te komen om er de macht te grijpen.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.61) Dans le plus grand secret, Bonaparte prépare donc son évasion, sa trahison. Il va s’enfuir, et charger Kléber de se débrouiller avec ses mameluks, ses imans et ses fellahs.
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988
(p.133) Turkey was bullied into giving French merchants unprecedented privileges in the Levant.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.57) Il y a l’incident de route, près de Jaffa (la ville a été prise le 7 mars), des deux mille prisonniers que Bonaparte, plutôt que de les nourrir — on ne va surtout pas les relâcher ! — trouve plus commode de faire exterminer, dans les dunes, à l’arme blanche, afin d’économiser les munitions ; et il y aura, au retour, encore à Jaffa, l’autre incident : les pestiférés. Les dévots de Napoléon ont longtemps maintenu la légende — et la peinture officielle s’en est mêlée — du général au grand cœur, touchant sans effroi les bubons de ses soldats mourants. Et que de cris pour protester contre l’infamie calomniatrice de la rumeur : mais non, Bonaparte n’a pas « touché les bubons » ; il les a fait tuer, ses malades ! Depuis la publication des Cahiers de Bertrand,
1. En partant, et pour assurer ses arrières, Bonaparte lance aux Ulémas cette proclamation : * Il était écrit qu’après avoir détruit les ennemis de l’Islam [il s’agit des chevaliers de Malte] et fait abattre leurs croix, je viendrais du fond de l’Occident, remplir ma tâche annoncée dans plus de vingt passages du saint livre le Koran » ; suivait cet avertissement: « Je sais tout, et même ce que vous n’avez dit à personne. »
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.58) la cause est entendue. Le 5 juillet 1817, à Sainte-Hélène, Napoléon a dit la vérité à Bertrand : mais oui, il les a liquidés, ces hommes ; pour qu’ils ne tombent pas, dira-t-il, aux mains des Turcs qui les eussent torturés… Par humanité, en somme. Ajoutons que le Sultan ne doit point pouvoir se targuer d’avoir fait des prisonniers français ; on lui retire donc cette joie. L’opium, puis le « sublimé corrosif », règlent la question.
Le sort des soldats français pestiférés troublait beaucoup moins Bonaparte que ne le consternait sa déconvenue de Saint-Jean-d’Acre. Car il n’y avait pas eu moyen de passer. Du 19 mars au 28 mai 1799, Napoléon Bonaparte s’est acharné en vain contre la ville. Assaut sur assaut. Lourdes pertes. Rien à faire. Le verrou ne saute pas. C’est gai ! Finie, presque avant d’avoir commencé, la grande « entreprise » en laquelle Bonaparte mettait toutes ses espérances. Il l’avouera, à la fin de sa vie, en termes clairs : « C’est devant Saint-Jean-d’Acre que ma fortune a tourné ». Il se voyait déjà costumé en calife ou en maharadja et vautré indéfiniment dans les délices et les ravages. C’est manqué. Par la faute des Anglais.
|
|
Jean Burnat, G.H. Dumont, Emile Wanty, Le dossier Napoléon, éd. Marabout, 1962
(p.85) Et Chaptal écrit de son côté, quelques années plus tard, lui aussi: Napoléon portait dans la guerre ce caractère d’insensibilité qui, dans toutes les phases de sa carrière orageuse, a toujours été le trait dominant. En Egypte, du côté de Jaffa, il fit fusiller sept mille Turcs qui s’étaient rendus par capitulation. Cinq ou six individus qui avaient échappé à cet effroyable carnage se réfugièrent à Saint-Jean-d’Acre, y firent connaître cet attentat à la bonne foi et déterminèrent la garnison à n’écouter aucune proposition et à se défendre jusqu’à la mort. C’est la cause principale de la résistance que Bonaparte essuya à Saint-Jean-d’Acre. A peu près dans le même temps, il fit empoisonner quatre-vingt-sept soldats, malades de la peste, dans l’hôpital de Jaffa. On essaya d’abord l’opium, qui ne produisit pas l’effet qu’on en attendait, et on employa ensuite le sublimé corrosif.
|
|
Jean Vermeil, Les Bruits du silence, L’autre histoire de France, éd. du Félin, 1993
(p.152) Une pyramide de cadavres
Le général Kléber arrive devant Jaffa le 3 mars 1799. Il s’installe au nord de la ville pour isoler Saint-Jean-d’Acre et Naplouse. Le général Damas établit que les villages de plaine sont bien défendus et les montagnards prêts à la guérilla. Les Français restent dans la plaine littorale. Le siège de Jaffa commence. La ville a tenu de longs sièges en 1773 et en 1776. La seconde fois, Abou Dahab a massacré ses habitants. Le 7 mars au matin, Bonaparte donne l’assaut. La ville se rend dans l’après-midi. Les soldats se livrent au pillage habituel (7 et 8 mars). Napoléon raconte : « Tout fut passé au fil de l’épée ; la ville, ainsi au pillage, éprouva toutes les horreurs d’une ville prise d’assaut. » Sur les cinq mille hommes de la garnison, deux mille sont tombés au combat. Les trois mille autres se cachent dans la citadelle. Ils reçoivent de Beauharnais et Croisier, aides de camp de Bonaparte, la promesse de la vie sauve.
Bonaparte s’écrie : « Que veulent-ils que j’en fasse ? Que diable ont-ils fait là ? », et ordonne l’exécution des soldats turcs. Il retire du lot les Égyptiens, environ cinq cents, et trois cents artilleurs turcs entraînés à la française. Il gracie Abdullah Aga, le commandant de la place. Il reste à exécuter deux mille deux cents hommes. Les soldats français retrouvent vite les manières de la Terreur et de la guerre de Vendée. L’exécution a lieu le 10 mars, dimanche de la Passion. Miot la décrit : « Arrivés enfin dans les dunes de sable au sud-ouest de Jaffa, on les arrêta auprès d’une mare d’eau jaunâtre. Alors, l’officier qui commandait les troupes fit diviser la masse par petites portions, et ces (p.152) pelotons, conduits sur plusieurs points différents, y furent fusillés. Cette horrible opération demanda beaucoup de temps, malgré le nombre des troupes réservées pour ce funeste sacrifice, et qui, je dois le déclarer, ne se prêtaient qu’avec une extrême répugnance au ministère abominable qu’on exigeait de leurs bras victorieux. Les […] Turcs […] firent avec calme leur ablution dans cette eau stagnante […], puis, se prenant la main, après l’avoir portée sur le cœur et à la bouche, ainsi que se saluent les Musulmans, ils donnaient et recevaient un éternel adieu. Leurs âmes courageuses paraissaient défier la mort… »
Bonaparte donne l’ordre d’économiser la poudre. L’exécution se rationalise. On prend son temps. Miot continue : « Nos soldats avaient épuisé leurs cartouches ; il fallut frapper [les derniers rangs] à la baïonnette et à l’arme blanche. Il se forma, puisqu’il faut le dire, une pyramide effroyable de morts et de mourants dégouttant de sang, et il fallut retirer les corps déjà expirés pour achever les malheureux qui, à l’abri de ce rempart affreux, épouvantable, n’avaient point encore été frappés. »
Peyrusse, adjoint du payeur général Estève, voit la scène ainsi : « Environ trois mille hommes posèrent leurs armes et furent conduits sur-le-champ au camp ; par ordre du général en chef [Bonaparte], on mit à part les Égyptiens, les Maugrabins [Maghrébins] et les Turcs. « Les Maugrabins furent tous conduits le lendemain sur les bords de la mer, et deux bataillons commencèrent à les fusiller; ils n’avaient d’autre ressource pour se sauver que de se jeter à la mer ; ils ne balancèrent pas et se jetèrent tous à la nage. On eut le loisir de les fusiller et, dans un instant, la mer fut teintée de sang et couverte de cadavres ; quelques-uns avaient eu le bonheur de se sauver sur des rochers ; on envoya des soldats sur des barques pour les achever […]. Cette exécution finie, nous aimions à nous persuader qu’elle ne se renouvellerait plus et que tous les autres prisonniers seraient épargnés.. . Notre espérance fut bientôt déçue lorsque, le lendemain, on a conduit au supplice mille deux cents canonniers turcs, qui, pendant deux jours, étaient restés couchés sans subsistance devant la tente du général en chef [Bonaparte]. On avait bien recommandé de ne pas prodiguer la poudre et on a eu la férocité de les poignarder à coups de baïonnette ; on a trouvé parmi les victimes beaucoup d’enfants qui, en mourant, s’étaient attachés aux corps de leur père. »
Le chef de bataillon Detroye fait le compte : « Le 7 mars, dans l’assaut, il a péri plus de 2 000 Turcs, le 8 mars par la fusillade 800, le 9 800, le 10 mars 600, le 11 mars 1441.» On veut justifier Bonaparte, en le dépeignant irrité par la présence à Jaffa de combattants (p.154) d’une garnison vaincue, El-Arich, en armes malgré la convention de reddition. Mais il n’a pas respecté la convention non plus puisqu’il a lui-même enrôlé une partie d’entre eux. De plus, les hommes d’El-Arich présents à Jaffa ne sont que de trois à quatre cents. Les autres ont quand même été éliminés.
On justifie aussi Bonaparte par l’argument du manque de troupes et de bateaux pour reconduire les prisonniers. Mais il a trouvé des hommes et des bateaux pour ramener les cinq cents Égyptiens dans leur pays, et laisse une centaine d’hommes à Jaffa. On justifie encore Bonaparte par le manque d’aliments. Mais il saisit quatre cent mille rations de biscuits et deux mille quintaux de riz à Jaffa. On soutient que, délivrés, les prisonniers auraient renforcé Jezzar à Saint-Jean-d’Acre. Mais Jezzar aurait été bien embarrassé pour les nourrir et les armer. Le vrai motif de Bonaparte est politique. Il sait que Abou Dahab a conquis la Palestine en 1776 de cette façon. Il veut intimider Jezzar.
Bonaparte cultive un orientalisme trouble. Il se présente en civilisateur, mais aimerait se débarrasser d’une civilisation gênante. Il fait des confidences dans ce sens à Mme de Rémusat. Bonaparte se sent invincible. Le 9 mars, deux jours après le massacre, il proclame aux habitants de la Palestine : « II est bon que vous sachiez que tous les efforts humains sont inutiles contre moi, car tout ce que j’entreprends doit réussir. Ceux qui se déclarent mes amis prospèrent. Ceux qui se déclarent mes ennemis périssent. L’exemple qui vient d’arriver à Jaffa et Gaza doit vous faire connaître que je suis terrible pour mes ennemis, que je suis bon pour mes amis, et surtout clément et miséricordieux pour le pauvre peuple. »
|
|
Massacre d’Albanais, de Turcs, d’Arabes
Paul Masson, Un triste épisode de la vieille cité palestinienne aujourd’hui incorporée à Israël, DH 04/08/2007
JAFFA Du passage de Napoléon Bonaparte à Jaffa, on ne connaît souvent que le tableau d’Antoine-Jean Gros où on voit le commandant en chef du corps expéditionnaire français visitant les pestiférés. Entouré d’officiers qui manifestent de l’inquiétude ou de l’horreur, impavide, il touche du doigt le bubon d’un pestiféré arabe. Cette peinture romantique montre ainsi le futur empereur manifestant courage, compassion et grandeur d’âme. Reprenant un geste du Christ, choisissant un malade d’une autre religion que la sienne, le peintre en fait un héros intemporel, digne de l’admiration de tous, indépendamment de leurs nationalités ou de leurs croyances. La réalité, on s’en doute, fut moins édifiante. En février 1799, sous la pression anglaise, la Turquie avait déclaré la guerre à la France. Elle avait envoyé deux armées vers l’Egypte, une par la Syrie et l’autre par la mer vers Alexandrie. Bonaparte quitta Le Caire pour remonter vers le nord à la rencontre de la première de ces armées. Le corps expéditionnaire français, fort de treize mille hommes, avait pour objectif Saint-Jean d’Acre. Le 20 février, il prit sans difficulté El Arich tenu par des Albanais et des Mameluks, non sans massacrer plusieurs centaines de combattants.
Après s’être ensuite emparé sans difficulté de Gaza, Bonaparte arriva devant une petite cité endormie sur ses falaises de grès, au bord de la mer. C’était Jaffa, l’une des plus anciennes cités du monde, Jaffa-la-Belle disait-on jadis. La ville résista pendant trois jours avec un tel acharnement que les vainqueurs, saisis par une folie aveugle, voulurent tout massacrer et détruire, malgré les consignes de Bonaparte qui refusait de voir cette victoire déboucher sur un carnage. Deux mille défenseurs furent cependant tués pendant les combats, les portes de harems forcées et les femmes violées. Les derniers résistants trouvèrent refuge dans un caravansérail. Sur la promesse d’avoir la vie sauve s’ils se rendaient, ils mirent bas les armes.
Le massacre
Bonaparte, en les voyant défiler, se demanda ce qu’il allait en faire. Déjà les captifs pris à El Arich avaient promis de ne plus se battre contre lui et de se retirer sur Bagdad. Or, voici qu’ils se retrouvaient pour la plupart sur les murailles de Jaffa. Ils avaient manqué à leur parole; ils devaient mourir. Libérer les rescapés de Jaffa, c’était s’exposer à ce qu’ils reprennent les armes, comme après El Arich. Contre l’avis de ses officiers, dont Berthier, Bonaparte décida donc de les exécuter.
Dans un roman sur la vie de Napoléon, Michel Peyramaure décrit avec force détails cette opération* : « Les exécutions eurent lieu en bordure de mer, au milieu de dunes, de rochers et de mares d’eau saumâtre. Divisés en groupes, les prisonniers, parmi lesquels des vieillards qui rassemblaient autour d’eux les condamnés pour les dernières prières et les ablutions, se présentaient sans crainte et sans faiblesse devan t les pelotons d’où partait un feu d’enfer. Le massacre dura des heures. Lorsque les soldats manquaient de munitions, ils opéraient à la baïonnette et à l’arme blanche, frappant au hasard, à tour de bras pour en finir au plus vite, dégageant des monticules de victimes des blessés qui gémissaient sous les cadavres et qu’ils achevaient. On rappelait, en leur promettant la vie sauve, certains captifs qui s’enfuyaient à la nage et, à peine avaient-ils rejoint la côte, on les égorgeait. »
Il n’en fut pas de même à Saint-Jean d’Acre, inexpugnable en raison des fortifications et de sa citadelle construite par les Croisés. (…) Les Français ne disposant pas de l’artillerie nécessaire, le siège piétina. Si bien que le 18 mai, après l’échec d’une huitième attaque contre la citadelle, Bonaparte annonça à son état-major sa décision de lever le siège pour aller barrer la route aux Turcs dans le Delta. Il abandonna là les blessés et les pestiférés dont certains demandèrent de l’opium pour abréger leurs souffrances. Lorsqu’elle arriva à Jaffa, l’armée qui avait débarqué en Egypte moins d’un an auparavant était réduite de moitié.
*Napoléon, chronique romanesque. Michel Peyramaure. Robert Laffont.
Un petit air de Saint-Paul-de-Vence…
(…) Visiblement, Jaffa n’a pas un un très bon souvenir du passage du futur empereur des Français. Dans la légende qui complète la gravure le concernant, on peut même lire que « deux ans après son passage, la ville avait encore une odeur de cadavre ». Dans le bas de la ville, près du port, le lazaret où il avait rendu visite aux pestiférés français est devenu un couvent arménien, actuellement en restauration. Aucune allusion à sa visite n’y figure. Ainsi, Les Pestiférés de Jaffa peint en 1804, tout comme Bonaparte au Pont d’Arcole (1796) ou Le champ de bataille d’Eylau (1808) n’était-il qu’une œuvre de propagande et le peintre Gros un chantre de l’épopée napoléonienne dont Jaffa n’a plus qu’un vague et mauvais souvenir.
|
|
Napoleon und seine Zeit, 1769-1821, in: Geo Epoche, 55, 2012
(S.56) Nach viertägiger Belagerung nehmen die Franzosen am 7. März /1899/ die Hafenstadt Jaffa ein. Die Soldaten plündern, morden, vergewaltigen. Bonaparte befiehlt die Hinrichtung von 3000 osmanischen Kämpfern, die sich ergeben haben, nachdem ihnen ein französischer Offizier das Leben zugesichert hatte. Das Massaker dauert mehrere Tage.
|
|
Jean Vermeil, Les Bruits du silence, L’autre histoire de France, éd. du Félin, 1993
(p.152) Une pyramide de cadavres
Le général Kléber arrive devant Jaffa le 3 mars 1799. Il s’installe au nord de la ville pour isoler Saint-Jean-d’Acre et Naplouse. Le général Damas établit que les villages de plaine sont bien défendus et les montagnards prêts à la guérilla. Les Français restent dans la plaine littorale. Le siège de Jaffa commence. La ville a tenu de longs sièges en 1773 et en 1776. La seconde fois, Abou Dahab a massacré ses habitants. Le 7 mars au matin, Bonaparte donne l’assaut. La ville se rend dans l’après-midi. Les soldats se livrent au pillage habituel (7 et 8 mars). Napoléon raconte : « Tout fut passé au fil de l’épée ; la ville, ainsi au pillage, éprouva toutes les horreurs d’une ville prise d’assaut. » Sur les cinq mille hommes de la garnison, deux mille sont tombés au combat. Les trois mille autres se cachent dans la citadelle. Ils reçoivent de Beauharnais et Croisier, aides de camp de Bonaparte, la promesse de la vie sauve. Bonaparte s’écrie : « Que veulent-ils que j’en fasse ? Que diable ont-ils fait là ? », et ordonne l’exécution des soldats turcs. (…) Les soldats français retrouvent vite les manières de la Terreur et de la guerre de Vendée. L’exécution a lieu le 10 mars, dimanche de la Passion. Miot la décrit : « Arrivés enfin dans les dunes de sable au sud-ouest de Jaffa, on les arrêta auprès d’une mare d’eau jaunâtre. Alors, l’officier qui commandait les troupes fit diviser la masse par petites portions, et ces (p.152) pelotons, conduits sur plusieurs points différents, y furent fusillés. Cette horrible opération demanda beaucoup de temps, malgré le nombre des troupes réservées pour ce funeste sacrifice, et qui, je dois le déclarer, ne se prêtaient qu’avec une extrême répugnance au ministère abominable qu’on exigeait de leurs bras victorieux. Les […] Turcs […] firent avec calme leur ablution dans cette eau stagnante […], puis, se prenant la main, après l’avoir portée sur le cœur et à la bouche, ainsi que se saluent les Musulmans, ils donnaient et recevaient un éternel adieu. Leurs âmes courageuses paraissaient défier la mort… »
Bonaparte donne l’ordre d’économiser la poudre. L’exécution se rationalise. On prend son temps. Miot continue : « Nos soldats avaient épuisé leurs cartouches ; il fallut frapper [les derniers rangs] à la baïonnette et à l’arme blanche. Il se forma, puisqu’il faut le dire, une pyramide effroyable de morts et de mourants dégouttant de sang, et il fallut retirer les corps déjà expirés pour achever les malheureux qui, à l’abri de ce rempart affreux, épouvantable, n’avaient point encore été frappés. » Peyrusse, adjoint du payeur général Estève, voit la scène ainsi : « Environ trois mille hommes posèrent leurs armes et furent conduits sur-le-champ au camp ; par ordre du général en chef [Bonaparte], on mit à part les Égyptiens, les Maugrabins [Maghrébins] et les Turcs.
« Les Maugrabins furent tous conduits le lendemain sur les bords de la mer, et deux bataillons commencèrent à les fusiller; ils n’avaient d’autre ressource pour se sauver que de se jeter à la mer ; ils ne balancèrent pas et se jetèrent tous à la nage. On eut le loisir de les fusiller et, dans un instant, la mer fut teintée de sang et couverte de cadavres ; quelques-uns avaient eu le bonheur de se sauver sur des rochers ; on envoya des soldats sur des barques pour les achever […]. Cette exécution finie, nous aimions à nous persuader qu’elle ne se renouvellerait plus et que tous les autres prisonniers seraient épargnés.. . Notre espérance fut bientôt déçue lorsque, le lendemain, on a conduit au supplice mille deux cents canonniers turcs, qui, pendant deux jours, étaient restés couchés sans subsistance devant la tente du général en chef [Bonaparte]. On avait bien recommandé de ne pas prodiguer la poudre et on a eu la férocité de les poignarder à coups de baïonnette ; on a trouvé parmi les victimes beaucoup d’enfants qui, en mourant, s’étaient attachés aux corps de leur père. » Le chef de bataillon Detroye fait le compte : « Le 7 mars, dans l’assaut, il a péri plus de 2 000 Turcs, le 8 mars par la fusillade 800, le 9 800, le 10 mars 600, le 11 mars 1441.» (…)
|
| Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.294) février-juin 1799 : campagne de Syrie contre les armées ottomanes descendues de Constantinople, par Bonaparte, Kléber, Lannes et Murât, marquée par la prise d’El-Arich, de Gaza, du port de Jaffa (où la peste fait des ravages), et par le long siège, qui n’aboutit pas de Saint-Jean-d’Acre (printemps 1799). Si les détails de cette guerre sanglante et désordonnée ne nous intéressent pas ici, le comportement de Bonaparte en Egypte mérite qu’on s’y arrête. La proclamation à son armée, qu’il rédigea à bord de l’Orient le 22 juin 1798 (voir Annexe n° 16, p. 467) est une merveille d’hypocrisie. Il y expose les raisons officielles de l’expédition : détruire la puissance des 470 beys mamlouks, qui favorisent exclusivement le commerce anglais (l’Egypte était une province de l’Empire ottoman ; les beys étaient des gouverneurs de provinces appartenant à l’ancienne dynastie turque des mamlouks) ; mais surtout il prodigue à ses soldats des conseils sur la manière de se comporter avec des musulmans qui ne manquent pas d’intérêt.
(p.296) Oublions les massacres, les pestiférés de Jaffa euthanasiés à l’opium (…).
|

(in: LW, 01/07/2010)

Der ewige Zorn
(Stern, 22/01/2015)

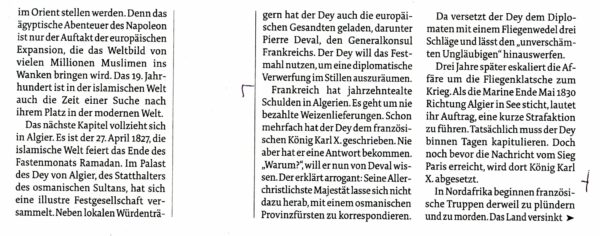

2.3 Napoléon à la conquête de l’Espagne et du Portugal
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
(p.198) / insurrection à Madrid à l’annonce de la tentative par les Français d’emmener l’infant don Francisco à Bayonne/
(p.199) – Mort aux Français! Murat dirige ses troupes depuis la porte San Vicente, dans le prolongement du palais royal. Quatre colonnes françaises venant des portes s’avancent en convergeant vers la Puerta del Sol. Des lanciers, des mameluks dévalent la calle de Alcala sous une pluie de tuiles, de pavés, on lance même des meubles, les insurgés tirent des fenêtres, des soupiraux au ras du sol. – Mort aux gavachos! L’ennemi le plus détesté, ce sont les mameluks – descendants des .Maures, anciens maîtres de l’Espagne; ils ont de larges culottes rouges, un turban blanc, une ceinture chatoyante. Des grappes humaines s’accrochent a leurs étriers, a la queue des chevaux, crevant le ventre des montures, les cavaliers sont jetés à terre, poignardés. Ceux qui échappent a l’étreinte féroce chargent et chargent encore, manient avec une adresse incroyable leur cimeterre courbe, on voit voltiger des têtes. Les soldats français, exaspérés a la vue des cadavres de leurs camarades, ne font pas de quartier. Toute maison d’où l’on a tiré est envahie, saccagée, les habitants percés de baïonnettes, les moines d’un couvent devant lequel agonise un mameluk sont tous décapités, leurs têtes jetées par les fenêtres. Le détachement qui gardait le parc d’artillerie de Monteleone a été désarmé, massacré; les insurgés ont pris deux canons, ils les mettent en batterie, une colonne française recule; un cuirassier français bascule de son cheval, une femme le transperce avec son sabre, un soldat a réussi a avertir Murat de l’échec qui se dessine de ce côté.
– Qu’on en finisse avec cette canaille effrénée! Un ouvrier espagnol paraît, portant un mouchoir blanc au bout de son épée; il veut parlementer, la foule ne lui en laisse pas le temps. La bataille reprend et cette fois, les Français l’emportent.
Il est une heure de l’après-midi, l’insurrection est désorganisée; on ne verra plus ici et là que des massacres isolés. Puis des délégués de la junte parcourent les rues, portant un drapeau blanc:
– Paix, paix ! que chacun rentre chez soi !
Mais la répression est déja en cours. « Une commission militaire siégeant à ‘l’hôtel de la poste, Puerta del Sol, jugera sommairement les insurgés pris les armes à la main », a proclamé Murat. La chasse dans les rues recommence, mais en sens inverse. Tout Espagnol sur lequel on trouve seulement un canif, des ciseaux, un rasoir – un barbier en avait un sur lui – est arrêté, lardé de coups de baïonnette, trainé devant la commission, aussitôt condamné.
Il y a plusieurs lieux d’exécution: au Prado, à la montée du Retiro et dans le patio de l’église de Buen Suceso; sous les murs du couvent de Jésus, à la montagne du Principe Pio. Toutes les fenêtres des maisons de la ville doivent être fermées; on tire à vue sur qui se montre. Comme toujours, les émeutiers les plus actifs se sont déja défilés, et des innocents sont emmenés. Certains ont de l’argent, veulent corrompre les soldats. Rien à faire; la soif de vengeance est trop grande. Mais un vieux Madrilène ne cache pas qu’il a tué trois soldats et même il s’en vante.
(p.200) De sa maison, au numéro 9 de la Puerta del Sol, Goya, le vieux Goya, sourd mais point aveugle, a vu une partie de l’insurrection, ensuite il interrogera des témoins. Le plus génial reportage télévisé n’aurait pas la force de ce qu’a gravé et peint Goya sur Dos de Mayo dans les «Désastres de la Guerre». La peinture des exécutions au Principe Pio, avec l’Espagnol en chemise debout devant les fusils, les bras étendus ans un geste d’imprécation, avec le troupeau des victimes qui arrivent, avec les soldats qui épaulent – un seul falot éclaire la scène – est un chef-d’oeuvre tragique.
(p.201) La rébellion prend forme d’abord a Oviedo (Asturies), où le chanoine Llano Ponte a convoqué toute la population des environs. Le 24 à minuit, Ie tocsin; conduits par des moines, les insurgés marchent sur le dépôt d’armes ou, sans que les officiers espagnols s’y opposent, ils prennent cent mille fusils. Cent mille. La junte locale déclare solennellement la guerre a Napoléon. Murat, informé, déclare qu’il s’agit là “d’une f1ammèche égarée».
Le même jour, à Valence, le chanoine Calvo ouvre la chasse aux (p.202) afrancesados, ce sont les « collaborateurs». Le comte de Cervalloni, réputé tel, est assassiné – par un moine, le Padre Rico – sa tête promenée au bout d’une pique. D’autres Français sont massacrés sur la place du Grao, d’autres à la plaza de Toros, plus de 300 victimes.
En chaire, les prêtres s’adressent ainsi à Napoléon : «Tu es le roi des ténèbres qu’entourent des nuées de sauterelles: c’est toi que l’Apocalypse a désigné, tu t’appelles Apollyon, c’est-a-dire la destruction … Elle sera dispersée comme paille cette armée française… » Presque partout, le clergé prend la tête de la résistance. L’armée valencienne compte, pour l’artillerie seulement, 1 400 ecclésiastiques; on enrôle dans les églises, dans les couvents; pas d’uniformes, seulement une écharpe rouge portant ces mots : « Vive Ferdinand VII! Religion et Patrie! » Murat, informé, envoie cette fois le corps d’armée de Moncey qui sc heurte à une sorte de horde de Kamikazés. Moncey n’insiste pas pour prendre Valence, on verra plus tard.
Après Valence, Murcie; après Murcie, Séville. Là, c’est un laïc, un Catalan nommé Nicolas Tap qui, à la nouvelle des abdications de Bayonne, conduit le peuple à l’arsenal (les officiers espagnols laissent toujours faire) et arme 20 000 hommes. Le colonel Pedro de Echavarry les harangue : « Soldats, le lascif Murat fait fabriquer 40 000 carcans pour vous conduire vers le nord comme les plus immondes animaux. N’est-il point préférable de verser votre sang pour la défensc de l’Eglise, du royaume et de vous-mêmes? Douze millions d’habitants vous contemplent et envient votre gloire! ».
A Badajoz (Estramadure, près de la frontiere portugaise), le gouverneur comte de la Torre a interdit toute cérémonic lc jour dc la saint Ferdinand, dans l’intention d’empêcher les troubles. Unc foule envahit son hôtel et l’assomme; son cadavre, découpé en quartiers, est exposé sur le pont. Plusieurs officiers français, venant du Portugal, ont la malchance d’arriver là à cet instant. Jetés à bas de leurs chevaux, piétinés, couverts de crachats, ils vont périr sous les couteaux, lorsqu’un tortionnaire, plus raffiné, dit qu’il faut les garder en otages pour le cas où les Français arriveraient. L’un de ces malheureux s’en tirera.
Murat envoie Dupont sévir contre les insurgés de l’Andalousie : “Le premier coup de canon que vous allez faire tirer sur ces misérables doit rendre pour toujours la tranquillité a l’ Andalousie et, j’ose le dire, à l’Espagne. »
C’est de son lit que Murat dicte ce billet d’un optimisme aveugle..
(p.203) On se fait passer sous Ie manteau une brochure intitulée Catéchisme qui circule partout en Espagne. C’est une initiation à la résistance et elle commence ainsi : “Dis-moi, mon fils, qui es-tu ? – Espagnol, par la grâce de Dieu. Qui est l’ennemi de ton bonheur? – Napoléon, empereur des Français. – De quelle origine provient Napaléon? – Du péché – Et Murat? De Napoléon. – Godoy? – De la fornication de tous les deux. – Que sont les Français? – D’anciens chrétiens devenus hérétiques. – Est-ce un crime d’étre né Français? – Non, un Français n’est damné que passé (p.204) l’âge de sept ans. – Est-ce un péché de tuer un Français? – Non, c’est faire oeuvre méritoire et délivrer la patrie de ses agresseurs. » .
Un officier français logé chez des Espagnols les a protégés lors de la répression après le Dos de Mayo; comme il change de garnison, voici le compliment que lui adresse son hôte a l’instant du départ:
– Je vous ai bien des obligations. Ma femme vous doit la vie et je vous dois celle de nos enfants. Eh bien ! il faut que je vous fasse connaître ce qu’est dans le fond de son coeur un véritable Espagnol. S’il ne restait plus que vous de Français en Espagne, je vous tuerais de ma propre main, afin de délivrer entiérement mon pays.
Les espions font sans cesse à l’Empereur des rapports sur les émeutes de province et sur l’état d’esprit de la population, mais il refuse de croire au danger. «Si l’on remue encore, c’est que Murat, le 2 mai, a eu la main trop légère.» Autour de lui, même aveuglement. « Depuis des siècles, écrit Roederer, les Espagnols sont gouvernés par des moines et mangés par les poux; ils sont gueux, ignorants, cagots, paresseux et pas trop braves.»
Voici pourtant le moment où l’Espagne va devenir jardin des supplices. Les soldats d’une colonne française arrivant a Manzanarés (province de la Manche; !es paysans de cette province sont réputés les plus fanatiques) voient dans un champ au bord de la route des porcs en train de se repaître de débris humains. Deux cents soldats français ont été torturés et massacrés là: les mains n’ont plus d’ongles, les visages plus d’yeux.
A Lerma, d’autres cadav’res dont les parties sexuelles ont été cisaillées. Le général René parti le 24 mai de Madrid en compagnie de son aide de camp – c’est son neveu, un adolescent – est capturé par des résistants dans la Sierra Morena. Ses deux compagnons sont sciés entre deux planches. René, blessé, s’est échappé. Un officier espagnol, apitoyé, l’a fait transporter dans un hôpital. D’autres paysans insurgés viennent l’y poignarder.
Les représailles et vengeances sont en cours. Lerma est incendiée et pillée. Les soldats, «affublés de robes de moine, tournent en procession autour des incendies en imitant les chants sacrés avec des paroles de garnison les moins édifiantes ».
Nous voici au 7 juin. L’armée du général Dupont – Pierre Antoine, comte Dupont de l’Étang -, venant de Valdepenas marche sur Cordoue. A La Carolina, entre Almuradiel et Linares, ils voient de chaque côté de la route des soldats français embrochés et rôtis; d’autres qu’on a enterrés vivants jusqu’au cou, d’affreux restes de cadavres sciés; un peu plus loin, trois corps, celui d’un officier, de sa femme et de sa fille, sur qui on a commis «des indécences qu’on ne peut décrire.» Le 7 juin, cette armée bouscule les Espagnols au pont d’ Alcolea, sur le Guadalquivir.
– Maintenant, Cordoue est a nous! Pas si vite. Cordoue, la ville de la mosquée aux mille colonnes est faite en partie de rues tortueuses, vestiges, elles aussi, de l’occupation maure. Les défenseurs tirent des maisons, des églises. Mais cette résistance ne peut tenir devant une armée. Les portes sont forcées, et l’on (p.205) massacre. Les soldats ne s’interrompent que pour aller visiter les caves. Ceux qui n’y tombent pas ivres morts en remontent encore plus furieux. On viole, on tue, on brûle. Religieux et religieuses sont parmi les premières victimes car on a tiré aussi des couvents. La ville devient un désert de cauchemar ou l’on voit des porcs « mangeant les seins des femmes qui ont reçu la mort dans la rue. » Le sac de Cordoue dure plusieurs jours. Le camp de l’armée est alors un bazar où l’on trouve de tout, aussi bien des moutons et des chèvres que des meubles, des objets d’or et d’argent, des tableaux de famille, des miroirs dorés. Et l’on voit, surprenant spectacle, des paysans venus des environs et qui achètent de tout – à très bon marché – aux soldats. “Les fourgons des généraux, dit un témoin, crèvent sous le poids de l’or, de l’argent et des vases sacrés pris dans les églises. On ne saurait dire si nous sommes plus chargés d’exécration ou de ces richesses.»
(p. 206) /Bataille de Saragosse: le 2 juillet/ C’est ce jour-là que va devenir célèbre à jamais dans l’histoire de l’Espagne une fille de vingt-deux ans, Maria Agustina. (…) Comme les défenseurs de Saragosse pressés par les Français à la porte del Portillo, au sud de la ville, reculaient, Maria Agustina saisit une mèche des mains d’un artilleur mourant:
– Par Notre-Dame del Pilar, je jure de mourir plutôt que de quitter ce poste!
Les défenseurs reprennent courage; la mitraille arrête l’élan des Français. Ceux-ci perdirent 500 hommes, dont beaucoup d’officiers. Verdier rappela ses troupes. Le siège de Saragosse devait être levé le 13 août sans résultat. Agustina obtint un grade dans l’armée espagnole, la junte lui accorda une médaille et son nom même fut changé: Agustina Zaragossa. Byron a célébré cette héroïne.
(p.210) Castanos, dit le Gitan est un personnage hors du commun. Commandant du camp de Sa Roque, devant Gibraltar, il a osé, aprés l’émeute madrilène du 2 mai , la répression, féliciter Murat pour « sa magnanimité ». – Vous pouvez compter sur moi comme sur un général français.
Bonne poire, Murat lui a donné de l’argent pour ses troupes. Il les a aussitôt augmentées, mieux armées et entrainées à force. Contre les Français. Contre les Français, toute fourberie est légitime, recommandée. Maintenant, le Gitan tient dans sa main, parqués dans la cuvette de Baylen, les pillards de Cordoue. Qu’ils crèvent au milieu de leur butin. C’est bien fait, faisons traîner les pourparlers! Enfin, Castanos reçoit Dupont, qui lui remet son épée.
(p.212) Castanos avait ordonné que les colonnes de prisonnicrs évitent la grandes villes «pour ne pas être exposés aux vengeances populaires”. Savait-il que les paysans seraient pires que les citadins? Partout sur le passage se forment des haies d’hommes, de femmes et d’enfants. Partout le même cri: Cordoba! Cordoba ! (Cordoue). Le sac de Cordoue est un opprobre qui mérite pire que la mort. Les enfants se faufilent dans les rangs pour mordre les Français «et ne lâchent prise qu’après avoir emporté le morceau».
(p.213) Les soldats qui commettent la faute de quitter la colonne un instant (pour aller boire, pour faire leurs besoins) sont capturés par les paysans et tués, avec des raffinements atroces: yeux crevés avec des ciseaux, parties sexuelles arrachées. Des muletiers mélangent du sang français au vin de leur outre. L’«intox» de la population par les prêtres et les fanatiques a atteint des sommets: – Nous savons que vous tuez les enfants, dit une Espagnole a un malheureux captif. Est-ce vrai que vous les mangez ensuite?
Les officiers qui partagent le sort de leurs hommes – beaucoup l’ont fait volontairement – sont traités comme eux. A Aralar, les habitants, couteaux brandis, assiègent l’auberge où ils sont enfermés. « Cordoba! Cordoba! A midi, on vous coupera la téte! » Plusieurs officiers se donnent la mort et un médecin espagnol. appelé par l’alcade, s’écrie: “Ah, le beau spectacle!»
A Xerès, les autorités empêchent de justesse le massacre d’une colonne entourée par la foule et déja couverte de crachats. A Lebrija. soixante-quinze dragons, officiers et leurs hommes, sont massacrés dans un couvent et dans une caseme. Un des tueurs s’écrie: «Il y en a encore qui remuent les yeux !», et l’on achève les moribonds.
Dans un petit bourg appelé Los Gabescas, deux cents dragons sont massacrés le 8 septembre, jour de la Nativité de la Sainte Vierge. “Cordoba! Cordoba! » On assiste à des scènes presque indicibles. Des paysans fouillent les déjections des soldats qui viennent de déféquer pour s’emparer « s’il s’en trouve, des pièces d’or que parfois nos soldats, au moment d’être pris, espéraient sauver en les avalant.» Gille, dans Les Mémoires d’un conscrit de 1808 raconte qu’un de ses camarades avait ainsi sauvé 22 pièces d’or : «Il les conserva ainsi huit jours dans son corps et ce ne fut qu’au bout de cette époque et à la suite de douleurs aiguës qu’il finit par les retrouver. »
Récupérer sur les Français pillards est une idée fixe, une hantise, on déchire les doublures de leurs vêtements, on défait les épaulettes, on arrache les pansements des blessés.
(p.231) /Franchissement de la sierra de Guadarrama en pleine tempête de neige/ – Place, Place a l’Empereur! Serrez sur la droite! Ces hommes obéissent, bousculés par les gradés, mais un fantassin de l’Empire en tenue de marche, chargé de son barda, de son fusil, de ses munitions, non, cet homme-là n’a rien d’une danseuse. Les fantassins alourdis glissent sur le verglas, tombent, se font mal, certains se blessent. L’Empereur peut bien passer, pas une exclamation. Ce qu’on entend, ce sont des jurons et des insultes et cette colère ne fait que commencer.
Voici la montée. Sur le plat, le cheval de l’Empereur a déjà failli s’abattre plusieurs fois. Pied à terre et les officiers et les chasseurs imitent le grand chef, on va en file indienne, chevaux en main, tandis que le vent pousse la neige encore plus fort. On avance à deux kilomètres à l’heure, parfois moins, parfois on ne peut plus avancer et même on recule. Nous voyons Napoléon tantôt appuyé sur Savary, tantôt sur Duroc; puis les officiers de son état-major «entrelacent leurs bras” pour se tenir l’un à l’autre, l’Empereur au milieu d’eux. A trente-huit ans, cet homme est infatigable à cheval, endurant, dur à l’inconfort, mais point entraîné à la marche; il trébuche, il dit : « Foutu métier!”, le voilà maintenant à cheval sur un canon qu’on tire à bras, locomotion moins pénible, mais tandis qu’ainsi l’Empereur dépasse deux régiments qui se traînent, ce qu’il entend ne doit guère le réconforter. – Salaud, fumier, charogne! Qu’on lui foute un coup de fusil! Qu’on en finisse!
Les hommes qui ont tant de fois crié vive l’Empereur s’engueulent entre eux, s’excitent l’un l’autre: – Si tu es trop lâche, laisse-moi passer, je lui logerai une balle dans la tête!
En si peu de temps de l’adoration a la malédiction. Nous savons que cela s’est vu maintes fois dans l’Histoire.
(p.232) Le dernier degré de la misére va durer longtemps pour les soldats. Le 24 décembre, Napoléon reçoit un message de Soult : « Le 2e corps est entré en combat au nord de Valderas avec des détachements de l’armée anglaise.» Réponse immédiate de l’Empereur: si Soult est attaqué, qu’il recule d’une journée vers l’est afin d’attirer Moore dans cette direction Et lui, Napoléon, attaquera l’Anglais sur ses derrières ou sur son flanc avec les troupes de Ney.
Parfaite manoeuvre en perspective, mais nous sommes en Espagne. L’officier portant ces instructions à Soult est enlevé et assassinné par les guerilleros. Les dépêches qu’il avait sur lui sont aussitôt transmises à Moore. Et Moore, dès cet instant, n’a plus qu’une idée: foncer vers le nord à la vitesse maxima pour aller se rembarquer à La Corogne. Napoléon n’a lui aussi plus qu’une idee : rattraper Moore avant qu’il ne se rembarque. Moralité pour ses soldats : une fois de plus marche ou crève. Ce sera pour beaucoup marche et crève.
Quinze lieues par jour, voilà ce que voudrait l’Empereur. L’exploitl serait possible par beau temps, avec des hommes reposés. Mais maintenant, la Guadarrama laissée derrière, la pluie a succédé à la neige. Une pluie glaciale. Les champs sont inondés, les routes sont des rivières de boue, c’est pire qu’en Pologne. Chaque régiment trouve sur sur son passage les épaves de celui qui l’a précédé : voitures enlisées avec, le plus souvent, leur attelage de mulets, d’ânes et de chevaux et aussi des chevaux de cavalerie et même des soldats, enlisés eux aussi, ou morts autrement. Si vous voulez savoir comment, voici.
Un soldat qui n’est pas un conscrit, pas une mauviette, non, un fusilier de la Garde, soudain s’arrête et il parle à ses copains: – Je suis un brave homme. Vous m’avez vu au feu. Je ne veux pas déserter, mais cela est trop fort pour moi.
Il appuie le canon de son fusil sur son front, presse la détente avec son pied, c’est fini. Il ne sera pas le seul. Le 28 décembre, une douzaine de soldats de la Garde se donnent pareillement la mort. «Je ne veux pas désecrter», a dit le premier suicidé. C’est que, déserter, c’est s’exposer à pire qu’à la mort rapide: les guerilleros sont toujours là dans le paysage, plus ou moins loin sur le flanc des colonnes. Un déserteur ne ferait pas une demi-lieue sans tomber entre leurs mains, autrement dit la torture avant la mort. Pourtant, d’autres désespérés qui hésitent à se tuer d’un coup de feu, tout simplement se couchent dans la boue. Les copains leur disent qu’ils sont fous. – Non, c’est lui qui est fou. Le Tondu.
Les suicidés de cette course à la mer – à la mort – n’ont pas été dénombrés, ni les enlisés. L’armée ressemble à un convoi funèbre échelonné sur des dizaines de lieues. Les unités sont mélangées, les brigades, les divisions. La Garde elle-même n’en peut plus et se disloque. Percy suit avec ses ambulances . «Nul besoin de demander le chemin, chevaux, mulets, ânes morts l’indiquent assez.» Il écrit aussi: «Nul peuple guerrier ou vagabond ne nous a jamais égalés pour la destruction et le brigandage.» Ce sont surtout les soldats du rang qui terrifient les habitants des misérables cabanes de terre. Dès qu’ils voient un officier, ils le supplient de rester pour les protéger, lui offrent tout ce qu’ils ont.
(p.233) Atteindre les Anglais à tout prix. L’ordre de l’Empereur est d’atteindre Astorga dans les vingt-quatre heures. Soixante kilomètres à parcourir dans la boue et sous la pluie, en grande partie de nuit car nous voilà au 1er janvier 1809. Les moins hébétés des troupiers qui se lèvent ce jour-là ricanent et jurent en se souhaitant la bonne année. Beaucoup se souhaitent mutuellement que le Tondu crève le plus tôt possible, oui, voilà où l’on en est.
(p.245) Nous avons déja jeté un long regard sur Saragosse, que ses couvents et ses rnonuments rnassifs faisaient ressernbler a une place forte. Quand les troupes françaises envoyées par Lannes s’en approchèrent pour la seconde fois, le 20 décernbre 1808 (le premier siège avait duré du 15 juin au 13 août, résultat nul), sa garnison cornprenait 30 000 soldats plus autant de paysans et d’habitants armés. Les Français étaient 30 000. Au début, les bornbardernents et les attaques de harcèlement n’irnpressionnèrent guère les assiégés. L’âme de la résistance était José Rebelledo de Palafox y Melzi, dit plus sirnplement Palafox, général de trente-trois ans, ex-garde du corps de Ferdinand VII; de médiocre courage, dépourvu de toute expérience militaire, rnais parlant bien, plaisant aux femmes, en vérité un faux héros que l’Espagne placerait plus tard sur un piédestal, (duc de Saragosse) parce qu’à toute résistance il faut une idole.
Napoléon, irrité de la lenteur des opérations, cornmanda à Lannes d’aller y voir en personne. Le 26 janvier, tous les canons français tirèrent ensemble et le gros couvent de San Engracia fut enlevé par les Polonais de la légion de la Vistule. Dans les réfectoires, dans les (p.246) chapelles, dans les couloirs et jusque dans les cellules, les rnoines couverts de sang se battaient cornrne des démons, un Polonais fut assommé à coups de crucifix. Une bataille tout aussi sauvage se déroula à l’intérieur de l’église baroque des Capucins, aux rnurs entiérement dorés; les Espagnols tiraient des galeries supérieures, de la tribune des orgues. Ils tiraient des fenêtres de toutes les maisons; vouloir franchir un espace découvert était une folie mortelle; il fallait progresser très lentement, en édifiant à rnesure des rnurettes, des épaulernents; faute de temps pour chercher et disposer des pierres, les soldats français se servaient de sacs de blé, de ballots de laine et surtout, c’était le matériau le plus apprécié, de livres pris dans les bibliothèques des couvents et des églises; on entassait l’un sur l’autre, comme des briques, des in-folio sans prix.. La rnême lente progression continuait sous terre, les sapeurs creusant à la lueur de lampes, de torches, dont la fumée les suffoquait; parfois leur pic brisait des vases antiques remplis d’or, d’argent, de médailles datant des Carthaginois, des Rornains. Il arrivait aussi que ces sapeurs débouchaient dans une cave où des Espagnols se tenaient terrés au milieu de jarres de vin et d’huile, et des batailles d’enfer s’y déroulaient, dans des rnares d’huile, de vin, puis de sang.
Cornbien de tués dans ce carnage, on ne sait pas. Du côté français, un rapport fait état de six cents rnorts par jour, rnais rien n’est vérifiable. On se bat pour enlever l’hôpital des fous, âprernent défendu et qui est en flammes; des dérnents se jettent par les fenêtres; d’autres grabataires sont grillés vifs. Juste en face, le couvent de San-Francisco, énormc bâtisse, résiste encore, rnais il est miné; le 10 février, une explosion énorrne projette en l’air une compagnie entière de grenadiers de Valence: un instant plus tard, les demiers défenseurs, précipités du haut du clocher, font un trajet en sens inverse. Le lendemain, on trouva des rnonceaux de cadavres dans les caves où des familIes s’étaient réfugiées.
Tous les lieux de culte sont des lieux de fureur. Dans l’église des Récollets, on se bat au milieu des cercueils. « De l’un d’eux sort la tête livide et décharnée d’un évêque enseveli dans ses habits pontificaux. » Au couvent Saint-Lazare, les tireurs se replient jusqu’au pied de l’autel où sont entassés des femmes et des enfants. Qui épargner dans cette folie de sang, dans cette furnée épaisse? Les soldats français tirent dans le tas.
Le carnp de l’armée française, fait de baraques et de tentes, se trouve hors de la ville. On y rnanque presque de tout, parce que toute la province d’ Aragon est soulevée, les convois ne passent pas. Le camp offre un aspect insensé. Les tableaux des couvents, des églises, servent de toits aux baraques, des Velasquez, des Murillo, des Goya: à terre, en guise de paille, des vieux parchemins: on entretient les feux avec des ornernents d’autel, des statues des saints.
Les blessés et les malades français sont entassés dans des couloirs extra-rnuros. Le «service» y est assuré par des Espagnols réquisitionnés de qui la plus grande joie, qu’ils ne cachent pas, est de balancer les morts dans les fosses communes.
|
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
En août 1810, à Villafranca de Navarre, vingt grenadiers français et une cantinière sont, par elle, faits prisonniers. Les hommes de Diez dévêtent la femme, l’enduisent de noir de fumée, la promènent sur un âne, la tête tournée vers la queue, avec un écriteau : «Puta de los Franceses. » Puis, après lui avoir crevé un oeil et coupé une oreille, ils l’exposent dans une cage d’osier. Quant aux grenadiers, cinq d’entre eux, tirés au sort, sont enterrés jusqu’au cou et servent à un jeu de boules; quand une de leurs têtes est touchée, l’assistance applaudit; le jeu dure jusqu’à la mort de ces martyrs. Les autres sont réservés pour les réjouissances du 15 août – date à laquelle les Français célèbrent la fête de l’Empereur: le boucher alors les assomme, tandis que la cantinière, moribonde, est clouée sur la porte de l’église. Le curé et l’alcade de Villafranca, écoeurés par ce spectacle, ont alerté les troupes françaises les plus proches. Villafranca a été cernée, incendiée, les habitants massacrés.
Francisca Espoz y Mina, dit simplement Mina, dit aussi l’oncle Francisco, a été un chef de guerilla non moins illustre. Paysan navarrais au départ, mais une lithographie le représente vêtu comme un général, l’air altier. Homme de moeurs austères, disait-on. Point de femmes dans son camp. Discipline de fer, et une organisation de tous les services: hôpitaux dans les villages isolés, fabriques de poudre dans des cavernes.
Le service de renseignements espionne jusqu’au général Reille, chargé de traquer le chef de guerilla : sa maîtresse, une Navarraise, fait savoir tous les deux jours à Mina tous les mouvements des troupes françaises de la région. Grande rigueur aussi dans le châtiment des traîtres. Tout Espagnol ayant aidé les Français a l’oreille droite coupée et, marquée au fer rouge sur Ie front, l’inscription : « Viva Mina! » Grâce à ce chef exemplaire, on a assisté en Navarre à une ascension vertigineuse dans les représailles. Ayant appris que des parents, femmes et enfants de guerilleros sont retenus en otages dans des cachots de Pampelune, Mina déclare en 1811 « la guerre à mort et sans quartier aux chefs et soldats français, y compris leur Empereur ». Et voici :
Trois Espagnols surpris à fabriquer de la poudre sont pendus a Pampelune. Réponse : la nuit suivante, trois grenadiers français assaillis et pendus avec un écriteau en français: « Vous pendez les nôtres. Nous pendons les v6tres.» Laconisme qui servira de légende A Goya.
Les camarades des grenadiers exigent vengeance: quinze moines sont arretés, pendus, et le régiment défile devant les gibets.
Quelques jours plus tard, on trouve aux portes de Pampelune deux (p.288) officiers et quatre soldats français pendus. Le général Abbé fait fusiller six Espagnols et une affiche avertit Mina : « Pour un Français, dix Espagnols seront dorénavant exécutés. » Réponse : les guerilleros pendent quatre soldats français par les pieds après leur avoir coupé le nez, les oreilles et crevé les yeux. Auprès d’eux, une nouvelle affiche, de Mina: pour un soldat espagnol, vingt soldats français seront exécutés; pour un officier espagnol, quatre officiers français. Réponse du général Abbé: 40 prisonniers espagnols seront fusillés; et encore une affiche française: «Le général Abbé enverra au besoin chercher en France d’autres prisonniers espagnols pour les exécuter.»
A la boucherie sur place succèdent les atrocités en campagne. Vingt Français ayant été égorgés à Tordesa, le général Abbé poursuit Mina, qui a fait mouvement et de qui la tête est mise à prix. Le guerillero a avec lui des prisonniers. Serré de près, il les fait pousser dans un précipice, et on lapide ceux qui bougent encore.
Deux succès retentissants vont porter à son sommet la gloire de Mina. 25 mai 1811. Une colonne commandée par un colonel – 400 soldats, 100 voitures plus 1 000 prisonniers espagnols – s’engage dans la gorge d’Arlaban. sur la route de Salinas. Les guerilleros de Mina l’attaquent à six heures du matin. Au premier coup de feu. les prisonniers espagnols se couchent; puis ils bondissent et vont se joindre à leurs compatriotes. Les 400 soldats français se défendent courageusement, le combat dure jusqu’à trois heures de l’après-midi. Bilan: toutes les voitures pillées, 65 tués, dont cinq femmes affreusement mutilées.
En apprenant l’arrivée d’un renfort français, Mina s’est enfui avec ses hommes. Et avec des prisonniers, comme ceux-ci suivent mal, il les fait pousser à coups de baïonnette dans un ravin.
(p.293) Les miliciens portugais étaient les premiers à talonner l’arrière-garde, à se jeter sur les groupes isolés. Leur férocité allait se montrer à la hauteur de celle des guerilleros espagnols. Scier un homme entre deux planches est chez eux une habitude. Dans une maison isolée des environs de Thomar, on découvre cloué à un mur un objet plat sanguinolent, affreux. Au-dessus, un écriteau : « Peau d’un dragon français écorché vif». Les Anglais, au cours de leur avance, verront dans un champ un cercle de feu : c’est de la paille qu’on brûle et, dans le cercle, un blessé français se traîne; chaque fois qu’il. est sur le point de sortir du brasier, on l’y rejette a coups de fourche. Oter ce malheureux à ses bourreaux ne fut pas facile.
(p.305) Après la reddition de Baylen, les soldats de Dupont et Vedel s’étaient mis en marche le 23 juillet 1808 à 4 heures du matin. Ils ne savaient pas qu’ils iraient sur les pontons. Les accords d’Andujar prévoyaient expressément leur rapatriement en France. J’ai raconté un peu dans un précédent chapitre leur terrible cheminement vers le sud. Ils avaient été répartis en deux colonnes. La première colonne suivit la rive gauche du Guadalquivir. Conformément aux accords, les officiers avaient conservé leurs armes, leurs chevaux, leurs voitures, leurs fourgons, et les soldats avaient gardé leur sac. L’escorte était constituée d’un bataillon d’infanterie de Murcie et de cent cavaliers espagnols .
Le premier soir, à l’arrivée au bourg de Bujalance, Ie chef de l’escorte dit au général Dupont que les soldats de cette colonne seraient logés chez l’habitant. Heureusement, une femme révéla que douze cents miliciens et guerilleros entouraient le bourg, décidés à égorger les Français pendant la nuit. On bivouaqua à l’entour et l’on repartit. J’ai dit quelques mots de la haie d’insultes, de menaces et de crachats qui se formait au passage de chaque agglomération. «Tout prisonnier qui s’écartait pour un besoin ou qui, n’écoutant que sa faiblesse, ne suivait pas la colonne, a raconté Henri Ducor, marin de la Garde impériale, les habitants accouraient pour le massacrer. Nous n’avions qu’à nous retourner pour être témoins de ces assassinats et, ne l’eussions-nous pas fait, des cris lamentables et les chants barbares des égorgeurs ne nous révélaient que trop ce qui se passait. Femmes, enfants, vieillards, tous s’en mêlaient.»
|
|
Els Fiers, Over ‘Goya Graveur’, een tentoonstelling , in: Focus Knack 16/04/08, p.88
De gruwelijke Desastres gaan over de « inval van Napoleon en de onafhankelijkheidsstrijd in het begin van de 19e eeuw. Nadat hij door Spanje was gereisd legde Goya schokkende executies, verkrachtigen, verminkingen en hongersnood vast in verbluffende gravures, maar omdat het klimaat te gespannen was, werd de série angstvallig geheimgehouden. Pas 35 jaar na de dood van de kunstenaar kwamen de Desastres in de openbaarheid.
|
|
Georges Jacquemin, Les Boteresses liégeoises à la Butte du Lion de Waterloo ? (1826), éd. Collet, 2000
(p.24) L’Espagne la connut : » Goya… a croqué l’ âme altière de ce peuple en rébelllion contre l’occupation de son pays par les Français,., Il a vécu et ressenti, au plus profond de son être, cette .guérilla sans merci que le peuple espagnol menait contre l’ennemi.., Il est le témoin angoissé… de la révolte des Madrilènes le ((dos de mayo » (le 2 mai 1808), du massacre de ses concitoyens le lendemain (le » tres de mayo »), des violences, des répressions sanguinaires et du martyre du peuple espagnol, événements qu’il fixe en des images cruelles et désespérées dans les gravures des « Désastres de la guerre » où, en soixante eaux-fortes, il perpétue l’hallucinant souvenir de toutes les horreurs que peut commettre.,. une soldatesque déchaînée.» (Fr. Frings, » Guide 1815”, 1997, n° 47.)
|
|
Joachim Kannicht, Und alles wegen Napoleon, Bernard & Graefe Verlag, 1986
(Spanien) (p.114) General Grouchy hatte Befehl erhalten, von der Alcala Strasse anzurücken und die Zusammenrottungen von über 20 000 Menschen hier und auf den umliegenden Plätzen aufzulösen. Dreissig Kartätschenschüsse (aus Kanonen) und einige Kavallerieangriffe »reinigten« alle StraBen. Aus Fenstern wurde auf die Soldaten geschossen. Die Brigadegenerale Guillot und Daubrai liessen daraufhin die Tiïren von Häusern einschlagen, und wer mit der Waffe in der Hand oder beim Schiessen erwischt wurde, wurde auf der Stelle niedergemacht. Unterdessen zogen die Aufrührer ins Zeughaus ein, um sich der 28 Kanonen und der zehntausend dort gelagerten Flinten zu bemächtigen. Aber General Lefranc, der mit seiner Brigade im Kloster San Bernardine einquartiert war, griff mit einem Regiment im Sturmschritt ein und liess alle Eindringlinge im Arsenal niedermetzeln. (p.120) Während des Guerillakrieges kamen 1808 auf einen spanischen Guerillero etwa fünf französische Soldaten. Nach modernen Gesichtspunkten waren das relativ viele spanische Guerilleros, denn bei den »modernen Kleinkriegen« standen in Malaya Anfang der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts nie mehr als 5000 kommunistische Partisanen nahezu 250 000 Soldaten und Polizisten gegenüber; Ende der fünfziger Jahre kämpften jeweils höchstens 30 000 algerische Aufständische gegen nahezu 500 000 französische Soldaten. (p.122) Wenngleich die meisten Hannoveraner »königstreu« waren, kämpften doch auch einige unter französischer Fahne . Bei dem Vormarsch auf Valladolid im Dezember 1808 zum Beispiel stiessen die Kavalleristen der Vorhut Moores auf französische Beitreibungskommandos, unter denen sich ein Zug hannoverscher Jäger befand. Zum Korps des französischen Armeeführers Soult gehörte das Regiment «Chasseurs hannovriens« in der Brigade Franceschi. Valladolid war zu dieser Zeit von Franceschi mit 200 französischen und 400 hannoverschen Jägern besetzt. Bei (p.123) anschliessenden Gefechten trafen die unter englischer und französischer Fahne kämpfenden Hannoveraner aufeinander; die französische hannoversche Legion hatte zehn Tote und 13 Verwundete. (p.123) « Noch verlustreicher ging es bei Fuentes de Oro Anfang Mai 1811 zu. Da die auf französischer Seite eingesetzte hannoversche Infanterie rote Waffenröcke trug, wurde sie von einer französischen Batterie mit Kartätschen beschossen. Man hatte sie für Engländer gehalten. Dieser Irrtum kostete über 100 Tote und noch mehr Verwundete unter den hannoverschen Legionären. (p.171) Den Waffenstillstand vom 2. Juni verstanden die gegen Napoleon Verbündeten fur sich zu nutzen. Österreich und Schweden hatten sich inzwischen der Allianz England-Preussen-Russland angeschlossen. So waren sie den etwa 700 000 Franzosen um 100 000 Soldaten überlegen. Sicher bewirkte auch die Unerfahrenheit der Soldaten Napoleons, dass der Kaiser keinen Erfolg mehr erringen konnte, doch vor allem war es der Taktik der Alliierten zuzuschreiben, dass Napoleon schliesslich im Oktober 1813 bei Leipzig gestellt und unter hohen Verlusten an Toten, Verwundeten, Gefangenen und Uberläufern geschlagen wurde. In der Völkerschlacht von Leipzig fiel die Entscheidung über die Befreiung Deutschlands. Der Angriff auf Frankreich begann. Napoleon verstand es zwar mit aller Meisterschaft, seine Truppen hinter den Rhein zurückzuführen, doch wieder war er gezwungen, eine neue Armee aus dem Boden zu stampfen. Alte Männer und fast noch Knaben wurden zu den Waffen gerufen. Über 100 000 Mann verteidigten östlich des Rheins noch befestigte Städte, zum Beispiel Hamburg, und etwa noch einmal soviel wehrten sich gegen den vorrückenden Wellington in Süd-Frankreich.
|
|
Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, éd. Flammarion, 2006
(p.84) Comme les Vendéens ou les paysans français, les Espagnols sont rejetés aux franges de l’humanité par les officiers qui traversent le pays : « Ces Espagnols toutefois étaient d’une saleté repoussante. Chez eux, nul bien-être, une nourriture épouvantable, un abêtissement complet ; ils vivaient couverts de vermine sous le même toit que leurs animaux ; nulle instruction, nul développement de l’intelligence ; les prêtres et les moines régnaient en maîtres sur cette population superstitieuse et sans libre arbitre2. »
Avant les méthodes mises en œuvre par Bugeaud en Afrique, Soult décide, « pour dompter toute résistance dans l’Aragon et purger les montagnes de toute guérilla », de mettre sur pied des colonnes mobiles, « unités de composition variable, créées à la demande, qui ont pris en Espagne, dans cette guerre fluide et vaporeuse, une importance croissante »3. Le général Thiébault, gouverneur de Bur-gos, qui recourt avec succès à ce système, en élabore même un véritable mode d’emploi : « À force de marches et de contremarches, de crochets,
1. J.-L. Reynaud, Contre-guérilla en Espagne, 1808-1814, Economica, 1992, p. 31. 2. Témoignage du capitaine Aymonin rapporté in G. Bapst, Le Maréchal Canrobert, p. 87. 1. J.-L. Reynaud, Contre-guérilla en Espagne, 1808-1814, p. 98.
(p.85) de ruses, d’embuscades, en faisant des trajets réputés impossibles, grâce au secours de quelques espions et […] au soin que je prenais de tromper jusqu’à mes aides de camp et mes secrétaires sur mes moindres projets, je ne marchais jamais contre ces guérillas sans les joindre, sans les battre1. » La prise de Saragosse, à laquelle Bugeaud, qui n’était encore que chef de bataillon, participe, donne lieu à des combats tout aussi intenses et tout aussi meurtriers que ceux de Constantine : après cinquante-deux jours d’un terrible siège, commencé le 20 décembre 1808, le premier assaut est donné le 11 janvier 1809. Mais pour conquérir la ville, vingt-trois jours de combats, rue par rue, maison par maison, sont encore nécessaires. Le 21 février, les derniers défenseurs capitulent. Près de 60 000 Espagnols sont morts, dont un grand nombre de civils. Un dernier rapprochement : le général Loison, qui fit massacrer, en 1808, la population de la ville d’Evora, au Portugal, devient un véritable croque-mitaine pour les Espagnols
1.Mémoires du général baron Thiébault, t. IV, Pion, 1896, p. 357.
|
|
Jean Burnat, G.H. Dumont, Emile Wanty, Le dossier Napoléon, éd. Marabout, 1962
(p.172) (…) l’Espagne lui offrait un genre de guerre pour lequel il n’avait aucune aptitude. On l’a vu : ce qu’il savait faire avec une singulière supériorité, c’était de combiner une hardie et rapide offensive, et de frapper l’adversaire d’un coup irrémédiable ; et c’est ce qu’il venait d’exécuter victorieusement à Ratisbonne et à Wagram ; mais, pour cela, il fallait que cet adversaire ne se dérobât pas à l’offensive. Or, l’Espagne n’offrait ni Wagram, ni Iéna, ni Austerlitz à son envahisseur : partout l’insurrection, des bandes qui harcèlent l’ennemi, des troupes qui, vaincues, se rallient, des sièges, qui ne finissent pas, puis, à côté, une armée anglaise solide, capable de porter les plus rudes coups, mais en même temps habile à refuser les conflits où elle n’a pas mis de son côté les chances. Que Napoléon ait été impuissant à mener une pareille guerre, le fait le prouve ; pendant les années de 1810 et de 1811, où il fut en paix avec le reste de l’Europe, il employa vainement les immenses forces de son Empire, ses armées si vaillantes, ses maréchaux si renommés, à lutter contre les citadins et les paysans de l’Espagne, contre la petite armée de Wellington.
E. Littré, de l’Institut.
|
|
WIKIPEDIA
Soulèvement du Dos de Mayo
Dos de Mayo
Le soulèvement du Dos de Mayo (Levantamiento del 2 de mayo, soulèvement du 2 mai) de 1808 est le nom sous lequel on désigne la rébellion du peuple madrilène contre l’occupation de la ville par les Français, et qui s’étendit dans toute l’Espagne. Il marque le début de la Guerre d’indépendance espagnole. Il est aujourd’hui célébré dans la Communauté autonome de Madrid comme « Jour de la communauté » (Día de la Comunidad, équivalent pour la région d’une fête nationale). Sommaire 2 ¡Que nos lo llevan! (Ils nous l’enlèvent !)
Antécédents
Depuis les événements du Soulèvement d’Aranjuez (17 mars 1808) pendant lesquels le roi Charles IV a abdiqué en faveur de son fils Ferdinand VII, Madrid est occupée par le général Murat (23 mars). Ferdinand VII revient à la cour, salué par les acclamations du peuple de Madrid. Napoléon l’invite à le rejoindre à Bayonne. Le 20, Ferdinand VII passe la frontière, espérant, lors de cette réunion, se faire reconnaître comme roi d’Espagne. Son père demande à se joindre à eux et arrive à Bayonne le 30 avril, escorté par les troupes françaises. En fait, Napoléon par ses pressions, obtient l’abdication de Charles IV et de Ferdinand VII en faveur de Joseph Bonaparte (futur Joseph Ier). À Madrid, une Junta de Gobierno représente le roi Ferdinand VII. Cependant, le pouvoir effectif reste entre les mains de Murat, lequel a réduit la Junta de Gobierno à un rôle de simple marionnette ou de simple spectatrice des événements. Le 27 avril, Murat sollicite, théoriquement au nom de Charles IV, l’autorisation de conduire à Bayonne la reine d’Étrurie (fille de Charles IV) et l’infant François de Paule. Au début, lors de la réunion dans la nuit du 1er au 2 mai, la junte refuse, puis finalement cède à la suite des instructions de Ferdinand VII, amenées par un émissaire arrivé de Bayonne (« conserver la paix et l’harmonie avec les Français »). ¡Que nos lo llevan! (Ils nous l’enlèvent !) Le 2 mai 1808, la multitude commença à se concentrer devant le palais royal. La foule vit comment les soldats français amenaient hors du palais la reine d’Étrurie. Sa sortie ne produisit aucun choc. La présence d’une autre voiture a fait penser qu’elle était destinée à l’infant François de Paule. Excitée par José Blas de Molina et aux cris de ¡Que nos lo llevan! (Ils nous l’enlèvent!), la foule pénétra dans le palais. L’infant apparut à un balcon augmentant l’agitation sur la place. Les deux officiers français chargés du transfert, le colonel Auguste Lagrange et Michel Desmaisieres furent sauvés par une patrouille passant par là. Ce tumulte est exploité par Murat, qui dépêche un bataillon de grenadiers de la Garde impériale au palais, accompagnés par de l’artillerie, lesquels tirent sans sommations sur la foule déchaînée. Cette foule se disperse dans tout Madrid aux cris de Mort aux Français. La lutte va s’étendre à Madrid et durera pendant des heures. Le combat de rues[modifier Les madrilènes durent découvrir en cet instant les conditions de la guerre de rues : constitution de bandes de quartier commandés par des chefs improvisés ; obligation de trouver des armes (ils luttaient avec des couteaux face à des sabres) ; nécessité d’empêcher l’arrivée de nouvelles troupes françaises. Tout cela ne fut pas suffisant et Murat put mettre en pratique une tactique aussi simple qu’efficace. Quand les madrilènes ont voulu se rendre maîtres des portes de l’enceinte de Madrid pour empêcher l’arrivée des forces françaises cantonnées hors de Madrid, le gros des troupes de Murat (quelque 30 000 hommes) avait déjà pénétré dans la cité, faisant un mouvement concentrique pour entrer dans Madrid. Cependant la résistance à l’avance des Français fut beaucoup plus efficace que ce qu’avait prévu Murat, spécialement à la Porte de Tolède, la Puerta del Sol et le Parc d’Artillerie de Monteleón ; cette opération permit à Murat de mettre Madrid sous la juridiction militaire, et de traiter les madrilènes comme des rebelles. Il plaça également sous ses ordres la Junta de Gobierno. L’un après l’autre, les foyers de résistance vont tomber. À la rue d’Alcala et sur la Puerta del Sol, les chasseurs à cheval de la Garde impériale, appuyés par les mamelouks, dispersent les manifestants[1]. Les soldats de Napoléon exercent leur cruauté sur le peuple madrilène. Des centaines d’Espagnols, hommes et femmes, et des soldats français meurent dans cet affrontement. Le tableau de Goya La Charge des Mamelouks reflète les combats de rue qui se sont produits ce jour. Daoíz et Velarde Mort de Pedro Velarde y Santillán durant la défense du Parc d’artillerie de Monteléon, par Joaquín Sorolla (1884). Pendant ce temps, les militaires espagnols restent passifs dans leurs casernements, suivant les ordres du capitaine général Francisco Javier Negrete. Seuls les artilleurs du parc d’Artillerie situé au Palais de Monteleón désobéissent aux ordres et rejoignent l’insurrection. Les héros de plus haut grade seront les capitaines Luis Daoíz y Torres (qui assume le commandement en tant que plus âgé) et Pedro Velarde Santillán. Avec leurs hommes ils se retranchent dans le Parc d’Artillerie de Monteleón. Ils y sont assaillis par les troupes westphaliennes du général Lefranc. Mais ces derniers sont repoussés par une défense acharnée. Faisant alors venir deux pièces d’artillerie, les Français ouvrent le feu sur les Espagnols. Plusieurs colonnes françaises, couvertes par les canons, chargèrent les défenseurs du Parc d’Artillerie. Mais encore une fois, l’héroïque défense parvint à repousser les Westphaliens. Voulant en finir, Lefranc lança deux bataillons qui chargèrent les insurgés à la baïonnette. Cette fois, les Espagnols furent enfoncés. Daoiz et Velarde furent tués, ainsi que nombres de leurs hommes, tandis que d’autres étaient fait prisonniers. Les insurgés en armes Le Deux Mai 1808, ce ne fut pas la rébellion de tous les Espagnols contre l’occupant français, mais celui du peuple espagnol contre un occupant toléré (par indifférence, peur ou intérêt) par un grand nombre des membres de l’Administration. La Carga de los Mamelucos (la Charge de Mamelouks) de Goya, représente les principales caractéristiques de la lutte : professionnels parfaitement équipés (les mamelouks ou les cuirassiers) juchés sur de grands chevaux qui dominent la populace à pied, seulement armée de couteaux ou de fusils archaïques ; présence active dans le combat de femmes, dont certaines perdront la vie (Manuela Malasaña ou Clara del Rey) ; présence quasi exclusive du peuple et de certains militaires. La répression La répression est cruelle. Murat ne se contente pas d’avoir écrasé le soulèvement mais a trois objectifs: contrôler l’administration et l’armée espagnoles; appliquer un châtiment rigoureux aux rebelles pour servir de leçon à tous les Espagnols; et montrer que c’est lui qui gouverne l’Espagne. Le soir du 2 mai, il signe un décret qui crée une commission militaire, présidée par le général Grouchy pour condamner à mort tous ceux qui ont été arrêtés avec les armes à la main (Seront fusillés tous ceux qui durant la rébellion ont été pris avec des armes). Le Conseil de Castille publie une proclamation selon laquelle est déclarée illicite toute réunion dans des lieux publics; on ordonne la remise de toutes les armes, blanches ou à feu. Des militaires espagnols collaborent avec Grouchy dans la commission militaire. Dans un premier temps, les classes dirigeantes paraissent préférer le triomphe des armes de Murat plutôt que de celles des patriotes, composés uniquement par les classes populaires. Au Salón du Prado et dans les champs de La Moncloa, on fusilla des centaines de patriotes. Quelques milliers d’Espagnols moururent sans doute lors du soulèvement et des exécutions qui suivirent. De leur côté, les Français perdirent ce jour-là 60 officiers et 900 hommes du rang. Conséquences Statue érigée à Santander à la mémoire du capitaine d’artillerie Pedro Velarde Santillán, héros cantabre de la Guerre d’indépendance espagnole tué pendant le soulèvement du 2 mai 1808 de Madrid. Murat pensait, sans doute, en avoir fini avec les élans révolutionnaires des Espagnols, en leur inspirant une terreur effrayante (garantissant pour lui-même la couronne d’Espagne). Cependant, le sang répandu ne fit qu’enflammer le courage des Espagnols. Il donna le signal du début de la lutte dans toute l’Espagne contre les troupes d’invasion. Ce même 2 mai, dans la soirée, dans la ville de Móstoles devant les nouvelles horribles qu’apportaient les fugitifs de la répression dans la capitale, un homme politique de premier plan (Secrétaire del Almirantazgo y Fiscal del Supremo Consejo de Guerra), Juan Pérez Villamil fit signer par les alcaldes du village (Andrés Torrejón et Simón Hernández) un édit dans lequel tous les Espagnols étaient appelés à prendre les armes contre l’envahisseur, en commençant par accourir au secours de la capitale. Cet édit, d’une manière indirecte, provoqua le soulèvement général. Les débuts de celui-ci furent marqués par les mesures du corregidor de Talavera de la Reina, Pedro Pérez de la Mula, et de l’alcalde de Trujillo, Antonio Martín Rivas; tous les deux organisèrent des listes de volontaires, avec des vivres et des armes, pour venir en aide à la Cour. Guerre d’indépendance espagnole Cet article traite de la guerre de 1808-1814, appelée également Guerre d’Espagne. Pour la guerre d’Espagne de 1936-1939, voir l’article Guerre d’Espagne La guerre d’indépendance espagnole est une guerre qui opposa la France et l’Espagne à partir de 1808. Ce conflit porte différents noms selon les pays : campagne d’Espagne pour les Français, ou encore guerre d’Espagne (à ne pas confondre avec d’autres conflits désignés aussi sous le même terme), guerre d’indépendance pour les Espagnols, guerre péninsulaire pour les Portugais et les anglophones, guerre du français pour les Catalans. La guerre commence en 1808 lorsque Madrid se souleva contre l’armée française stationnée dans la capitale espagnole. L’insurrection se généralise à tout le pays après que Napoléon obtient l’abdication du roi d’Espagne au profit du frère de l’empereur, Joseph. L’armée française se heurta à une guérilla, puis à l’armée britannique, venue aider le Portugal. Débordés, les soldats de l’empereur durent refluer en deçà des Pyrénées en 1813. L’invasion de la France par les Espagnols, Britanniques et Portugais commandés par Wellington, devenait imminente. Sommaire 3 Constitution espagnole de 1812 4.1 Conséquences des opérations 4.2 Liste des batailles et combats
Origines Articles détaillés : Invasions françaises au Portugal et Ordre de bataille de l’armée de Portugal. La défense du parc d’artillerie de Montéléon par Joaquín Sorolla y Bastida. L’Espagne était, après le traité de San Ildefonso signé par le prince Manuel Godoy en 1796, une fidèle alliée de la France et c’est avec elle qu’elle subit la terrible défaite de Trafalgar en 1805. La perte de toutes communications avec ses colonies d’outre-mer lui fit rechercher des compensations territoriales sur le royaume voisin du Portugal, ceci avec le soutien de Napoléon. En effet, la monarchie portugaise était un fidèle allié du Royaume-Uni et refusait de fermer ses ports aux navires anglais. Ce fut la guerre dite des oranges qui se conclut le 6 juin 1801 par le Traité de Badajoz (1801). En 1807, le Portugal refusant d’appliquer le Blocus continental, Napoléon décida d’envoyer ses troupes dans la péninsule, officiellement pour envahir le Portugal qui représentait une faille notable dans son dispositif. Avec le Traité de Fontainebleau signé avec Charles IV, il obtint l’autorisation pour ses troupes, commandées par le général français Jean-Andoche Junot, de traverser l’Espagne pour châtier les portugais. Ainsi débute la première tentative d’invasion du Portugal (18 octobre 1807). Napoléon commença alors à se mêler des affaires espagnoles. Sous prétexte d’envoyer des renforts à Junot, il fit entrer en Espagne une armée commandée par Murat comme l’y autorisait le traité de Fontainebleau. À ce moment, un coup d’État dirigé en sous-main par l’infant Ferdinand, renversa le roi Charles IV. Ferdinand, devenu Ferdinand VII, prit le pouvoir. Le roi déchu en appela à l’arbitrage de Napoléon. Celui-ci convoqua le père et le fils à la conférence de Bayonne (avril-mai 1808). Voyant l’état de décrépitude de la monarchie espagnole, l’empereur tenta de profiter de la situation pour mettre la main sur l’Espagne. Ses conseillers le poussaient : le ministre Champagny écrivait par exemple : « il est nécessaire qu’une main ferme vienne rétablir l’ordre dans son administration [celle de l’Espagne] et prévienne la ruine vers laquelle elle [l’Espagne] marche à grands pas »[1]. Habitué à sa popularité et à la docilité de l’Italie et des Polonais, Napoléon crut bien sincèrement que les afrancesados (les partisans des Français) constituaient la majorité des espagnols ; il se trompa grandement[2]. À Madrid, des rumeurs affirmaient que la famille royale espagnole était retenue en otage par Napoléon à Bayonne. Le 2 mai 1808, appréhendant l’enlèvement de l’infant de la famille royale par la France, la population madrilène se souleva contre les troupes françaises, au moment même où Ferdinand et Charles se disputaient le trône d’Espagne devant l’Empereur. La rébellion fut écrasée dans le sang par Murat. Le célèbre tableau de Goya, Tres de mayo, rappelle les fusillades nées de cette répression. Napoléon crut pouvoir poursuivre son objectif : il força les deux souverains à abdiquer puis offrit la couronne vacante à son frère Joseph. C’était une grave erreur d’appréciation. L’Empire s’engageait dans une guerre contre toute la péninsule qui allait miner ses forces pendant près de six ans. Descriptif des opérations Cruelle guérilla La Reddition de Bailén par José Casado del Alisal (1864). Le guet-apens de Bayonne déclencha l’embrasement de l’Espagne. Malgré sa rapide répression, le soulèvement de Madrid inspira d’autres villes du pays : Carthagène, León, Santiago, Séville, Lérida et Saragosse. L’armée française était partout attaquée. Le 18 juillet 1808, le général Pierre Dupont de l’Étang et ses 20 000 hommes furent vaincus près de la petite ville andalouse de Bailén. Ce fut la première défaite retentissante de l’armée impériale en Europe continentale. En soi la défaite ne rendait pas la situation militaire des Français catastrophique mais elle eut un énorme impact psychologique pour leurs ennemis : les soldats de Napoléon pouvaient être battus. Deux jours plus tard, malgré cet échec, Joseph Bonaparte, le nouveau roi d’Espagne, parvint à entrer à Madrid. Mais il ne put y rester longtemps. De son côté, le général Junot dut évacuer le Portugal face à l’offensive des Britanniques du futur duc de Wellington. La dégradation de la situation inquiétait Napoléon. L’empereur se rendit en personne en Espagne, à la tête de 80 000 soldats qu’il avait tirés d’Allemagne. Il ne resta que quelques mois (novembre 1808-janvier 1809) en Espagne mais son intervention assura la reprise en main des villes par les Français. Madrid, menacé d’un assaut, ouvrit ses portes au conquérant. Le 4 décembre 1808, dans une proclamation qu’il adressa aux habitants, il menaça de traiter l’Espagne en pays conquis, si elle persistait à ne pas reconnaître Joseph Napoléon pour roi[3]. À regret, les Madrilènes virent une nouvelle fois le frère de l’empereur s’installer au palais royal. Malgré la brillante campagne napoléonienne et les réformes mises en place (abolition des droits féodaux et de l’Inquisition), le pays était loin d’être soumis. Le contrôle des campagnes restait difficile. Les prêtres espagnols appelaient leurs fidèles à la croisade contre les Français. Les difficultés de l’occupant résidaient surtout dans la particularité du combat : les espagnols pratiquaient la guérilla[4]. Si les Français remportaient régulièrement des victoires contre l’armée régulière espagnole et prenaient d’assaut les villes, ils peinaient contre les petits groupes de résistants embusqués qui les harcelaient. C’est aussi à cette époque que débuta la seconde tentative d’invasion française au Portugal commandée par le maréchal Soult. Elle se traduit par un nouvel échec français (février à mai 1809). Guerre civile La guérilla réussit à provoquer l’enlisement du conflit. Les Français, qui avaient affaire à une hydre à mille têtes, ne manquaient pourtant pas de partisans, qu’on appelait afrancesados. Pour beaucoup imprégnés des idées des Lumières, ces derniers espéraient que l’occupation française mette à bas la féodalité et l’absolutisme espagnols. Cette guerre d’Espagne se doublait donc d’une guerre civile. Des atrocités – saccages, viols, profanations, agressions sadiques – furent commises par tous les camps. Contre-attaque[modifier | modifier le code] Malgré les problèmes rencontrés en Espagne, Napoléon décide d’engager des moyens considérables pour venir à bout du Portugal (juillet 1810). Il confie au maréchal Masséna la conduite de la troisième invasion napoléonienne au Portugal, la coalition anglo-portugaise étant commandée par Wellington. L’invasion française se heurte à une politique de la terre brûlée terriblement efficace et vient buter contre les lignes de Torres Vedras construites dans le plus grand secret. Après avoir chassé les Français du royaume portugais, Wellington poursuit son offensive en Espagne avec la bataille de Fuentes de Oñoro (mai 1811) et le siège de Ciudad Rodrigo (1812) qui permettent à Wellington d’avancer vers Madrid. Constitution espagnole de 1812 Le 19 mars 1812, à Cadix, les Cortes adoptent la première Constitution espagnole. La Constitution a été appelée La Pepa, nommé pour avoir été promulguée le jour de Saint Joseph (étant Pepe un surnom de Joseph en espagnol). Cette constitution n’a pas toujours été appliquée. Elle fut abrogée et rétablie deux fois. Elle a cependant eu un rayonnement assez exceptionnel[réf. nécessaire]. Elle est en partie inspirée de la Constitution française de 1791 puisqu’elle opte pour un monocaméralisme et est aussi inspirée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle consacre d’importants droits de l’homme et notamment un suffrage universel masculin. Cette Constitution a été appliquée à Naples et à Turin et a largement influencé la Russie, dans la mesure où cette constitution s’appliquait aux Indes, alors colonies espagnoles[réf. nécessaire]. La Constitution de Cadix a eu une influence non négligeable puisque certaines de ses dispositions se retrouvent dans la Constitution espagnole actuelle. Conflit international Reis à l’effigie d’Emmanuel II et célébrant le centenaire de la Guerre péninsulaire, 1910. La campagne de Russie obligea l’empereur à dégarnir de troupes l’Espagne. Wellington en profita et pénétra à Madrid le 11 août 1812, les troupes britanniques, espagnoles et portugaises ayant battu les troupes françaises lors de la bataille de Salamanque, le 22 juillet. Le 3 novembre, Joseph put retourner dans la capitale espagnole. Mais ce n’était que le dernier sursaut. En quelques semaines, de mai à juillet 1813, Joseph et l’armée française reculèrent jusqu’aux Pyrénées. Napoléon comprit sa défaite et accepta, par le traité de Valençay, le retour de l’ancien roi d’Espagne, Ferdinand VII, dans son royaume. Début 1814, la Catalogne était reconquise par les Espagnols. La guerre d’Espagne s’achevait, mais à l’inverse débutait pour les Hispano-Britanniques la campagne de France qui allait amener la chute de Napoléon. Conséquences des opérations Dans le domaine socio-économique, le coût de la guerre en Espagne fut une perte nette de la population de 375 000 à 215 000, cause directe de la violence et de la famine de 1812, qui a ajouté à la crise des maladies et les épidémies de la famine de 1808, résultant en un solde de population qui déclina de 885 000 à 560 000 personnes qui a particulièrement touché la Catalogne, l’Estrémadure et l’Andalousie. Une perturbation sociale et la destruction des infrastructures de l’industrie et de l’agriculture mirent en faillite l’Etat. Une dévastation humaine et matérielle du pays, privé de sa puissance navale et exclus des principales questions discutées lors du Congrès de Vienne, où le paysage géopolitique ultérieure de l’Europe fut ajouté. Outre-Atlantique, l’Amérique espagnole a obtenu son indépendance après la guerre hispano-américaine de l’Indépendance. Sur le front politique intérieur, le conflit a forgé l’identité nationale espagnole et a ouvert les portes au constitutionnalisme, entraîné dans les premières constitutions du pays, le statut bonapartiste de Bayonne et de la Constitution de Cadix. Cependant, il a également lancé une ère de guerre civile entre les partisans de l’absolutisme et du libéralisme, appelé guerres carlistes, qui pourraient en étendre au XIXe siècle et qui ont marqué l’évolution du pays. Liste des batailles et combats 1808 15 juin – 13 août : Siège de Saragosse (1808) 14 juillet : Bataille de Medina del Rio Seco 19 au 22 juillet : Bataille de Bailén (capitulation française : le général Dupont est fait prisonnier avec environ 20 000 hommes, qui finissent sur les pontons de Cadix) 31 octobre : Bataille de Durango, victoire incomplète 5 novembre : Bataille de Valmaseda 7 novembre : Bataille de Burgos 10–11 novembre : Bataille d’Espinosa 23 novembre : Bataille de Tudela 30 novembre : bataille de Somosierra 20 décembre–2 février 1809 : Siège de Saragosse (1809) 21 décembre : Bataille de Sahagún 29 décembre : Bataille de Benavente
1809
1er janvier : Bataille de Castellón de Ampurias 16 janvier : Bataille de La Corogne 25 février : Bataille de Valls 17 mars : Bataille de Villafranca 28 mars : Bataille de Medellín 6 mai – 12 décembre : Siège de Gérone 27 juillet : Bataille de Talavera 11 août : Bataille d’Almonacid 19 novembre : Bataille d’Ocaña 28 novembre : Bataille d’Alba de Tormes
1810 Arthur Wellesley de Wellington par Francisco Goya. 26 avril – 10 juillet : Siège de Ciudad Rodrigo (1810) 25 juillet – 27 août: Siège d’Almeida 27 septembre : Bataille de Buçaco Octobre : arrêt des Français devant Torres Vedras 1811[modifier | modifier le code] 19 février : bataille de Gebora 10 avril–19 août : siège de Figueras 5 mai : bataille de Fuentes de Oñoro 23 juin : bataille de Benavides 25 octobre : bataille de Sagonte 19 décembre 1811 – 5 janvier 1812 : siège de Tarifa
1812 8–19 janvier : Siège de Ciudad Rodrigo (1812) 16 mars–6 avril : Siège de Badajoz 22 juillet : Bataille des Arapiles (ou Bataille de Salamanque) 18 septembre–22 octobre : Siège de Burgos (1812)
1813 Le maréchal Jean-de-Dieu Soult. 6 avril : combat de Valencia (général Boyer) contre les Espagnols 1er juin : combat de Barnes (général Coureux) contre les Espagnols 21 juin : bataille de Vitoria (Joseph Ier et le maréchal Jourdan) contre les hispano-luso-britanniques 28 juillet–1er août : Bataille de Sorauren 31 août : bataille de San Marcial 13 septembre : bataille d’Ordal (maréchal Suchet) contre les hispano-britanniques 13 septembre : combat de Villefranca (maréchal Suchet) contre les hispano-britanniques 4 octobre : combat de Saint-Privé-d’Embas (général Petit) contre les Espagnols 10 novembre : bataille de la Nivelle 10 décembre : combat de Bassussarry (maréchal Jean-de-Dieu Soult) contre les hispano-britanniques 9–12 décembre : bataille de la Nive 1814[modifier | modifier le code] 1er janvier 1814 : Bataille de Molins de Rey 27 février : Combat d’Orthez (maréchal Soult) contre les Luso-Britanniques 2 mars 1814 : Bataille d’Aire-sur-l’Adour 12 mars : Combat d’Urella (maréchal Soult) contre les Hispano-Britanniques 19 mars 1814 : Bataille de Vic-de-Bigorre 20 mars 1814 : Bataille de Tarbes 10 avril : Bataille de Toulouse (maréchal Soult) contre les Hispano-Britanniques Conséquences Napoléon l’avoua à Sainte-Hélène : « cette malheureuse guerre d’Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France ». On estime que le conflit retint 300 000 soldats français. L’Espagne fut un piège et un boulet pour la politique expansionniste de l’empereur. Les Espagnols gardent un fier souvenir de cette guerre. Unis malgré leur divergences, ils ont réussi à repousser l’armée française. Grande animatrice de la résistance, l’Église catholique retrouva une nouvelle vigueur. Toutefois, à la sortie de la guerre, le pays était dévasté. Il rata d’ailleurs le virage de la modernisation agricole et industrielle au XIXe siècle. Autre point négatif du côté espagnol, les colonies d’Amérique profitèrent de la guerre pour s’émanciper de la métropole. Enfin, alors que le retour de Ferdinand VII en 1813 nourrissait beaucoup d’espoirs chez ses sujets, son règne ne permit pas de résoudre la crise politique. Le front commun né de la lutte contre Napoléon se brisa. L’Espagne retrouva ses divisions entre libéraux et ultra-conservateurs. Les Espagnols, qui luttaient dans l’espoir de rétablir leur roi sur le trône, finirent par se révolter contre ce même roi en 1820. Notes et références ↑ « Il faut qu’un prince ami de la France règne en Espagne ; c’est l’ouvrage de Louis XIV qu‘il faut recommencer. Ce que la politique conseille, la justice l’autorise ! » ↑ Mullié affirme que « cette nation fière, qui était comme assoupie depuis assez longtemps, indignée de ce que des étrangers se permettaient de régler ses destinées, de changer la dynastie de ses rois sans la consulter, oubliant l’extrême faiblesse de ses moyens, jura l’extermination de tous les Français ; toutes les classes, tous les sexes, les prêtres, les moines, les religieuses, les mendiants feront tout ce qui dépendra d’eux pour repousser les armées du conquérant usurpateur de leurs droits. Les Espagnols se battent rarement en bataille rangée, mais ils parviendront à lasser, à détruire leurs ennemis par une guerre d’embuscade, de partisans, d’assassins. Pour atteindre ce but, le poignard, le poison, tous les genres de destruction, de vengeance, leur sembleront légitimes ; le sol de la péninsule deviendra pour les Français un véritable cimetière, où ils trouveront la mort sans profit et sans gloire. » ↑ « Je mettrai alors la couronne d’Espagne sur ma tête, et je saurai la faire respecter des méchants : car Dieu m’a donné la force et le caractère pour surmonter tous les obstacles. » ↑ L’historien Jean-René Aymes considère d’ailleurs cette guerre d’Espagne comme la première guerre de guérilla de l’histoire. Une thèse tout à fait contestable dans la mesure où la guérilla est la conséquence logique d’une guerre asymétrique. Sans porter officiellement le nom de « guérilla », le harcèlement des troupes britanniques par celles de Du Guesclin durant la guerre de Cent Ans en ont, par exemple, toutes les caractéristiques.
|
| Hernández Raquel, Castaños volvío a ganar, El P. 08/10/2005
La ciudad de Bailén (Jaén) recrea la batalla de 1808 que marcó el principio del ocaso del Imperio de Napoleón. La contienda significó la primera derrota de las tropas franceses, con la rendición de unos 20 000 soldados.
|
|
Arturo Pérez-Reverte, Una intifada de navaja y macetazo, EP 20/04/2008
Guerre de la independencia – La sublevación del 2 de mayo
|
|
in: Rives méditerranéennes 2010 : Le Portugal et Napoléon Raisons de la défaite de Napoléon au Portugal António Pedro Vicente
p. 13-26
Résumés
Entre 1801 et 1811, le Portugal a été le théâtre d’affrontements militaires que l’historiographie désigne souvent comme « Guerre d’Espagne ». Pourtant la position stratégique et commerciale du Portugal en faisait un enjeu en lui-même, comme le prouve l’intervention de Napoléon dès 1801. Les erreurs successives commises par l’armée française au cours des différentes campagnes conduisent à un échec programmé par l’impréparation des hommes, les dissensions des généraux et les aspects propres au terrain. Toutefois, elles servent aussi de révélateur à toutes les insuffisances de la conduite des opérations et, à ce titre, laissaient présager de la défaite en Espagne et sur d’autres terrains.
Between 1801 and 1811, Portugal was the theatre of military operations often called “Guerre d’Espagne” (Peninsular war) in historiography. The strategic and commercial importance of Portugal was a stake in itself which is revealed by Napoleon’s invasion as early as 1801. The French army’s repeated mistakes throughout the different campaigns entailed a defeat that was widely due to a lack of soldier’s training, differences of opinion between generals as well as particularities of the war zone. It also illustrates the deficiency in the command of the army which forecasted a defeat in Spain and on other battlefields.
· 1 António Pedro Vicente, « A influência inglesa em Portugal. Documentos enviados ao Directório e Con (…) · 2 Idem, Ibidem. · 3 « Olivença, Início da Expansão Napoleónica na Península », in Revista História, juin 2001. · 1L’histoire de l’épopée napoléonienne oublie généralement de mentionner que le Portugal a été le théâtre d’importantes batailles entre 1801 et 1811, période au cours de laquelle des soldats portugais ont combattu les forces françaises aux côtés des armées anglaises et espagnoles à travers la péninsule ibérique et jusqu’au sud de la France. Lorsque l’on étudie cette période profondément et pendant de nombreuses années, comme nous l’avons fait, on ne peut qu’être étonné par la désignation générale de Guerre d’Espagne donnée à cette épopée commencée par la Révolution Française et dont quelques années plus tard Napoléon, d’abord en tant que consul puis en tant qu’empereur, deviendrait le personnage principal. Celui-ci ne se rendit jamais au Portugal mais y envoya des émissaires ou des alliés dans le but d’avoir la mainmise sur une nation dont les frontières avaient été fixées depuis longtemps ; une nation dont la position stratégique était capitale pour le commerce international et d’une importance fondamentale pour son vieil allié l’Angleterre. Effectivement, ce pays trouvait sur les côtes portugaises, celles de ses colonies et des îles adjacentes, le meilleur port de refuge nécessaire au soutien de ses intérêts économiques, à une époque où ceux-ci avaient été mis à mal par l’indépendance des Etats-Unis. Il suffit de mentionner le Brésil pour évaluer à quel point l’Angleterre profitait d’une source de richesses vitale pour l’équilibre de son économie1. D’ailleurs, avant même que Napoléon ne devienne un homme politique important, de très nombreux patriotes français écrivaient au Directoire pour expliquer à ses dirigeants que le meilleur moyen de vaincre l’inexpugnable Albion était de conquérir le Portugal. Ce qui démontre bien, si besoin en était, que le Portugal était considéré comme le soutien fondamental au développement de son vieil allié2. Napoléon s’aperçut très tôt de l’importance stratégique du Portugal et estimait qu’il fallait le conquérir pour pouvoir concrétiser pleinement son projet d’unir l’Europe sous les ailes protectrices de l’aigle impérial3.
· 4 « Godoy e Portugal, uma leitura das suas Memórias » in O Tempo de Napoleão em Portugal, Lisboa, Co (…) 2En 1801, le Portugal est envahi sur son ordre et au nom de ses intérêts. À l’époque, Godoy, le puissant dirigeant espagnol, est convaincu qu’une coalition franco-espagnole viendra à bout de la suprématie anglaise et décide de s’allier à la France, poussé à la fois par son ambition et par la crainte de déplaire à Napoléon plus que par admiration pour lui. C’est ce que l’on peut déduire de la lecture attentive des Mémoires4 du politique espagnol rédigés au cours de son long exil, qui ne se terminent qu’à sa mort à Paris en 1851, ainsi que de la correspondance de Napoléon dans laquelle celui-ci exprime clairement son intention de commencer la conquête de la Péninsule Ibérique par le Portugal. Pour ce faire, il lève d’abord une armée commandée par son beau-frère, le général Leclerc, à laquelle il ajoute d’autres troupes placées sous le commandement du général Saint-Cyr. Godoy comprend très vite que l’Espagne ne gagnerait rien dans cette guerre dont la France serait la seule bénéficiaire et regretterait plus tard de n’avoir été qu’un jouet dans les mains du dictateur français. Cette invasion marque la première phase du projet de Napoléon de conquérir l’Espagne, projet que, grâce à d’habiles manœuvres politiciennes, il finirait par la mettre à exécution. · 5 « Olivença, início da Expansão Napoleónica em Portugal », art. cit. · 6 Idem. · 7 António Pedro Vicente, « Portugal perante a política Napoleónica dos Bloqueios Continentais à Inva (…) · 3 Dans cet essai sur la défaite des armées de Napoléon en territoire portugais, seront évoquées les raisons pour lesquelles la première incursion des forces napoléoniennes au Portugal a débouché sur l’échec de ses projets. Effectivement, avec cette première invasion, qui eut lieu en 1801, Napoléon poursuivait deux objectifs : d’une part conserver le soutien de l’Espagne et, d’autre part, une fois conquis le territoire portugais en totalité ou en partie – fait qui se concrétisa avec la conquête de la Province de l’Alentejo – négocier à son avantage avec les Anglais avec lesquels il était déjà engagé par le Traité d’Amiens. L’échange de ces territoires conquis, très importants pour l’ennemi lui permettait d’obtenir des avantages économiques dans d’autres régions alors en possession de l’Angleterre, notamment en Amérique5. Mais la trêve fut de courte durée, Godoy et Lucien Bonaparte, frère de Napoléon et ambassadeur de France en Espagne, signèrent un accord de paix qui n’allait absolument pas bénéficier à la France dans la mesure où ils s’étaientlimités à prendre possession de Olivença, négligeant les autres territoires conquis. Ainsi le traité de Badajoz servait-il les intérêts portugais faisant échouer tous les espoirs que Napoléon avait déposés dans « la monnaie d’échange » que le Portugal constituait potentiellement6. Les lettres que le consul français adressa à Talleyrand et à Lucien Bonaparte sont très claires et ne laissent aucun doute sur les projets qu’il nourrissait. En ce sens, cette première incursion se solda par un échec7.
· 8 Idem, Ibidem · 9 Lettres inédites de Napoléon Ier (An VIII — 1815), tome premier, (An VIII — 1809), deuxième éditio (…) · 4 Quant à la deuxième invasion, menée sous le commandement administratif et militaire de Junot, ancien ambassadeur de France au Portugal, elle aboutirait également à un échec dans la mesure où elle ne permettrait pas à Napoléon de concrétiser ses projets. Les contrariétés commencèrent dès que l’envahisseur entra dans Lisbonne sans avoir pu empêcher la fuite de la famille royale vers le Brésil. Junot ne s’empara ni du Régent ni de sa couronne et ainsi, contrairement à l’Espagne, le Portugal allait demeurer un pays indépendant. Par ailleurs, Junot, dont il était légitime de penser qu’il connaissait le pays et la mentalité de ses habitants, allait démontrer une incapacité totale à gouverner la nation occupée. En premier lieu, il ne comprit pas que l’Angleterre, qui jusque là avait hésité à s’engager aux côtés du Portugal, ne consentirait jamais à ce que lui soit retiré son allié le plus utile avec sa colonie du Brésil qui l’alimentait en produits de première nécessité pour le fonctionnement de son économie gravement atteinte par l’indépendance des États-Unis. Il négligea également le fait qu’un pays dans lequel l’indépendance était une tradition séculaire supporterait mal une quelconque tutelle, aussi douce fût-elle. Quant à la stratégie consistant à justifier l’invasion française comme une protection contre l’oppresseur anglais, elle fut un échec total et ne fit qu’alimenter les pamphlets virulents hostiles à la Révolution Française et à la politique qui s’ensuivit et qui peut être considérée comme la ‘troisième phase révolutionnaire’ suivant Jacques Godechot8. Les batailles de Columbeira, Roliça et Vimeiro, menées par les généraux de Junot contre les armées anglo-portugaises et remportées par les Anglais venus alors se porter en aide aux Portugais, constituent une preuve irréfutable de cette profonde défaite. D’ailleurs il suffit de lire la correspondance échangée entre Napoléon et Junot pour comprendre à quel point ce dernier ignorait tout de la mentalité portugaise. Napoléon faisait preuve de bien plus de lucidité et d’intelligence quant à la situation dans laquelle se trouvait Junot et aux risques que celui-ci courait en adoptant une attitude qui ne tenait pas compte de la réalité du pays occupé. Ainsi, dans sa lettre du 7 janvier 1808, répondant à une missive de Junot datée du 21 décembre, Napoléon affirme-t-il9 : « Je reçois votre lettre du 21 décembre. Je vois avec peine que, depuis le 1er décembre, jour de votre entrée à Lisbonne, jusqu’au 18, où ont commencé à se manifester les premiers symptômes d’insurrection, vous n’ayez rien fait. Je n’ai cependant cessé de vous écrire : Désarmez les habitants ; renvoyez toutes les troupes portugaises ; faites des exemples sévères ; maintenez-vous dans une situation de sévérité qui vous fasse craindre. Mais il paraît que votre tête est pleine d’illusions, et que vous n’avez aucune connaissance de l’esprit des Portugais et des circonstances où vous vous trouvez. Je ne reconnais pas là un homme qui a été élevé à mon école. Je ne doute pas que, en conséquence de cette insurrection, vous n’ayez désarmé la ville de Lisbonne, fait fusiller une soixantaine de personnes et pris les mesures convenables. Toutes mes lettres vous ont prédit ce qui commence à vous arriver et ce qui vous arrivera bientôt. Vous serez honteusement chassé de Lisbonne, aussitôt que les Anglais auront opéré un débarquement, si vous continuez à agir avec cette mollesse. Vous avez perdu un temps précieux, mais vous êtes encore à temps. J’espère que mes lettres, que vous aurez reçues successivement, vous auront fixé sur le parti à prendre, et que vous aurez adopté des mesures fortes et vigoureuses, sans vous repaître d’illusions et de bavardages. Vous êtes dans un pays conquis, et vous agissez comme si vous étiez en Bourgogne. Je n’ai ni l’inventaire de l’artillerie ni celui des places fortes ; je ne connais ni leur nombre ni leur situation. Je ne sais pas même si vous les occupez. Vous n’avez pas encore envoyé au ministre la carte de vos étapes depuis Bayonne jusqu’à votre première place forte, ni aucune note sur la situation du pays. J’avais cependant de fortes raisons de le désirer. Enfin je suis porté à croire que mes troupes ne sont pas encore dans Almeida. S’il arrivait quelque événement, vous vous trouveriez bloqué par les Portugais. Il y a dans tout cela une singulière imprévoyance. »
5 La teneur de la correspondance échangée entre Napoléon et Junot, comme celle de la lettre que nous venons de citer en partie, montre bien que ce dernier n’était pas l’homme de la situation. Après huit mois passés au Portugal il rentra en France. Une fois de plus, les intérêts de Napoléon étaient contrariés.
6 L’expédition de Soult constitue la troisième invasion, au service des intérêts expansionnistes de Napoléon en Europe et requiert une analyse sous plusieurs angles, seule à même de rendre compte des erreurs qui y furent commises et de leur poids dans la défaite. Après l’embarquement des troupes françaises, à la suite de la « Convention de Sintra », le pays se trouvait dans un état de totale anarchie surtout après le départ du général anglais Moore, qui, dans une certaine mesure, était parvenu à calmer les esprits les plus exaltés dans le nord du Portugal. Ainsi, les désaccords entre le commandement anglais et l’évêque de Porto ne cessaient d’augmenter du fait que celui-ci considérait sa ville comme le siège du gouvernement. Le peuple, alarmé par les rumeurs d’une nouvelle invasion, rendait encore plus ingouvernable le pays qui venait tout juste d’échapper à la tutelle des étrangers.
· 10 António Pedro Vicente, « A Legião Portuguesa em França : uma abertura à Europa » Lisboa, Actas do (…) · 7 Après la Convention de Sintra, l’Angleterre fit en sorte que soient respectés les intérêts du Portugal, qui depuis longtemps, jouaient en sa faveur face aux menaces françaises. Ajoutons que, dans l’intervalle entre l’invasion de Junot et celle de Soult, l’Espagne se trouvait pratiquement sous tutelle française, si l’on excepte la région de Cadix où allaient bientôt se réunir les Cortes qui contribueraient de façon décisive à l’installation du régime constitutionnel. Enfin, dans le court laps de temps qui sépare le départ de Junot de la nouvelle invasion, l’Angleterre continua à aider le Portugal. C’est ainsi que, à Porto, le colonel anglais Robert Wilson, demeurant à l’écart des dissidences politiques citées plus haut, équipa et disciplina un corps d’armée portugais et en fit deux bataillons d’infanterie, deux de cavalerie et une batterie d’artillerie qu’il baptisa Leal Legião Portuguesa (Loyale Légion Portugaise) en opposition au nom de Legião Portuguesa10 donné par Junot au corps d’armée formé par les dix mille combattants lusitaniens engagés aux côtés des armées napoléoniennes. C’est à cette même époque que le général anglais Beresford, qui avait été détaché à Madère, à partir de 1807 se rendit pour la deuxième fois en territoire portugais pour s’y voir confier l’organisation de l’armée portugaise.
8 Nous avons fait une brève allusion aux évènements liés à l’invasion menée par Soult. On le sait, le général Moore, avant de mourir au champ de bataille en Galice, avait réussi à repousser les armées de Junot, Ney et Soult, soit près de 60.000 hommes, loin des frontières portugaises. Napoléon ordonna alors à Soult qu’après avoir anéanti l’armée anglaise, fortement ébranlée par la mort de son commandant, de marcher sur le Portugal et d’occuper la ville de Porto au début du mois de février 1809. Pour l’aider dans sa tâche, le général Victor s’installerait à Mérida et menacerait Lisbonne. Quant au général Lapisse, détaché du corps d’armée de Bessières, il occuperait Salamanque, Ciudad Rodrigo et Almeida : ainsi la ligne du Douro serait garnie de troupes et l’arrière-garde de l’armée française de Galice serait protégée. Tout portait donc à croire que Soult était suffisamment protégé pour pouvoir entrer au Portugal sans courir de gros risques. Par ailleurs, l’armée portugaise était en phase de réorganisation et l’Espagne était pratiquement occupée par les troupes françaises.
· 11 António Pedro Vicente, Bernardim Freire de Andrade e Castro, um soldado da Guerra Peninsular, Lisb (…) · 12 J.J. Teixeira Botelho, História Popular da Guerra Peninsular, Porto, Livraria Chardon, 1916.
9 Ces ordres donnés par Napoléon prouvent incontestablement qu’il ignorait tout de l’état des routes espagnoles et portugaises et que les quelques informations qu’on lui avait fournies étaient pour le moins lacunaires. Sur le théâtre des opérations, les besoins essentiels à une armée ne pouvant être satisfaits, faute d’un approvisionnement en vivres organisé ; les soldats qui pratiquaient la maraude, étaient obligés de se déplacer en petits groupes à la merci des attaques perpétrées par des paysans armés. Ces derniers profitaient des obstacles d’un terrain qu’ils connaissaient bien pour provoquer d’innombrables embuscades, assassinant les petits contingents militaires nécessaires à l’occupation de chaque point stratégiquement important pour poursuivre la marche. Ainsi les troupes se dispersaient et les contingents perdaient des hommes. Malgré tout, grâce à la trahison des commandants espagnols, Soult réussit sans aucune difficulté à occuper Ferrol à la fin du mois de janvier. Ajoutons qu’à proximité de la frontière, des milliers de soldats de l’armée espagnole sous les ordres du général La Romana désertèrent. Napoléon estimait alors que la défaite des armées espagnoles entraînerait la reddition de l’Espagne. Les troupes de Soult prirent position à Tuy, Salvaterra et Vigo, sur la frontière portugaise. Là, un premier obstacle se présenta que Napoléon et Soult avaient mésestimé : la traversée du Minho. Si le maréchal avait eu connaissance de la difficulté que posait la traversée de ce fleuve, jamais il ne l’aurait tentée et aurait ainsi gagné un temps précieux. Tout d’abord il aurait dû commencer par porter ses troupes à un endroit qu’il utiliserait d’ailleurs ultérieurement, là où les gros obstacles pouvaient être surmontés. Il faut dire que le Minho, ligne de séparation entre l’Espagne et le Portugal, depuis l’embouchure et au cours de 65kms à l’intérieur des terres, cesse d’être navigable en amont de Monção. Soult, qui avait décidé de passer le Minho à Valença dut y renoncer car les fortes pluies d’hiver avaient gonflé le débit du fleuve. Il choisit alors comme lieu de passage le hameau de Seixas près de Caminha qui se trouvait un peu plus bas sur la rive droite. Toutefois, les Portugais présents sur le terrain, parmi lesquels Gonçalo Coelho de Araújo et le colonel français au service du Portugal, Champalimaud, tous deux sous le commandement de Bernardim Freire d’Andrade, avaient pris soin de retirer toute embarcation qui pourrait faciliter le passage des troupes11. Malgré les difficultés dues à la force du courant, cette tentative, qui eut lieu le 16 février avant le lever du jour permit le passage de 300 hommes qui furent aussitôt abattus par les soldats portugais. Ce même jour, aux environs de midi, une nouvelle tentative eut lieu devant Vila Nova de Cerveira. Là encore Soult s’y prit mal et les ordonnances du Gouverneur Gonçalo Coelho de Araújo repoussèrent énergiquement ses armées. Devant l’impossibilité de traverser le Minho et d’entrer au Portugal, Soult choisit la ville d’Orense en Galice, comme nouveau point de passage. Etant donné que cette région était en proie à des convulsions, le Maréchal devait la conquérir village par village, sans cesse arrêté dans sa marche par les innombrables barricades dressées par les habitants. Six mois s’étaient écoulés depuis la Convention de Sintra et le départ de Junot, quand le 6 mars, l’avant-garde de l’armée du Duc de Dalmatie arriva près de Monterrey, à la frontière de la province de Trás-os-Montes. C’est à peu près à cette date que le Duc de Beresford, le général anglais que la Régence avait choisi pour aider les forces portugaises, débarqua à Lisbonne. Il était tard pour éviter l’invasion. Après la prise de Chaves, Soult était arrivé sans grands encombres à Porto en suivant la route de Braga. C’est à proximité de cette ville, au nord-est, sur la position de Carvalho d’Este, que commencèrent les troubles populaires qui allaient provoquer l’assassinat d’une partie de l’Etat Major portugais qui était sous le commandement de Bernardim Freire de Andrade, lui aussi assassiné sous prétexte qu’il était jacobin, alliés aux Français et donc traître. La misère dans laquelle se trouvait le pays, l’absence de moyens nécessaires au combat si souvent réclamés par ceux qui étaient en charge de la défense du Minho et de Porto, menèrent à une situation chaotique. Dans ce contexte, l’armée de Soult atteignit Porto et, le 28 mars, la reddition fut proposée à ceux qui défendaient la ville. Soult s’attarda à Porto deux mois de plus que prévu contrariant ainsi les plans de Napoléon. Précisons qu’il régnait alors dans la ville un climat délétère alimenté, d’une part par la misère matérielle et psychologique dans laquelle le peuple était tombé et, d’autre part par la démagogie de l’évêque gouverneur de Porto. Tout cela faisait que de nombreux Portugais caressaient le rêve d’être gouvernés par un roi français comme ceux que Napoléon avait installés sur les trônes des pays conquis. D’ailleurs, pendant son court séjour au Portugal, Soult, lui-même, fit tout pour attirer la sympathie des Portugais et créer un climat de paix de façon à rallier les mécontents dont le nombre ne cessait d’augmenter12.
10 Toutefois, il n’avait pas prévu l’avancée des armées anglo-portugaises où se détachaient les troupes de la Leal Legião Lusitana de Wilson et celle de Wellington qui se rejoignirent sur la Serra do Pilar devant Porto, sur la rive gauche du Douro que Soult avait eu l’imprudence de laisser sans défense. À partir du 12 mai 1809, un mois et demi après la conquête française de Porto, Wellington profita, avec prudence, de la situation militaire que ses ennemis lui offraient. Le Douro, dans les eaux duquel tant d’habitants de Porto avaient perdu la vie au cours du triste épisode du ‘Ponte das Barcas’ (pont des bateaux), fut franchi. Ainsi se termina, par un nouvel échec pour les armées napoléoniennes, la troisième invasion du Portugal. Le maréchal Soult dont les qualités militaires ne sont pas en cause et que l’empereur avait fait Duc de Dalmatie pour le récompenser de son courage et de ses qualités de stratège, révéla une totale méconnaissance du pays qu’il voulait conquérir. Sans doute n’avait-il pas compris pourquoi les Anglais s’étaient empressés, peu de temps auparavant, pendant l’occupation menée par Junot, de venir au secours de leur vieil allié.
· 13 António Pedro Vicente, « A influência inglesa em Portugal », art.cit. · 11 Toutefois, Napoléon n’abandonnait pas l’idée de conquérir le Portugal, qui contrairement à l’Espagne presque entièrement sous sa coupe, était toujours indépendant. Il chargea Masséna de cette mission quelques mois après l’échec de Soult à Porto. Rappelons que l’ancien ministre espagnol, Manuel Godoy, alors exilé en France, s’était laissé convaincre, comme il l’a d’ailleurs écrit dans ses Mémoires, que l’alliance des deux puissances, française et espagnole, permettrait de venir à bout de la suprématie anglaise. Or, ce but n’avait toujours pas été atteint. Une fois la flotte de la coalition franco-portugaise défaite, d’abord à Aboukir puis à Trafalgar, Napoléon allait prendre conscience qu’il lui était impossible de débarquer sur les côtes anglaises. Par ailleurs, depuis le Directoire13, les dirigeants français et notamment Bonaparte, alors simple consul, avaient reçu en provenance de tous les coins de France, de nombreuses lettres de patriotes français, conservées aujourd’hui aux archives de Vincennes, leur donnant des conseils sur la meilleure façon de soumettre l’Angleterre. Dans toutes ces missives une seule et même recommandation : pour vaincre l’Angleterre, il fallait d’abord défaire son vieil allié le Portugal de façon à porter un rude coup à l’économie anglaise. Effectivement, l’Angleterre trouvait sur les côtes portugaises une excellente base pour l’essor de ses activités commerciales et industrielles, pour l’acquisition de ses matières premières, notamment de celles qu’elle avait quelque difficulté à trouver depuis l’indépendance des Etats-Unis. Mais le Portugal lui offrait également un domaine commercial qui embrassait de vastes territoires : les îles adjacentes et le Brésil où l’Angleterre jouissait d’avantages douaniers concernant des produits d’une importance cruciale pour son industrie. Le Portugal était en somme la « vache à lait » de l’Angleterre selon l’expression d’un patriote français et sa conquête provoquerait sa banqueroute. Il ne faut donc pas s’étonner que Napoléon tînt tant à avoir la mainmise sur cette partie de la péninsule. L’Espagne était conquise et vivait sous le joug d’un roi français. À l’époque, tout le territoire espagnol, à quelques rares exceptions, comme la ville de Cadix, luttait depuis le 2 mai pour recouvrer son indépendance.
12 Les 80.000 soldats que comptait l’armée de Masséna (Prince d’Essling) faisaient partie de deux des 9 corps d’armée maintenus dans la péninsule. Parmi les officiers supérieurs qui étaient à leur tête, Ney, le fameux général de cavalerie et les deux généraux vaincus précédemment, Junot et Soult, étaient sous le haut commandement de Masséna. Là encore le choix de Napoléon s’avéra très vite désastreux : Ney estimait que le commandement de l’expédition devait lui revenir et ce en raison de son rang élevé ; Junot et Soult, soudain commis à un rôle subalterne et aux ordres d’un camarade, qui plus est, ignorant tout du Portugal, faisaient régner un sentiment de malaise au sein de leurs troupes. Voilà quelques raisons parmi d’autres qui ne tarderaient pas à provoquer des dissidences et des résultats adverses aux intérêts de la politique française. · 14 António Pedro Vicente, « Almeida em 1810, 1ª etapa de uma invasão improvisada », in O Tempo de Nap (…) · 15 Le Génie Français au Portugal sous l’Empire. Aspects de son activité à l’époque de l’occupation de (…) · 16 Marcel Guingret, Relation Historique de la Campagne sous le Maréchal Masséna, Prince d’Essling, Li (…) · 17 Ce fut le cas de la 2e division du 9e corps d’armée commandée par le général Drouet d’Erlon qui re (…) · 18 Donald Howard, (ed., translated and annotated), The French Campaign in Portugal, An account by Jea (…) · 13 Dans ses Mémoires, le général Foy, décrit de façon explicite le comportement de ces officiers et d’autres encore, comme Eblé, Fririon, Reynier, tous haut gradés dont les désaccords, qui commencèrent dès Salamanque, portèrent un grave préjudice au fonctionnement des armées françaises et contribuèrent à favoriser les Portugais. Cette gigantesque armée entra en territoire portugais au début du mois d’août 1810 et tomba sur un premier obstacle : Almeida. De l’avis de plusieurs stratèges, Masséna avait déjà commis plusieurs erreurs. Ainsi perdit-il un temps précieux à vouloir conquérir la place forte de Ciudad Rodrigo. Même constat à Almeida où, toutefois, la chance lui sourit quand le 26 août, la poudrière de la forteresse explosa, précipitant la reddition14. D’ailleurs, le temps et l’énergie employés à conquérir une forteresse ne faisaient déjà plus partie des pratiques en vigueur à l’époque. Il suffisait d’en faire le siège de façon à protéger l’arrière‑garde contre toute attaque. De plus, voulant entrer dans Lisbonne, Masséna choisit de prendre la rive droite du Mondego, erreur qu’il aurait pu éviter s’il avait pris connaissance du rapport de l’un des ingénieurs de Junot, un dénommé Boucherat, qui expliquait clairement les raisons pour lesquelles le chemin menant vers la capitale ne pouvait en aucun cas se faire en empruntant cette rive15. Masséna, calculant qu’il nécessitait 17 jours de vivres jusqu’à Lisbonne, ordonna aux corps d’armée de faire les récoltes dans les champs abandonnés par les paysans. Cette décision lui porta préjudice. Une autre erreur fut également lourde de conséquences : l’absence d’un service des vivres amenait les soldats à pratiquer le pillage. Ce système de maraude avait des effets tragiques et des conséquences funestes quand les voleurs étaient découverts. L’armée de Masséna passa ainsi par Pinhel, Trancoso, Mangualde, Guarda, Celorico, Fornos. Après avoir traversé l’affluent du Douro, le Coa, Masséna arriva à Viseu, désertée par sa population. Le Maréchal semblait avoir oublié que l’automne approchait et que, les chemins seraient bientôt difficilement praticables. Ses plans étaient peu à peu mis en difficulté. Il était surveillé nuit et jour par l’armée anglo-portugaise sous le commandement de Wellington, lequel avait conseillé aux habitants d’abandonner leurs foyers et d’emporter ou de cacher tout ce dont l’ennemi aurait pu tirer profit. Mais c’est à Bussaco que la gloire du Prince d’Esling va commencer à se ternir. Cette chaîne de montagnes, qui depuis le Mondego se dirige au cours de huit millesvers le nord, allait être fatale aux plans français. Toutes les routes venant de l’est qui permettent de rejoindre Coimbra, passent par des reliefs montagneux qui rendent difficiles le passage d’une armée quelle qu’elle soit. C’est là que Masséna fut stoppé dans sa marche par des troupes déployées sur les hauteurs de la montagne. Les forces anglo-portugaises comptaient quelques 70.000 hommes. Le 27 août, vers deux heures du matin, l’armée française se mit en mouvement et attaqua au lever du jour. Les Français perdirent 4.500 hommes dont 223 officiers. Devant ce revers, Masséna ordonna de tourner la position, ce qu’il aurait sans doute fait beaucoup plus tôt s’il avait eu connaissance de la topographie des lieux. Les quelques officiers portugais de la Legião Portuguesa, qui accompagnaient l’armée française n’aidèrent pas Masséna : serait-ce par méconnaissance du terrain ou bien accès de patriotisme ? Toujours est-il que l’armée française perdit presque deux jours à découvrir le chemin menant à Coimbra par Boialvo (Águeda). Enfin le 29 août, aux premières heures du matin, l’armée se mit en route vers Coimbra, point de passage obligatoire pour les deux armées16 et prit la direction de Pombal puis de Leiria (centre névralgique pour les combattants). Les troupes anglo-portugaises, devançant toujours les troupes françaises, allèrent en direction du sud jusqu’aux célèbres lignes de défense de Torres Vedras qu’elles avaient précédemment fortifiées mettant à profit le temps précieux que les multiples erreurs de Masséna leur avaient concédé. Selon les mémorialistes, ces erreurs ne seraient pas toutes de l’entière responsabilité de Masséna : ils affirment que, pour de mesquines questions de jalousie ou autres, des informations importantes ne lui furent pas fournies (ainsi le rapport de Boucherat). Quant aux nominations de Junot, Soult et Ney, lesquels se sentant humiliés d’être sous les ordres du Prince d’Essling, ne luttèrent pas de façon efficace, elles ne sont pas non plus le fait de Masséna. Celui-ci arriva bien tard devant les lignes de Torres Vedras. Il ne put les franchir et dût renoncer définitivement à entrer dans Lisbonne. Des villes et des villages désertés par leurs habitants, le manque de nourriture, de secours depuis longtemps demandés, jamais arrivés, l’absence de toute collaboration de la part des chefs militaires de prestige17, l’ignorance dans laquelle celui-ci fut maintenu de certains rapports cités plus haut, les dissidences existant au sein de son Etat Major, sont autant de facteurs qui contribuèrent à l’échec de cette invasion. À certains moments, Masséna avait recours à l’aide de son confident Jean-Jacques Pelet, un jeune homme alors âgé de 28 ans. Grâce essentiellement au travail de compilation de Donald Horward, nous avons aujourd’hui accès aux Mémoires et aux études faites par ce jeune ingénieur géographe qui sera ultérieurement nommé général et prendra la direction des archives de guerre françaises18. Foy, Guingret, Marbot et d’autres mémorialistes indiquent certains des évènements qui menèrent à une nouvelle défaite de Napoléon.
14 Bussaco fut l’une des dernières batailles et des nombreuses défaites de l’armée française au Portugal. Lors de sa retraite, Masséna livra quelques combats de moindre importance à Redinha et à Pombal. L’on estime que, malgré les défaites subies, Masséna révéla une grande valeur militaire en parvenant à regagner la frontière espagnole sans perdre beaucoup d’hommes. Dans le laps de temps qui s’écoula entre août 1810 et mars 1811, Soult, à qui Napoléon avait ordonné de rejoindre Lisbonne par la rive gauche du Tage pour apporter son aide à Masséna qui venait du sud par la frontière de Badajoz, ne le fit pas.
15 À partir de cette date, un corps militaire d’une dizaine de milliers de Portugais, dans une épopée qui reste à raconter, va traverser l’Espagne en compagnie des troupes anglaises et espagnoles et atteindre le sud de la France. Le rêve que Napoléon avait caressé de « s’offrir une balade » dans la péninsule s’était écroulé. L’aigle, jusqu’alors altier, allait succomber en abandonnant derrière lui un paysage de mort et de destruction que seuls l’ambition, la ténacité et le génie des peuples permettraient de reconstruire. Effectivement le spectacle des actes barbares pratiqués par chacun des camps, les assassinats, l’obligation faite aux populations affamées de s’enfuir en abandonnant leurs foyers et leurs biens, ne pouvaient que provoquer une profonde douleur chez les habitants des régions dévastées. Mais, plus tard, après avoir de nouveau goûté à la liberté et à la paix, ceux-ci trouvèrent en eux les forces nécessaires à la reconstruction de leurs maisons et de leurs biens.
Le témoignage du général Marbot · 19 Les Mémoires du Général Baron de Marbot furent écrits en 1847 et publiés, en 3 volumes, en 1891. É (…) · 16 Beaucoup d’affirmations concernant la désastreuse épopée de Napoléon dans la péninsule, sont corroborées par le Français Jean Baptiste AntoineMarcellin deMarbot,c’est pourquoi nous avons choisi de présenter rapidement quelques-unes de ses réflexions sur le sujet. Dans l’un des chapitres de ses intéressants Mémoires19 intitulé « Causes principales de nos revers dans la Péninsule », le Général Baron de Marbot, énumère certaines des raisons qui menèrent aux guerres péninsulaires. Il affirme ainsi, à propos de la victoire de Baylen remportée par les armées anglo-luso-espagnoles, que « ce succès inespéré non seulement accrut le courage des Espagnols, mais enflamma aussi celui de leurs voisins les Portugais ». Il fait également allusion au départ précipité de la famille royale vers le Brésil « de crainte d’être arrêtée par les Français ». Il évoque aussi la défaite de Junot, les triomphes de Napoléon et l’installation de son frère sur le trône d’Espagne, les victoires de Soult et la mort du général Moore en Galice .Les victoires de Napoléon s’espacèrent, selon l’avis de ce mémorialiste, quand « … le cabinet de Londres lui [suscita] habilement un nouvel et puissant ennemi : l’Autriche venait de déclarer la guerre à Napoléon, qui fut contraint de courir en Allemagne, en laissant à ses lieutenants la difficile tâche de comprimer l’insurrection ».
17 D’après Marbot quand le « maître abandonna la péninsule, le faible roi Joseph n’ayant ni les connaissances militaires ni la fermeté nécessaires pour le remplacer, il n’y eut plus de centre de commandement ». Il rapporte la situation du Maréchal Soult abandonné à Porto « sans que le maréchal Victor exécutât l’ordre qu’il avait reçu d’aller le rejoindre » et explique que « L’anarchie la plus complète [régnait] parmi les maréchaux et chefs des divers corps de l’armée française ». Il ajoute que « Soult, à son tour, refusa plus tard de venir au secours de Masséna, lorsque celui-ci était aux portes de Lisbonne, où il l’attendit vainement pendant six mois ! » et que, plus tard, « Masséna ne put obtenir que Bessières l’aidât à battre les Anglais devant Almeida ! » Le Baron explique comment Masséna, incapable de percer les lignes fortifiées de Torres Vedras, renonça à conquérir Lisbonne et le Portugal.
18 Marbot raconte dans le détail des scènes d’égoïsme et de désobéissance qui causèrent la perte de l’armée française mais reconnaît « que le tort principal appartint au gouvernement » en la personne de Napoléon qui, « se voyant attaqué en Allemagne par l’Autriche, [s’éloigna] de l’Espagne pour courir au-devant du danger le plus pressant ». Toutefois Marbot exprime son incompréhension devant le comportement de Napoléon lorsque celui-ci, « après la victoire de Wagram, la paix conclue dans le Nord, (…) n’[a] pas senti combien il importait à ses intérêts de retourner dans la Péninsule, afin d’y terminer la guerre en chassant les Anglais ! ». En fait, ce qui le surprend le plus, c’est que « ce grand génie ait cru à la possibilité de diriger, de Paris, les mouvements des diverses armées qui occupaient à cinq cents lieues de lui l’Espagne et le Portugal, couverts d’un nombre immense d’insurgés, arrêtant les officiers porteurs de dépêches et condamnant ainsi souvent les chefs d’armée français à rester sans nouvelles et sans ordres pendant plusieurs mois ».
19 Marbot estime que « puisque l’Empereur ne pouvait ou ne voulait venir lui-même, il aurait dû (…) punir très sévèrement ceux qui ne lui obéiraient pas ! » Quant à son frère Joseph, le roi d’Espagne, Marbot le dépeint comme un homme « instruit mais totalement étranger à l’art militaire » et incapable de se faire obéir des officiers. Le roi Joseph était d’ailleurs le premier à désobéir aux ordres de l’Empereur, refusant d’envoyer en France les soldats ennemis faits prisonniers et les intégrant dans des corps d’armée. Marbot se montre en désaccord avec le système de recrutement napoléonien dont il estime qu’il était préjudiciable à l’armée française : « La défection des soldats étrangers dont l’Empereur inondait la Péninsule, ajoutée à celle des prisonniers espagnols si imprudemment réarmés par Joseph, nous devint infiniment préjudiciable. » Marbot mentionne enfin ce qui lui semble être « la cause principale » des revers français dans la péninsule : 20 « l’immense supériorité de la justesse du tir de l’infanterie anglaise, supériorité qui provient du très fréquent exercice à la cible, et beaucoup aussi de sa formation sur deux rangs »
21 Dans ses Mémoires, Marbot livre également sa conviction intime que « Napoléon aurait fini par triompher et par établir son frère sur le trône d’Espagne, s’il se fût borné à terminer cette guerre avant d’aller en Russie ». Pour ce dire, il se basait sur le fait que, seul le soutien financier de l’Angleterre permettait le maintien de lacoalition. Or, lepays était las d’autant de dépenses et la Chambre des Communes s’apprêtait à refuser de voter les crédits nécessaires mais la nouvelle que Napoléon allait partir attaquer la Russie la fit changer d’avis et autoriser la « continuation de la guerre ». Marbot mentionne également les défaites du maréchal Marmontet du roi Joseph en Espagne où les Français essuyèrent de « tels revers que vers la fin de 1813, nos armées durent repasser les Pyrénées et abandonner totalement l’Espagne qui leur avait coûté tant de sang ! ».
22 L’ultime citation des Mémoires de Marbot, vaut d’être mentionnée parce qu’elle rend justice au courage des soldats portugais et qu’il est rarissime de trouver ce genre de considération sous la plume d’un mémorialiste français. Après avoir reconnu l’esprit de persévérance des soldats espagnols, Marbot fait l’éloge des soldats portugais dans les termes suivants : « Quant aux Portugais, on ne leur a pas rendu justice pour la part qu’ils ont prise aux guerres de la Péninsule. Moins cruels, beaucoup plus disciplinés que les Espagnols et d’un courage plus calme, ils formaient dans l’armée de Wellington plusieurs brigades et divisions qui, dirigées par des officiers anglais, ne le cédaient en rien aux troupes britanniques ; mais, moins vantards que les Espagnols, ils ont peu parlé d’eux et de leurs exploits, et la renommée les a moins célébrés ».
23 Les historiens et les chroniqueurs ont trop souvent négligé de prendre en compte la frustration des projets de Napoléon ainsi que les erreurs successives de tous ordres accumulées au long d’années qui ne pouvaient qu’aboutir à une défaite. Ils oublient de mentionner également que c’est dans cet espace péninsulaire, qu’a commencé la chute de Napoléon. Il y aura, après, la campagne de Russie dont on connaît l’issue malheureuse. Nous sommes personnellement convaincus que les défaites subies par Napoléon au Portugal entre 1807 et 1811, au cours desquelles on vit chanceler des chefs militaires de grande valeur, ont profondément influencé sa défaite finale.
Notes
1 António Pedro Vicente, « A influência inglesa em Portugal. Documentos enviados ao Directório e Consulado, 1796-1801 », in Revista de História das Ideias, vol. II, Coimbra, Faculdade de Letras, 1988. 2 Idem, Ibidem. 3 « Olivença, Início da Expansão Napoleónica na Península », in Revista História, juin 2001. 4 « Godoy e Portugal, uma leitura das suas Memórias » in O Tempo de Napoleão em Portugal, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 2ª edição, 2000. 5 « Olivença, início da Expansão Napoleónica em Portugal », art. cit. 6 Idem. 7 António Pedro Vicente, « Portugal perante a política Napoleónica dos Bloqueios Continentais à Invasão de Junot », in Guerra Peninsular, Novas Interpretações, Lisboa, Tribuna da História, 2005. 8 Idem, Ibidem 9 Lettres inédites de Napoléon Ier (An VIII — 1815), tome premier, (An VIII — 1809), deuxième édition, Paris, Librairie Plon, 1897, p. 136. 10 António Pedro Vicente, « A Legião Portuguesa em França : uma abertura à Europa » Lisboa, Actas do III Colóquio da Comissão Portuguesa de História Militar,Lisboa, 1992 et P. Boppe, La Légion Portugaise, 1807-1813, Paris, Berger Levrault, 1897. 11 António Pedro Vicente, Bernardim Freire de Andrade e Castro, um soldado da Guerra Peninsular, Lisboa, Arquivo Histórico Militar, 1970. 12 J.J. Teixeira Botelho, História Popular da Guerra Peninsular, Porto, Livraria Chardon, 1916. 13 António Pedro Vicente, « A influência inglesa em Portugal », art.cit. 14 António Pedro Vicente, « Almeida em 1810, 1ª etapa de uma invasão improvisada », in O Tempo de Napoleão em Portugal, op.cit. 15 Le Génie Français au Portugal sous l’Empire. Aspects de son activité à l’époque de l’occupation de ce pays par l’armée de Junot, 1807-1808, Lisboa, Serviço de História Militar do Estado Maior do Exército, 1984. 16 Marcel Guingret, Relation Historique de la Campagne sous le Maréchal Masséna, Prince d’Essling, Limoges, 1817. 17 Ce fut le cas de la 2e division du 9e corps d’armée commandée par le général Drouet d’Erlon qui resta à Leiria avec des milliers de soldats sous prétexte qu’il n’obéissait qu’aux ordres du roi Joseph Bonaparte et pas à ceux de Masséna. 18 Donald Howard, (ed., translated and annotated), The French Campaign in Portugal, An account by Jean Jacques Pelet, Minneapolis, 1973. 19 Les Mémoires du Général Baron de Marbot furent écrits en 1847 et publiés, en 3 volumes, en 1891. Élevé au grade de lieutenant-général, Jean Baptiste Antoine Marcellin de Marbot participa aux campagnes napoléoniennes en Italie, Russie, Pologne, Allemagne, Espagne et au Portugal, où il fit partie de l’Etat Major de Masséna. Ses Mémoires sur les évènements au Portugal offrent un éclairage intéressant sur les causes de la défaite des armées napoléoniennes entre 1810 et 1811.
António Pedro Vicente, « Raisons de la défaite de Napoléon au Portugal », Rives méditerranéennes, 36 | 2010, 13-26. Université Nova de Lisbonne https://www.facebook.com/gregory.buisseret.3/videos/1837551669828546/
|

Dos de Mayo - Madrid - le massacre du 2 mai 1808 par les troupes napoléoniennes (la Garde Impériale et les Mamelouks)*, commémoré chaque année
* Il est dès lors absurde de voir défiler en Entre-Sambre-et-Meuse des gens portant ces uniformes, comme si de tels faits ne s’étaient jamais passés.
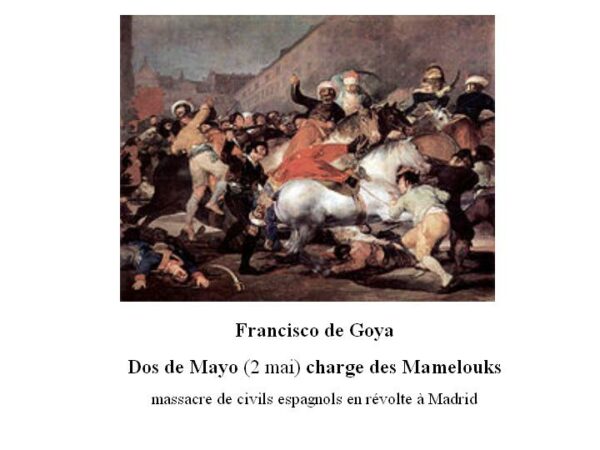


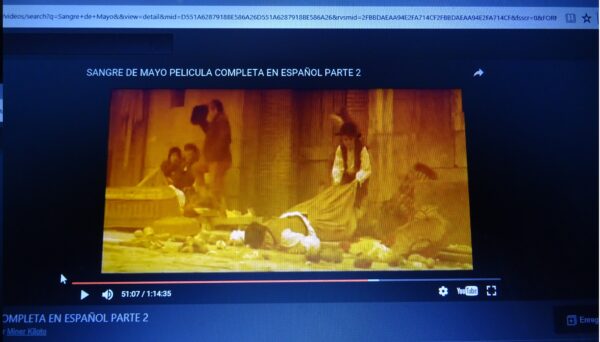
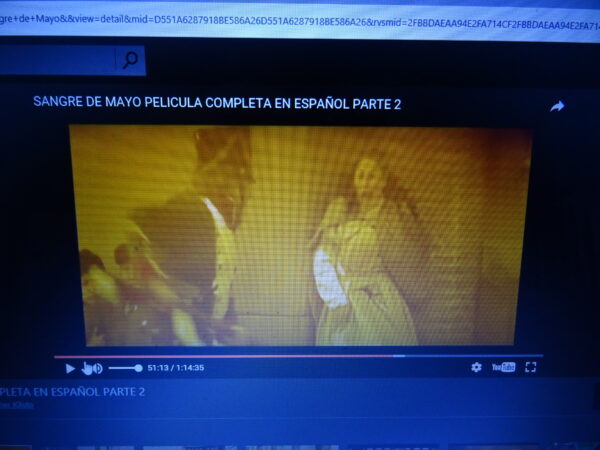
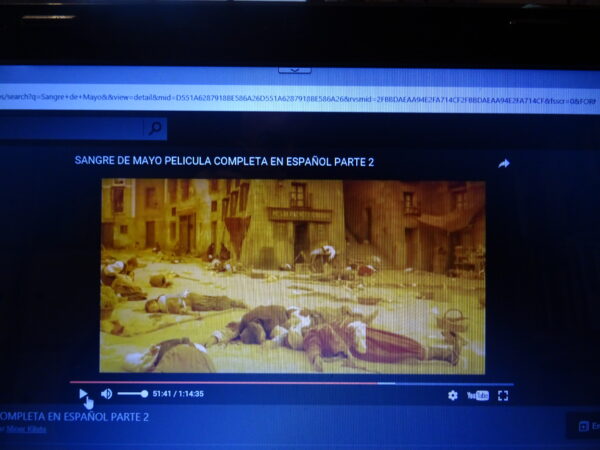


El Dos de Mayo. Defensa del Parque de Artilleria de Monteleón, en Madrid, el día Dos de Mayo 1808.

El Tres de Mayo, by Francisco de Goya, from Prado…

Obelisco Dos de mayo (Madrid)

Portugal - Porto - "Napoleon's peninsula war statue" - statue commémorant la victoire du Bien (les Anglais et les Portugais) sur le Mal (Napoléon et sa bande d'envahisseurs)


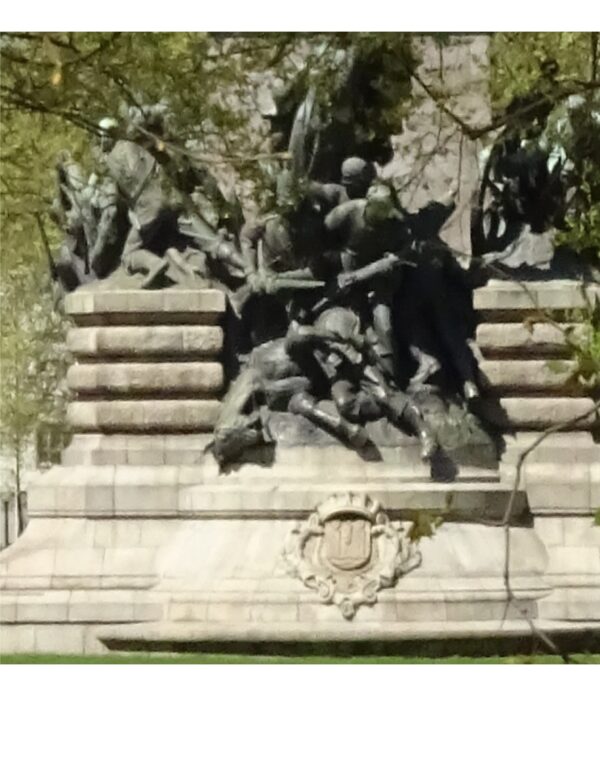

Porto - " Campo dos Mártires da Pátria " (Place des Martyrs de la Patrie) (face à l'invasion de l'armée napoléonienne)
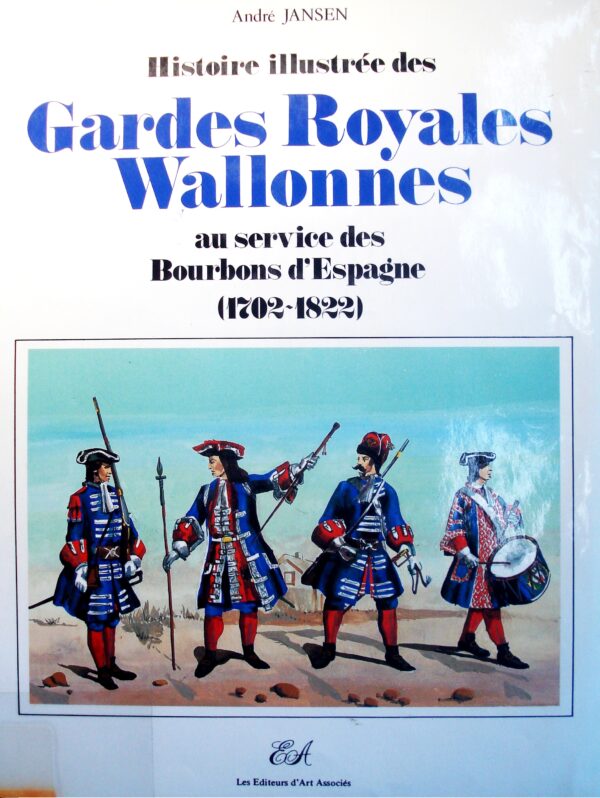
Guerre d'Espagne - Quand les Gardes Wallonnes luttaient contre l'armée du dictateur raciste Napoléon...*
* Alors qu’en Entre-Sambre-et-Meuse, en plein centre de la « Wallonie », des gens en uniformes napoléoniens (donc pas ceux dits erronément en « 2e Empire » (càd. en uniformes belges (1830-1914)) ou vraiment du 2e Empire français (zouaves)) défilent … en faisant un fameux pied-de-nez à leur histoire. Complètement stupide et unique en Europe.
(in: André Jansen, Histoire illustrée des Gardes Royales Wallonnes au service des Bourbons d’Espagne (1702-1822), s.d.)
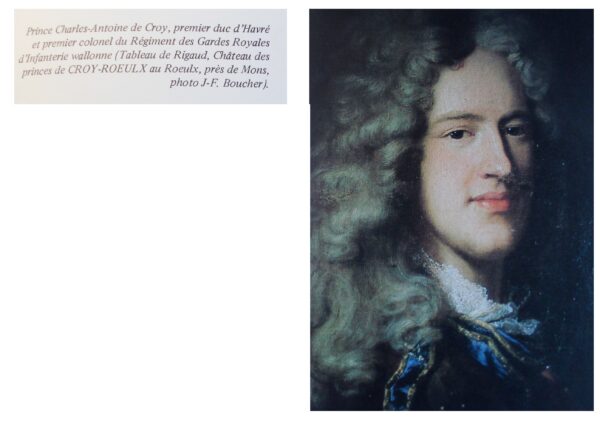
(Prince Charles-Antoine de Croÿ, colonel du Régiment des Gardes Royales d’Infanterie wallonne)
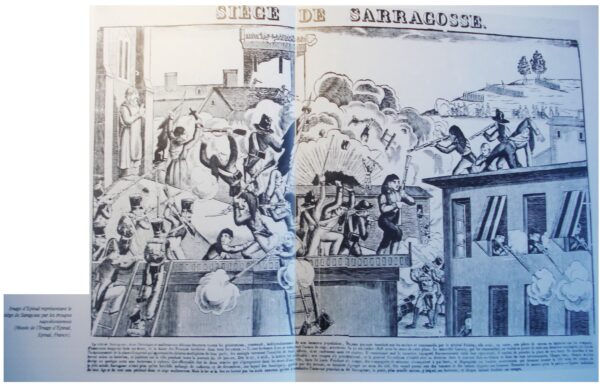
(Le siège de Sarragosse)

(Charles, comte de Romrée de Vichenet, capitaine des Gardes Wallonnes)

(uniformes de Gardes Wallonnes sous Philippe V)

(grenadiers, officier, fifre des Gardes Wallonnes)

(grenadier et fusilier des Gardes Wallonnes)

(officier des Gardes Wallonnes en 1802 et en 1822)
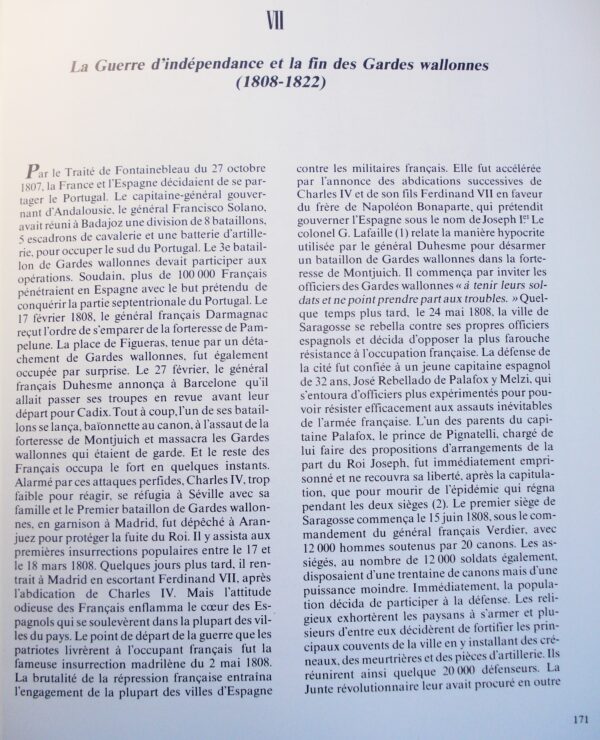
(la guerre d’indépendance et la fin des Gardes Wallonnes)
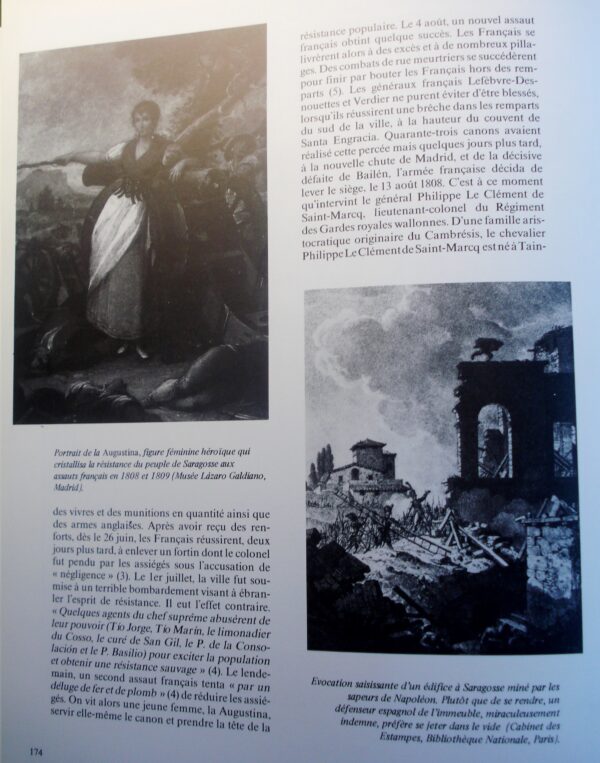
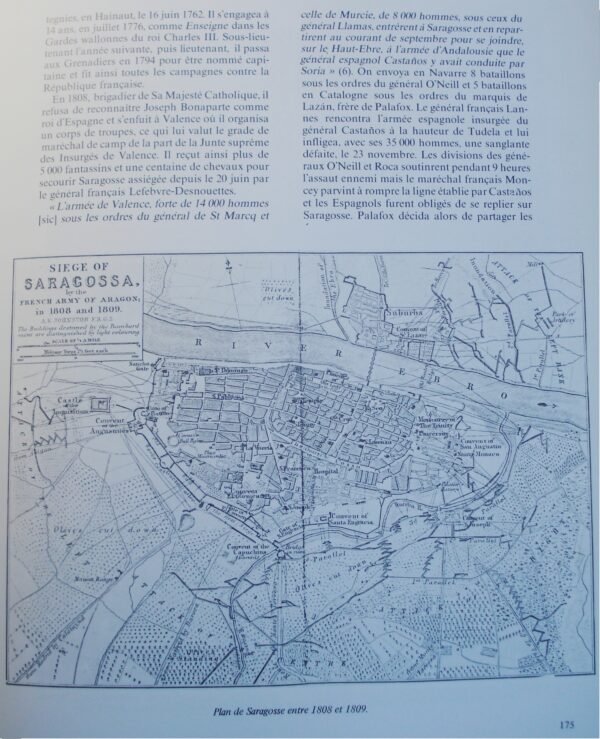
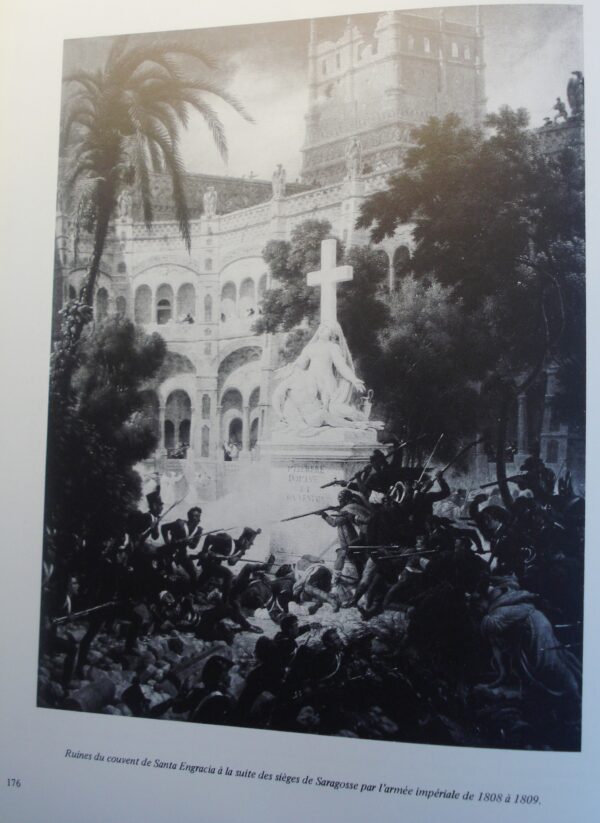

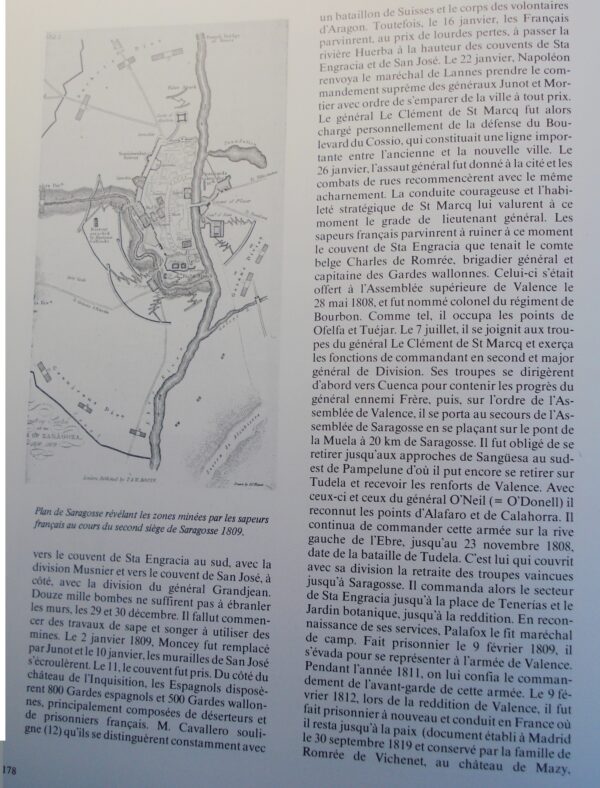
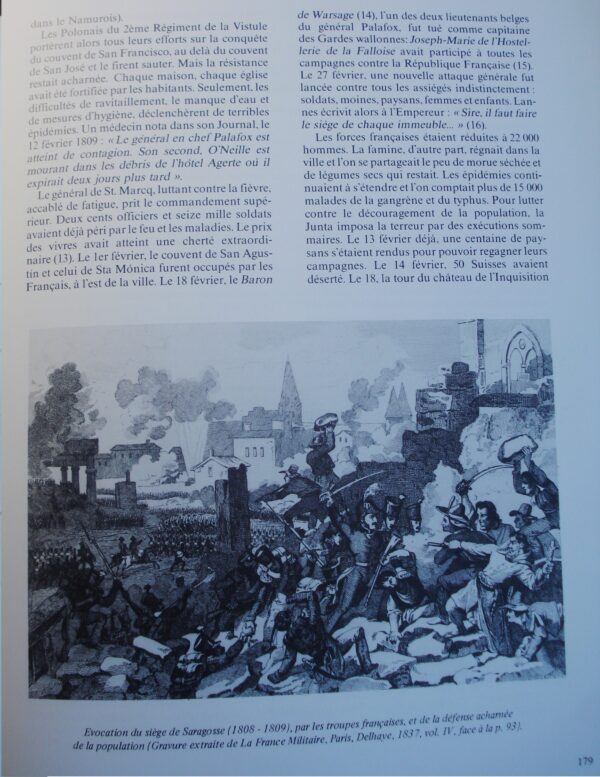

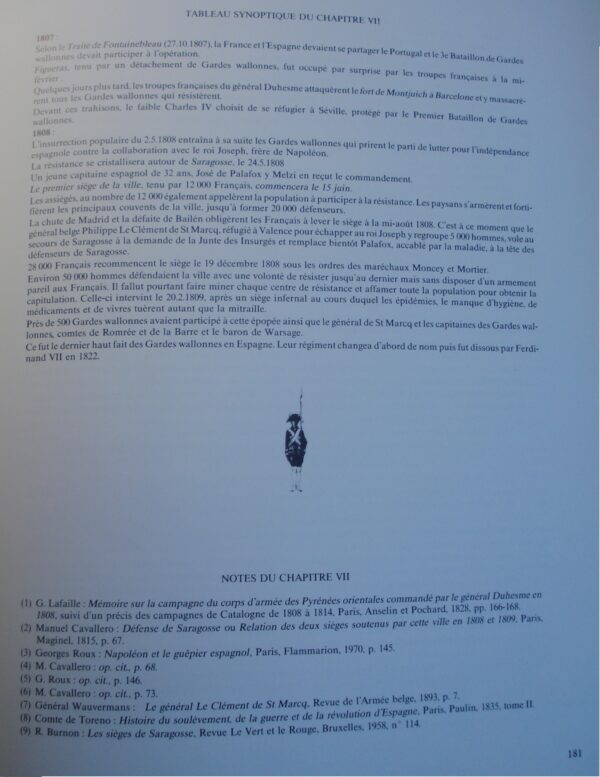
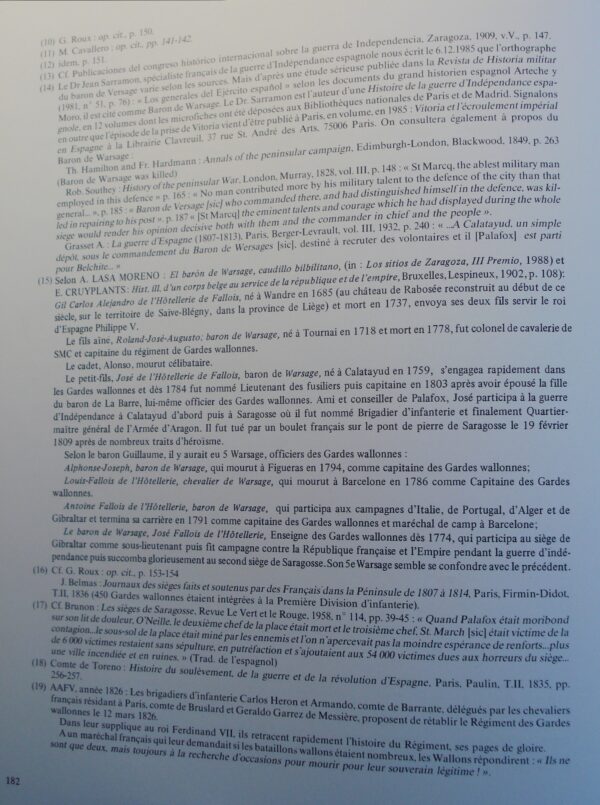

2.4 Les campagnes de Napoléon contre l’Autriche, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse
|
Eric Bracke, Bonn brengt ambiguë Napoleon in beeld, in : Knack 19/01/11, p.112-116
(p.112) Francisco Goya etst in zijn indrukwekkende reeks prenten over de gruwelen van de Franse bezetting in Spanje een zwart beeld van Napoleon. De liberale Beethoven was aanvankelijk een fervent bewonderaar, maar dat sloeg om toen Napoleon zichzelf als een rasechte autocraat tot keizer kroonde. De woedende componist zag in mei 1804 af van zijn voornemen om zijn Derde Symfonie aan de Corsicaan op te dragen. Op het schutblad van zijn manuscript heeft hij ‘Bonaparte’ in Sinfonia Grande intitolata Bonaparte zo heftig doorkrast dat er een gat in het papier achterbleef. Het werd uiteindelijk Sinfonia Eroica (Heroïsche symfonie).
|
|
Andreas Hofer, in: Wikipedia
Andreas Hofer (22 novembre 1767 – 20 février 1810) était un patriote tyrolien. Aubergiste de profession, il fut l’instigateur de la rébellion des montagnards tyroliens contre l’impérialisme bonapartiste et marqua le nationalisme pantyrolien. Andreas Hofer naquit en 1767 à St. Leonhard in Passeier (en italien : San Leonardo in Passiria (BZ)), dans le Tyrol du Sud. Son père était un aubergiste au Sandwirt et le jeune Andreas y apprit son métier. En négociant le vin en Italie du nord, il apprit l’italien. Plus tard, il épousa Anna Ladurner et, en 1791, il fut élu au Landtag tyrolien.
La guérilla tyrolienne Lors la guerre de la troisième coalition contre les forces napoléoniennes, il devint capitaine d’une milice. Lors de l’annexion du Tyrol par la Bavière, au Traité de Presbourg en 1805, Hofer prit la tête du mouvement de résistance anti-bavaroise. En janvier 1809, il était à Vienne, lorsque l’empereur François II d’Autriche, offrit son support moral à une possible insurrection. Dès le 9 avril 1809 la rébellion tyrolienne débuta. Le 11, ses troupes défirent les Bavarois à Sterzing. Cette victoire mena à l’occupation d’Innsbruck. Hofer devint un chef de milice et surtout acquit une notoriété lui conférant le rôle de chef charismatique du patriotisme tyrolien. La victoire de Napoléon contre les Autrichiens de l’Archiduc Charles dissipèrent les espoirs de succès des Tyroliens. Les Bavarois reprirent Innsbruck, mais dès le départ des troupes napoléoniennes, la rébellion reprit de plus belle. Les 25 et 29 mai, les troupes d’Hofer vainquirent les Bavarois à l’Iselberg. Hofer prit Innsbruck le 30. Le 29 mai, Hofer reçut une lettre de l’empereur d’Autriche lui assurant qu’il ne signerait jamais de traité exigeant la cession du Tyrol. Et un intendant autrichien fut dépêché pour administrer le pays. Dès lors, Hofer retourna chez lui. La victoire de Wagram, le 6 juillet, vint annuler les succès précédents. L’armistice de Znaim, le 12, cédait le Tyrol et la Bavière. Napoléon envoya 40 000 hommes pour reprendre Innsbruck. La guérilla de Hofer recommença. Sa tête fut mise à prix. Les 13 et 14 août, il défit le maréchal Lefebvre au Bergisel après 12 heures de bataille. Une fois encore il prit Innsbruck.
Un chef charismatique Hofer devint commandant en chef et dirigea ses troupes depuis Hofburg au nom de l’empereur d’Autriche. Le 29 septembre il reçut une médaille impériale et une nouvelle assurance du soutien de l’Autriche au Tyrol. Le Traité de Schönbrunn reconduisit le scénario de l’armistice de Znaim et céda encore le Tyrol à la Bavière. Hofer et ses compagnons déposèrent les armes contre la promesse d’une amnistie. Le 12 novembre, Hofer reçut de fausses informations de pseudo-victoires autrichiennes. Ce qui l’incita à reprendre les armes. Cette fois, la mobilisation fut faible et rapidement les troupes franco-bavaroises réduisirent la guérilla. Hofer alla se cacher dans les montagnes de son Passeiertal natal. Sa tête fut mise à prix 1 500 florins. Franz Raffl, son voisin, le trahit et il fut capturé par les troupes italiennes le 2 janvier 1810 dans un chalet d’alpage (le Pfandleralm, un pâturage alpin près de la ferme de Prantach en face de San Martino in Passiria), et envoyé à la cour martiale de Mantoue. Raffl fut retrouvé lynché.
Chute de Hofer La légende prétend que Napoléon donna l’ordre d’un « juste procès avant de le descendre » (plus tard il confia à Metternich que Hofer avait été exécuté contre sa décision). Andreas Hofer fut fusillé à Mantoue le 20 février 1810.
Hofer devint un martyr en Allemagne et Autriche. Son nom servit de point de ralliement contre le pouvoir de Napoléon.
Un symbole d’indépendance En 1823, les restes de Hofer furent rapatriés de Mantoue à Innsbruck. En 1834, sa tombe fut ornée d’un mausolée de marbre. En 1818, sa famille reçut une lettre de noblesse de l’empereur d’Autriche. En 1893, sa statue en bronze fut érigée au Bergisel (Innsbruck). Chaque année, à Meran, son épopée est rejouée en plein air. L’hymne d’Andreas Hofer, est devenu l’hymne officiel du Tyrol. Pendant les années de querelle linguistique au Tyrol du Sud, la mémoire de Hofer fut souvent utilisée comme exemple de la résistance de la population germanophone aux velléités d’italianisation, notamment sous le régime fasciste.
|
|
Karl Mittermaier, /über den Freiheitskämpfer Andreas Hofer/, in : Die Zeit, 08/04/2009
Am 9. April 1809 rufen die Schützenhauptmänner Andreas Hofer und Martin Teimer in einer Offenen Order ganz Tirol zum Widerstand auf. (…) Der 13. August bringt die Entscheidung; wieder fallt sie am Bergisel. 20 000 französischen, bayerischen und sächsischen Soldaten stehen 15 000 Tiroler Schützen gegenüber. Es wird Hofers grösster Triumph: Die fremden Truppen geben Tirol vorerst auf, und er zieht als Landeskommandant in die Innsbrucker Hofburg ein.
(…) Napoleon befehlt, den Gefangenen in Mantua erschiessen zu lassen. »Zu Mantua in Banden / der treue Hofer war«, so beginnt ein bis heute berühmtes Lied, in dem Julius Mosen 1831 Hofers Ende nationalistisch verklärte. Dabei ist die Stadt dem Gefangenen durchaus nicht feindlich gesinnt. Zeitgenössischen Berichten zufolge zeigen die Mantuaner Mitleid mit ihm. Von einem Lösegeld ist die Rede, das sie für die Freilassung Hofers aufgebracht hätten. Pierre François Bisson, der Festungskommandant, lässt sich nicht erweichen. Am 18. Februar erhalt er von Napoleon die Order, eine Kommission zur Verurteilung Hofers einzusetzen und ihn binnen 24 Stunden erschiessen zu lassen. Hofers Verbrechen: Er habe vom Schönbrunner Frieden gewusst und dennoch die Tiroler zu weiterem Kampf aufgehetzt. Wie erwartet, verurteilt das Militärgericht den Angeklagten zum Tode. Auch Kajetan Sweth soll mit dem Leben büssen, doch wird der Schreiber begnadigt und auf die Insel Elba deportiert.
|
| Andreas Hofer 1809 – Die Freiheit des Adlers, ARD – 28/12/2002
Tobias Moretti spielt den Tiroler Volkshelden Andreas Hofer, der mit einer Armee erzürnter Bauern den grossen Napoleon und seinen bayerischen Verbündeten die Stirn bot.
|
|
La chanson « Douce nuit, sainte nuit » fête ses 190 ans, AL 22/12/2008
Grâce à la résistance du Tyrol à Napoléon Bien que plébiscitée par l’auditoire, la chanson reste dans un premier temps confinée au village d’Oberndorf (près de Salzbourg), où habite l’auteur, Joseph Mohr. Jusqu’au passage, dans le village, d’un facteur d’orgues tyrolien, qui l’inscrit au répertoire des chanteurs itinérants de cette province. Des gars qui parcouraient l’Europe pour gagner quelques sous l’hiver. « Auréolé de sa résistance à Napoléon, le Tyrol est alors très en vogue dans les pays alliés, et ses meilleurs chanteurs, comme la famille Rainer, sont des vedettes mondiales. », note Renate Ebeling-Winkler, historienne.
|
|
Contingent des grenadiers fribourgeois
Description
En 1799, les troupes de la Révolution française envahirent la Suisse. Lorsque Napoléon retira les armées françaises en 1803, le canton de Fribourg (en Suisse) réorganisa sa protection militaire. Le Corps franc vit le jour en 1804 et fut équipé de l’uniforme bleu – héritage de l’ancienne garde d’Etat – avec les revers rouges – héritage du Service de France – uniforme que les Grenadiers du Noble Contingent fribourgeois portent encore aujourd’hui. Ces troupes fribourgeoises prirent une part active à la protection de la neutralité confédérale en 1805 , 1809, 1813 et 1815. Le plus haut fait d’armes fut, en 1814, l’occupation de Genève par les troupes fribourgeoises et soleuroises, en prévision d’attaques françaises contre cette ville. Cette mission confiée par la Diète fédérale, était une mission de confiance. Il fallait des soldats « parfaitement exercés », astreints à « une discipline rigoureuse » et des « officiers expérimentés ». Cette occupation fut l’une des prémices de l’admission de Genève dans la Confédération helvétique. Lors de troubles internes, les troupes fribourgeoises furent mises sur pied avec succès, en 1830 à Fribourg, en 1831 à Bâle et à Neuchâtel et, en Valais en 1839. Les grenadiers passèrent alors dans les troupes fédérales dès 1844.
https://www2.unil.ch/unicom/allez_savoir/as26/pages/as26_3_bonaparte.html
|
|
4. Des Vaudois libérés pour être enrôlés dans les armées de Bonaparte
Conquête opportuniste ou planifiée, les troupes françaises franchissent la frontière. Loin de se contenter de «libérer» les Vaudois, elles envahissent encore le reste de la Suisse où se déroulent batailles, déprédations et pillages. Ce qui permet à nos «protecteurs» de se remplir les poches, avant de contribuer au financement de la campagne de Bonaparte en Egypte. «Les Français se sont servis et bien servis. Mais, si l’on compare aux autres républiques sœurs ou aux cantons alémaniques, il faut bien admettre que le Pays de Vaud s’en tire très bien, observe François Jequier. D’abord parce que les troupes de Ménard y sont entrées en libérateurs et pas pour le conquérir. Ensuite parce que la région lémanique n’a jamais été un champ de bataille. Enfin, parce que les Vaudois ont payé. Pour offrir le logement, la nourriture, les chevaux et pour faciliter le passage des troupes qui s’y est bien mieux déroulé qu’en Suisse centrale où il y a eu des massacres.»
Reste que la libération du Pays de Vaud coûte quand même des vies vaudoises. Car la Suisse doit fournir des soldats à la France. Entre 1798 et 1815, ce sont près de 30’000 Suisses qui vont combattre pour Napoléon, dont 4700 Vaudois, un chiffre plutôt élevé, comme l’ont montré les recherches d’Alain-Jacques Tornare*. Autant de soldats qui ont payé cher leur engagement pour la France. «Attention à l’abus de langage, prévient François Jequier qui aimerait bien inclure l’histoire des maladies dans celle des armées: bon nombre de ces gens ne sont pas morts glorieusement les armes à la main, comme on le répète souvent. Ils ont crevé misérablement dans les latrines avec le choléra, sans avoir tiré un coup de fusil.» 5. 1798-1803 Le destin méconnu de la Suisse envahie
Que devient cette Suisse envahie? Un satellite de la France redessiné à l’image de la grande voisine si envahissante. Le pays est remodelé en une République helvétique, une et indivisible, et gouverné à la française par un Directoire de cinq membres centralisé à Aarau. Quant à l’ancien Pays sujet de Vaud, il se mue en canton du Léman, sur le modèle d’un département français. Pour le reste, l’histoire de cette période reste à écrire, assure Danièle Tosato-Rigo qui regrette cette lacune. «C’est un moment unique de l’histoire suisse où l’on a une histoire nationale qui se met en place, avec un gouvernement centralisé et des projets nationaux. On a longtemps été tributaires d’une vi-sion noire de ce régime, partant de l’idée que, comme il y a eu plusieurs changements de pouvoir, cela a forcément été mal vécu par les Suisses.»
6. 1802, quand Bonaparte stoppe une armée suisse avec un aide de camp
Si les Vaudois et les Fribourgeois trouvent leur compte dans cette République helvétique, ils sont bien les seuls. Dans les autres cantons, les anciennes élites reprennent bien vite le pouvoir et contestent aussitôt ce Directoire suisse qui gouverne la nation depuis Aarau, mais sans réel soutien local. «On a le sentiment que l’histoire se déroule alors à deux vitesses, une à Aarau, et une autre dans les cantons», observe Danièle Tosato-Rigo.
La réalité, c’est que la République helvétique ne tient pas sans l’appui des baïonnettes françaises. Aussi, dès que Bonaparte ordonne à ses troupes de se retirer de Suisse, en août 1802, la guerre civile éclate. «Elle se développe à une vitesse extraordinaire. En quelques semaines, les troupes fédéralistes arrivent, pratiquement sans résistance, aux portes de Lausanne où s’était réfugié le gouvernement de l’Helvétique», raconte François Jequier. Et soudain, tout s’arrête. Il suffit que Bonaparte dépêche un aide de camp afin d’annoncer aux Suisses qu’il se fera le médiateur de ce conflit pour que l’armée fédéraliste, qui avait quasiment gagné la partie, stoppe sa marche en avant.
«L’affaire mérite analyse», poursuit l’historien lausannois. Comment un seul envoyé de Bonaparte peut-il exercer une telle influence sur des troupes suisses? François Jequier y voit une réaction à la stupéfiante force de frappe de l’armée française. «Les Suisses savaient à quoi s’attendre en cas de conflit. Ils signent donc un armistice sur place, à Montpreyveres. Là, Bonaparte sauve la Suisse d’une guerre civile, et de ça, on peut lui être reconnaissant.»
Du coup, nous ne saurons jamais ce que serait devenu le pays déchiré sans cette intervention du général français. «On peut penser que les Suisses étaient incapables de prendre leur sort en main, ajoute Danièle Tosato-Rigo. On peut aussi imaginer que beaucoup de Suisses avaient une idée de leur avenir très différente de celle que la France voulait imposer. Et que cet épisode montre toute la force d’une intervention étrangère qui va stopper un processus bien avancé, qui aurait peut-être permis d’écrire une histoire très différente de celle que nous avons finalement vécue.»
7. 1803, les arrière-pensées du médiateur Bonaparte
Avec l’entrée en jeu de Bonaparte, la donne change du tout au tout. Alors que la première intervention des Français avait amené le régime centralisé de la République helvétique, l’Acte de Médiation met en place un régime fédéraliste. Qui rend un maximum de compétences aux cantons. Et l’effort débouche sur une formule qui se révèle parfaitement praticable dans tous les cantons. «On a souvent répété que Bonaparte connaissait le système suisse au point d’être le seul fidèle à ces institutions», rappelle Danièle Tosato-Rigo. Et c’est vrai? «Il les connaît remarquablement bien», répond l’historienne, qui ajoute aussitôt que Bonaparte trouve son compte dans l’arrangement proposé. «S’il ne parle que de l’esprit des institutions et de l’incapacité des Suisses à s’occuper d’eux-mêmes, Bonaparte n’évoque jamais le traité d’alliance qui sera proposé juste après aux Helvètes. Et qu’ils ne pourront pas refuser.» 8. Bonaparte et la Suisse Comment évaluer l’influence exercée par Bonaparte sur la Suisse? «Le premier élément à prendre en considération, c’est la durée, répond François Jequier. L’Acte de Médiation a duré dix ans, ce qui permet de poser des bases. On voir alors que ce système a fonctionné et qu’il a fait ses preuves. A la chute de Napoléon, on découvre que les gens ont appris à vivre différemment. C’est particulièrement vrai pour le canton de Vaud où des élites se sont imposées et ont pu poser les jalons de leur nouveau canton.»
|
|
Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988
(p.133) Civil war broke out in Switzerland; Napoleon sent in Ney with 40,000 men, taking control as ‘Grand Mediator of the Swiss Confederation’ – Aloys Reding of Berne and his hopelessly outnumbered little army being defeated and imprisoned.
|
|
https://www.geschichte-schweiz.ch/mediation-napoleon.html
Vom Diktat des Napoleon Bonaparte zurück in die alte Ordnung
Die Helvetische Revolution von 1798 war schon 1802 an ihrem sturen Zentralismus gescheitert und im Chaos eines Bürgerkriegs untergegangen.
Die Mediationsverfassung von 1803
In diesem Moment griff der französische Militärdiktator und spätere Kaiser Napoleon Bonaparte ein, verlangte das sofortige Ende des Bürgerkriegs und rief Delegationen der Revolutionäre wie der Reaktionäre [Anhänger der alten Ordnung] zu Verhandlungen nach Paris. Im Oktober 1802 kamen erneut französische Truppen in die Schweiz und entwaffneten die Aufständischen in der Zentralschweiz. Napoleon hatte sich allerdings schon früher mit der Situation in der Schweiz vertraut gemacht und begriff deshalb, dass der zentralistische Einheitsstaat in der Schweiz angesichts der grossen sprachlichen, kulturellen und religiösen Unterschiede und Gegensätze keine Chance hatte. Deshalb legte er einen föderalistischen [bundesstaatlichen] Verfassungsentwurf vor. Die gängige Bezeichnung Mediation [Vermittlung] beschreibt die Rolle Napoleons allerdings kaum zutreffend, wenn auch Napoleon selbst sich gerne als Vermittler darstellte. In Wirklichkeit war die als Mediationsakte betitelte neue Verfassung für die Schweiz weitest gehend ein Diktat Napoleons. Die Mediationsakte gab den grössten Teil der staatlichen Kompetenzen an die 19 Kantone der neuen Eidgenossenschaft ab und eliminierte sowohl das nationale Parlament als auch die Zentralregierung. Die Tagsatzung als nichtständige Konferenz der Kantone wurde wieder eingeführt. Einzig die Aussenpolitik sollte dem Bund vorbehalten bleiben.
War also wieder alles wie vor der Revolution von 1798? Bei weitem nicht! Zunächst einmal zählte die Schweiz der Mediationszeit nebst den 13 Orten von 1513 sechs neue, gleichberechtigte Kantone: St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt. Zudem hielt die Mediationsakte ausdrücklich die politische und rechtliche Gleichheit aller Bürger fest. Die 19 Kantonsverfassungen bildeten den grössten Teil der Mediations-Verfassung. Nidwalden und Obwalden traten nun auch gegen aussen als selbstständige Halbkantone auf. Der Jura, Genf und Neuenburg blieben aber Frankreich einverleibt, das Wallis wurde 1810 von Frankreich annektiert [einverleibt]. Während kleine Kantone wie Appenzell, Glarus mit wenigen knappen Bestimmungen die althergebrachte Organisation (mit Landsgemeinde) wieder in Kraft setzten, übernahmen andere die Institutionen der parlamentarischen Demokratie von der Helvetik. Dabei fällt auf, dass die Verfassungen grosser Kantone wie Basel und Bern sich fast gleichen wie ein Ei dem anderen, was die Vermutung nahelegt, dass hier nicht wirklich kantonale Eigenheiten berücksichtigt sondern ein Kompromiss zwischen Revolutionären und Reaktionären festgeschrieben (bzw. von Napoleon diktiert) wurde. Immerhin zeigt das Beispiel des Kantons Aargau, wieviel Spielraum für eigene Bestimmungen blieb, wenn sich nur die Vertreter dieses Kantons darauf zu einigen vermochten.
Noch grössere Abhängigkeit von Frankreich
Die Abhängigkeit der Schweiz von Frankreich nahm aber noch zu. Napoleon zwang die Schweiz 16’000 Soldaten für seine Armeen zu stellen und bei der Finanzierung seiner Kriege mitzuhelfen. Auf seinem Russlandfeldzug 1812 scheiterte Napoleon am russischen Winter und an Nachschubproblemen, von 9’000 Schweizer Soldaten in seiner Russland – Armee überlebten nur 700, das bekannte Beresinalied gibt ihre Stimmung wieder. Bei allen berechtigten Vorbehalten und aller Abneigung gegenüber Diktatoren muss man Napoleon zugute gehalten werden, dass er für Frankreich und für weite Teile Europas mit dem Zivilgesetzbuch (Code Civil) von 1804 ein wesentliches Element des modernen Rechtsstaates schuf.
England, Russland, Preussen und Österreich verbündeten sich, um den grössenwahnsinnigen Napoleon in die Schranken zu weisen, aber auch, um die aus heutiger Sicht wegweisenden Errungenschaften der Französischen Revolution (Liberté, Égalité, Fraternité: Freiheit = Abschaffung der Leibeigenschaft, Gleichheit aller vor dem Gesetz und Brüderlichkeit = Solidarität, soziale Gerechtigkeit) rückgängig zu machen. Ende 1813 rückten 130’000 russische und österreichische Soldaten in die Schweiz ein. Zeitweise hatten Kaiser Alexander von Russland, Kaiser Franz von Österreich und König Friedrich Wilhelm III. von Preussen ihr Hauptquartier in Basel. Napoleon wurde besiegt, auf die Insel Elba verbannt, kehrte aber nach kurzer Zeit zurück, wurde endgültig besiegt und auf die Insel St. Helena verbannt. Die Schweizer Tagsatzung beeilte sich, auf die Seite der Sieger zu wechseln und hob die Mediationsverfassung von 1803 auf, worauf alsogleich der Streit über die neue Ordnung ausbrach. In Luzern und Bern gelangten durch Staatsstreich Vertreter der alten Patrizierfamilien wieder an die Macht. Bern, Uri, Schwyz und Graubünden versuchten, die alten Untertanenverhältnisse wieder herzustellen, drangen damit aber nicht durch.
Die Restauration von 1815
Der Wiener Kongress
Auf dem Wiener Kongress von 1815 versammelten sich die europäischen Fürsten und Staatsmänner, um die Verhältnisse in Europa nach der Niederlage Napoleons bei Waterloo neu zu ordnen und ein neues Gleichgewicht zwischen den Grossmächten zu schaffen. Zahlreichen Kleinstaaten (u.a. Venedig, Genua) wurde die Wiederherstellung verweigert. Ebenso wenig kam man dem Wunsch der polnischen, deutschen und italienischen Patrioten nach Nationalstaaten entgegen. Unter diesen Umständen konnte die Schweiz froh sein, im Wesentlichen in ihren Grenzen von 1798 wieder hergestellt zu werden.
Die immerwährende Neutralität
Der Preis für das Überleben der Schweiz als Kleinstaat war die Verpflichtung zur Neutralität: In einer besonderen Erklärung garantierten die Siegermächte die immerwährende Neutralität der Schweiz. Damit war einerseits das Versprechen verbunden, die Schweiz nicht anzugreifen, andererseits aber auch die Verpflichtung der Schweiz ihrerseits keine militärischen Bündnisse mehr einzugehen und den Durchzug fremder Truppen durch ihr Gebiet zu verhindern. Dieser Rolle ist die Schweiz seither mehr oder weniger gewissenhaft nachgekommen und die Neutralität ist zu einem tief verinnerlichten Prinzip geworden, so sehr, dass heute das ernsthafte Nachdenken darüber eher behindert wird, ob und wie die Neutralität in einer völlig veränderten Welt überhaupt noch sinnvoll ist.
Die heute gültigen Grenzen der Schweiz
Das Wallis und Genf waren vor 1798 zugewandte Orte gewesen, Neuenburg war von alters her im Besitz der französischen Adelshauses Orléans-Longueville gewesen, 1510 – 1529 von Bern, Solothurn, Fribourg und Luzern besetzt worden und wurde 1598 von Frankreich und Spanien als zugewandter Ort der Eidgenossenschaft anerkannt. Seit 1648 hatten die 3 Stände in Neuenburg ein Mitspracherecht, sie wählten 1707 nach dem Aussterben des Fürstenhauses Orléans-Longueville den König von Preussen zu ihrem Landesherrn. Dies war ganz im Sinne Berns, denn Preussen war protestantisch und weit weg. Während der Helvetik und Mediation waren das Wallis, Genf, Neuenburg und das Fürstbistum Basel (Teile des Elsass und heutiger Kanton Jura) Frankreich einverleibt worden.
Die Siegermächte hatten alles Interesse, dass sich diese Gebiete von Frankreich lösten und als eigenständige Kantone zur Schweiz kamen. Nur das Elsass blieb bei Frankreich. Neuenburg erhielt einen Sonderstatus, es war bis 1857 sowohl ein Kanton der Schweiz als auch ein preussisches Fürstentum! Bern erreichte, dass ihm der heutige Kanton Jura gewissermassen als Ersatz für die verlorene Waadt zugeschlagen wurde. Die ehemals zugewandten Orte Mulhouse (Elsass) und Rottweil (Süddeutschland) sowie die bündnerischen Untertanengebiete Veltlin, Bormio und Chiavenna gingen der Schweiz definitiv verloren. Insgesamt konnte ein Rückfall in die Zeit vor 1798 wenigstens für die grossen ehemaligen Untertanengebiete, die neue Kantone geworden waren, weit gehend verhindert werden. Die Schweiz bestand nun aus 22 Kantonen und hatte ein geschlossenes Staatsgebiet in den heutigen Grenzen (bis auf winzige spätere Korrekturen) erreicht.
Die Restauration im Innern
Im Inneren vollzog die Schweiz den europäischen Trend mit etwa der selben begrenzten Autonomie nach, wie seinerzeit in der Helvetik. Die Partei der Konservativen setzte sich zunächst weit gehend durch und erreichte bis 1848 eine Restauration (Wiedereinsetzung) der alten Ordnung mit einem losen Bund von Kantonen, die der Tagsatzung nur grössere Verhandlungen mit dem Ausland und die Regelung einzelner militärischer Belange überliessen. Die Städte konnten die Landschaft zwar nicht wie vorher total beherrschen, waren aber in den Parlamenten übervertreten. So hatte etwa die Stadt Basel im Grossen Rat 90 Vertreter, die Landschaft aber für mehr als doppelt so viele Einwohner nur deren 64. In Bern (Landschaft 99 von 299 Sitzen), Luzern (Landschaft 10 von 36 Ratssitzen), Zürich (Landschaft 82 von 212 Sitzen) usw. waren die Verhältnisse ähnlich ungerecht. Gewisse Verbesserungen der Helvetik bei den persönlichen Freiheitsrechten (Abschaffung der Leibeigenschaft) und der allgemeinen Volksschulbildung blieben allerdings bestehen. Die Freunde des Neuen verschwanden aber nicht vollständig, die Partei der Liberalen blieb bestehen, später spaltete sich davon die Partei der Radikalen [Freisinnigen] ab, die noch weiter gehende Forderungen stellte und insbesondere die Kirche als Hüterin des konservativen Gedankengutes entschieden bekämpfte. Ihre Hauptforderungen waren demokratisch, d.h. nach allgemeinem Stimmrecht gewählte Räte öffentliche Rats- und Gerichtsverhandlungen Handels- und Gewerbefreiheit (Abschaffung der Beschränkungen, die nur den Mitgliedern bestimmter Zünfte die Ausübung gewisser Handwerke erlaubten) Stärkung des Bundes auf Kosten der Kantonshoheit (einheitliche Regelungen für die ganze Schweiz)
|
|
Napo: Suisse: trésor monétaire pillé avant la campagne d’Egypte
|
|
wikipedia
L’histoire de la Suisse sous domination française est l’étape de la formation de la Confédération suisse qui suit la Confédération des XIII cantons. Elle est comprise entre le début des manifestations provoquées par la Révolution française de 1789 et la création de la Confédération des XXII cantons le 7 août 1815. Les premières réactions en Suisse face aux événements de la Révolution française sont négatives : l’annonce du massacre des gardes suisses au Palais des Tuileries, la tentative d’invasion française de Genève en 1792 et la prise, la même année, de l’évêché de Bâle rattaché à la France sont autant d’événements qui sont mal perçus localement. À la suite de l’échec d’un soulèvement en Suisse romande contre Berne, les meneurs se réfugient à Paris où ils poussent à la fin 1797 le gouvernement français à envahir la Suisse, qui capitule une année plus tard. Le gouvernement français met alors en place le nouveau régime de la République helvétique, État centralisé et unitaire dont les limites administratives internes sont largement redessinées. Pendant cette période, la Suisse est touchée à la fois par les conflits européens et par des révoltes intérieures. Le 30 septembre 1802, Napoléon Bonaparte impose l’Acte de médiation qui définit une nouvelle Constitution pour le pays ainsi qu’un nouveau découpage des frontières cantonales. Le Valais devient brièvement indépendant sous le nom de République rhodanienne avant d’être annexé par l’Empire français en 1810 tout comme Genève qui devient le chef-lieu du département du Léman et Neuchâtel qui est transformée en principauté. Pendant cette période, la Suisse est un protectorat français qui connaît une période de stabilité et de paix bien que son industrie soit durement touchée par les effets du blocus continental et de la mobilisation pour la Grande Armée.
https://www2.unil.ch/unicom/allez_savoir/as26/pages/as26_3_bonaparte.html Histoire Bonaparte et la Suisse par Jocelyn Rochat
Retour sur quelques idées fausses que nous nous faisons de cette époque, de la «libération» forcée des Vaudois en 1798 à la Médiation intéressée du Premier des Français en 1803.
A deux reprises entre 1798 et 1803, la France intervient dans les affaires intérieures de la Suisse. Chaque fois la baïonnette au fusil. Elle en profite pour imposer deux modèles de gouvernement radicalement différents. Qui garantissaient tous deux le soutien des Helvètes à ce grand voisin si envahissant. Le point sur ces pages tragiques de notre histoire, à l’occasion du Bicentenaire de l’Acte de Médiation.
1 Les Vaudois de 1798 ne voulaient pas être libérés
Il faut bien se résoudre à l’écrire: la «révolution» vaudoise s’est faite contre l’avis d’une très large majorité de la population qui s’accommodait parfaitement de la présence de Leurs Excellences de Berne. «La vision classique de l’histoire, celle qui nous montre tous les Vaudois derrière le nouveau régime, est un cliché qui ne résiste pas à l’analyse, assure le professeur d’histoire à l’Université de Lausanne (UNIL) François Jequier. 75 à 80% de la population rurale n’avait pas à se plaindre de sa situation, et je crois même que ces gens craignaient d’être placés sous le contrôle des élites locales et urbaines plutôt que sous celui des Bernois.» Seules les élites des villes vaudoises (et encore, pas toutes!) ont vécu la période bernoise comme une humiliation, ajoute Danièle Tosato-Rigo, également professeur d’histoire à l’UNIL. Parce qu’elles participaient au pouvoir local mais que leur carrière s’arrêtait là, alors que certaines auraient aspiré à un rôle politique plus important. «Cela dit, je pense que ces élites auraient été d’accord de rester au sein de la république de Berne, moyennant des réformes. On le voit bien en 1798 : jusqu’au dernier moment, dans la nuit du 23 au 24 janvier, les élites locales ont recherché le compromis en envoyant une délégation à Berne.» En réalité, ce sont surtout nos «libérateurs» français qui voulaient présenter les Bernois com-me des ennemis, poursuit Danièle Tosato-Rigo. «La proclamation du général Ménard qui fait suite à l’incident de Thierrens et qui annonce l’arrivée des troupes françaises précise notamment : «Vaudois, vos ennemis seront les nôtres.» Au fond, c’est l’intervention française qui transforme les Bernois en ennemis des Vaudois. C’est le libérateur qui définit a posteriori quel était l’ennemi à abattre. Et qui utilise la rhétorique habituelle des grandes puissances libératrices pour recouvrir de ce voile ses ambitions plus concrètes.» 2. Les Français sont autant conquérants que libérateurs
Si les Vaudois ont été délivrés «malgré eux», leurs «libérateurs» avaient tout sauf des mines de bons samaritains. A l’évidence, Paris cherchait un prétexte pour intervenir au Nord des Alpes, notamment pour des raisons stratégiques. Parce que le contrôle de la Suisse offrait un libre accès aux cols alpins et parce qu’il y avait de gros intérêts financiers en jeu. Le Directoire, qui régit l’Hexagone de cette époque, est au bord de la faillite. Et la Suisse, croient les Français, regorge d’or.
« On a beaucoup fantasmé sur l’importance du trésor de Berne en oubliant que toutes les autres villes de Suisse avaient été pillées», précise François Jequier. Du coup, la «guerre de libération» des Vaudois prend une allure nettement moins désintéressée. «On a trop fait d’histoire valdo-vaudoise, observe François Jequier. Dès qu’on prend du recul au niveau de l’Europe et que l’on observe la politique menée par le Directoire dans les différentes républiques sœurs (Belgique, Italie, Suisse) où la France est intervenue militairement, on se rend compte que les discours «libérateurs» sont les mêmes, que les prétextes invoqués sont les mêmes, que les démarches sont identiques, tout comme les pillages et la manière d’imposer une constitution après coup.»
Bref, on a clairement affaire à une politique systématique de prise de contrôle de diverses régions frontalières comme de leurs trésors.
3. Le Pays de Vaud a peut-être été libéré par hasard
Si la France cherchait un prétexte pour intervenir en Suisse, comment l’a-t-elle trouvé? Certains avancent le nom du Vaudois Frédéric-César de La Harpe qui a effectué, durant ses années d’exil à Paris, un gros travail de lobbying auprès du Directoire pour obtenir une intervention militaire en Pays de Vaud. Mais l’efficacité de ses efforts reste incertaine, notamment parce que La Harpe n’était pas pris au sérieux, comme le montre Talleyrand qui considérait le patriote lémanique comme un «agitateur». Et ne voyait pas pourquoi la France aurait dû s’ingérer dans les affaires d’un pays voisin dont elle garantissait la neutralité. Du coup, les historiens envisagent un autre scénario, en forme de conquête un peu par hasard. «Il arrive parfois que des épisodes un peu inattendus précipitent les grands événements», avance Danièle Tosato-Rigo, avant de rappeler que le Directoire hésitait sur la politique à mener envers la Suisse. Deux tendances s’y affrontaient. Les «faucons», favorables à une intervention militaire, et des «colombes», plus diplomates, qui auraient préféré que les patriotes vaudois commencent eux-mêmes leur révolution avant de franchir la frontière pour leur porter secours.
Ce Directoire divisé et indécis a peut-être été placé devant un fait accompli. Car, selon certains chercheurs, le général français Ménard serait intervenu avant d’avoir obtenu un quelconque aval de Paris. « L’invasion est menée en 1798 par une division qui revient d’Italie et qui compte 10’000 hommes, poursuit Danièle Tosato-Rigo. A ce moment-là, Ménard ne sait trop que faire avec ce corps d’armée, étant donné qu’il est toujours dangereux de licencier 10’000 hommes. Il y avait là, sur son chemin, des Vaudois qui pouvaient se libérer. Du coup, on peut imaginer que les pions se mettent en place comme dans une partie d’échecs. Ménard prend une initiative, cherche un casus belli, le trouve à Thierrens et entre en Suisse avec ses hommes. »
4. Des Vaudois libérés pour être enrôlés dans les armées de Bonaparte
Conquête opportuniste ou planifiée, les troupes françaises franchissent la frontière. Loin de se contenter de «libérer» les Vaudois, elles envahissent encore le reste de la Suisse où se déroulent batailles, déprédations et pillages. Ce qui permet à nos «protecteurs» de se remplir les poches, avant de contribuer au financement de la campagne de Bonaparte en Egypte. « Les Français se sont servis et bien servis. Mais, si l’on compare aux autres républiques sœurs ou aux cantons alémaniques, il faut bien admettre que le Pays de Vaud s’en tire très bien, observe François Jequier. D’abord parce que les troupes de Ménard y sont entrées en libérateurs et pas pour le conquérir. Ensuite parce que la région lémanique n’a jamais été un champ de bataille. Enfin, parce que les Vaudois ont payé. Pour offrir le logement, la nourriture, les chevaux et pour faciliter le passage des troupes qui s’y est bien mieux déroulé qu’en Suisse centrale où il y a eu des massacres.»
Reste que la libération du Pays de Vaud coûte quand même des vies vaudoises. Car la Suisse doit fournir des soldats à la France. Entre 1798 et 1815, ce sont près de 30’000 Suisses qui vont combattre pour Napoléon, dont 4700 Vaudois, un chiffre plutôt élevé, comme l’ont montré les recherches d’Alain-Jacques Tornare*. Autant de soldats qui ont payé cher leur engagement pour la France. « Attention à l’abus de langage, prévient François Jequier qui aimerait bien inclure l’histoire des maladies dans celle des armées: bon nombre de ces gens ne sont pas morts glorieusement les armes à la main, comme on le répète souvent. Ils ont crevé misérablement dans les latrines avec le choléra, sans avoir tiré un coup de fusil.»
Histoire de la Suisse sous la domination helvétique (Wikipedia)
L’histoire de la Suisse sous domination française est l’étape de la formation de la Confédération suisse qui suit la Confédération des XIII cantons. Elle est comprise entre le début des manifestations provoquées par la Révolution française de 1789 et la création de la Confédération des XXII cantons le 7 août 1815. Les premières réactions en Suisse face aux événements de la Révolution française sont négatives : l’annonce du massacre des gardes suisses au Palais des Tuileries, la tentative d’invasion française de Genève en 1792 et la prise, la même année, de l’évêché de Bâle rattaché à la France sont autant d’événements qui sont mal perçus localement. À la suite de l’échec d’un soulèvement en Suisse romande contre Berne, les meneurs se réfugient à Paris où ils poussent à la fin 1797 le gouvernement français à envahir la Suisse, qui capitule une année plus tard. Le gouvernement français met alors en place le nouveau régime de la République helvétique, État centralisé et unitaire dont les limites administratives internes sont largement redessinées. Pendant cette période, la Suisse est touchée à la fois par les conflits européens et par des révoltes intérieures.
Le 30 septembre 1802, Napoléon Bonaparte impose l’Acte de médiation qui définit une nouvelle Constitution pour le pays ainsi qu’un nouveau découpage des frontières cantonales. Le Valais devient brièvement indépendant sous le nom de République rhodanienne avant d’être annexé par l’Empire français en 1810 tout comme Genève qui devient le chef-lieu du département du Léman et Neuchâtel qui est transformée en principauté. Pendant cette période, la Suisse est un protectorat français qui connaît une période de stabilité et de paix bien que son industrie soit durement touchée par les effets du blocus continental et de la mobilisation pour la Grande Armée.
Sommaire · 1 Avant la Révolution helvétique 1.1 Prise de la Bastille vue de Suisse 1.2 Émigrés français en Suisse et communauté suisse en France 1.3 Divisions internes et premières agitations 3.1 Invasion du pays de Vaud et de Berne 3.2 Résistance des Waldstätten 4.1 Première constitution helvétique 5.3 Les coups d’État de 1800 à 1802 5.4 La seconde constitution helvétique et la guerre des Bâtons 6.2 Confédération des XIX cantons 6.3 La première Diète de Fribourg 6.5 La Suisse et le blocus continental 7 La chute du système napoléonien 7.2 Des militaires suisses dans les armées de l’Empire 7.3 Bataille des Nations et la chute de la médiation
Avant la Révolution helvétique
Prise de la Bastille vue de Suisse
Les évènements de juillet 1789, en particulier la prise de la Bastille le 14 juillet, bien que connus quasiment immédiatement en Suisse par le biais de la presse, n’ont que peu de répercussions. Les seules mesures prises par le canton de Berne, limitrophe de la France, sont d’interdire la vente d’armes, de poudre et de munitions ainsi que de déployer des forces militaires le long de la frontière avec la Franche-Comté. Les nouvelles venant de France sont largement commentées dans la société, en particulier grâce aux mercenaires de retour de Paris, ainsi que par la presse étrangère et locale même si plusieurs cantons, dont celui de Berne dès septembre 1790, mettent en place une censure des journaux[1]. Cette censure s’applique à la fois à l’importation des nombreux journaux français, qui ont vu le jour à la suite de la libéralisation de la presse votée le 26 août 1789 avec la déclaration des droits de l’homme et qui sont importés en Suisse, et à ceux qui sont imprimés localement par les libraires, en particulier ceux de Lausanne – ville qui acquiert une réputation de « séditieuse » aux yeux des autorités bernoises.
Les autorités vont toutefois, dans les années qui suivent immédiatement le déclenchement de la Révolution française, faire quelques gestes symboliques en faveur d’une plus grande égalité : sans aller jusqu’à soutenir les idées de Charles de Müller-Friedberg qui propose la suppression du statut de sujet dans l’évêché de Saint-Gall, la ville de Bâle abolit le servage en 1790 et celle de Berne accorde la bourgeoisie à une petite trentaine de familles du Gros-de-Vaud et de Morat. De son côté, la République de Mulhouse, alors alliée de la Confédération tout comme le Valais, Genève ou l’évêché de Bâle, vote le 15 mars 1798 pour son adhésion à la nouvelle République française, abandonnant son indépendance.
Émigrés français en Suisse et communauté suisse en France
Dès 1789, des réfugiés politiques français, appartenant principalement à l’aristocratie ou au clergé et rapidement appelés « émigrés » par les autorités, affluent en Suisse romande. Ces émigrés sont répertoriés dans des listes, et des commissions cantonales ad hoc sont mises sur pied pour réglementer le droit d’asile et délivrer les permis de séjour. Ces émigrés s’installent, pour des raisons linguistiques, dans les pays de Vaud et du Valais, ainsi que dans les régions de Neuchâtel, Soleure et Fribourg où un recensement en dénombre 3 700[5]. Si la majorité des émigrés vivent retirés et rentrent dans leur pays dès que possible, certains profitent du laxisme relatif des autorités cantonales pour tenir des réunions secrètes et y lancer différentes intrigues politiques contre-révolutionnaires. Devant les demandes répétées de la France, des émigrés sont expulsés de la Confédération en 1798.
À l’inverse, plusieurs Confédérés ou ressortissants de cités alliées, comme Genève ou Neuchâtel, vont jouer un rôle dans le déclenchement de la Révolution française, puis dans son déroulement, souvent pour la soutenir, parfois pour en contenir les excès — Étienne Clavière, Jean-Paul Marat ou encore Jacques Necker et sa fille Germaine de Staël, soit pour la combattre comme les militaires Pierre Victor de Besenval de Brünstatt et Louis-Auguste d’Affry ou le journaliste Jacques Mallet du Pan.
Une importante communauté helvétique ou genevoise est en effet réfugiée à Paris depuis l’échec de la révolution genevoise de 1782. En 1790 est fondé un « Club helvétique de Paris » qui ne sera actif qu’un peu plus d’une année. Fondé par un marchand de vin, il commence par critiquer le système aristocratique des cantons et s’active dans les casernes des gardes suisses avec une certaine efficacité[6]. Les membres fondateurs sont rapidement rejoints par des réfugiés fribourgeois arrivés à la suite du soulèvement Chenaux, dont l’avocat Jean Nicolas André Castella qui devient l’un des rédacteurs du club[7]. Le principal succès du club est d’obtenir de l’Assemblée nationale, le 20 mai 1790, la libération de deux galériens fribourgeois. Cependant, déserté par ses membres et confronté à des dissensions opposant les dirigeants, le club ferme ses portes le 3 août 1791.
Divisions internes et premières agitations
Les premières véritables réactions éclatent dans les régions frontalières de la France et fortement industrialisées ou pratiquant une agriculture spécialisée, telles que le pays de Vaud, la région bâloise, la campagne de Schaffhouse et le Valais. Ces manifestations prennent plusieurs formes, allant des plus symboliques telles que le port de la cocarde ou les chants de la chanson « ah ! ça ira » jusqu’aux plus sérieuses telles que la revendication de droits sociaux et les batailles rangées avec la police locale.
Dans le canton de Vaud par exemple, la commémoration de la prise de la Bastille est célébrée en 1790 et 1791 par la tenue de banquets qui deviennent rapidement suspects aux yeux des autorités bernoises[9]. Celles-ci interdisent alors tout rassemblement et toute manifestation publique, à l’exception de la fête des vignerons de Vevey, tout en instituant une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les « troubles » locaux[10]. Cette commission fait arrêter, entre la fin de 1790 et la mi-1791, un pasteur protestant, deux organisateurs de banquets qui seront enfermés quelques mois au château de Chillon, ainsi qu’Amédée de la Harpe qui est condamné à mort par contumace avant de rejoindre l’armée du Premier Empire où il deviendra général[11].
Le Bas-Valais, alors sujet du Haut-Valais, connaît à son tour une série de désordres, dont celui provoqué par Pierre-Maurice Rey-Bellet, qui deviendra une figure de l’historiographie valaisanne sous le nom du « Gros-Bellet », le 8 septembre 1790 à la foire de Monthey. L’année suivante, une conjuration menée par une trentaine d’hommes du Val d’Illiez vise à prendre le pouvoir en exécutant, lors d’une opération de commando fixée au 8 février 1791 plus de 160 notables ; l’opération est cependant découverte par les autorités et les sept meneurs sont exécutés le 19 novembre 1791 par décapitation. Pour l’histoire, les conjurés avaient prévu de pendre leurs victimes à des crochets sur le pont de Monthey, d’où le nom de « conjuration des Crochets » que prit cet épisode dans l’histoire locale.
Enfin, devant les troubles qui agitent la principauté bâloise, le prince-évêque de Bâle Sigismond de Roggenbach envoie, au début de l’année 1791, un émissaire à Vienne pour demander l’aide de l’empereur Léopold II d’Autriche. Celui-ci envoie des troupes qui occupent Porrentruy dès le 18 mars 1791. Outre une augmentation des troubles locaux, cette occupation provoque une réaction militaire de la France, en application du traité de 1780, sous la forme d’une invasion du territoire épiscopal quelques jours seulement après la déclaration de guerre à l’Autriche au printemps 1792. Ce territoire devient, pendant quelque temps, la République rauracienne avant d’être rattaché à la France en mars 1793 pour former le département du Mont-Terrible.
Révolution helvétique
Guerre de 1792 à 1797
Lorsque la France déclare la guerre à l’Autriche le 20 avril 1792, une grande partie de l’Europe se trouve, par le jeu des alliances, entraînée dans le conflit.
Pour la population suisse, et bien plus que les autres faits de guerre, les évènements du 10 août 1792 et surtout le massacre aux Tuileries des quelque 800 gardes suisses chargés de la défense du roi ont un fort retentissement et exacerbent le débat entre les partisans de l’entrée en guerre contre la France et ceux de la neutralité. Conséquence du massacre, l’Assemblée nationale française licencie l’ensemble des régiments suisses au service de la France le 20 août et rompt ses relations diplomatiques avec la Suisse le 15 septembre. En 1821, le monument du Lion de Lucerne, créé par le Danois Thorwaldsen, sera érigé en mémoire des gardes suisses tombés à cette occasion[bouquet 2]. Lors de la retraite en octobre 1796 de l’armée du général Moreau, 12 000 hommes sont mobilisés pour surveiller la frontière que longent les troupes françaises et ce afin d’éviter une violation du territoire suisse. La même année, la Diète fédérale reconnaît officiellement la République française ainsi que son représentant, l’ambassadeur François Barthélemy, en poste depuis 1792 jusqu’alors à titre officieux.
La victoire française d’octobre 1797, confirmée par le traité de Campo-Formio, marque la fin du système politique de balance entre la France et l’Autriche qui avait assuré la survie de la Suisse pendant les siècles derniers : le pays entre dès lors totalement dans la sphère d’influence de la France qui, en décembre 1797, prend possession de la partie sud de l’évêché de Bâle. Le même traité enlève à la Suisse les régions de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna qui sont données à la République cisalpine nouvellement créée.
Révolution genevoise
À Genève, les troubles vont en augmentant, malgré l’introduction le 14 novembre 1791 du « Code genevois », revendiqué par la population de la ville depuis plus de 50 ans et qui introduit l’égalité politique de tous les citoyens. Après l’entrée des troupes françaises en Savoie sans déclaration de guerre le 23 septembre 1792, le colonel Guillaume-Bernhard de Muralt, nommé général de l’armée suisse par la Diète, conduit une armée confédérée formée principalement de troupes bernoises jusque dans les murs de Genève où elles prennent garnison le 30 septembre 1792 en réponse à la demande d’aide formulée par le gouvernement de la République genevoise. Pendant près de deux mois, les armées françaises, stationnées à Carouge et à Sierne et commandées par le général de Montesquiou, et les armées suisses, dont le quartier général se trouve à Nyon, se retrouvent face à face. Après de laborieuses négociations, les troupes suisses se retirent le 27 octobre à la suite de la signature d’un accord aux termes duquel la France s’engage à ne pas occuper Genève.
Toutefois, les troubles reprennent en ville à la suite de la publication par la Convention nationale française le 19 novembre 1792 d’un décret qui promet « fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer la liberté ». Ces troubles culminent avec l’éclatement de deux insurrections les 4 et 28 décembre 1792 où les Conseils patriciens sont abolis et le pouvoir délégué à des comités provisoires jusqu’au vote de la nouvelle constitution, le 5 février 1794, qui déclare l’égalité politique pour la totalité de la population à l’exception notable des catholiques. À la suite de l’approbation de la constitution, la tension monte entre les nouvelles autorités et les tenants de l’Ancien Régime qui souhaitent ouvertement la défaite militaire de la France et le retour à l’ordre politique antérieur. À partir de l’été 1794, plusieurs tribunaux révolutionnaires sont instaurés et condamnent plus de 400 personnes à des peines de prison, à des bannissements ou même, dans une quarantaine de cas, à la peine de mort, parfois par contumace, sur le modèle de la Terreur française. Ces procès ne cesseront qu’avec la chute des Montagnards parisiens.
Saint-Gall et Zurich
Outre Genève, deux autres régions connaissent des troubles révolutionnaires, diversement couronnés de succès. Tout d’abord, la région de l’Alte Landschaft (« Ancienne terre » en allemand), appartenant à l’abbaye de Saint-Gall, voit surgir un mouvement de revendications concernant des réformes politiques et fiscales, alors même que le territoire n’a pas de frontière commune avec la France. Ce mouvement, conduit par le notable Johannes Künzle, obtient du populaire abbé de Saint-Gall Beda Angehrn un accord appelé Gütlicher Vertrag (« Traité à l’amiable » en allemand) qui est adopté lors d’une Landsgemeinde qui se tient le 23 novembre 1795 et qui supprime le servage tout en cédant aux communes plusieurs droits politiques[19]. Après la mort de l’abbé en 1796, la remise en cause du traité par son successeur provoque de nouvelles tensions qui aboutissent à une marche des paysans sur l’abbaye le 18 février 1797, obligeant à nouveau les ecclésiastiques à négocier pour calmer le jeu jusqu’au déclenchement de la Révolution helvétique où les anciennes terres se déclarent libres.
La seconde affaire secoue le canton de Zurich et oppose la ville à la campagne qui réclame une égalité de droits et de traitements. Pendant l’été 1794, les autorités de la commune rurale de Stäfa rédigent une pétition adressée aux autorités cantonales, qui exprime (sur un ton très respectueux) plusieurs revendications. Les autorités de la ville font saisir et détruire les copies de ce document et condamnent leurs auteurs au bannissement. Cependant, quelques mois plus tard, une copie du pacte de Waldmann, rédigé en 1489 et qui confirme les droits et franchises réclamées dans le mémorial de Stäfa, est découverte à Küsnacht. Les autorités répriment sévèrement la fête populaire organisée à cette occasion et près de 2 000 militaires sont envoyés sur place : six personnes sont condamnées à la détention à perpétuité alors que 260 autres écopent de peines plus légères. L’intervention d’Henri Pestalozzi, un temps soupçonné d’être l’un des auteurs de la pétition, ne fait pas plier la justice malgré un mémoire adressé aux autorités zurichoises dans lequel il défend le droit des campagnards à revendiquer une égalité de traitement avec la ville et qu’il signe « Pestalozzi, citoyen zurichois et citoyen français ».
Dans tous les cas de soulèvements, le mouvement révolutionnaire local reçoit l’aide et le soutien d’une partie de l’aristocratie locale qui souhaite des réformes ainsi que d’une partie du clergé (protestant et catholique) ; les membres de l’ancienne élite politique et les théologiens en faveur des réformes vont devenir, quelques années plus tard, autant de piliers politiques, sociaux et militaires des nouvelles structures desquelles l’Église ne sera jamais exclue, contrairement à ce qui se passe alors en France à la même époque[.
Révolution vaudoise
Après Genève, c’est le pays de Vaud qui se révolte à partir de 1797. Cette révolution principalement menée par Frédéric-César de La Harpe, Henri Monod et Jean-Jacques Cart vise deux buts distincts : l’indépendance vis-à-vis de l’occupant bernois et le maintien de Vaud comme canton suisse. Bien qu’aidée financièrement par la France, elle n’est pas dirigée par Paris et constitue bien un évènement endogène initié par les élites locales pour protester contre différentes manœuvres bernoises visant à réduire le pouvoir local.
Après avoir rencontré à plusieurs reprises le général Bonaparte qui avait été accueilli en héros à Genève, Lausanne et Bâle lors de sa traversée de la Suisse en novembre 1797, Frédéric-César « Laharpe » (comme il se fait alors appeler), exilé à Paris, fait paraître en décembre 1797 une brochure dédiée « aux habitants du Pays de Vaud, esclaves des oligarques de Fribourg et de Berne » dans laquelle il défend l’idée d’une constitution définissant un gouvernement indépendant. Il obtient du Directoire, le 28 décembre 1797, la protection officielle de la France pour le pays de Vaud assortie d’une menace d’intervention militaire contre quiconque s’y attaquerait ; cette protection permet aux patriotes de passer à l’action et de présenter, dès début janvier 1798, plusieurs pétitions demandant la tenue d’états généraux dans le but de régler les griefs entre les communes de Vaud et Berne sans devoir passer par l’intervention d’une puissance étrangère.
Dans le même temps, le Bâlois Peter Ochs, également exilé à Paris, rédige un projet de constitution helvétique qui, fondée sur le droit constitutionnel français, définit une nation étatique et unitaire sans aucun fédéralisme, et qui s’inspire du modèle des États-Unis d’Amérique dans son système bicaméral. En Suisse, le 10 janvier 1798, est créé à Lausanne un « comité des réunions » ayant pour but de mettre sur pied des autorités politiques aptes à diriger le pays de Vaud. De ce comité émerge, le 18 janvier, sous la présidence de Jean-Louis de Bons, un « comité central » de 20 membres représentant les villes et les principales communes du pays.
Le 12 janvier, un commando de Vevey prend d’assaut le château de Chillon, symbole du pouvoir bernois, ce qui provoque une accélération des évènements : deux proclamations sont publiées simultanément le 23 janvier : l’une, émanant du colonel Franz Rudolf von Weiss, chef de l’armée bernoise, qui déclare la patrie en danger et l’autre, publiée depuis Ferney-Voltaire par le général français Philippe Romain Ménard[note 1], qui annonce aux habitants de Nyon qu’il a ordre de les protéger contre toute forme d’agression[andrey 15]. Au matin du 24 janvier, le comité central proclame la République lémanique et fait flotter le drapeau vert et blanc avec l’inscription « République lémanique, Liberté, Égalité ». Le terme de « République lémanique », prôné par de la Harpe, ne s’imposera cependant pas, cette république se trouvant annexée quelques années plus tard dans le département du Léman. Le président de l’assemblée Henri Monod ratifie au matin la déclaration d’indépendance vis-à-vis de Berne, ce qui pousse les baillis bernois à quitter le sol vaudois pour retourner dans le canton de Berne sans qu’aucun ne soit blessé ou même menacé.
Bien que la déclaration d’indépendance n’ait jamais été reconnue par les officiels bernois, la révolution vaudoise s’est passée dans le calme, sans aucune effusion de sang et fut selon l’expression de François Jequier « une révolution bourgeoise sans levier populaire » où les bourgeois, qui avaient pris le pouvoir, multiplièrent les gestes en directions des campagnes qui suivirent le mouvement. La seule forme de résistance est la formation d’une unité contre-révolutionnaire appelée « Légion romande » puis « Légion fidèle » qui rassemble, sous le commandement du colonel Ferdinand de Rovéréa, quelque 600 membres pendant les quelques semaines de sa courte existence.
Invasion française Invasion du pays de Vaud et de Berne
Carte de l’invasion française.
Le 24 décembre 1797, le général français Laurent de Gouvion-Saint-Cyr pénètre en Ajoie et s’empare en quelques jours et sans aucune résistance du val de Saint-Imier, de la vallée de Moutier et de la ville de Bienne, sous prétexte de libérer les populations locales[felber 4]. Pratiquement simultanément, la dernière Diète fédérale s’ouvre le 27 décembre pour réformer la constitution ; elle ne parvient qu’à démontrer son inefficacité en raison de la confusion qu’apportent les débats qui s’y tiennent. Au début de l’année suivante, le général Philippe Romain Ménard adresse un ultimatum au colonel von Weiss, chef de l’armée bernoise, pour qu’il se retire du pays de Vaud ; il prend comme prétexte la mort d’un hussard français dans la nuit du 25 au 26 janvier à Thierrens, à la suite d’un malentendu, pour occuper le pays de Vaud dès le 27 janvier 1798, alors que les troupes du général Antoine-Guillaume Rampon traversent le lac Léman depuis Évian-les-Bains pour occuper Lausanne.
Après de nombreuses tractations politiques, le directoire fait connaître son intention d’établir une république en Suisse, organisée sur le modèle français. De Lausanne, devenue le quartier général des forces françaises, le général Ménard déclare la guerre à la république de Berne et lance ses troupes en direction de l’est[30]. Berne est réduit à la nécessité de se défendre et appelle les autres cantons à son secours. Soleure, Fribourg et Zurich ainsi que les petits cantons centraux envoient des troupes. L’ensemble, environ 20 000 soldats, est réparti en quatre divisions sous les ordres du général Charles Louis d’Erlach nommé commandant en chef de l’armée confédérée par la Diète. Le général Guillaume Marie-Anne Brune prend le 4 février 1798 le commandement des troupes françaises positionnées dans le pays de Vaud et fait réunir ses troupes sur la frontière de Fribourg pendant qu’un corps de l’armée du Rhin, commandé par le général Schauenburg, vient en renfort par le Jura. Brune décide de gagner du temps en proposant des négociations avec les Bernois. Ceux-ci acceptent et une trêve de 15 jours est déclarée en attendant une réponse du Directoire. Ces négociations infructueuses sont frustrantes pour le général d’Erlach qui se voit empêché d’agir par le gouvernement trompé par les promesses françaises. Il propose même sa démission, qui sera toutefois refusée, le 28 février 1798. Brune et Schauenburg concertent un plan d’attaque pour le 1er mars 1798, le jour de l’expiration de l’armistice. Pendant ce temps, Berne hésite tandis que d’Erlach tente de convaincre le sénat bernois de l’autoriser à attaquer, mais l’indécision est totale et les ordres et contre-ordres se succèdent, engendrant la confusion dans les troupes bernoises.
Le 1er mars 1798, comme prévu, l’attaque française est lancée sur toute la ligne. La première bataille de cette guerre, la bataille de Longeau, se déroule le lendemain dès 4 heures du matin. La ville de Fribourg capitule le 2 mars 1798. La ville de Berne capitule à son tour le 4 mars 1798, sans avoir livré bataille, alors que les combats se poursuivent le 5 à Neuenegg, où les Français sont défaits par une troupe bernoise, ainsi qu’à Fraubrunnen et à Grauholz, où les troupes suisses se font battre et se débandent devant les Français. Soupçonnant à juste titre une trahison des officiers supérieurs, un jeune aide-major assassine les colonels Ludwig Stettler et Karl von Ryhiner alors que les troupes françaises pénètrent dans la ville de Berne. Le général d’Erlach, présent à Grauholz, réussit à s’enfuir pour se réfugier dans l’Oberland bernois dans le but de rassembler de nouvelles troupes mais il est assassiné à son tour le 5 mars au soir[].
En pillant la ville de Berne, les Français récupèrent cinq millions de livres et attribuent trois millions supplémentaires au financement de la campagne d’Égypte du général Bonaparte ; quelque 47 000 livres seront également attribuées au pays de Vaud. Les villes de Fribourg, Soleure, Lucerne et Zurich sont également astreintes au paiement d’un impôt de guerre de 16 millions de livres ordonné par le commissaire français Rapinat dont le nom a alors inspiré un quatrain à l’écrivain Philippe Bridel : Le bon Suisse qu’on assassine
Résistance des Waldstätten
Pendant les mois de mars et avril 1798, plusieurs propositions de systèmes politiques sont étudiées pour la nouvelle Confédération. C’est finalement le gouvernement français qui décide, malgré les vives protestations de Laharpe, de diviser le pays en trois républiques : l’Helvétie qui regroupe le nord du pays, la Rhodanie pour la Suisse romande et le Tessin et la Tellgovie pour la Suisse centrale et les Grisons. Cette décision sera rapidement mise en cause et les trois républiques ne survivront que quelques semaines.
Pendant ce temps, les combats entre l’envahisseur français et les insurgés suisses qui refusent de rendre les armes continuent : les troupes des cantons primitifs, aidés de Zoug et Glaris, réunissent environ 10 000 hommes qui sont placés sous le commandement d’Alois von Reding, jusqu’alors commandant des milices du canton de Schwytz. Les insurgés attaquent à plusieurs reprises les troupes du général Schauenburg, en s’emparant notamment de la ville de Lucerne, jusqu’au 30 avril où ils doivent se replier au nord du canton de Schwytz. Au début du mois de mai, les combats s’intensifient lors des batailles de la Schindellegi, de Rotherthurm et de Morgarten. Un armistice est conclu le 3 mai suivi le lendemain de la reddition sous conditions votée par la Landsgemeinde. Une nouvelle révolte contre l’occupation française est déclenchée le 7 mai dans le Haut-Valais après que le Bas-Valais a voté à une large majorité pour la réunion du Valais à la République helvétique. Partant du district de Conches et avec l’appui du clergé local, les troupes locales descendent sur Sion et Sierre qu’elles occupent sans résistance. Le 17 mai, le général français Jean Thomas Guillaume Lorge commandant une troupe de 3 700 Français et 1 500 Vaudois reprend Sion qui est livrée au pillage et partiellement incendiée. Une centaine de prisonniers sont emmenés comme otages et la ville, l’évêque et la population se retrouvent taxés d’une contribution de 600 000 écus locaux soit environ 1 800 000 livres françaises.
La dernière révolte vient, à la fin août 1798, du canton de Nidwald dont les habitants refusent de prêter serment à la nouvelle constitution sous la pression du clergé qui déclare que ce serment équivaut à un sacrilège ; les autorités de la nouvelle république sont renversées le 18 août par 16 000 Nidwaldiens, renforcés d’Uranais et de Schwytzois. Le 9 septembre, les 12 000 Français du général Schauenburg pénètrent dans la ville de Stans après quatre jours de combats. Les troupes françaises massacrent alors environ 300 civils, incendient et pillent la ville ainsi que les villages voisins.
République helvétique Première constitution helvétique
La première constitution helvétique est rédigée à Paris par Pierre Ochs et se voit officiellement approuvée le 28 mars 1798 par une assemblée nationale composée d’une centaine de représentants réunis par le commissaire français François-Philibert Lecarlier, remplaçant du général Brune auxquels les représentants d’Uri, de Schwytz, de Nidwald, de Zoug, de Glaris, d’Appenzell, du Togenbourg et de Sargans refusent de se joindre[38]. Elle définit une « République helvétique une et indivisible », sur le modèle de la Constitution française, qui prévoit une nouvelle organisation politique, l’abolition des droits féodaux et l’introduction de certaines libertés (de culte, de la presse ou de la propriété par exemple). D’États indépendants, les cantons ne deviennent que de simples unités administratives dirigés par un préfet sur le modèle des départements français, précisant qu’« il n’y a plus de frontières entre les cantons et les pays sujets, ni de canton à canton ». Le pouvoir central reçoit, de par la constitution, de grandes responsabilités avec, en particulier, l’unification des poids et des mesures, des lois, de l’armée et de la monnaie.
Le franc suisse devient l’unité monétaire de base et remplace les différentes monnaies et les différents systèmes de comptes cantonaux. Le franc, qui vaut 10 batz ou 100 rappen a un poids d’argent fin de 6,6194 g. Des pièces en argent de 40, 20, 10, 5 batz sont frappées dans les ateliers de Berne, Bâle et Soleure, de même que des doublons d’or valant 32 et 16 francs ; cette unification monétaire échoue toutefois rapidement en raison de la pénurie de métaux précieux. L’éducation publique obligatoire est introduite sur le plan national par la première constitution helvétique qui reconnaît pour la première fois l’usage de trois langues officielles — l’allemand, le français et l’italien — dans le pays, ce qui provoquera une forte résistance des cantons alémaniques, pour qui la Suisse devait rester un pays germanophone. Le texte prône enfin une stricte séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires et l’instauration d’un État laïc départageant les pouvoirs politiques et ceux de l’Église.
Si la constitution n’utilise à aucun moment le mot « peuple » — dont la classe bourgeoise se méfie et tient pour une masse d’ignorants — elle utilise par contre largement celui de « citoyen » défini comme une personne « actuellement bourgeois effectif, soit d’une ville municipale ou dominante, soit d’un village sujet ou non sujet », soit environ 330 000 personnes, ce qui représente environ 20 % de la population totale. Selon l’article 24 de la constitution, chaque citoyen doit, à l’âge de 20 ans, s’inscrire sur le registre civique et prêter serment « de servir sa patrie et la cause de la liberté et de l’égalité, en bon et fidèle citoyen, avec toute l’exactitude et le zèle dont il est capable… ». La principale responsabilité politique des citoyens est d’élire, parmi eux, le corps électoral donc chaque électeur représente 100 citoyens et dont la moitié seulement est élue par tirage au sort.
Organisation structurelle
Découpage en cantons de la République helvétique au début de 1798. La constitution découpe le territoire de l’Helvétique (du nom couramment donné à la République helvétique) en 22 cantons : en plus des 13 cantons existants jusqu’alors sont créés les huit cantons suivants : le canton de Saint-Gall comprenant la ville de Saint-Gall, l’Alte Landschaft et le Toggenburg ; le canton de Sargans formé des régions du Rheintal, de Sax, de Gams, de Werdenberg, de Gaster, d’Uznach, de Rapperswil et de March ; les cantons d’Argovie et du Léman par séparation du canton de Berne ; les cantons de Thurgovie, de Bellinzone et de Lugano formés à partir d’anciens bailliages communs ; les cantons du Valais et des Grisons, anciens territoires indépendants.
Le territoire de Genève devient partie intégrante du département du Léman alors que Neuchâtel est détachée de la Suisse tout en restant une principauté prussienne. La capitale du pays, au départ Aarau, devient Lucerne le 22 septembre 1789 pour des raisons de place avant d’être déplacée à Berne en 1799 à la suite de l’occupation autrichienne. Enfin, le 20 septembre 1802, la capitale provisoire passe à Lausanne pour un mois après les révolutions internes.
Découpage en cantons de la République helvétique à la fin de 1798.
Pendant les mois qui suivent la signature de la constitution, plusieurs redécoupages territoriaux ont lieu. Le 28 mars, le canton de Berne est à nouveau amputé d’une région par la formation du canton d’Oberland alors que, le 11 avril, le canton de Zoug se retrouve privé des régions de Baden, des Freie Ämter et du Kelleramt au profit du nouveau canton de Baden. Enfin, à la suite de la révolte du canton de Nidwald contre la constitution, les cantons d’Uri, de Schwytz, d’Unterwald et de Zoug sont regroupés au sein du canton de Waldstätten, le canton de Linth regroupe ceux de Glaris et de Sargans et le canton du Säntis ceux d’Appenzell et de Saint-Gall, réduisant ainsi le nombre de cantons à 18. En 1802, un nouveau changement territorial aura lieu par l’échange du Fricktal, jusqu’alors territoire autrichien, nouvellement rattaché au canton d’Argovie avec le Valais, érigé en république et dont le ministre plénipotentiaire sera François-René de Chateaubriand qui ne s’y rendra jamais.
Organisation politique
Grande première dans l’histoire politique de la Confédération, la constitution prévoit un pouvoir législatif bicaméral sur le modèle français de la Constitution de l’an III, appelé « Parlement », et dont les membres sont élus par le corps électoral. Le Sénat, chambre haute, est composé de quatre membres par canton et se trouve responsable des modifications de la constitution alors que le Grand Conseil, chambre basse composée de 144 membres élus proportionnellement à la population de chaque canton, élabore les lois qui sont ensuite approuvées ou refusées par le Sénat et inversement. Les membres des deux chambres doivent porter un costume officiel lors de leurs sessions et jouissent de l’immunité parlementaire[41].
Le pouvoir exécutif de la république est confié, selon la constitution, à un Directoire exécutif de constitué de cinq membres, âgés de 40 ans au moins, et élus par le Parlement selon un système complexe qui prévoit un renouvellement annuel de l’un des cinq membres par tirage au sort. Ce directoire dispose de pouvoirs plus étendus que son homologue français.
Les cantons, réduits au rang de simples entités administratives, disposent à leur tête d’un préfet national (appelé en allemand Regierungsstatthalter, soit Lieutenant du gouvernement), qui représente le gouvernement central et est chargé de la nomination de la plupart des fonctionnaires locaux ainsi que de la sécurité locale pour laquelle il peut faire appel aux troupes cantonales. Ces cantons sont divisés en districts, dirigés par des sous-préfets nommés par le préfet.
Le pouvoir judiciaire est exercé pour sa part par un Tribunal suprême formé d’un juge et d’un suppléant par canton renouvelé par quart tous les ans et dont le président est nommé par le Directoire. Le Tribunal suprême est la seule instance à même de prononcer une peine de mort et la torture est officiellement interdite[]. Aux niveaux inférieurs, des tribunaux de districts de neuf membres ainsi que des tribunaux de cantons, formés de treize juges, sont chargés respectivement des jugements relevant de la correctionnelle et de la police pour les premiers et des jugements pénaux en premier appel pour les seconds. Pendant les quelques années que dure la République helvétique, trois forces politiques s’affrontent : d’un côté se trouvent les « patriotes » ou « unitaires », amis de la France et qualifiés de jacobins par le camp opposé. De l’autre côté se trouvent les « fédéralistes », partisans de l’Autriche et de l’Angleterre et qualifiés d’oligarques par leurs adversaires. Enfin, au centre, se trouve le troisième camp, celui des « républicains » généralement indécis et appelés « modérantistes » par les deux extrêmes. Pendant toute la période allant jusqu’en 1802, la polarisation gauche-droite du débat politique va s’intensifier au détriment de la voie centrale, alors que les trois camps vont successivement prendre le pouvoir : les « patriotes » de 1798 à 1799, les « républicains » en 1800 puis les « fédéralistes » dès 1802.
Organisation militaire
En vertu du « Traité de paix et d’alliance offensive et défensive » conclu avec la République française, la République helvétique se doit de mettre sur pied une armée. Le Directoire crée ainsi le 4 septembre 1798 la Légion helvétique principalement destinée au maintien de l’ordre intérieur[45]. Cette troupe permanente devait être initialement composée de 1 500 volontaires répartis en quinze compagnies et dirigées par le général Augustin Keller avant que son effectif ne double selon une loi votée le 7 mai 1799 mais qui ne sera jamais appliquée. Cette légion représente la première tentative au niveau national d’un service militaire obligatoire formant une armée de milice dont l’équipement et l’instruction sont uniformisés.
En parallèle, et selon le trait susmentionné, le gouvernement français réclame dès le mois d’octobre « la mise sur pied de 18 000 hommes » qui doivent être répartis dans six demi-brigades auxiliaires rattachées à l’armée française. Malgré plusieurs déclarations et appels du Directoire, rapidement appuyés par différents règlements et lois, les appels au volontariat ne permettent de réunir que 500 officiers et environ 3 500 hommes. Lors de la campagne d’Italie de 1799 à laquelle elle prend part, l’armée helvétique n’aligne que quelque 5 000 hommes sur les 211 512 attendus par la France.
Organisation économique
Dans bien des régions de campagne, la révolution de 1798 n’a été acceptée que difficilement par les paysans et principalement sur la promesse de l’abolition des dîmes et les cens qui les touchaient depuis le Haut Moyen Âge ; le plan financier visant à compenser cette perte prévoit la vente des biens nationaux et la redistribution des sommes ainsi collectées aux anciens bénéficiaires de droits féodaux. Cependant, dès le début de la République helvétique, les finances publiques deviennent un problème majeur : les saisies financières opérées par les troupes françaises couplées à la guerre de 1799 ont laissé le pays au bord de la faillite.
Dans le but d’assainir les finances publiques, le Directoire décide de nationaliser la fortune des cantons et met sur pied un système d’impôts directs prélevés identiquement sur l’ensemble du territoire : impôts sur le capital, impôts fonciers, taxe d’habitation et taxes de commerce sont ainsi approuvés par le gouvernement qui accompagne ces mesures par la création de plusieurs impôts indirects tels que le droit de timbre ou les taxes sur les boissons et le sel. Ces mesures ne peuvent toutefois pas être appliquées car la nouvelle administration centralisée n’a pas encore eu le temps de se mettre en place : sur les 13,5 millions de francs prévus comme recettes au budget de 1799, seuls 3,8 millions seront récoltés. Et malgré plusieurs mesures très impopulaires qui provoqueront de nombreuses révoltes entre 1801 et 1803, la République helvétique doit suspendre ses paiements dès 1801, se plaçant ainsi en état de cessation de paiement.
Guerre en Suisse
Malgré sa neutralité officielle, l’alliance militaire offensive et défensive de la République helvétique avec la France et sa position centrale en font une cible pour les alliés qui vont entraîner le pays dans la guerre.
La guerre des Grisons
Dès mars 1799, l’armée d’Helvétie commandée par André Masséna pénètre dans les vallées des Grisons, qu’il conquiert successivement au prix de nombreux affrontements avec l’armée autrichienne, afin d’assurer la liaison entre les armées du Danube et d’Italie. Le général instaure, le 12 mars, un gouvernement provisoire à Coire et permet, le 21 du même mois, aux Grisons, jusqu’alors simples alliés de la Confédération, de rejoindre la nouvelle République helvétique comme nouveau canton. Cependant, la victoire de l’archiduc Charles d’Autriche sur le général Jean-Baptiste Jourdan à Stockach le 25 mars permet à l’armée autrichienne du général Friedrich von Hotze, augmentée de quelques milliers d’émigrés suisses, d’entrer en Suisse et de reprendre les Grisons avant de se répandre sur l’ensemble du pays, de Schaffhouse et Saint-Gall jusqu’au Haut-Valais pour faire sa jonction le 22 mai avec l’archiduc Charles, qui, de son côté passe le Rhin à Stein am Rhein le 21. Pendant cette opération, une paysanne grisonne nommée Anna Maria Bühler devient une héroïne locale en retardant la retraite des troupes françaises : selon le journal local, le 3 mai 1799, elle s’était « jetée sur l’attelage tirant les canons français, les retenant jusqu’à l’arrivée des compatriotes, qui purent ainsi prendre les chevaux et les pièces » ; son geste lui vaudra d’être reçue en audience en 1811 par l’empereur à Vienne.
Les batailles de Zurich
Devant l’avancée des armées alliées, Masséna se retranche dans la ville de Zurich où la bataille s’engage dès le 4 juin et se poursuit pendant deux jours, après lesquels le général français en net désavantage numérique se retire à l’ouest de la Limmat, laissant l’archiduc Charles pénétrer dans la ville. Les troupes autrichiennes, dans les jours qui suivent, s’emparent encore des cantons de Schwytz, de Glaris, d’Uri et du Tessin, coupant ainsi le pays en deux et forçant les autorités de la république à quitter Lucerne, trop proche des lignes autrichiennes, pour se réfugier à Berne qui devient ainsi la nouvelle capitale du pays.
Alors que le découragement et la déroute financière frappent durement le pays et provoquent plusieurs manifestations populaires dénonçant l’alliance franco-helvétique de 1789, Masséna repasse la Limmat le 3 septembre 1799 et attaque les troupes russes qui ont remplacé les Autrichiens le 26 septembre lors de la deuxième bataille de Zurich qu’il remporte, forçant le général russe Alexandre Korsakov et ses 27 000 hommes à quitter la ville. Dans le même temps, une seconde armée russe commandée par Alexandre Souvorov et arrivant d’Italie par le col du Saint-Gothard est également repoussée par le général Lecourbe et doit quitter le pays par le col du Panix où il perd un tiers de ses hommes. Le 25 septembre, l’armée autrichienne perd le général Friedrich von Hotze lors d’une reconnaissance, ce qui crée le désordre et la confusion chez ses soldats. Ils essaient malgré tout de défendre le village de Kaltbrunn, mais ce dernier est finalement emporté à la baïonnette, mettant en déroute l’armée autrichienne. De fait, dès l’automne 1799, les combats sur le territoire helvétique cessent même si des troupes autrichiennes continuent à stationner dans certaines vallées grisonnes jusqu’au début de 1800.
Les mouvements militaires sur le territoire de la République helvétique provoquent plusieurs soulèvements populaires, soit contre le rétablissement de l’Ancien Régime par les Autrichiens de la part des paysans du nord-est du pays, soit contre la république des Français dans l’ouest du pays et le Haut-Valais dont l’insurrection de mai 1799 est réprimée dans le sang près de la forêt de Finges après quinze jours de lutte. De tous côtés, le retour à la neutralité et la fin de l’alliance offensive avec la France est demandée : Peter Ochs, principal partisan de l’alliance française, est finalement forcé par ses six collègues à démissionner du Directoire le 25 juin 1799.
Les coups d’État de 1800 à 1802
La paix signée le 9 février 1801 à Lunéville marque à la fois la fin de la seconde coalition et la reconnaissance officielle de la République helvétique par l’Autriche. La présence continue de troupes françaises sur le territoire de la République helvétique est largement utilisée par les anciens adversaires de la France, en particulier l’Angleterre (qui utilisera cet argument en 1803 pour rompre la paix d’Amiens) par voie de presse ainsi que par voie diplomatique pour prouver que le premier consul Bonaparte ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de ce pays, forçant le gouvernement français à riposter par une campagne de presse expliquant la position française en Suisse.
En parallèle, entre 1800 et 1802, pas moins de quatre coups d’État vont secouer la République helvétique ; si tous se déroulent sans effusion de sang et dans une indifférence relative de la population, ils démontrent aux occupants français que le gouvernement central de la république n’est pas capable d’atteindre la stabilité nécessaire pour gouverner le pays[52]. Le premier des coups d’État se produit le 7 et 8 janvier 1800 lorsque le Directoire, conduit par le « patriote » Laharpe, est supprimé et remplacé par une « Commission exécutive provisoire » de sept membres parmi lesquels seuls deux anciens directeurs (Dodler et Savary) figurent. Le second coup d’État survient le 7 août 1800 lorsque les deux chambres du parlement sont dissoutes par le gouvernement provisoire et remplacées par un « Conseil législatif » de 43 membres. Le troisième coup d’État voit, le 27 octobre 1801, l’union contre nature des fédéralistes et des autorités françaises pour renverser les autorités en place et pousser au pouvoir Alois von Reding. Enfin, le dernier coup d’État est le fait de la gauche des « patriotes », le 17 avril 1802, qui pousse Reding à la démission et lance l’élaboration d’une nouvelle Constitution.
Dans la nuit du 19 au 20 février 1802 éclate une insurrection dans le pays de Vaud où des paysans locaux, baptisés les « Bourla-Papey » (littéralement brûle-papiers en patois local), mettent le feu aux archives du château de La Sarraz afin de détruire les titres de propriété utilisés par le gouvernement de la République helvétique pour réclamer le paiement des droits féodaux[53]. Cet épisode se répète à plusieurs reprises dans plusieurs châteaux de La Côte et du Gros-de-Vaud jusqu’au début du mois de mai, lorsque les contingents venant de plusieurs villages et menés par Louis Reymond se regroupent à Morges pour préparer une action sur Lausanne où ils pénètrent aux cris de « Paix aux hommes, guerre aux papiers ! » le 8 mai et se heurtent aux forces françaises mobilisées sous les ordres du commissaire Bernhard Friedrich Kuhn qui parvient à négocier un retrait des paysans en l’échange d’un armistice général et de l’abolition des droits féodaux dans les meilleurs délais. Les principaux chefs de l’insurrection seront toutefois condamnés à mort par contumace en juin 1802 par un tribunal spécial dont la décision sera, sous l’influence d’Henri Monod, adoucie par une amnistie le 15 octobre[54]. Cette révolte a été décrite par Charles-Ferdinand Ramuz en 1942 dans son roman La guerre aux papiers.
La seconde constitution helvétique et la guerre des Bâtons
Dès l’adoption de la constitution, plusieurs projets de modifications sont lancés, principalement dans le but de redonner plus de poids politique aux cantons. Une nouvelle version de cette constitution, appelée « Constitution de la Malmaison » du nom de la résidence du Premier consul où ce texte a été en grande partie rédigé, voit le jour pendant l’année 1802 : cette version, tout en confirmant que « la République helvétique est une », redonne un certain pouvoir aux cantons qui ont chacun une « organisation relative à sa localité et à ses mœurs » ainsi qu’une administration propre.
Le texte est soumis à la votation populaire (pour la première fois dans le pays), le 25 mai 1802. Officiellement, le texte est approuvé par seize cantons contre cinq et par 167 172 voix contre 92 423 tout en sachant que les abstentions ont été décomptées comme approbation[]. Devant ce qu’il pense être un retour à la stabilisation dans le pays, le Premier Consul Bonaparte ordonne alors le 25 juillet 1802 à ses troupes de se retirer du territoire helvétique dès le mois d’août de la même année.
Dès le départ des troupes françaises, des soulèvements populaires éclatent dans le canton de Berne et en Suisse centrale où les cantons proclament leur indépendance tout en mettant sur pied une milice de 8 000 hommes commandée par le colonel Bachmann qui va bousculer et vaincre facilement les troupes officielles du gouvernement dans ce qui sera par la suite appelé Stecklikrieg (« Guerre des Bâtons » en allemand) en référence à l’équipement de fortune des troupes insurgées. Un premier combat se déroule le 28 août au col du Rengg, suivi de la marche des insurgés vers les frontières de Vaud et de Fribourg ; le gouvernement helvétique, alors présidé par Johann Rudolf Dolder, quitte Berne pour se réfugier à Lausanne le 19 septembre 1802 dans l’espoir de reprendre l’offensive. Le 3 octobre, les 2 000 hommes des troupes régulières se heurtent aux fédéralistes à Faoug où elles sont battues et doivent se replier sur Lausanne. Le lendemain, le général Jean Rapp, aide de camp de Bonaparte, arrive sur les lieux pour informer les belligérants de la décision de médiation prise par le Premier consul.
L’Acte de médiation
« Je ne puis ni ne dois rester insensible au malheur auquel vous êtes en proie ; je reviens sur ma résolution ; je serai le médiateur de vos différends ». C’est par ces mots que Bonaparte s’adresse le 30 septembre 1802 aux « Habitants de l’Helvétie ». Cette médiation débouchera, après quelques mois de travail, sur l’Acte de médiation, première constitution de la Suisse moderne.
La médiation de Bonaparte
La médiation armée que Bonaparte apporte aux autorités helvétiques n’est pas imposée mais réclamée par ces mêmes autorités et par les fédéralistes ; lorsqu’il accepte le rôle de médiateur, le Premier consul menace d’employer la force pour exercer ce rôle, méthode largement utilisée en droit international jusqu’au milieu du XIXe siècle. Elle prend la forme officielle d’une proclamation qui convoque à Paris une Consulta helvétique réunissant 60 membres des différentes fractions, parmi lesquels Johann Heinrich Pestalozzi, Pierre Ochs, Louis d’Affry ou Henri Monod – mais pas Laharpe qui a refusé tout mandat – et encadrée par quatre sénateurs français. Le choix de la capitale française est justifié par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord auprès des députés en arguant de la désorganisation du pays et du besoin de mettre un maximum de distance entre ces députés et les troubles civils.
Dès le début des travaux de la conférence, Bonaparte se prononce pour une organisation fédéraliste du pays, défendue par les anciens patriciens du pays bien que les unitaires soient majoritairement représentés. Pendant les premières semaines de travail, les différentes délégations vont élaborer des projets de constitutions cantonales et fédérales, avant que deux commissions de cinq membres chacune ne soient désignées pour tenir les discussions finales, avec Bonaparte, à partir du 29 janvier 1803. Ce dernier rédige personnellement l’Acte de médiation et le remet aux dix membres des commissions le 19 février, avant que la conférence ne soit officiellement dissoute le 21 février.
L’acte en lui-même est un document formé d’un préambule rédigé par Bonaparte, des 19 constitutions cantonales comprenant chacune en moyenne vingt articles, puis de l’Acte fédéral qui définit en quarante articles l’organisation politique, sociale et militaire du pays. Enfin, le document se termine par deux annexes, comprenant respectivement treize et neuf articles, décrivant les dispositions transitoires à mettre en œuvre jusqu’à la tenue de la première Diète[60].
Confédération des XIX cantons
Découpage de la Suisse en cantons sous la médiation.
L’Acte de médiation, qui entre en vigueur officiellement le 15 avril 1803, définit 19 cantons nommés officiellement, pour la seule et unique fois dans l’histoire du pays, par ordre alphabétique : Appenzell, Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Unterwald, Uri, Vaud, Zoug et Zurich. Le gouvernement des cantons est de trois types différents : pour les campagnards (Uri, Schwytz, Unterwald, Glaris, Appenzell et Zoug), la Landsgemeinde est rétablie ; pour les anciens cantons-villes (Bâle, Berne, Fribourg, Lucerne, Schaffhouse, Soleure et Zurich), l’ancienne aristocratie locale reprend le pouvoir ; pour les nouveaux cantons enfin (Argovie, Saint-Gall, Thurgovie, Tessin et Vaud), une démocratie représentative est mise en place ; cas spécial, les Grisons retrouvent leur structure particulière.
Les douanes qui existaient entre les cantons avant 1798 ne sont pas rétablies mais remplacées par des péages. Dans le même ordre d’idées, alors que le franc suisse est confirmé comme monnaie officielle du pays, chaque canton garde sa propre monnaie. L’organe directeur du pays redevient la Diète fédérale, qui se réunit normalement une fois par an au chef-lieu du canton directeur qui change chaque année. Elle est formée de 19 délégués, un par canton dont les six plus peuplés (Argovie, Berne, Grisons, Saint-Gall, Vaud, et Zurich) ont une voix double. Son rôle est essentiellement limité à la politique extérieure ainsi qu’à la défense, avec également une fonction peu employée de tribunal d’arbitrage en cas de litiges entre cantons, ceux-ci préférant régler leurs problèmes inter-cantonaux par voie de concordats[61].
Pour la seule et unique fois de son histoire[nappey 3], le pays est gouverné par une seule personne portant le titre de « landamman de la Suisse »[note 8] qui est à la fois le chef d’État du pays et celui du canton présidant la Diète pour l’année en cours. De par ses fonctions, il représente la Diète envers les chefs d’État étrangers, mène les discussions et négociations internationales, surveille l’exécution des décisions prises par la Diète ainsi que la gestion du trésor fédéral et peut enfin convoquer une Diète extraordinaire.
La première Diète de Fribourg
De retour de Paris avec les pleins pouvoirs, Louis d’Affry passe la moitié de l’année à Fribourg à préparer et mettre en place la nouvelle administration pour pouvoir, le 4 juillet 1803, ouvrir en tant que Landamman la première Diète fédérale. Celle-ci va durer trois mois pendant lesquels le nouveau gouvernement du pays se retrouve à l’honneur à la fois dans la presse et par la diplomatie européenne. Parmi les nombreux sujets à l’ordre du jour, les députés adoptent le 27 septembre 1803 un nouveau texte d’alliance avec la France (baptisé par la suite seconde paix de Fribourg en référence à la paix perpétuelle signée en 1516) qui remplace l’alliance offensive et défensive de 1798. Ce traité, uniquement défensif, se double d’un traité de capitulation générale permettant à l’armée française de recruter jusqu’à 16 000 hommes de troupe parmi les soldats suisses ainsi que la possibilité, sur proposition du Landammann, pour vingt jeunes Suisses de suivre l’École polytechnique. L’un des premiers effets du traité signé avec la France est le départ des troupes françaises du sol helvétique dès janvier 1804, marquant ainsi la fin de la dernière occupation du territoire (à l’exception du canton du Tessin en 1807) par une armée étrangère.
La Bockenkrieg
Le retour au pouvoir des oligarchies composées d’aristocrates et de notables de l’Ancien Régime dans certaines villes du pays ne satisfait pas la population rurale, dépendante des villes. C’est en particulier le cas au début de l’année 1804 lorsque les paysans vivant sur les bords du lac de Zurich mettent le feu au château de Wädenswil le 24 mars 1804. Au nombre de 600 et menés par un savetier nommé Hans Jakob Willi, les paysans tendent un piège aux troupes locales en les attirant sur la colline du Bocken (d’où le nom de guerre du Bocken, en allemand Bockenkrieg, donné à l’épisode) située sur le territoire de la commune de Horgen et en les enfermant dans une auberge. Les militaires tentent alors une sortie désespérée après avoir mis le feu à une maison, laissant douze morts et quatorze blessés sur le champ de bataille.
Avant même que les autorités zurichoises n’en fassent la demande, le nouveau Landamman bernois Niklaus Rudolf von Wattenwyl ordonne la mobilisation des troupes fédérales et les envoie à Affoltern am Albis où elles écrasent les paysans le 3 avril. Les trois meneurs sont capturés et exécutés alors que la région reste occupée par les troupes fédérales pendant quelques années, montrant ainsi la détermination des nouvelles autorités à combattre cette insurrection qui sera la dernière guerre menée par des paysans suisses.
La Suisse et le blocus continental
Bien qu’officiellement neutre, la Suisse entre dans le blocus continental du nouvel empereur Napoléon Ier dès le 5 juillet 1806 en interdisant l’importation de marchandises britanniques. Ce blocus aura des effets à la fois négatifs et positifs sur l’économie nationale : déjà touchée par les effets des mesures protectionnistes prises par la France, en particulier sur les cotonnades, le chanvre et le lin, l’industrie textile du pays va devoir rationaliser sa production, provoquant ainsi une hausse du chômage, principalement dans l’est du pays. Cependant, l’absence de concurrence britannique permet dans le même temps le développement des filatures de coton et l’écoulement des productions. En 1805, le filateur zurichois Hans Caspar Escher va lancer sa propre production de métiers mécaniques, créant ainsi l’entreprise Escher-Wyss, l’une des principales usines métallurgiques du pays, aujourd’hui spécialisée dans la fabrication de turbines.
Corollaires de ces avancées technologiques, deux expositions organisées à Berne en 1804 et 1810 et consacrées à l’artisanat et à l’industrie sont les précurseurs des futures « expositions nationales ». C’est pendant la même période que sont organisées dans le canton de Berne en 1805 et 1808 les fêtes d’Unspunnen qui, dans le cadre du renouveau patriotique et dans le but de fortifier les liens entre ville et campagne, représentent l’idéal suisse d’une vie rude et naturelle grâce en partie à la tenue de jeux traditionnels dits « de bergers » qui eurent un rayonnement suprarégional.
Pendant cette période, deux importants chantiers de génie civil sont engagés dans le pays : c’est tout d’abord l’achèvement de la route hippomobile du col du Simplon qui remplace l’ancien sentier muletier reliant Brigue à Domodossola. Cette nouvelle route, construite sous la direction de l’ingénieur en chef Nicolas Céard et dont le coût de 8 millions de francs a été entièrement financé par la France et l’Italie, est inaugurée en secret le 5 octobre 1805 ; il s’agit en effet d’un projet militaire permettant d’achever la route menant de Paris à Milan et qui doit le plus possible rester inconnu des Autrichiens alors en guerre contre la France en Italie.
D’autre part, en 1807, commencent les travaux de correction de la Linth qui durent jusqu’en 1823 et qui permettent à la fois de mettre fin aux inondations quasi-annuelles de la Linth en amont du lac de Zurich et d’assécher et mettre en culture les marécages de la région. Cette entreprise sera entièrement financée par souscription publique, sans que l’État n’ait à dépenser un seul franc, et réalisée par l’ingénieur zurichois Hans Conrad Escher qui sera, en récompense, honoré du titre de von der Linth.
Pendant la période du blocus continental, deux catastrophes marquent les esprits et provoquent des élans souvent imprévus de solidarité entre les différents groupes de populations du pays.
Le 2 avril 1805, la ville fribourgeoise de Bulle est quasiment entièrement détruite lors d’un incendie. Si aucune victime n’est à déplorer, les quelque 1 200 habitants de l’époque sont pratiquement tous sinistrés et les dépôts de gruyère sont entièrement détruits, cette dernière nouvelle faisant les grands titres de la presse étrangère, en particulier du Moniteur universel français du 17 avril qui évalue les dégâts au montant de 7 à 800 000 francs[]. Grâce aux aides financières venant de tout le pays, les travaux de reconstruction sont rapidement entrepris : si une rangée de maisons est supprimée pour créer la grande place du marché, la halle aux grains est rebâtie en premier, alors que l’hôtel de ville est achevé en 1808 et l’église paroissiale en 1816. Une année plus tard, le 2 septembre 1806, le pays connaît la plus grave catastrophe naturelle de son histoire avec l’éboulement de 35 à 40 millions de mètres cubes de roches sur six kilomètres carrés qui détruisent totalement la centaine de maisons qui composent alors le village de Goldau, situé sur le territoire de la commune d’Arth, et tuent 437 personnes et environ 400 têtes de bétail.
La chute du système napoléonien
Le groupe de Coppet
Dès son arrivée au château de Coppet en avril 1802, Germaine de Staël, exilée de Paris par Napoléon, publie Delphine en 1802 et Corinne en 1807 et fonde ce que Stendhal appelle « les États généraux de l’opinion européenne », à savoir le groupe de Coppet réunissant autour d’elle différents politiciens et écrivains français et allemands tels Benjamin Constant ou Juliette Récamier qui vont, pendant une dizaine d’années, œuvrer à la formation et à la diffusion de nouveau concepts issus des idées des Lumières dans des domaines tels que la politique, l’économie, la religion, la littérature ou le théâtre. Le groupe, et en particulier son instigatrice, va rapidement incarner une forme de résistance morale à la dictature impériale française, ce qui lui vaut d’être surveillée de près. Elle parvient toutefois à tromper la vigilance de ses gardiens en 1812 lorsqu’elle entreprend un long voyage qui la mènera de la Russie à la Grande-Bretagne en passant par la Suède et l’Autriche, autant de pays opposés au régime français et qui formeront, quelques années plus tard, une nouvelle coalition contre celui-ci.
Des militaires suisses dans les armées de l’Empire
Outre les 14 000 hommes répartis en quatre régiments de ligne et deux régiments de la garde prévus dans la dernière capitulation passée entre la Diète fédérale et le royaume de France en 1816, les Suisses seront plusieurs dizaines de milliers à servir dans les différentes armées d’Europe pendant les guerres de la Révolution française et du Premier empire, dont une trentaine de généraux de l’armée française sur les 190 étrangers qui exercent un commandement entre 1798 et 1815.
Malgré la longue tradition du mercenariat suisse au service de la France, les autorités éprouvent dès 1810 de plus en plus de mal à remplir leurs obligations en hommes : les pertes importantes subies par les régiments français, couplées aux nombreux retards de paiement de la solde et des rentes pour les anciens militaires, à la défectuosité du système d’enrôlement et aux difficultés imposées par les inspecteurs français qui exigent en particulier que les recrues soient suisses depuis plusieurs générations empêchent la plupart des cantons de fournir les contingents prévus. Les troupes suisses seront cependant partie prenante dans la plupart des grandes batailles de l’histoire napoléonienne : à Wagram, à Trafalgar ou encore à Bailén où le régiment de Reding des Grisons se retrouve face-à-face avec celui d’Affry (fils du Landammann) de Soleure. Cependant, le principal engagement qui sera également le plus meurtrier pour les troupes suisses, est celui de la Bérézina où les 1 300 hommes restants, faute de munitions, vont devoir charger à huit reprises à la baïonnette les soldats russes pour permettre aux restes de la Grande Armée de franchir le fleuve : seuls 300 hommes survivront à cette bataille.
Bataille des Nations et la chute de la médiation
Les vainqueurs de la bataille de Leipzig (peinture de Johann Peter Krafft, 1839, musée historique de Berlin).
À la suite de la défaite de Napoléon lors de la bataille de Leipzig en octobre 1813, les troupes françaises poursuivies par celles de la sixième Coalition européenne se retirent du sol allemand pour rejoindre la France. À cette occasion, la mobilisation générale est ordonnée par la Diète pour défendre les frontières du pays ; cet appel à la mobilisation ne rencontre que peu d’écho et ne permet de réunir que quelques dizaines de milliers d’hommes : les demandes incessantes de la France qui absorbait les meilleurs soldats du pays, couplées au manque de solidarité cantonale marqué par une défiance envers l’armée fédérale et à la volonté nette de Napoléon d’empêcher le développement d’une véritable armée en Suisse, expliquent ce faible rendement. Malgré les messages de la Diète qui va rappeler la neutralité du pays dans le conflit et malgré l’avis défavorable du tsar Alexandre Ier qui s’affiche en défenseur des nouveaux cantons, en particulier du canton de Vaud[f], les alliés traversent le pays de part en part sur une ligne Bâle–Berne–Lausanne en direction de la France. Les quelque 12 000 soldats suisses ne pouvant pas rivaliser avec l’armée autrichienne de 160 000 hommes qui commence à franchir le Rhin à Bâle dès le 21 décembre 1813, le général Von Wattenwyl renonce à toute résistance et ordonne le licenciement des troupes ; à cette occasion, de nombreuses accusations de trahison seront proférées par les soldats envers leurs supérieurs, en particulier envers le général en titre, sans toutefois aucune suite judiciaire.
Devant l’avancée des troupes alliées qui atteignent Neuchâtel le 24 décembre et Lausanne le 26, la Diète réunie à Zurich sous la direction du Landammann Hans Reinhard décrète le 29 décembre 1813 que « l’Acte de médiation ne saurait durer plus longtemps », mettant ainsi fin au régime de la médiation. Cependant, cette décision est prise en l’absence des représentants de sept des 19 cantons, la rendant anticonstitutionnelle. Deux jours plus tard, après que les troupes françaises ont évacué la ville sans combattre devant l’avancée du général autrichien Ferdinand von Bubna und Littitz, Genève déclare à son tour son indépendance et quitte l’Empire français pour retrouver, pour quelques années, son statut de république autonome.
Avec la chute de la médiation qui précède celle de son médiateur en avril 1814, la Suisse retrouve son indépendance et quitte la sphère de domination française. Une longue Diète de plus d’une année va, tout en acceptant trois nouveaux cantons en son sein, élaborer et adopter officiellement un nouveau Pacte fédéral, document fondateur de la Confédération des XXII cantons qui sera confirmé et soutenu par les pays européens lors du congrès de Vienne de 1815. 1. |
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.400) Austerlitz (2 décembre 1805, lors de la campagne d’Allemagne) est la plus fameuse bataille de Napoléon. La troisième coalition contre la France avait été ouverte par l’accord conclu à Saint-Pétersbourg entre l’Angleterre et la Russie le 11 avril 1805, suivi d’un traité d’alliance entre les deux nations en juillet, alliance que rallia l’empereur autrichien François II en août, ainsi que Naples et la Suède. Napoléon était sur ses gardes : de Boulogne, où il préparait une hypothétique invasion de l’Angleterre, il surveillait les Autrichiens et avait prévu de marcher sur Vienne par deux voies : par la Bavière (nation alliée de la France) et en suivant la vallée du Danube – d’une part, à travers la Bohême-Moravie d’autre part. La (p.401) première bataille importante de la campagne eut lieu à Ulm, où s’était enfermé le général autrichien Mack, qui capitula en octobre 1805 ; mais la bataille décisive eut lieu à Austerlitz (entre Prague et Vienne). Le champ de bataille d’Austerlitz, choisi par Napoléon, était une vaste plaine, bordée par un ruisseau (le Goldbach), avec, au centre, un plateau (le plateau de Pratzen) dominant la plaine d’environ deux cents mètres. Le 29 novembre, au lieu de s’installer sur le plateau, Napoléon l’abandonne aux Austro-Russes, feint de battre en retraite et déploie son armée en arrière du Goldbach. Son plan était le suivant : inspirer aux alliés ennemis le projet de tourner l’armée française par sa droite, pour lui couper la route de Vienne (vers le village de Telnitz), ce qui les obligerait à dégarnir le plateau de Pratzen et à se diriger vers Telnitz.
Les Autrichiens tombèrent dans le piège, quittèrent le plateau central et allèrent défendre la route de Vienne, tandis que les Russes, commandés par Koutouzov, occupaient le plateau le 30 novembre ; le 2 décembre, vers sept heures du matin, les Autrichiens se ruèrent à l’attaque de Telnitz et des villages voisins (tenus par Davout) et, pendant ce combat, Napoléon, profitant du brouillard très dense qui noyait la petite vallée du Goldbach et les flancs du plateau de Pratzen, envoyait Soult sur le plateau vers huit heures et demie : à neuf heures le brouillard d’Austerlitz commençait à se dissiper et les Austro-Russes découvrirent qu’ils avaient perdu le centre du champ de bataille, occupé maintenant par les Français. Ils essayèrent de reconquérir Pratzen, mais n’y parvinrent pas : à 16 heures, la nuit tombait et Napoléon avait gagné la bataille d’Austerlitz. Mais comment ? Par un « coup de poker », comme l’écrit Jacques Garnier, spécialiste de l’histoire des batailles napoléoniennes. Car la manœuvre d’Austerlitz (laisser le plateau à l’ennemi, l’attirer à Telnitz et profiter du brouillard) ne pouvait réussir que sous plusieurs conditions : 1° que les Austro-Russes tombent dans le piège qui les attirait à Telnitz et dégarnissent le plateau ; 2° que le brouillard fasse son apparition au bon moment ; 3° qu’il persiste suffisamment longtemps, pour permettre aux Français d’escalader les flancs du plateau sans être vus. Quelle pythonisse pouvait prévoir tout cela ? À Austerlitz, Napoléon n’a pas fait preuve de génie, il a simplement joué au loto et gagné le gros lot. Encore fallait-il avoir le cran de miser.
(p.402) La victoire d’Iéna (14 octobre 1806, au cours de la campagne de Prusse) ne fut pas due à un pari, comme celle d’Austerlitz, mais à un coup de malchance pour les Prussiens. Le 13 octobre, Napoléon et son armée, au grand complet, atteignaient léna, juste en arrière des positions prussiennes ; il ignorait que le roi de Prusse et ses généraux, craignant d’être cernés, avaient décidé la retraite et que l’armée prussienne s’était divisée en deux colonnes, l’une sous le commandement du duc de Brunswick, l’autre commandée par Hohenlohe. Croyant donc avoir toute l’armée ennemie devant lui, il décide de l’enfoncer de front et d’envoyer Davout la tourner par Auerstedt, à vingt kilomètres au nord. La bataille a eu lieu, et Napoléon écrase sans mal Hohenlohe, qui n’a avec lui qu’une partie de l’armée prussienne. Le même jour, Davout sera vainqueur à Auerstedt.
(p.402) La campagne de Pologne contre les Russes, en 1806-1807, fut mal préparée. Eylau (8 février 1807) fut une boucherie inutile (le mot est de Napoléon lui-même) ; Friedland (14 juin 1807) fut une bataille improvisée, offensive, mais parfaitement réussie (les Russes étaient dans une position dangereuse, le dos à une rivière) ; huit jours après, les Russes demandaient l’armistice et le tsar Alexandre Ier rencontra Napoléon sur un radeau lancé au milieu du Niémen : la paix fut signée à Tilsit le 8 juillet 1807, c’était un traité napoléonien, c’est-à-dire une simple trêve, lourde de guerres futures (il prévoyait le démembrement de la Prusse et la résurrection partielle de la Pologne à laquelle la Russie ne risquait pas de souscrire).
Après la campagne de Pologne, Napoléon décide d’asphyxier économiquement l’Angleterre en organisant le blocus continental, initiative qui l’entraîna dans une politique de guerres et d’annexions, en particulier à deux interventions militaires qui devaient lui être fatales : au Portugal (en 1807) et en Espagne (1808). Il détrôna les dynasties régnantes, nomma son frère Joseph roi d’Espagne et dut faire face alors, dans la péninsule Ibérique, à une longue guérilla qui, soutenue par un corps expéditionnaire anglais (commandé par Wellington), eut enfin raison de Napoléon.
La campagne de 1809, en Autriche et en Allemagne, a été marquée par les batailles d’Essling (21-22 mai) et de Wagram (4-6 juillet). La première fut perdue par Napoléon, qui cherchait un passage sur le Danube, à l’est de Vienne (qu’il occupait), pour (p.403) débusquer le prince Charles et son armée. Il choisit d’utiliser l’île de Lobau, sur le fleuve, fait construire rapidement un pont, franchit le Danube, est repoussé par les Autrichiens à Essling, et doit se replier avec son armée dans l’île (où il se retrancha). Sa défaite était due principalement à la crue du Danube, pourtant prévisible à cette époque de l’année. Quarante jours plus tard, c’était la décrue, Napoléon et son armée purent quitter l’île de Lobau et l’Empereur offrit la bataille à l’archiduc Charles dans la plaine dominée par le plateau de Wagram (4-6 juillet 1809), qui opposa l’armée française (190 000 hommes) à l’armée autrichienne (220 000 hommes). La victoire revint à Napoléon et à ses généraux (Masséna, Bernadotte, Oudinot, Davout), mais elle ne fut suivie d’aucun résultat tactique, puisque l’archiduc Charles put s’échapper et se replier en Bohême. Elle fut cependant suivie de la signature du traité de Vienne (14 octobre 1809)… et du mariage de Napoléon avec la fille de l’empereur autrichien, Marie-Louise, destiné à fonder une dynastie Bonaparte, puisque Joséphine n’avait pas donné d’héritier à l’Empereur (il divorça le 16 décembre 1809, le mariage religieux fut annulé le 9 février 1810, et Napoléon épousa Marie-Louise le 1er avril 1810 ; un enfant, le roi de Rome, devait naître de cette union le 20 mars 1811).
|
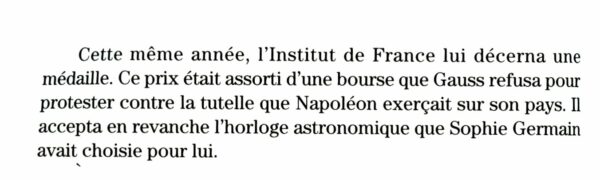
Le mathématicien Gauss détestait Napoléon...
(in: Gauss, Une révolution de la théorie des nombres, 2018, éd. RBA, p.98)

Autriche / Arrestation du résistant tyrolien Andreas Hofer
(Die Zeit, 08/04/2009)

Autriche / Peloton d'exécution pour le résistant tyrolien Andreas Hofer à Mantova (Mantoue)

2.5 La campagne désastreuse de Napoléon en Russie: mise au point
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont
(p.331) Devant Smolensk, les cosaques ne tenaient pas. Ce n’était par leur vocation de tenir devant une attaque massive. On lit dans certains récits qu’il furent « balayés » par la cavalerie légère de Murat et l’infanterie de Ney. Non, ils se dérobaient. La cavalerie napoléonienne dite légère avançait d’un trot assez lent et derrière elle les fantassins. Un millier de cosaques s’étaient habilement défilés derriere un pli de terrain et de broussailles et ils avaient galopé au-devant des Français en poussant un cri qui ressemblait à « Hourrah! ». Quelques-uns d’entre eux étaient même arrivés si près du maréchal Ney que celui-ci avait eu le collet de son habit déchiré par une balle de carabine, puis, devant la pression continue, les cavaliers sauvages sur leurs petits chevaux s’étaient éparpillés à droite et à gauche; une nuée d’insectes qui se diluait.
(p.337) Nous avons vu plus de 400.000 hommes franchir le Niémen.
(p. 372) Ayant quitté Mojaisk, Napoléon traversa en partie le champ de bataille de la Moskowa. Il en émanait une odeur insoutenable et des nuées de corbeaux s’en élevaient à mesure que s’avançaient les cavaliers de l’escorte impériale. Le souverain vit là avec effroi un blessé qui survivait encore au milieu des cadavres. Incapable de marcher, il s’était traîné d’une charogne de cheval à une autre pour se nourrir. Reconnaissant l’Empereur, il trouva encore assez de force pour l’injurier.
(p.375) Dans toutes les guerres, avant la motorisation des armées, les chevaux ont été des martyrs. La plus grande palme doit être attribuée à ceux de la Grande Armée en Russie. Massacrés (comme les hommes) sur les champs de bataille, abandonnés blessés (comme souvent les hommes), jambes brisées, ventre crevé ; agonisant pendant des jours, picorés encore vivant par les corbeaux, puis sur la neige glacée, mangés vivants par les hommes.
Tombés, on n’attend pas qu’ils soient morts pour les découper, le gel les durcit trop vite. On voit de ces animaux secouer la tête en hennissant tandis que les dépeceurs s’affairent. En quelques jours, ce spectacle qui nous révulserait va cesser d’attendrir et même d’intéresser. Dès qu’un cheval s’abat, en même temps qu’il est dépecé, des gourmands l’ouvrent pour chercher Ie foie, morceau réputé le plus savoureux; d’autres- l’égorgent pour recueillir du sang dans leurs grandes marmites. Ils le consomment à peine cuit, barbouillant affreusement leur visage barbu et sale.
On va voir mieux et, pour ainsi dire, plus étrange : des hommes découpent des biftecks dans les cuisses de chevaux qui marchent encore, attelés à un véhicule. Le froid est tel que l’animal saigne à peine; il continue à marcher sans s’apercevoir, semble-t-il, de ce qu’on leur fait subir; anesthésie locale – au moins provisoire – par le froid. Une sorte de mot d’ordre se répand: – C’est mieux de les manger vivants.
Au départ de Moscou, des soldats ont eu des chiens qu’ils aimaient bien. Plus de chiens, tous dévorés. Des hommes ont-ils été dévorés par des hommes ? Au hasard des témoignages, on rencontre ici et là des allusions. Elles ont été souvent démenties parce que le cannibalisme est tabou, mais le désir désespéré de survivre a raison de tous les tabous : de nos jours même, l’histoire d’un avion tombé dans la Cordillère des Andes nous l’a rappelé. Entre autres survivants de la retraite de Russie, le sergent Bourgogne dit un mot: « Nous joignîmes deux soldats de la.ligne. Ils nous assurèrent qu’ils avaient vu des soldats étrangers (des Croates) faisant partie de notre armée, retirer du feu d’une grange un cadavre tout r6ti, en couper et en manger. Je crois que cela est arrivé plusieurs fois dans le cours de cette fatale campagne, sans cependant jamais l’avoir vu. Quel intérêt ces hommes presque mourants auraient-ils eu à nous Ie dire, si cela n’était pas vrai? »
(p.380) La longue marche a repris, par moins vingt-huit. Paul-Émile Victor m’a assuré que marcher sur la neige par vingt-huit degrés de froid, n’importe quel homme ou n’importe quelle femme peut le faire à condition d’être en bonne santé, d’être vêtu et nourri comme cette température l’exige. Les survivants de la Grande Armée qui cheminaient maintenant en direction d’Orcha (à environ 120 km au sud-ouest de Smolensk) – ne parlons pas des blessés et des malades qui agonisent en marchant – sont sous-alimentés, couverts de vermine sous leurs haillons et leur état psychique est déplorable, d’abord parce que chaque matin ils laissent sur la neige les cadavres de copains nus et congelés. Larrcy a décrit l’aspect de ces morts: «La peau et les muscles s’exfolient comme dans les statues de cire, les os restent à nu. Le nez s’enlèverait comme un faux nez, les mains putréfiées tombent. Hormis la Garde, officiers et soldats vont dans le même désordre, toutes armes confondues. Certains ont sur l’épaule une besace et sur le côté un pot attaché par une corde, d’autres traînent par la bride des ombres de chevaux portant chacun une marmite et de chétives provisions. Cependant roulent encore dans ce long neuve humain douloureux, des voitures où sont des officiers et des civils, hommes et femmes.
Bivouaquer par vingt-huit degrés de froid, on ne peut; aussi le fait-on de préférence en arrivant à un village, si misérable soit-il, parce que les isbas fournissent soit du bois de chauffage, soit un abri. Elles sont construites de troncs de sapin, superposés en carré, simplement retenus par des échancrures pratiquées aux extrémités et dont les interstices sont bourrés avec de la mousse. Les démolir n’est qu’un jeu.
Les individus et les groupes qui prétendent garder une isba intacte pour s’y abriter prennent un risque énorme. Neuf fois sur dix, d’autres groupes les attaquent, en commençant par arracher la toiture. En cas de résistance, les assaillants mettent le feu.
Je viens de parler de groupes parce que, après Krasnoïé, on ne voit plus dans l’armée d’unités constituées, seulement de petites bandes.
(p.381) Honssov se trouve sur la Bérézina, à 120 km de là. En avant! Des malades, des blessés tombent, on les pousse sur le côté de la route sans écouter leurs plaintes, souvent en les injuriant. La férocité n’est pourtant pas absolument générale car on voit des soldats guidant par la main un aveugle. N’importe quel habitué des sports d’hiver sait que, sur la neige, faute de lunettes protectrices, les yeux souffrent. Les troupiers qui marchent depuis des semaines sur l’étendue blanche sont maintenant atteints d’ophtalmies aiguës parce qu’ils n’ont pas de lunettes, parce que la fumée des bivouacs a irrité leurs yeux, parce qu’ils se sont frotté les yeux avec leurs mains dégoûtantes – ou avec de la neige, dans l’espoir de moins souffrir. La cécité inspire a priori la pitié. Pourtant, peu de ces aveugles atteindront la Bérézina.
(p.384) Malgré les épouvantables souffrances endurées, le prestige du chef suprême agissait encore sur une partie de l’armée, on entendait encore crier vive l’Empereur!, mais les occasions de le faire étaient de plus en plus rares. Sur les blessés agonisant le long de la route, le magnétisme n’agissait plus : le contraire eût été surprenant. Peu avant Borissov, gisait sur la neige un employé de l’administration de l’armée qui venait d’avoir les deux jambes brisées. Comme Napoléon passait à cheval à la tête de l’escadron sacré, cet homme se souleva sur ses bras : – Voilà, s’écria-t-il, ce misérable pantin qui nous mène depuis dix ans comme des automates! Camarades, il est fou, méfiez-vous de lui, il est devenu cannibale! Le monstre vous dévorera tous!
L’Empereur passa sans paraître le voir ni l’entendre et ainsi rarent les autres cavaliers et la Garde derrière eux et derrière tous ceux qui suivaient. Que faire maintenant sinon obéir à l’Empereur et le suivre?
On arrivait à la Bérézina. (p.393) De la Bérézina à Vilna, il y avait environ 250 km; ensuite, seulement une soixantaine jusqu’a Kovno, sur le Niémen. Naturellement, les soldats ne comptaient pas en kilomètres, mais en lieues.
L’armée a d’abord traversé une région marécageuse. La température s’était adoucie. On allait sur une route étroite entre les marais, certains étaient franchis sur des ponts de bois. Les hommes à pied cheminaient pêle-mêle avec des caissons d’artillerie – il y en avait encore – et des voitures d’officiers et de civils, il y en avait encore et, parfois, certains tombaient dans les marais fangeux et s’y noyaient; ou ils s’y enlisaient lentement. « Au secours » mais on n’écoutait pas.
Puis de nouveau le froid. Entre la Bérézina et Vilna, la température s’est maintenue entre moins vingt et un et moins trente, avec plusieurs pointes – elles duraient parfois une journée, une nuit – à moins trente et un. Des nuées tournoyantes de corbeaux survolaient toujours l’exode, et l’on commença à voir de ces oiseaux qui, soudain, tombaient comme des pierres. Foudroyés par le froid. Des soldats tournaient la tête de côté et d’autre pour voir si un camarade s’effondrait; à peine touchait-il la neige, il était dépouillé; on se bousculait, on se battait avec injures pour le dépouiller. D’autres n’avaient plus l’énergie de se livrer à ces atroces violences, ils allaient comme des fantômes.
Les visages emmitouflés de chiffons, de morceaux de vêtements, de n’importe quoi, personne ne parlait parce que l’haleine des paroles se gelait sur les faces. On entendait seulement les croassements des corbeaux, le grincement des roues des voitures et aussi ici et là comme un martèlement de sabots sur la neige durcie. C’étaient des hommes qui, n’ayant plus de souliers, allaient les pieds enveloppés de chiffons si durcis que les blocs de leurs pieds produisaient ce bruit. Certains, rendus inconscients par le malheur, allaient même pieds nus, faisaient le même bruit. Aux bivouacs ces hommes tendaient au feu leurs pieds-glaçons. Beaucoup ne pouvaient repartir.
A intervalles, les cosaques apparaissaient sur la neige comme des points noirs qui grossissaient très vite. Seule la Garde – ce qui en restait – était capable de repousser leurs assauts. Quant aux autres, « ceux qui avaient gardé des armes les jetaient pour se sauver plus promptement ou pour que, s’ils étaient pris, ils ne soient pas soupçonnés de vouloir se défendre ». Des hommes qui dans les batailles avaient souvent montré un courage surhumain; ils étaient comme morts à eux-mêmes, le regard fixe, l’air hébété. Beaucoup devaient conserver, même rentrés en France, ce masque ragé. Les soldats appelaient cela la moscovite.
(p.399) L’ENFER FROID “Eh bien, le brigand est donc parti! – Oui, il vient de partir à l’instant. Il nous a déjà fait le coup en Egypte. » Étonné de cette expression de brigand, j’appris avec surprise par la suite de la conversation qu’il s’agissait de Napoléon. Peu de temps après, l’armée fut instruite officiellement de ce départ.» (René Bourgeois, chirurgien-major du régiment Dauphin-Cuirassier)
Comment la Garde n’aurait-elle pas été l’unité la plus blessée par le départ de son père chéri et chérisseur? Après son départ, elle se débande, plus de marche en ordre, on la voit mêlée aux autres soldats clochards, exténués. Le nouveau commandant en chef, Murat, ne dit rien, il laisse faire, d’ailleurs que pourrait-il ? « Il était bien illusoire de confier à un maréchal la conduite des misérables débris qui restaient. On ne pouvait concevoir ni un plan ni la moindre organisation tactique. Sauve qui peut était le seul commandement que nous voulions écouter. » Une seule idée : en finir. On ne pense même plus à Kovno, au Niémen, c’est trop loin, un seul nom circule : Vilna. « A Vilna, disent des soldats, je me coucherai dans une maison et je mourrai content.» On en est là.
Or, à Oszmiana, environ 80 km avant Vilna, voici de nouveau un imprévu, un mouvement sur l’avant. Arrivent à la rencontre, non pas des ennemis pour barrer la route, mais un renfort, une division entière, 12 000 hommes, sous les ordres du général Loison. Des soldats jeunes et en bonne santé, spectacle à peine croyable. Ils regardent avec effarement les spectres qui les interrogent. – Oui, nous venons de Vilna.
En réalité, ils ont séjourné quelque temps à Vilna, mais ils viennent de toute l’Allemagne – une majorité d’Allemands parmi eux – et il y en a même qui viennent de France. De France! Et pourtant, personne ne leur demande de nouvelles du cher pays, les spectres sont bien trop occupés – « bestialement», dirait le lieutenant Hubert Lyautey – à autre chose : à manger. La division Loison est arrivée avec des fourgons de ravitaillement; des biscuits surtout, de durs biscuits de soldat, mais là, sur la neige, autour des pauvres maisons de bois d’Oszmiana, ces biscuits, les soldats les mangent en pleurant de joie. Déjà les hommes de la division Loison font mouvement, ils marchent vers l’arrière du long troupeau : ils ont été envoyés pour protéger la retraite.
Un des événements, non le plus spectaculaire, mais le plus dramatique de la retraite de Russie – souvent à peine mentionné, comme un détail – va se produire, dans les quarante-huit heures qui vont suivre, entre Oszmiana et Vilna : les deux tiers de la division Loison vont périr. Non sous les coups de l’ennemi, sous les charges des cosaques. Les cosaques n’attaqueront que peu et sans insister, entre Smiana et Vilna. Environ huit mille soldats de la division « fraiche » envoyés en renfort, vont mourir tout simplement de froid.
Ils sont jeunes, bien nourris depuis des semaines, point épuisés par de trop longues marches, vêtus normalement comme des soldats en campagne – ce n’est pas assez; mieux valaient peut-être, après tout, les loques – pouilleuses entassées les unes sur les autres par-dessus la vermine et la crasse – mais surtout, ils ne sont pas le résultat d’une sélection impitoyable faite durant toute la retraite par le froid et la misère. Affrontés brutalement à ce froid inhumain, la plupart ne résistent pas. « On les voyait d’abord chanceler pendant quelques instants et marcher d’un pas mal assuré, comme ivres. Ils avaient la figure rouge et gonflée, bientôt (p.400) ils finissaient par être entièrement paralysés : leurs fusils s’échappaient de leurs mains inertes, leurs jambes fléchissaient sous eux et enfin ils tombaient.» Autre observation d’un médecin : « Les yeux étaient extrêmement rouges et souvent le sang s’écoulait par gouttes au-dehors de la conjonctive. Ainsi l’on peut dire sans métaphore qu’ils répandaient des larmes de sang. Cela n’est pas une exagération, beaucoup de personnes ont pu le constater. » Bref, sur 12 000 conscrits, 8 000 morts de froid. Les autres sont à l’arrière-garde et feront leur devoir.
(p.405) Au sommet de la hiérarchie, c’est un autre désordre. Murat réunit un conseil de guerre au cours duquel il vitupère Napoléon avec véhémence. I1 va bientôt lui écrire qu’il ne veut plus conserver son commandement, qu’il le passe à Eugène de Beauharnais, et il va partir pour ses États sans attendre la réponse du souverain. C’est Ney, encore lui, qui, avec les survivants de la division Loison, encore eux, va défendre Kovno pour laisser à des bandes désespérées le temps de franchir le Niémen. Des 400 000 hommes qui l’ont traversé d’ouest en est entre le 24 et le 30 juin 1812, combien vont le repasser, partie sur les ponts, partie sur la glace? Les dénombrements précis faits plus tard dans des bureaux à quatre cents lieues du fleuve glacé sont illusoires. Disons que sur 400 000 hommes, il en revint 10 000, ou 20000. Les Russes ont fait 100 000 prisonniers. Tout le reste est mort. La Grande Armée n’existe plus. Mais Napoléon est rentré en France pour chercher 300 000 soldats.
(p.408) / Pour échapper à la conscription/
Dernière solution : déserter ou frauder. J’ai parlé de ces bandes de réfractaires qui se sauvaient dans les bois, dans les montagnes. En 1813, ils étaient encore plus nombreux qu’auparavant parce qu’on savait que rejoindre l’armée, c’était au moins deux chances sur trois d’y laisser sa peau: l’Empereur lui-même n’avait presque rien caché des désastres dans le fameux 29e Bulletin. Il n’y avait plus assez de gendarmes pour faire la chasse aux réfractaires. En mai 1813, on allait compter environ 160 000 insoumis.
Frauder, c’était par exemple se mutiler volontairement : se casser les dents de devant ou se les carier en mâchant de l’encens) afin de ne pouvoir déchirer les cartouches: s’amputer du pouce pour ne pas pouvoir tenir le fusil: se faire aux bras et aux cuisses, à l’aide de vésicatoires, des plaies qu’on entretenait avec des compresses d’eau imprégnées d’arsenic: c’était se casser un pied, il y en avait qui allait jusqu’à se crever un oeil, mais les mutilations rendaient suspect: ou alors, payer pour obtenir de faux certificats de maladies graves : des médecins se livraient à ce trafic: des secrétaires de mairie délivraient de fausses pièces d’état civil trompant sur 1’âge, parfois même de faux certificats de décès: le réfractaire disparaissait et sa famille simulait son enterrement. Là aussi, il y avait un risque, surtout dans les campagnes, parce que les gens jasaient.
(p.451) 3 février 1814, trois heures de l’après-midi. Napoléon entre dans Troyes. Portes et volets sont fermés, la ville est glacée d’épouvante : la nouvelle s’est répandue que l’Empereur venait d’être battu sur le sol de France, c’est la fin. Les troupes exténuées défilent dans les rues désertes. Des soldats s’arrêtent devant les maisons barricadées, ils frappent aux portes en demandant du pain. Rien. Les habitants veulent garder leurs provisions pour satisfaire aux exigences des Russes, Prussiens et Autrichiens, pour n’être pas molestés quand ces ennemis arriveront. Des gens ont l’audace d’ouvrir leur fenêtre pour crier cela tout crûment aux soldats. Alors la colère éclate, les portes sont défoncées, les habitants roués de coups, les boutiques pillées.
(p.473) A la hauteur des faubourgs Saint-Martin et Saint-Denis, dans l’assistance, rien que des visages graves, tristes, un silence plutôt hostile. Une foule plus dense bordait plus loin le boulevard. Les soldats alliés défilaient en bon ordre, ils avaient un air de santé, leurs chevaux étaient luisants. Une puissante odeur de crottin flottait. L’enthousiasme fut déclenché au niveau de la rue Poissonnière par deux ou trois cris de: «Vive Alexandre ! Vivent les Alliés! » Le superbe souverain russe ralentit son cheval. – Nous vous apportons la paix! cria-t-il d’une voix forte.
Il ajouta d’autres paroles que les acclamations couvrirent. Des gens se jetaient vers son cheval, d’autres s’agenouillaientl Un délire se déchaîna lorsque les musiques russes se mirent à jouer des airs français. Les pseudo-vainqueurs de Napoléon étaient acclamés autant et plus que l’avait jamais été l’Empereur des Français dans sa capitale. En fait, c’était la paix qu’on acclamait. L’exaltation atteignit son sommet avenue des Champs-Elysées. Des hommes et des femmes embrassaient les bottes du tzar, son cheval. Pour mieux voir le spectacle, des femmes sautaient en croupe des cavaliers de l’état-major. Alexandre se retourna en riant : – Pourvu qu’on n’enlève pas ces Sabines!
Après ce défilé, des dizaines de milliers de Parisiens défilèrent eux-mêmes pour aller voir les troupes alliées campées sur les Champs-Elysées, à Neuilly et avenue de la Motte-Picquet. Drapeaux au vent, sonneries de trompettes, cuisines des troupiers, tout était spectacle pittoresque. Sur les Champs-Elysées, le bivouac des Anglais, Irlandais et Ecossais plaisait beaucoup, avec ses uniformes rouges, ses jupes à carreaux, les joueurs de cornemuse. Mais la plus grande curiosité allait aux campements d’en face, ceux des cosaques. Leurs huttes étaient faites de bottes de paille maintenues par des lances fichées en terre. Barbus, hirsutes, yeux bridés, sans gêne ils s’épouillaient, jouaient aux cartes, faisaient leur tambouille. Cordiaux si on s’adressait à eux (par gestes) point hostiles aux échanges : contre du tabac français, ils donnaient un gobelet d’émail russe; ou une chaîne de montre d’origine inconnue. Plusieurs de ces fils des steppes commirent une faute de tact en ouvrant au Pont-Neuf une sorte de marché où ils vendaient divers objets pillés par eux dans la région parisienne. Des spoliés le surent, arrivèrent, voulurent reprendre leur bien, il y eut là quelques bagarres. Point d’idylle sans jamais un nuage.
De tout événement naît un commerce. Moins de quarante-huit heures après l’entrée des Alliés à Paris, partout des marchands en boutique ou ambulants vendent des brochures. des chansons injurieuses pour Napoléon. On le compare à Robespierre, à Attila; il est un ogre, un assassin.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris
CH. VIII EXIT “NABOU”
(p.133-134) NAPOLÉON BONAPARTE DIRIGE CONTRE LA RUSSIE en 1812 une « croisade européenne » ; c’est sa formule. Sous lui, l’Europe se lève contre « la barbarie Tartare ». L’armée-Babel qu’il a réunie compte près de 700 000 hommes, mais il y a là quelque 400 000 Allemands, Polonais, Italiens, Hollandais, Suisses même. Il s’imagine que ces asservis vont se faire tuer en sa faveur (1) pour alourdir encore leur servage, alors que la plupart n’attendent que l’occasion de briser leurs chaînes. L’énormité des désertions, pendant la campagne de Russie, est passée sous silence par les chantres de « l’épopée », de même que l’illusion dont Mollien (T. 111, p. 67) nous faisait part: franchissant le Niémen, Napoléon croyait tout de bon aller au devant de profits gigantesques; il s’en était ouvert à son trésorier et comptait « lever en Russie autant de contributions qu’il en avair tirées de la Prusse et de l’Autriche », ensemble.
(1) Napoléon en était persuadé, estimant que la peur y suffirait. Et il disait, très fier, à Fouché: “Ainsi j’aurai l’extraordinaire politique d’avoir mes ennemis à mon service.”
|
|
Napoleon und seine Zeit, 1769-1821, in: Geo Epoche, 55, 2012
(S.131) /in Russland/
Napoleon bleibt 18 Tage in Wilna. Er ist – ungewöhnlich fur ihn – unentschlossen. Diesen Zeitverlust muss er aufholen. Am 16. Juli zieht er weiter. Er treibt die Armee zu Gewaltmarschen, um den zurückweichenden Gegner zu erreichen und zur Schlacht zu zwingen. Tagsüber steigen die Temperaturen nun auf 36 Grad. Die Marschkolonnen wirbeln Wolken aus Staub auf. Mensch und Tier dursten. Ortschaften mit Brunnen sind rar, Teiche und Gräben enthalten nur abgestandenes Wasser oder sind ausgetrocknet. Viele Soldaten trinken Pferde-Urin aus den Spurrillen der Strassen. Zahllose Kämpfer sterben an Dehydrierung, an Ruhr oder Erschöpfung.
Auch der Zustand der Pferde ist erbärmlich. Durch das schlechte Futter – oft erhalten sie nur altes Stroh vom Dach einer Bauernhütte – bekommen sie Koliken. Viele sind bald bis auf die Knochen abgemagert. Aus ihren wundgescheuerten Rücken tropft Eiter. Die gesamte Armee, Pferde wie Soldaten, leidet an Durchfall. Der Wegesrand ist voller Exkremente – und voller Pferdekadaver sowie Leichen der auf dem Marsch Verstorbenen. In der Hitze verbreiten sie fürchterlichen Gestank. Mitte Juli laufen die meisten Infanteristen bereits barfuss, da ihre Schuhe zerschlissen sind. Tausende halten das Marschtempo nicht durch, bleiben zurück, krank, entkräftet. Hunderte nehmen sich aus Verzweiflung das Leben. Viele desertieren, 50 000 Soldaten allein auf den ersten Etappen. Als die Armee am 28. Juli Witebsk erreicht, ist sie bereits um ein Drittel geschrumpft, ohne eine grosse Schlacht geschlagen zu haben.
(S.135) Das Inferno ist das Startsignal fur die Plünderungen. In einer wahren Raserei versuchen die Männer der Grande Armee, so viel wie möglich an sich zu reissen, bevor es Opfer der Flammen wird. ,,Man sah einen endlosen Zug von Soldaten, die Wein, Zucker, Tee, Möbel, Pelze, Kunstwerke und dergleichen mit sich schleppten », berichtet ein französischer Oberst. Die Armee befindet sich in völliger Auflösung. Überall laufen betrunkene Soldaten und Offiziere herum, beladen mit Beute und Proviant. Durch das Tosen der Flammen gellen die Schreie von Frauen, die vergewaltigt werden. Und das Heulen von Kettenhunden, die lebendig verbrennen.
(S.138) In der Nacht zum 23. Oktober hören die Einheiten, die sich noch nahe Moskau befinden, das Grollen explodierender Sprengsätze – Napoleon hat der Nachhut befohlen, den Kreml in die Luft zu sprengen. Da jedoch viele Zünder versagen, wird die Festung, trotz grosser Schäden, nicht zerstôrt.
(S.142) Der Andrang an den Brucken lässt nicht nach. Die Hinteren schieben sich über die Gestürzten und Gestrauchelten. ,,Ich habe in meinem Leben nie etwas Grausigeres erlebt als das Gefühl, über lebende Kreaturen hinwegzugehen, die versuchen, sich an meinen Beinen festzuklammern », berichtet ein Leutnant. Das Blutbad dauert an, bis es Napoleons Nachhut gelingt, die russischen Angreifer zuruckzudrängen. Doch auch in dieser Nacht lagern noch Tausende am östlichen Ufer. Sie sind zu erschöpft und zu apathisch, um dem Aufruf zu folgen, die Brücke zu überqueren. Am darauffolgenden Morgen gegen acht Uhr brennen die Brücken: Napoleons Soldaten haben sie angezündet, um dem Feind die Verfolgung unmöglich zu machen. Für Tausende Menschen, die nun zurückbleiben – Frauen, Kinder, Kranke, Verwundete, Erschöpfte -, ist es das sichere Todesurteil. In ihrem fürchterlichen Geschrei mischen sich Wut und Angst. An der Beresina verliert Napoleon mehr als 20000 Menschen, darunter mindestens 10000 Zivilisten.
(S.144) Erst im Januar 1813, als Rückkehrer der Grande Armee Ostpreussen erreichen, offenbart sich das ganze Ausmass der Katastrophe. Etwa 400 000 Soldaten des vor einem halben Jahr gut 600 000 Mann zählenden Heeres sind auf dem Russlandfeldzug gestorben – weniger als ein Viertel davon im Kampf, die Übrigen durch Hunger, Kälte, Krankheiten oder in der Gefangenschaft.
|
Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002(p.403) La rupture de l’alliance franco-russe qui avait été conclue à Erfurt fut la conséquence d’une part du rapprochement franco-autrichien après Wagram, d’autre part de la création du grand-duché de Varsovie, par Napoléon, en 1807, qui laissait présager une renaissance de l’État polonais que s’étaient jadis partagé la Russie et l’Autriche. Contre Napoléon, le tsar noua donc une même coalition avec les Anglais et la guerre éclata au mois de juin 1812. Une Grande Armée de près de 800 000 hommes partit, à pied, de Paris pour Moscou ; on sait qu’il n’en revint que quelques milliers. L’inefficacité totale de Napoléon en matière de stratégie se manifesta cruellement dans cette campagne de Russie ; il y fit les mêmes erreurs que Hitler plus d’un siècle plus tard : il partit avec une armée sans service sanitaire, sans train des équipages, presque sans service d’intendance, sans information géographique certaine (son meilleur instrument, en la matière, était un atlas de la Russie qu’avait rapporté Bâcler d’Albe de Varsovie en 1807), avec l’intention de vivre sur le pays, mais en ignorant à peu près tout et de ses ressources, et de son peuple. Il n’avait pas prévu ni (p.404) la stratégie de la terre brûlée adoptée par les généraux russes (notamment par Barclay de Tolly, qui fait le vide devant lui), ni l’extraordinaire stratégie de Koutouzov qui suivait la Grande Armée en attendant son heure, ni le froid russe, ni le dégel, ni qu’il prendrait une capitale en ruine, vidée de ses habitants et brûlée, ni la Bérézina. Le flambeau du guerrier Napoléon, qui avait fait illusion pendant dix-neuf ans, était éteint. Le désastre de Russie était, selon le mot célèbre de Talleyrand, « le commencement de la fin ».
|
|
Walter Krämer, Götz Trenkler, Das Beste aus dem Lexikon der populären Irrtümer, Piper Verlag, 2002
Napoleon Napoleons Russlandfeldzug wurde vor allem durch den harten Winter zu einer grossen Katastrophe
Kaiser Napoleon I. hat seinen grossen Russlandfeldzug nicht durch den harten Winter, sondern durch seine eigenen Fehler verloren; seine bekannte Entschuldigung für das Desaster »Unser Untergang war der Winter; wir sind das Opfer des Klimas « war nur ein Versuch, das eigene Versagen zu bemänteln. In Wahrheit war das Wetter den grössten Teil des Feldzuges über kaum kälter als üblich, eher wärmer. Wie überlieferte Wetterdaten zeigen, betrug die mittlere Temperatur in Kiew und Warschau im Oktober, zu Beginn des Rückzugs, +10°C, in Reval und Riga +7°C; selbst Ende November, beim berühmten Übergang über die angeblich eisstarrende Beresina, war der Fluss überhaupt noch nicht zugefroren; die bekannten Bilder von schneeverwehten, mit gewaltigen Eisschollen kämpfenden französischen Soldaten sind reine Erfindungen. Wenn der Napoleon Biograph André Maurois von russischen Granaten schreibt, die das Eis des Flusses aufgerissen hätten, ist er dabei dem Kaiser genauso auf den Leim gegangen wie der Rest der Welt. »Die Kälte nahm plötzlich zu«, behauptet Napoleon in seinem Bulletin vom 5.Dezember, »und in der Nacht vom 14. auf den 15. [November] zeigte das Thermometer 16 bis 18 Grad unter dem Gefrierpunkt. Die Wege waren mit Glatteis überdeckt; die Kavallerie, Artillerie und Trainpferde fielen jede Nacht in Menge um, nicht zu Hunderten, sondern zu Tausenden… Wir mussten einen grossen Teil unserer Kanonen im Stich lassen und zerstören sowie einen grossen Teil unseres Kriegs und Mundvorrats… « In Wahrheit hatte die Kälte tatsächlich zugenommen, aber erst viel später. Die enormen Materialverluste auf dem Rückweg waren vor allem schlechter Planung und nicht der Kälte zuzuschreiben. Beim Aufbruch aus Moskau hatte die Armee nur Pferdefutter für eine Woche, und vor allem deshalb, also aus Futtermangel, und nicht des Frostes wegen »fielen die Trainpferde jede Nacht zu Tausenden«. Selbst im November betrugen die mittleren Temperaturen in Kiew noch +2°C, wie einschlägige Aufzeichnungen zeigen, und selbst die kälteste überlieferte Novembernacht, mit 8 °C bei Smolensk, liegt noch weit über den Horrorfrösten, von denen Napoleon berichtet bat. Dass seine Märchen trotzdem geglaubt wurden, liegt an der grossen Kälte, die dann schliesslich wirklich ausbrach, wenn auch erst im Dezember, lange nach der eigentlichen Katastrophe. Die wenigen Heimkehrer, die unter anderem auch von klirrendem Frost auf dem Rückweg berichteten, schienen Napoleons Ausrede zu bestätigen; dass dieser Frost erst nach dem Untergang der «Grande Armée « ausbrach, wurde dabei übersehen.
Lit.: V. Cronin: Napoleon, Frankfurt a. M. 1975; G.Prause: Tratschkes Lexikon für Besserwisser, München 1986 (vor allem das Kapitel »Nicht der Winter verursachte die Russland Katastrophe«).
|
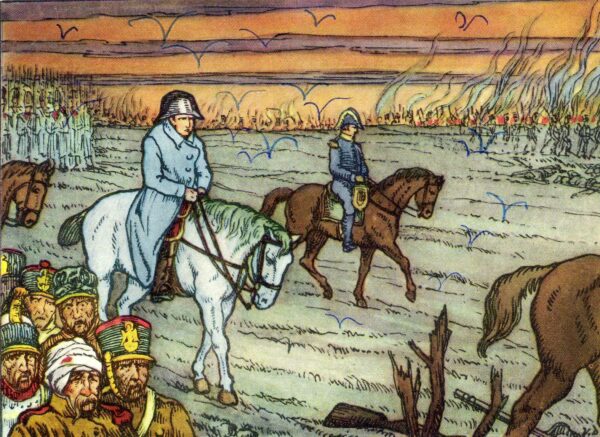

Russia against Napoleon: how Russia really won (Dominic Lieven)
(in: The Economist, 17/04/2010)

(Ullrich Volker, Die Tragödie des Rückzugs, Die Zeit, 04/04/2012)

Krepiert für Frankreich
(s.r.)

tableau de propagande napoléonienne
2.6 Les pillages en Europe par l’armée napoléonienne
|
Dell’ Orso Silvia, Ritornano in Italia le opere d’arte trafugate all’ estero, in : Gente, 14/12/2006, p.84-88
(p.88) Non è una novità che tanti capolavori d’arte vengano rubati e trafugati. I furti e le esportazioni clandestine sono una piaga antica e non solo in Italia: dalle opere d’arte sottratte corne bottino di guerra alle razzie napoleoniche (l’Incoronazione di spine di Tiziano, proveniente da Santa Maria delle Grazie a Milano e la Madonna della Vittoria del Mantegna, da Mantova, testimoniano ancora oggi al Louvre la consistenza di quelle spoliazioni), razzie compiute con una sistematicità non dissimile da quelle effettuate dai tedeschi nell’ultima guerra, fino a portarsi via straordinar! capolavori con la motivazione di poterli tutelare meglio.
|
|
From: Pierre Thomasset
Sent: Saturday, March 31, 2007 10:48 AM
Voici une autre information que j’ai apprise récemment : je comprends de mieux en mieux que l’expression « se prendre pour Napoléon » soit synonyme d’esprit dérangé. Sur ordre de ce malade de Napoléon, les archives vaticanes furent classées par les archivistes français à Paris, pendant quatre ans. Une partie fut détruite, brûlée, perdue ou mélangée. Ceux que ces archives intéressent peuvent regarder dans le grenier de leurs grands-parents, surtout s’ils étaient charcutiers à Paris. Les autres peuvent aider le Vatican à remettre dans l’ordre ce qui en reste. Voici un extrait d’une information à ce sujet, que vous pourrez facilement retrouver sur Internet. « En février 1810, Napoléon émit un édit d’occupation des archives papales; … Divers convois, composés d’énormes chariots … quittèrent Rome pour Paris … des expéditions analogues furent réalisées par la suite. A Paris, les … archives papales … devaient intégrer le projet des Archives Centrales de l’Empire, … L’épopée napoléonienne définitivement passée, Pie VII, le 12 août 1815, donna l’ordre à Marino Marini … de reprendre la préparation de l’expédition des archives … Marini reprit …ce travail le 3 septembre 1815, et … en octobre suivant, les premiers convois pouvaient partir, … Dans ces voyages de retour …, se reproduisirent les dommages encourus à l’aller, en particulier la perte de chariots entiers … Le 23 décembre 1815, Mgr Marini rentrait à Rome et pouvait remettre au pape la première partie de la documentation soustraite par Napoléon. C’est à ce moment qu’il fut demandé au comte Ginnasi … de récupérer la partie des Archives Vaticanes encore sur le sol français, et de la réexpédier à Rome. … le cardinal … Ercole Consalvi, décida que les « papiers inutiles, qui peuvent être jetés aux flammes » seraient ainsi détruits sur place. Le comte Ginnasi s’exécuta si bien que lorsqu’il revint à Rome, il avait brûlé des centaines (sinon des milliers) d’unités, tandis que d’autres milliers avaient été vendues comme papier à des charcutiers parisiens, si bien que beaucoup de séries d’archives vaticanes furent mutilées et d’autres disparurent pour toujours. Entre juillet 1816 et mars 1817, on envoya à Rome plusieurs convois, et le matériel Vatican retrouva progressivement son siège (avec les pertes mentionnées) les années suivantes. Bien à vous. Pierre Thomasset
|
|
Überall werden Galerien geplündert: Paris soll Kapitale der Kunst werden.
Zu den Schattenseiten von Napoleons imperialen Träumen gehört ein ebenfalls wenig bekanntes Kapitel, dem die Ausstellung unter der Überschrift »Objekte der Begierde» breiten Raum widmet: der Raub von Kunstsammlungen und Archiven aus Europa und ihre Überführung nach Paris, das zur Kapitale der Künste und Wïssenschaften ausgebaut werden sollte.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris
(p.118) « La guerre est la source de la richesse nationale ». Ce principe-là, tout à fait girondin, et fondamental chez Carnot, Bonaparte en fera sans cesse, vastement l’application. Le 5 octobre 1809, après Wagram, il écrivait à son trésorier, Mollien : «Cette campagne ne m’a pas rendu autant que la précédente; par les articles secrets du traité, je recevrai quelque 100 millions » ; il n’en pourra malheureusement arracher que 85, à l’Autriche. (En Prusse, ç’avait été une bien autre fiesta; les millions par centaines). Mais, à Hambourg, il va rafler 34 millions d’un seul coup; et lorsqu’il saisit lui-même la Hollande, à la place de ce Louis piteux qui ne savait pas faire « rendre » le pays, il impose, sur-le-champ, aux Bataves une contribution de 50 millions; présent qu’ils sont invités à lui remettre en témoignage du bonheur qu’ils éprouvent à l’avoir désormais pour souverain. Il avale les Etats du Pape ? Immédiatement main basse sur les « biens d’ Eglise » ; soit, à peu près, 150 millions. Le 24 mars, 1811, devant les Conseils réunis du Commerce et des Manufactures, Napoléon se targuera d’avoir « fait entrer en France plus d’un milliard de contributions étrangères depuis 1806 « .
(p.120) Ledit « Trésor des Braves » se mue, en 1810, par sénatus-consulte, en «Domaine Extraordinaire »; les sommes qui s’y entasseront, l’empereur s’en réserve, à lui seul, le maniement, et « sans être lié, précise la loi qu’il édicte, par aucune disposition du code » ; ce Trésor-en-marge, les bonnes gens devront croire qu’il est destiné à « subvenir aux dépenses des armées, récompenser les dévouements civils et militaires, élever des monuments, exécuter des travaux publics, ajouter à la splendeur de l’Empire ». Mais Mollien le Trésorier est bien obligé de constater qu’en réalité le budget de la guerre, à la charge du pays, et alimenté par les impôts, s’accroît de manière continue (344 millions en 1807; 400 en 1808; 700 en 1811; 722 en 1812, et 816 en 1813) et que, si l’empereur s’interdit d’augmenter sérieusement l’impôt foncier, car (p.121) il veille à ne point irriter les propriétaires, en revanche les contributions indirectes (ou « droits réunis ») qui pèsent lourd sur les humbles (mais l’étendue de la multitude permet, globalement, de beaux résultats) montent, montent, avec les années: 2 millions en 1808, 106 en 1809, 128 en 1811, 147 en 1812; en 1813, ils atteindront 189 millions, soit plus du double de ce qu’ils étaient cinq ans plus tôt. Les « grands travaux » ? Dépenses réelles, sur ce chapitre, de 1804 à 1813: 102 millions pour les embellissements de Paris, 148 millions pour tout le reste de la France; soit, au total, 250 millions en dix ans; alors que, pour les trois seules années 1811-1813, les dépenses militaires figurent au budget pour 2 milliards et 238 millions. (p.122) Le Domaine Extraordinaire de Napoléon Bonaparte, c’est son bien, son trésor, son argent; dépouilles européennes. Cela même pour quoi, en vue de quoi, il a, depuis vingt ans, tant joué des coudes, tant « combiné » (1) d’abord, et tant tué ensuite; la garantie de cette opulence, suprême et sans mesure, but unique de sa trajectoire.
(1) Confidence à Roederer : « Pour arriver où je suis arrivé, on ne sait pas ce qu’il m’a fallu de patience et de combinaisons”.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.47) On cite trop peu, dans les manuels, les instructions de Carnot, dès 1794 (et contre la volonté de Robespierre) à Jourdan et à Pichegru: « Montrez à vos hommes les richesses de l’Allemagne »; « En Belgique, prenez tout; il faut vider le pays. »
|
|
http://cms.berlineur.eu/?p=144
Quand Venus s’offrait des vacances à Paris Le 23 mai 2007, par pgom1
Fille de Prusse, kidnappée par Napoléon, manipulée par Hitler, et symbole de toutes les luttes et de toutes les époques…, s’il y a une berlinoise qui a été le témoin numéro 1 de l’Histoire de l’Allemagne, c’est bien elle! Elle n’a d’ailleurs sans doute rien à envier au Génie de la Bastille, à la Statue de la Liberté ou encore à la Bonne-Mère de Marseille. Le Quadrige de Venus orne la Porte de Brandebourg depuis 1793. Sculpté par Emmanuel-Ernst Jury (forgeron de Potsdam) sur les plans de Johann Gottfried Shadow (1764-1850), il représente la Déesse de la Victoire, Venus, sur un char tiré par 4 chevaux. Précisons tout-de-suite que le quadrige visible aujourd’hui n’est pas l’original, détruit lors de la bataille de Berlin (Avril – 7 Mai 45) alors que des soldats allemands s’étaient réfugié dessus. La direction dans laquelle est orientée Venus a son importance comme nous allons le voir. Initialement, elle était tournée vers la Ville -et donc vers l’Est comme aujourd’hui-, et elle symbolisait alors la grandeur prussienne et la Paix. Alors qu’il envahit la Prusse, Napoléon “saisit” le Quadrige, qu’il veut exposer à Paris. Celui-ci est donc démonté en décembre 1806 sur ordre de Denon (surnommé par les généraux français “notre voleur à la suite de la Grande Armée“), réparti en 12 caisses monumentales, et expédié à Paris par voie d’eau. L’enlèvement de la Venus s’avère être une grave erreur politique, car elle va dès lors symboliser pour les Prussiens la haine de l’envahisseur français. De plus, si on la destinait à orner le sommet de l’Arc du Carrousel du Louvre, elle s’avère être trop petite. Finalement, et même si elle est restaurée, elle ne sera jamais utilisée. Pour la petite histoire, ce sont les chevaux de St Marc (ou chevaux de Corinthe comme on les appelait alors), enlevés à Venise en 1797, qui seront choisis à la place. Aujourd’hui, une reproduction de ces chevaux orne toujours l’Arc de Triomphe du Carrousel (les originaux ayant été réexpédiés à Venise). Le Quadrige est “ramené à la maison” en 1814 par les armées prussiennes après une traversée triomphale de l’Empire, et la place qui l’accueille est, à l’occasion de ces célèbrations de la Victoire sur les armées napoléoniennes, renommée Pariser Platz : Place de Paris.
|
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014
(p.37) Troisième catégorie de prébendiers : les grands maréchaux ou généraux d’Empire. Napoléon tient à s’assurer de leur fidélité sans faille. Beaucoup sont depuis le début ses compagnons d’armes. Les titres, les gratifications de terres et les riches émoluments les combleront. Surtout, ils ont été invités à s’enrichir de leurs conquêtes. Dans sa célèbre déclaration du 27 mars 1796, le jeune chef de guerre de l’armée d’Italie avait dit à ses soldats : « Je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesses. » C’était une véritable invitation au pillage ! Ainsi, au classement des chefs militaires en fonction de leur bravoure, de leur habileté au combat ou de leurs hauts faits pourrait s’ajouter une autre hiérarchie, celle de leurs pillages. Si Suchet et Davout furent sans doute à la fois les meilleurs soldats et les plus honnêtes, Soult et Masséna furent parmi les plus discutés et les plus corrompus.
|
|
Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014
(p.73) Les prises artistiques – et l’on sait ici le rôle joué par Vivant Denon – sont également emblématiques. L’enlèvement des chefs-d’œuvre dans les pays conquis était d’usage courant et il a duré fort longtemps. Les musées européens sont chargés d’œuvres qui proviennent des butins des guerres sur le continent comme des razzias coloniales. Déjà, le Directoire avait prélevé des chefs-d’œuvre en Belgique, puis en Italie. Nos musées et les salons avaient fait une place nouvelle aux pièces des écoles flamande et italienne acquises gratuitement. Le Consulat et l’Empire enrichiront ces collections, année après année, au rythme des conquêtes. Le musée Napoléon, nom donné après coup au Muséum français ouvert au Louvre en 1793, (…).
|
| Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.456-457) annexe n° 11 Le pillage de l’Italie
Nous avons tenté de démontrer, dans ce livre, que la brillante et victorieuse campagne d’Italie est à porter au crédit de Carnot et des Directeurs, qui la dirigèrent à distance, et non pas à Bonaparte, qui ne fit qu’exécuter docilement les ordres reçus. C’est aussi le Directoire qui ordonna le pillage méthodique de l’Italie, crime de guerre dont Bonaparte ne fut que l’exécutant. Voici l’ordre (cynique) qu’il reçut à cet effet, daté du 7 mai 1796 (il le reçut le 14 ou le 15 mai). Le texte est extrait de Debidour, op. cit., II, p. 333.
Il n’est pas impossible que l’idée de voler les richesses artistiques italiennes ait d’abord germé dans l’esprit de Bonaparte et que cette lettre soit, non pas un ordre, mais une autorisation de pillage. « Le Directoire exécutif est persuadé, citoyen général, que vous regardez la gloire des beaux-arts comme attachée à celle de l’armée que vous commandez. L’Italie leur doit en grande partie ses richesses et son illustration ; mais le temps est arrivé où leur règne doit passer en France pour affermir et embellir celui de la liberté. Le Musée national [l’ancêtre de notre musée du Louvre, créé en 1793 et installé dans la grande galerie du Louvre] doit renfermer les monuments les plus célèbres de tous les arts, et vous ne négligerez pas de l’enrichir de ceux qu’il attend des conquêtes actuelles de l’armée d’Italie et de celles qui lui sont encore réservées. Cette glorieuse campagne, en mettant la République en mesure de donner la paix à ses ennemis, doit encore réparer les ravages du vandalisme en son sein et joindre à l’éclat des trophées militaires le charme des arts bienfaisants et consolateurs.
Le Directoire exécutif vous invite donc à rechercher, à recueillir et à faire transporter à Paris les objets de ce genre les plus précieux et à donner des ordres précis pour l’exécution éclairée de ces dispositions dont il désire que vous lui rendiez compte.
letourneur, carnot, la révellière-lépeaux »
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.35) Patriotism aside, it should also be pointed out that Napoleon was furious with Louis and Talleyrand because they had never paid him a cent of his huge pension. (p.36) He was having to finance his lavish lifestyle (he had a hundred servants on the island, as well as his Guards) out of his own money, which was now running low. Soon he would not have enough to pay his soldiers, and without them he would be defenceless against Talleyrand’s attempts to kidnap him. As any Frenchman knows, if you want to claim your pension rights, it is best to go straight to the central office in Paris. He had no choice but to leave Elba.
(p.37) He had already written the speech he intended to give to the nation: ‘People of France, a prince imposed by a temporarily victorious enemy is relying upon a few enemies of the people who hâve been condemned by all French governments for the last 25 years. During my exile, I have heard your complaints and your wishes. You have been demanding the government of your choice. I have crossed the sea and am here to reclaim my rights, which are also yours.’ And he didn’t only mean his pension.
Napoleon’s triumphant march north to Paris is the favourite story among pro-Bonaparte historians. They savour every detail. Reading their accounts, you get to know everything Napoleon ate en route (half a roast chicken in the village of Roccavignon near Grasse, for example, and roast duck and olives in Sisteron, in the foothills of the Alps), how little he slept (he would set off every morning at four a.m.), and the flattering speeches he gave in every town he crossed (‘my dearest wish was to arrive with the speed of an eagle in this good town of Gap/Grenoble/what’s its name again?’).
The descriptions of how French soldiers, supposedly in the service of Louis XVIII, defied their officers and joined Napoleon are the stuff of a propaganda film. These are the Bonapartists’ fondest memories.
(p.38) Boney was back in 1815.
(p.40) French historian called Aurélien Lignereux revealed that Napoleon was right to be afraid of opposition. Ordinary middle-class French people were reacting to the news of his return with trepidation. They saw it as yet another upheaval, and suspected that war would be around the corner yet again.
XI When Napoleon arrived in Paris on 20 March 1815, schoolchildren greeted the news by cheering and beating out a celebration drumroll on their desktops. Perhaps they knew that they were safe from conscription, though it probably wasn’t a good idea to be too proficient at drumming – Napoleon’s armies sent young drummer boys into the front lines, to be shot at just like the adults.
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.208) A national art collection had been started in 1793, largely consisting of works that had been ‘liberated’ from the Church or the royal family during the Revolution. Napoleon began(p.209) to contribute to the collection as soon as he was named chief of the French army based in Italy in 1796. All French generals were under orders to ‘send to France all the artistic and scientific monuments that they consider worthy of entering our museums and libraries’, and Napoleon fulfilled his mission with the same thoroughness he applied to any task, pillaging Europe’s art collections – including that of the Vatican – of its finest pictures, sculptures and manuscripts. In 1800, on seizing power, he moved the collection to the Louvre, ironically evicting a large group of artists who had been squatting there since the Revolution. He also decided that the country’s art collection needed to be centralised, and dispossessed many provincial museums of their prize exhibits.
|
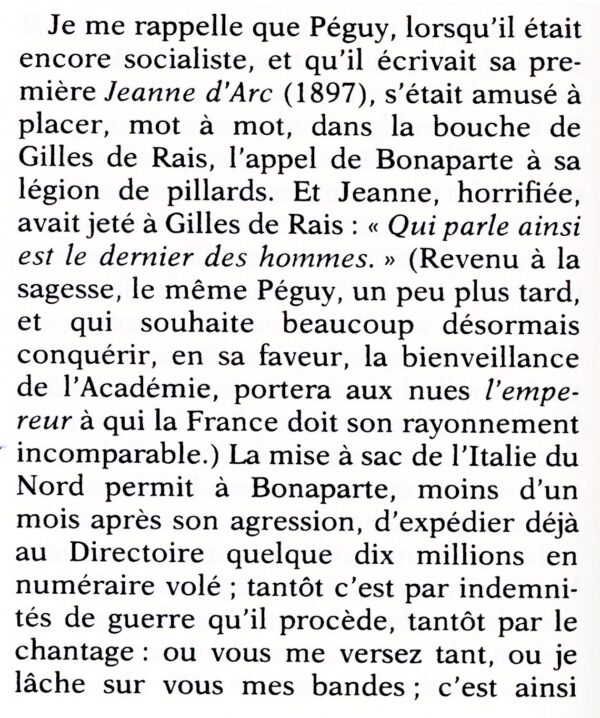
Pillages de l'Europe et de l'Egypte par l'armée napoléonienne
(in: Henri Guillemin, 1789, Silence aux pauvres, Utovie, 2012, p.56-59)
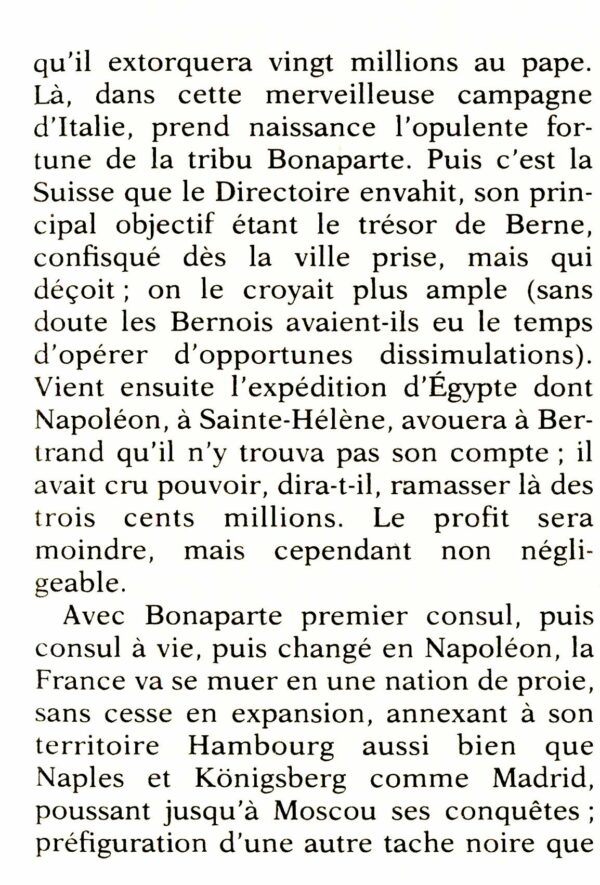

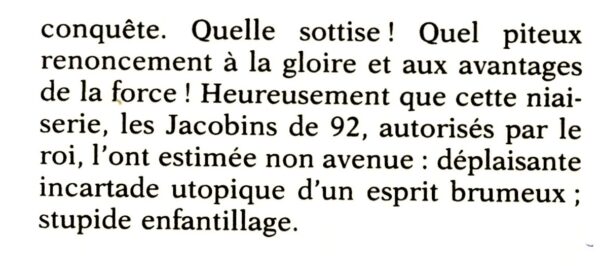

Kunstroof als militaire discipline onder Napoleon
(in: Geschiedenis, 4, 2015)

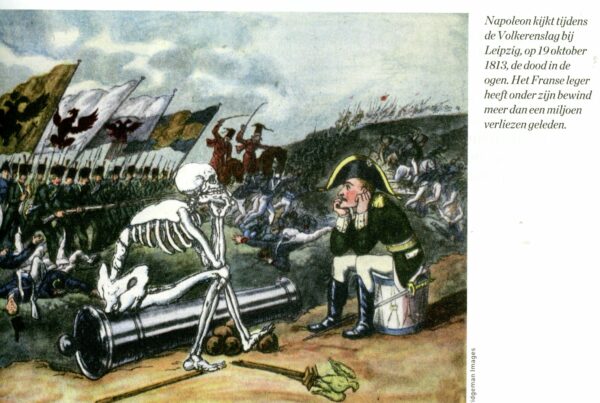
2013: de Volkerenslag bij Leipzig: de nederlaag van Napoleon
(Johan Op de Beeck, in: Knack Historia, 2019, p.17)
2.7 Avant, pendant et après Waterloo

Les innombrables mensonges concernant la Bataille de Waterloo en 1815
(in: Luc De Vos, Het einde van Napoleon, Waterloo 1815, 2002, p.7)
Pendant Napoléon…
|
in : Bernard Coppens, Patrice Courcelle, Le chemin d’Ohain, Waterloo 1815, Les carnets de la campagne, n°2, éd. De la Belle Alliance, 1999
(p.23) LE 7e BATAILLON DE LIGNE BELGE L’armée des Pays-Bas qui combattit à Waterloo était issue de la fusion hâtive d’éléments constitués dans deux pays différents, la Hollande et la Belgique, que la politique européenne avait réunis sans que les sentiments des populations aient été pris en compte.
Le sort de la Belgique, au moment de l’invasion par les troupes alliées était demeuré incertain. Trois solutions furent envisagées : l’indépendance, le retour à la souveraineté de la maison d’Autriche, et l’union de la Belgique et de la Hollande, afin de former un état en mesure de s’opposer à l’expansionnisme français. Une partie du pays, les départements de la Meuse-Inférieure (Limbourg) et celui de l’Ourthe (Liège), formèrent avec le département de la Roer, le gouvernement général du Bas-Rhin dont le siège était à Aix-la-Chapelle, et que la Prusse espérait pouvoir s’attribuer. Finalement, les Hautes Puissances alliées, sur les instances pressantes de Guillaume d’Orange, se mirent d’accord sur la réunion de la Belgique et de la Hollande, et signèrent un protocole dans ce sens au mois de juin 1814. Le 21 juillet le Prince souverain des Pays-Bas « accepta » la souveraineté des provinces belgiques. Dès ce moment, la fusion des troupes belges et hollandaises devait s’opérer. Mais pour des raisons de haute diplomatie, le secret fut gardé sur le traité. La réunion de la Belgique et des Pays-Bas ne fut connue qu’à la fin du mois de février 1815 ; quant aux frontières du nouveau royaume, elles ne furent arrêtées définitivement que par le traité de Vienne, signé le 31 mars 1815. Tout ceci explique que la mise sur pied d’une force armée en Belgique fut plutôt décousue.
En janvier 1814, l’organisation de l’armée hollandaise fut fixée à 16 bataillons de ligne et 6 bataillons de chasseurs ; chaque bataillon devant être constitué de 10 compagnies, dont deux compagnies d’élite désignées sous le nom de flanqueurs.
Dès la fin de février 1814, le gouverneur militaire de Bruxelles faisait paraître une proclamation pour la formation de régiments belges. Une « légion belge » avait été mise sur pied en mars 1814, elle devait être composée à l’origine de quatre régiments d’infanterie (régiments de Brabant, de Flandre, de Hainaut et de Namur) et d’un régiment de chevau-légers. Cette légion fut placée sous le commandement du comte de Murray, lieutenant général au service de l’empereur d’Autriche, belge de naissance, et dont le nom rappelait celui du régiment wallon de Murray. Plus tard deux bataillons d’infanterie légère et une division d’artillerie complétèrent la légion. Les régiments devaient être de deux bataillons de six compagnies chacun, la compagnie étant de 100 hommes.
Un avenir incertain
(…) Lorsqu’il prit les rênes du gouvernement des mains du baron Vincent, en août 1814, le Prince-souverain des Pays-Bas avait institué une commission pour la direction des affaires militaires Le pays avait été épuisé par les réquisitions militaires de toutes sortes, et la Belgique, du fait de l’incertitude sur son avenir se trouvait gouvernée sans vision d’avenir par un gouverneur autrichien, le baron Vincent, lequel ne faisait rien pour favoriser l’organisation militaire d’un pays qui ne devait pas rester sous la domination de son maître. De ce fait, la légion belge était dans un grand dénuement. Le cadre en officiers était hétérogène, composé d’officiers ayant servi en Autriche ou en France ; quelques officiers étaient hollandais ou nassauviens. Dans ces conditions, l’instruction de la troupe ne pouvait être que médiocre. Le recrutement ne pouvait se faire que sur la base du volontariat, (…).
Soldat d’une compagnie de flanqueurs.
(…) Le 7 août, la légion belge était placée sous les ordres du général anglais sir Thomas Graham. Le 1er septembre, l’infanterie belge fut réorganisée à la hollandaise et se composait de huit bataillons d’infanterie de ligne (portant les numéros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et 9) et de deux bataillons d’infanterie légère portant les numéros 5 et 10. Tous ces bataillons se composaient d’un état-major et de six compagnies, dont deux de flanqueurs, et d’un dépôt. L’effectif de chaque bataillon devait s’élever à 30 officiers et 912 hommes de troupe.
L’organisation du 7e bataillon fut entièrement terminée le 17 septembre. Mais l’habillement et l’armement continuaient à faire défaut. Le général Tindal, inspecteur général des troupes belges, écrivait le 7 novembre au prince-souverain : « L’armée, surtout l’infanterie, n’a que peu de bons officiers… Tous les soldats ne sont pas encore casernes, ce qui est naturellement nuisible à la discipline. (…) L’armement est très mauvais et des bataillons entiers n’en ont point. La comparaison avec l’armée anglaise, abondamment pourvue de tout et n’ayant que des effets des meilleures qualités, est peu propre à porter les jeunes gens à s’enrôler dans l’armée nationale. Cet état de choses me désole. »
Mais petit à petit, grâce à la rentrée d’officiers libérés du service français, les troupes belges améliorèrent leur instruction. On lit dans le « Journal de la Belgique », à la date du 8 mars 1815, dans une lettre écrite à Gand : « Le 7e bataillon belge, dans les rangs duquel on remarque avec plaisir des officiers qui se sont distingués dans les armées française et autrichienne, s’est fait admirer par une précision et une promptitude de mouvements qui feraient honneur aux troupes les plus exercées. «
Scheltens, un des anciens officiers de ce bataillon, qui sortait des grenadiers à pied de la garde, et qui, à ce titre, devait savoir juger les troupes, rend le témoignage suivant : « Notre bataillon était parfaitement composé : tous des officiers célibataires ; (…) Quoique jeunes d’âge, nous étions vieux soldats expérimentés. Il en était de même des sous-officiers et de beaucoup de soldats. Tous les officiers savaient faire des armes, plusieurs étaient de première force, ainsi que les sous-officiers. Les caporaux et presque tous les soldats tiraient également bien. Nous avions plus de 200 maîtres et autant de prévôts au bataillon. «
MOBILISATION
La nouvelle du débarquement effectué par Napoléon le 1er mars 1815 au Golfe Juan arriva à Vienne le 7 mars, et à La Haye le 11 mars. Le 13 mars, les signataires du traité de Paris proclamèrent que Napoléon Bonaparte était l’ennemi de l’Europe, le déclarèrent hors la loi des nations civilisées et s’engagèrent à soutenir Louis XVIII avec toutes les forces dont ils disposaient. Le prince d’Orange pressa le général Tindal afin de mettre le plus rapidement possible les troupes belges en état de faire campagne. L’ordre de mobilisation des troupes belges fut lancé le 24 mars. Des fusils furent envoyés d’Angleterre pour remplacer ceux du modèle français qui équipaient encore en partie certaines unités. Le 21 avril 1815, une dernière réorganisation compléta l’amalgame entre les troupes belges et hollandaises. Tous les corps de ligne devaient être compris, à partir du 1er juin, dans la même série de numéro, sans distinction d’origine. Le 7e bataillon de ligne belge conserva, dans cette réorganisation, son numéro. Il combattit dans les rangs de la première brigade (Bijlandt) de la deuxième division néerlandaise, placée sous les ordres du général Perponcher.
COMPOSITION
Les bataillons d’infanterie néerlandais comprenaient six compagnies, dont deux de flanqueurs, et une compagnie de dépôt. Les compagnies étaient composées de : 1 capitaine ; 1 premier lieutenant ; 1 second lieutenant ; 1 sergent-major ; 4 sergents ; 1 fourrier ; 8 caporaux ; 2 tambours ; 1 fifre et 108 soldats.
HABILLEMENT : Le règlement du 9 janvier 1815 définit la tenue des bataillons de ligne : Habit bleu fermant sur la poitrine au moyen d’un seul rang de 9 boutons, portant le numéro du bataillon, collet parements et passepoils blancs, doublure (retroussis) rouge ponceau. Veste à manche blanche sans distinction, pantalon large gris sur demi-guêtres grises, capote grise, shako portant sur le devant une plaque ornée de la lettre « W » (pour Willem : Guillaume), pompon vert de 43/4 pouces (mesure du Rhin). Bonnet de police de drap bleu, avec distinctive blanche. Les compagnies de flanqueurs se distinguaient par des wings de drap bleu liserés de blanc, et par un pompon vert à sommet blanc. Certains auteurs ont donné aux flanqueurs belges le pompon et le cordon rouge. Les officiers portaient l’habit à pans longs. Sur le shako ils avaient, à la place du pompon, un petit plumet de plumes de coq de la même dimension et couleur que le pompon. Ils portaient, comme signe de service, l’écharpe orange autour de la taille, nouée derrière l’épée. Les officiers supérieurs étaient distingués par deux épaulettes à bouillons, les capitaines par une épaulette à bouillons sur l’épaule droite, les lieutenants par une épaulette à franges sur l’épaule droite. Les adjudants portaient l’épaulette de leur grade sur l’épaule gauche. Les officiers portaient un pantalon collant gris, avec bottes à la Souwarow, mais non échancrées dans le haut, sans galon ni gland. Les sous-officiers avaient des chevrons au-dessus des parements : deux galons d’argent pour le sergent-major, un I chevron d’argent pour le sergent, deux chevrons de poils de chameau blancs pour le caporal ; sergents et caporaux étaient armés du sabre-briquet ; les dragonnes étaient, pour les sergents, de ruban argent à gland orange, et pour les caporaux de ruban blanc à gland orange. Les nids d’hirondelle pour les tambours et cornets étaient blancs à galons et frange blanc. Le tambour-major avait le fond et la frange de couleur argent, les caporaux-cornets portaient le fond et les galons de couleur blanche avec la frange d’or. Les bataillons du Nord et ceux du Sud ne différaient que par la coiffure: shako tronconnique à visière et couvre-nuque pour les premiers, shako du modèle anglais pour les seconds. D’après les journaux, les troupes belges étaient habillées selon le règlement du 9 janvier 1815 dès la fin de ce même mois. Le Journal de la Belgique écrit le 23 janvier : « Le bataillon belge, qui se trouve ici (Bruxelles) en garnison, s’est rendu aujourd’hui à k messe avec le nouvel uniforme. Ceux qui le composent portent le shako forme anglaise, avec un W sur le devant. « Et le 31 janvier : « Le bataillon belge, en garnison dans cette ville, a passé aujourd’hui une grande revue sur la place de l’hôtel de ville. Hors la couleur de l’uniforme, qui est bleu, l’infanterie belgique est habillée à l’anglaise : même coupe d’habit, même shako, pantalon large et demi-guêtres grises. Les officiers sont décorés de l’écharpe orange. » Légende des illustrations: En haut à gauche; sergent, à droite; officier. Au centre; tambour des compagnies du centre. En bas à gauche; sapeur, à droite; fusilier des compagnies du centre.
(p.149) /tableau/ La charge du 2e Carabiniers à Waterloo : les Belges y jouèrent un rôle important lors des combats qui bloquèrent les assauts du maréchal Ney. |
|
Napoleon und seine Zeit, 1769-1821, in: Geo Epoche, 55, 2012
(S.158) /Waterloo/ Der französische Vorstoss scheitert im Hagel der Musketenkugeln. Anstatt « Vive l’Empereur » brüllen Napoléons Soldaten nur noch « Sauve qui peut » – rette sich, wer kann – und fliehen. 25 000 Franzosen und 22 000 Krieger der Koalition bleiben verwundet oder getötet zurück. Es ist acht Uhr abends, und Napoleon ist geschlagen. |
| Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002
(p.406) La question sur laquelle les historiens militaires ont glosé depuis près de deux siècles a été reprise récemment avec subtilité par un historien belge contemporain, Bernard Coppens (dans le n° 10 de la revue La Patience, publiée à Bruxelles) qui a montré que la défaite de l’armée française à Waterloo provient non pas du fait que Grouchy n’avait pas été exact au rendez-vous et avait laissé échapper les Prussiens de Blücher (ce qui était une faute, certes, mais une faute tactique réparable), mais d’une méconnaissance grossière du champ de bataille de la part de Napoléon (ce qui était une faute stratégique impardonnable).
(p.407) Nous allons tenter ici, textes en mains, de montrer que la version traditionnelle de la bataille de Waterloo est une imposture, méticuleusement montée par les historiens traditionnels et compétents de Napoléon III et de la Troisième République, mais qui, motivés par un nationalisme ou un patriotisme (antiprussien, bien entendu) de mauvais aloi, s’étaient donné la tâche sacrée : 1° de réveiller l’enthousiasme patriotique et militaire des Français en exaltant les grandes victoires napoléoniennes, afin d’effacer les conséquences de la guerre avec la Prusse en 1870-71 ; 2° de leur faire oublier Napoléon III, considéré comme l’assassin de la République, et de réveiller leur enthousiasme républicain, en opposant à ce « Napoléon le Petit » un « Napoléon le Grand1 » dont la « grandeur », en fait, est une imposture, comme nous tentons de le montrer dans ce livre. Les historiens scientifiques contemporains, issus de l’École des Annales ont, certes, remis les choses au point, mais les écrivains – parfois talentueux -qui « racontent » l’histoire dans le but de plaire à leur public ont perpétué l’imposture du chef de guerre génial qui a trébuché à Waterloo parce qu’il avait été trahi par les erreurs de ses généraux (Ney et Grouchy en particulier). En fait, c’est lui, Napoléon, qui a commis deux graves erreurs, comme nous Talions voir : l’une de livrer la bataille en sachant pertinemment que l’ennemi avait l’avantage absolu du nombre, l’autre de l’avoir engagée sans avoir pris sérieusement connaissance du champ de bataille.
1 Ce qui est un fabuleux contresens historique, perpétué par tous les manuels d’histoire à destination des écoles, collèges et lycées de la IIIe République.
|
|
Walter Krämer, Götz Trenkler, Das Beste aus dem Lexikon der populären Irrtümer, Piper Verlag, 2002
Waterloo 2
Nur wegen Preussen hat Napoleon die Schlacht bei Waterloo verloren. An einem verregneten Junitag des Jahres 1815 versuchen 70 000 Franzosen mit Gewehren, Bajonetten und Kanonen eine etwa gleich grosse Armee von Engländern, Holländern und Belgiern, auch einigen tausend Deutschen, südlich des Dorfes Waterloo bei Brüssel in die Flucht zu schlagen. Der Versuch misslingt. Im Gegensatz zu manchen Darstellungen in deutschen Geschichtsbüchern waren die Preussen unter Gebhard Leberecht Fürst Blücher an dieser Schlacht nur minimal beteiligt. Zwar stellten sie eine von vier Armeen, welche den von Elba zurückgekehrten Kaiser Napoleon I. in Frankreich angreifen sollten, waren aber zwei Tage zuvor bei Ligny von Napoleon geschlagen worden und kamen erst nach Waterloo, als die Entscheidung schon gefallen war.
Lange vor dem Eintreffen der Preussen, um elf Uhr morgens, greifen die ersten französischen Infanterieregimenter die linke Flanke der Engländer an sie wollen den Herzog von Wellington verleiten, zur Verteidigung seiner Flanke das Zentrum zu schwächen. Der Plan misslingt die Verteidiger behaupten ihre Stellung auch ohne Verstärkung. Darauf berennen die Franzosen mit voller Macht, zu Fuss, zu Pferd und mit Kanonendonner, die alliierten Stellungen in der Mitte, werden aber ein um das andere Mal zurückgeschlagen. Und als dann selbst Napoleons Elitetruppen, die berühmte Garde, keinen Durchbruch schafft, wird das Durchbrechen der englischen Stellungen immer aussichtsloser, die ersten Franzosen beginnen zu fliehen, Napoleon und seine Generale können ihre Männer nicht mehr halten, Panik entsteht, die Franzosen ziehen ab.
Diesen Sieg hatten die Alliierten vor allem der Entschlossenheit ihrer Truppen zu verdanken, vor den anstürmenden, anreitenden, schiessenden, säbelschwingenden französischen Grenadieren und Dragonern nicht Reissaus zu nehmen. Die Preussen unter Blücher kamen erst am späten Nachmittag dazu, als die Franzosen schon entmutigt waren. Der berühmte Ausspruch Wellingtons: »Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preussen kamen «, ist so nie gefallen (allein schon deshalb nicht, weil die Preussen schon ab halb fünf Uhr nachmittags, also bei hellem Tag, am Rand des Schlachtfelds zu sehen waren).
Natürlich haben die Reserven, die Napoleon den Preussen unter Blücher entgegenstellen musste, gegen die Engländer gefehlt, aber diese hatten schon seit Stunden Angriff auf Angriff der Franzosen abgeschlagen, und deshalb ist es nur fair, ihnen auch den Sieg bei Waterloo zu lassen. Mit dieser Schlacht ist das Schicksal Napoleons besiegelt: Die politische Klasse Frankreichs entzieht ihm das Vertrauen, er muss fliehen, findet alle Häfen blockiert und ergibt sich schliesslich dem Kapitän eines englischen Kriegsschiffs, das vor Rochefort im Atlantik patrouilliert. Es folgen fünf Jahre Verbannung auf Sankt Helena, wo er als geschlagene Schachfigur vom Rand des Brettes den Fortgang der Partie betrachtet; dann ist Napoleon endgültig tot.
Lit.: J. Keegan: The face of battle, New York 1976 (besonders das Kapitel über Waterloo).
|
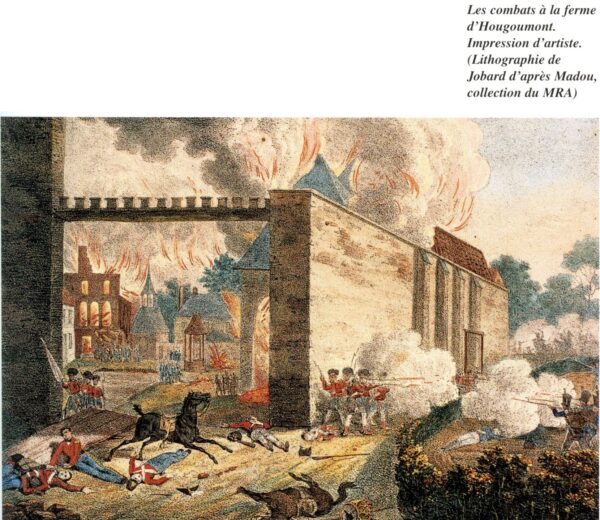
(in: Luc De Vos, op.citat.)
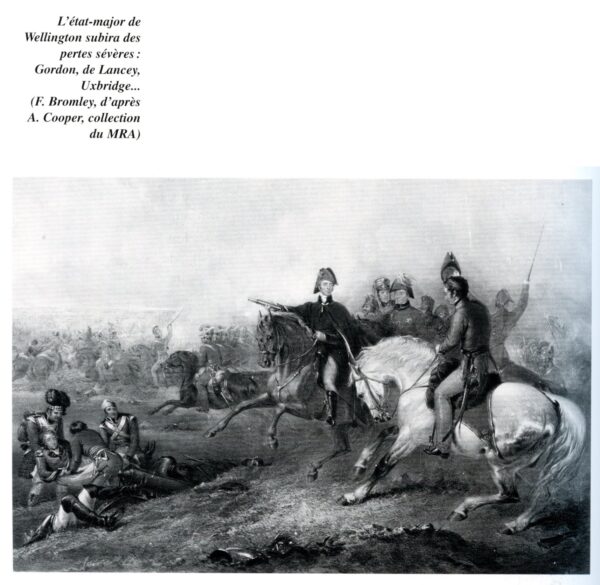

De Belgisch-Nederlandse troepen in de slag bij Waterloo
(Johan Op de Beeck, in: Knack Historia, 2019, p.62-71; 112)


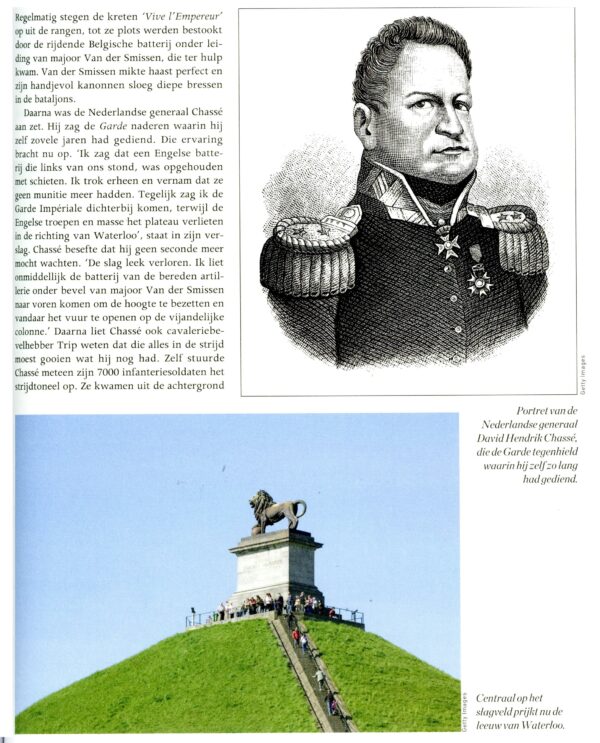






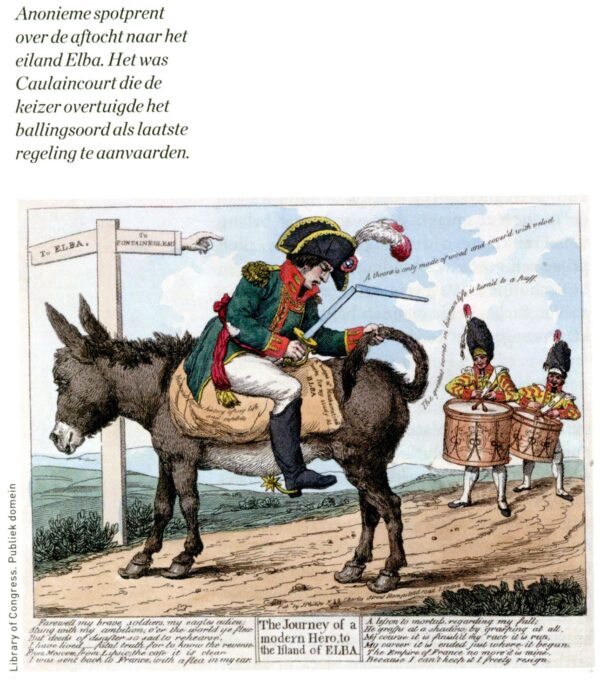
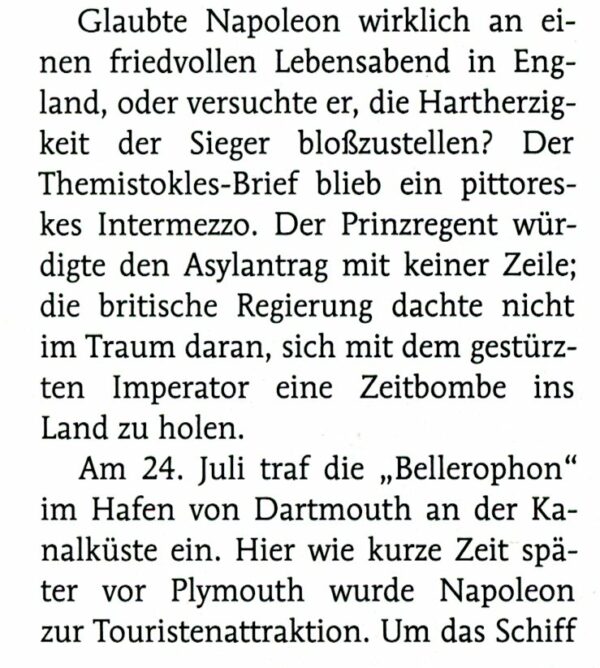
Napoleon, ein Touristenattraktion / Napoléon, une attraction touristique
(in: Damals, in 1815, 07/2019, S.66-67)
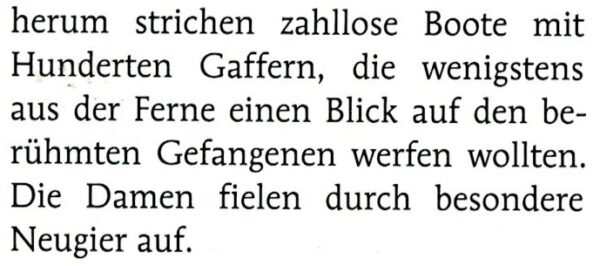
|
Luc De Vos, Les quatre jours de Waterloo, 15-18 juin 1815, éd. Versant Sud, 2002
(p.64) (…) Le peuple se réjouissait de pouvoir assister à la grande cérémonie militaire prévue pour le 21 juin, en souvenir de la bataille de Vittoria, remportée par Wellington contre le maréchal Jourdan en 1813.
|
|
Luc De Vos, Les quatre jours de Waterloo, 15-18 juin 1815, éd. Versant Sud, 2002
(p.131) La phrase célèbre « La Garde meurt, mais ne se rend pas !» n’a jamais été prononcée par Cambronne. C’est une invention d’un journaliste nommé Rougemont qui écrivit cela dans le Journal général de la France, du 24 juin 1815. Le romantisme qui suivit la période napoléonienne a colporté le mot qui a survécu jusqu’à nos jours. Mais, comme c’est souvent le cas, ce genre de propos traduit bien l’état d’esprit qui règne dans un corps d’élite à un moment crucial. Diverses contre-attaques menées par quelques escadrons de la garde personnelle de Napoléon n’apportèrent aucun soulagement. Partout résonnaient les cris «trahison» et «sauve qui peut». Les mensonges concernant l’arrivée de Grouchy se retournaient à présent contre l’Empereur. Le faux espoir dégénéra en désespoir. Il n’était plus possible d’arrêter dans leur fuite les débris des corps d’armée de Drouet d’Erlon et de Reille. Seule une brigade de la division Durutte put se retirer en combattant en bon ordre sous la direction de Ney.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris.
(p.140) Le cortège comprend quinze voitures . Bonaparte est dans une « dormeuse » , berline de luxe, avec un lit. Il n’est pas de mauvaise humeur, car il emporte plusieurs millions; et Hortense lui a remis, discrètement, une écharpe où elle a cousu tout un petit stock de diamants; il s’en est fait une ceinture qu’il dissimule sous sa redingote. Une incommodité, néanmoins: un nouvel accident vénérien, suite d’un divertissement- mal – choisi, ces jours-ci, à Fontainebleau.
(p.144) Une guerre de quatre jours, 15-18 juin 1815, et c’est la déroute. Napoléon s’enfuit à cheval, sans même pouvoir sauver cette berline qui l’avait amené à Waterloo et dans laquelle il avait caché, à toutes fins utiles, des sacs d’or et pour 800 000 F de diamants. Il aura le temps, néanmoins, avant de quitter son palais, de se faire remettre 180 actions de 10 000 francs sur les canaux d’Orléans et du Loing, et de placer, chez Laffitte, 5 300 000 francs… A Rochefort, le 14 juillet, il rédige cette lettre fameuse où il remet son sort à la générosité d’un peuple sur lequel il a déversé, pendant quinze ans ou presque, des torrents d’insultes : « Je viens, comme Thémistocle, m’asseoir au foyer du peuple britannique » (il a écrit : « sur le foyer ), mais l’Histoire convenable rectifie d’elle-même et sa référence à Thémistocle, est malheureuse, car l’ Athénien avait intrigué avec les Perses contre son propre pays et (p.145) il se réfugiait auprès de ceux qui l’avaient eu pour complice, mais les connaissances de Napoléon Bonaparte, en tous domaines, ont toujours été sommaires). Vinrent les années de Sainte-Hélène où, sous les travestissements de la légende, les humeurs réelles, la conduite réelle et les vrais propos du Sire en chômage, sont, dit très bien Audiberti, “à faire pitié ». L’ Angleterre avait rendu un service immense à son prestige en lui fournissant un cadre d’exil propre à frapper les imaginations: cette ile, tout là-bas, de l’autre côté de la terre, et lui, sans doute, en redingote grise et petit chapeau, qui regarde avec une longue-vue, en direction de cette France que lui cache la courbure du globe; c’est l’aigle enchaîné qui bat des ailes, désespérément, à la pointe d’un roc, ou l’oiseau formidable, immobile, (p.146) qui attend la mort dans un silence pathétique, plein de souvenirs et de rêves. La réalité n’a rien à voir avec cette fiction. (p.147) L’homme y apparaît dans sa médiocrité navrante; non pas, seulement une âme basse, et à ras de terre, mais qui dégage une odeur putride. Incapable d’élan, étranger à toute idée haute – la nature, les fleurs, la mer, le ciel, ne l’intéressent pas ; il ne les voit point -, haussant les épaules devant ce qui fait (p.148) la noblesse humaine, il est totalement replié sur soi et remâche du matin au soir les épisodes de sa carrière, supputant ce qu’il eût dû faire pour que « ça durât » plus longtemps. Il avait dit, déjà, devant Bourrienne : « Je n’aime personne », et, devant Roederer, le 12 novembre 1813 : « Je suis l’homme du calcul sec » ; écoutez-le maintenant :« Je suis aussi indépendant qu’un homme puisse l’être » ( 19 novembre 1817); nul être au monde qui lui soit cher; à Bertrand, peu de jours avant sa mort (26 avril 1821) : « Je ne connais ni femme, ni enfant ; il faut qu’on me soit attaché », c’est tout ; et il précisait: – Tenez, Montholon, je sais très bien qu’il n’est ici qu’en vue d’une dotation testamentaire; mais quand on veut une part dans le testament de quelqu’un, on le sert, on lui obéit, on rampe; je nen demande pas davantage. Et à Gourgaud : « Je n’apprécie les gens que dans 1a mesure où ils me sont utiles, et pendant qu’ils 1e sont ».
(p.150) Son testament du 15 avril sera son dernier numéro d’histrion: « … Que mon fils adopte ma devise : Tout pour le peuple français ! [ sic] ». Et ceci : « Je désire que mes cendres reposent au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé » – comme il le lui avait prouvé sans cesse. Des particuliers qui n’ont pas à se plaindre, ce sont les membres de la tribu née de Carlo et de Letizia. La France a vu sa jeunesse fauchée, et les cadavres de ses enfants en pyramides monstrueuses: elle est amputée maintenant de la Sarre et de la Savoie; elle a 700 000 millions d’indemnité à verser aux envahisseurs qui l’occuperont pendant trois ans. Mais « Nabou » a tout de même joliment bien réussi pour son clan. La Mamma a un palais à Rome, et tous et toutes sont grassement pourvus. La France a payé très cher leur raid, chez elle, de vingt ans et leur pluie de sauterelles, mais quand ils évoquent leur taudis d’autrefois, rue de la Mauvaise Herbe, à Ajaccio, ils ont de quoi jubiler et se frotter les mains. Ils sont « les Bonaparte », une «grande famille », une très grande famille désonnais. Beaucoup d’esprits droits, à leur insu conditionnés, en sont encore à redire ce que professait M. Gabriel Hanotaux (les successeurs ne lui ont pas manqué) quant aux mérites de « l’empereur » , à la reconnaissance que lui doivent les Français :« On n’avait jamais vu, on ne verra sans doute jamais, de la main d’un seul homme, et en un temps si court, pareille accumulation de bienfaits. » Vous pensez! Le Code civil, les préfets, le Concordat, l’Université, la Madeleine, la colonne Vendôme, les « prisons d’Etat » , et tout le reste… Voyons les choses en face, et telles qu’elles furent dans leur (p.152) vérité, telles qu’elles demeurent encore. L’immense mérite de Bonaparte c’est celui que lui reconnaissaient très justement, Necker le banquier et sa fille; il avait fermé, une bonne fois, l’épouvantable parenthèse ouverte par le 10 août, quand – écrira Mme de Staël – «la révolution changea d’objet », quand « les gens de la classe ouvrière s’imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allair cesser de peser sur eux » (1). Il avait ramené la canaille au chenil et même, coup d’éclat, en lui inspirant, sous l’uniforme – un « bienfait » sans nom, ce déguisement perpétuel des prolétaires en soldats! – de l’enthousiasme, de la passion (2). Quel repos pour les gens de bien! Ce qui se traduit, dans la langue de M. Madelin, par cette haute phrase: « Le destin amena Bonaparre à son heure pour refaire la France » (3). « J’ai rétabli la propriété et la religion », prononce Bonaparte, résumant son oeuvre, à Sainte-Hélène, le 13 août 1817. La voilà, en effet, la formule-clé; c’est à ce grand acte qu’il doit une gratitude adorante.
(1) Quand, dira Chateaubriand, pour sa part, « les sabots frappaient à la porte des gens à souliers”. (2) Nous touchons là à ce côté sinistre de la nature humaine dont Victor Hugo a parlé dans des mots, trop peu connus, sur “la chair à canon amoureuse du canonnier”. (3) Refaire ? Je m’aperçois que le terme peut être pris, familièrement, dans un sens quj conviendrait ici très bien.
(p.152) Mollien avait articulé, lui aussi, l’exacte sentence: “Il a renversé le gouvernement populaire”; “il a assis (p.153) la bourgeoisie au pouvoir ». M. Bainville était encore plus explicite : « Il a fait cesser la lutte des classes « . D’où l’adjectif, sous sa plume : « bénie », oui, bénie, la superbe époque consulaire. Des guerres, sans doute, à l’extérieur; mais le bienfait suprême de la paix sociale; la tranquillité pour les « honnêtes gens ». Louis-Philippe savait ce qu’il faisait lorsqu’il organisait, en grande pompe (1840) le « retour des cendres « , dans le temps même où il ceinturait Paris de ces forts dont les canons, dans sa pensée comme dans celle de M. Thiers, serviraient, le cas échéant, à la « dissuasion » de la plèbe.
Quant aux menus détails que j’ai jugé bon de rapporter sur M. Bonaparte lui-même, sa personne et son « âme », si ce n’est pas très beau, ce n’est pas à moi qu’il faut s’en prendre ; « c’est la vérité qui est coupable », disait déjà Robespierre. Mais quand elle déplaît à certains, elle perd pour eux le droit d’exister.
|
Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont(p.451) 3 février 1814, trois heures de l’après-midi. Napoléon entre dans Troyes. Portes et volets sont fermés, la ville est glacée d’épouvante : la nouvelle s’est répandue que l’Empereur venait d’être battu sur le sol de France, c’est la fin. Les troupes exténuées défilent dans les rues désertes. Des soldats s’arrêtent devant les maisons barricadées, ils frappent aux portes en demandant du pain. Rien. Les habitants veulent garder leurs provisions pour satisfaire aux exigences des Russes, Prussiens et Autrichiens, pour n’être pas molestés quand ces ennemis arriveront. Des gens ont l’audace d’ouvrir leur fenêtre pour crier cela tout crûment aux soldats. Alors la colère éclate, les portes sont défoncées, les habitants roués de coups, les boutiques pillées.
(p.473) A la hauteur des faubourgs Saint-Martin et Saint-Denis, dans l’assistance, rien que des visages graves, tristes, un silence plutôt hostile. Une foule plus dense bordait plus loin le boulevard. Les soldats alliés défilaient en bon ordre, ils avaient un air de santé, leurs chevaux étaient luisants. Une puissante odeur de crottin flottait. L’enthousiasme fut déclenché au niveau de la rue Poissonnière par deux ou trois cris de: «Vive Alexandre ! Vivent les Alliés! » Le superbe souverain russe ralentit son cheval. – Nous vous apportons la paix! cria-t-il d’une voix forte.
Il ajouta d’autres paroles que les acclamations couvrirent. Des gens se jetaient vers son cheval, d’autres s’agenouillaient ! Un délire se déchaîna lorsque les musiques russes se mirent à jouer des airs français. Les pseudo-vainqueurs de Napoléon étaient acclamés autant et plus que l’avait jamais été l’Empereur des Français dans sa capitale. En fait, c’était la paix qu’on acclamait. L’exaltation atteignit son sommet avenue des Champs-Elysées. Des hommes et des femmes embrassaient les bottes du tzar, son cheval. Pour mieux voir le spectacle, des femmes sautaient en croupe des cavaliers de l’état-major. Alexandre se retourna en riant : – Pourvu qu’on n’enlève pas ces Sabines!
Après ce défilé, des dizaines de milliers de Parisiens défilèrent eux-mêmes pour aller voir les troupes alliées campées sur les Champs-Elysées, à Neuilly et avenue de la Motte-Picquet. Drapeaux au vent, sonneries de trompettes, cuisines des troupiers, tout était spectacle pittoresque. Sur les Champs-Elysées, le bivouac des Anglais, Irlandais et Ecossais plaisait beaucoup, avec ses uniformes rouges, ses jupes à carreaux, les joueurs de cornemuse. Mais la plus grande curiosité allait aux campements d’en face, ceux des cosaques. Leurs huttes étaient faites de bottes de paille maintenues par des lances fichées en terre. Barbus, hirsutes, yeux bridés, sans gêne ils s’épouillaient, jouaient aux cartes, faisaient leur tambouille. Cordiaux si on s’adressait à eux (par gestes) point hostiles aux échanges : contre du tabac français, ils donnaient un gobelet d’émail russe; ou une chaîne de montre d’origine inconnue. Plusieurs de ces fils des steppes commirent une faute de tact en ouvrant au Pont-Neuf une sorte de marché où ils vendaient divers objets pillés par eux dans la région parisienne. Des spoliés le surent, arrivèrent, voulurent reprendre leur bien, il y eut là quelques bagarres. Point d’idylle sans jamais un nuage.
De tout événement naît un commerce. Moins de quarante-huit heures après l’entrée des Alliés à Paris, partout des marchands en boutique ou ambulants vendent des brochures. des chansons injurieuses pour Napoléon. On le compare à Robespierre, à Attila; il est un ogre, un assassin.
|
|
Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005
(p.140) Une guerre de quatre jours, 15-18 juin 1815, et c’est la déroute. Napoléon s’enfuit à cheval, sans même pouvoir sauver cette berline qui l’avait amené à Waterloo et dans laquelle il avait caché, à toutes fins utiles, des sacs d’or et pour 800 000 F de diamants. Il aura le temps, néanmoins, avant de quitter son palais, de se faire remettre 180 actions de 10 000 francs sur les canaux d’Orléans et du Loing, et de placer, chez Laffitte, 5 300 000 francs. A Rochefort, le 14 juillet, il rédige cette lettre fameuse où il remet son sort à la générosité d’un peuple sur lequel il a déversé, pendant quinze ans ou presque, des torrents d’insultes : « Je viens, comme Thémistocle, m’asseoir au foyer du peuple britannique » (il a écrit : « sur le foyer », mais l’Histoire convenable rectifie d’elle-même et sa référence à Thémistocle, est malheureuse, car l’Athénien avait intrigué avec les Perses contre son propre pays et il se réfugiait auprès (p.141) de ceux qui l’avaient eu pour complice, mais les connaissances de Napoléon Bonaparte, en tous domaines, ont toujours été sommaires).
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.231) When talking about Napoleon’s first abdication in 1814, Bonapartist historians often fail to mention that he only just made it alive to the south coast of France because of the hostility of his own people. Even Walter Scott’s account of French people ‘insulting his passage’ doesn’t paint the full picture. As Napoleon’s convoy of carriages passed through Orgon, in Provence, there was a minor riot, and he had to disguise himself as a messenger to save his skin. He also insisted on taking a British warship across to Elba, because the French navy was under the command of his rival, the treacherous Talleyrand, and Napoleon suspected that he might ‘fall overboard’ during the Crossing. The French sailors designated to escort the Emperor were sent away at the last minute, and Napoleon entrusted himself to the hated – but apparently more honourable – British (…).
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.232) By 1815, almost everyone in France except Napoleon was exhausted by his war effort. Since the Revolution, about 1.4 million Frenchmen had died in battle. In total, around 30 per cent of French males born between 1790 and 1795 were killed or wounded in uniform.
|
|
Stephen Clarke, How the French won Waterloo (or think they did), 2015
(p.140) A man of the same age as Napoleon (he was born two weeks before his famous prisoner), Sir Hudson Lowe was an old soldier whose path had very nearly crossed that of his French captive several times during the Napoleonic Wars. Lowe had been sent to Toulon just before it was liberated by the young Napoleon in 1793. He had then been posted on the island of Corsica (when it was briefly under British control) and even billeted at (p.141) the Buonaparte family home. Later on, he had commanded a force of pro-British Corsican exiles in the Mediterranean, a fact that irritated Napoleon considerably – he called them ‘vagabond Corsican deserters’. And after serving during the 1814 campaign to oust Napoleon from power, Lowe had been chosen to take the glad tidings of his abdication to London. In French eyes, Lowe was therefore just about the most troublesome anti-Bonaparte campaigner the British government could have chosen.
|

