
Le génocide franco-français : Vendée / Vengé : armes chimiques, fours crématoires, graisse humaine, peaux humaines tannées, …
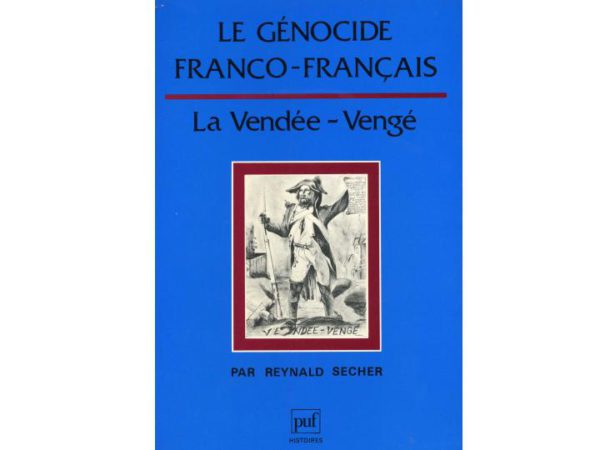
à lire:
Le génocide franco-français
La Vendée – Vengé*
par Reynald Secher
Armes chimiques, fours crématoires, graisse humaine, peaux humaines tannées, …
extraits de cette étude historique sur les atrocités commises par l’armée révolutionnaire française en Vendée:
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
(Art. 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et préambule de la Constitution du 24 juin 1793.)
(p.146-147) » Un délire de sang et de sadisme s’empare des soldats : ils se réservent comme butin de guerre les femmes les plus distinguées et les religieuses. Ils dépouillent les cadavres de leurs vêtements, et les alignent sur le dos… ils appellent cette opération . « mettre en batterie… ». « Ils vont, raconte de Béjarry, jusqu’à introduire dans le corps des victimes des cartouches auxquelles ils mettent le feu » (…). « Des prisonniers, dit l’abbé Deniau, vieillards, femmes, enfants, prêtres sont traînés vers Ponthière pour y être fusillés. Un prêtre vieux et infirme ne pouvant suivre, un soldat le transperce avec sa baïonnette et dit à l’un de ses camarades : ‘prends-en le bout’. Ils le portent jusqu’à ce que le malheureux ait rendu le dernier soupir. » Un charroyeur de cadavres, raconte un témoin, embrochait les victimes avec une fourche et les entassait dans sa charrette. Les Bleus sabrent sans répit : « J’ai vu (des cadavres), écrit le représentant Benaben, sur le bord du chemin, une centaine qui étaient nus et entassés les uns sur les autres, à peu près comme des porcs qu’on aurait voulu saler… »
Vingt-sept Vendéennes, avec leurs enfants, ramenées de Bonnétable en charrette, sont tuées, place des Jacobins, par les tricoteuses. « Voilà la plus belle journée que nous ayons eue depuis dix mois « , s’exclame Prieux.
(p.152) Un citoyen au représentant du peuple Minier explique qu’on a eu recours à des moyens plus radicaux et plus efficaces que la guillotine:
» Mon ami, je t’annonce avec plaisir que les brigands sont bien détruits. Le nombre qu’ on en amène ici depuis huit jours est incalculable. Il en arrive à tout moment. Comme en les fusillant c’est trop long et qu’on use de la poudre et des balles, on a pris le parti d’en mettre un certain nombre dans de grands bateaux, de les conduire au milieu de la rivière, à une demi-lieue de la ville et là on coule le bateau à fond. Cette opération se fait journellement. »
La procédure est simple : on entasse la cargaison humaine dans une vieille galiote aménagée de sorte de sabords; une fois au large, on les fait voler en éclats à coups de hache : l’eau gicle de toutes parts et en quelques instants tous les prisonniers sont noyés. Ceux qui en réchappent sont immédiatement sabrés (d’ où le mot de « sabrades » inventé par Grandmaison) par les bourreaux qui de leurs barques légères assistent au spectacle.
Témoin au procès de Carrier, Guillaume-François Lahennec dépose ainsi :
» D’abord les noyades se faisaient de nuit mais le comité révolutionnaire ne tarda pas à se familiariser avec le crime. Il n’en devint que plus cruel et dès ce moment, les noyades se firent en plein jour… D’abord les individus étaient noyés avec leurs vêtements; mais ensuite le comité, conduit par la cupidité autant que par le raffinement de la cruauté, dépouillait de leurs vêtements ceux qu’il voulait immoler aux différentes passions qui l’animaient. Il faut aussi vous parler du « mariage républicain » qui consistait à attacher, tout nus, sous les aisselles, un jeune homme à une jeune femme, et à les précipiter ainsi dans les eaux » (…).
La femme Pichot, vingt-cinquième témoin, demeurant à la Sècherie de Nantes, c’est-à-dire juste en face de l’ endroit où l’ on noie, déclare qu’ elle a vu, du 18 au 2 brumaire, des charpentiers faire des trous à une sapine ou gabare : le lendemain elle apprend qu’on avait noyé « grand nombre de femmes dont plusieurs portaient des enfants sur leurs bras » et qu’un autre jour on trouva 60 prisonniers morts étouffés dans une galiote : on les avait « oubliés » pendant quarante-huit heures.
Carrier se vante devant l’inspecteur de l’armée, Martin Naudelle « d’y avoir fait passer deux mille huit cents brigands » dans ce qu’il appelle « la déportation verticale dans la baignoire nationale », » le grand verre des calotins » ou » le baptême patriotique ».
(p.153) En fait, ce sont 4 800 personnes recensées que la Loire, « ce torrent révolutionnaire » , engloutit au cours du seul automne 1793.
Goullin, le lieutenant de Carrier au terme du procès contre le proconsul, déclare cyniquement:
« Il faut apprendre de ce tribunal qu’à cette époque les prisons étaient remplies de brigands et que le dessein d’immoler tous les détenus était suffisamment justifié par les circonstances puisqu’ on ne parlait que de conspirations. Je soutiens que ces mesures, tout extrêmes qu’elles paraissent, étaient inévitables. Parisiens . si vous avez jugé nécessaire la journée du 2 septembre, notre position était encore plus délicate que la vôtre; ces noyades, toutes révoltantes qu’elles vous semblent, n’étaient pas moins indispensables que le massacre auquel vous vous êtes livrés. «
(p.155) 2. La seconde répression organisée par la force légale. – Les passions sont tellement surexcitées pendant cette année 1793 qu’ on songe à recourir aux armes chimiques, Un pharmacien d’ Angers, Proust, invente une boule contenant d’ après lui « un levain propre à rendre mortel l’air de toute une contrée. On pourrait l’employer pour détruire la V endée par infection; mais des essais tentés sur des moutons sont sans résultat. Carrier propose alors le poison sous forme d’ arsenic dans les puits. Westermann a une idée semblable mais plus perfide : il sollicite l’envoi de « six livres d’arsenic et d’une voiture d’ eau-de-vie » qu’ on aurait laissée prendre aux Vendéens. On ignore pourquoi ce projet n’est pas retenu. Sans doute, comme le précise Simone Loidreau, on n’ était pas sûr de la discipline et de la sobriété des troupes républicaines et on craignait qu’ elles ne boivent en cachette… Santerre réclame du ministre de la Guerre, le 22 août 1793, « des mines !… des mines à force ! des fumées soporatives et empoisonnées !… « . A sa suite, Rossignol demande au Comité de Salut public de bien vouloir envoyer en Vendée le chimiste Fourcroy pour étudier les solutions possibles comme l’explique Santerre :
« Par les mines, des fumigations Ou autres moyens, on pourrait détruire, endormir, asphyxier l’armée ennemie. «
Les idées fusent. Certaines semblent avoir même trouvé un commencement d’ exécution, témoin cette lettre de Savin à Charette, du 25 mai 1793 :
« Nous fûmes vraiment étonnés de la quantité d’arsenic que nous trouvâmes à Palluau, au commencement de la guerre. On nous a même constamment assuré qu’un étranger, qu’ils avaient avec eux et qui fut tué à cette affaire, était chargé d’assurer le projet d’empoisonnement… »
Pour arriver à leurs fins, les républicains décident alors d’avoir recours aux colonnes infernales, à la flottille dont l’action est presque inconnue, voire insoupçonnée et aux commissaires civils.
(p.156) Le but est de faire de la Vendée un « cimetière de la France », « de transformer ce pays en désert, après en avoir soutiré tout ce qu’il renferme ,, (…). L’idée est déjà énoncée partiellement dès le 4 avril 1793 :
» La guerre que nous avons à soutenir, déclarent les généraux à la Convention, est d’autant plus désastreuse que les positions occupées par les brigands sont de nature à faire périr beaucoup de monde, si l’on ne prend des moyens extraordinaires. Un seul nous a paru propre à épargner le sang des pères de famille qui ont abandonné leurs foyers pour le soutien de la cause de la liberté : l’incendie des bois dans lesquels, après être poursuivis, les brigands se seront retirés; la démolition de tous les moulins établis sur le territoire occupé, et qu’on aura parcouru sans pouvoir le conserver, nous a également paru une voie assurée de les réduire… «
(p.163) Les officiers subalternes, souvent écoeurés, témoignent eux aussi :
« Amey, écrit l’officier de police Gannet dans un rapport, fait allumer les fours et lorsqu’ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations; il nous a répondu que c’était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D’abord on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes, et nous n’avons trop rien dit; mais aujourd’hui les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et Turreau qu’ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des royalistes manquant, ils s’adressent aux épouses des vrais patriotes. Déjà, à notre connaissance, vingt-trois ont subi cet horrible supplice et elles n’étaient coupables que d’adorer la nation (…) Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont menacés du même sort » (…).
Le président du district le 25 janvier s’en étonne :
« Tes soldats se disant républicains se livrent à la débauche, à la dilapidation et à toutes les horreurs dont les cannibales ne sont pas même susceptibles… »
(p.164) Le capitaine Dupuy, du bataillon de la Liberté, adresse à sa soeur, les 17 et 26 nivôse (janvier 1794) deux lettres tout aussi explicites :
» Nos soldats parcourent par des chemins épouvantables les tristes déserts de la Vendée… Partout où nous passons, nous portons la flamme et la mort. L’âge, le sexe, rien n’est respecté. Hier, un de nos détachements brûla un village. Un volontaire tua de sa main trois femmes. C’est atroce mais le salut de la République l’exige impérieusement (…) Quelle guerre !
Nous n’avons pas vu un seul individu sans le fusiller. Partout la terre est jonchée de cadavres; partout les flammes ont porté leur ravage » (…).
« Les délits ne se sont pas bornés au pillage, ajoute Lequenio. Le viol et la barbarie la plus outrée se sont représentés dans tous les coins. On a vu des militaires républicains violer des femmes rebelles sur des pierres amoncelées le long des grandes routes et les fusiller et les poignarder en sortant de leurs bras; on en a vu d’autres porter des enfants à la mamelle au bout de la baïonnette ou de la pique qui avait percé du même coup la mère et l’enfant » (…).
« J’ai vu brûler vifs des femmes et des hommes, écrit le chirurgien Thomas. J’ai vu cent cinquante soldats maltraiter et violer des femmes, des filles de quatorze et quinze ans, les massacrer ensuite et jeter de baïonnette en baïonnette de tendres enfants restés à côté de leurs mères étendues sur le carreau… »
Beaudesson, régisseur général des subsistances militaires, qui a suivi de Doué à Cholet la division Bonnaire fait la déclaration suivante :
« La route de Vihiers à Cholet était jonchée de cadavres, les uns morts depuis trois ou quatre jours et les autres venant d’expirer. Partout, les champs voisins du grand chemin étaient couverts de victimes égorgées… Çà et là des maisons éparses à moitié brûlées (…). »
Le général Avri1, en ventôse an II, se réjouit d’avoir « couché les insurgés de Saint-Lyphard par terre au nombre de cent. Il en a été grillé une quantité dans le brûlis de toutes les maisons du bourg » (…).
En fait, l’action des colonnes infernales dure quatre mois, du 21 janvier environ au 15 mai 1794. Seule la première « promenade » a un plan précis. Turreau ne rencontre que deux problèmes mineurs : le général Duval, que la blessure reçue à la bataille du Moulin-aux-Chèvres rend incapable de marcher, doit mettre sa division sous le commandement du chef de bataillon Prévignaud; à Saint-Florent, le général Moulin, pourtant « aussi bon patriote que ses collègues », ne peut lever qu’une faible colonne de 650 hommes : la plupart des soldats avaient déjà été envoyés en Basse-Vendée.
(p.165) Aussi le 2 février, chaque colonne a gagné l’ objectif fixé après avoir exécuté le programme a la lettre. Il est a remarquer, poursuit Simone Loidreau, des degrés divers dans la cruauté, le sadisme et le sacrilège. On peut dire que les colonnes deux et cinq se signalèrent particulièrement alors que Prévignaud, commandant temporaire de la première, et surtout Bonnaire, général de la quatrième, quoique grands incendiaires, semblent avoir beaucoup moins tué.
(p.166) Le même jour, à La Pommeraie, il « brûle et casse la tête à l’ordinaire ». Le 27, il pénètre à La Flocellière. Chapelain, maire et capitaine de la garde nationale, veut intercéder auprès de lui pour la conservation de son « malheureux bourg ». Grignon menace de le faire fusiller et ordonne un égorgement général de la population. Il n’hésite pas à tuer même les républicains : « Je sais qu’il y a des patriotes dans ce pays, note-t-il, c’est égal, nous devons tout sacrifier. » Un patriote et sa servante sont ainsi coupés en morceaux. « Quand tout fut sacrifié à Flocellière », selon le maire Chapelain, Grignon veut aller à Pouzauges :
« En vain, l’ex-constituant Dillon, curé du Vieux Pouzauges, essaie de plaider la cause de ses concitoyens; en vain. Grignon y met le feu. Pendant ce temps, suivi de son état-major, il monte au château et fait fusiller cinquante et quelques personnes qui y étaient enfermées. »
(p.170) Pour qu’aucun Vendéen ne puisse échapper, Turreau donne ordre aux gardes nationaux des postes frontières renforcés, « de surveiller de jour et d’éclairer de nuit tous les passages pour arrêter quiconque se présenterait ». Il décide aussi de confier à Moulin le commandement de la division qu’il laisse à Cholet. Quant aux autres colonnes, Turreau n’en reforme que huit qui doivent toujours « marcher à la même hauteur » de façon à pouvoir se prêter main-forte. D’après Robert, général divisionnaire, le 2 avril 1794, l’armée comprend 103 812 soldats, soit 95 73 5 hommes d’infanterie, 4 108 cavaliers, 3 809 canonniers et 160 artilleurs.
Cette troupe se répartit en trois noyaux : la force de l’armée des côtes de Brest, la force de l’armée des côtes de Cherbourg et celle de l’Ouest, plus faible que les deux autres.
La répression est toujours aussi sanglante, comme l’écrit Turreau à Huché, le 1er mars261 :
» Courage, mon camarade et bientôt les environs de Cholet seront nettoyés de rebelles. Si chaque officier général ou supérieur les tuait comme toi par centaines, on en aurait bientôt trouvé la fin. »
(p.172) Horribles sont les descriptions que Peigné et l’abbé font de la tuerie :
» Là c’étaient de pauvres jeunes filles toutes nues suspendues à des branches d’arbres, les mains attachées derrière le dos, après avoir été violées, Heureux encore quand, en l’absence des Bleus, quelques passants charitables venaient les délivrer de ce honteux supplice. Ici, par un raffinement de barbarie, peut-être sans exemple, des femmes enceintes étaient étendues et écrasées sous des pressoirs. Une pauvre femme, qui se trouvait dans ce cas, fut ouverte vivante au Bois-Chapelet, près Le Maillon. Le nommé Jean Lainé, de La Croix-de-Beauchêne, fut brûlé vif dans son lit où il était retenu pour cause de maladie. La femme Sanson, du pé-Bardou, eut le même sort, après avoir été à moitié massacrée. Des membres sanglants et des enfants à la mamelle étaient portés en triomphe au bout des baïonnettes.
» Une jeune fille de La Chapelle fut prise par des bourreaux, qui après l’avoir violée la suspendirent à un chêne, les pieds en haut. Chaque jambe était attachée séparément à une branche de l’arbre et écartée le plus loin possible l’une de l’autre. C’est dans cette position qu’ils lui fendirent le corps avec leur sabre jusqu’à la tête et la séparèrent en deux. «
Au château de La Vrillère, les Bleus se saisissent de deux jeunes filles et tentent de les emmener prisonnières. L’une d’elles se cramponne au fauteuil de sa mère impotente. Un soldat, furieux de ne pouvoir lui faire lâcher prise, dégaine son sabre et lui tranche la main. Dans d’autres cas, des femmes sont jetées par les fenêtres sur des baïonnettes pointées dans leur direction.
Il y eut encore beaucoup d’autres atrocités ce 17 mars que Peigné appelle la journée » du grand massacre ».
(p.173) « Au village de La Trônière, raconte-t-il, on voit encore aujourd’hui une petite rue où les cadavres étaient entassés et d’où coulait un ruisseau de sang jusqu’au Guineau. A La Pironnière, et en plusieurs autres lieux, des enfants, au berceau, furent transpercés et portés palpitants au bout des baïonnettes (…). A La Grange, commune du Loroux-Bottereau, on
sauva la vie d’un enfant qu’on arracha au sein de sa mère, qui avait été égorgée et sur lequel ses lèvres déjà livides étaient encore collées » (…).
(p.174) Les témoignages des atrocités commises sont nombreux : à Clisson, des cadavres mutilés et des personnes encore en vie sont jetés dans un puits du château; 41 personnes sont noyées à Bourgneuf-en-Retz. A Angers, on tanne la peau des victimes, afin de faire des culottes de cheval destinées aux officiers supérieurs : « Le nommé Pecquel, chirurgien-major du 4e Bataillon des Ardennes, explique un témoin, Claude-Jean Humeau, dans une déclaration au tribunal d’ Angers en date du 6 novembre 1794, en a écorchés trente-deux. Il voulut contraindre Alexis Lemonier, chamoiseur aux Ponts-de-Cé, de les tanner. Les peaux furent transportées chez un nommé Langlais, tanneur où un soldat les a travaillées. Ces peaux sont chez Prud’homme, manchonnier… » Un autre témoin, le berger Robin, raconte que les cadavres « étaient écorchés à mi-corps parce qu’on coupait la peau au-dessous de la ceinture, puis le long de chacune des cuisses jusqu’à la cheville des pieds de manière qu’après son enlèvement le pantalon se trouvait en partie formé; il ne restait plus qu’à tanner et à coudre…». Un soldat avouera à la comtesse de La Bouère avoir fait la même opération à Nantes et avoir vendu 12 peaux à La Flèche.
(p.175) En cela, ces hommes ne faisaient que suivre Saint-Just qui, dans un rapport, en date du 14 août 1793, à la Commission des Moyens extraordinaires déclare : « On tanne à Meudon la peau humaine. La peau qui provient d’hommes est d’une consistance et d’une bonté supérieures à celle des chamois. Celle des sujets féminins est plus souple, mais elle présente moins de solidité… .»
A Clisson encore, le 5 avril 1794, des soldats du général Crouzat brûlent 150 femmes pour en extraire de la graisse : « Nous faisions des trous de terre, témoigne l’un d’eux, pour placer des chaudières afin de recevoir ce qui tombait; nous avions mis des barres de fer dessus et placé les femmes dessus, (…) puis au-dessus encore était le feu (…). Deux de mes camarades étaient avec moi pour cette affaire.
J’en envoyai 10 barils à Nantes. C’était comme de la graisse de momie : elle servait pour les hôpitaux « .
Les Sociétés populaires, les Directoires et le Conseil des villes ne sont pas en reste comme à Angers qui prend une délibération « propre à frapper l’imagination populaire » : « Du 16 frimaire de l’an II de la République française, une et indivisible, les officiers de santé, d’ après la réquisition des représentants du peuple, ont été invités à se rendre à la Maison commune pour les faire participer à l’arrêté desdits représentants portant que les têtes de tous les brigands morts sous les murs de cette ville seront coupées et disséquées pour ensuite être mises sur les murs. Le laboratoire de l’Ecole de chirurgie de cette ville a été indiqué pour faire ce travail » (…). Cependant, les officiers de santé ne paraissent pas avoir montré un bien grand empressement à répondre à la convocation car le même conseil général, trois jours plus tard, est obligé d’ annuler sa délibération ne sachant que faire des têtes : « Les citoyens Pinval et Chotard chargés de se tourner vers les représentants du peuple pour savoir ce qu’on fera des têtes déposées dans le magasin du citoyen Delaunay, que les officiers de santé ont négligé de prendre pour les disséquer, ainsi qu’ils ont été requis, et qui sentent très mauvais, rapportent que les représentants ont décidé qu’il fallait les enterrer. Il a, en conséquence, été délibéré qu’elles le seraient tout de suite… »
(p.175-176) Les prisons regorgent de prisonniers à tel point que les représetants du peuple demandent à la municipalité de Nantes un nouveau local « sûr et spacieux ». L’entrepôt des cafés, construction très vaste, est retenu. En raison de la déplorable tenue des lieux et du mauvais régime alimentaire, une épidémie de typhus s’y déclare : c’est une véritable hécatombe. En un mois 400 détenus y décèdent comme l’indique un rapport des commissaires « bienveillants » . Allard, Louis Chapetel et Robin, intitulé . « travaux pour les inhumations et enfouissement des animaux crevés ».
(p.185) Tous les districts de la Vendée insurgée se doivent de faire des recherches précises de tous les cadavres non inhumés. Ceux-ci doivent être enterrés dans des fosses profondes, recouverts de chaux vive et d’une couche de terre de trois pieds au moins. Dans le cas où des cadavres se trouveraient à l’orée d’une forêt, il faut les brûler.
Des commissaires sont même nommés pour surveiller ces inhumations. Dès le 5 février 1794, le médecin Terrier, chargé de faire enterrer « les cadavres morts par l’effet de la guerre « , signale à l’administration départementale qu’il en reste beaucoup « non enterrés ou mal « , qui infestent l’air. Il demande plusieurs fois 100 barriques de chaux « pour jeter dessus ».
(p.201-202) Depuis trois ans que les armées parcourent le pays, mettant tout à feu et à sang, les soldats ont aussi pris l’habitude de se livrer à des violences gratuites et à d’horribles abominations. On les voit couramment tuer les Vendéens, les décapiter et promener leur tête au bout d’une pique. Le général Gauvillier, commandant en chef de l’armée, s’en indigne, le 30 prairial an III : « Pour moi, c’est un crime envers l’homme, l’humanité et la générosité française. »
Rossignol, au Louroux-Béconnais donne
» plusieurs coups de sabre sur la tête d’un malheureux gui refuse de le loger et menace d’attacher toute la municipalité avec ses écharpes à des chevaux, si on ne donne pas un cheval à une femme « .
(p.202) Les humiliations quotidiennes sont aussi de règle : des « exhortations » sont adressées aux campagnes pour les habituer à travailler les jours « appelés dimanches et fêtes ». Les «signes extérieurs » de culte et de royauté sont détruits avec rage. A Aigrefeuille, les titres féodaux sont brûlés « aux cris répétés de périssent les tyrans et leurs titres ! Vive la République… ».
La liberté de libre circulation est entravée et parfois remise en question. Certains districts obligent même les femmes, les enfants et les vieillards, accusés d’espionnage et de toutes sortes de services rendus aux insurgés, à rentrer et à résider dans leurs villages incendiés.
(p.295) (…) les caractéristiques de la guerre de Vendée s’expliquent : guerre populaire, elle l’est par l’origine de ses participants; guerre rurale, elle l’est par le cadre où elle se déroule; guerre cléricale, puis religieuse, elle l’est par le mobile qui a armé le bras des Vendéens; guerre politique, elle l’est par le choix démocratique de son encadrement. En fait, cette guerre est avant tout une croisade pour la liberté individuelle, la sécurité des personnes, la conservation des biens. Face au « tyran d’oppression « , la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen rejoint saint Thomas d’Aquin pour justifier moralement l’insoumission. Son texte est sans ambiguïté (art. 35) :
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
(p.296) Les constituants pouvaient-ils soupçonner l’effet boomerang de la vieille affirmation du refus de l’arbitraire, quelle que fût son origine ? Aux yeux des Vendéens, leur révolte était, tout à la fois, et légitime, et légale, en elle-même. La Vendée devenait ainsi une force morale considérable : elle ne pouvait être vaincue que par la disproportion des forces, le poids du nombre, le temps et les massacres. La répression fut à la mesure du danger encouru par le nouveau régime. Face à une révolte populaire, c’était toute sa légitimité « populaire » qui se trouvait mise en cause. Et l’ on était en guerre.
On tua donc au nom de l’unité nationale – argument identique à celui de 1685 – de l’indivisibilité de la République, de la fraternité, de la liberté et du patriotisme. Comme l’explique Napoléon Ier, seul le délire idéologique peut expliquer cette folie meurtrière : le
Comité de Salut public n’est-il pas le « sanctuaire de la vérité ».
La finalité, froide et logique, s’impose aux dirigeants comme aux exécutants. Robespierre s’en targue devant le Comité :
» Il faut étouffer les ennemis intérieurs de la République ou périr avec elle; or, dans cette situation la première maxime de votre politique doit être qu’ on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur (…). Cette terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. »
Le génocide s’inscrit dans cette logique incontestée. Dès le 1er octobre 1793, la Convention le proclame solennellement à l’armée de l’Ouest :
« Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés; le soldat de la patrie l’exige, l’impatience du peuple français le commande, son courage doit l’accomplir (…).»
Dès lors, la mission terroriste passe avant les opérations militaires : « dépeupler la Vendée » (Francastel, 4 janvier 1794); « purger entièrement le sol de la liberté de cette race maudite » (général Beaufort, 30 janvier 1794); « exécrable », dira Minier.
Carrier se défend du moindre sentiment magnanime :
» Qu’on ne vienne donc pas nous parler d’humanité envers ces féroces Vendéens; ils seront tous exterminés; les mesures adoptées nous assurent un prompt retour à la tranquillité dans ce pays; mais il ne faut pas laisser un seul rebelle, car leur repentir ne sera jamais sincère » (…).
Vain calcul et singulière illusion politique : le retour à la tranquillité en fut d’autant retardé.
(p.297) Des témoignages hallucinants nous sont parvenus, tel celui de Le Bouvier des Mortiers19 recueilli au Luc (Vendée), au village de La Nouette :
« Une femme, pressée par les douleurs de l’accouchement, était cachée dans une masure près de ce village; des soldats la trouvèrent, lui coupèrent la langue, lui fendirent le ventre, en enlevèrent l’enfant à la pointe des baïonnettes. On entendait d’un quart de lieue les hurlements de cette malheureuse femme qui était expirante quand on arriva pour la secourir. »
(p.305) Les guerres de Vendée constituent donc une page particulièrement dramatique de notre histoire, que les gouvernements successifs, à l’exception paradoxale de Napoléon Ier, ont marginalisée, voire réduite au silence. Les contemporains ont volontairement minimisé les événements : seuls les principaux coupables sont condamnés à mort; les autres, tout en étant convaincus de complicité, sont relaxés « ne l’ayant pas fait avec des intentions criminelles » (sic). La Restauration, gênée par l’aspect de contestation subversive et par la violence de la guerre, au nom des principes édictés dans le cadre de la charte de 1814, a préféré l’oublier. Par ailleurs, les républicains trouvent extrêmement embarrassant d’ admettre que le gouvernement avait dû, en pleine révolution, signer des traités avec des pouvoirs insurrectionnels auxquels, par là même, il conférait une certaine reconnaissance. Quant aux militaires, trop souvent battus en rase campagne, la guérilla vendéenne leur a posé un problème technique et intellectuel inhabituel qu’ils ont mal maîtrisé. D’ailleurs, bon nombre de généraux, et non des moindres, se sont désistés, tels Bonaparte, d’Augereau, ou ont démissionné tels Dumas, Bard qui refuse de « procéder à des massacres organisés », ou Kléber qui « quitte son commandement devant les exigences sauvages du Comité de Salut public ». Les autres historiens, comme Michelet, font l’apologie de la terreur, considèrent les répresseurs comme des » héros », des « martyrs » auxquels on devrait dresser un monument, classent « d’inventions admirables » les méthodes retenues, conspuent les Vendéens, « ces lâches barbares ».
« La logique seule dirait que le plus cruel des deux partis était celui qui croyait venger Dieu, qui cherchait à égaler par l’infini des souffrances l’infini du crime. Les républicains, en versant le sang, n’avaient pas une vue si haute. Ils voulaient supprimer l’ennemi, rien de plus; leurs fusillades, leurs noyades étaient des moyens d’abréger la mort et non des sacrifices humains » (…).
Il est des pages plus glorieuses de Michelet et l’argumentation a été au XIXe siècle trop de fois reprise par d’autres afin de justifier l’injustifiable. La peur, sans doute, se trouve à l’origine de toute terreur : Marx l’avait bien compris, mais la peur peut-elle justifier (p.306) la volonté hautement proclamée d’ extermination ? Et la fin a-t-elle jamais justifié les moyens de qui que ce fût ? Dans les vieilles civilisations asiatiques, le meurtre de l’homme » porteur de la semence volante » est certes crime, mais non sacrilège, fût-il exécuté dans un temple; l’assassinat de la femme, en anéantissant la chaîne de la vie, est souillure irrémédiable qu’il faut expier : le lieu saint lui-même devient profané pour un temps. Cest cette volonté de faire disparaître de dessus la terre toute trace d’un peuple révolté qui contient la définition même du génocide. Que les Vendéens ne fussent pas des saints, qu’ils aient à leur passif des massacres . rien de plus logique dans l’inexorable chaîne des représailles et des contre-représailles. Rien, cependant, ne peut justifier les délires de la haine et leurs fruits pervers. Car la graine de la haine a fécondé le XXe siècle en flots de sang; ce fut l’honneur de quelques généraux de s’être refusé à verser celui des non-combattants : à la générosité de Bonchamp répond celle de Hoche pour l’honneur de l’homme. On peut cependant, avec Sainte-Beuve
« juger que le mal, les moyens violents, iniques, inhumains, même en supposant qu’ils aient eu durant le moment de crise une apparence d’utilité immédiate, laissent ensuite, en fût-ce que sur les imaginations frappées (…) de longues traces funestes, contagieuses soit en des imitations théoriques, exagérées, soit en des craintes étroites et pusillanimes ».
*PUF 1992


